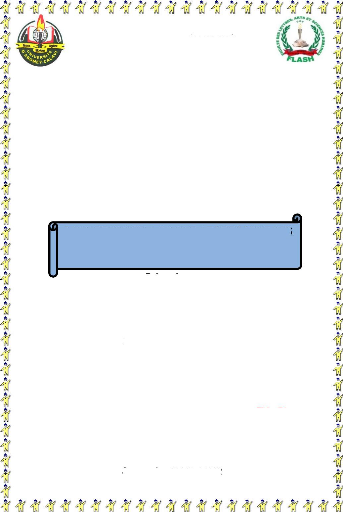
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)
FACULTE DES LETTRES, ARTS
ET SCIENCES HUMAINES
(FLASH)
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
(DGAT)
MEMOIRE DE MAITRISE
Option: Aménagement du Territoire
GOUVERNANCE LOCALE DES RESSOURCES
EN EAU DANS LA COMMUNE DE
ZE
Présenté par :
KANHONOU Arnaud
Rodrigue
Sous la direction de :
Dr. Expédit W.
VISSIN
Maître-Assistant au
DGAT/FLASH/UAC
Président du Jury : Dr VISSIN Mention :
Très-Bien
Examinateur : Dr ETENE Note : 16/20
Rapporteur : Dr VIGNINOU
Soutenu le 17 / 10 / 2012
DEDICACE
Le présent document est dédié à
o Mon père KANHONOU Atchadé Adrien et
o Ma mère DOSSOU Avlessi Victorine.
SOMMAIRE DEDICACE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2
SOMMAIRE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 SIGLES ET ACRONYMES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~ 4 REMERCIEMENTS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5
Resume/Abstract ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6
INTRODUCTION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE, CONCEPTUEL
ET
GEOGRAPHIQUE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 9
1.1. Cadre theorique de l'etude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 1.2.
Cadre conceptuel de l'etude~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 11 1.3. Cadre geographique de
l'etude~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18 CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE~~~..~~~~~~~
23
2.1. Nature des donnees~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23
2.2. Outils ou materiels de collecte de donnees~~~~~~~~~~~~~
24
2.3. Collecte des donnees~~~~~~~~~~~~~~~~. 24
2.4. Traitement de données~~~~~~~~~~~~~~~~. 27
2.5. Analyse de donnees~~~~~~~~~~~~~~~~~. 28
CHAPITRE III : RESULTATS ET SUGGESTIONS.~~~~~~~~~~ 29 3.1. Etat
des lieux des ressources en eau de la commune de Ze 29
3.2. Acteurs de la
gouvernance locale des ressources en eau de la commune de
Ze~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 40
3.3. Gouvernance locale des ressources en eau dans la commune de
Ze 54
3.4. Suggestions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61
CONCLUSION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..
65
Bibliographie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. 67
Liste des figures, photos et tableaux 71
Annexe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 72
SIGLES ET ACRONYMES
AERAMR : l'Association pour Etude et
Réalisation des Aménagements en Milieu Rural
AOC : Alfa Omega Consultants
AUE : Association des Usagers d'Eau
ASE : l'Association pour la Santé et
l'Education
ASECNA : Agence pour la Sécurité
de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
BDI : Base de Données
Intégrées
CGPE : Comités de Gestion des Points
d'Eau
DED : Direction des Etudes
Démographiques
DG-Eau : Direction Générale de
l'Eau
FAO : Sigle de Food and Agriculture
Organization, « Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture ».
GIRE : Gestion Intégrée des
Ressources en Eau
GWP/AO : Partenariat Mondial de l'Eau / Afrique
de l'Ouest
INSAE : Institut National de la Statistique et
de l'Analyse Economique LACEEDE : Laboratoire Pierre PAGNEY,
Climat, Eau, Écosystème et Développement
MMEE : Ministère des Mines, de l'Energie
et de l'Eau
MSPCL : Ministère de la
Sécurité Publique et des Collectivités Locales
PADEAR : Programme d'Assistance au Développement du
Secteur de l'Eau et de l'Assainissement en Milieu Rural
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PPEA : Programme Pluriannuel Eau et
Assainissement
SGEEF : Société
Générale d'Energie Electrique et Fluides
SNAEMR : Stratégie Nationale
d'Approvisionnement en Eau en Milieu Rural SNGRE :
Stratégie Nationale de Gestion des Ressources en Eau
SONADER : Société Nationale pour
le Développement Rural
REMERCIEMENTS
Au terme de cette recherche, qu'il nous soit permis d'exprimer
notre gratitude à tous ceux qui nous ont soutenu à divers
niveau.
Nous rendons un hommage sincère à tous les
enseignants du DGAT dont les qualifications intellectuelles nous ont
forgé et armé pour la vie.
Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance
à notre directeur de mémoire le Docteur Expédit W. VISSIN
qui, malgré ses multiples occupations, n'a ménagé aucun
effort à nous encadrer. Qu'il reçoive ici notre profonde
reconnaissance tant pour son sens du partage du savoir que pour sa patience.
Au Docteur AKOUEHOU Gaston, qui a accepté suivre nos
diverses analyses avec un grand engouement.
En effet, nous témoignons notre reconnaissance à
tous ceux qui nous ont offert leur soutien tant moral, spirituel que financier.
Il s'agit de AKOGNONGBE Arsène et de KOUMASSI Hervé.
Que tous nos amis, frère et soeurs : Judicaël,
Inès, Elodie, Géraud et Gérald, Rose et Rosette,
Charlotte, Euloge, Perrin, Rodrigue et Asthène avec qui nous avons
cheminé ensemble, trouvent ici la marque de sympathie de notre part pour
la franche collaboration et l'assistance dont ils ont fait preuve tout au long
de ce cursus.
A tous les ménages, gestionnaires d'eau, élus
locaux de la commune de Zè, qui nous ont accordé leur temps, leur
savoir et leur hospitalité.
Enfin, au-delà de toute chose, que la grâce et la
louange soient rendues au Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait
pour nous.
RESUME
La commune de Zè est confrontée à
d'énormes problèmes de gestion hydraulique liés au mauvais
usage des modes de gestion des ressources en eau. La présente recherche
vise à faire l'inventaire des ressources en eau du secteur
d'étude et à contribuer à une meilleure gouvernance locale
des ressources en eau.
Pour mener cette étude, la documentation, les
investigations en milieu réel et l'observation ont été
utilisées comme techniques pour la collecte des données et
informations.
Au total, 248 points d'eau sont présents sur le
territoire de la commune et sont inégalement répartis dans les
arrondissements. Cette mauvaise gouvernance due à la mauvaise
application des modes de gestion entraîne la mauvaise répartition
des ressources en eau. Pour résoudre ce problème, l'étude
propose des stratégies telles que l'association des populations à
la base à la gestion des ressources en eau, la sensibilisation des
acteurs et utilisateurs..
Mots clés : Zè, gouvernance
locale, ressource en eau, autorités locales.
ABSTRACT
Zè Land is confrontated of much issues of hydraulic
management related of the worst usage of the different ways of the water
resources management. The research in that case obvious to outline in this
sector of work water resources, which contributes in one performance local
governance in water resources.
Managing of such kind of work, the documentation, the
investigations in this real land and the observation have been used as
technical for the gathering of informations and data.
Definitely, 248 hydraulic infrastructures after work available
on Zè Land are not well share in its districts. This worst distribution
drive to the worst local governance of water resources. Over come to such
issues, the work has been done, propose such strategies like gathering the
inherit populations of the resources in water management and the
sensibilization of user and actors....
Key words: Zè, Local governance, water
resource, local authorities.
INTRODUCTION
L'eau est une ressource limitée et vulnérable,
indispensable à la vie, au développement et à
l'environnement (Azonsi et al, 2009).
Les changements climatiques et les processus migratoires
soulèvent de nouveaux défis pour l'accès à l'eau au
Sahel car la concurrence sur les ressources en eau à des fins agricoles
augmente (Baron et al, 2008).
La consommation d'eau dans le monde a plus que triplé
en cinquante ans, en raison de la croissance démographique importante et
des besoins croissants de la population en eau (Mathieu et al,
2001)
Le Bénin reçoit entre 700 à 1400 mm par an
de précipitations réparties sur 70 à 110 jours dans
l'année (MEPN, 2008).
La ressource eau, malgré son existence en termes de
quantité constitue une source de problèmes aux communautés
locales. Sa rareté et les déficits critiques liés à
la satisfaction équitable des besoins sont souvent source de
tragédie. Aussi, la pérennisation des ressources en eau est
devenue un sujet d'intérêt national dans le cadre du
développement durable et de la gestion intégrée des
ressources en eau (Boko, 2009).
L'accès aux ressources en eau et la bonne gouvernance
de ceux-ci sont des facteurs déterminants du développement
économique, social et local (CARE International, 2007).
Avec la décentralisation, c'est la collectivité
locale qui prend en charge la gouvernance des ressources en eau. C'est au
niveau local que s'organisent donc la mise en oeuvre et la gouvernance des
ressources en eau. Pour ce faire, les autorités locales ont la
responsabilité de répondre aux attentes de leur population, en
associant tous les acteurs à la gestion de l'eau (Amadou, 2009).
Dans la commune de Zè, les populations utilisent l'eau
dans diverses activités telles que l'utilisation domestique,
l'approvisionnement en eau potable, les besoins des petites unités de
transformation et l'irrigation des cultures. L'inefficacité des
structures de gestion des ressources en eau, la mauvaise
gouvernance des ressources en eau sont des problèmes que
rencontre la population Zè.
La présente recherche menée à travers le
thème « Gouvernance locale des ressources en eau dans la
commune de Zè » vise à contribuer à une
meilleure connaissance des différentes ressources en eau dans la Commune
de Zè, le mode de gouvernance utilisé pour gérer les
ressources disponibles et les problèmes liés à cette
gouvernance.
Le contenu du mémoire s'articule autour de trois chapitres
à savoir :
· le premier chapitre présente les cadres
théorique, conceptuel et géographique du secteur d'étude
;
· le deuxième résume la méthodologie
adoptée pour atteindre les objectifs fixés ;
· le troisième chapitre expose les résultats
obtenus et les suggestions.
CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE, CONCEPTUEL ET
GEOGRAPHIQUE
Ce chapitre présente la problématique, les
objectifs et hypothèses sur lesquels se fondent cette étude d'une
part et d'autre part les traits caractéristiques du milieu de la Commune
de Zè.
1.1. Cadre théorique de l'étude
1.1.1. Problématique
L'accès aux ressources en eau dans les villages,
quartiers de ville et les communes, a été un défi majeur
dans la mise en oeuvre de la décentralisation et de la gouvernance
locale.
D'après Vissin (2007), la terre est la seule
planète du système solaire à disposer grace à sa
position prolongée, d'eau liquide à la surface.
L'eau est relativement abondante sur la planète, mais
sous l'effet de la croissance démographique galopante observée
ces dernières années, on assiste à l'utilisation abusive
de la ressource (Mathieu et al, 2001).
Dès lors, le problème de la gestion des
ressources en eau par les autorités locales se pose avec acuité
et occupe désormais une partie importante des débats de la GIRE
(Baron et al, 2008). Dans les années 1990, le Bénin
s'est engagé dans un vaste processus de réflexion sur la
gouvernance locale des ressources en eau menée dans les communes (Azonsi
et al, 2009).
Les dernières lois sur l'eau adoptées dans
plusieurs pays méditerranéens se fixent des objectifs de gestion
durable et de gouvernance locale, qui seraient permises par une gestion plus
locale, favorisant la concertation et le développement communautaire
(Fateha, 2010).
Aussi, dans le domaine de la gestion des ressources en eau,
la «bonne gouvernance locale » renvoie à un modèle,
dont les règles ont été élaborées au niveau
global lors de diverses conférences (Consultation de New Delhi en
septembre 1990, Conférence de Dublin en janvier 1992, sommet de
Johannesburg en juin 2002) et dont la mise en oeuvre est
censée reposer sur l'adhésion des acteurs locaux et les
utilisateurs des ressources en eau.
Selon Baron et al (2008), la gouvernance locale des
ressources en eau combine une action collective entre la population et les
autorités locales. Quant aux communes, les textes de lois sur la
décentralisation prévoient leur réelle implication dans la
mise en place des infrastructures hydrauliques sur leur territoire (Hounmenou,
2006).
L'implication des populations dans le choix du niveau de
service et le mode de gestion a été un facteur déclencheur
du développement local (CARE International, 2007).
L'approche GIRE appliquée à la gestion des
ressources en eau à l'échelle des communes de Toffo et d'Allada
diagnostique les problèmes suivants: la mauvaise gouvernance locale des
ressources en eau, la mauvaise exploitation de l'eau,
l'inéquitabilité des installations d'ouvrages d'eau d'un
arrondissement à un autre, la mauvaise gestion des cotisations des fonds
de l'eau... (Egounlety et al, 2008).
La Commune de Zè qui fait l'objet de cette
étude n'est pas en marge de ces problèmes. A cet effet, le
présent travail se veut une contribution à l'amélioration
des modes de gestion des ressources en eau dans ladite commune afin de
résoudre les problèmes liées à la gouvernance
locale des ressources en eau. Une telle étude suscite les questions
suivantes :
- quels sont les acteurs intervenant dans la gestion des
ressources en eau
dans la commune de Zè ?
- la gestion des ressources en eau est-elle efficace ?
- quelles sont les mesures à prendre pour assurer une
meilleure
gouvernance des ressources en eau dans la commune de Zè
?
C'est pour répondre à ces interrogations, que le
sujet : « Gouvernance locale des ressources en eau dans la commune
de Zè » a été choisie.
1.1.2. Hypothèses
Les hypothèses de recherche qui sous-tendent cette
étude sont:
'V dans le contexte actuel de la décentralisation, de
nouveaux acteurs interviennent dans la gestion des ressources en eau à
Zè ;
v' les ressources en eau ne sont pas bien gérer dans la
commune de Zè ;
v' des solutions existent pour améliorer la gouvernance
locale des ressources en eau faite dans la commune de Zè.
Pour vérifier ces hypothèses, des objectifs de
travail ont été fixés.
1.1.3. Objectifs
1.1.3.1. Objectif général
L'objectif général de cette étude est de
contribuer à une meilleure gouvernance locale des ressources en eau dans
la commune de Zè.
1.1.3.2. Objectifs spécifiques
Spécifiquement, il s'agit de :
v' identifier les différents acteurs intervenant dans la
gouvernance locale des ressources en eau ;
v' analyser les modes de gestion locale des ressources en eau
;
v' proposer des mesures pour améliorer la gestion locale
des ressources en eau pour un développement local durable.
1.2. Cadre conceptuel de l'étude
1.2.1. Définition opératoire
- Gouvernance locale :
La gouvernance locale est l'ensemble des règles,
procédures, institutions et mécanismes mis en place en dehors de
l'Etat, pour permettre aux citoyens d'exprimer leurs intérêts,
d'exercer leurs droits et de participer au processus de
prise de décisions, à l'exercice du pouvoir et de
gestion des ressources dont ils disposent (Amadou, 2009).
Dans cette étude, la gouvernance locale est l'ensemble
des dispositions et des actions visant à protéger et à
améliorer la gestion les ressources en eau de la commune par les
autorités locales, les gestionnaires d'ouvrages hydrauliques et la
population à la base en vue de leur exploitation rationnelle.
- Décentralisation
Au sens large, la décentralisation consiste en un
transfert de pouvoirs entre deux personnes morales distinctes (Adomou, 2008).
Mais, nous voulons, dans le cadre de la présente étude, parler
plus précisément de la décentralisation territoriale qui a
été instituée au Bénin depuis les élections
municipales de décembre 2002. Elle vise à donner aux
collectivités locales (les communes) des compétences propres
distinctes de celles de l'Etat par le rapprochement du processus de prise de
décision des citoyens favorisant l'émergence d'une
démarche de proximité.
- Ressource en eau :
L'idée de la ressource en eau fait appel à
toutes les disponibilités en eau, aussi bien souterraines que
superficielles de la terre pouvant faire l'objet d'une exploitation (Boko,
2009).
Dans le cadre de cette recherche, la ressource en eau
comprend donc les eaux atmosphériques (eau de pluie) les eaux
superficielles (les bas-fonds, les cours d'eau) et les eaux souterraines(les
puits, les forages, les points d'eau aménagée) de la
localité, utiles et disponibles pour l'homme et les
écosystèmes.
- Autorités locales :
Les lois sur la décentralisation transfèrent aux
autorités locales un certain nombre de pouvoir et de compétences
liés à la gestion de l'eau. Les autorités
locales ont la lourde responsabilité d'assurer le
développement économique durable et équilibré de
leurs territoires à travers notamment l'utilisation et la gestion
rationnelle des ressources hydriques (GWP/AO, 2009).
Dans le cadre de cette étude, une autorité
locale est toute personne physique qui a en charge, l'ensemble des dispositions
de gestion et de protection des ressources en eau de sa commune.
1.2.2. Point des connaissances
La problématique de la gouvernance locale des
ressources en eau est une question cruciale dans le processus du
développement local durable. Pour remédier aux problèmes
de gestion et de gouvernance de l'eau au Bénin, beaucoup d'études
ont été menées. Flles ont été
consacrées surtout aux modes de gestions utilisés, les acteurs de
la gestion des ressources en eau et aux techniques de gestion des ressources en
eau utilisée de part et d'autre sur le territoire.
Boko (2009), montre que la
responsabilité effective des populations à la base est l'une des
conditions incontournables pour accroître les chances de succès
d'un développement qui ne peut ni s'administrer, ni s'imposer tout
simplement parce qu'on ne développe pas, mais on se développe.
Pour lui, parmi les principaux problèmes qui freinent le
développement à la base, on note en bonne place celui de l'eau.
Il note enfin que la gestion sectorielle des ressources en eau,
caractérisée par une multiplicité des centres de
décision, la faible implication des acteurs et des usagers dans la prise
de décision et la gestion des conflits entre agriculteurs et pasteurs
sont à la base de la mauvaise gestion des ressources en eau dans la
vallée de l'Ouémé.
Pour Adomou (2008), il serait plus judicieux
de concrétiser d'abord la maîtrise d'ouvrage hydraulique communale
de chaque point d'eau par la signature avec les gestionnaires actuels des
cahiers de charges stipulant clairement leurs droits et obligations et la prise
de mesures limitant le développement des surcoûts de
gestion avant d'envisager la gestion professionnalisée
qui consistera à recruter des gestionnaires qualifiés. De toute
façon, la professionnalisation du service d'approvisionnement en eau
doit être entendue comme un processus et non une panacée
imposée une fois pour toutes dans la précipitation.
Boko (2012), dans son étude portant
sur : « la contribution à la mobilisation et à la gestion
des eaux pluviales dans l'arrondissement de Banikoara », propose que les
modes de gestion des eaux pluviales doivent passer notamment par la
modification des techniques culturales au niveau des versants et la
mobilisation des eaux de pluies. Pour l'auteur, la meilleure gestion des eaux
passe par un suivi rationnel des techniques de gestion par les populations de
la commune.
Pour Kpohonsito (2007), la
problématique de l'approvisionnement en eau potable dans la commune de
Bopa réside dans le fait que les communautés ne se sont pas
véritablement approprié la gestion des points d'eau mis à
leur disposition. Il note aussi, que la mauvaise gestion des points d'eau est
liée aux modes de gestion utilisés par la commune.
Selon Hounmènou (2006), l'implication
active des populations bénéficiaires dans la gestion des
équipements hydrauliques, constitue actuellement une sérieuse
option, visant à favoriser leur accès durable. Cette implication
passe, dans une large mesure, par l'émergence au sein de ces
populations, de structures
de gestion chargées de l'entretien et de la maintenance
des équipements. Iitrouve aussi que le mode de gestion
concertée serait plus efficace dans les
communes du Bénin.
Yelouassi, 2011, identifie parmi les acteurs
fondamentaux de la gestion des ressources en eaux, deux acteurs fondamentaux
dans la commune d'Athiémé : la Mairie et le Fermier. La Mairie
recrute le fermier pour assurer la distribution par vente de l'eau des
châteaux. L'auteur trouve que les activités du fermier ne sont pas
couronnées de réussites et sont donc jonchées de
difficultés récurrentes qui ne facilitent pas la bonne gestion
des équipements hydrauliques. Aussi pour des
solutions idoines, l'auteur prévoit un dialogue entre
les responsables municipaux et les fermiers pour une meilleure gestion.
Par contre, Koudamiloro, 2011, identifie
quatre acteurs dans la gestion des ressources en eau à Challa-Ogoï
: il s'agit des autorités communales, des ONG, des Associations de
Développement et de la population. Selon l'auteur, les solutions pour
améliorer la gestion des ressources en eau de la localité passent
par l'association de ces différents acteurs qui doivent penser à
l'identification des zones non desservies et à la réalisation de
nouveaux ouvrages. Ils doivent également réparer les pompes en
panne et ravitailler périodiquement le magasin de la mairie en
pièces de rechange des ouvrages hydrauliques.
Chleq et al, (1997) et Geny P.,
(1992) ont élaboré un guide de gestion des
ressources naturelles à partir de l'étude des relations de
l'homme avec l'environnement, de l'analyse des ressources naturelles des
composantes de l'environnement et des stratégies de gestion des
ressources en eau. Ces auteurs pensent que la gestion durable des ressources en
eau d'une localité dépend des modes de gestion utilisée
dans cette localité.
Enfin, Yamongbe (2011) souligne dans son
mémoire de maîtrise que les problèmes de gestion hydrique
que rencontre la commune de Zè sont liés à la mauvaise
utilisation des modes de gestion des ressources en eau et aux manques
d'entretien des points d'eau par la population. Il fait d'abord l'état
des lieux des sources d'approvisionnement de la commune et a montré
ensuite que la multiplicité des sources d'approvisionnement doit
bénéficier d'une gestion particulière des utilisateurs.
L'auteur pense que les propositions de solution à préconiser
comporteront : l'accessibilité à l'eau potable, la
sensibilisation des populations pour l'adoption de meilleure politique de
gestion des eaux dans la commune de Zè.
Après cette littérature, il est important de
souligner que ces différents auteurs ont étudié les
acteurs de la gestion des ressources en eau, les différentes
possibilités de mobilisation et de gestion des eaux et l'impact de la
mauvaise
gestion sur la population ainsi que les propositions de
solution pour améliorer la gestion de l'eau. Cependant, l'accent n'a pas
été mis sur le rôle de la population locale dans la gestion
des ressources en eau et les problèmes liés aux mauvais usages
des modes de gestion des ressources en eau dans la gouvernance locale.
La présente recherche s'évertue à
montrer de façon spécifique, les avantages d'une bonne
gouvernance locale des ressources en eau disponible dans la commune de
Zè à travers l'association des populations à la base.
1.2.3. Cadre conceptuel de l'étude
L'eau était considérée comme un bien
commun ouvert c'est-à-dire un bien dont l'utilisation à
volonté et gratuite n'est régie par aucune règle. Avec
cette liberté d'accès, la tentation pour les usagers d'en abuser
est très grande. Tout individu pouvait utiliser la ressource publique
d'eau potable sans se préoccuper de la durabilité,
c'est-à-dire de l'entretien, ni du renouvellement de
l'équipement.
Dans ce contexte, les populations ne pouvaient que compter
sur la providence étatique pour un fonctionnement continu du
système. Il apparaît donc clair que compte tenu des moyens
très limités de l'Etat et de sa sollicitude multisectorielle,
qu'il ne peut accomplir continuellement une telle mission.
C'est ainsi que les installations hydrauliques dans presque
toutes les zones rurales du Bénin sont tombées dans une situation
de panne irréversible et leurs usagers (les populations) ont dû
recourir aux anciennes sources impropres à la consommation que
constituaient les eaux de surface (marigots, mares, digues de fortune, etc.)
(Adomou, 2008).
Il a fallu attendre les années 1980 pour voir la
réalisation des premiers projets de construction de puits modernes, de
Forages à Motricité Humaine et d'Adduction d'Eau Villageoise.
Bien qu'en cette période une prise de conscience est née de la
part de l'Etat et de ses partenaires techniques et financiers, les ouvrages
hydrauliques en grande majorité ont été construits en
milieu rural sur la seule initiative des pouvoirs publics sans une implication
suffisante des
communautés bénéficiaires, qui de ce fait,
ne sont préparées ni à leur entretien ni à leur
gestion (Hounmènou, 2006).
L'Etat et les collectivités territoriales, dans leurs
domaines respectifs de compétences, veillent à la gestion durable
de l'eau, en vue d'en garantir aux usagers un accès équitable.
L'Article 10 de la Loi n° 2010-44 portant gestion de l'eau en
République du Bénin stipule que : « Les décisions
relatives à la gestion de l'eau sont prises, selon le cas, par les
autorités compétentes aux niveaux national, départemental,
ou communal, en concertation avec les institutions de base et les usagers
organisés en groupes d'intérêt, sous réserve
qu'aucune considération d'intérêt général ou
d'efficacité ne s'y oppose ».
Avec la décentralisation, de nouveaux acteurs
interviennent dans la gestion des ressources en eau. Les collectivités
locales auxquelles les lois sur la décentralisation transfèrent
un certain nombre de compétences liées à la gestion de
l'eau ; le secteur privé : joue un rôle d'appui à la
réalisation et la gestion d'infrastructures hydrauliques indispensables
à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais ce
secteur n'est pas encore réellement impliqué dans les aspects
liés à la gouvernance de l'eau. L'implication de toutes les
catégories d'acteurs ne peut donc qu'être progressive : il s'agit
des Organisations Non Gouvernementales (ONG) nationales et internationales, la
société civile et les partenaires au développement. Il
faut souligner que chacun de ces acteurs travaille avec les structures ou
comités villageoises pour la gouvernance de leur ressource en eau
(GWP/AO, 2009).
Les besoins en eau pour les communautés locales sont
désormais assurés en milieu rural par la DG-Eau et en milieu
urbain par la SONEB. Cet approvisionnement est réalisé
grâce à la mobilisation des ressources en eau souterraines et de
surface. Ces eaux sont donc mobilisées à travers la
réalisation des FPM, des AEV et BF, des PEA et des Puits Modernes.
(Djoï, 2011).
L'aperçu de l'évolution conceptuelle des
ressources en eau, permettra d'aborder le cadre spécifique de la commune
de Zè.
1.3. Cadre géographique de l'étude
Le cadre géographique présente les
différents traits physiques, humains et économiques qui
caractérisent la commune de Zè.
1.3.1. Milieu d'étude
La commune de Zè, est l'une des 08 subdivisions
administratives du département de l'Atlantique, comprise entre 6°32
et 6°87 de latitude Nord d'une part et entre 2°13 et 2° 26 de
longitude Est d'autre part. Avec une superficie de 653km2, Zè
est limité au Nord par les communes de Zogbodomey (Zou) et Toffo. Au sud
par les communes d'Abomey-Calavi et de Tori-Bossito ; à l'Est par les
communes d'Adjohoun, de Bonou (Ouémé) et à l'Ouest par la
commune d'Allada (Mairie de Zè, 2006).
Le secteur d'étude compte onze (11) arrondissements
qui sont : Adjan, Dawé, Djigbé, Dodji-Bata,
Hèkanmè, Koundokpoé, Sèdjè-Dénou,
Sèdjè-Houègoudo, Tangbo-Djèvié, Yokpo et
Zè (RGPH, 2002).
Le réseau hydrographique est peu dense et très
localisé. Seule la zone nord de la commune est irriguée par des
affluents du fleuve Ouémé tel que la Sô. Plusieurs
bas-fonds, lacs, marais, cours d'eau parsèment le territoire de la
commune (DED, 2005).
La figure 1 présente la situation géographique des
ressources en eau de la commune de Zè.
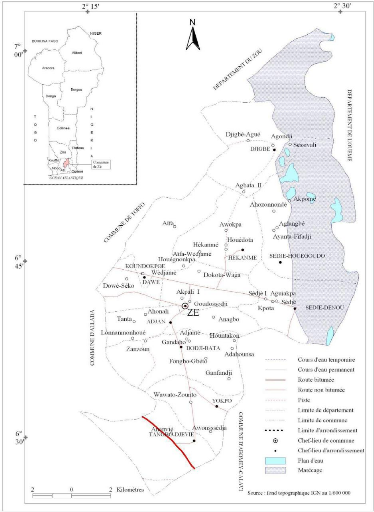
Figure 1: Situation géographique des
ressources en eau de la commune de Zè
1.3.2. Relief et climat
Le relief est un facteur déterminant pour
l'accès aux ressources en eau. Le relief de la Commune de Zè est
un élément du vaste plateau d'Allada, d'une altitude moyenne de
100 m qui s'incline légèrement vers la côte et surplombe au
Nord, la dépression de la Lama. Il est composé de quelques
petites dépressions constituées de bas-fonds. Les formations
géologiques qui composent ce relief sont constituées
essentiellement de dépôts sablo-argileux altérés en
faciès de terre de barre (Fahala et al, 2009).
Le climat est l'ensemble des moyennes concernant la
température, les précipitations et les vents (Pierre et
al, 1998). La mousson, qui est un vent humide venant du sud-ouest du
Bénin, apporte la pluie tandis que l'alizé du nord-est souffle
pendant la grande saison sèche (Adam et al, 1983). Le climat de
Zè est de type béninien, marqué par des hauteurs
pluviométriques plus ou moins élevées, une amplitude
thermique annuelle relativement faible (inférieure à 5°C) et
par la succession de quatre saisons distinctes (Mairie de Zè, 2005),
comme l'indique la figure ci dessus:
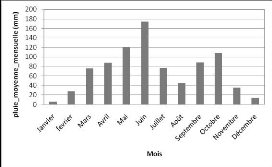
Figure 2: Régime pluviométrique
moyen mensuel de Zè de 1965 à 2008
Source :
ASECNA, 2011
L'analyse de la figure 2 montre une succession de saisons qui
se présente comme suit : une grande saison pluvieuse d'Avril à
Juillet ; une petite saison pluvieuse de Septembre à Novembre ; une
grande saison sèche de Décembre à Mars et une petite
saison sèche centrée sur le mois d'Août. Au cours de la
petite
saison pluvieuse et la grande saison pluvieuse, la population
utilise l'eau de pluie qu'elle recueille dans les jarres, les bidons, les
plastiques et les citernes.
1.3.3. Sol et végétation
Le caractère des sols permet la
perméabilité de l'eau et la disponibilité de l'eau pour
les populations. Le territoire de la Commune est dominé par les sols
faiblement ferralitiques communément appelés terre de barre. Ces
terres sont de teinte rouge et servent de support à toutes les cultures
pluviales. Les sols hydromorphes à horizon superficiel gris assez riche
constituent le substrat des
plans d'eau et des bas-fonds observés à
Djigbé et à Sèdjè-Dénou. Mairie de
Zè(2006).
La végétation favorise les
précipitations. PACT (2010). Le couvert végétal de la
commune de Zè, s'articule autour de quatre ensembles à savoir :
les forêts claires et formations boisées dont la forêt
classée de Djigbé (3441 ha), les formations arborées et
arbustives, les formations aquatiques et les plantations d'Elaeis
guineensis (palmier à huile) d'une superficie de 3056 ha
installées par la SONADER et gérées actuellement par des
Coopératives d'Aménagement Rural (CAR). On peut y rencontrer des
espèces telles que Milicia Excelsa (Iroko), Ceiba
pentendra (Fromager), Adansonia digitata (baobab), Nymphea
Lotus etc. La photo1 présente l'aspect d'une piste rurale et la
couverture végétale dans la commune de Zè.

Photo1 : piste rurale de Goulo en saison
pluvieuse.
Prise de vue : KANHONOU, Juillet
2011
1.3.4. Population et activités
économiques
L'eau constitue un bien considéré à
l'instar de l'air, comme essentiel à la vie humaine. Les villageois sont
prêts à consentir une contribution financière majeure, afin
de s'assurer une source locale en eau potable. Les modes de consommation et de
production de l'eau subissent en général de nombreuses et
importantes transformations, faisant ainsi évoluer de façon
manifeste, la place de cette ressource dans le système économique
et social (Hounmenou, 2006).
D'après le Recensement Général de la
Population et de l'Habitation (RGPH) de 2002 la population de la Commune de
Zè est estimée à 72.814 hts soit 9,08 % de la population
du département de l'Atlantique avec un taux d'accroissement de 2,78 %.
D'une densité de 112hts/km2 soit la plus faible du
département, elle est composée de 34.898 hommes et de 37.916
femmes et est à majorité rurale (84,92 %) (INSAE, 2002).
L'analyse de tous les secteurs productifs et générateurs de
revenus et d'emplois montre que l'économie de la Commune de Zè
est dominée par le secteur primaire dont les plus importantes
activités sont : l'agriculture et la transformation agroalimentaire
(AOC, 2006). D'autres activités telles que le commerce, l'artisanat, la
pêche, l'élevage et la vente de l'eau par les fontainiers sont non
négligeables. La population utilise les ressources en eau pour mener ces
activités économiques.
Chapitre II : APPROCHE METHODOLOGIQUE
La démarche méthodologique adoptée pour
conduire cette étude comprend : la recherche documentaire, la collecte
des données, les travaux de terrain, l'analyse et le traitement des
données collectées.
2.1. Nature des données :
De toutes les données collectées, seules les
hauteurs de pluies comportent des lacunes. Ainsi, sur l'ensemble de la station
(Annexe IV) considérée, 10 années présentent des
données manquantes. Ces données ont donc été
comblées par une interpolation linéaire simple. Elles se
présentent comme suit :
· Les données
pluviométriques
Il s'agit des chroniques pluviométriques extraites de
la base de données de l'ASECNA et du LACEEDE. Elles sont
constituées des hauteurs pluviométriques maximales annuelles de
la période de 1965 à 2008.
· Les données
démographiques
Il s'agit des statistiques démographiques du RGPH3 de
Zè reçue à l'INSAE qui ont permis de connaitre l'effectif
des ménages de la commune de Zè ;
· Les données
socio-anthropologiques
Ce sont les informations relatives aux acteurs du secteur de
l'eau, le mode de gestion, les contraintes, les problèmes que
rencontrent les acteurs de l'eau et les suggestions apportées par ces
derniers sur la base d'un questionnaire établi au préalable.
2.2. Outils ou matériels de collecte des
données
Plusieurs outils ont servi à la collecte des
données. Il s'agit de :
· des questionnaires adressés aux populations,
autorités locales et aux acteurs en charge de la gestion des ressources
en eau, pour recueillir les informations relatives aux aspects physiques,
humains, les infrastructures hydrauliques et les stratégies de
résolution des problèmes liés à leur commune ;
· un guide d'entretien qui a permis de recueillir les
informations relatives aux informations géographiques,
démographiques et organisationnelles. Il est adressé aux
autorités locales et aux personnes en charge de la gestion des
ressources en eau dans la commune ;
· un guide d'observation, c'est un tableau qui a permis de
recenser le type, l'accessibilité et la fréquentation de
l'ouvrage hydraulique sur le terrain ;
· l'appareil photo numérique a permis de prendre
les images des différents types d'ouvrages hydrauliques et sources
d'approvisionnement en eau présents dans l'ensemble de la commune ;
· le Global Positioning System (GPS) a permis de situer
les ouvrages hydrauliques sur la carte de situation des ouvrages d'hydrauliques
grace aux coordonnées géographiques.
2.3. Techniques de collecte de données
Elles regroupent la recherche documentaire, la
pré-enquete, l'enquête et l'échantillonnage.
2.3.1. Recherche documentaire
Elle a permis de faire le point de l'ensemble des ouvrages et
de mieux cerner les contours du sujet et d'orienter les questions à
poser aux groupes cibles. Il s'agit des ouvrages scientifiques et
généraux tels que les mémoires, les thèses et les
rapports d'activités consultés dans divers centres de
documentation Le tableau I résume les centres et les types
d'informations collectées.
Tableau I : Documentation
Structure de la
documentation
|
Nature des documents consultés
|
Type d'information
|
Bibliothèque de l'UAC
|
Mémoire, rapport et thèses
|
Information générale à
caractère méthodologique
|
Africa Rice
|
Revues et ouvrages généraux
|
Information sur la gestion de l'eau dans l'agriculture
|
ASECNA/ LACEEDE
|
Rapport sur les relevées
pluviométriques
|
Données pluviométriques
|
INSAE
|
Rapports et les articles
|
Données statistiques sur la
démographie de Zè
|
Centre de documentation de la FLASH et de l'ABE
|
Mémoires et thèses
|
Information à caractère
méthodologique
|
Direction générale de
l'hydraulique Atlantique/Littoral
|
Guides et ouvrages hydrauliques
|
Information sur la répartition
des ouvrages
hydrauliques de
Zè, les modes de gestion des
ressources en eau dans la
commune
|
ONG-AERAMR
|
Rapport annuel d'activité
|
Données sur les ouvrages
hydrauliques réalisés et les
réalisations de l'ONG dans la commune.
|
Mairie de Zè
|
P.D.C et Rapport d'activité
|
Information générale sur Zè.
|
|
Source : Enquête de terrain,
Juillet 2011
2.3.2. La pré-enquête
Elle a permis de se familiariser avec le milieu
d'étude, la population de Zè en général et à
identifier les acteurs intervenant dans la gestion des ressources en eau dans
la commune. Elle a permis aussi de constater les problèmes et de
repréciser le questionnaire d'enquête.
2.3.3. Enquête de terrain
L'enquête proprement dite a couvert deux
périodes bien définies (saison sèche et saison pluvieuse)
pendant lesquelles les personnes ciblées (les autorités locales,
les gestionnaires d'eau et les ménages) ont été
questionnées. L'enquête a été rigoureusement
menée dans tous les arrondissements de la commune à l'aide des
questionnaires d'enquête et les guides d'entretien.
2.3.4. Echantillonnage
L'échantillon a été
déterminé par la méthode probabiliste et la technique de
choix aléatoire et proportionnellement à la taille des
ménages sur la base d'un certain nombre de critères.
En effet, les personnes interrogées ont au moins dix
huit (18) ans et soixante (60) ans au plus. Les groupes cibles sont
constitués des ménages ciblés dans la commune, des
personnes âgées, sages et notables, des personnes ressources
impliquées dans la gouvernance des ressources en eau dans la commune
(techniciens et ingénieurs de la DG-Eau, de la Direction
Départementale de l'Eau d'Abomey-Calavi, les ONG intervenant dans le
domaine, les fermiers et les fontainiers).
L'échantillon a été
déterminé à partir de l'effectif de chaque arrondissement,
notamment de chaque ménage. La taille de l'échantillon a
été déterminée en suivant la méthode de
SCHWARTZ (2002). Elle a été calculée avec un degré
de confiance de 95 % et une marge d'erreur de plus ou moins 5 %.
N = Zá2. P Q / d2
avec
N= taille de l'échantillon par arrondissement
Zá = écart fixé à 1,96 correspondant
à un degré de confiance de 95 %
P = nombre de ménages de l'arrondissement / nombre
ménages de la commune.
Q = 1 -- P
d = marge d'erreur qui est égale à 5 %
En procédant ainsi par arrondissement, un taux
d'échantillonnage de 5 % est appliqué au résultat pour
déterminer le nombre exact de ménages à enquêter par
arrondissement. Le tableau II présente la répartition des
personnes enquêtées par arrondissement.
Tableau II : Répartition des
ménages enquêtés
Arrondissements
|
Nombre de ménages (2002)
|
Echantillon enquêté
|
Taux (%)
|
Adjan
|
992
|
16
|
8
|
Dawé
|
798
|
13
|
6
|
Djigbé
|
747
|
12
|
6
|
Dodji-Bata
|
1667
|
25
|
12
|
Hekanmè
|
1493
|
23
|
11
|
Koundokpoé
|
1225
|
19
|
9
|
Sèdjè-Dénou
|
1037
|
16
|
8
|
Sèdjè-Houègoudo
|
847
|
14
|
7
|
Tangbo-Djèvié
|
1708
|
26
|
12
|
Yokpo
|
770
|
12
|
6
|
Zè
|
2174
|
31
|
15
|
TOTAL
|
13458
|
207
|
100
|
|
Source : INSAE, Enquête de terrain,
2011
Le tableau II montre la répartition par arrondissement
du nombre de ménages, de l'échantillon enquêté et le
taux d'échantillonnage. Au total donc, soit 207 ménages ont
été interrogés sur 13458 que comptent les onze
arrondissements de la commune de Zè. Ce qui représente environ 5
% du nombre de ménages total de la Commune.
2.4. Traitement des données
Les données collectées ont fait l'objet d'une
codification et d'un dépouillement manuel. Elles ont été
traitées à l'ordinateur grâce aux logiciels Word, Excel et
Arc View. Le logiciel Word a été utilisé pour la saisie
des textes, Excel pour le traitement des données et l'élaboration
des graphiques et tableaux et Arc View pour la réalisation des
cartes.
Les données pluviométriques ont
été traitées par Excel pour connaitre le régime
pluviométrique. Les hauteurs mensuelles et la moyenne de pluie sont
exprimées pour la période d'étude choisie. Aussi, elles
ont permis de présenter l'évolution inter mensuelle des
précipitations à Zè de 1965 à 2008.
Les données démographiques ont permis de
connaitre la taille des ménages à enquêter selon le RGPH2.
La connaissance de ces données a permis de faire une
analyse de l'effet de la taille des ménages sur l'usage
croissant des ressources en eau.
Les données socio-anthropologiques, concernant les
ressources en eau de la commune, le mode de gestion utilisé dans la
commune, l'apport de la population dans la gestion des ressources en eau ont
été regroupés dans des diagrammes et
présentés en tableaux.
2.5. Analyse des données
La méthode utilisée pour analyser les modes de
gouvernance locale des ressources en eau est le modèle SWOT (Forces,
Faiblesses, Opportunités et Menaces). Il a permis d'identifier les
facteurs physiques, humains et socioéconomiques internes et externes qui
influencent la gouvernance locale des ressources en eau dans la commune de
Zè (figure 9).
Cette approche méthodologique a permis d'obtenir les
résultats présentés dans le chapitre III.
Chapitre III : RESULTATS ET SUGGESTIONS
Ce chapitre présente d'une part, l'état des
lieux des ressources en eau de la commune de Zè, d'autre part les
principaux acteurs de la gouvernance locale des ressources en eau, la
gouvernance locale des ressources en eau et enfin, les suggestions pour
améliorer les modes de gouvernance des ressources en eau
utilisées dans la commune de Zè.
3.1. Etat des lieux des ressources en eau de la
commune de Zè
Parmi les communes de l'Atlantique, la commune de Zè a
fait d'énormes progrès dans la fourniture et dans la
réalisation d'ouvrages hydrauliques sur l'ensemble de son territoire
(DDC/ Atlantique-Littoral). Malgré ces progrès, certains
arrondissements ne disposent pas d'ouvrages hydrauliques ; c'est le cas par
exemple de Djigbé, Dodji-Bata, Koundokpoé,
Sèdjè-Dénou, SèdjèHouègoudo,
Tangbo-Djèvié et Yokpo.
La figure 3 présente les ressources en eau
recensées de la commune de Zè.
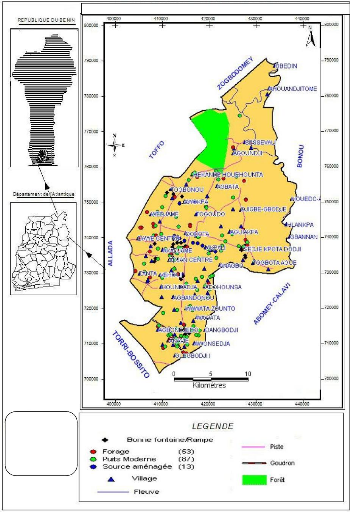
Source :
Ministère de l'Energie et de l'eau Réalisation :
Direction Générale de l'Eau
Année 2010
Figure 3: Point des ressources en eau de la Commune de
Zè
L'analyse de la figure 3 montre que les ressources en eau de
la commune sont inégalement réparties dans les arrondissements.
Dans l'ensemble de la commune, les synthèses de l'année 2010
montrent une inégale répartition sur le territoire des points
d'eau. (53) Forages, (87) Puits modernes et (13) Sources
Aménagées. Certains arrondissements disposent sur leur territoire
les ouvrages hydrauliques par contre, d'autres n'en disposent pas. Les
arrondissements de Djigbé et de Sèdjè-Dénou sont
peu couverts en point d'eau alors que Hèkanmè et Zè
disposent assez d'ouvrages hydrauliques. Ceci peut s'expliquer par la mauvaise
politique de répartition des ouvrages hydrauliques et aussi, la position
géographique de certains arrondissements de la commune.
L'irrégularité de la disponibilité des
ressources hydrauliques d'un arrondissement à un autre est
présentée dans le tableau III.
Tableau III : Synthèse de la situation
hydraulique dans la commune de Zè
Arrondissements
|
1 RP bEIFGiRX}EDIIsF
fonctionnels par type
|
Nombre GiAEV
|
Nombre Rampe en panne
|
Nombre GiFPM en
panne
|
Nombre de PM en
panne
|
|
PM
|
SA
|
BF
|
PEA
|
|
3
|
7
|
0
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
DAWE
|
3
|
2
|
0
|
8
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
DJIGBE
|
0
|
1
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
DODJI-BATA
|
7
|
14
|
0
|
24
|
0
|
1
|
0
|
5
|
0
|
HEKANME
|
3
|
6
|
1
|
6
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
KOUNDOKPOE
|
4
|
9
|
0
|
29
|
0
|
3
|
2
|
1
|
1
|
SEDJE-DENOU
|
3
|
3
|
0
|
10
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2
|
SEDJE- HOUEGOUDO
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
TANGBO-DJEVIE
|
4
|
10
|
0
|
17
|
4
|
2
|
4
|
5
|
3
|
YOKPO
|
2
|
10
|
0
|
7
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
ZE
|
5
|
15
|
10
|
26
|
1
|
2
|
8
|
3
|
1
|
|
Source : Enquête de terrain,
2011
Légende : FPM : Forage
équipé de Pompe à Motricité humaine;
PM : Puits Moderne ; SA : Source
Aménagée ; BF: Borne Fontaine ;
PEA : Poste d'Eau Autonome ; AEV : Adduction
d'Eau Villageoise.
L'analyse du tableau III montre que la commune de Zè
dispose de 298 ouvrages hydrauliques dont 50 en pannes. La population utilise
donc 248 points d'eau. Ces ouvrages sont inégalement répartis
dans les arrondissements de la
commune. Les arrondissements tels que Adjan, Dawé,
Djigbé, Dodji-Bata, Koundokpoé, Sèdjè-Dénou,
Sèdjè-Houègoudo, Tangbo-Djèvié et Yokpo ne
possèdent aucune source Aménagée (SA). Le même
constat se fait à Djigbé, Dodji-Bata, Koundokpoé,
Sèdjè-Dénou et Sèdjè-Houègoudo qui ne
disposent pas de PEA. Ceci est dû à une mauvaise vision
d'aménagement et d'implantation des ouvrages hydrauliques. Les habitants
dépourvus d'infrastructures hydrauliques se ruent vers les villages
voisins pour s'approvisionner.
3.1.1. Ressources en eau de la commune de Zè
Les ressources en eau recensées dans les
arrondissements de la commune de Zè sont essentiellement
constituées des eaux atmosphériques, des eaux superficielles et
des eaux souterraines.
1. Les eaux atmosphériques
Elles sont constituées des eaux de pluie en
général. Pour stocker l'eau de pluie, les habitants de la commune
utilisent les jarres, les plastiques et les bassines. Par contre, certains
construisent des citernes pour recueillir l'eau grâce aux
gouttières qui transportent l'eau de pluie de la toiture à la
citerne. La photo 2 montre un ouvrage hydraulique qui sert à stocker
l'eau de pluie.

Photo 2: Citernes à Zè centre et
à Hèkanmè.
Prise de vue : KANHONOU, Juillet
2011
Les citernes ci-dessus sont couvertes de tôles qui
protègent l'eau des déchets mais ne garantissent pas sa
propreté. La profondeur et le diamètre varient en fonction des
moyens financiers dont dispose le propriétaire.
2. Les eaux superficielles
Le réseau hydrographique est très peu
développé dans la commune de Zè. Du sud jusqu'au centre de
la commune des marigots et des bas-fonds s'observent. Entre autre, Havikpa ;
Houégnon ; Tozounmè ; Agbato ; Togbo et Dovinou. Par contre, la
zone Nord de la commune est irriguée par les affluents du fleuve
Ouémé tel que la Sô.
Plusieurs cours d'eau temporaires traversent les
arrondissements de DodjiBata, Yokpo, Zè et Djigbé. Au Nord--Est,
la zone est marécageuse avec des plans d'eau et des marais par endroit
tels à Sèdjè-Dénou,
Sèdjè-Houègoudo, Djigbé, Djigbé-Agué,
Agoundji et Gbodjè. La photo 3 représente deux sources d'eaux
superficielles de la commune de Zè.

(a) (b)
Photo 3 : Tozounmè et Havito, plan
d'eau et source thermale aménagée
à
Hèkanmè.
Prise de vue : KANHONOU, Juillet
2011
La photo 3(a) présente d'une part, un plan d'eau
appelé Tozounmè, très poissonneuse et constitue
également une eau de boisson pour la population environnante. La photo
3(b) quant à elle, est une source thermale aménagée qui
sert de breuvage aux animaux et d'eau de boisson à la
population, mais elle est male entretenue avec assez de boue.
3. Les eaux souterraines
Les eaux souterraines sont mobilisées par les ouvrages
hydrauliques. Ce sont : l'Adduction d'Eau Villageoise (AEV), le Poste d'Eau
Autonome (PEA), les Forages, les puits traditionnels et les puits modernes.
· L'AEV
L'AEV est généralement constituée d'un
forage équipé d'un système de pompage motorisé
relié à un réservoir de stockage et à un
réseau de distribution. La photo 4 est celle d'une AEV.

(a) (b)
Photo 4 : Vue d'une Borne Fontaine à
Adjanhonou et d'une AEV à
Koundokpoé
Prise de vue : KANHONOU, juillet
2011
La photo 4(a) est celle une Borne Fontaine et la photo4(b)
est une AEV. Ces deux ouvrages sont des AEV ; elles sont des points d'eau
public, qui desservent les habitants qui n'ont pas de pompes ou de branchement
privé et dont l'effectif atteint 250.
· Le PEA
Le PEA est constitué d'un forage ou d'un puits
à grand diamètre équipé d'un système de
pompage motorisé relié à un réservoir de stockage.
La photo5 présente un PEA.
|
|
|
|
|
|
|
Réservoir de stockage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cabine de pompage
motorisé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Photo 5 : Vue d'un Poste d'Eau Autonome
à Koundokpoé.
Prise de vue : KANHONOU,
juillet 2011
La photo5 est celle d'un PEA de Koundokpoé,
destiné au minimum à 1000 personnes (PADEAR, 2008). Le PEA
ci-dessus est mal entretenu avec assez d'herbes aux alentours ; ceci montre une
négligence du gestionnaire.
· Les forages
Le forage est un trou de petit diamètre (10 à
30cm) creusé dans le sol et qui arrive jusqu'à l'eau (PPEA,
2010). La photo 6 présente un Forage équipé de Pompe
à Motricité Humaine.
Photo 6: Vue d'un Forage équipé
d'une Pompe à Motricité Humaine
à
Guékoumèdé.
Prise de vue : KANHONOU,
2011
Le Forage équipé d'une Pompe à
Motricité Humaine est la solution retenue dans une localité
lorsque la population à desservir atteint 250 habitants. Sur cette
photo, on peut voir un enfant s'amuser avec la pompe, ce qui peut être la
cause des nombreux ouvrages non fonctionnels observés dans certains
arrondissements de la commune.
· Les puits traditionnels
Les puits traditionnels recensés dans la commune sont
peu profonds et ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de couvercles
mais servent souvent de boisson dans la plupart des villages. Chaque village
possède un puits traditionnel et sa gestion est concertée. La
photo 7 est celle d'un puits traditionnel.
Photo 7 : vue d'un puits traditionnel dans le
village d'Aïfa
Prise de vue : KANHONOU,
juillet 2011
· Les puits modernes
La plupart des habitants de la commune de Zè utilise
l'eau de puits moderne pour leur besoin. La photo 8 est celle d'un puits
moderne.
|
|
|
|
|
|
|
|
Poteau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poulie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treuil munide corde
|
|
|
|
|
|
|
|
Margelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La clôture
|
|
|
|
|
|
|
Photo 8: Vue d'un Puits Moderne à
Akadjamè
Prise de vue : KANHONOU, juillet
2011
Les puits modernes de Zè comme l'indique la photo 8
sont équipés d'une trappe et d'un treuil muni d'une corde aux
deux extrémités sur laquelle est fixé un seau. Le
système permet de faire descendre le seau vide en même temps que
l'on remonte un seau plein d'eau.
3.1.2. Usages par type de ressources en eau
La population de la commune de Zè utilise les ressources
en eau à de diverses fins.
· Usage des eaux
atmosphériques
L'eau de pluie est utilisée dans les activités
ménagères à savoir : la lessive, la toilette, la cuisine
et la lessive.
Sur les 207 ménages enquetés, 89 disposent
d'une citerne et recueillent l'eau de pluie. Tous les 50 agriculteurs
interviewés utilisent les eaux de pluies conservés dans des
citernes.
Il n'existe pas d'industries dans la commune de Zè.
Les unités de transformations disponibles sont pour la plupart, des
associations de femmes qui s'occupent de la transformation du manioc en gari et
tapioca, de l'ananas en jus d'ananas et de la noix de palme en huile rouge.
Elles utilisent donc de l'eau de citerne pour laver et mettre au propre le
manioc ou la noix de palme. Certains particuliers vendent l'eau pour
alléger les peines de la population, rapprocher les points d'eau dans
leur village et pour augmenter également leur revenu financier en
construisant des citernes dans leur maison pour alimenter les habitants qui
sont éloignés des Bornes Fontaines.
· Usages des eaux superficielles
Le paysan africain est impuissant de retenir, de
préserver, d'utiliser avec précaution l'eau de pluie
tombée sur sa terre au bénéfice des plantes, des cultures,
de la mettre en réserve pour en disposer durant les périodes
sèches (Chleq et al, 1997).
Les cultures au Bénin sont exposées aux
aléas climatiques (MEPN, 2008). Le paysan attend le début de la
saison pluvieuse pour commencer à cultiver ; s'il n'y a pas de pluie,
les cultures sont exposées à la sécheresse. La frange de
la population interviewée constituée d'agriculteurs estime
qu'elle souffre énormément du manque d'eau en saison
sèche. Ils puisent dans les marigots ou les cours d'eau qu'ils utilisent
pour arroser leurs champs d'ananas ou de manioc.
Sur les 207 ménages enquêtés, 15,46 %
utilisent les eaux superficielles, soit un total de 32 ménages. Parmi
ces ménages, certains utilisent les eaux superficielles pour leur besoin
domestique.
Par contre, d'autres irriguent leur champ en se servant des
sillons et des billons. Dans les régions d'Awokpa, Djigbé,
Houedota, Sèdjè-Dénou et
SèdjèHouègoudo, la production rizicole et le
maraîchage se font dans les bas-fonds. Mais la non maîtrise de
l'eau dans les casiers emporte très souvent les cultures. La photo 9
montre un champ irrigué.

Photo 9 : Vue d'un champ irrigué
à Adjan
Prise de vue : KANHONOU, juillet
2011
La plupart des paysans de l'arrondissement d'Adjan
installé à côté des cours d'eau irriguent leur champ
pour mieux faire face aux intempéries climatiques.
La pisciculture est aussi pratiquée dans des trous
à poisson non encore aménagés à Houéhounta.
Deux Organisations Non Gouvernementale telles que l'Association Huma-Nature et
l'Association pour la Santé et l'Education installées à
Zè, font à part la vente de l'eau, le jardinage et aussi la
culture du manioc à proximité de leur point d'eau.
· Usage des eaux souterraines
Sur les 207 ménages enquêtés, 147
utilisent les sources d'eau non aménagées (les citernes et les
puits traditionnels) pour satisfaire les besoins tels que : la boisson, la
cuisine, la toilette et la lessive, soit un pourcentage de 71 %.
Par contre, les 60 restants, soit 29 % de
l'échantillon utilisent les sources d'eau aménagées (les
PEA, les AEV, les Forages, les Puits Modernes et les Bornes Fontaines) pour la
boisson et la cuisine. La plupart d'entre eux exprime des doutes sur la
qualité de l'eau qu'elle boive car la majorité de ces
ressources
telles que les puits traditionnels n'est pas
protégée. La figure 4 présente la fréquence
d'utilisation des sources d'eau aménagées et celle des sources
d'eau non aménagées.
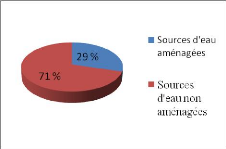
Figure 4: fréquence d'utilisation des
eaux souterraines pour les usages
domestiques
Source :
Enquête de terrain, 2011
L'analyse de la figure 4 révèle que parmi les
enquêtés, 71 % continuent d'utiliser l'eau des sources non
aménagées pour les usages domestiques pendant que 29 % utilisent
les sources aménagées pour ces mêmes usages. Ceci peut
être à la base de maladies hydriques liées aux microbes
contenus dans ces eaux qui ne sont pas couvert pour la plupart. La mauvaise
gestion des ressources en eau de la part des sages de la localité et le
non respect des règles par la population sont aussi à la base de
l'abandon des ouvrages et des pannes fréquentes. L'entretien des points
d'eau et des ouvrages est nécessaire pour limiter ces risques.
Le commerce de l'eau est assuré par des particuliers,
des associations et des fermiers qui se portent volontaires ou sont
désignés pour la vente. La plupart de ces particuliers vendent
l'eau à un prix beaucoup plus inférieur qu'à celui des
fontainiers (prix fixé par la commune). Pour les particuliers, le prix
de vente du bidon d'eau de 25 litres est soit à 15 FCFA ou à 20
FCFA alors que la même quantité d'eau est vendue par le fontainier
à 25 FCFA. La photo 10 présente des châteaux d'eau
privés à Goulo et Havikpa.
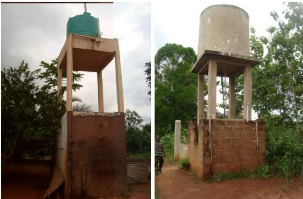
(a) (b)
Photo 10: Châteaux d'eau privés
à Goulo et Havikpa
Prise de vue : KANHONOU,
2011
Les châteaux d'eau ci-dessus sont en matériau
précaire (plastique), photo 10(a) et définitif
(béton), photo 10(b). Ils servent à alimenter le
propriétaire et la population en eau potable. Ils sont munis d'un
réservoir dans lequel l'eau est stockée et vendu selon le prix
fixé par le vendeur.
3.1.3. Variation saisonnière des ménages aux
ressources en eau
· En saison pluvieuse
L'utilisation des ressources en eau et des ouvrages
hydrauliques varie d'une saison à une autre. La figure 5 présente
l'affluence des ménages aux sources d'eau en saison pluvieuse dans la
commune de Zè.
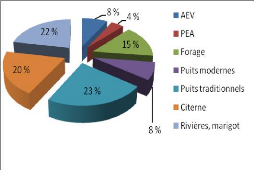
Figure 5: Répartition de l'usage des
ressources en eau en saison pluvieuse
dans la commune de
ZèSource : Enquête de
terrain, 2011
L'analyse de la figure 5 montre qu'en saison pluvieuse l'eau
est abondante dans les rivières, marigots, citernes et puits
traditionnels avec un taux d'utilisation respectif de 23 %, 20 % et 22 %.
Tandis que pendant la même période le taux d'utilisation des AEV,
PEA, des forages et des puits modernes est respectivement 8 %, 4 %, 15 % et 8
%. Le constat fait est qu'en saison pluvieuse, les eaux souterraines sont
abandonnées au profit des eaux atmosphérique et superficielle.
· En saison sèche
Pendant la saison sèche, c'est le
phénomène contraire qui s'observe aux sources d'eau de la commune
de Zè. Les eaux superficielles et atmosphériques tarissent et on
assiste à une concentration de la population dans les sources d'eau
souterraines. La figure 6 présente l'affluence des ménages aux
sources d'eau en saison sèche dans la commune de Zè.
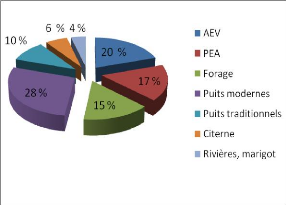
Figure 6 : Répartition de l'usage des
ressources en eau en saison sèche dans
la commune de
ZèSource : Enquête de
terrain, 2011
De l'analyse de la figure 6, il ressort que pendant la saison
sèche, la population se rue beaucoup plus sur l'eau de forage (15 %),
les puits modernes (28 %), les AEV (20 %) et les PEA (17 %). Par contre, les
citernes (6 %), les rivières, marigots (4 %) et les puits traditionnels
(10 %) sont peu fréquentés pendant cette saison. En cette saison
sèche, les sources d'eau atmosphérique et superficielle tarissent
; ceci explique le pourcentage faible observé au niveau de ces ouvrages.
Cette ruée a pour conséquence la forte pression sur l'utilisation
des ouvrages hydrauliques avec les pannes fréquentes et l'abandon
à l'état neuf de certains ouvrages hydrauliques (ONG-AERAMR,
2011).
3.1.4. Modes de gestion des ressources en eau
Il existe en général (04) quatre modes de
gestion des ressources en eau au Bénin : le contrat tripartite ; le
contrat production-distribution ; le contrat Association de Consommateurs et le
contrat fermier.
Parmi ces modes, le contrat fermier est le mode de gestion
utilisé dans la commune de Zè. Dans ce mode de gestion, les
consommateurs n'ont pas de rôle direct et ne sont pas constituée
en association. La commune signe un contrat
d'affermage directement avec un opérateur privé
(fermier). Le fermier à plusieurs rôles qui sont :
· exploiter les ouvrages et vendre l'eau aux consommateurs
à un tarif fixé par le contrat ;
· assurer le fonctionnement, l'entretien courant et la
maintenance du système ;
· verser, au démarrage du contrat, une caution sur
le compte « Eau » de la commune ;
· verser une redevance pour le renouvellement et les
extensions à la commune assise sur le nombre de m3 produit et
verser une redevance au budget communal ;
· éventuellement, verser une redevance dans le
cadre de la loi sur l'eau.
Dans ce mode, c'est la commune qui à la charge du
renouvellement du système de pompage et de réalisation des
extensions éventuelles. La plupart des personnes enquetées sur le
contrat fermier actuellement utilisé, estime qu'il serait mieux que le
conseiller technique de la mairie revoie le mode de gestion en associant la
population à la base puisqu'elle ne l'est pas. Etant donné que le
mode de gestion est en début d'application, la mairie quant à
elle, estime que le contrat fermier est meilleur et plus rentable. La figure 7
présente le contrat fermier dans la commune de Zè.
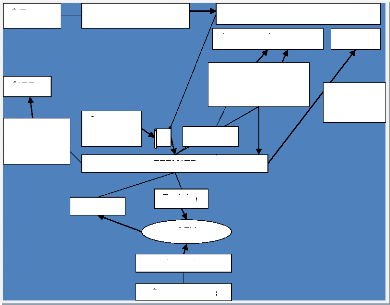
Redevance au m3 produit
GIRE
S-Eau
Recettes
Appui, suivi, contrôle
Contrat d'affermage
Consommateurs
FERMIER
Achètent l'eau
Exploite
AEV
Caution
Redevance au m3 pour renouvellement et
extensions
Compte spécifique Eau
Commune de Zè
Redevance au m3
Budget
Figure 7 : Contrat fermier :
Délégation par la commune à un fermier Source
: PADEAR, 2008
L'analyse de la figure 7 révèle que dans le
contrat fermier, le Service-Eau (S-Eau) assure seulement l'appui, le suivi et
le contrôle de l'eau dans la commune. La commune étant le maitre
d'ouvrages des points d'eau, signe avec le fermier un contrat d'affermage. Le
fermier à son tour, paie une caution sur la redevance au m3
pour les renouvellements et les extensions dans le compte spécifique que
la mairie réserve à « l'eau ». Il paie aussi une
redevance au m3 produit dans le cadre de la loi sur l'eau : «
l'eau paye l'eau » à la GIRE. Lorsqu'il s'acquitte de ces cautions,
il exploite les adductions d'eau villageoise et collectent les fonds de la
vente d'eau achetée par les consommateurs. Les recettes issues de la
vente serviront à l'entretien de l'ouvrage et à payer
périodiquement les redevances.
3.1.5. Problèmes du mode de gestion des ressources
en eau
Il appartient à la commune de déléguer la
gestion des ouvrages d'eau ; elle choisit le type de délégation
qui lui semble convenir le mieux à chaque point
d'eau. Il existe deux types à savoir : la
délégation à un représentant de la commune et la
délégation à un opérateur privé. Le
délégataire peut gérer un ou plusieurs points d'eau.
(PADEAR, 2008).
Le Gontrat fermier en vigueur dans la commune de Zè,
présente certaines failles qui se résument comme suit :
- la gestion communautaire à l'état actuel ne
rassure pas la pérennité du service de fourniture de l'eau
potable aux populations de la commune de Zè ;
- comptes-rendus de gestion insuffisants, démocratie
interne biaisée, fréquence de conflits internes entre
responsables gestionnaires ou du fait de prétendants à la gestion
;
- le coût de fonctionnement des Associations d'Usagers
de l'Eau Potable est trop élevé par endroit, de telle sorte que
la rentabilité des AEV est menacée de ce seul fait ;
- le type d'énergie utilisé (groupe
électrogène, ou abonnement à la société
béninoise de l'énergie électrique) ; et la consommation
par tête de personne de l'eau potable sont, tout de même, autant
d'autres facteurs qui influencent négativement la rentabilité des
AEV.
Get ensemble de constats collabore les idées de Janique
(2003) lorsque ce dernier déclare : « l'idée qu'un
comité villageois reviendrait moins cher qu'un opérateur
privé en charge de la gestion des mêmes équipements
hydrauliques tient parfois du mythe : détournements financiers,
difficultés à gérer les équipements de
manière professionnelle ou à investir pour d'éventuelles
extensions, manque de disponibilité liée au
bénévolat imposé aux membres du comité,
voilà autant de facteurs de risques pour le développement des
projets selon les modalités prévues à l'origine et donc de
possibilités de surcoût ».
Au vu de tout ceci, l'étude propose de repenser la
stratégie en priorisant l'option professionnelle des gestionnaires d'eau
avec une association concertée de la population locale.
3.1.6. Projection de la population de Zè face aux
besoins en points d'eau
Le tableau IV présente la projection de la population de
Zè.
Tableau IV : Projection de la population de
Zè face à ses besoins en point d'eau de 2010 à 2015
|
Arrondissement
|
Population 2010
|
Besoins
2010
|
Population 2011
|
Besoins 2011
|
Population 2012
|
Besoin
2012
|
Population 2013
|
Besoins
2013
|
Population 2014
|
Besoins
2014
|
Population 2015
|
Besoins
2015
|
|
Adjan
|
7008
|
28
|
7206
|
29
|
7410
|
30
|
7620
|
30
|
7836
|
31
|
8057
|
32
|
|
Dawé
|
4788
|
19
|
4924
|
20
|
5063
|
20
|
5206
|
21
|
5353
|
21
|
5505
|
22
|
|
Djigbé
|
4589
|
18
|
4719
|
19
|
4852
|
19
|
4990
|
20
|
5131
|
20
|
5276
|
21
|
|
Dodji-Bata
|
11401
|
46
|
11724
|
47
|
12055
|
48
|
12397
|
50
|
12747
|
51
|
13108
|
52
|
|
Hèkanmè
|
10201
|
41
|
10490
|
42
|
10787
|
43
|
11092
|
44
|
11406
|
46
|
11728
|
47
|
|
Koundokpoé
|
8160
|
33
|
8391
|
34
|
8628
|
35
|
8873
|
35
|
9124
|
36
|
9382
|
38
|
|
Sèdjè-Dénou
|
6871
|
27
|
7065
|
28
|
7265
|
29
|
7471
|
30
|
7682
|
31
|
7900
|
32
|
|
Sèdjè-Houègoudo
|
6033
|
24
|
6204
|
25
|
6379
|
26
|
6560
|
26
|
6745
|
27
|
6936
|
28
|
|
Tangbo Djèvié
|
12006
|
48
|
12346
|
49
|
12695
|
51
|
13054
|
52
|
13424
|
54
|
13804
|
55
|
|
Yokpo
|
6238
|
25
|
6415
|
26
|
6596
|
26
|
6783
|
27
|
6975
|
28
|
7172
|
29
|
|
Zè
|
13735
|
55
|
14124
|
56
|
14523
|
58
|
14934
|
60
|
15357
|
61
|
15792
|
63
|
|
Total
|
91030
|
364
|
93606
|
374
|
96255
|
385
|
98979
|
396
|
101780
|
407
|
104661
|
419
|
Source : INSAE / AERAMR/
Enquête de terrain, 2011
Pt P0 (1 r)t Avec :
Pt Population de l'année T1 ; P0
Population de l'année T0 ; r : Taux
d'accroissement de la population ; t : Nombre d'année
séparant T0 et T1.
D'après les résultats du tableau III, la commune
de Zè dispose de 248 points d'eau en 2011 pour une population de 93606
hbts alors que la commune a besoin de 374 points d'eau pour satisfaire ses
besoins. La population évolue de façon exponentielle alors que
les points d'eau ne sont pas construits en fonction de l'évolution de la
population. L'analyse du tableau IV montre la projection de la population de la
commune de Zè sur une période de (05) cinq ans en fonction de ses
besoins en point d'eau. Plus la population évolue plus les besoins en
points d'eau évoluent alors que les points d'eau ne sont construits que
périodiquement. En 2012 donc, pour une population de 96255 hbts il faut
385 points d'eau et pour une population de 104661 hbts il faut 419 points d'eau
en 2015. Si les manques en points d'eau persistent d'ici 2015, la commune de
Zè aura de nombreuses difficultés pour satisfaire sa population
en eau.
3.2. Acteurs de la gouvernance locale des ressources en
eau de Zè
Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion et dans la
gouvernance des ressources en eau dans la commune de Zè. Ce sont :
l'Etat, la Commune, les Structures d'Intermédiation Sociale et les
partenaires du développement, le fermier, l'exploitant et la population
locale.
1. Etat
L'Etat, à travers le Ministère de l'Energie et
de l'Eau, la Direction GénéraleEau et ses services
déconcentrés, exerce plusieurs rôles selon le guide
à l'usage des communes dans l'approvisionnement en eau dans une commune.
Entre autre, il définit la politique nationale du secteur de l'eau et
veille sur sa mise en oeuvre, assure l'orientation et la coordination des
actions des partenaires externes dans le secteur de l'eau.
L'article 1er de la loi 2010-044 du 21 Novembre
2010 sur l'eau en république du Bénin dit que : « Toute
personne a le droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et
a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection
de l'environnement et à la conservation des ressources
naturelles en général, en l'occurrence l'eau ».
Ainsi, il apporte un appui conseil aux communes et aux autres
intervenants impliqués dans le secteur de l'eau à travers des
actions d'informations, de formations et d'assistance technique et conseil
(PPEA, 2010). La structure déconcentrée telle que le service de
l'hydraulique est présent au côté de la mairie et suit
rigoureusement par des relevés piézométriques pour voir
l'évolution des nappes. L'eau est suivie et la gestion est sans
gaspillage. (DDC/ Atlantique/Littoral).
2. Commune
La loi de décentralisation 97-029 du 15 janvier 1999
confère à la commune toutes responsabilités sur la gestion
des ressources de sa localité. Celle-ci lui confère plusieurs
rôles à savoir :
- planification de la réalisation des ouvrages
d'alimentation en eau potable à partir des besoins réels des
populations et dans une vision de l'aménagement global de son territoire
;
- choix du mode de gestion propre à garantir la
durabilité des ouvrages et sa mise en oeuvre ;
- mettre en place un environnement pour la maintenance des
ouvrages hydrauliques ;
- et enfin, le contrôle du bon fonctionnement du service
public de l'eau (PADEAR, 2008).
La commune est responsable du service public de l'eau à
partir des ouvrages d'alimentation en eau potable. La loi de
décentralisation et la stratégie sectorielle précisent que
la commune est propriétaire des ouvrages d'alimentation en eau potable
(MSPCL, 2006).
La gestion des ressources en eau qui recouvre l'exploitation
(production et distribution), l'entretien et la maintenance doivent être
aussi délégués par la
commune. Elle assure également le contrôle et la
régulation afin de garantir la viabilité et la
pérennité des ressources en eau de sa commune (PPEA, 2010).
3. Structures d'Intermédiation Sociale et les
partenaires du développement
Les ONG nationales et internationales appuient la commune de
Zè pour sa couverture en eau. Les SIS sont des prestataires
sélectionnés par la commune qui mettent à la disposition
de celle-ci des agents qualifiés. Ces agents interviennent à la
demande de la commune pour mettre en place un service publique d'eau. Ces
structures travaillent en relation avec la mairie pour la fourniture, la
distribution et la vente d'eau potable dans la commune. Le représentant
de la structure de gestion, désigné sous le nom de Fermier,
délègue un exploitant qui se charge de la gestion, de la
distribution et de l'entretien du point d'eau et rendra compte au fermier. A
son tour, le fermier paie une redevance à la mairie compte tenue du
nombre de m3 d'eau pompé. Dans la commune de Zè, le
m3 d'eau est fixé à 600 FCFA. En effet, ces structures
servent de relais à la mairie par le mode de gestion qui les relie :
« Le contrat fermier» (Figure 7).
Dans la commune de Zè, les recherches ont montré
que les 04 structures ou prestataires qui s'occupent de la gestion de l'eau
à Zè rendent compte à la mairie. La mairie travaille donc
en affermage avec quatre (04) structures qui sont : SONICA ; Canal Eau ; Global
Initiative ; Société Générale d'Energie Electrique
et Fluides (SGEEF). Aussi, certains partenaires au développement et ONG
travaillent pour la couverture et la réalisation d'ouvrages hydrauliques
dans la commune. Au nombre de ceux-ci, l'Association pour la Santé et
l'Education (ASE) ; l'Association pour Etude et Réalisation des
Aménagements en Milieu Rural (AERAMR) ; l'Initiative
Développement (ID) ; Gradelos-ONG et Association Huma Nature (AHE).
Leur assistance technique, financière et leur conseil
aident à résoudre un temps soit peu le problème de gestion
et de gouvernance des ressources en eau à Zè.
4. Fermier
Le fermier est une personne physique ou morale ayant une
existence légale d ont la compétence lui permet d'assurer la
gestion de l'AEV ou d'un ouvrage d'eau. Il est important que le fermier
entretienne correctement les équipements du point d'eau (PPEA, 2010).
La commune signe avec le fermier un cahier de charges
précis qui décrit ses responsabilités. La plupart des
fermiers exerçant dans la commune de Zè sont les
représentants des structures qui travaillent en affermage avec la
mairie.
Enfin, il décide en commun accord avec la mairie de
l'extension ou non du réseau hydraulique dont il à la charge en
construisant les Bornes Fontaines ou en branchant les particuliers.
5. Exploitant
L'exploitant est la troisième personnalité en
charge de la gestion de l'eau à part la mairie et le fermier. Il a le
plus grand rôle en matière de gestion des ouvrages d'eau. C'est le
représentant du fermier sur le terrain. L'exploitant reste au niveau du
PEA qui alimente les Bornes Fontaines et les Branchements Privés (PPEA,
2010).
Les exploitants interviewés à Zè sont
pour la plupart lettrés, ils ont soit suivi une formation en gestion
d'eau au CARDER, à la direction de l'hydraulique ou une formation
interne au sein de la structure qui les emploie. Au PEA, l'exploitant remplit
le château en mettant en marche le moteur; il s'assure que le groupe
électrique qu'il utilise est en bon état. Aussi, son rôle
est de parcourir les Bornes Fontaines et les branchements publics pour relever
leur consommation au m3, collecter les fonds d'eau et rendre ensuite
compte au fermier. Dans le cas ou l'exploitant n'arriverait pas à
réunir la totalité des fonds, il assumera les pertes.
L'exploitant assure aussi le maintient et l'entretien des ouvrages d'eau, la
protection et la distribution de l'eau.
6. Population locale
Selon le Dictionnaire Universel, 1995, on entend par usager ou
consommateur, toute personne qui utilise un service, en particulier un service
public ou un domaine public. Les usagers des ressources en eau concernent
respectivement, les hommes et jeunes hommes, les enfants, les sages et
personnes âgées, les femmes et les jeunes filles. La gouvernance
locale des ressources en eau concerne tout individu vivant dans une
localité. La population locale joue plusieurs rôles dans la
gestion et dans l'approvisionnement des ressources en eau. La population
utilise l'eau et paie le service de l'eau. A la demande de la commune, elle
propose une personne pour prendre en charge la gestion des points d'eau de leur
localité. La qualité de l'eau reste un service qu'elle doit
exiger de l'autorité locale en place (PADEAR, 2008).
Les hommes et les jeunes garçons se chargent
généralement d'aménager les points d'eau, de
réparer les ouvrages en panne et d'en créer d'autres puisqu'ils
sont fortement représentés au niveau des comités
où, ils participent à la gestion. Les personnes
âgées interviennent généralement dans le
règlement de conflits liés à l'eau, et veillent
également au maintien de la propreté et au respect des us et
coutumes liés à l'eau. Dans la commune de Zè, la femme
s'occupe généralement de l'approvisionnement du ménage en
eau de consommation en allant prélever matin, midi et soir à la
source. Ce rôle, les femmes le jouent la plupart du temps en compagnie de
leurs enfants qui les aident pour le transport. (YAMONGBE, 2011). La photo 11
montre un groupe de femmes et d'enfant à un point d'eau.

Photo 11 : Rôle des femmes et des
enfants dans la gestion de l'eau
Prise de vue :
KANHONOU, 2011
La photo 11 montre que les femmes et les enfants jouent un
grand rôle dans l'approvisionnement et la gouvernance de l'eau. Pour la
recherche de beaucoup plus d'efficacité dans leurs actions dans la
commune, des Associations de Consommateurs d'Eau Potable (ACEP), des
Associations d'Usagers d'Eau (AUE) se créent un peu partout dans les
arrondissements de Zè: cas des AEV et AUE de
Sèdjè-Dénou et de Goulo à Zè.
La figure 8 présente le taux d'implication des acteurs
dans la gestion des ressources en eau.
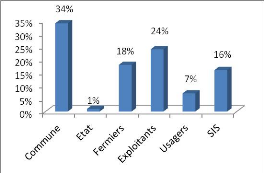
Figure 8: Taux d'implication des acteurs dans
la gestion des ressources en eau
dans la commune de
Zè.
Source : Enquête de terrain,
2011
L'analyse de la figure 8 montre l'implication des divers
acteurs de la gestion des ressources en eau dans la commune de Zè. Ces
acteurs sont impliqués de façon diverses dans la gouvernance de
l'eau. Seuls les acteurs qualifiés et en affermage avec la commune
s'implique dans cette gestion : il s'agit des fermiers (18 %), des exploitants
(24 %) et des SIS (16 %). Le pourcentage faible (7 %) observé au niveau
des usagers montre le faible taux d'implication de la population locale, des
utilisateurs ou consommateurs d'eau dans la gouvernance locale des ressources
en eau dans la commune de Zè.
3.3. Gouvernance locale des ressources en eau dans la
commune de Zè
3.3.1. Application du modèle SWOT à la
gouvernance locale des ressources en eau de la commune de Zè
La figure 9 présente le modèle SWOT appliqué
au concept de la gouvernance locale des ressources en eau de la commune de
Zè:

Déterminants naturels : Ressources en eau de la
commune de Zè.
Eaux atmosphériques, eaux superficielles et eaux
souterraines
Facteurs de pression : Actions anthropiques, gouvernance
locale
Aspects socioéconomiques : emplois
générés, gains financiers et utilisation
Mode de gouvernance : Contrat fermier Gestion des
ressources d'eau, entretien et maintien des ouvrages hydrauliques
Disponibilité des ressources en eau, existence
des structures de gestion en affermage, présence des structures
d'intermédiation sociales, la population locale
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET ANTHROPIQUES : Absence
d'assistance technique et financière aux fermiers et aux gestionnaires,
abandon et pannes fréquentes des ressources en eau et ouvrages
hydrauliques, dégradation des écosystèmes
DEFINITION DES STRATEGIES:
- Amélioration des modes de gestion des ressources
en eau.
- Amélioration des revenus.
- Association de la population locale à la
gouvernance locale des ressources en eau
- Sensibilisation des gestionnaires et des
utilisateurs
- Gestion rationnelle des ressources en eau
FACTEURS INTERNES
FORCES
FAIBLESSES
MENACES

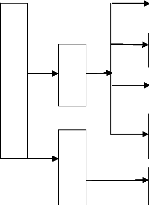
Comblement des plans d'eau, aléas climatiques,
inégale répartition des ouvrages, qualification professionnelle
peu requise des fermiers, des notables et utilisateurs


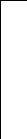
FACTEURS EXTERNES
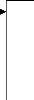
OPPORTUNITES

Figure 9: Modèle d'analyse de la
gouvernance locale des ressources en eau de
la commune de Zè à
l'aide de SWOT
Source : Enquête de
terrain
La figure 9 présente le modèle SWOT appliqué
à l'analyse de la gouvernance locale des ressources en eau de la commune
de Zè.
Flle montre les facteurs internes (physiques, humains et
socioéconomiques) qui influencent la gouvernance locale des ressources
en eau de la commune de Zè et les facteurs externes (les menaces et les
opportunités) qui agissent sur la gouvernance locale des ressources en
eau. L'identification de ces différents facteurs permet de
définir des stratégies efficaces telles que :
l'amélioration des modes de gestion des ressources en eau,
l'amélioration des revenus, l'association de la population à la
gouvernance locale des ressources en eau, la sensibilisation des gestionnaires
et des utilisateurs et la gestion rationnelle des ressources en eau dans la
commune de Zè. Ces différentes stratégies peuvent
maximiser les forces et les opportunités, minimiser l'impact des
faiblesses et des menaces et si possible, les transformer en forces ou
opportunités.
1. Facteurs internes
Ils présentent les forces et les faiblesses de la
gouvernance locale des ressources en eau dans la commune de Zè.
· Forces
La commune de Zè dispose d'importantes ressources en
eau qui, mieux gérées, lui permettront de couvrir ses besoins
à moyen et long terme. Flle organise périodiquement avec l'apport
des sages et des chefs de village non desservis en points d'eau surtout en eau
potable des rencontres pour débattre des problèmes hydrauliques
que rencontrent les habitants : c'est le rôle fondamental que la Cellule
Communale Fau et Assainissement assure. Ces ressources en eau
génèrent des emplois et de revenus financiers à la
localité.
Selon la Base de Données Intégrée (BDI)
de la décentralisation, il incombe aux communes de s'engager dans une
démarche d'aménagement du territoire en vue d'assurer les
meilleures conditions de vie à l'ensemble de la population. Elle doit
pour cela, partir des besoins réels de la population pour les
infrastructures
hydrauliques, ce qui implique une connaissance approfondie de la
situation de la desserte en eau sur le territoire communal (PADEAR, 2008).
Différents groupes d'utilisateurs (paysans,
éleveurs, communautés, écologistes) peuvent influencer les
stratégies de gestion et de mise en valeur des ressources en eau. Cela
apporte des avantages additionnels, car les utilisateurs avisés
appliquent une autorégulation locale par rapport aux questions telles
que la conservation de l'eau et la protection des sources d'eau superficielle
bien plus efficacement que la réglementation et la surveillance
centralisée ne puissent réaliser (AERAMR, 2010).
· Faiblesses
Les ressources en eau de la commune de Zè, malgré
leur disponibilité sur le territoire, leur gestion présente des
faiblesses. Le Programme Pluriannuel Eau et
Assainissement avait réalisé en 2009 trois (03) FPM
dans la commune de Zèprécisément dans les
localités de Sadiga à Akpali, de Dékansa à Yokpo
centre et
du CEG Sèdjè-Dénou. Les comités de
gestions qui s'occupaient de ses FPM n'arrivaient pas à solder le prix
de ces ouvrages. L'ONG-AERAMR a prit donc la décision d'appuyer
financièrement les localités de Dékansa et du CEG
SèdjèDénou. Pour ce qui concerne Sadiga, la mairie s'est
portée volontaire pour payer sa participation financière (AERAMR,
2010).
Parmi les fontainiers interviewés, certains ont
confié qu'avant, les comités de gestion d'eau faisaient des
assemblées générales pour mettre au courant la population
des activités qu'ils mènent, mais avec la mairie qui est devenue
maître d'ouvrage, plus rien n'est fait à cet effet. La population
n'est plus tenue au courant des actions que la mairie mène.
Le comblement des plans d'eau et les aléas climatiques
affectent les sources d'eau superficielles et souterraines. Aussi, les fermiers
en exercice ont une qualification professionnelle peu requise avec des notables
et utilisateurs qui ne connaissent pas leur rôle dans la gouvernance des
ressources en eau.
La plupart des ouvrages d'eau sont des puits à grand
diamètre qui nécessite assez d'énergie. Il faut donc
déployer assez de force musculaire pour tirer un seau d'eau. Cela
devient un calvaire pour les populations en saison sèche car les puits
deviennent de plus en plus profonds et aussi, les sources d'eau superficielles
tarissent.
La population souffre souvent du manque d'eau du fait que
certains fontainiers ou fermiers se rendent au champ ou vaquent à leurs
occupations personnelles emportant ainsi la clé de l'ouvrage d'eau. Les
membres des Comités de Gestion des Points d'Eau (CGPE) dilapident les
recettes issues de la vente de l'eau et ne font plus de versement à la
CLCAM. Il a été aussi constaté depuis trois ans, qu'aucun
versement n'est fait par la plus part des ouvrages simples existant dans la
commune (ONG-AERAMR, 2011).
2. Facteurs externes
La gouvernance locale des ressources en eau de la commune de
Zè présente des opportunités et des menaces.
· Opportunités
La commune a de nombreux atouts pour mieux gérer les
ressources en eau dont elle dispose. Les enquêtes effectuées dans
la commune ont montré que la population de Zè s'intéresse
aux problèmes qu'elle rencontre dans la gouvernance des ressources en
eau. Lorsqu'un point d'eau est en panne, les sages et notables expriment le
besoin depuis la base c'est-à-dire au conseil du comité de
gestion d'eau qui à son tour, informera la mairie qui avisera la
Direction de l'Hydraulique ou les SIS pour la réalisation ou la
rénovation de l'ouvrage. Pendant la réalisation de l'ouvrage, la
population sans être inviter, participe activement à la
construction.
Désormais, la question de la gouvernance de l'eau
concerne aussi bien les autorités que la population ; « Etant
donné que la commune travaille pour la
population, elle se sent de plus en plus concernée par
ses actions et la soutien » (CST/Zè). Aussi, un gestionnaire d'eau
a affirmé : « Le puits appartient à tout le village, si
chaque foyer sait que c'est cette eau qu'il doit utiliser, il doit
l'entretenir. L'association de gestion d'eau du village, se regroupe
périodiquement pour discuter des problèmes qui concernent la
gestion des points d'eau du village ».
Le rapport annuel des activités de l'ONG-AERAMR
souligne que dans le cadre de la réalisation et de la rénovation
de certains ouvrages hydrauliques dans certains arrondissements de Zè ;
elle a remarqué que la population s'implique de plus en plus aux
questions de la gestion des ressources en eau. Au cours de ces multiples
réunions, la population et les autorités locales étaient
souvent présents (AERAMR, 2010).
D'une manière générale, la population de
Zè veut travailler avec la commune, mais ne souhaiterait en aucun cas
que le prix du bidon d'eau augmente et exige néanmoins la
réparation des ouvrages en pannes. Il faut noter que les comités
de gestions des points d'eau ont affirmé leur volonté de
travailler avec la communauté mais exigent que les personnes qui
s'occuperont de la gestion des nouveaux points d'eau réalisés et
rénovés par les ONG soient choisies dans leurs localités
respectives. La photo 12 est celle d'un puits moderne de l'Association Huma
Nature indiquant l'apport de la population à la commune dans le cadre de
la gouvernance locale de l'eau.

Photo 12: Puits de l'Association Huma Nature
à Akpali
Prise de vue : KANHONOU,
2011
Le puits moderne ci-dessus est une oeuvre de l'Association
Huma Nature qui vend l'eau à la population et cultive du manioc ;
l'association délègue chaque année un gestionnaire et
compte perfectionner le puits en le dotant d'un château pour mieux
désservir la population d'Akpali.
· Menaces
De nombreux risques environnementaux menacent les ressources en
eau de la commune. Plusieurs facteurs de pressions agissent sur ces ressources.
Entre
autre, les actions anthropiques (activités humaines) et le
mode de gestion utilisé(le contrat fermier). Les ressources en eau
subissent des pressions de plus en
plus fortes de la part des populations
qui en tirent une partie de leur revenu. On
note une faible mobilisation
sociale autour des programmes de développement
liés aux
ressources en eau et des difficultés d'accès aux points d'eau et
ouvrages
hydrauliques qui tombent régulièrement en panne.
L'inexistence d'une politique et/ou stratégie claire et
bien documentée de gestion des potentialités en eau (absence
d'instruments de gestion des ressources et d'outils d'aide à la
décision) empêche les autorités locales et les
gestionnaires d'eau dans leur action dans la commune. Aussi, le manque
d'information et de connaissances sur les principes et orientations sectoriels
et la protection des ressources en eau au niveau des collectivités
locales, la faible implication des acteurs et des usagers dans les prises de
décisions menacent également la gouvernance des ressources en
eau.
Les autorités locales ont une faible connaissance des
ressources d'eau disponibles dans la commune. L'accès difficile des
populations aux infrastructures adéquates d'alimentation en eau potable
et d'assainissement, à cause des manques d'investissements, l'absence
d'assistance technique et financière aux fermiers et aux gestionnaires,
la perturbation de l'écosystème due à l'usage abusive des
sources d'eau superficielles empêchent également la bonne
gouvernance des ressources en eau dans la commune.
Le secteur privé n'est pas encore réellement
impliqué dans les aspects liés à la gouvernance de l'eau.
Cela est dû au fait que la prise de conscience et la volonté
politique pour promouvoir la gestion rationnelle, équitable et
acceptée des ressources en eau sont assez récentes. L'implication
de toutes les catégories d'acteurs ne peut donc qu'être
progressive (GWP/AO, 2009).
Si les solutions techniques existent à ces faiblesses
et menaces et sont bien connues, les conditions d'exploitation et de gestion
utilisées actuellement dans l'ensemble de la commune constituent de
sérieuses menaces pour la protection et la préservation des
ressources en eau. Les obstacles liés à la faible capacité
de gouvernance locale des ressources en eau persistent toujours.
Néanmoins, l'étude propose des solutions pour assurer une
meilleure gouvernance locale des ressources en eau dans la commune de
Zè.
3.4. Suggestions
Afin d'assurer l'efficacité de la gouvernance locale
des ressources en eau et d'améliorer l'équité pour les
populations locales, une approche participative et communautaire est cruciale.
La décentralisation est un moyen prometteur de l'institutionnalisation
et de l'augmentation de la participation populaire qui fait de la gouvernance
locale, une gestion durable et efficace des ressources en eau (Ribot, 2002),
(De Jong, 2009).
La gouvernance locale récemment engagée ne
saurait être exempte d'insuffisances quand on sait que tout changement
requiert un minimum de temps et d'apprentissage de savoir-faire et de
savoir-être en vue d'une adaptation des différents acteurs
(Amadou, 2009).
Eu égard à tout ce qui précède, il
est important de définir certaines approches de solutions ou
stratégies à l'endroit de tous les acteurs intervenant dans la
gouvernance locale des ressources en eau de la commune de Zè :
'( A l'endroit de la commune
> créer des projets d'aménagement de l'espace
rural relatif à la conservation des eaux et des sols, à la
maîtrise des ressources en eau à des fins pastorales, ils doivent
être exécutés avec une planification cohérente, pour
contribuer à une mise en valeur durable des ressources en eau ;
> sensibiliser les acteurs et les usagers de l'eau à
prendre en charge la gestion des ressources en eau surtout celles des sources
d'eau superficielles ;
> faire appel à des partenaires techniques et
financiers pour voir dans quelles mesures ils pourront aider la population pour
l'approvisionnement des villages non desservis et dépourvus d'eau
potable ;
> oeuvrer pour un partenariat avec les partenaires financiers,
les ONG et les SIS qui s'occupent de la gestion de l'eau ;
> renouveler les équipements, revoir le prix de l'eau
pour faciliter l'accès à l'eau ;
> s'assurer de la qualité du service en demandant
l'avis des consommateurs, en enregistrant et en analysant les plaintes des
consommateurs par rapport à la qualité du service ;
> mobiliser toutes les ressources d'eau disponible dans la
commune dans un commun accord avec la population ;
? suivre la gestion de l'AEV après la
délégation de la gestion à un exploitant ;
> initier des campagnes de sensibilisation pour l'éveil
de la conscience des populations sur la gouvernance locale des ressources en
eau ;
? et poursuivre les campagnes de sensibilisation à
l'endroit des usagers sur l'intérêt de s'organiser pour une
gestion équitable et rationnelle, gage d'un développement
durable.
v' A l'endroit des fermiers
> conseiller les gestionnaires d'eau et financer le secteur de
l'eau ;
> mieux organiser les gestionnaires d'eau à travers les
formations et les conseils pour qu'ils soient beaucoup plus professionnels ;
> augmenter la capacité de stockage et de pompage des
ouvrages hydrauliques;
? faire l'extension et la densification du réseau de
distribution pour desservir les nouveaux quartiers ou villages, faire les
branchements privés et augmenter le nombre de points de distribution
;
? et définir un profil des membres du comité de
gestion du point d'eau et leur choix.
v' A l'endroit des structures d'intermédiation
sociales et des partenaires au développement
? penser à la rénovation et la
réhabilitation des ouvrages hydrauliques existants ;
> créer et formuler des cadres de concertation, de
collaboration et de coopération entre les acteurs intervenant dans le
secteur de l'eau ;
> promouvoir une collaboration entre les autorités
locales de la commune de Zè, la Direction de l'hydraulique, les
exploitants et les usagers ;
> établir un véritable dialogue entre les
différentes institutions intervenant dans le secteur de l'eau ;
> et augmenter les interventions du secteur privé
pour faire face aux sollicitations de la commune en matière de
construction d'infrastructures hydrauliques.
A l'endroit des exploitantsV
? faire l'entretien préventif qui consiste à
changer en temps utile, les pièces d'usures des pompes pour faciliter le
fonctionnement au quotidien et éviter une usure
accélérée des autres organes de l'ouvrage hydraulique ;
? faire un suivi pour amener les membres des comités de
gestion à verser les recettes issues de la vente de l'eau à la
CLCAM ;
? et prendre des engagements rigoureux concernant la vente de
l'eau et la bonne gestion de l'ouvrage ;
A l'endroit dellEITHHHIENIHIe
? éviter l'utilisation abusive des eaux superficielles
;
? utiliser rationnellement les ouvrages hydrauliques et surtout
les sources d'eau superficielles ;
? Regrouper la population en association ou comité de
gestion des points d'eau ;
? créer et mettre en place des mécanismes de
prévention et de règlement des conflits autours des ressources en
eau ;
? mobiliser la participation financière pour la
maintenance des ouvrages d'approvisionnement en eau ;
? créer un comité conseil pour
l'amélioration de la qualité de l'eau à usage domestique
;
? participer activement aux travaux de réhabilitation et
de nettoyage des ouvrages hydrauliques et des sources d'eau superficielles ;
? et enfin, identifier en collaboration avec les autres
acteurs impliqués, toutes les sources d'eau superficielles et
souterraines inaccessibles pour leur réhabilitation et une meilleure
connaissance des ressources en eau de la commune de Zè dans le cadre
d'une bonne gouvernance locale.
Conclusion
La commune de Zè dispose assez d'ouvrages hydrauliques
sur son territoire mais la gouvernance que les autorités locales, les
gestionnaires d'eau et plus précisément la population en font,
handicape la gestion de ces ouvrages.
L'abandon des ouvrages hydrauliques en panne est dû non
seulement au manque de financement mais surtout à la négligence
et à la mauvaise gouvernance des acteurs. Pour rendre plus efficace la
gouvernance locale à Zè, chaque village doit disposer de :
· un comité de gestion de point d'eau ;
· un comité de pisciculteurs ;
· un comité de maraîchers.
La décentralisation pourrait être une
première étape logique pour mettre en oeuvre la gouvernance et la
gestion de l'eau au niveau local. Seulement si les ressources et les pouvoirs
sont décentralisés, il est possible pour les autorités
locales de Zè de décider de la plupart des solutions durables
dans leur localité. Pour assurer l'efficacité des outils de mise
en oeuvre, la participation de la population locale doit être
primordiale, ce qui est le mieux possible avec un Etat démocratique de
décentralisation des réformes.
D'après les analyses et les informations recueillies
sur ce thème, il ressort que la commune de Zè dispose d'un
potentiel hydrique important mais beaucoup de contraintes entravent
l'exploitation rationnelle et la gestion judicieuse des ressources en eau. La
gouvernance locale, pour être effectif, doit donc tenir compte de
l'apport de la population à la base.
Etant donné que les autorités locales
travaillent pour la population, il urge qu'il y ait une gestion
concertée entre les deux parties afin d'assurer une bonne gouvernance
locale.
Les constats et les suggestions soulevés dans cette
recherche, permettront sans doute aux autorités locales et aux
gestionnaires des ressources en eau de la commune de Zè de tracer une
bonne stratégie de gouvernance pour l'utilisation
rationnelle de cette richesse qui reste toujours précieuse
pour tout développement social, économique et durable.
La décentralisation occupe aujourd'hui une grande place
dans la gestion des ressources en eau. Dans le cadre d'études
postérieures, des réflexions seront faites sur la valorisation
des bas-fonds de la commune de Zè à travers le rôle des
acteurs de l'eau et de la population locale pour un développement
durable. L'étude portera sur le thème : «
DECENTRALISATION ET ROLE DE LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE DANS LA
VALORISATION DES MARECAGES EN ZONES RURALES : CAS DE LA COMMUNE DE ZE
».
BIBLIOGRAPHIE
1- Adam K. S., Boko S. 1983: Le Bénin,
Edicef, 96p
2- Adandedjan E. 2009 : Gestion de l'eau dans
l'arrondissement de Kpankou, commune de Kétou, Mémoire de
maîtrise, UAC. Bénin, 88p.
3- Adomou A. 2008 : Décentralisation
et gouvernance de l'eau en milieu rural au Bénin : cas de la commune de
Toffo, département de l'Atlantique, Diplôme d'Etude
Supérieure Spécialisée, IUB. Bénin, 80p.
4- Amadou M. 2009 : La problématique
de la communication dans la gouvernance locale au Bénin : le cas de la
commune de Savè. Master en développement communautaire. UAC,
Bénin, 89p.
5- AOC. 2006 : Schéma Directeur
d'Aménagement Communal de Zè, Cotonou, 121p.
6- Azonsi F. Alé G. Cougny G. 2009 :
Processus de gestion intégrée des ressources en eau au
Bénin, 21p.
7- Baron Carine et Bonnassieux Alain. 2008 :
Accessibilité aux ressources en eau et participation des
acteurs locaux : quelles réponses faces aux enjeux de durabilité
cas des Associations d'Usagers de l'Eau au Sud-ouest du Burkina-Faso.
Journées du développement du GRES, Burkina-Faso, 23p.
8- Boko F. 2012 : Contribution à la
mobilisation et à la gestion des eaux pluviales dans l'arrondissement de
Banikoara, Mémoire de maitrise, UAC, Bénin, 60p.
9- Boko S.Y.W. 2009 : Gestion communautaire
des ressources en eau et conflits d'usage dans la basse vallée de
l'Ouémé. Diplôme d'Etude Supérieure
Spécialisée. UAC, Bénin, 62p.
10- CARE International, 2007 : La bonne
gestion de l'eau facteur du développement. Article de journal Mai 2007,
Projet visant l'accès à l'eau, Maroc.16p.
11- Chleq J-L, Dupriez H, 1997 : Métiers
de l'eau du Sahel : Eaux et terre en fuite, Terre et vie, L'harmattan, 121p.
12- DED. 2005 : Cahier des villages et
quartiers de ville du département de l'Atlantique/RGPH-2002, Novembre
2005, Cotonou, 35p.
13- De Jong D. 2009 : Afrique du Sud:
Défaillances municipales, Mettez la Décentralisation en
péril. Den Haag: Conférence Internationale de l'eau et
l'assainissement. URL-Consulté le: 25.10.2010. 12p.
14- Dictionnaire Universe!, 1995 :
Hachette/Edicef. Paris, 1498p
15- Djoï L.M. 2011 : Stratégie
de l'eau et de l'assainissement dans la commune de Sèmè-Kpodji,
Mémoire de maîtrise géographie, UAC, Bénin, 82p
16- Egoun!ety Biokou A. Amegankpoe C. Araye R. 2008 :
L'approche GIRE appliquée à la gestion des ouvrages
d'eau potable à l'échelle communale dans les communes de
Zè. Rapport de formation, Niaouli, 37p.
17- Faha!a A., Guidibi E. 2009 : Monographie
de la commune de Zè, Programme d'appui au démarrage des communes,
Afrique Conseil, Bénin, 27p.
18- Fateha J. (2010) : Gouvernance de l'eau
et autorités locales en Méditerranée : La gestion de la
pollution, Mémoire de stage, UNSA, Nice, 82p
19- Geny P., 1992 : Environnement et
développement rural (guide de gestion des ressources naturelles). Paris,
Frison-Roche-ACCT-MCD, 397p.
20- GWP. 2009 : Activités de
promotion de gouvernance locale autour des forages artésiens de Tohoue
et Gnanli-Zassa ; commune de Zogbodomey. Rapport de synthèse et
d'étape. Bénin, 73p.
21- GWP/AO. 2009 : Evaluation de la gouvernance
de l'eau au Bénin : analyse de la situation et actions prioritaires,
52p
22- Hounmenou B.G. 2006 : Gouvernance de l'eau
potable et dynamique locales en zone rurale au Bénin. DESS, UAC, 63p
23- INSAE, RGPH2, (Février 1992),
Fichiers villages, Novembre 1994
24- INSAE, RGPH3, (Février 2002),
Résultats Définitifs, Décembre 2003
25- INSAE, 2005 : Cahier des villages et
quartiers de ville : département de l'ATLANTIQUE, Cotonou, 35p.
26- Janique, E., (2003) : Eau et
assainissement : croyances, modes et modèles, in Afrique contemporaine,
in Afrique contemporaine, Paris, pp.103- 116.
27- Koudamiloro O. 2011 : Gestion
endogène de l'eau de consommation et problèmes sanitaires dans
l'arrondissement de Challa-Ogoï, Mémoire de maîtrise, UAC,
Bénin, 79p.
28- Kpohonsito F. 2007 : La gestion
communale des ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu rural au
Bénin : cas de la commune de Bopa, Mémoire de maitrise, UAC,
Bénin, 94.
29- Mairie de Zè, 2006 : Schéma
Directeur d'Aménagement Communal de la commune de Zè, 118p.
30- Mairie de Zè, 2006 : Plan de
développement communal de la commune de Zè, 134p
31- Mathieu J.L. Laurent .J .L. 2001 :
Géographie 2e, Programme 2001, NATHAN. Italie,
287p.
32- MEPN. 2008 : Programme d'Action National
d'Adaptation aux Changements Climatiques du Bénin (PANA-Bénin)
,81p.
33- MSPCL. 2006 : Recueil des lois sur la
Décentralisation. Bénin, 172p.
34- ONG-AERAMR. 2011 : Rapport annuel des
activités d'Avril 2010 à Mars 2011 à Zè.
Bénin, 61p.
35- PACT, 2010 : Programme d'Appui aux
Collectivités Territoriales, Feuille de route du PDC de la commune de
Zè (Version provisoire), Aout 2010,83p
36- PADEAR. 2008 : Intermédiation
sociale aux Adductions d'eau villageoise/ Guide à l'usage des communes,
Version3, Novembre 2008, 56p.
37- PPEA. 2010 : Intermédiation sociale
pour les ouvrages simples/ Guide à l'usage des communes, Version1,
Décembre 2008, Bénin, 62p.
38- Pierre G., Fernand V. 1998 :
Dictionnaire de la Géographie, 6ème
édition, Presse Universitaire de France, 487p.
39- Ribot J. 2002: Décentralisation
africaine: Acteurs locaux, Pouvoir et accessibilité. Démocratie,
Gouvernance et droit de l'homme. Genève: United Nations Research
Institute for Social Development (UNRISD) and International Development
Research Centre (IDRC). (Consulté le: 25.10.2010), 59p.
40- Vissin E. 2007 : Impact de la
variabilité climatique et de la dynamique des états de surfaces
sur les écoulements du bassin béninois du fleuve Niger.
Thèse de doctorat, Bourgogne, 286p.
41- Yamongbe T.C. 2011 : Approvisionnement
en eau potable et problèmes sanitaires dans la commune de Zè.
Mémoire de maitrise en géographie, UAC, Bénin, 73p.
42- Yelouassi X.N.A. 2011 : Eau potable et
gestion des équipements hydrauliques de la commune
d'Athiémé (Sud-Bénin). Mémoire de maîtrise,
UAC, Bénin, 77p.
Liste des tableaux :
Tableau I :
Documentation...................................................................
25
Tableau II : Répartition des
ménages
enquêtés............................................
27
Tableau III : Synthèse de la situation
hydraulique dans la commune de Zè......... 31 Tableau IV :
Projection de la population de Zè face à ses besoins en
point d'eau
47
79
de2010 à
2015.................................................................................
Tableau V : Hauteurs mensuelles de pluies de la station de
Toffo de 2000 à 2010..
Liste des figures :
Figure 1 : Situation de la commune de
Zè..................................................
19
Figure 2: Régime pluviométrique moyen
mensuelle de Zè de 1965 à 2008.......... 20
Figure 3 :
Point des ressources en eau de la commune de
Zè......................... 30
Figure 4: Fréquence d'utilisation des
eaux souterraines pour les usages
domestiques.................................................................................
40
Figure 5: Répartition de l'usage des ressources
en eau en saison pluvieuse dans la
communede
Zè..........................................................................
42
Figure 6 : Répartition de l'usage des ressources
en eau en saison sèche dans la
communede
Zè..........................................................................
43
Figure 7: Contrat fermier :
Délégation par la commune à un fermier...............
45
Figure 8 : Taux d'implication des acteurs dans la
gestion des ressources en eau
dans la commune de
Zè.......................................................................
53
Figure 9: Modèle d'analyse de la gouvernance
locale des ressources en eau de la
commune de Zè à l'aide de
SWOT.........................................................
55
Liste des photos :
Photo 1 : Piste rurale de Goulo en saison
pluvieuse.................................... 21
Photo 2 : Citernes à Zè centre et
à Hèkanmè........................................
32
Photo 3 : Tozounmè et Havito, plan d'eau
et source thermale aménagée à Hèkanmè
33 Photo 4 : Vue d'une Borne Fontaine à Adjanhonou et
d'une AEV à
Koundokpoé....................................................................................
34
35
36
36
37 39 41 55 59
Photo 5 : Vue d'un Poste d'Eau Autonome à
Koundokpoé...........................
Photo 6 : Vue
d'un Forage Equipé d'une Pompe à Motricité Humaine
à
Guékoumèdé
Photo 7 : Vue d'un Puits traditionnel dans le
village d'Aïfa............................
Photo 8 : Vue d'un puits moderne à
Akadjamè.......................................... Photo 9 :
Vue d'un Champ irrigué à Adjan..............
................................. Photo 10 : Châteaux
d'eau privés à Goulo et
Havikpa..................................
Photo 11 : Rôle des femmes et des enfants
dans la gestion de l'eau
Photo 12: Puits de l'Association Huma Nature
à Akpali
ANNEXE
I- QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
A l'endroit des ménages
1-Identification
1. Date de l'enquête| | | | | | | | | | |
2. Arrondissement :
3. Village :
4. Nom et Prénoms de l'enquêté
5.Âge : 1. >20ans|__| 2. <40ans|__| 3. <50ans|__|
4. >60ans|__|
6. Genre 1. Homme |__| 2. Femme|__|
7. Quelle est votre activité principale?
8. Ethnie :
9. Nombre de personnes dans le ménage |__| 1. Moins de
5|__| 2. De 5 à 10
10. Quelles sont vos sources d'approvisionnement en eau en
saison pluvieuse? 1. Rivière|___| 2. Lac|___| 3. Marigot|___| 4.
Bas-fonds|___| 5. Puits traditionnel du village|___| 6. Citerne|___| 7. Pompe
(Borne Fontaine, Branchement Privé) |___| 11. Autres|___|
2-Types d'usages et modes de gestion des ressources en
eau
11. Quelles sont vos sources d'approvisionnement en eau en
Saison sèche ?
12. Laquelle utilisez-vous le plus fréquemment ?
13. Qui sont les usagers de ces points d'eau
14. quelle est leur provenance ?
15. Quels sont les usages que vous faites de l'eau?
16. Existe-t-il des structures de gestion de la ressource en eau
? Si oui, qui sont-t-elles?
17. Combien en existe-t-il? A qui appartiennent-ils ?
18. Quelle distance faites-vous pour aller à la source
d'eau ? 1. Moins de 01 km|__| 2. 1 à 5 km|__| 3. Plus de 5 km
19. Avez-vous de l'eau disponible en toute saison ?|__| 1.
Oui|__| 2. Non
20. Si non, pendant combien de temps vous en manquez
21. L'eau couvre-t-elle tous vos besoins? |__| 1. Oui|__| 2.
Non
22. comment la-conservez-vous?
3-Efficacité des modes de gestion des ressources
en eau
23. La conservation de l'eau est-t-elle efficace selon vous ? 1.
Oui|__| 2.Non|__|
24. Comment les structures de gestion gèrent les
ressources en eau?
25. La manière dont-t-elles gèrent l'eau
est-t-elle efficace ? 1. Oui|__| 2. Non|__|
26. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la
gestion de vos sources d'approvisionnement en eau ?
27. Existe-il des structures locales de résolution de ces
problèmes ? 1. Oui|__| 2. Non |__|
28. Qui les a mis en place ? |__| 1. Etat|__| 2. ONG|__| 3.
Autorités locales|__|
29. Les structures sont telles efficaces ? |__| 1. Oui|__| 2.
Non
30. Comment fonctionnent-elles?
4-les mesures pour améliorer la gestion des
ressources en eau
31. Quel est le rôle des ménages et des usagers de
l'eau dans la gouvernance locale des ressources en eau ?
34. Que pensez-vous de la gouvernance locale de la ressource en
eau?
35. Est-ce qu'elle permet une gestion efficace et rationnelle de
l'eau?
36. Suggérer vous des solutions sur la manière
dont on doit gérer les ressources d'eau disponible?
II- Grille d'entretien
A l'endroit des autorités locales et ceux qui
s'occupent de la gestion de l'eau 1-Identification
1- Date de l'enquête |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
2- Arrondissement de :
3- Village de | |
4- Nom et Prénoms de l'enquêté :
5- Âge |____|
6- Profession :
7- Nombre de personnes dans le ménage
2-Les types d'usages et les modes de gestion des
ressources en eau
8- Comment s'appelle votre structure ou votre ONG ?
9- Qui sont les gestionnaires d'ouvrages d'eau ?
10- Quel est votre rôle dans la gestion de l'eau ?
11- Depuis quand fonctionne telle ?
12- Comment gérez-vous les ressources en eau dont vous
disposez ?
13- Etes-vous un membre de l'AUE ou de l'AEV ? |__| 1.oui
|__|2.non
14- Quels sont les modes de gestion en eau que vous utilisez?
15- A quelles fins utilisez-vous l'eau ?
16- Quelles techniques utilisez-vous dans la gestion des
ressources en eau ?
17- Comment se fait la distribution de l'eau ?
18- Qui vous aide dans vos taches ?
19- Quel est le rôle des AEV et AUE ?
20- Arrivez-vous à subvenir aux besoins en eau de la
population ? |___| 1.Oui |___| 2.Non
3-Efficacité des modes de gestion des ressources
en eau
21- Si non, pourquoi ?
22- L'eau est telle vendu ? Si oui à quel prix ?
23- Quelle qualification professionnelle avez-vous?
24- Etes-vous satisfait des prestations des structures de
gestion de la ressource en eau ? |___| 1.Oui |___| 2.Non Si Non, pourquoi ?
27- Comment qualifiez-vous vos actions dans la commune?
28- Quelles sont les structures qui existent dans la commune?
29- Les structures sont-elles efficaces ? Comment?
30- Quelles sont les différents secteurs dans lesquels
vous intervenez ?
31- Comment se fait la gestion des ressources en eau dans chaque
secteur?
32- Comment arrivez-vous à faire participer la population
et ainsi, faire en sorte qu'elle se sente impliquée dans la gestion des
ressources en eau ?
33- Entretenez-vous des rapports avec ces structures ?
34- Qui entretient et maintient les installations d'eau ?
35- Selon vous, la gestion de l'eau est-elle efficace? Si non,
pourquoi ?
36- Quelles sont les problèmes de gestion que vous
rencontrez ? 4-Les mesures pour améliorer la gestion des
ressources en eau
37- Est-ce-que vous arrivez au bout de ces problèmes?
38- D'où proviennent vos sources de financement pour
l'entretien des sources d'eau et ouvrage d'eau?
39- Y a-t-il des habitants de la commune qui n'ont pas
accès à l'eau? Si oui, pourquoi?
40- Comment éviter cela?
41- Quelles solutions envisagez-vous?
42- Y-a-t-il des politiques de réduction du prix de l'eau
dans la commune? Si oui, citez-les ?
43- Payez-vous une redevance (somme versée en contre
partie d'un service) à la commune? Si oui, combien? | | 1.Oui ? | |
2.Non
44- Quels rapports avez-vous avec les services de l'eau?
45- Quels rapports avez-vous avec la mairie?
46- Quels rapports avez-vous avec les partenaires financiers?
Quelles sont les réalisations de l'Etat en matière de gestion des
ressources en eau?
47- Quelles sont les actions et mesures à prendre pour
mieux gérer les ressources en eau ?
48- Quelles sont les actions de la commune en vue d'une
meilleure gestion des ressources en eau ?
49- Obtenez-vous des conseils ou des aides? Si oui,
auprès de qui ou de quelle structure?
50- Comment comptez-vous atteindre vos objectifs?
51- Quel rôle joue la mairie dans la gestion des
ressources en eau?
52- Quelles sont selon vous, les procédures à
suivre pour assurer une meilleure gestion des ressources en eau?
III- GRILLE D'OBSERVATION 1- Les points d'eau
|
Points d'eau
|
Puits traditionnel
|
Puits moderne
|
Forage
|
Rivière
|
Lac
|
Marigot
|
Pompe
|
|
Présence
|
Oui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Non
|
|
|
|
|
|
|
|
2- Aménagement des points d'eau
Points d'eau aménagés
|
Clôture
|
Couvercle
|
Regard
|
Margelle
|
Présence
|
Oui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3- Gestion des points d'eau
Présence dans les points
d'eau
|
Présence de flasque
d'eau
|
Pompe rouillée
|
Présence d'animaux domestiques
|
Présence de mauvaises herbes
|
Vétusté des ouvrages d'eau
|
Equipements neufs et propres
|
Oui
|
|
|
|
|
|
|
Non
|
|
|
|
|
|
|
|
4- Comportement des utilisateurs
|
Utilisateurs
|
Affluence le matin
|
Affluence à midi
|
Affluence le soir
|
Entretien des points d'eau
|
Gestion des points d'eau
|
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Non
|
|
Femmes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hommes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enfants
|
|
|
|
|
|
|
|
IV- Tableau V : Hauteurs mensuelles de pluies de
la station de Toffo de 2000 à 2010
|
Mois
Année
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
2000
|
-
|
10,4
|
86,2
|
47,2
|
141,1
|
175,9
|
104,9
|
90,5
|
78,2
|
195,2
|
39,2
|
-
|
|
2001
|
-
|
6,6
|
14,0
|
23,7
|
163,3
|
221,2
|
24,5
|
35,7
|
152,1
|
164,8
|
16,6
|
-
|
|
2002
|
50,0
|
-
|
97,9
|
-
|
90,1
|
289,5
|
268,6
|
36,0
|
65,0
|
345,3
|
62,6
|
-
|
|
2003
|
39,3
|
37,3
|
56,9
|
169,2
|
41,3
|
188,2
|
112,0
|
-
|
283,5
|
373,1
|
186,0
|
18,6
|
|
2004
|
48,5
|
-
|
119,5
|
-
|
-
|
114,7
|
30,0
|
95,6
|
204,6
|
199,5
|
46,7
|
-
|
|
2005
|
-
|
22,5
|
290,6
|
60,5
|
109,0
|
-
|
71,0
|
72,0
|
206,5
|
234,0
|
79,0
|
8,0
|
|
2006
|
-
|
5,5
|
121,7
|
80,0
|
353,5
|
233,5
|
21,5
|
9,0
|
285,0
|
35,0
|
162,0
|
-
|
|
2007
|
-
|
60,0
|
40,0
|
151,5
|
183,3
|
225,5
|
161,0
|
117,0
|
260,0
|
303,0
|
55,0
|
2,5
|
|
2008
|
-
|
-
|
137,5
|
66,0
|
91,5
|
237,5
|
260,7
|
71,2
|
117,3
|
136,3
|
31,9
|
-
|
|
2009
|
13,5
|
58,6
|
47,0
|
185,5
|
213,3
|
184,2
|
106,4
|
56,8
|
103,8
|
82,5
|
79,2
|
-
|
|
2010
|
22,0
|
_
|
192,4
|
100,3
|
157,1
|
-
|
149,0
|
173,5
|
230,6
|
244,5
|
143,9
|
20,5
|
Source : ASECNA, LACEEDE, 2011
Table des matières
DEDICACE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 2
SOMMAIRE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 SIGLES ET
ACRONYMES ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 REMERCIEMENTS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 5 Résumé/ Abstract
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 6
INTRODUCTION~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 CHAPITRE I :
CADRES THEORIQUE, CONCEPTUEL ET GEOGRAPHIQUE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..
9 1.1. Cadre théorique de
l'étude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 1.1.1.
Problématique~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 9 1.1.2.
Hypotheses~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. 11 1.1.3.
Objectifs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 11 1.1.3.1. Objectif
général~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 11 1.1.3.2.
Objectifs spécifiques~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11 1.2.
Cadre conceptuel de l'étude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11
1.2.1. Définition opératoire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
11 - Gouvernance locale~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. 11 -
- Décentralisation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12
- - Ressources en eau 12
- - Autorités locales
12
1.2.2. Point des connaissances~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
13
1.2.3. Cadre conceptuel de l'étude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..
16 1.3. Cadre géographique de
l'étude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. 18 1.3.1. Milieu
d'étude~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 18 1.3.2. Relief et
climat~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 20 1.3.3. Sol et
végétation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 21 1.3.4.
Population et activités économiques~~~~~~~~~~~~~~~~... 22
CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE~~~~~~~~~~~... 23
2.1. Nature des données~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..
23
· Les données pluviométriques
23
· Les données démographiques
23
· Les données
socio-anthropologiques~~~~~~~~...~~~~~~~~~ 23
2.2. Outils ou matériels de collecte des
données~~~~~~~~~~~~~~ 24 2.3. Collecte des
données~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 24 2.3.1. Recherche
documentaire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 24 2.3.2. La
pré-enquête~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 25
2.3.3. Enquête de terrain~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
25
2.3.4.
Echantillonnage.........................................................................
26
2.4. Traitement des
données...................................................................
27
2.5. Analyse des
données......................................................................
28
Chapitre III : Résultats et
suggestions......................................................
29
3.1. Etat des lieux des ressources en eau de la commune de
Zè......................... 29
3.1.1. Ressources en eau de la commune de
Zè.......................................... 32
1. Les eaux
atmosphériques.................................................................
32
2. Les eaux
superficielles....................................................................
33
3. Les eaux
souterraines......................................................................
34
·
L'AEV.......................................................................................
34
· Le PEA
......................................................................................
35
· Les forages
..................................................................................
35
· Les Puits
traditionnels......................................................................
36
· Les Puits
modernes.........................................................................
37
3.1.2. Usages par types de ressources en
eau............................................... 37
· Usages des eaux
atmosphériques..........................................................
37
· Usages des eaux superficielles
............................................................
38
· Usages des eaux
souterraines..............................................................
39
3.1.3. Variation saisonnière des ménages
aux ressources en eau........................ 41
· En saison
pluvieuse.........................................................................
41
· En saison
sèche..............................................................................
42
3.1.4. Mode de gestion des ressources en eau et des ouvrages
hydrauliques......... 43
3.1.5. Problèmes du mode de gestion des ressources en
eau............................ 45
3.1.6. Projection de la population de Zè face à ses
besoins en point d'eau............ 47
3.2. Acteurs de la gouvernance locale des ressources en eau de
Zè..................... 48
1.
L'Etat.........................................................................................
48
2.
Commune....................................................................................
49
3. Structures d'Intermédiation Sociale et les partenaires
du développement.......... 50
4.
fermier.........................................................................................
51
5.
Exploitant...................................................................................
51
6. Population locale...........................
................................................. 52
3.3. Gouvernance locale des ressources en eau de la commune de
Zè................. 54
3.3.1. Application du modèle SWOT à la gouvernance
locale des ressources en eau
dansla commune de
Zè........................................................................
54
1. Facteurs
internes............................................................................
56
· Forces
........................................................................................
56
·
Faiblesses«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~.
57
2. Facteurs externes
«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~.
58
· Opportunités
«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~.
58
· Menaces
«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~.
60
3.4. Suggestions 61
ü A l'endroit de la
commune«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
62
ü A l'endroit des fermiers 63
ü A l'endroit des structures d'intermédiation
sociale et des partenaires au
développement«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
63
ü A l'endroit des exploitants 64
ü A l'endroit de la population
locale«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~..
64
Conclusion«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~..
65
Bibliographie«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
67
Liste des tableaux 71
Liste des
figures«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~..
71
Liste des
photos«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
71
Annexe«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
72
Table des
matières«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~«~
78



