|
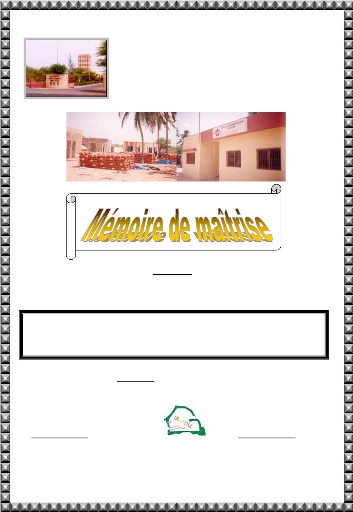
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS
*************
UFR DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
****************
SECTION DE GEOGRAPHIE
************
Option:
ENVIflONNLMLNT
|
Une zone maraîchère en crise au nord du Sénégal
: le Gandiolais et le Toubé dans la communauté rurale de Gandon
|
Présenté par : Papa Daouda DIOP
Sous la direction de : Année universitaire :
Géraud MAGRIN Géographe
Avec le concours de GIRARDEL
GIRARDEL / U.G.B. CIRAD-TERA 2004/2005
2
DEDICACES
Nous dédions ce travail :
À feu Papa Balla et feue Maman
Bintou Diop, pour leur affection et leur soutien sans faille. Sources
éternelles d'amour sincère, votre fils jure de rester à
jamais votre chantre. Certes, je n'ai pas eu la chance et le bonheur de vivre
longtemps auprès vous. Mais sachez que je suis fier de vous. Je prends
en témoin mes frères et soeurs de l'oeuvre que vous avez
laissée derrière vous pour que la famille reste toujours unie.
Ce travail est aussi dédié à tous ceux qui
ont toujours cru à notre réussite. On pense à :
- nos soeurs Fatou, Anta et Binta Thiam1 (pour son
soutien sans faille depuis mes premières années universitaires)
;
- nos frères Amadou, Djiby, Moussé Bar, Ibrahima,
leurs épouses et leurs enfants;
- Badara, Magatte, Masse, Khalifa, Abdou ;
- notre Tante Fatou Mbaye et à toute sa famille. Cette
grande dame ne cessera jamais de marquer nos années passées au
lycée. Chez elle, on était plus que son propre fils. Dieu nous
est témoin.
Au nom de vous tous, nous dédions ce travail à
tous ce qui, de près où de loin, ont contribué à
notre formation.
Nous dédions ce travail à :
- nos amis et frères d'enfance Thiouna Bâ, Aba
Diop, Aïda Diop, Cheikh Diop, Daouda Diop, Masse Diop, Momar Talla Diop,
Rokhaya Mbaye, Moussa Sène, Mamadou Wade et à tous les
frères « Entente ».
- tous les camarades de promotion et aux étudiants
résidents du G6C et du bloc C (village J). - à nos amis et
frères étudiants Madièyna Bakhoum, Papy Barry, Diaé
Camara, feu Patrick Coly, Nassirou Dicko, Cheikh Diop, Souleymane Diop, Betty
Diouf, Ousmane Bitèye Diouf, Kadiata Gaye, Marie Ndao, Timack Ngom,
Aïssatou Sène, Jean Christophe Sagna, ... Qu'ensemble nous
réussissons. Amen !
1 Employée du CROUS à l'agence comptable
particulière (A.C.P.)
3
REMERCIEMENTS
Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce ce que nous
avons eu l'honneur et le bonheur de connaître dans notre vie des
formateurs de qualité. De l'école primaire à
l'université en passant par le collège et le lycée, que
tous nos enseignants trouvent ici nos remerciements.
Nous accordons une mention spéciale à celui qui
nous a enseigné la meilleure méthode de raisonnement et de
travail que nous n'avons jamais connue, nous voulons citer notre directeur de
mémoire Géraud Magrin. Il faut dire combien dans cette recherche
nous lui sommes redevables pour sa disponibilité, son appui scientifique
et la rigueur méthodologique apportées, malgré ses
multiples contraintes.
Sans l'existence préalable d'une formation de
qualité reçue dès nos premiers pas à
l'université et sans le concours précieux d'un certain nombre de
personnes, ce travail ne serait peut-être pas réalisé.
Ainsi, nous tenons à remercier particulièrement :
- Les enseignants de la section de géographie notamment
: Adrien Coly, André D'Alméida, Mouhamadou Maouloud
Diakhaté, Oumar Diop, Serigne Modou Fall, Cheikh Sarr, Sidy Mouhamed
Seck, Boubou Aldiouma Sy, Cheikh Samba Wade, auxquels nous exprimons notre
profonde gratitude.
- Le personnel élu du conseil rural de Gandon, les
agents des services techniques spécialisés, les membres du
comité de développement local, les membres des organisations
communautaires de base ciblées qui ont bien voulu nous aider à
obtenir des informations, parfois embarrassantes, sur lesquelles repose tout le
travail.
- Les camarades avec qui nous avons travaillé sur le
terrain : Haby Bâ Der, Maïmouna Diallo, Ibrahima Diatta, El hadj
Malick Thioune et à toute l'équipe du GIRARDEL,
particulièrement à Aminata Camara, qui n'a ménagé
aucun effort pour la réussite de ce travail.
4
SOMMAIRE
INTRODUCTION 5
Première partie : Le Gandiolais et le
Toubé, un cadre physique et humain, favorable à
l'activité agricole 16
Chapitre I : Caractéristiques du milieu physique et
dynamique du secteur agricole dans le
Gandiolais et le Toubé 17
Chapitre II : Données socio-économiques et
systèmes de productions agricoles dans le
Gandiolais et le Toubé 29
Deuxième partie : Facteurs explicatifs de
l'évolution et des contraintes des systèmes de
production agricole dans le Gandiolais et le Toubé
43
Chapitre I : Dynamiques des systèmes de production
agricoles 44
Chapitre II : Quelques contraintes liées aux
systèmes de productions agricoles du
Gandiolais 79
.
Troisième partie : Quelles perspectives pour
l'agriculture du Gandiolais ? 91
Chapitre I : Stratégies à adopter pour
atténuer les problèmes de l'agriculture du
Gandiolais 92
Chapitre II : Quelques orientations possibles pour un
développement agricole durable 104
CONCLUSION 112
5
INTRODUCTION
Dans les pays sahéliens, où le premier facteur
de production est l'eau, sévissent de graves situations de
sécheresse entraînant d'importantes pénuries de
denrées alimentaires. Depuis la fin des années 1960, le
déficit hydrique est constant. Les pluies sont insuffisantes, viennent
trop tard, s'arrêtent trop tôt ou parfois s'interrompent trop
longtemps. La sécurisation de l'alimentation en eau est donc, sans
doute, l'élément qui pourrait offrir les meilleures
possibilités d'augmentation des productions agricoles. L'agriculture
traditionnelle, caractérisée par un outillage rudimentaire, se
trouvait jusqu'au début des années 1970 en équilibre avec
les besoins locaux. Aujourd'hui, elle ne parvient plus à assurer la
sécurité alimentaire. Les rendements, particulièrement
vivriers, ont globalement peu évolué au cours des trois
dernières décennies et les augmentations de production ne sont,
le plus souvent dues qu'à un accroissement des surfaces
cultivées. Cet accroissement est lié soit à la mise en
valeur des terres marginales, peu favorables à l'exploitation agricole,
soit à la réduction du temps de jachère.
L'équation reste aujourd'hui de se demander comment
augmenter la production agricole, transformer l'agriculture traditionnelle en
une agriculture moderne tout en permettant qu'un équilibre existe entre
les besoins humains et les ressources offertes par le milieu naturel. Il s'agit
également de se demander comment faire pour que les systèmes de
production agricole basés sur les cultures itinérantes soient
compatibles avec le maintien de la fertilité des sols.
Dans un souci d'accroissement de la production agricole,
depuis la fin des années 1960, l'Etat du Sénégal, par
l'entremise de la SAED (Société Nationale d'Aménagement et
d'Exploitation des terres du Delta du Sénégal et des
Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé),
a orienté les pratiques agricoles du Delta vers d'autres systèmes
de culture : cultures irriguées et cultures maraîchères qui
viennent s'ajouter sur les cultures de décrues qui s'y
développaient déjà. Le Delta du Sénégal
s'étend sur 150 kilomètres de Richard Toll à l'embouchure
du fleuve Sénégal. Dans le Delta, où les systèmes
de production agricole ont subit de profondes mutations à cause de la
sécheresse, la main-mise de l'homme sur le milieu se manifeste souvent
par une série de dégradation : pression forte sur les surfaces
agricoles utiles, coupe abusive des espèces végétales
favorisant la dynamique éolienne. Le Gandiolais et le Toubé (voir
carte n°1) qui occupent l'extrémité Sud du Delta du
Sénégal, se présente comme un exemple.
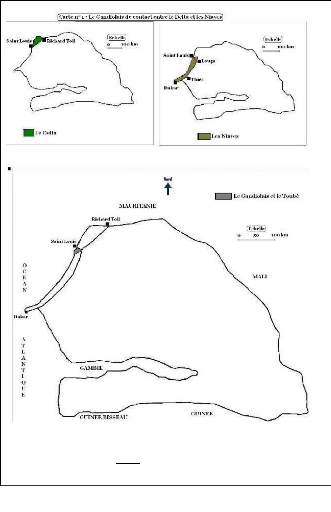
Source : Diop P. D. - 2005 -
6
7
Situés au Nord-Ouest du Sénégal, le
Gandiolais et le Toubé sont également une partie
intégrante de la zone des Niayes, dont ils occupent
l'extrémité septentrionale. Cette situation, de contact entre le
Delta et les Niayes, leurs confère une particularité
géographique, longtemps favorable à la production
maraîchère.
La région des Niayes s'étend en bordure du
littoral de la presqu'île du Cap-vert jusqu'au Sud de Saint Louis, au
niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Elle est
constituée d'une série de dépressions inter dunaires qui
s'étale en arrière de la côte. « Les Niayes proprement
dites correspondent à des lacs asséchés et à des
vallées anciennes où la nappe phréatique affleure. Dans
les Niayes, près de 57% des exploitations maraîchères se
développent sur les versants sableux ». (Ouatara D., 1989 : 2).
Dans son premier Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols
(POAS) élaboré par la SAED, la communauté rurale de
Gandon, avec une superficie de 560 km2, compte 81 villages et 25
hameaux, répartis en quatre zones (voir carte n°2),
caractérisées chacune par une particularité agricole : le
secteur de Rao occupe le Sud-est de la communauté rurale. Dans cette
zone, la culture sous pluie et l'élevage sont les principales
activités ; au Nord-est, c'est la zone de Ndiawdoune, où on
pratique les cultures irriguées, les cultures de décrues et un
peu de maraîchage ; le secteur de Toubé est situé à
l'ouest. Il abrite les cultures sous pluies et un peu de maraîchage, et
enfin, au Sud-ouest c'est la zone du Gandiolais, située sur le littoral.
C'est une zone, qui est réputée être un secteur de
maraîchage par excellence. La communauté rurale de Gandon est
limitée au Nord par la communauté rurale de Ross Béthio,
à l'Ouest par l'océan atlantique et la commune de Saint Louis,
à l'Est par la communauté rurale de Mpal, au Sud et au Sud-est
par les communautés rurales de Sakal et de Keur Momar Sarr
(région de Louga).
La zone du Gandiolais et de Toubé compte 35 villages
(18 villages dans le Gandiolais et 17 villages dans le Toubé) et
plusieurs hameaux, dont certains sont rattachés au village le plus
proche. Elle couvre une superficie de 350 km2, soit 65% sur les 560
km2 de la communauté rurale. Cette zone est
particulièrement frappée par une concentration de sel sur les
sols (35 g/l). La région est caractérisée par une
série de dépressions inter dunaires qui va de la côte vers
le continent et constitue une importante zone de maraîchage. Par sa
position estuarienne, la zone est soumise sur le plan hydrologique à
l'influence directe du fleuve Sénégal. Elle
bénéficie également d'un important réseau
hydrographique : le Ngalam, la cuvette de Gueumbeul, située à une
quinzaine de kilomètre au Sud de Saint Louis et plusieurs autres
mares.
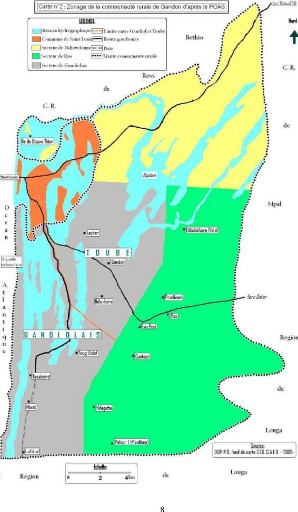
fcat e I%'2:Zonaga de 4a oumn minaute rtirale co
Gatlünn d'apr 1w PO/LS:
HEIL
Reibto
77
·l +
Riic' 1
·
·f.
·
C. R
·
i
·
·
i r
·
t *
t it
i ~
· 'r
f* *;...a
4lC
deBa:11Th 'I
i
i#*...... * ...:
L1n
· 1.6
·
r
·
Ll
L
q Lr L.
VreklÎJr'
·
· J:
E.
·
n lig ~~;~j
Loup
Tam
KIP PL. Fend de !mite n.C. SA1.a
· MOS
·
Ittgioit
Loup
4f[
W ail
2
Ia
8
i
·
i
·
P'r--1 Lai lit rLilt (.1
Tomikr
Cn ijwur Jr SABI IanMr--1 Lratr itnickr.7p4r
E] fCttI Ç ôr i~likianLlmur4.. ~l't tr
jr4trorn ik- ilr.) ' ' iZ I]wIru
fi'Hiii rr11Lt YIrJ .
~e rfnwr do S,nndinlnn
9
PROBLEMATIQUE
La population du Gandiolais a une longue tradition
maraîchère. Durant la période de la colonisation, le
Gandiolais produisait toutes sortes de productions destinées à la
population européenne qui vivait à l'époque à Saint
Louis : la patate douce, le manioc, le haricot, le niébé, le
béréf, la pomme de terre, le piment, la tomate (Bonnardel R.,
1992 : 200). Les produits étaient aisément écoulés
sur les marchés de la capitale coloniale (Saint Louis). A
côté de l'activité agricole se développait la
pêche maritime et continentale, l'extraction du sel et l'activité
pastorale.
A partir des années 1970, en raison d'un cycle de
sécheresse qui persiste et de multiples contraintes
socio-économiques, la population du Gandiolais se spécialise aux
cultures maraîchères, particulièrement dans la production
d'oignons. Une spécialisation imputable à la dégradation
des eaux et des terres par la remontée saline, à l'abondance des
produits maraîchers venus d'autres localités, à
l'émergence du marché national au déclin du marché
local. A ceux-là, s'ajoutent l'ouverture du barrage de Diama en 1986 et
de la nouvelle embouchure en 2003 qui, tout rendant les terres du Gandiolais et
de Toubé impropres à l'exploitation agricole, accroissent la
concentration de la salure dans les sols et les nappes du sous-sol. Avant la
mise en place du barrage, les crues du fleuve Sénégal
enregistrées à Saint Louis, avec un régime tropical
caractérisé par une crue de juillet à octobre et un
étiage de novembre à juin, étaient liées aux pluies
enregistrées dans le haut bassin en amont de Bakel. La décrue
commençait dès que les pluies diminuaient et s'échelonnait
de novembre jusqu'en mai. C'est pendant cette période de décrue
que se produisait l'intrusion de l'eau de mer, la langue salée qui,
avant la mise en eau du barrage de Diama, pouvait remonter le fleuve sur
environ 200 km en amont de Saint Louis, rendant ainsi impropres les terres du
Delta et du Gandiolais. C'est dans ce contexte qu'a été
créé le barrage, situé à 27 km au nord de Saint
Louis. Il a pour rôle d'arrêter la remontée de la langue
salée dans sa partie amont et d'y créer un lac de retenu en eau
douce. En revanche, dans sa partie avale, où se situe la
communauté rurale de Gandon, le barrage de Diama accroît la
concentration de la salure dans les sols et les nappes du sous-sol.
La nouvelle embouchure, ouverte sur la langue de Barbarie,
durant la nuit du 3 au 4 octobre 2003, favorise une entrée brutale des
eaux salées après le retrait des eaux de crue. Elle a pour
objectif, d'après le service régional de l'Hydraulique, de
préserver la ville de Saint Louis
10
des inondations (Diop I. : communication orale)2.
Cette brèche (ou canal de délestage) fait l'objet de plusieurs
interrogations sur l'avenir de la gestion de l'environnement local,
particulièrement sur les cultures littorales dans la langue de Barbarie
et sur le maraîchage dans le Gandiolais (Diatta I., 2004 : 63).
Dans le Gandiolais, la nappe phréatique
présente de l'eau douce dans la partie orientale, sur les dunes rouges.
En revanche, elle se dégrade dans la partie occidentale proche de la
côte avec une minéralisation allant jusqu'à 2,5 g/l.
Cependant, la réalisation du canal du Gandiolais (travaux en cours) pour
réalimenter le bassin de Rao Peul au Sud-Ouest et la vallée du
Gandiolais pourrait favoriser la désalinisation des terres du Gandiolais
(Bâ H., 2005 : 95).
Le maraîchage, qui est la principale activité
agricole de la zone, bénéficie d'un microclimat favorable
à la production agricole, d'une nappe phréatique peu profonde sur
le littoral (moins de 3m). Il mobilise une population active locale
composée essentiellement de personnes âgées, dont la
moyenne d'âges tourne autour de 50 ans. Celles-ci sont assistées
par des enfants de moins de 18 ans. A cause de la pénibilité des
travaux agricoles et des rendements de plus en plus faibles, de la
dégradation progressive des eaux et des sols, des difficultés
d'accès aux terres fertiles, les acteurs agricoles, notamment les
adultes, migrent vers les grandes villes (Richard Toll, Dakar).
En raison de la dégradation des conditions climatiques
du milieu et de la surexploitation3 des faibles réserves en
eau douce, l'offre agricole du Gandiolais est de moins en moins
compétitive et la vente locale de plus en plus difficile dans les
marchés locaux. Comme solution, on assiste depuis 2004, à
l'émergence d'un système de production agricole jamais connu dans
le Gandiolais et le Toubé, qui se développe dans de nombreux
villages à travers des G.I.E. (Groupement d'Intérêt
Economique) féminins. Il s'agit des micro-jardins « hors sol
».
L'élevage est le second secteur d'activité
socio-économique du Gandiolais et est étroitement lié
à l'agriculture par la fourniture de la fumure organique. Les principaux
acteurs sont des Peuls, avec quelques bergers Wolofs et Maures. Le
bétail est constitué pour l'essentiel de petits ruminants (ovins
et caprins).
2 Le 9 juin 2004 à
l'amphithéâtre Madické Diop (Amphi A) de l'U.G.B., s'est
tenue une conférence sur le thème : « La brèche
de Saint Louis, solution ou catastrophe ? ». Elle a vu la
participation de certains enseignants de la section de géographie et du
service de l'hydraulique.
3 La nappe du Gandiolais est constituée par
une faible couche d'eau douce sous jacente à la nappe salée. Ces
réserves, estimées à 10.000m3/ha, font l'objet d'un
pompage important par les maraîchers (10 mm/j/producteur). A long terme,
on assiste à l'épuisement de la nappe d'eau douce ou à sa
pollution par contamination. (Aw F.Z., 1999 : 34).
11
En dehors des activités agro-pastorales, la population
du Gandiolais pratique également le commerce, la pêche et
l'exploitation du sel (voir El. M. Thioune,)4.
En raison de l'enclavement de certains villages, gros
producteurs de cultures maraîchères, les contraintes liées
à l'agriculture dans le Gandiolais ne se limitent pas aux facteurs
physiques et naturels du milieu. Les maraîchers du Gandiolais font aussi
face aux difficultés liées à l'écoulement des
produits agro-alimentaires (stockage, distribution, transport et
commercialisation). Le facteur de transport constitue un frein à
l'évacuation et à l'écoulement des produits agricoles du
Gandiolais. L'absence de marchés hebdomadaires (Louma) dans la zone est
un autre facteur limitant l'écoulement des produits agricoles locaux. La
communauté rurale de Gandon ne dispose que d'un marché
hebdomadaire (le marché de dimanche à Pelour) qui est d'envergure
limité à cause de sa position géographique5.
En plus de ces difficultés liées à la
production, au transport et à l'écoulement des produits
agricoles, la population du Gandiolais se heurte à d'autres
difficultés d'ordre économique et social. Malgré l'appui
de grands partenaires comme l'Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles (ISRA), la CARITAS, le PLAN Sénégal, etc., les
producteurs continuent toujours d'endurer les coûts élevés
des intrants, l'enclavement des zones de production, la non maîtrise du
calendrier cultural. Les populations du Gandiolais et de la communauté
rurale en général, ont compris que pour qu'il y ait un
développement dans leur localité, il leurs faut élaborer
et mettre en oeuvre des stratégies concertées. Elles se lancent
ainsi dans des initiatives locales de développement. C'est dans ce sens
que des initiatives sont engagées par la population pour promouvoir le
développement de leur localité. Il y a parmi ces initiateurs,
l'Association pour le Développement du Gandiolais et de Toubé
(A.D.G.T), des associations des jeunes et de femmes qui existent dans tous les
villages.
Face à toutes les contraintes techniques et
socio-économiques étroitement liées aux impacts
climatiques, le Gandiolais reste toujours un pôle maraîcher. Une
meilleure maîtrise du milieu apparaît comme une
nécessité dans la perspective d'un développement
basé sur la productivité agricole et qui soit en
adéquation avec la nature et les attentes de la population riveraine.
C'est cette situation qui a conduit, d'une part, à des stratégies
paysannes de migration des espaces culturaux ou à l'exode rural, et
d'autre part à la réalisation du canal du Gandiolais.
L'édification du barrage de Diama, la surexploitation
de la nappe d'eau douce, le déficit pluviométrique depuis 1968,
garant d'une évaporation intense et récemment l'ouverture de
la
4 El Hadj Malick Thioune, mémoire de
maîtrise en cours de rédaction, L'exploitation des salines
littorales du Gandiolais (bas Delta du fleuve Sénégal : une
activité en sursis ?), université Gaston Berger de Saint
louis.
5 Pelour 1 (ou Mboltime) se situe à
l'extrême Sud de la communauté rurale de Gandon, dans le secteur
de Rao.
12
nouvelle embouchure sur la langue de Barbarie, sont entre
autre, quelques uns des phénomènes qui expliquent l'origine de la
salinité des sols et des eaux souterraines dans le Gandiolais. Cette
situation contraint les producteurs agricoles à abandonner les terres de
cultures devenues salées à l'Ouest (sur le littoral), impropres
à toute exploitation agricole et à délaisser à
l'Est (sur les dunes et dans les dépressions inter dunaires) les
cultures vivrières au profit de l'activité
maraîchère, malgré toutes les contraintes
rencontrées.
Pour apporter des solutions à ces différentes
contraintes, cette étude s'est fixée comme objectif de trouver
des réponses à un certain nombre d'interrogations. Il s'agit de
voir si le Gandiolais fait face à une crise socio-économique et
écologique qui constitue une entrave à l'évolution de la
production agricole. Quels seraient les facteurs explicatifs de cette crise ?
Quelles stratégies adopter pour faire face à cette crise ? Y
a-t-il une différence entre l'évolution actuelle du Gandiolais et
celle du reste des Niayes ? Après avoir identifié les facteurs
responsables de cette crise, les résultats obtenus pourraient permettre
de proposer des orientations pour surmonter ces contraintes. Pour
répondre à ces interrogations, deux hypothèses sont ainsi
retenues :
- Une meilleure maîtrise du milieu et de ces
contraintes s'avère indispensable pour un développement agricole
durable dans le Gandiolais et le Toubé.
- Le rapprochement du secteur agricole des autres secteurs
d'activités socio-économiques au niveau de la C.R. de Gandon,
dans une dynamique de gestion intégrée, pourrait favoriser le
développement de la localité.
13
METHODOLOGIE
La méthodologie adoptée pour l'accomplissement
de ce travail s'inscrit dans le cadre de la vérification des
hypothèses de départ dégagées dans la
problématique, afin d'atteindre les objectifs fixés.
Trois étapes ont permis de présenter ces
résultats
1. la recherche documentaire ;
2. le travail d'enquêtes de terrain ;
3. le traitement des données recueillies sur le
terrain.
Recherche documentaire
Cette recherche s'est déroulée dans des
institutions spécialisées à la recherche scientifique. Les
recherches effectuées dans ces institutions ont permis de consulter
plusieurs ouvrages généraux qui traitent le thème sur
l'agriculture et le développement rural et certains documents
scientifiques qui présentent des études sur le Delta et les
Niayes. Parmi ces institutions, il y a les bibliothèques de
l'université de Saint Louis et de Dakar, le centre de documentation de
l'Unité de Formation et de Recherche (U.F.R.) des lettres et sciences
humaines, la salle de documentation de GIRARDEL (Groupe interdisciplinaire de
recherche pour l'appui à la planification régionale et au
développement local).6
Enquêtes de terrain
Sur le terrain, la documentation s'est effectuée au
niveau de la maison communautaire de Gandon, dans les différents centres
spécialisés en agriculture et en développement rural
(SAED, ISRA, ANCAR,...), les mutuelles et organisations communautaires de base.
En ce qui concerne les services spécialisés, il s'agissait
d'étudier leur relation avec la communauté rurale et les acteurs
locaux ainsi que les formes de partenariat qu'ils entretiennent avec eux. Quant
aux mutuelles et les organisations communautaires de base, il s'agissait de
voir leur mode de fonctionnement, les atouts, limites et perspectives, ainsi
que leur rapport avec les autres secteurs de développement de la
communauté rurale. Malgré une bibliographie assez abondante sur
le thème de recherche, peu de publications récentes ont
été trouvées sur le Gandiolais.
6 Le GIRARDEL est un réseau de recherche
appliqué au développement qui associe des chercheurs de
différentes disciplines (...). Il essaie d'instaurer un véritable
partenariat avec les collectivités locales qui le souhaitent (...). Loin
de l'approche « projet », il s'agit ici de mettre en oeuvre dans la
durée une démarche d'accompagnement des collectivités
(Magrin G., Traoré B., 2003 : 3).
14
Parallèlement à cette étude
thématique, plusieurs séjours ont été
effectués sur le terrain. Le premier déplacement dans la zone a
été effectué dans le secteur du Gandiolais du jeudi 18 au
mercredi 24 mars 2004. L'objectif fixé pour ce premier séjour sur
le terrain était de mieux connaître le milieu et les acteurs
agricoles. Ceci nous a permis de faire une première analyse sur les
systèmes de cultures maraîchères et de vérifier les
hypothèses de départ. On a également saisi cette occasion
pour discuter avec quelques notables de la localité, les chefs de
villages et responsables de groupements. Ceux-ci nous ont permis pour chaque
déplacement de choisir deux à trois villages, d'aller visiter les
exploitations maraîchères et de soumettre une série de
questionnaires (cf. annexes 6) aux différents exploitants.
Le second déplacement dans cette même zone a eu
lieu les 17, 18 et 19 avril. Ce séjour nous a permis de visiter certes
quelques villages, mais il nous a surtout poussé vers les
maraîchers et les employés temporaires (sourgha). Les
discutions portaient sur les pratiques culturales, les méthodes de
gestion, l'écoulement des produits et les contraintes. Pour les
sourgha, l'essentiel des entretiens était axé sur leurs
conditions de vie, le système de partage, les accords préalables
avec leur employeur.
Entre le 22 et 27 juin, nous avons effectué un autre
séjour toujours dans le secteur du Gandiolais. Ce séjour de six
jours a permis de visiter d'autres villages et hameaux à Gandiol. Les
dernières visites ont été faites dans le secteur de
Toubé pendant l'hivernage qui coïncide avec la période des
cultures sous pluies. Enfin, pour faire sortir les ressemblances d'une zone
à une autre, on s'est rendu dans le Gandiolais durant l'hivernage (21,
22 et 23 août). Ainsi on a visité 23 villages et hameaux, soit les
deux tiers de l'ensemble du Gandiolais et de Toubé. Pour avoir une
vision plus claire sur l'agriculture et ses contraintes, quelques villages du
secteur de Rao (Gantour, Ndoye Diagne, Pelour, Rao Peul et Ndialakhar Wolof)
ont également été visités. Le choix porté
sur les villages enquêtés se justifie par plusieurs raisons :
situation géographique, du Sud (Dégou Niayes), on est allé
jusqu'au Nord (Ndiébène Toubé Peul), en passant par
Ndiakhère (voir en annexe 2 la liste des villages
enquêtés). L'objectif était de couvrir toute la zone et de
faire ressortir les points communs et les différents qui existent d'une
zone à l'autre. Certains villages comme Mboumbaye, Ricotte ont
été ciblés pour leur rôle dans le secteur
maraîcher.
Les questions portaient sur l'identification de la personne
interrogée, la pratique de l'activité agricole, les
différentes variétés utilisées, les moyens
utilisés, le produit et sa destination. On s'est aussi
intéressé sur l'organisation interne des producteurs, leurs
rapports avec la communauté rurale et les partenaires au
développement.
15
Sur les 23 villages enquêtés, on a estimé
qu'il fallait interroger au moins le dixième de la population. Mais
faute de données chiffrées sur la population de chaque village,
on a décidé d'interroger au moins 10 personnes par village pour
les villages moins peuplés et 20 à 30 personnes pour les villages
peuplés. Concernant les hameaux, il était décidé
d'interroger toute personne rencontrée. A la fin de l'enquête, on
a recensé, sur treize gros villages, sept petits villages et trois
hameaux, plus de 140 personnes interrogées. L'âge des personnes
enquêtées est au minimum 15 ans et 71 ans au maximum. La
majorité était des hommes. Des entretiens sont aussi tenus avec
les acteurs locaux, afin d'avoir une idée sur leur vision de
l'agriculture et les perspectives envisageables pour son
développement.
Ces enquêtes ne se sont pas effectuées sans de
grandes difficultés. Certaines personnes refusaient de nous recevoir ou
restaient indifférentes à notre présence. « Beaucoup
ont passé avant vous et ça ne nous a rien servi »,
c'était souvent la réponse que nous donnait cette population,
particulièrement celle du Gandiolais occupée de leurs travaux
agricoles. D'autres nous demandaient d'aller se rapprocher du chef de village
ou bien d'attendre que le propriétaire du champ soit là (il
s'agit souvent d'un frère ou d'un père). Ce dernier, dont on
ignorait où il était et quand est ce qu'il devait être sur
les lieux, n'arrivait presque jamais. Certains villages étaient presque
inaccessibles pendant la saison des pluies, à cause de l'état des
pistes. Au niveau de la maison communautaire de Gandon, le président,
n'étant pas alphabétisé, répondait sommairement aux
questions avant de nous demander de se rapprocher de sa secrétaire.
Cette dernière ne manquait pas de nous demander de repasser
prochainement pour une raison ou une autre. L'essentiel des informations
recueillies dans les locaux a été obtenue auprès de
quelques conseillers ruraux. Ces derniers, dont certains d'entre eux
comprennent parfaitement l'intérêt de nos recherches, nous
demandent même de leur faire parvenir une copie du document final
à la fin du travail d'étude et de recherche. Hormis ces quelques
difficultés, le travail de terrain a été satisfaisant.
Traitement de données :
Le traitement de données recueillies sur le terrain a
été fait à l'aide de l'outil informatique. Les textes sont
saisis sous Word (office 2003). Les courbes et les graphiques ont
été réalisés sous Excel. Les cartes et les photos
ont été modifiées et améliorées sous Paint.
Enfin, Power point a été très utile dans l'agencement des
points retenus pour la rédaction finale.
16
Première partie :
*******
Le Gandiolais et le Toubé, un cadre
physique et humain, favorable à
l'activité agricole
17
CHAPITRE I
Caractéristiques du milieu physique et dynamique
du secteur agricole dans le Gandiolais
1. L'influence des facteurs climatiques sur les
pratiques agricoles
Il s'agira de caractériser ici le climat du Gandiolais sur
la base de quelques éléments
notamment la température, l'humidité relative,
la pluviométrie, les vents, etc. Ces paramètres pourraient
permettre de mieux saisir les influences directes des manifestations
atmosphériques à la surface du sol et donc d'observer les liens
favorables entre le climat et l'agriculture.
1.1. Le régime thermique
Cette partie est consacrée à l'étude de la
température, de l'humidité relative et de
l'évaporation. Au terme de l'analyse de ces quelques
éléments de l'atmosphère, on parviendra à
déterminer les effets climatiques propices à l'agriculture du
Gandiolais.
1.1.1. La température
La zone du Gandiolais présente un climat de type
sahélien qui, en raison de la proximité de l'océan,
reçoit l'influence côtière qui contribue à
l'atténuation des températures dans la zone du littoral.
L'étude de celles-ci montre des disparités à travers
l'existence de deux saisons : la saison chaude qui va de juillet à
octobre, avec des valeurs moyennes mensuelles supérieures ou
égales à 31°C (cf. tableau 1), et la saison froide de
novembre à juin, caractérisée par une température
moyenne mensuelle inférieure ou égale à 26°C,
d'où la longueur et l'intensité de la saison sèche. Ces
disparités thermiques ont leur influence sur les pratiques agricoles. La
saison chaude correspond à la période des cultures sous pluies
pratiquées dans toute la zone, particulièrement dans les villages
de Toubé. Tandis que la saison froide reste favorable aux cultures
maraîchères.
Tableau 1 : Température moyennes mensuelles
(1995-2004)
|
MOIS
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
T°c
|
26
|
28
|
28
|
27
|
28
|
29
|
31
|
31
|
32
|
32
|
30
|
--
|
Source : Météo nationale - station
régionale de Saint Louis - (2004)
L'atténuation des températures dans la zone du
littorale offre à la partie côtière du Gandiolais un
micro-climat caractérisé par un temps frais, propice à la
production de nombreuses spéculations, notamment l'oignon, la tomate et
la patate douce.
18
1.1.2. L'humidité relative :
L'humidité de l'air détermine les flux de vapeur
d'eau dans l'atmosphère. En saison des pluies, elle dépasse
largement la valeur des 60% du mois juin au mois de septembre, où le
maximum des maxima atteint 68% au mois d'août. Tandis que les minima sont
enregistrés durant les mois de décembre, janvier, février
et mars avec un minimum qui avoisine les 25% aux mois de janvier et
février.
Tableau 2 : Moyenne mensuelle de l'humidité
relative entre 1995 et 2004
|
MOIS
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
|
H. R.
|
25
|
25
|
33
|
42
|
53
|
63
|
67
|
68
|
66
|
52
|
34
|
28
|
Source : Météo nationale - station
régionale de Saint Louis - (2004)
Cette situation notée en saison froide, combinée
à l'influence thermique, constitue un atout favorable à la
production agricole durant toute cette période, d'où la
possibilité de mettre en place plusieurs spéculations
maraîchères, telles que l'oignon, la carotte, la pomme de
terre.
1.1.3. L'évaporation :
Les faibles valeurs enregistrées pendant la saison des
pluies s'expliquent par l'effet des pluies et de la couverture nuageuse, qui
atténue le phénomène d'évaporation, mais aussi par
l'influence de l'alizé maritime, frais et humide parcourant la zone
littorale. Durant la saison sèche, l'évaporation devient plus
forte avec un maximum de 62% enregistré au mois de janvier (cf. tableau
3). C'est également la période pendant laquelle on note un
assèchement global de la quasi-totalité des plans d'eau
superficielle, inondés par la crue en hivernage. Ainsi les exploitants
maraîchers, pour satisfaire la forte demande en eau douce, se rabattent
sur la nappe profonde. De ce fait, on assiste à une exploitation intense
des réserves de la nappe d'eau douce (seule source d'alimentation pour
le maraîchage accessible à travers des puits forés) et
à la remontée de la nappe salée sous jacente de la nappe
d'eau douce.
Tableau 3 : Moyenne mensuelle de l'évaporation en
mm (2002-2004)
|
MOIS
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
AN.
|
|
Evap.
|
62
|
61
|
59
|
46
|
42
|
32
|
28
|
27
|
29
|
29
|
55
|
58
|
44
|
Source : Météo nationale - station
régionale de Saint Louis - (2004)
Les plus faibles valeurs de l'évaporation sont
notées entre juillet et octobre avec un minimum de 27mm au mois
d'août. Le taux d'évaporation moyenne annuelle est d'environ
2.400mm (FAO : Organisation pour l'Agriculture et l'Alimentation -
Météo nationale - Saint
19
Louis - 2004). L'évaporation est loin d'être
couverte par la pluviométrie (environ 200 à 250 mm/an) et le
déficit hydrique est important surtout pendant la saison
sèche.
1.2. Le régime pluviométrique
Le Gandiolais est situé au coeur de la zone
sahélienne (16°W et 16°N), au Sud de l'isohyète 300mm,
correspondant au bas Delta du Sénégal. Cette situation lui
confère un régime tropical caractérisé par deux
saisons : une longue saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à
juin) et une courte saison des pluies de 2 à 3 mois (juillet à
septembre) qui coïncide avec l'arrivée du FIT (Front inter
tropical) dans la région de Saint Louis.
On peut individualiser trois saisons principales à
durée presque similaire :
- l'hivernage (ou la saison des pluies) de juillet à
septembre/octobre ;
- la saison sèche froide qui va de novembre à
février ;
- la saison sèche chaude qui va de mars à
juin.
Dans le Gandiolais, les pluies sont faibles, uniquement
alimentées par les lignes de grains. Elles sont le plus souvent de type
orageux. Du fait de sa position septentrionale (Nord-Ouest), le FIT s'installe
tardivement, vers le début du mois de juillet, annonçant ainsi le
début de la saison des pluies. Ces pluies sont
irrégulières et inégalement réparties dans le
temps. Les mois d'août et de septembre restent les mois les plus pluvieux
de l'année (cf. tableau 4).
Outre la concentration temporelle des pluies, le Gandiolais,
à l'image de l'ensemble du Delta, est également
caractérisé par une très grande variabilité inter
annuelle. Cette incertitude du bilan hydrique annuel constitue un handicap pour
les cultures sous pluies. La moyenne pluviométrique annuelle varie entre
250mm et 350mm. Ceci suscite chez les populations une incertitude autour des
dates de semis et sur l'ensemble du cycle végétatif des cultures
vivrières telles que le mil, le niébé, le
béréf. En 2004 par exemple, les premières pluies ont
été recueillies le 29 juin (0,2mm) et ce n'est que 26 jours plus
tard, les 22, 23 et 24 juillet que l'hivernage a débuté à
Saint Louis avec respectivement 0,5mm, 0,2mm et 0,6mm de pluies (cf. annexe 4,
tableaux 2). Ceci se traduit sur le terrain par un abandon des cultures sous
pluies ou par la réduction des terres réservées à
ce type de culture. Le nombre de jours de pluies durant la période
1995-2004 révèle par ailleurs une faible disparité inter
annuelle, avec en moyenne 25 jours de pluies par année.
20
Tableau 4 : Moyenne mensuelle de la pluviométrie en
mm (1995-2004)
|
ANNEES
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
CUMUL
|
|
1995
|
-
|
2
|
Tr
|
-
|
-
|
3
|
38
|
102
|
126
|
11
|
1
|
33
|
316
|
|
1996
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
11
|
19
|
47
|
23
|
16
|
Tr
|
-
|
117
|
|
1997
|
-
|
-
|
Tr
|
-
|
3
|
9
|
-
|
146
|
62
|
-
|
Tr
|
-
|
220
|
|
1998
|
Tr
|
1
|
Tr
|
Tr
|
-
|
-
|
2
|
132
|
122
|
4
|
Tr
|
Tr
|
202
|
|
1999
|
Tr
|
-
|
Tr
|
Tr
|
-
|
-
|
54
|
147
|
33
|
127
|
-
|
-
|
361
|
|
2000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
174
|
159
|
68
|
46
|
-
|
-
|
447
|
|
2001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70
|
84
|
102
|
19
|
-
|
-
|
276
|
|
2002
|
68
|
-
|
-
|
1
|
-
|
14
|
28
|
28
|
70
|
89
|
-
|
-
|
298
|
|
2003
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1
|
1
|
10
|
47
|
229
|
62
|
-
|
NP
|
352
|
|
2004
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,2
|
1,7
|
94
|
34,1
|
-
|
-
|
-
|
130
|
|
NORMAL
|
68
|
3
|
1
|
3
|
4
|
38,2
|
296,7
|
656
|
869,1
|
373
|
1
|
33
|
256
|
Source : Météo nationale - station
régionale de Saint Louis - 2004
Pendant presque 10 ans, le nombre de jours de pluies n'a pas
atteint 40 jours avec un maximum de 39 jours en 1995 et un minimum de 18 jours
en 1997. Parallèlement, on note une baisse du volume
pluviométrique, passant de 318mm en 1995 à 130mm en 2004 (cf.
tableau 5). Tableau n°5 : Hauteurs de la pluviométrie et
nombre de jours de pluies entre 1995 et 2004
|
années
|
hauteurs pluies en mm
|
nombre de jours de pluie
|
|
1995
|
318,7
|
39
|
|
1996
|
117,1
|
25
|
|
1997
|
263,4
|
18
|
|
1998
|
260,4
|
24
|
|
1999
|
363,7
|
32
|
|
2000
|
431,4
|
26
|
|
2001
|
275,3
|
32
|
|
2002
|
296,9
|
24
|
|
2003
|
350,6
|
30
|
|
2004
|
130
|
23
|
Source : Météo national - station
régionale de saint Louis - 2004
Cette faiblesse des quantités de pluies
enregistrées peut être expliquée par le long parcours
continental du FIT (des pluies) avant d'arriver au Nord.
21
L'hivernage dans le Gandiolais et en général
à Saint Louis a une durée limitée. Selon la station
météorologique de Saint Louis, sur un intervalle de 91 jours en
2004, il n'y a eu que 23 jours de pluies. Les premières pluies ont
été enregistrées le 29 juin avec 0,2mm ; tandis que la
date du 27 septembre marque la fin de l'hivernage de la même année
avec 4,5mm. Cette courte saison des pluies combinée à une
irrégularité temporelle influe sur les eaux stagnantes. Les eaux
de crue qui commençaient à s'installer, se retirent plutôt
que prévu. Ce retrait prématuré avant que tous les plans
d'eau ne soient inondés et la nappe suffisamment alimentée, fait
que les réserves humides, qui satisfont le maraîchage après
le retrait des crues sont très limitées. Figure n°1 :
Evolution de la hauteur pluviométrique à Saint Louis de 1995-2004
(en mm)
431
364
351
319
263
260
297
275
117
130
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Source : Météo nationale - station
régionale de Saint Louis - 2004
Avec un bilan hydrique largement déficitaire depuis
plusieurs décennies, les cultures sous pluies bénéficient
d'autres types de pluies plus ou moins favorables à leur
évolution. Il s'agit d'abord des pluies de contre saison (ou pluies de
« heug »), qui tombent entre novembre et février. Elles sont
certes faibles, mais peuvent limiter l'action érosive du vent en
imbibant le sol. Il y a aussi la rosée et les brouillards, qui apportent
de l'humidité au sol et aux plantes. Ces pluies favorisent une baisse
des températures et une hausse de l'humidité de l'air. Elles
constituent également un apport hydrique important pour les cultures de
la saison froide.
22
1.3. Le régime des vents
La zone du Gandiolais et de Toubé est soumise à
l'influence de trois masses d'air :
- l'harmattan (ou alizé continental), vent chaud et sec
qui souffle pendant la saison sèche entre mars et juin ;
- les alizés maritimes, vents frais, secs et
chargés d'embruns. Les embruns sont une pluie fine formée par
l'écrêtement des vagues par le vent. Ce sont de petites masses
d'air saturées en eau salée qui circulent, dans le Gandiolais,
pendant la saison froide. Favorables aux cultures maraîchères,
elles soufflent de novembre à février ;
- enfin, la mousson, chargée d'humidité et
porteuse de pluies, souffle de juillet à octobre. L'analyse de
l'évolution de la vitesse moyenne mensuelle des vents à Saint
Louis présente une grande variabilité avec des maxima en pleine
saison des pluies atteignant 16,3m/s au mois d'août. Pendant cette
période, les vitesses mensuelles sont au-dessus des 12m/s, avec le
minimum des maxima de 12,75 m/s au mois d'octobre.
Figure n°2 : Evolution de la vitesse moyenne
mensuelle des vents en m/s (1995-2004)
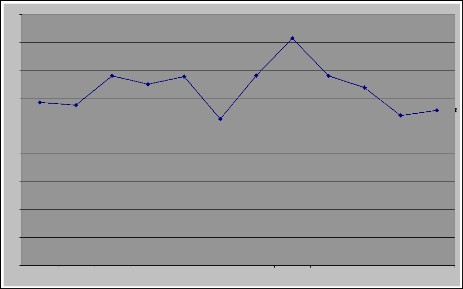
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,6
|
13
|
13,55
|
|
13,62
|
13,6
|
12,75
|
|
|
|
11,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,5
10,5
11,12
janvier fevrier mars avril mai juin juillet
août septembre octobre novembre décembre
Source : Météo nationale - station
régionale de Saint Louis - 2004
Ces chiffres annoncent une période éolienne
où le vent constitue un véritable facteur d'ensablement des
cuvettes maraîchères. Sans les quelques espèces
végétales sur et aux abords des dunes, qui affaiblissent la
vitesse du vent, toutes les cuvettes maraîchères situées
dans les dépressions inter dunaires seraient entièrement
ensablées. La raréfaction des pluies, limitant la germination des
espèces herbacées, livre un sol vulnérable aux caprices
des vents
23
tourbillonnants. Ceux-ci érodent le sol et lui
emportent ses éléments fertilisants, causant des problèmes
d'ensablement des axes hydriques existants et des cuvettes
maraîchères le plus souvent situées dans des
dépressions. Ces sols affaiblis, où les rares averses
ruissellent, réduisent les possibilités d'alimentation des
réserves hydriques du sol, entraînant la remontée de la
nappe salée.
2. Le Gandiolais, une zone écologique
vulnérable
Dans le bas Delta en général, l'altitude est
partout faible et de vastes étendues sont en dessous du niveau de la
mer. Tous les sols de l'embouchure à Richard-Toll sont salés,
avec des variations suivant les milieux. C'est une région qui
bénéficie d'un important potentiel hydraulique, mais de plus en
plus menacée par la remontée du sel en surface. Le Gandiolais et
le Toubé présentent généralement les mêmes
caractéristiques hydriques et biogéographiques que le Delta, mais
compte tenu de l'influence de la région naturelle des Niayes, on
relève quelques caractères spécifiques à cette
zone.
2.1 Typologie des sols
Dans le Gandiolais comme dans l'ensemble du Delta, la
salinité sur les sols s'explique par deux faits. Elle est d'une part
« liée aux invasions marines du quaternaire, qui ont salé
les sols de la profondeur et les nappes souterraines » et d'autre part
à « l'eau de mer qui remonte le fleuve en période
d'étiage » (Bonnardel R., 1992 : 196).
Dans la communauté rurale de Gandon, on peut identifier
trois à quatre types de sols (cf. figure n°3):
- les sols sableux (sols diors) compacts et à
teneur d'argile élevée. Favorables à la culture sous
pluies (arachide, petit mil, béref, niébé) et au
maraîchage, ils couvrent environ 61% des terres de la communauté
rurale de Gandon (Gandon, 2001 : 27). Ces terres s'étendent sur une
bonne partie du Gandiolais et couvrent l'ensemble des parties Nord (le
Toubé);
- les sols du Walo (zone de Ndiawdoune) couvrent 5% des terres
de la C.R. de Gandon. Ces sols sont annuellement inondés par les crues.
Ils constituent le domaine privilégié de la culture du maïs,
du riz et du sorgho ;
- enfin, il y a les sols alluviaux et les sols salins, qui
couvrent respectivement 24% et 10% de la superficie totale de la
communauté rurale. Les sols alluviaux sont des sols constitués de
dépôts alluvionnaires laissés par les eaux. Ce sont des
sols favorables à la culture maraîchère
24
tandis que les sols salins constituent des zones d'extraction du
sel. Figure n°3 : Typologie des sols dans la communauté
rurale de Gandon
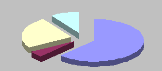
24%
61%
5%
10%
Sols Diors Sols du Walo Sols alluviaux Sols salins
Source : D'après les données recueillies
à la communauté rurale - 2004
Dans ce milieu, les dunes blanches vives (ou dunes littorales)
constituent les substrats les plus récents. Elles sont visibles sur
l'axe Mboumbaye-Lahlar. Ce sont des sols qui constituent un support favorable
à la culture maraîchère.
Viennent ensuite les dunes jaunes, caractérisées
par l'influence très marquée de la nappe qui est de très
faible profondeur. Ces dunes s'aperçoivent sur l'axe
Leybar-Ndiébène Toubé Wolof dans la zone de Toubé
et continuent jusqu'à l'Est de Gandon. Le village de Toug Peul, l'axe
Ricotte-Ndiébène Gandiol sont bâtis sur ces dunes jaunes.
Ils sont favorables aux cultures sous pluies.
Il y a le sous groupe hydromorphe (sol gorgé d'eau) qui
occupe les dépressions inter dunaires des dunes jaunes et couvrent des
superficies importantes dans le Gandiolais. Ces sols, d'une profondeur de 2
à 3m, sont favorables à l'arboriculture. Avec la remise en eau
prochaine de la vallée du Gandiolais, ces sols pourront être des
sites d'accueil de l'agriculture irriguée.
Enfin, il y a les dunes rouges. Ce sont des terres
traditionnellement réservées à la culture
céréalière. On les rencontrent à
l'extrémité Est du Gandiolais et couvrent l'essentiel du secteur
de Rao.
A côté de ces sols, existent d'autres types de
sols fortement marqués par le sel. Ils sont visibles le long de la route
Saint Louis - Tassinère et sur la partie Sud-ouest de Toubé entre
Ngaye Ngaye et Ndiakhère. Ce sont des terres inaptes à toute
exploitation agricole, uniquement réservées à l'extraction
du sel.
25
2.2. Les ressources hydriques
Au-delà de l'océan atlantique, qui sert
d'exutoire au fleuve Sénégal, les ressources hydriques dans le
Gandiolais et le Toubé sont diversifiées et très
importantes.
2.2.1. Les eaux de surfaces
De par sa position estuarienne, la zone du Gandiolais et de
Toubé est soumise sur le plan hydrologique à l'influence directe
du fleuve Sénégal7. En plus d'avoir une large
ouverture sur l'océan atlantique (près d'une trentaine de km), le
Gandiolais bénéficie aussi d'un important réseau
hydrographique plus ou moins pérenne. On peut en effet distinguer le
Ngalam, défluent du fleuve Sénégal, la cuvette de
Gueumbeul, plusieurs bras du fleuve (le Ndiassew, Mbenguègne,
Ndiëgueur, Leybar, Ndialakhar, etc.), plusieurs mares temporaires
(Mbirelé, Thianare,) et tant d'autres (C.R., 2003 : 3). Mais tous ces
plans d'eau (bras du fleuve et mares) sont à peu près
inutilisables. A l'exception du Ngalam et des eaux du fleuve
Sénégal, dont le taux de salinité varie suivant les
saisons, presque tous les plans d'eau de la zone sont inexploitables pour
l'agriculture. Ils sont affectés par la sécheresse qui dure
depuis plus de trois décennies, la salinité due en grande partie
à la remontée de la nappe salée et l'envahissement de la
flore aquatique souvent composée d'espèces halophytes (qui
supportent la salinité). A ces contraintes s'ajoutent la perturbation du
plan d'eau, initialement mis en place de façon naturelle, par le barrage
de Diama et la baisse de la nappe qui fait suite au déficit hydrique
noté depuis le début des années 1970. L'ouverture
récente de la nouvelle embouchure sur la langue de Barbarie, qui,
après le retrait des eaux de crue, favorise l'entrée brutale de
la langue salée, est une autre raison qui pourrait expliquer la
salinisation des eaux (figure n°4). Face à toutes ces contraintes,
les eaux de surface sont devenues inutilisables pour la mise en valeur des
terres de culture.
En hivernage, les apports pluviométriques et les eaux
d'inondation des crues donnent l'aspect d'une zone complètement
noyée. Pendant toute cette période, du mois d'août au mois
d'octobre, presque toute la partie occidentale reste submergée par les
eaux tandis que la partie orientale, domaine des dunes continentales est au
dessus des eaux.
7 Avec un bassin versant de 335.000km2,
dont 25.000km2 au Sénégal, le fleuve
Sénégal comprend le haut bassin situé en amont de Bakel,
la moyenne vallée de Bakel à Richard Toll et le Delta de Richard
Toll à l'embouchure du fleuve.
26
Figure n°4 : Facteurs et effets de l'évolution
de la salinisation des terres du Gandiolais et de
Toubé
Sécheresse
Barrage de Diama
Nouvelle embouchure
Rareté de l'eau douce
Salinisation progressive
des nappes et de la terre
Dégradation des terres de
culture et du couvert
végétal
Crises socio-économique
et environnementale
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Baisse de la
|
2. Surexploitation
|
3. Remontée
|
4. Abandon
|
|
production et
|
|
de la nappe d'eau
|
|
de la nappe
|
|
des terres de
|
|
des rendements
|
|
douce
|
|
d'eau salée
|
|
culture
|
Source : enquêtes personnelles 2005
C'est d'ailleurs cette partie continentale qui est mise en
valeur par les agriculteurs durant la saison humide. Ces plans d'eau
inondés pendant la période des hautes eaux disparaissent à
la fin de l'hivernage, au fur et à mesure que l'on avance vers la saison
sèche, du fait de l'intensité de l'évaporation.
Excepté le Ngalam, source d'alimentation de l'actuel canal du Gandiolais
et les eaux de crue du fleuve, la population agricole se contente, en saison
sèche, des eaux de la nappe pour la production
maraîchère.
27
2.2.2. Les eaux souterraines
Bien réparties et diversifiées, les eaux
souterraines ont depuis longtemps fait l'objet d'une importante exploitation
pour la satisfaction des besoins humains et animaux. On note la présence
d'un nombre important de puits dans le Gandiolais et le Toubé. On compte
jusqu'à 4 à 5 puits par exploitation maraîchère et
environ 10 puits par ha à Ricotte, Mboumbaye et Mouit (enquêtes
personnelles 2004). L'autre difficulté, c'est l'envahissement des puits
par les eaux salées, qui fait suite à un pompage excessif. La
conséquence est l'abandon de certaines terres agricoles (Cf. photo 1).
Ainsi, la plupart des maraîchers de Mouit sont originaires de
Ndiébène Gandiol ou de Ndiol Gandiol.
Photo n° 1: Les effets du sel sur les terres du
Gandiolais

Parcelle de tomate dégradée par le sol
Puits abandonné
Source : Photo H. Gervais 2004
Près du littoral, les eaux souterraines se
présentent sous forme de nappes de surface avec une profondeur de 0,5
à 2m. Tandis qu'à l'intérieur du continent, à l'Est
de Ndiébène Toubé Wolof et de Ndiébène
Toubé Peul, elles deviennent plus profondes et peuvent atteindre 15m.
Les puisards traditionnels deviennent nettement insuffisants.
Pour avoir en permanence de l'eau douce dans les puits, la stratégie
consiste à creuser plusieurs puits, ce qui constitue un risque
d'affectation de la nappe à long terme. Tous les producteurs n'ont pas
les moyens financiers pour creuser autant de puits dans une même parcelle
de moins d'un hectare. Pour un seul puits de trois mètres en bon
état, il faut 4 sacs de ciment à 3.000 francs le sac, 4 barres de
fer à 1.000 francs la barre et payer aux maçons 2.000 francs pour
chaque mètre creusé (résultats d'enquêtes 2004). Il
faut au moins deux maçons pour forer un puits. Au total, pour un puits
de 3 mètres, le propriétaire de la parcelle doit débourser
au minimum 28.000 francs, sans compter la prise en charge des maçons
durant tout le temps des travaux. Dans certains villages situés sur les
dunes comme Toug Wolof, la profondeur d'un puits peut atteindre parfois 8m
à 10m.
Durant les années 1970-1990, dans le cadre de ses
interventions dans la zone du Gandiolais et de Toubé, l'organisation
humanitaire CARITAS, ayant très tôt fait ce constat, avait
établi l'optimum de 10 à 20 puits par hectare sur les champs
où l'on développait la culture
28
de légumes. Une centaine de puits ont été
forés et cimentés dans le Gandiolais et environ 2.000 puits dans
l'ensemble de la communauté rurale (CARITAS, 2004 : 4). Ces puits,
malgré leur large disponibilité, sont aujourd'hui dans leur
grande majorité abandonnés car ils ont été
installés sur des sites présentement envahis par le sel.
2.3. Le couvert végétal
Suivant la qualité des sols, les conditions climatiques
et le micro-climat local, on observe dans le Gandiolais et le Toubé une
couverture végétale diversifiée et adaptée à
la sécheresse : de la végétation de type steppe arbustive
avec une dominance des épines à une savane
dégradée, on passe par endroit à une
végétation forestière de type Niayes également
dégradée. Dans cette zone du Gandiolais et de Toubé, on
observe la présence d'une végétation halophyte, qui
évolue de façon naturelle dans les aménagements agricoles
abandonnés, en bordure des cuvettes et sur les bordures des
aménagements actuelles. Elle compose plus de 80% de l'essentiel de la
couverture végétale attestant le degré de salinité
des terres. C'est une formation herbeuse qui présente un aspect
très ouvert (enquêtes personnelles 2004).
Sur les différents types de sols identifiés dans
le Gandiolais s'est fixée une végétation plus ou moins
adaptée aux conditions climatiques du milieu8 :
- sur les dunes de sables vifs, on remarque une
végétation constituée de Casuarina equisetifolia
(Filao), plantée en haies vives pour fixer le sol, d'Euphorbia
balsamifera (Salane en Wolof) ; cette espèce est repiquée en
haie vive sous forme de brise-vent pour protéger les
périmètres maraîchers de l'ensablement. Elle sert aussi
à délimiter les cuvettes maraîchères, à
clôturer les concessions et les enclos pour éviter la divagation
des animaux. Il y a aussi sur ces dunes blanches l'Acacia radiana ou
Acacia tortilus (Seng) qui sert de fourrage au bétail et
l'Opuntia tuna (Garga mbocé), qui forme par endroit des
peuplements très concentrés, fixant les dunes.
- sur les dunes jaunes, les espaces où se
développe le Faidherbia albida (Kadd) sont très
convoités par les agriculteurs parce qu'étant des sols
très fertiles. Il fournit l'essentiel du fourrage pour le bétail
en saison sèche. On observe sur ces terres la présence d'une
végétation herbacée, caractérisée par une
plante bien connue, le Cenchrus biflorus (Cram-cram).
- ailleurs, sur les dunes rouges, on trouve plusieurs
espèces (l'Acacia nilotica (Neb neb), l'Acacia senegalensis
(Werek), Adansonia digitata (Guy)) qui s'adaptent au milieu.
(Voire en annexe 1 les espèces végétales
rencontrées dans le Gandiolais et le Toubé).
8 Le 17 novembre 2004, nous nous sommes rendus sur le
terrain avec M. Diatta Marone, ethnobotaniste. C'est lui qui nous a aidé
à identifier l'ensemble des espèces végétales
rencontré, leur nom scientifique et vernaculaire.
29
CHAPITRE II
Données socio-économiques et
systèmes de production agricole dans le Gandiolais et le
Toubé
1. L'environnent humain et le milieu agricole
Cette partie est consacrée à l'évolution
démographique par rapport aux activités socio-économiques
dans le Gandiolais. Les conditions climatiques, la dégradation du milieu
physique, la mobilité démographique, la proximité de la
ville de Saint Louis, sont entre autres les points sur lesquels se portera
l'analyse.
1.1 Le peuplement
D'après les enquêtes effectuées dans la
zone, l'histoire du peuplement remonte au XVIème
siècle9. Le village de Gandiol semble exister 100 ans
déjà avant la ville de Saint Louis. En reconstituant l'histoire,
Gandiol a dû naître au milieu du XVIème. Les premiers
habitants seraient originaires d'un bourg appelé Ndiol à
Lampsar10. Ils furent les premiers à occuper la zone. Ils
étaient des migrants saisonniers Peuls, Wolofs ou Mandingues qui
venaient en saison sèche afin de faire paître leurs animaux et
repartaient en début d'hivernage. Il s'agissait d'un groupement nomade
qui combinait cultures et migrations pastorales. Ils suivaient leurs troupeaux
suivant les saisons de l'année et y restaient pendant plusieurs mois
comme éleveurs et agriculteurs avant de reprendre le chemin du retour.
Leur sédentarisation fut provoquée par la perte des troupeaux.
Le premier village du Gandiol fut le village de Ndiol Gandiol
créé par ceux de Ndiol Lampsar. Le nom Gandiol serait tiré
du vocabulaire Wolof « Gaayi Ndiol »11, qui
signifie littéralement en français « Les gars de Ndiol
». L'origine du mot « Gaayi Ndiol » semble
confirmer que les premiers résidants étaient des Wolofs.
Traditionnellement on distingue dans le Gandiolais un certain
nombre de groupes ethniques. Il s'agit des Wolofs, qui occupent tout le secteur
de Toubé, des Peuls et des Maures. Avec le temps, ces groupes ethniques
ont réussi à adopter un mode de vie quasi identique.
9 Entretiens du 18 mars 2004 avec Ablaye Diop, chef du
village de Ndiébène Gandiol, 18 avril 2004 Madialé Ndiaye
chef du village de Ndiol Gandiol et plusieurs autres sages du même
village.
10 Lampsar est un village situé à
l'extrême Nord-est de la communauté rurale de Gandon, dans la zone
de Ndiawdoune. Il est en majorité peuplé de Peuls.
11 Idem, le 18 avril 2004.
30
1.2 La répartition spatiale de la population
Avec une superficie de 350km2, soit 65,2% de
l'ensemble de la communauté rurale de Gandon (cf. carte n°3), la
zone du Gandiolais et de Toubé semble être la plus peuplée
de toute la communauté rurale. Au niveau de la maison communautaire de
Gandon, il n'existe pas de données chiffrées et
détaillées, mais suivant les résultats d'enquêtes,
le secteur de Toubé regrouperait approximativement à lui seul,
plus du quart de la population de la communauté rurale. Les deux
secteurs réunis pourraient rassembler la moitié des habitants de
la communauté rurale qui, en 2002, totalisait 44.000 habitants, soit une
densité de 71 habitants au Km2.
Cette concentration de la population augmente au fur et
à mesure qu'on va du Sud vers le Nord. Cette situation se justifie d'une
part par l'enclavement de la partie Sud, malgré la place qu'y occupe le
maraîchage, par sa vulnérabilité à l'envahissement
des eaux de crue, et d'autre part par la proximité de la ville de Saint
Louis qui offre des avantages aux populations de la partie Nord (petit
commerce, métiers d'ouvrage et emploi de bonne ou domestique).
1.3 Composition et structure de la population
Il s'agira ici de faire une analyse sur l'organisation sociale
de la population du Gandiolais et de Toubé, et le rythme actuel de son
évolution démographique.
1.3.1 Composition
La communauté rurale de Gandon est
caractérisée par sa diversité ethnique. On y trouve des
Wolofs, qui composent l'essentiel de la population, des Peuls, des Maures, des
Sérères, des Soninké. En 2002, les Wolofs
représentaient 45% de la population totale. Les Peuls étaient
estimés à 35%, les Maures 15%. Les autres ethnies
représentaient 5%. Le Gandiolais semble présenter le même
profil. Les principales ethnies rencontrées dans cette zone sont les
Wolofs (78%), les Peuls 20% et les Maures 2% (figure 5). Les Wolofs
s'installent sur l'ensemble de la zone, mais se regroupent davantage à
l'intérieur du continent loin de la côte. Ils sont des
agriculteurs et des ouvriers travaillant à la ville de Saint Louis.
Quant aux Peuls, du fait de leur mobilité, on les retrouve sur presque
toute la zone ; ce sont des agriculteurs et des éleveurs. Ils pratiquent
en même temps le maraîchage et l'élevage extensif.
S'agissant des Maures, ils se sont implantés sur les dunes jaunes et le
littoral. Ils ont comme activité socio-économique le commerce,
l'élevage de petits ruminants et de camelins et le maraîchage.
31
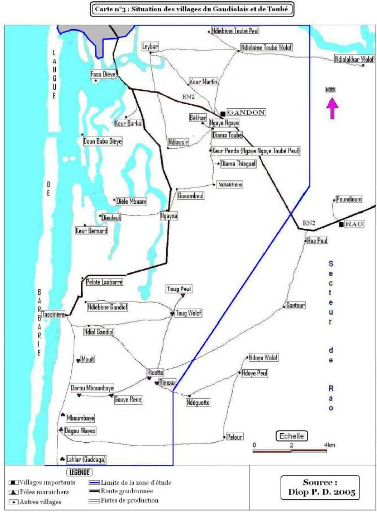
32
Figure 5 : Composition ethnique de la population dans la
communauté rurale (en %, 2002)
? Répartition de la population au niveau de la
communauté rurale de Gandon
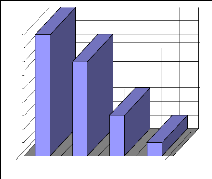
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Wolofs Peuls Maures Autres
45
35
15
5
? Répartition de la population au niveau du Gandiolais
et du Toubé
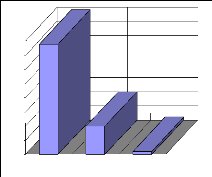
40
80
70
60
50
30
20
10
0
Wolofs Peuls Maures
78
20
2
Source : Conseil rural de Gandon : Données 2002
1.3.2. Structure
La population du Gandiolais est caractérisée par
une forte proportion de jeunes âgés de moins de 20 ans. Cette
situation s'explique par l'émigration des jeunes actifs qui se dirigent
vers les grandes villes à la recherche de meilleurs revenus. Les
années de sécheresse ont entraîné une
dégradation des sols et de la couverture végétale et ont
suscité une migration de la population. Les Wolofs, en particulier, ont
connu une vague d'émigration vers les grands centres urbains comme Saint
Louis et Dakar, mais surtout vers l'étranger (Mauritanie, Gambie et en
Europe)12. L'émigration vers l'étranger est un
phénomène nouveau dans le Gandiolais. D'après les
enquêtes effectuées dans la zone, certains jeunes ont migré
vers l'Italie ou
12 Entretien du 19 mars avec Gougne, conseiller rural
et notable à Gandiol. Dans le questionnaire également plusieurs
personnes ont confirmé cette vague émigration des jeunes vers
l'étranger.
33
l'Espagne. Les retombées économiques de
l'émigration ne sont pas pour le moment visibles, mais les familles qui
en bénéficient (2 à 3 familles par village) affirment
être de plus en plus indépendantes des revenus agricoles. Par
contre dans le Toubé, ce phénomène est connu depuis
plusieurs dizaines d'années. Les retombées économiques de
l'émigration se manifestent à travers des activités comme
le transport. Beaucoup de jeunes émigrés s'investissent dans ce
secteur.
2. Agriculture et autres activités
génératrices de revenus
Dans le Gandiolais, comme dans l'ensemble de la
communauté rurale de Gandon, la population agricole devance de loin les
éleveurs. Au niveau de la communauté rurale, les agriculteurs
représentent près de 65% de la population active contre 25% pour
les éleveurs. Les pêcheurs comptent 5% des actifs. Quant au
commerce, il représente un faible taux du pourcentage des actifs
(3%).
Figure n°6 : Répartition de la population de
la communauté rurale par secteur d'activité
Agriculteurs Eleveurs
Pêcheurs Commerçants Autres

5% 3%2%
25%
65%
Source: D'après les données de la
communauté rurale - 2004
La forte présence d'une population agricole (65%) sur
une zone largement caractérisée par un déficit hydrique
constant justifie le niveau de pauvreté. La population dépend
pour l'essentiellement des revenus agricoles. Les autres secteurs
d'activité (l'élevage, la pêche et le commerce) ne
constituent, par rapport à l'agriculture, qu'une activité
secondaire.
34
2.1. L'agriculture
Le Gandiolais est une région fortement agricole. Il
s'agit d'une agriculture largement tributaire des aléas climatiques.
L'irrégularité spatio-temporelle de la pluviométrie a
encouragé l'activité maraîchère au détriment
des cultures sous pluies (cf. carte 4).
2.1.1. Les cultures sous pluies
Les cultures sous pluies sont peu développées
dans le Gandiolais. Elles sont pratiquées dans le Dièri,
c'est-à-dire la partie sablonneuse s'éloignant du fleuve, jamais
atteinte par les crues. C'est une agriculture de subsistance. Les
variétés choisies sont très limitées, en raison de
l'incertitude sur le bilan hydrique. Les principales cultures sont par ordre
d'importance : le niébé, le béref, l'arachide, le petit
mil (ou souna) et le maïs.
Pendant l'hivernage de l'année 2004, l'Etat du
Sénégal, à travers les communautés rurales, avait
distribué des boutures de manioc à tous les paysans13.
Il s'agissait pour ces derniers de l'intégration d'une nouvelle
variété de culture sous pluie. Mais avec l'arrivée des
criquets pèlerins, toutes les attentes ont été
déçues. Déjà victimes d'un déficit hydrique
intense et inhabituel en 2004 (130mm de pluies), les paysans Gandiolais ont vu
les quelques produits de niébé, du mil et du manioc qui
fleurissaient, dévastés par les criquets sous leur regard
impuissant. La paille qui pouvait être vendue ou qui devait servir de
fourrage pour le bétail n'a pas été également
épargnée. Les récoltes ont été
exceptionnellement faibles. De même, le maraîchage a dû subir
un coup dur du péril acridien. Les pépinières qui ont
été plantées à la fin de l'hivernage et qui
devaient servir aux premières récoltes pour les maraîchers
ont aussi été ravagées par les criquets
pèlerins.
Les cultures sous pluies sont, dans le Gandiolais et le
Toubé, victimes d'un déficit hydrique permanent. Même si
depuis l'année 2002, les pluies tombent fin juin (cf. tableau 4), la
probabilité des pluies précoces, dangereuses pour les premiers
semis, est toujours grande. Les pluies ne s'installent officiellement
qu'à la fin du mois de juillet et sont à nouveau incertaines
à partir de la fin du mois de septembre. Si l'on ne tient pas compte de
l'humidité résiduelle du sol, la véritable période
de culture est restreinte à deux mois (août et septembre). Durant
cet intervalle, de fortes pluies (des averses) peuvent saturer le sol,
entraînant le ruissellement des eaux, provocant l'érosion des
terres et l'inondation des routes et des pistes de production qui permettent
d'accéder aux villages.
13 L'Etat du Sénégal avait
décidé de développer la culture de manioc pour la saison
2004. De ce fait, il avait distribué sur l'ensemble du territoire des
boutures de manioc aux paysans.
35
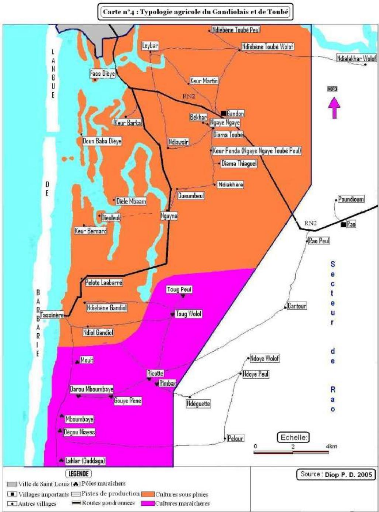
36
En plus du déficit pluviométrique chronique, les
paysans rencontrent d'autres problèmes tels que le manque de semences et
l'absence de crédits en engrais pour les cultures sous pluies. Pour des
raisons liées à ces contraintes économiques, les paysans
optent de plus en plus pour la culture de niébé et de
béréf. Leurs semences coûtent moins cher. Les banques
commerciales et les mutuelles ne sont pas disposées à
prêter de l'argent, de la semence ou de l'engrais aux agriculteurs en
saison des pluies. En prenant l'exemple sur les années passées
où le volume pluviométrique est relativement faible, les
mutuelles ne veulent prendre aucun risque en accordant des prêts aux
paysans. Les récoltes sont maigres et les producteurs ne sont pas
sûrs de pouvoir rembourser leur prêt à la fin de la saison.
Et même avec un bon hivernage, les récoltes ne sont pas
destinées à la vente. Il s'agit donc d'une agriculture de
subsistance précaire.
2.1.2. Les cultures maraîchères
Les cultures maraîchères sont pratiquées
un peu partout dans le Gandiolais et le Toubé, mais
particulièrement sur le littoral. L'oignon, la tomate, la pomme de terre
et les légumes (carotte, aubergine, patate douce, chou) constituent les
principales spéculations avec une large dominance des oignons. Les trois
quarts de la superficie des terres agricoles du Gandiolais sont occupés
par l'oignon (cf. photos planche 1). Le maraîchage constitue la
principale activité agricole à laquelle s'adonne l'ensemble de la
population qui vit sur le littoral. Mais elle reste une activité qui
bénéficie d'une faible ouverture sur les marchés de la
ville de Saint Louis, à cause de la concurrence des produits de la zone
périurbaine, de la Vallée et des produits importés. Au
lieu de se lancer dans une véritable politique de diversification des
produits maraîchers, les paysans se contentent des cultures
traditionnellement pratiquées dans la zone depuis plusieurs
décennies (la patate douce, la pomme de terre, la tomate). Ces produits
rapportent peu et sont difficilement écoulés. Les partenaires au
développement comme l'ANCAR ou la CARITAS, qui soutiennent les
producteurs du Gandiolais, n'interviennent pas dans le circuit commercial. La
vente est l'affaire personnelle du producteur. Les produits
récoltés et destinés à la vente sur les
marchés régionaux et nationaux se heurtent à la
concurrence de ceux des régions les mieux adaptées à la
production de masse : la Vallée de fleuve, le Saloum, la Casamance,
etc., sans parler des produits d'importation (l'oignon Hollandais). Chaque
année, l'Etat importe une importante quantité d'oignons. Dans le
but de promouvoir la vente des produits locaux, en 2004, il avait
décidée de réduire, voire même d'arrêter les
importations à partir du mois d'avril. Ce choix n'encourage pas les
producteurs surtout ceux du Gandiolais, car au mois d'avril, une bonne partie
de l'oignon stocké serait déjà pourrie.
37
Planche 1 : L'oignon constitue l'essentiel de la
production maraîchère du Gandiolais

Photo 2 : Une parcelle d'oignon à
maturité (3 mois 10 jours) à Mboumbaye Gandiol. L'arrosage manuel
est l'unique système d'irrigation utilisé dans le Gandiolais.

Photo 3 : Une parcelle d'oignon de deux
mois à Lahlar (Gadaga). Cette parcelle de plus d'un hectare est
constituée par de petites planches de 50cm de long sur 25 à 30cm
de large.

Photo 4 : Plusieurs hectares
exploités à Dégou Niayes, l'unique variété
trouvée sur les lieux est l'oignon rouge (ou « garmi
»).
Clichés : P.D. Diop,
juillet 2005
Les producteurs d'oignons avaient demandé à
l'Etat d'arrêter ou de limiter les importations à partir du mois
de février, mais sans succès.
Le concurrent le plus proche et le plus stable du Gandiolais
sur les marchés urbains est la zone périurbaine. A Saint-Louis du
Sénégal, l'agriculture urbaine est conçue par Bonnardel
comme une activité à part entière. Son importance
réside dans le fait qu'au-delà de l'alimentation des populations,
elle assure une meilleure qualité de la vie urbaine. Dans la
réserve maraîchère de Khor, les cultures produites sont
généralement des légumes (carottes, choux, aubergines,
etc.). A l'Est de la ville se trouvent les jardins et les vergers du village de
Bango qui produisent d'importantes cultures maraîchères. Les
grandes exploitations urbaines se retrouvent au niveau de ce village, où
l'espace est plus disponible. Aujourd'hui, l'agriculture périurbaine
dépasse même le cadre périphérique de la ville
(Mangane, 2004 : 92). Les sites de production sont observables un peu partout
dans la ville.
Tableau 6: Répartition des
sites de production agricole dans la ville de Saint-Louis
|
Entités
|
Sites
|
|
Ile
|
Sud, Nord
|
|
Langue de Barbarie
|
Fasse Dièye, Hydrobase, Goxumbacc
|
|
Sor
|
Pikine, Diaminar, Medina Course, Leona,
Cité Niakh, Ndiolofène,
Diamaguène,
Balacoss, Corniche, Darou
|
|
Péricentre communal
|
Sénéfou bougou, route de khor, Khor Usine,
Cabane, Khar yalla
Kanda, barrage,
|
Source : Mangane 2004, d'après la D.R.D.R.,
Avril 1999, Saint-Louis
Les produits cultivés sont à caractère
vivrier-marchand14. La demande en produit alimentaire dans la ville
de Saint-Louis est très importante. La ville compte plusieurs
marchés et les petits commerces se développent partout dans les
coins de quartier. Reste donc de savoir si cette production périurbaine
ne constitue t-elle pas un blocage pour l'écoulement des produits
maraîchers du Gandiolais au niveau de la ville de Saint Louis.
38
14 Produits destinés à la consommation
locale et à la commercialisation.
39
2.2. L'élevage et la pêche
Malgré l'importance de la population agricole dans la
zone, le Gandiolais compte 30% du total de sa population active, qui
s'identifie dans les secteurs de l'élevage et de la pêche.
2.2.1. L'élevage
L'élevage est le second secteur d'activité
économique de la zone. Il mobilise 25% de la population active. C'est un
élevage traditionnel extensif, dominé par les petits ruminants :
les ovins et les caprins. L'élevage bovin, qui est une source reconnue
de matière organique par son fumier, est faiblement
représenté. Une des explications pourrait être le faible
capital de fourrage, qui ne favorise pas l'alimentation du bétail dans
le Gandiolais. A la place, les producteurs utilisent « le fumier des
petits ruminants qui se décompose difficilement » (Diallo G.D.,
1994 : 5). L'élevage est essentiellement pratiqué par les Peuls.
Cependant, les Wolofs connaissaient depuis longtemps l'élevage de case
qui se résume à quelques têtes, moins d'une dizaine par
concession. Plusieurs concessions Wolofs peuvent réunir leur
bétail, ovins en général, qu'ils confient à un
éleveur Peul, moyennant une rémunération mensuelle de 125
francs par tête. L'élevage des autres espèces telles que
les bovins et les camelins est en général sous la charge d'un
membre de la famille. L'élevage Peul est conduit en hivernage par le
berger vers des zones de pâture. En saison sèche, période
pendant laquelle la couverture végétale se raréfie, le
bétail pâture librement et crée le plus souvent des
conflits entre éleveurs et maraîchers.
En plus des ovins et des caprins, on pratique dans la
région l'élevage de bovins, d'équins, d'asins, de camelins
et de volailles. L'élevage de volailles n'est pas très
développé dans la zone, mais ces fientes pourraient
accroître la production maraîchère.
Cependant, on note un certain recul de l'activité
pastorale à cause de la sécheresse. C'est ainsi que les
éleveurs font recours au pâturage aérien15.
L'autre problème c'est la mise en culture des terres initialement
réservées au pâturage à l'Est par les populations
des villages de Ndiol Gandiol et de Ndiébène Gandiol, qui fuient
la nappe d'eau salée.
15 Pâturage aérien : système qui
consiste à couper les branches des arbres et arbustes pour pouvoir
nourrir le bétail.
40
2.2.2 La pêche
Disposant d'une façade maritime et d'un fleuve qui la
traverse sur toute sa longueur, le Gandiolais a toute la possibilité de
pratiquer la pêche maritime et continentale. Mais, malgré cette
large ouverture maritime et fluviale, la pêche reste une activité
négligée. Elle n'est pratiquée que par une faible
proportion de la population active (5%). Excepté quelques villages
(Mouit, Tassinère, Ndiol Gandiol, Gueumbeul) qui s'adonnent
occasionnellement à la pêche, cette activité n'est
pratiquée que par la population de la langue de Barbarie (un quartier de
la ville de Saint Louis situé à l'ouest du Gandiolais sur l'autre
rive du fleuve).
2.3. Le commerce et l'exploitation du sel
Avec seulement près de 5% sur l'ensemble de la
population active, le commerce et l'exploitation du sel sont les deux secteurs
les plus délaissés par les jeunes de la localité. Le
commerce est surtout pratiqué par les Maures et l'exploitation du sel
uniquement par les femmes.
2.3.1 Le commerce
Il s'agit de l'activité socio-économique qui
enregistre la plus faible proportion de la population active (3%). Hormis
quelques boutiques ouvertes par des G.I.E. et gérées par des
locaux, le commerce est seulement assuré par les Maures et quelques
bana-banas (marchands ambulants). Ceux-ci achètent et revendent
les produits du maraîchage. Souvent ces bana-banas sont des
maraîchers plus aisés qui se transforment momentanément en
marchands. Cette technique qui leurs permet d'être à la fois des
maraîchers et des marchands, leurs permet aussi d'avoir le contrôle
sur la vente. La technique est la suivante : en début de saison
sèche, les bana-banas livrent des intrants à
crédit aux maraîchers les moins aisés. Pendant la
période de la vente, ils achètent les produits de récolte
à ces derniers, en y retranchant la valeur des produits
prêtés en début de saison. Ce retrait peut se faire soit en
espèce soit en nature. Quel que soit le mode de retrait (espèce
ou nature), le maraîcher est dépendant du client. Le bana-bana
impose au maraîcher un faible prix (150 à 170f le kg d'oignon
quand le marché n'est pas saturé). Lorsque le produit est en
abondance sur les marchés, le bana-bana peut proposer au
maraîcher jusqu'à 80f le kg. Ce dernier, déjà
endettés, est parfois contraint de vendre le produit à bas prix
pour ne pas laisser l'oignon pourrir entre ses mains. L'oignon est une
variété qui ne supporte pas longtemps le stockage sous le chaud
soleil et à l'air libre comme c'est le cas dans le Gandiolais (cf. photo
5).
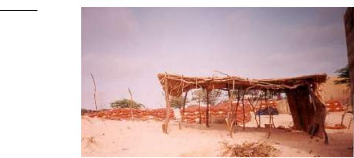
Photo 5 : Mode de conservation de l'oignon à
Gandiol
41
Cliché : P. D. Diop, juillet 2005 à
Ricotte
Plus d'une dizaine de tonnes d'oignons stockés
à l'air libre, sous le soleil par les maraîchers, attendant les
éventuels clients (bana-bana)
Parallèlement, le maraîcher non endetté
peut vendre son produit jusqu'à 220f le kg. L'ouverture annoncée
par la communauté rurale de Gandon d'un marché hebdomadaire au
croisement Méridien sur une superficie de 10 hectares pourrait mettre
fin à ce monopôle du commerce local à l'intérieur de
Gandiol. Le croisement Méridien est situé sur la route de Dakar.
Il constitue un carrefour entre Saint Louis, Gandiol et Toubé. Ce futur
marché hebdomadaire fera face à l'ancien hôtel
Méridien, aujourd'hui appelé hôtel Mame Coumba Bang. Ce
marché, par sa position géographique et stratégique,
pourra devenir un pôle d'affluence de foules venues de toute la
région de Saint Louis. Il aura également à jouer un grand
rôle dans le dynamisme et le développement économique de la
communauté rurale de Gandon.
2.3.2. L'exploitation de sel
Contrairement aux autres activités
socio-économiques de plein-temps, l'extraction du sel dans le
Gandiolais, particulièrement réservée aux femmes, est une
activité à temps partiel. Le mode d'exploitation est artisanal et
le sel est tiré des marais (voir El M. Thioune, mémoire de
maîtrise en cours). Un sac de sel de 50kg se vend entre 1.250 francs et
2.000 francs suivant les périodes de l'année. S'ajoute à
ces mares le marigot de Ngaye Ngaye (Ndiëgueur) qui est un défluent
du fleuve Sénégal. Contrairement aux mares de Gandiol qui tirent
leur sel du sous-sol, le sel de Ndiëgeur est lié aux crues du
fleuve. A la fin du trait des eaux de crue, la population locale piège
les dernières quantités d'eau. Cette quantité d'eau
piégée, après évaporation, laissera sur place du
sel. La vente du sel, qui a lieu en période de soudure, constitue une
autre source de revenus durant cette période.
42
Conclusion de la première partie
Le Gandiolais est un écosystème
spécifique constitué de dunes et de dépressions. Il
bénéficie, sur le littoral, d'un micro climat influencé
par l'alizé maritime. La zone est particulièrement
caractérisée par ses conditions hydriques et édaphiques
qui lui confèrent sa particularité maraîchère. Mais
les remontées salines enregistrées depuis les années 1970,
qui coïncident avec le début d'un cycle de sécheresse
persistante, entraînent une dégradation progressive de
l'environnement naturel et des activités économiques,
particulièrement l'agriculture. Le Gandiolais et le Toubé,
longtemps confrontés à d'énormes difficultés
liés à ces contraintes physiques, souffrent aujourd'hui d'autres
difficultés socio-économiques. Le maraîchage, principale
activité agricole menacé par la dégradation des eaux et
des terres, est de plus en plus confronté à un problème de
débouchés pour l'écoulement de ses produits.
43
Deuxième partie
*******
Facteurs explicatifs de l'évolution et des
contraintes du système de productions
agricoles dans le Gandiolais et le Toubé
44
CHAPITRE I
Dynamique des systèmes de production dans le
Gandiolais et le Toubé
1. Analyse de l'évolution de la production
agricole
Cette analyse sera axée sur les pratiques culturales
adoptées par les populations. Il s'agira de faire l'étude du
foncier, les méthodes de fertilisation des terres et les systèmes
d'irrigation adaptés aux conditions du milieu.
1.1. Le régime foncier
1.1.1. L'accès à la terre
Dans les Niayes, notamment dans la zone du Gandiolais, les
terres sont régies par la loi 64-46 du 27 juin 1964 sur le domaine
national. Conformément à la loi, le conseil rural demeure seul
détenteur des compétences en matière d'affectation et de
désaffectation foncières. Depuis l'entrée en vigueur de
cette loi, les terres qui ne sont pas immatriculées sont placées
sous la propriété de l'Etat. Cette loi stipule que « la
terre ne peut être l'objet de droit de succession ». C'est ainsi que
la plupart des terres de la communauté rurale de Gandon sont sous
l'autorité étatique. Sur l'ensemble de la communauté
rurale comme partout dans le pays, l'Etat a affirmé un droit de
propriété ou de tutelle sur les ressources foncières ou
sur une grande partie d'entre elles. Cette affirmation lui permet de se
réclamer propriétaire des terres agricoles. Mais dans cette zone,
cette loi trouve ses limites dans son application effective. Au niveau de la
communauté rurale, l'attribution des terres se fait de façon
arbitraire. La commission domaniale et la communauté rurale en
général, regroupent pour l'essentiel des conseillers non
alphabétisés. Sur les 32 conseillers que comptait la
communauté rurale de Gandon avant l'année 2002, un seul avait le
niveau universitaire et cinq avaient le niveau secondaire. Trois autres
n'avaient subi que l'enseignement secondaire. Les 23 conseillers restant
n'avaient aucune formation scolaire (cf. Tableau 7). Près de 88% des
conseillers sont des Wolofs, 9% sont des Peuls et 3% des Sérères
(secteur de Ndiawdoune). Les conseillers sont âgés entre 30 ans et
70 ans. Les 19% sont âgés de plus de 40 ans dont une femme.
45
Tableau 7 : Présentation des conseillers ruraux de
la communauté rurale de Gandon
|
Nombre
|
Alphabétisés en :
|
Niveau d'étude
|
%
|
|
01
|
Français
|
universitaire
|
03
|
|
05
|
Français
|
secondaire
|
16
|
|
03
|
Français
|
C.E.P.E.16
|
09
|
|
09
|
Wolof
|
- - -
|
28
|
|
05
|
Pular
|
- - -
|
16
|
|
09
|
Non alphabétisés
|
- - -
|
28
|
Source : P.L.D de la communauté rurale de
Gandon, 2001
Les conseillers qui s'occupent de la question foncière
ont une connaissance limitée sur les responsabilités qui leur
sont confiées. Depuis la mise en place du nouveau conseil rural en mai
2002, on assiste à une « ré-appropriation » des terres.
Certaines familles se voient déposséder de leurs terres «
héritées » ou qui leurs étaient attribuées par
le conseil rural avant mai 2002, au profit d'une communauté
étrangère à la localité. Les raisons
avancées sont entre autre « tous les terrains non
viabilisés, pendant quatre ans après leur attribution, doivent
être dépossédés de leurs propriétaires et
réaffectés à d'autres personnes»17. C'est
ainsi que ceux qui se sentent menacés d'une probable
désaffectation tentent de mettre en valeur leur parcelle en la
clôturant avec des haies vives, une façon de la légitimer.
En effet, plus de 80% des personnes enquêtés dans le Gandiolais
estiment être les propriétaires des parcelles exploitées.
De cette portion, 90% auraient acquis leur parcelle léguée par
leurs grands parents ou arrières grands-parents (figure n°7). Les
10% restant l'auraient acquis par achat. La plupart de la population qui aurait
acheté leur parcelle, affirme l'avoir revendu à des «
étrangers »18. Des terrains de 400m2
(20m/20m) ont été revendus entre 150.000f et
400.000f19.
16 Certificat d'Etude Primaire Elémentaire
17 Entretien du 17 mars 2005 à Gandon avec
Assane Wade, conseiller rural, chargée de la question foncière au
niveau de la communauté rurale.
18 En fait, des personnes qui ne sont pas
originaires de la communauté rurale de Gandon. La plupart viennent de la
ville de Saint Louis.
19 Entretien avec quelques vendeurs de terrains
à Ngaye Ngaye, le 25 août 2004.
46
Figure n°7 : Occupation traditionnelle des terres de
culture dans le Gandiolais et Toubé
|
|
|
parcelles héritées
parcelles achetées
|
|
90%
|
|
Source : enquêtes personnelles 2004
Sur ces terres, on rencontre également des exploitants
qui viennent d'autres secteurs et à qui, on a prêté ou
loué une parcelle à cultiver. Des pratiques de locations ou de
ventes sont très fréquentes du fait du contexte économique
et social de la population locale. Dans cette zone plus de 95% de la population
vivent en dessous de leurs moyens. Ainsi, certains parents vendent une ou des
parcelles appartenant à leurs fils ou neveux pour pouvoir survivre.
Cette pratique est très fréquente dans le secteur de
Toubé.
1.1.2. Contraintes liées à l'accès
à la terre
La gestion et l'attribution des terres de culture dans la
communauté rurale de Gandon se heurtent, le plus souvent, à des
contraintes d'ordre institutionnelles et sociales. Les contraintes
institutionnelles sont en grande partie liées à
l'imprécision des limites territoriales entre la commune de Saint Louis
et la communauté rurale de Gandon. La communauté rurale de
Gandon, à l'image des autres communautés rurales, a
été créée en 1972, dans le cadre de la
décentralisation. Cette création fait suite à la
volonté de l'Etat d'introduire la décentralisation dans les
campagnes. Avec la réforme de 1996, l'Etat a transféré
neuf domaines de compétences20 aux collectivités
locales en vue de pouvoir apporter une réponse plus satisfaisante aux
préoccupations des populations. Cette réforme définit la
communauté rurale comme un terroir constitué « d'un certain
nombre de villages unis par une solidarité résultant notamment du
voisinage, possédant des intérêts communs et capables
ensemble de trouver les ressources nécessaires à leur
développement » (article 192 de la loi n°96-06). Mais ce que
l'Etat a oublié de préciser, c'est la délimitation
territoriale définitive des communes et communautés
20 1- La gestion et l'utilisation du domaine privé de
l'Etat, du domaine public et du domaine national ; 2-l'environnement et la
gestion des ressources naturelles ; 3- la santé, la population et
l'action sociale ; 4- la jeunesse, les sports et les loisirs ; 5- la culture ;
6- l'éducation, l'alphabétisation, la promotion des langues
nationales et la formation professionnelle ; 7- la planification ; 8-
l'aménagement du territoire ; 9- l'urbanisme et l'habitat.
47
rurales. Cette imprécision est aujourd'hui source de
rivalité entre commune et communauté rurale ou entre deux
communautés rurales. Le cas de la commune de Saint Louis et de la
communauté rurale de Gandon est illustratif. « Ces deux
entités entretiennent des rapports plutôt conflictuels, et ce
depuis les années 80, date de création de la communauté
rurale de Gandon » (Rigod M., 2004 : 121). Les conflits portent pour
l'essentiel sur le foncier et les enjeux financiers, puisque les terres que
réclame la commune de Saint Louis ont un intérêt fiscal.
Les litiges fonciers ne datent pas d'aujourd'hui. « La commune de Saint
Louis s'est opposée en maintes occasions à la communauté
rurale de Gandon (implantation de l'université, contrôle des
espaces touristiques de la Langue de Barbarie ou des rives du fleuve) »
(Magrin, 2003 :13). Elle percevait jusqu'en 2002 les taxes foncières et
professionnelles des hôteliers qui reviendraient de droit à
Gandon. En plus, Saint Louis s'était octroyé pendant toutes ces
années la partie du cordon littoral qui concentre d'importantes
infrastructures touristiques de la Langue de Barbarie. La commune de Saint
Louis qui se trouve entre l'océan atlantique et la communauté
rurale de Gandon fait face à un manque cruel de ressources
foncières. Elle est victime d'une importante croissance
démographique. Aujourd'hui, par le principe de «
l'intercommunalité » (Magrin, 2003 : 11), elle cherche à
créer une coopération commune avec Gandon ; une
coopération allant dans le sens de « former une "communauté
urbaine" » avec la communauté rurale (Rigod, 2004 : 121).
1.2. Les pratiques culturales
Il s'agit dans cette partie de décrire les techniques
culturales utilisées dans le Gandiolais. L'analyse sera axée sur
les techniques de fertilisation et celles d'irrigation.
1.2.1. Méthodes de fertilisation des terres
agricoles
Le Gandiolais est caractérisé par une multitude
de méthodes culturales adaptées au milieu. Il s'agit d'un
système rotatif de gestion des terres agricoles, qui permet de conserver
la fertilité des sols et de limiter en même temps l'ensablement
des cuvettes maraîchères. Il permet également de faire
plusieurs récoltes dans l'année. D'après les
enquêtes effectuées dans le Gandiolais et le Toubé, les
modes de gestion des terres varient en fonction des besoins
socio-économiques de la population. Il ressort de ces enquêtes que
les méthodes de fertilisation utilisées par les paysans sont
beaucoup plus fréquentes en saison sèche (maraîchage) qu'en
saison des pluies. Le tableau suivant montre le pourcentage de la population
agricole, toute saison confondue, qui pratique la fertilisation des terres.
48
Figure n°8 : Proportion des exploitations du
Gandiolais et de Toubé qui utilisent les techniques de maintien de la
fertilité des sols (en %)
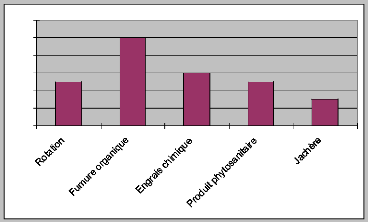
120
100
80
60
40
20
0
100
50
60
50
30
Source : enquêtes personnelles (2004)
L'analyse du tableau montre l'évolution des pratiques
agricoles de gestion de la fertilité des terres dans le Gandiolais et le
Toubé. Ces pourcentages tiennent en compte les cultures sous pluies et
le maraîchage.
1.2.1.1. La rotation des cultures
Elle est très répandue dans le Gandiolais. Elle
consiste à ne pas pratiquer la culture d'une même
spéculation de façon successive sur la même parcelle. Dans
cette zone, plusieurs variétés sont mises au point, suivant un
calendrier d'occupation des sols qui s'échelonne sur les deux saisons de
l'année. Entre le mois de novembre et le mois de juillet, les
producteurs maraîchers utilisent plusieurs variétés, allant
de l'oignon à la tomate en passant par la patate douce, la carotte, etc.
Cependant, l'oignon reste la principale variété pouvant
être cultivée pendant toute l'année. A la suite des
enquêtes menées et des entretiens tenus avec les personnes
ressources, les maraîchers du Gandiolais peuvent avoir deux à
trois récoltes par année avec la seule variété
d'oignon, entre le mois de novembre de l'année en cours et le mois
d'octobre de l'année suivante. En saison froide les maraîchers
Gandiolais cultivent l'oignon entre novembre et février. La
variété utilisée durant cette période est
appelée « gagne mbaye ». Cette variété
ne résiste pas à la chaleur et pourrit rapidement. C'est pour
cette raison qu'elle n'est pratiquée qu'en saison froide en même
temps que les légumes (carotte, chou, navet). Entre mars et juin, une
autre variété appelée « garmi » est
cultivée. Celle-ci est moins fragile que la variété
49
« gagne mbaye » et plus facile à
écouler. Cette période correspond également dans le
Gandiolais à la culture de la tomate. A partir du mois de juillet
jusqu'au mois d'octobre, hormis quelques rares parcelles d'oignons, ces
mêmes producteurs pratiquent sur les mêmes parcelles la culture de
niébé, du béréf, du petit mil. La rotation des
cultures, utilisée par 50% des maraîchers du Gandiolais, contribue
à lutter contre la baisse de la fertilité des sols et le
parasitisme. Par exemple, les parasites qui attaquent les cultures de patate
sont inefficaces contre d'autres types de cultures de contre saison tels que le
béréf, l'aubergine. Elle permet aussi aux sols de se reposer par
l'alternance des espèces exigeantes (la pomme de terre) et des
espèces moins exigeantes (béref, niébé).
En revanche, la rotation des cultures peut constituer un
danger à long terme pour les sols. Les terres du Gandiolais sont
fortement affectées par la remontée du sel. Une exploitation
régulière, 12 mois sur 12, pendant trois années de suite
au minimum, leur fait perdre leur fertilité. Cette intensification de la
culture sur les mêmes parcelles, ajoutée à la
volonté de produire un peu plus chaque année, provoque la baisse
de la fertilité des sols. Le plus souvent, les propriétaires des
parcelles pratiquent cette méthode qui consiste à récolter
plusieurs fois dans l'année et ceci pendant trois ans de suite, avant la
jachère enherbée. Celle-ci se fait en compromis entre le paysan
et l'éleveur. Le paysan invite l'éleveur à introduire son
bétail dans la parcelle laissée au repos. Ce système
permet au paysan d'enrichir ses terres par la fumure animale
déposée dans le champ par le troupeau. En même temps, le
bétail se nourrit de l'herbe dans la parcelle. Au lieu de se faire par
le repos, la terre s'améliore ainsi grâce à l'action de
certaines plantes qui s'y évoluent de façon naturelle et d'une
fumure accrue
1.2.1.2 L'utilisation de l'engrais
Les engrais apportent aux plantes cultivées des
éléments qu'elles ne trouvent pas dans le sol en quantité
suffisante et qui améliorent les conditions de leur nutrition et de leur
croissance. On distingue les engrais organiques, comme le fumier et les engrais
minéraux ou chimiques, produits par l'industrie.
1.2.1.2.1 L'engrais organique (ou la fumure
animale)
La fumure animale est pratiquement utilisée par tous
les agriculteurs du Gandiolais (100%). Elle est utilisée en toute
saison. Le système de fertilisation consiste à distribuer la
fumure sur les parcelles avant toute nouvelle mise en culture (voir photo 6).
Les producteurs, dont la plupart ne sont pas de grands éleveurs, tirent
l'essentiel de l'engrais organique utilisé des achats. Dans plusieurs
villages enquêtés, il arrive parfois qu'un maraîcher
dépense jusqu'à
50
30.000 francs pour couvrir en fumier une parcelle d'un
hectare. La vente se fait selon les besoins du paysan, en gros et en
détail. Pour la vente en détail, le prix d'un sac de 50kg varie
moyenne entre 250 francs en saison des pluies et 400 francs en saison
sèche. La fumure étant achetée dans les villages des
éleveurs Peuls, doit être transportée vers les champs par
des charrettes. Le producteur paye 150 francs par sac entre les lieux de vente
et le champ. S'il s'agit de la vente en gros, la charge d'une charrette (20
sacs de 50kg) varie de 7.500 francs à 10.000f ; dans ce cas, le vendeur
assure lui-même le transport.
Photo n°6 : Quelques sacs de
fumure animale déjà achetés pour la saison des pluies
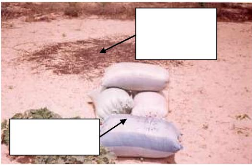
Sacs de 50 kg de fumure animale
Méthode de fertilisation avec la fumure animale.
Cliché : P. D. Diop, mai 2005 à Ndiol
Gandiol
Les producteurs agricoles du Gandiolais, n'étant pas de
grands éleveurs, font plusieurs kilomètres pour trouver la fumure
animale dans les villages Peuls situés à l'Est.
Les éleveurs interrogés sur cette question
attestent que la vente s'effectue en grandes quantités durant la saison
sèche. Il leurs arrive même de lier des contrats de vente avec les
maraîchers. Certains maraîchers par exemple, demandent au
préalable à l'éleveur qui a l'habitude de leur fournir du
fumier d'en leur faire des réserves. A.B.21 affirme avoir
vendu en 2004 plus d'une dizaine de charrettes chargées en fumier animal
aux maraîchers du Gandiolais. Il dit avoir gagné de cette vente
prés de 100.000f. Cet argent lui a permis de faire du petit
maraîchage derrière sa concession. En début de saison
sèche, la demande de fumure est très élevée.
Certains paysans sont obligés d'aller acheter le produit jusqu'aux
villages de Pélour, Gantour, Kalassane, Rao Peul, situés à
l'Est de Gandiol. Ils sont du secteur de Rao. Le village de Pélour est
à 8 km de Ricotte ; il est le village le plus proche de Gandiol parmi
les fournisseurs en fumure organique. Les fientes de volailles ne sont
utilisées que par les gros producteurs. Leurs coûts sont
élevés et elles sont faiblement disponibles dans la zone. Le prix
d'un sac de 50kg revient à 3.000 francs.
21 Entretien du 20 avril avec Aliou Bâ
(éleveur). Il est le frère cadet du chef de village de
Pélour 1
51
1.2.1.2.2. L'engrais chimique
Les engrais chimiques fournissent aux sols beaucoup
d'éléments fertilisants. Leur utilisation permet d'obtenir de
bons rendements. En raison de l'irrégularité de la
pluviométrie en hivernage, cet engrais n'est utilisé que par les
producteurs maraîchers. Plus de 60% des maraîchers l'utilisent dans
leur parcelle. Face à la cherté des prix et la baisse de la
fertilité des sols, les producteurs du Gandiolais utilisent plusieurs
variétés d'engrais chimique, parfois même celles qui ne
sont pas tout à fait adaptées à la culture mise en place.
En général, les variétés les plus répandues
dans la zone sont l'engrais « alam » (ou sucre) de couleur
toute blanche et l'engrais « sawagne » (appellation de la
population locale). L'engrais « sawagne » (ou «
fondé ») présente une couleur jaunâtre,
proche du blanc et plus ou moins grise. Mais la variété la plus
accessible par son prix est l'engrais « uré ». Cette
variété est également de couleur toute blanche. Le sac de
50kg coûte 10.000f. Cet engrais devrait être utilisé dans
les parcelles de culture de navet et de chou, mais faute de moyens financiers,
les maraîchers l'utilisent pour les plantations d'oignon. Les
maraîchers utilisent l'engrais « uré » une fois
par semaine pendant deux mois 15 jours après les semis des
pépinières. L'engrais « sawagne » vient
à partir de cette date et est utilisé deux fois avant la
récolte avec 10 jours d'intervalle22. Les autres
variétés, notamment l'engrais « alam » et le
« sawagne », coûtent respectivement 10.500 francs et
11.000 francs le sac de 50kg. Au détail, le kilogramme d'engrais revient
à 250 francs au maraîcher. Pour une parcelle de 1.500 planches, il
faut environ 40 kg de « uré » et 25 kg de «
sawagne ». Alors que pour une autre de 900 cuvettes, il faut 25
kg d' « uré » et 15 kg de « sawagne
». Pour les producteurs à faible revenu, le mode d'acquisition
se fait par crédit.
Dans presque tous les villages enquêtés, on
constate une quasi absence de mouvements coopératifs dans la zone. Ce
manque d'organisation empêche les producteurs d'accéder aux
crédits puisqu'ils n'ont pas de garantie valable pour en pouvoir
bénéficier. Ainsi, ils se rapprochent des quatre mutuelles des
communautés rurales de Mpal et de Gandon (deux mutuelles à Mpal,
une à Rao et une à Mboumbaye) pour un éventuel accord de
crédit.
La mutuelle de Mboumbaye (voir photo 7) est l'une des quatre
mutuelles accessibles aux producteurs. Jusqu'en 2002, les villages du
Gandiolais et de Toubé se rapprochaient des mutuelles de Mpal pour
décrocher un prêt. Celle de Mboumbaye créée en 2003
par les populations du Gandiolais, couvre aujourd'hui l'ensemble des villages
de Gandiol, de Fass Dièye à Lahlar (cf. carte 5). Son objectif
est de relancer le développement des activités
socio-économiques des villages concernés. Pour y parvenir, la
mutuelle a engagé deux permanents :
22 Entretien avec quelques sourgha, le 25
juin 2004 à Lahlar, Mboumbaye et Dégou Niayes.
52
Photo n°7 : Mutuelle d'épargne et de
crédit du Gandiol

Cliché : P. D. Diop, mai 2005 à Mboumbaye
Gandiol
La mutuelle de Mboumbaye est la seule existante dans la zone du
Gandiolais et de Toubé. En 2004, elle a financé plusieurs
producteurs (agriculteur, éleveur, commerçant, artisan et
pêcheur) de 14 villages différents. Pour l'année 2005, la
mutuelle espère financer plus de 40 producteurs.
une gérante et une caissière. La
première, originaire de Saint Louis reçoit les demandes de
financement et la seconde, qui habite à Mouit Gandiol contrôle les
fonds. Elles perçoivent respectivement 149.000 et 70.000f par mois. Pour
adhérer dans cette mutuelle, le paysan doit acheter un carnet
d'adhésion à 6.000f. Dès sa création, la mutuelle
de Mboumbaye a enregistré 1.000 adhérés, soit 6 millions
de francs. En 2004, la mutuelle bénéficie, auprès de ses
uniques partenaires d'origine Belge, d'un premier financement de 50 millions de
francs qui lui avait permis de couvrir 14 villages23. En 2005, les
mêmes partenaires leurs octroient un autre financement de 60 millions.
Pour bénéficier des prêts de la mutuelle, le producteur
doit être en règle avec la mutuelle ; c'est-à-dire
être un adhérent et ne pas avoir d'arriérés avec
elle. Le client doit également verser une somme de 1.000f dans la caisse
de roulement de la mutuelle et y ouvrir un compte, qui lui permet de
bénéficier d'un prêt. Le montant du prêt est
lié au mouvement du compte du client. Autrement dit, le client est tenu
de verser régulièrement sur son compte, puisque la
régularité de ses versements permettra de déterminer le
montant qui pourra lui être alloué. Le système de
prêt n'encourage pas les petits paysans qui jugent ces conditions
très lourdes. Le système fonctionne comme suit : pour un
prêt de 250.000f, le paysan fait un apport de 50.000f. Après la
récolte, il rembourse 275.000f. Pour un prêt de 500.000f, le
bénéficier doit également faire au préalable un
apport de 100.000f. Il paye après la vente de ses récoltes
550.000f. Le délai accordé au paysan pour le remboursement de la
dette est de 9 mois. La mutuelle accorde également des crédits
aux commerçants pour un délai d'un mois.
23 Entretien avec Magatte Diop, vice-président
de la mutuelle de Mboumbaye, le 02 juillet 2005.
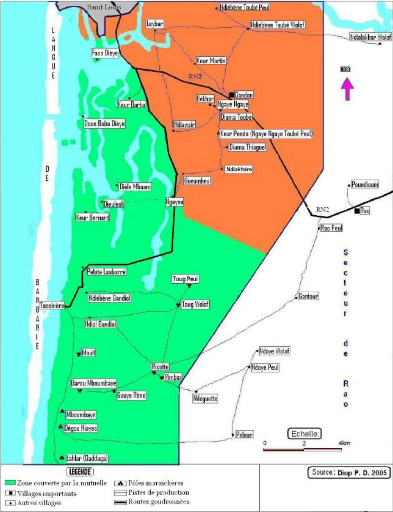
1:,utumbeul
r!Poundi erni
2
àkm
Mdiebëna Teuhé Wakof
-~[Hdia1~
eur Marlin
bekhar
Kir Petida Nap Na re Toube Peul
· diaru Tl~ia
·I
Ndr~kh~, r.
a
RN2
Toug Peul
d
Aid4Ve i41Pf~ e
r
4 1ridape Paul
R
a
o
Eche! le:
hlrar Gridda1114)
THEW
-- Zone cou ert2 par 1.1 nreatapIle 5E1 Fn14a na
arnicherea
EC Villages irupoitautt rsatea de
production
I lAlltres villages BRoutesgoudronu&es
[salve: Diop P. b. 20051
53
I Carte u" : Smile or t onve rt pa r Ia uinlnelle de
uiIroiu1baye j
54
Les prêts accordés aux éleveurs sont
remboursables en 6 mois et en 2 mois pour les artisans. Quant aux
pêcheurs, la mutuelle les accorde un délai de 8 à 10 mois.
Le client qui ne parvient pas à rembourser entièrement son
crédit ne pourra pas bénéficier d'un autre prêt. En
2004, O. B24 déclare avoir contracté un prêt de 500.000f
pour sa parcelle d'oignon. Après la vente des produits
récoltés, il n'a pu collecter que 300.000f. C'est ainsi qu'il n'a
pas pu bénéficier d'un prêt pour l'année 2005.
La mutuelle n'arrive pas à satisfaire l'ensemble des
demandes de ses clients. Elle finance par lots de 40 personnes. Cette
année 2005, elle espère pouvoir financer 2 lots, soit 80
producteurs (tout secteur confondu). Cette part est très faible, moins
de 10% de l'ensemble des adhérents ; mais pour les responsables de la
mutuelle du Gandiolais, cela s'explique par sa création récente.
Elle est à son deuxième financement, intervient dans plusieurs
secteurs et couvre déjà les besoins de 10% des ses membres.
1.2.1.3. Les produits
phytosanitaires
L'introduction des pesticides dans le maraîchage
contribue à l'amélioration de la productivité agricole.
Elle permet d'accéder à des rendements satisfaisants, mais elle
suscite de nombreuses inquiétudes liées notamment à la
santé et à la pollution des sols et des eaux. De la
pépinière à la récolte, les cultures sont
menacées par des agents pathogènes et des ravageurs. Pour lutter
contre ces agents nuisibles, les maraîchers du Gandiolais utilisent la
lutte chimique, souvent dangereuse pour leur état de santé (cf.
photo 8).
Photo n°8 : Méthode d'utilisation des produits
phytosanitaires dans le Gandiolais

Une parcelle d'oignon de 1152 pieds
Une pompe d'une capacité de 20 litres sert à
traiter les plantes
Cliché : P. D. Diop, juillet 2005 à Lahlar
(Gadaga)
Les sourgha qui, le plus souvent se chargent du
traitement chimique des plantations, utilisent le produit sans masque de
protection, ni gants avec des modes d'utilisation non
maîtrisés.
24 Entretien du 21 juillet 2004 avec Ousmane Bâ
producteur maraîcher à Dégou Niayes.
55
Les produits phytosanitaires sont vendus dans l'informel et
utilisés sans aucune maîtrise technique. Ils sont utilisés
par plus de 50% des maraîchers du Gandiolais de façon abusive et
désordonnée. Le produit est vendu localement aux maraîchers
par les bana-banas, sous forme de crédit, à 7.500 le
litre. Les maraîchers, dont la plupart sont des analphabètes,
ignorent en effet totalement les conditions de sécurité et les
modes d'emploi. Ils dépassent parfois largement le dosage
recommandé. Pour traiter leur parcelle, les maraîchers du
Gandiolais mesure la quantité de produit à utiliser sur les
bouchons de bouteilles d'un litre. Par exemple, pour 20 litres d'eau, le
maraîcher utilise une quantité de pesticide, égale à
trois bouchons. Pour couvrir toute une parcelle d'oignon de 1.500 cuvettes, il
utilise 9 bouchons, soit 60 litres d'eau. Par contre, certains maraîchers
dépassent largement cette dose et utilisent un litre de produit chimique
pour une parcelle de 900 cuvettes. L.M.25 déclare avoir
utilisé 1 litre et demi pour sa parcelle d'oignon de 1.152 cuvettes.
Lors des traitements phytosanitaires, une bonne partie des pesticides se
dépose sur le sol pouvant entraîner une pollution de la nappe et
probablement celle des eaux. La contamination de l'eau constitue un risque sur
la santé humaine et animale. Pour pouvoir mesurer l'effet des pesticides
sur l'homme et son environnement, il est indispensable d'instaurer un
système d'information destiné aux producteurs du Gandiolais.
1.2.1.4. La jachère
La jachère est définie comme « une partie
du finage laissée chaque année en repos (...). Elle a le double
résultat d'améliorer la qualité de la terre, de la
nettoyer, et de permettre de nourrir d'un plus grand troupeau » (Lebeau,
2000 : 49). La jachère concerne les terres non cultivées
temporairement. C'est une technique qui consiste à laisser la terre au
repos pendant quelques temps pour permettre la reconstitution de la
fertilité du sol. Comme l'humus n'est pas abondant sur les terres du
Gandiolais et que celles-ci, largement surexploitées, concentrent des
taux de salinité de plus en plus élevés, le
propriétaire laisse les troupeaux séjourner sur le champ durant
toute cette période, une façon de fumer le sol autant que
possible.
Dans les villages enquêtés, seuls 30% des
paysans, particulièrement des maraîchers, utilisent la
jachère comme technique de fertilisation. Plus de 70% des
propriétaires de champs ne pratiquent pas cette méthode,
malgré la disponibilité des terres de culture. Ce sont le plus
souvent des producteurs qui dépendent essentiellement de l'agriculture,
particulièrement le maraîchage. La plupart d'entre eux ne dispose
que de petites parcelles qui ne dépassent pas 1ha et n'ont que la terre
comme source de revenu. A la place de la jachère, ils utilisent, soit
la
25 Lamine Mané est un sourgha qui
vient de la Gambie. Nous l'avons rencontré à Lahlar le 02 juillet
2005 (voir photo 12).
56
fumure animale après les récoltes, soit ils
augmentent le dosage de l'engrais chimique.
Pour les 30% qui utilise la jachère, la mise au repos
des sols est liée à des contraintes financières (manque de
semences, d'engrais, de pesticides ou de matériels agricoles). Dans le
secteur de Toubé, où l'hivernage reste la principale saison
agricole, les irrégularités du régime
pluviométrique font que la plupart des parcelles ne sont pas mises en
valeur.
1.2.2. Méthodes d'irrigation
1.2.2.1 L'arrosage
L'arrosage manuel constitue l'unique système
d'irrigation dans le Gandiolais. C'est une technique rudimentaire. Le
matériel est constitué de deux seaux d'environ 10 litres chacun,
d'une corde adaptée à la longueur du puits le plus profond (voir
photo 9 planche 2). Les plantes sont repiquées sur de petites cuvettes
aménagées par le maraîcher, appelées aussi
assiettes. Celles-ci sont agencées en forme de damier et peuvent mesurer
50 cm de long sur 20 à 25 cm de large. Entre chaque deux colonnes, il y
a une issue qui permet au maraîcher de circuler librement entre les
assiettes. Une parcelle aménagée en petites cuvettes peut parfois
mesurer 100 m2 ou plus. Certaines cuvettes peuvent prendre 2 seaux
d'eau, ou 3 seaux pour 2 cuvettes. Les plantes doivent être
arrosées chaque jour pendant au moins trois mois. Sur une parcelle
d'oignons, on peut compter jusqu'à 900 assiettes au minimum. Le
maraîcher ou son employé doit faire la distance entre le puits et
les cuvettes autant de fois qu'il y en aura dans la parcelle. Certaines
assiettes se trouvent juste à côté du puits, d'autres
peuvent en être distantes d'une centaine de mètres. C'est ainsi
qu'un exploitant utilise trois à quatre puits pour un seul terrain
aménagé. Cette technique d'arrosage nécessite beaucoup de
force physique à cause de la lourdeur des seaux, d'un puisage difficile
et d'un long parcours (va et vient) à faire tout au long de la
journée. L'arrosage peut durer 10h à 12h d'horloge par
journée (de 4h du matin à 16h le soir). La population a
tenté de remplacer cette méthode par les pompes « Djambar
» avec l'aide de la CARITAS.
1.2.2.2. Les pompes Djambar
Les pompes Djambar ont été introduites dans le
Gandiolais par la CARITAS vers les années 1989. Il s'agissait pour cette
technique de pomper l'eau pour remplir un bassin de 2 m de diamètre,
construit à côté du puits. A partir de ce bassin, le
maraîcher devait puiser l'eau avec deux seaux pour aller arroser les
plantations.
Planche 2 : L'arrosage, méthode
traditionnelle d'irrigation très utilisée dans le
Gandiolais
|
|
|
|
Une corde de 8 à 10 m de long au minimum
|
|
|
Cuvettes d'environ 40 à 50 cm de long sur 20 à 25
cm de large
|
|
|
Seaux de 10
litres d'eau
|
|
57
Photo 9 : Une parcelle de tomate de 300
cuvettes à Mboumbaye Gandiol. Dans cette parcelle de tomate de 17 jours,
le sourgha utilise un seau d'eau par petite cuvette.

Photo 10 : Une parcelle d'oignon
à Mboumbaye. Photo 11 : Dans cette même
parcelle,
Le sourgha fait plus d'une dizaine de mètre
(va et le sourgha puise de l'eau d'un puits
vient) pour arroser une parcelle de 1.200 cuvettes. au milieu
des plantations.
Clichés photos : P.D. Diop, juillet 2005
58
La CARITAS cherchait à alléger les travaux
maraîchers en modifiant le système de puisage. La technique n'a
pas connu de grands succès dans cette zone. La population juge que ce
système constitue un double travail. Le système de puisage
consistait à tirer directement de l'eau à partir du puits et
d'aller la verser sur les plantes (cf. photos 10 et 11 planche 2). Le
système de pompage consiste d'abord à remplir le bassin en eau de
puits à partir de la pompe. Ensuite, il fallait puiser cette eau du
bassin pour arroser les plantations (enquêtes personnelles 2004). La
population maraîchère du Gandiolais, après avoir
testé cette méthode, a préféré le puisage
direct du puit. Le pompage nécessite des forces physiques, car pour
remplir un bassin, il faut pomper debout avec les deux mains pendant une
demi-heure. La machine présentait également un débit
faible et elle tombait souvent en panne. Le bassin, une fois rempli, pouvait
être vidé en moins d'une demi-heure. Et en plus un bassin ne
pouvait pas alimenter plus d'une cinquantaine de cuvettes, si on sait qu'il
faut 2 seaux pour une cuvette ou 3 seaux pour deux cuvettes. C'est d'ailleurs
pour cette raison que les maraîchers prenaient l'habitude de remplir le
bassin le soir pour gagner du temps le lendemain. Aujourd'hui, la population
souhaite une nouvelle technique de puisage, qui sollicite moins de force
physique et de temps. C'est ainsi qu'en 2004, le système de goutte
à goutte a été expérimenté dans la zone.
1.2.2.3. L'irrigation moderne
Cette technique était totalement méconnue dans
le Gandiolais. Ce n'est qu'en mai 2004 que le système de goutte à
goutte a été testé pour la première fois à
Gandiol dans le village de Dégou Niayes pour la production d'oignon.
C'est un système de pompage plus moderne que les pompes Djambar. L'eau
tirée du puits passe par des tuyaux percés de petits trous. Ces
tuyaux percés, allongés le long des plantations, servent à
arroser ces dernières par petites gouttes d'où le nom «
goutte à goutte ». Contrairement aux pompes Djambar qui
fonctionnent manuellement, le système de goutte à goutte (ou
motopompe) fonctionne avec du carburant.
Le propriétaire de la parcelle sur laquelle s'est faite
cette installation, O.B.26 semble ignorer totalement le mode de
gestion de cette technique. La machine est gérée par son fils
âgé de 17 ans (en 2004). M. O.B. déclare que dans les
premiers jours qui font suite à son installation, la machine
fonctionnait bien. Entre 6h et 10h de la matinée, il arrivait à
arroser toute sa parcelle. Pour lutter contre les parasites animaux et
végétaux nuisibles aux cultures, le maraîcher traitait les
cuvettes avec des pesticides à partir de la machine. Il s'agit d'un
traitement par ferti-irrigation27 utilisé en association avec
l'irrigation au "goutte à goutte". Les
26 Entretien du 20 juillet avec Ousmane Bâ le
propriétaire de la parcelle qui abrite le système de goutte
à goutte.
27 Il s'agit de faire le traitement des plantations
tout en les arrosant en même temps.
59
produits phytosanitaires et les engrais solubles sont
directement injectés dans le système d'irrigation. Très
satisfait du fonctionnement de la machine, le vieux O.B. avait ensablé
tous les quatre puits qui lui servaient auparavant d'arroser les assiettes.
Mais au bout de trois semaines, des problèmes surgissent. La machine
consomme beaucoup de carburant, 1 litre de super par jour, soit 500 à
630 francs le litre (juillet 2004). Le vieux a décaissé
près de 40.000f pour le carburant de la machine en deux mois dix jours.
Elle tombe fréquemment en panne et handicape les activités
agricoles. Il est obligé à chaque fois d'aller chercher un
technicien à Saint Louis pour la réparation de la machine. Il lui
arrivait parfois de rester une journée entière sans irriguer une
seule cuvette. Comme solution, O.B. était obligé d'aller
recreuser ses anciens puits pour arroser ses parcelles
maraîchères. Il déclare que le principal problème de
ce système était lié à la gestion technique de la
machine et à l'achat quotidien du carburant. En plus, le grand puits
foré qui alimentait en eau la motopompe était installé sur
une dune (photo 12). La quantité d'eau disponible du puits était
insuffisante par rapport aux besoins de la machine. O.B. était
obligé de prendre une pose de temps en temps, une façon de
permettre à la nappe de se recharger. Il déclare que s'il avait
subi une formation préalable sur la gestion et l'entretien de la
machine, il aurait pu faire une bonne saison maraîchère. Cette
année 2004 a été pour lui une grande perte : perte de
semences, d'argent et de temps. Un tel changement technique du système
d'irrigation dans le Gandiolais devrait être accompagné d'une
formation des maraîchers, allant dans le sens d'une maîtrise
technique, d'une bonne gestion de l'eau et de l'amélioration de cette
technique.
Photo 12 : Le " goutte à goutte ", un
système d'irrigation moderne en test dans le Gandiolais
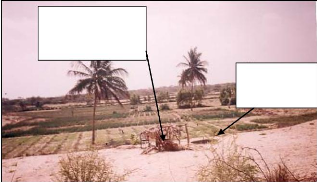
Le système «goutte à goutte »
actuellement abandonné pour des raisons techniques.
Le puits foré qui
sert à alimenter
la
motopompe.
Cliché : P. D. Diop, juillet 2005 à
Dègou Niayes
Les premiers tests de l'irrigation au "goutte à goutte"
n'ont pas réussi dans le Gandiolais. L'absence de maîtrise
technique est la raison qui explique cet échec. Une formation
préalable aux producteurs est indispensable pour la réussite de
cette technique d'irrigation moderne.
60
Sa réussite dans le Gandiolais contribuerait à
réduire le gaspillage de l'eau, à faciliter le puisage et
à économiser beaucoup plus de temps. Il permettrait
également d'éviter les pertes d'eau par évaporation.
1.3. Les modes d'exploitation des terres de culture
Dans le Gandiolais, une bonne partie des producteurs agricoles
travaille en dessous de leurs moyens financiers. La plupart d'entre eux n'ont
pas les capacités financières leurs permettant de mettre en
valeur leur terre. Ainsi, plusieurs méthodes sont utilisées pour
l'exploitation des terres de culture.
1.3.1. La location de la parcelle
« Plus rare est l'eau douce, plus la ressource devient
précieuse, plus sa valeur l'emporte sur celle de la terre » (Dresch
J., 1982 : 188). Cette phrase de Jean Dresch se vérifie dans le
Gandiolais. La nappe d'eau douce qui alimente les puits forés par les
maraîchers devient de plus en plus salée. Certains
maraîchers abandonnent leurs exploitations devenues salées
à cause de la remontée de la nappe et se dirigent vers d'autres
terres où la nappe est d'eau douce. C'est ainsi que dans le Gandiolais,
la valeur de l'eau l'emporte sur celle de la terre. La location des parcelles
de cultures se fait par rapport aux puits y existant et non par rapport
à sa superficie. Le locataire paye le nombre de puits que compte la
parcelle et non la taille de la parcelle elle-même. Autant il y a de
puits dans la parcelle, autant le prix de la location augmente. Par exemple,
pour une parcelle d'un hectare avec 6 puits, la location est de 10.000f par
puits soit 60.000f la parcelle ; alors qu'une parcelle de 3 hectares ne
disposant que de 4 puits, la location est à 40.000f la parcelle. Cette
pratique est très répandue dans le Gandiolais, surtout pendant la
période de la culture maraîchère. Plusieurs hectares sont
aujourd'hui abandonnés dans le Gandiolais à cause de la
remontée du sel en surface (cf. photo 13). Ces terres, inaptes à
toute exploitation agricole, sont devenues des parcours de bétail en
toute saison. Comme solution, leurs anciens propriétaires louent des
parcelles dans d'autres secteurs moins menacés. Les maraîchers des
villages de Ndiol Gandiol, de Ndiébène Gandiol et de
Tassinère, par exemple, louent des parcelles de cultures à Mouit,
Ricotte, Dégou Niayes ou Mboumbaye. La location se fait suivant le
nombre de puits dont dispose la parcelle. Un puits est loué à
10.000 francs par saison. La location d'une parcelle est juste pour une
production de la saison. Pour deux productions, il faut renouveler le contrat
de location. En raison de la forte demande de parcelle, certains producteurs
payent à l'avance la location pour la saison prochaine.
61
Photo 13 : Terres de cultures abandonnées à
cause du sel
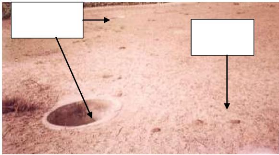
Puits salés et abandonnés
Parcelle abandonnée
Cliché : P. D. Diop, juillet 2005 à
Ndiol Gandiol
En revanche, pour les cultures pluviales, les actifs
rencontrés déclarent tous être propriétaires de leur
champ ; on n'a pas pu trouver une seule parcelle louée ou un seul paysan
locataire. Plusieurs raisons justifient ce constat. Du fait de
l'irrégularité des pluies et de la courte durée de la
saison sèche, les cultures sous pluies mobilisent de moins en moins de
monde. Les crédits accordés sur les semences et les engrais en
saison sèche ne sont pas attribués aux paysans pendant la saison
des pluies. Les faibles rendements enregistrés depuis plus de trois
décennies et le caractère de l'agriculture (subsistance) font que
l'aspect économique est peu favorisé pour les cultures sous
pluies.
Ce système de location de parcelles agricoles entre les
propriétaires et non propriétaires montre les limites de
l'application de la loi sur le domaine national, qui ne prévoit dans ses
textes la vente, encore moins la location d'une parcelle par son occupant. Elle
reflète des pratiques individuelles sur les terres de cultures qui ne
correspondent ni tout à fait aux systèmes coutumiers, ni à
la loi sur le domaine national.
1.3.2. L'emploi de la main-d'oeuvre
Ce mode d'exploitation de la terre est très
fréquent dans le Gandiolais. Pendant la saison des pluies par exemple,
le propriétaire exploite lui-même ses propres terres agricoles. Il
engage ses propres enfants dans les travaux champêtres. Ces derniers,
membres de la famille, n'ont pas besoin d'une rémunération ; mais
une fois mariés, ils deviennent autonomes et devront désormais
s'occuper de leurs propres parcelles. A défaut de cette main-d'oeuvre
familiale, le paysan fait appel aux éventuels ouvriers-paysans qui
seront rémunérés à la fin des travaux. Il s'agit de
quelques jeunes du village qui travaillent en villes en saison sèche. En
hivernage, ils acceptent d'être engagés, pour quelques jours voire
une semaine, par un paysan qui aurait à solliciter de la main-d'oeuvre.
Ces jeunes arrivent parfois à travailler avec plusieurs paysans
62
pendant les deux ou trois mois d'hivernage. Ce mode
d'exploitation est aujourd'hui de moins en moins pratiqué pour deux
raisons. Les producteurs ne sont pas convaincus de l'éventualité
d'une bonne saison des pluies à cause des aléas climatiques et de
la faiblesse des volumes pluviométriques enregistrés chaque
année. Ils ne sont également pas financièrement
prêts pour prendre en charge l'ensemble des besoins de leurs
employés (petit déjeuner et déjeuner) et la
rétribution (500f par jour et par employé) pour les travaux
effectués. Ainsi, ils préfèrent prendre eux-mêmes en
charge les quelques hectares qu'ils auront à mettre en valeur.
L'exploitation est dans ce cas de type familiale.
1.3.3 Le système de partage
Dans le Gandiolais, le système de partage varie suivant
les saisons de l'année. En saison des pluies, le système
utilisé est le métayage. Il s'agit d'un contrat d'exploitation
agricole dans lequel le propriétaire loue sa parcelle au métayer
en échange d'une partie des produits de récoltes. Cette pratique
consiste en un accord associatif entre le propriétaire de la parcelle et
l'agriculteur. Le locataire qui se voit confier la parcelle doit l'exploiter
par ses propres moyens. Il se charge de l'achat des produits agricoles tel que
les semences et produits industriels et matériels agricoles. A la fin
des travaux, il partage les produits de récolte avec le
propriétaire de la parcelle sur laquelle sont effectués les
travaux agricoles. C'est le système de métayage. Ce mode de
pratique agricole, en saison des pluies, n'est utilisé que par quelques
producteurs du Gandiolais. Ce sont par exemple ceux qui ont la force physique
pour travailler la terre, mais ne disposent pas de terres ou de moyens
financiers pour acheter des produits et du matériel agricole.
En saison sèche, ce système de partage reste la
principale méthode chez les maraîchers. Ces derniers engagent un
ou plusieurs travailleurs temporaires (sourgha) qui assurent les
travaux d'irrigation et parfois même toute la conduite de la culture
depuis la pépinière jusqu'à la récolte. Ces
temporaires viennent d'une part de l'intérieur du pays (Kaolack,
Ziguinchor, Kolda) et d'autre part de la sous région (Guinée,
Gambie, Mali). Leur employeur leur fournisse des semences, de l'engrais, des
produits chimiques, du matériel agricole, de la terre et des puits.
L'employeur doit en effet gratuitement prendre en charge l'ensemble des besoins
nécessaires de son ou ses employés. Ces besoins sont par exemple
le dortoir, les trois repas quotidien (petit déjeuner, déjeuner
et dîner) et éventuellement le thé28. Par contre
d'autres maraîchers assurent uniquement les repas.
28 Entretien du 19 mars 2004 avec quelques sourgha
à Mouit.
63
Planche 3 : Conditions de vie des
sourgha et stratégies de adoptées

Une case construite avec des sacs vidés, de la toile et
des nattes à Lahlar (Gadaga)
La case d'un sourgha à l'intérieur d'une
parcelle d'oignons à Mboumbaye
Photos 14-15 : Certains sourgha
construisent une case dans la parcelle pour y passer la nuit. Ce sont le
plus souvent ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'une chambre chez
l'employeur.
Clichés : P. D. Diop, juillet 2005

De la tomate plantée aux abords des cuvettes d'oignons.
Plantation d'oignons
Photo 16 : Pour couvrir leurs petits
besoins, les employés plantent de la tomate, qui a un cycle plus court
que celui de l'oignon (2 mois environ) aux abords des cuvettes d'oignons.
Clichés : P. D. Diop, juillet 2005

Plus de 770 cuvettes de tomate dans une parcelle à
Mboumaye
Une parcelle de carotte à Mouit Gandiol
Photos 17-18 : Quelques
sourgha, souvent ceux qui ne sont pas satisfaits des rendements de la
première saison d'oignons entre novembre et février, plantent
d'autres variétés (carottes ou tomates), une façon de
prolonger leur séjour avant la seconde saison d'oignons (d'avril
à juillet).
Clichés 17 et 18 : P. Thiam, janvier 200
64
Dans ce cas le sougha essaye de construire lui
même une case à l'intérieur de la parcelle pour y passer la
nuit durant tout son séjour (cf. photos 14-15). Pour couvrir leurs
petits besoins, comme la cigarette, le thé, les sourgha
plantent sur les rebords des cuvettes d'oignon quelques graines de tomates
(photo 16). Cette tomate récoltée par les sourgha est
vendue localement à des commerçantes de la place à 100f le
kg ou 2.500f la bassine. Ces dernières les revendent au niveau des
marchés locaux dans le Gandiolais.
Après la récolte de sa première
production d'oignons au mois d'avril (2005), le temporaire L.M. déclare
avoir obtenu, lui et son employeur, 87 sacs d'oignons, soit 3 tonnes 480 kg. La
parcelle comptait 771 cuvettes. Ils ont vendu les produits aux bana-banas
qui sont venus les acheter sur place à 120f le kg. Les
dépenses effectuées par son employeur s'élevaient à
26.400f. A la suite du partage du reste de la vente, ils se sont
retrouvés chacun avec 120.000f. Certains sourgha arrivent
parfois à faire deux campagnes avec leur employeur. Après la
première campagne celle d'oignon en saison chaude entre juin et
septembre, ils entament une seconde campagne à partir du mois de
novembre. Leur employeur leur offre des semences de carotte par exemple (cf.
Photo 17 et 18) pour la saison froide de novembre en février.
2. Les mutations dans l'organisation du secteur
agricole Gandiolais
2.1. Les cultures « hors sol »
Ce système de production agricole était une
méthode jusque là inconnue dans le Gandiolais. Depuis
l'année 2004, cette forme d'agriculture se développe à
travers un regroupement de G.I.E. Celui-ci compte déjà à
son actif 10 G.I.E., dont 7 issus du Gandiolais et du Toubé
répartis aux villages suivant : Gandon, Tassinère,
Ndiakhère, Ngaye Ngaye, Békhar, Ndiébène
Toubé Wolof et Ndiébène Gandiol. Ils sont soutenus par
l'ANCAR qui avait encouragé leur mise en place et assuré la
formation de 2 femmes par G.I.E. Cette formation portait sur les techniques de
conservation des légumes, de préparation de sirop et de
confiture, et de stérilisation des bocaux pour le conditionnement. Il
est difficile de savoir le nombre exact de femmes que compte les G.I.E.
Certains G.I.E. regroupent l'ensemble des femmes d'un village (G.I.E. Taty
Mbaye de Békhar), tandis que d'autres réunissent un ou deux
quartiers dans un village29. Le nombre d'adhérents change
régulièrement d'un G.I.E. à un autre. Certaines femmes
sursoient leur activité, parce que n'ayant pas été
encouragées par
29 Entretien du 23 juillet 2004 (à Gandon) avec
Adji Dieng, responsable d'un groupement de dix G.I.E., qui regroupe plusieurs
villages de la communauté rurale, dont sept dans le Gandiolais.
65
leur mari, d'autre par manque de temps. Parmi ces G.I.E.,
certains comptent plus d'une centaine de membres (Mor Golongor de
Ndiébène Toubé). Pour être membre du groupement, le
G.I.E. doit adhérer à hauteur de 5.000f. Les travaux de
production se font sur des tables d'environ 1m2. La technique
consiste à planter les pépinières sur ces tables et
à y faire le repiquage. Les produits récoltés seront
transformés localement en confiture de légumes ou en sirop de
fruits. La transformation se fait dans les locaux de la maison communautaire de
Gandon. Le produit fini est mis dans des bouteilles d'un litre. La vente se
fait sur place et dans la ville de Saint Louis. Les différentes
variétés sont la tomate, le bissap, le piment, le chou, produits
sur place. Les autres comme le tamarin, le gingembre, l'arachide, le mil, sont
achetés dans les marchés urbains et locaux. Parmi les produits
finis, il y a le sirop de bissap, de gingembre, de « Diiwu Nior »,
l'huile d'arachide. Les bouteilles sont vendues à 2.000f l'unité
pour le gingembre et le « Diiwu Nior ». Les bouteilles de bissap et
de tamarin sont vendues à 1.500f (cf. photo 19). La confiture de
légumes est vendue à 1.000f la bouteille.
Photo n°19 : Produits agricoles locaux
transformés par le G.I.E. Sukaly Gandon

Source : photo M. Sall, mars 2005 à Gandon
Quelques produits locaux transformés et exposés
à la vente par le G.P.F. de Sukaly Gandon.
Durant la première année, le groupement a eu un
bénéfice de plus de 40.000 francs. Une partie de cette somme sert
à rémunérer les femmes qui y travaillent, l'autre sert
à acheter les produits à transformer et le petit matériel
nécessaire : seaux, marmites, louches perforées, bocaux de
récupération. Après un an d'expérience, ces femmes
attestent que la technique nécessite beaucoup de moyens financiers et de
temps. Elles sollicitent un soutien matériel de la part de la
communauté rurale. Ce système de culture, comparées aux
cultures maraîchères ou sous pluies, ne nécessite pas de
grands espaces. Cela n'empêche pas les femmes de solliciter auprès
du conseil rural un espace pour la transformation et probablement l'exposition
des produits mis en vente.
66
2.2. Dynamique des organisations communautaires de base
Les organisations communautaires de base sont des structures
qui regroupent des organisations sociales traditionnelles ou modernes. Il
s'agit d'organisations mises en place par les populations du même terroir
à travers des O.P., des G.I.E. ou des G.P.F., pour la prise en charge de
leurs préoccupations. L'existence de ces organisations est doublement
importante. En même tant que leur action permet de mesurer le niveau de
prise de conscience et de participation des populations dans les actions de
développement, elle renseigne sur les articulations ou problèmes
qui se posent entre les différents pouvoirs intervenant dans la zone.
2.2.1. Formes d'organisations paysannes
Dans la communauté rurale de Gandon existent depuis
très longtemps des d'organisations traditionnelles. Leur influence se
limitait essentiellement au niveau du village et particulièrement aux
personnes qui y adhéraient. Leur mise en place relevait des liens de
parenté, d'affinités, ou pouvait être basée sur le
voisinage. Ce sont par exemple les tontines30, les regroupements par
classe d'âge, les mouvements associatifs de quartiers. Ces formes
d'organisations ne s'investissaient pas dans les activités productives,
contrairement aux formes d'organisations modernes.
Les organisations de type moderne, en plus des critères
qui composent les organisations traditionnelles, sont d'avantages
fondées sur des critères d'ordre social et d'activités
productives. Ce sont des O.C.B. dont les rayons d'actions dépassent le
cadre villageois pour s'insérer dans l'espace communautaire. Il s'agit
par exemple des G.P.F., des G.I.E., des O.J.F. (Organisation des Jeunes
Filles), Foyers de Jeunes (F.J.). Certaines de ces organisations ont
existé dans la zone du Gandiolais et de Toubé depuis les
années 1980. C'est le cas des F.J. et de quelques associations de
quartier devenues des G.I.E. D'autres organisations comme les O.J.F. et les
G.P.F. ont pris forme il y a moins de dix ans. Mais c'est durant les
années 2000 que toutes ces organisations villageoises ont ouvertement
commencé à se regrouper pour devenir des associations inter
villageoises. C'est le cas de l'A.D.V.G.T. (Association pour le
Développement des Villages de Gandiol et de Toubé). Elle a
été créée, il y a plus d'une dizaine
d'années, par les jeunes des deux secteurs concernés, mais elle
était inactive. L'une des raisons avancées pour expliquer cette
passivité est la mobilité des membres qui composaient le
bureau.
30 Groupement financier qui regroupe un certain
nombre de personnes. Chacune d'entre elles doit verser
régulièrement une somme et à tour de rôle, chaque
membre reçoit un jour la totalité des cotisations bimensuelles,
mensuelles ou hebdomadaires. C'est le cas des associations féminines
appelées « diamra » ou « assoce »
créées dans chaque quartier d'un village.
67
Ce sont des jeunes mariés sans emplois qui, compte tenu
des réalités socio-économiques, étaient
obligés de quitter leur village pour aller gagner leur vie ailleurs.
Depuis 2000, l'association est prise en charge par de jeunes instituteurs de la
zone. Mais contrairement aux G.I.E. et associations féminines,
l'A.D.V.G.T. n'est toujours pas parvenue à s'imposer concrètement
dans sa localité, faute d'une bonne politique de suivi.
Les mouvements de femmes constituent un cas particulier dans
ce dispositif organisationnel des populations. Leur rayon d'action et
d'influence est très ressenti partout dans la communauté rurale.
Aujourd'hui, la tendance pour ces femmes est au regroupement dans des
structures peu nombreuses mais socialement plus viables et
économiquement plus dynamiques que les organisations qui existaient
jusque là. C'est dans cet ordre d'idée qu'il faut comprendre la
constitution des ensembles associatifs comme les G.I.E. Taty Mbaye de
Békhar, Sukaly Gandon, Jïgenus Ndiébène Gandiol et
Mor Golongor de Ndiébène Toubé Wolof. Ce sont des
associations féminines qui s'illustrent particulièrement dans des
activités agricoles (culture, transformation et vente de produits
locaux).
2.2.2. Rôle des Organisations Communautaires de
Base
Le dynamisme des organisations communautaires de bases ou
acteurs locaux est un signe de la vitalité de la population et de sa
créativité. Ce sont en général des groupes qui ont
un champ d'activités bien délimité. Ils permettent
à une fraction de la population de se rassembler et d'agir ensemble. Ces
organisations témoignent du dynamisme d'une population susceptible de se
mobiliser dans une perspective de développement
socio-économique.
« Les O.P, à travers des pratiques
"stéréotypées", contribuent à accroître le
potentiel de la société rurale, à développer sa
capacité à se fixer des objectifs propres et certains des
instruments dont elles ont besoin pour les atteindre » (Mercoiret M. R.,
Bosc P. M., 1994 : 10)
En effet, ces organisations sont porteuses d'objectifs ou d'un
projet implicite sur le milieu social qu'elles contribuent à animer.
C'est pourquoi, après les avoir identifiées à partir de
leur dynamique organisationnelle, il convient de s'interroger sur leur
rôle dans le secteur agricole en particulier et dans la gestion et
l'impulsion du développement local en général.
68
2.2.3. Aperçu sur les actions des organisations
de producteurs
Au niveau de la communauté rurale, on peut
individualiser les G.P.F. et les associations des jeunes (O.J.F.- F.J.),
suivant leur dynamique opérationnelle.
2.2.3.1. Les Groupement de Producteurs
Féminins
De simples organisations culturelles, dont les
activités se limitaient à des rencontres familiales ou amicales
(tours de thé, festivités), les structures féminines sont
devenues des groupements socio-économiques. Depuis l'année 2004,
ces groupements se montrent actifs et sont présents dans toutes les
activités de développement en milieu rural. Dans la zone du
Gandiolais et de Toubé, on note un réel dynamisme des G.P.F.
notamment dans des activités entièrement agricoles. Ils
s'engagent à promouvoir le développement du maraîchage par
la transformation des produits agricoles locaux. Malheureusement, ils n'ont pas
les moyens de leurs ambitions, même s'ils bénéficient
souvent de l'aide de l'ANCAR et du PLAN Sénégal. Le premier
assure la formation et l'encadrement des O.C.B. dans le domaine agricole tandis
que le second les initie dans l'alphabétisation et la création de
boutiques communautaires et de G.I.E. L'exemple du G.I.E. Taty Mbaye de
Békhar mérite d'être rapporté.
? Le G.I.E. Taty Mbaye de
Békhar
Békhar est un petit village qui se trouve à
côté du village de Ngaye Ngaye. Il est situé à une
dizaine de km au Sud-est de la ville de Saint Louis sur la route nationale
numéro 2 et à moins d'un km à l'ouest du village de
Gandon. Il est composé de trois quartiers. Il y a Kilimane, où
vivent les familles Diop ; les familles Ngâne vivent à
Nganène et ceux qui portent le nom Mbaye se trouvent à Bayakhe.
Le chef du village est choisi dans la famille Mbaye, l'Imam porte le nom Diop.
Le village compte actuellement plus de 1.000 habitants. Il ressort des
discutions avec les sages de ce village qu'il est, après Leybar, le
village le plus ancien de Toubé31. Certains disent même
qu'il a été créé bien avant la ville de Saint
Louis.
Créé en 1987 par les femmes elles-mêmes
sous la forme d'un G.P.F., le groupement obtient en 1990 sa reconnaissance
juridique et crée en son sein un G.I.E. dénommé Taty
Mbaye.32 A l'origine, le G.I.E. se voulait une
fédération différente des O.P. de la communauté
rurale de Gandon. Mais avec le temps, il s'est finalement ouvert à toute
activité génératrice de revenus qui contribuerait à
promouvoir le développement de leur localité (cf. planche 5).
31 Entretien du 27 septembre 2004 avec le chef du
village, l'imam et quelques sages du village de Békhar.
32 Taty Mbaye est le nom du premier habitant du
village de Békhar. Elle est l'ancêtre de la famille Mbaye
69
Planche 5 : Quelques produits du
G.I.E. Taty Mbaye exposés lors du forum sur l'agriculture
organisé par l'ANCAR, la communauté rurale de Gandon et les O.P.
(mars 2005) à l'U.G.B.

Photo 20 : De la transformation des
produits agricoles à l'embouche bovine en passant par la teinture, le
G.I.E de Békhar a largement oeuvré pour la diversification.

Photo 21: Quelques flacons pour
la conservation des produits finis. Ils sont fabriqués par l'ANCAR pour
le G.I.E. de Taty Mbaye de Békhar

Photo 22 : Quelques produits
exposés dans les locaux du G.I.E. Taty Mbaye
Clichés : M. Sall, mars 2005
70
Taty Mbaye est né de la volonté des femmes du
village de Békhar de remédier au manque crucial de bien
d'équipements de la localité. Initialement, ces actions se
limitaient à des activités socioculturelles comme le « Set
setal »33. Aujourd'hui, ses actions deviennent de plus en plus
diversifiées (cf. photo 20).
Pour la réalisation de ses actions, le G.I.E. s'appuie
sur le soutien du conseil rural, qui joue le rôle de facilitateur entre
les partenaires au développement et les O.P. ; il a pu également
compter sur l'ANCAR, qui concourt financièrement à la
réalisation de certaines de ses actions et à la formation pour la
transformation des produits de légumes et fruits. L'ANCAR prend en
charge la fabrication des bouteilles qui servent à conserver et à
écouler les produits transformés comme le sirop de bissap, de
gingembre, la confiture de légumes, Diiwu Nior et la confection des
étiquettes apposées sur ces bouteilles (cf. photo 21).
Taty Mbaye regroupe l'ensemble des femmes du village de
Békhar (plus d'une soixantaine de membres). Pour bien mener leurs
travaux, les femmes se sont scindées en plusieurs groupes de dix
personnes34. Un groupe s'occupe de la culture sur table, un autre
est affecté à la teinture. La transformation de fruits et
légumes est également sous la charge d'un groupe de dix
personnes, de même que la couture. Deux autres groupes interviennent
respectivement dans la fabrication de savon et l'embouche bovine. Enfin, un
groupe s'occupe de l'aviculture. Aujourd'hui, le rêve de Taty Mbaye est
de bénéficier du soutien de tous les partenaires locaux
(agriculteurs, éleveurs, communauté rurale, etc.). La
diversité de leurs activités justifie l'intérêt que
tout le monde y porte maintenant, à la grande satisfaction des
populations membres du G.I.E. Au-delà de leur capacité à
s'organiser et à s'entendre sur un objectif commun, le G.I.E. Taty Mbaye
témoigne de l'aptitude des populations du Gandiolais et de Toubé
à traduire en actes concrets une bonne partie de leurs projets.
A ce titre, on constate que les O.C.B. constituent
d'importants collectifs pour la promotion du développement de leur
localité. Seulement, elles souffrent d'un manque crucial d'informations
et de formation par rapport à leurs activités, d'appui financier
pour la réalisation de leurs différents projets. De ce fait, la
communauté rurale de Gandon pourrait chercher à leur apporter une
plus grande assistance. Elle peut aussi être plus dynamique dans son
rôle de médiation entre les partenaires au développement et
les O.C.B.
Il ressort des résultats d'enquêtes obtenus
auprès des G.P.F. de Ngaye Ngaye qu'en dehors de leurs activités
à usage collectif (transformation de produits locaux, teinture, cultures
sur table, aviculture, couture), chaque femme s'engage dans le projet de
reboisement initié par
33 C'est le nettoiement d'un quartier, d'un village ou
d'une ville par un groupe de personnes issu de la localité.
34 Entretien du 24 mai 2005 avec Ndèye Mbaye,
responsable du G.I.E. Taty Mbaye
71
la réserve de Gueumbeul. Celle-ci, en collaboration avec
les femmes des villages environnants, développe depuis l'année
2004 une politique de reboisement (voir photo 23). Photo n° 23:
Projet de reboisement des femmes avec la réserve de Gueumbeul
|
|
|
|
|
|
|
Filao
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acajou
|
|
|
|
|
|
|
|
Sachets en plastique
|
|
|
|
Cliché : M. Sall, mars 2005
Le projet prend en compte l'ensemble des femmes des villages
de Ndiakhère, Gueumbeul, Ngayna, Diama, Békhar, Ngaye Ngaye. La
technique de plantation des pépinières consiste à
mélanger 2 brouettes de terreaux pour une brouette de sable. Le
mélange, mis dans des sachets en plastique doit être arrosé
3 à 4 jours avant le semis des graines. La réserve fournit aux
femmes les graines, et les sachets en plastique qui servent au repiquage. C'est
elle également qui viendra acheter une partie des
pépinières. L'autre partie devra être plantée par
les femmes au niveau de leurs villages respectifs. L'objectif de la
réserve est de faire régénérer la mangrove qui,
avec un fort taux de prélèvement, devient de plus en plus rare
dans la zone. Dans sa politique de reboisement la réserve essaie de
fournir du bois de chauffe, des fruits et de créer des brises vent pour
stabiliser le sable. Le manguier, le filao, l'acacia (Seng), l'acajou, le
citronnier constituent les espèces les plus sollicitées par
l'entreprise d'agroforesterie des femmes. Ces femmes s'emploient aussi dans
l'embouche bovine, l'artisanat et le petit commerce, la fabrication de savon.
Ils sont aidés en cela par l'ANCAR et PLAN Sénégal.
Les femmes du Gandiolais et de Toubé, à
l'exemple de celles de Békhar, gagneraient à dynamiser leur
groupement en élargissant leur marché de consommation à
l'échelle des communautés rurales de Gandon et de Mpal et de la
ville de Saint Louis.
72
2.2.3.2. Les associations de
jeunes
Tout comme les G.P.F., les associations de jeunes (O.J.F.-
A.S.C.- F.J.) s'illustraient pendant longtemps dans des activités
socioculturels. Jusqu'au début des années 2000, elles ne
présentaient aucun projet de développement
socio-économique. Leurs principales sources de motivation étaient
uniquement les activités de vacances. Il s'agit des «
navétanes »35 pour les A.S.C., des manifestations
théâtrales pour les O.J.F. et des rencontres intellectuelles
(thé-débat, cours de vacances) organisées par les foyers
des jeunes des différents villages. Depuis, l'année
dernière, les associations de jeunes prétendent devenir des
acteurs dynamiques présents dans toute action visant à promouvoir
le développement socio-économique de leur localité. Les
jeunes cherchent à impulser une nouvelle dynamique de
développement à la base. Parmi les projets mis en perspectif, il
y a l'aviculture et la création de boutiques communautaires. Mais
contrairement aux G.P.F., ces mouvements souffrent d'un manque réel
d'encadrement et de financement. Or, leur capacité de mobilisation
(plusieurs centaines de personnes) devrait être un atout dans
l'exécution des programmes de développement de la
localité.
2.2. Dynamiques induites dans le secteur agricole par les
partenaires au développement
Le secteur agricole de la communauté rurale de Gandon a
été régulièrement soutenu par des partenaires au
développement, étatiques et O.N.G., ce qui explique l'existence
de nombreuses structures d'intervention qui se sont succédées
depuis les indépendances. Mais les revenus tirés de l'agriculture
n'ont pas permis à cette partie de la région de Saint Louis de
satisfaire son autosuffisance alimentaire. Dans le Gandiolais et le
Toubé, ces interventions se sont le plus souvent soldées par des
échecs. Dans cette partie, les analyses porteront sur les
différentes réalisations et les causes de certains
échecs.
2.2.1. L'apport des partenaires au développement
dans le secteur agricole
L'ISRA et l'IRA ont pendant longtemps marqué leur
présence dans la communauté rurale de Gandon. Cette
présence a été déterminante dans la formation des
agriculteurs, pour certaines de ces structures comme l'IRA, à travers le
lancement des campagnes de vulgarisation. C'est dans cette campagne de
vulgarisation que « des variétés plus productives et
adaptées de tomate, oignon ont été proposées aux
horticulteurs Gandiolais et que l'utilisation de la fumure a été
rationalisée » (IRA, 2003 : 34). Dans cette campagne de
vulgarisation et de
35 Programmes sportifs et culturels de vacances
73
formation, plusieurs thèmes ont été
diffusés dans plusieurs villages du Gandiolais et Toubé. Parmi
ceux-ci, il y a l'utilisation du compostage et de la matière organique,
le respect du calendrier et des itinéraires techniques pour une
production de qualité, l'amendement des sols.
Le CECI (Centre canadien d'Etude et de Coopération
Internationale) développait jusqu'à la fin des années
1993, un programme d'appui aux producteurs Gandiolais. Ce programme ayant pour
objectif la maîtrise de la filière d'oignon depuis la production
jusqu'à la commercialisation, s'articulait autour des volets suivants
:
- le volet formation et développement ;
- le volet crédit et épargne ;
- le volet « appui technique » qui s'occupait de
l'amélioration de la qualité des semences et des conditions de
production ;
- et le volet commercialisation.
A partir de 1989, le CECI ayant constaté les contres
performances des producteurs liées à la fragilité de la
nappe et de la dégradation des terres agricoles, avait
déterminé des stratégies et des modalités de
gestion des ressources disponibles en eau douce. Reconnaissant que toute
tentative d'aménagement dans la zone du Gandiolais et de Toubé
requiert des connaissances appropriées, le CECI avait défini
trois zones distinctes de maraîchage36 (cf. carte 6).
- la partie centrale du Toubé , notamment les villages
de Ndiakhère, Gueumbeul, Keur Bernard, et la partie Nord-Ouest du
secteur de Gandiol (Tassinère, Ndiébène Gandiol et Ndiol)
considérées comme une zone à risque, dont l'exploitation
agricole, le maraîchage notamment, présente des
désavantages pour l'environnement et pour le producteur ;
- la partie situé Nord-est (Ndièbène
Toubé Peul, Ngaye Ngaye, Keur Martin, Gandon jusqu'au Nord de Diama
Thiaguel), qui forme un secteur potentiel mais avec quelques contraintes
techniques liées à la profondeur de la nappe ;
- enfin la partie Sud du Gandiolais, du Nord-est de Toug Peul
jusqu'à Lahlar en passant par Mouit et Mboumbaye, où la
production est sans grand risque.
Pour cette étude, le CECI avait l'objectif d'orienter
les producteurs pour une meilleure gestion de leur production agricole. Mais
à partir de 1993, il suspend ses interventions à cause de la
remontée du sel en surface.
Entre 1982 et 1990, la CARITAS a effectué plusieurs
réalisations dans la communauté rurale de Gandon. Durant ses
premières années, la CARITAS a soutenu en semences, intrants,
fonçage de puits, beaucoup d'agriculteurs.
36 Entretien du 26 mai 2004 avec Saër Thiam
à la Division Régionale pour le Développement Rural
(D.R.D.R.) de Saint Louis.
74
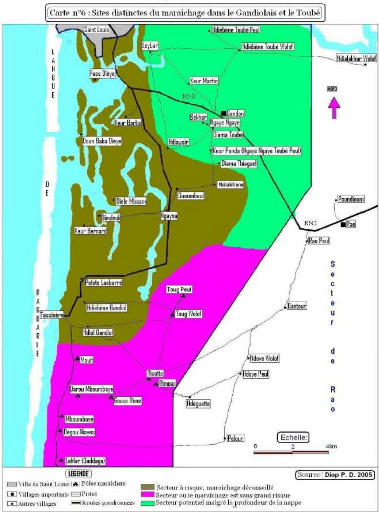
75
Avec la création d'un centre de formation et de
production agricole, l'organisation humanitaire compte aujourd'hui à son
actif le fonçage de près de 2.000 puits dans l'ensemble de la
communauté rurale pour le maraîchage. Dans le Gandiolais et le
Toubé, la CARITAS a assisté plus de 100 producteurs dans
l'approvisionnement en intrants, la formation de jeunes agriculteurs, la
création de fédérations de G.I.E., de groupements de
promotion économique, social et culturel aux techniques de
l'exploitation agricole (enquêtes personnelles 2004). Elle a
également offert des sessions de formation en technique de conduite
d'une pépinière et une session de formation sur les techniques de
production animale et avicole (CARITAS, 2004 : 1). Durant une vingtaine
d'années, la CARITAS a soutenu les producteurs du Gandiolais dans des
actions de fonçage de puits, l'approvisionnement en intrants,
création des Organisations Communautaires de Base (O.C.B.) et des
Groupements de Production Féminin (G.P.F.). Depuis 1998, les actions de
la CARITAS se sont réduites aujourd'hui à la formation et au
suivi avec un nombre restreint de villages. Dans la nouvelle démarche
qu'elle entend adopter, l'organisation compte soutenir les populations mais
avec un modeste apport de celles-ci dans les financements.
PLAN Sénégal intervient dans cette zone depuis
1990. Ces objectifs sont identiques à celles de la CARITAS, mais ils
s'étendent sur d'autres actions comme la création de boutiques
communautaires, l'alphabétisation de masse avec comme thème
l'initiation aux langues locales (Wolof et Pular). Le PLAN contribue
également dans l'approvisionnement en denrées de première
nécessité, l'organisation et l'encadrement des paysans par la
création des G.I.E. Toujours parmi ses réalisations, le PLAN
appuie les paysans dans le creusement de puits et l'équipement des
salles de classes qu'il a lui même construit au niveau des villages, mais
aussi dans le volet crédit/semences et crédit/épargne, la
mise en place de banque d'intrants et la formation d'agents de santé
communautaire (enquêtes personnelles 2004).
Le PNIR, programme financé par la banque mondiale,
appuie les collectivités locales dans la politique de
décentralisation. Basé sur une démarche participative, il
vise à réduire la pauvreté rurale et à
améliorer les conditions de vie des populations par l'accès aux
services sociaux de base. Le PNIR travaille actuellement avec 2 mutuelles dans
la communauté rurale de Gandon (Rao et Mboumbaye). Il les appuie dans
l'achat d'équipements, d'intrants et la vente de
pépinière. Les efforts déployés par le gouvernement
du Sénégal, par l'entremise du PNIR, ont permis à ce
dernier de financer les travaux de construction du poste de santé de
Gandon et son équipement. Il compte également à son actif
la réhabilitation des pistes de production qui permettent de rallier
à partir de la route nationale les villages de Leybar, de
Ndiébène Toubé Wolof, de Ndiakhère,
Tassinère, Mouit. Avec l'appui du PNIR, l'Etat a réalisé
un projet
76
d'adduction d'eau au collège de Gandon, à
l'école de Mouit et des micro projets (pour un coût global de 20
millions) qui permettront à certains G.I.E. de la communauté
rurale de Gandon de mener des activités génératrices de
revenus37.
L'ANCAR, société anonyme à participation
publique majoritaire, cherche à renforcer les capacités des O.P.
et à impliquer les producteurs dans le processus d'élaboration et
de mise en oeuvre du conseil agricole et rural. Son objectif est de «
faire du secteur rural le levier de l'économie »38. Ses
réalisations au niveau de la communauté rurale portent sur des
enseignements sur les techniques d'élaboration d'une fiche de projet et
sur les techniques de transformations et de conservation des produits locaux,
le suivi des activités lancées par l'agence d'exécution
technique. Tous ceux-ci devraient aboutir à l'accroissement de la
productivité du secteur agricole et des autres secteurs de
développement. Aujourd'hui, l'ANCAR poursuit sa mission selon une
nouvelle approche basée sur le partenariat avec les principaux acteurs.
Elle peut traiter directement ses projets avec les mutuelles ou organisations
juridiquement reconnues. Plus d'une centaine de projets sont en cours
d'exécution avec les O.P. de la communauté rurale de Gandon,
particulièrement les G.P.F.
Malgré le nombre important de structures qui sont
intervenues dans la communauté rurale de Gandon et la diversité
de leurs actions, les contraintes demeurent toujours.
2.2.2. Facteurs explicatifs des contre-performances
dans les interventions
Les échecs notés dans les interventions du
secteur agricole s'expliquent pour deux raisons. Il y a d'une part le manque de
qualification des producteurs dans la pratique et le suivi des orientations des
partenaires au développement. D'autre part la politique de ces derniers
est le plus souvent en inadéquation avec les aspirations des
producteurs.
L'introduction d'une nouvelle technique de production agricole
requiert avant tout l'information, la sensibilisation, la formation et
l'encadrement des producteurs locaux. Le transfert de compétences
initié par l'Etat du Sénégal s'est opéré
sans la préparation préalable des acteurs locaux qui ont
dorénavant en charge le développement de leur localité.
Ainsi, il en résulte chez eux une absence de maîtrise des
compétences, un défaut d'information sur le rôle et les
responsabilités induit par le transfert, une insuffisance ou une absence
de ressources financières et surtout de ressources humaines capables
d'agir devant les sollicitations pressantes
37
lesoleil@lesoleil.sn, article publié dans
l'édition du Samedi 30 avril 2005.
38 Séminaire permanent intitulé
Les Mercredi de Girardel. Le 2 février 2005, M. Samba
Kanté, Directeur Régional de l'ANCAR de Saint Louis, animait ce
séminaire qui portait sur le thème « Nouvelle vision du
conseil agricole et rural ». M. Kanté a présenté
l'ANCAR, ses objectifs et ses priorités.
77
des populations. Par conséquent, cette situation
favorise le scepticisme des partenaires au développement vis à
vis des élus locaux et de la population active.
Plusieurs partenaires ont suspendu ou réduit leurs
actions suite à des manquements répétitifs aux
résultats attendus. La CARITAS est l'un des principaux partenaires du
Gandiolais à suspendre ses activités. Depuis 1998, la CARITAS a
réduit ses actions, car elles se sont soldées, pour la plupart,
par des échecs. « Il se trouvait des paysans qui rataient presque
ou totalement leur campagne agricole et qui, se faisant, biaisaient l'objectif
de la CARITAS sur ce volet» (ibidem). Parmi celles-ci, il y a les
centaines de puits abandonnés à cause du sel, les séchoirs
tous dégradés faute d'entretien et les pompes Djambar, qui
souffraient d'un manque de suivi technique. De même, le Plan
Sénégal a considérablement réduit ses
activités dans la zone. Il a vu toutes les boutiques communautaires,
qu'il avait ouvertes pour les G.I.E. et G.P.F., fermées à cause
de pertes injustifiées. Le CECI également a du surseoir à
son programme depuis 1993, suite au refus des populations de suivre ses
propositions, à savoir l'abandon de certaines zones à risque.
Face à toutes ces contraintes les partenaires dans leur grande
majorité ont préféré mettre en terme à leur
programme d'appui aux populations agricoles du Gandiolais. Derrière eux,
ils laissent des programmes en cours ou une formation difficilement applicable
par les populations locales. Leur départ crée une rupture brutale
entre eux et les populations, laissant ces dernières abandonnées
à leur sort. C'est pourquoi, il faudrait du côté des
structures, privilégier l'encadrement des populations de manière
à ce qu'elles puissent se prendre en charge une fois le projet
arrivé à son terme. Pendant longtemps, la population du
Gandiolais et de Toubé avait une faible perception de l'objectif des
partenaires. L'idée qu'elle véhiculait était qu'un
partenaire au développement, « c'est le bailleurs qui doit apporter
des dons aux pauvres sans attendre rien au retour». Cette fausse
conception lui a valu sa situation actuelle. Les producteurs du Gandiolais
auraient pu mieux profiter des appuis dont ils ont
bénéficié durant plusieurs décennies.
Les partenaires ont aussi été en partie
responsables de leurs échecs. Dans un milieu agricole comme le
Gandiolais, où la population est pauvre, la première politique
d'appui pour une agriculture durable devait être la formation et la
vulgarisation. Les partenaires qui interviennent dans cette zone devaient
s'approcher de la population locale. Il ne s'agit pas seulement de proposer une
politique agricole et de définir les méthodes à adopter
pour sa réussite. Il faut au préalable qu'il y ait une
communication entre les exploitants et les partenaires. Ces derniers doivent en
premier lieu chercher à comprendre l'exploitant, sa situation sociale et
ses préoccupations majeures. Malheureusement, la forme adoptée
par les
78
partenaires au développement s'est basée sur une
approche du « haut vers le bas »39. Ce système ne
prévoit pas la communication du « bas vers la haut », alors
que le développement local sous entend que l'initiative vient de la
base. C'est là que la stratégie a failli, dans la mesure
où le partenaire propose, voire impose aux élus locaux et
notables, représentant la masse pauvre, son programme d'appui au
développement local. Souvent c'est le système « à
prendre ou à laisser ». La conséquence en est que les
discours des acteurs locaux et de l'opérateur sont le plus souvent
contradictoires. Le partenaire axe son discours sur la démarche ou la
méthode à adopter pour accroître les rendements des
cultures, alors que la population locale oriente le sien vers les besoins
quotidiens à satisfaire.
Dans l'optique d'un développement agricole durable, le
conseil rural et les exploitants agricoles pourraient favoriser le partenariat
avec les structures de recherche telle que l'ISRA. Ce partenariat est d'autant
plus nécessaire que les pratiques culturales ne sont pas toujours en
adéquation avec les conditions physiques du milieu. Une telle
collaboration leurs permettra de bénéficier des résultats
de la recherche et des innovations dans le domaine agricole.
Ces structures auront à aider les populations à
être mieux informées sur le respect des techniques de rotation de
cultures, de la pratique de l'assolement en systématisant les cultures
de variétés à cycle court. Elles auront également
comme tâche de faire respecter les itinéraires techniques pour
améliorer les rendements et de favoriser la réalisation des
brise-vent pour protéger les plantes contre l'ensablement. De ce
partenariat, les maraîchers gagneraient à avoir en premier lieu
une bonne maîtrise de la production, c'est-à-dire éviter la
surproduction au niveau des marchés locaux et nationaux pendant les
périodes de saturation. En second lieu, ils pourront rechercher des
partenaires en aval de la filière, c'est-à-dire essayer de
trouver des acheteurs avant même la récolte. L'agropôle de
Fass pourrait être, dans ce cas, l'un des principaux partenaires
commerciaux du Gandiolais (voir N. S. Dièye, mémoire de
maîtrise en cours). Enfin, la population agricole du Gandiolais devrait
produire en fonction de la demande sur le marché et des
possibilités de commercialisation.
39 Les recommandations techniques ont
été développées par des chercheurs dans leurs
services (ISRA et SAED par exemple) et transmises aux exploitants locaux par
des agents mandatés par les mêmes services.
79
CHAPITRE II
Quelques contraintes liées aux systèmes
de production agricole dans le Gandiolais
Les contraintes auxquelles sont confrontés les
producteurs agricoles du Gandiolais sont de plusieurs ordres. En dehors des
aléas climatiques et de la modification du régime hydraulique
naturel évoqués au-dessus et qui sont la source de
dégradation des eaux et des sols, le transport, le stockage,
l'écoulement des produits récoltés restent entre autre des
problèmes récurrents.
1. Les contraintes d'ordre sociale du secteur agricole
dans le Gandiolais et le Toubé
1.1. Contraintes socio-économiques
Dans le Gandiolais, le mode de production est un
système basé sur l'emploi d'un outillage traditionnel. Les
contraintes physiques et l'exploitation du milieu entraînent le
fonctionnement d'un système agraire caractérisé par une
grande mobilité de la population agricole. Cette mobilité est,
à la fois basée sur les conditions géographiques du milieu
et les activités saisonnières. Elle s'effectue d'une part entre
les zones littorales à tendance saline et les zones intérieures
où les dunes rouges sont plus ou moins fixées : Gouye
Rène, Ricotte, Toug Wolof et tout le secteur de Toubé. D'autre
part, la mobilité est quotidienne et s'opère entre le Gandiolais
et la ville de Saint Louis. Cette mobilité touche plus
particulièrement les femmes. Celles-ci, tout en demeurant au village,
s'offrent quelques opportunités de gagner peu d'argent en ville. Cette
offre se résume au petit commerce pour les mariées et emploi de
bonne pour les jeunes filles. Elle constitue une activité annexe qui
permet aux femmes de se débrouiller pour gagner quelques sous et faire
face aux besoins du foyer auxquels l'homme ne parvient à pourvoir. Pour
la plupart des personnes enquêtées, dont le gagne-pain
dépend essentiellement de l'agriculture, l'économie familiale est
partagée entre quelques produits maraîchers comme l'oignon
où les récoltes sont entièrement destinées à
la commercialisation et les cultures sous pluies pour la consommation
familiale. Pour ces populations, il est impossible de vendre en quantité
les produits récoltés. Et ceci pour plusieurs raisons : les
producteurs réservent une bonne partie de la production pour la
période de soudure qui coïncide avec la fin de la saison
sèche et le début de la saison des pluies. Elle correspond dans
le Gandiolais et le Toubé à la
80
période la plus difficile de l'année. Pour
assurer la transition entre cette période et les premières
récoltes de la saison des pluies, le paysan consomme sa réserve
de produits (mil, maïs, niébé, arachide). Pour certaines
familles nombreuses, le paysan est obligé d'utiliser les produits
récoltés pour la consommation familiale afin de mieux
répondre aux exigences alimentaires. « Je ne vends pas beaucoup
parce que la famille est très nombreuse et je ne dépends que de
la terre pour la nourrir » est souvent l'explication que donnent les
producteurs locaux pour justifier, malgré eux, les quantités de
récolte réservées pour la consommation familiale. Ainsi,
dans certaines concessions, la quasi-totalité de la production est
consommée par la famille. Une telle situation limite les
possibilités d'achats de semences, d'intrants et d'outils agricoles. Par
conséquent, le système de production reste traditionnel.
1.2. Contraintes relatives à la main-d'oeuvre
Partout dans le Gandiolais, la réduction du temps de
jachère a lourdement affecté les sols. Celle-ci se traduit par la
baisse de la teneur en matière organique, la dégradation de la
structure des sols, l'appauvrissement minéral les rendant moins
productifs et plus vulnérables à l'action érosive des
vents. Aspirant à de meilleures conditions de vie, les jeunes, qui
composent l'essentiel de la force active, se dirigent vers les grandes villes.
A cette situation d'exode rural, s'ajoute la division des familles après
le mariage des adultes.
Ainsi, pour compenser leur manque en main-d'oeuvre, les
maraîchers font appel aux saisonniers. C'est une main-d'oeuvre allochtone
non qualifiée. Malgré la prépondérance
remarquée des temporaires dans le Gandiolais, ces sourgha
commencent ces derniers temps à orienter de plus en plus leur
séjour vers d'autres secteurs maraîchers dont les conditions
d'emploi (la prise en charge et le système de partage) seront beaucoup
plus favorables. Parmi les zones ciblées, il y a le secteur de Potou,
Bango, Rao, Sakal et le lac de Guiers. Quelques raisons qui pourraient
expliquer ce choix de destination ont été avancées par les
sourgha rencontrés à Mouit, Dégou Niayes,
Mboumbaye et Lahlar. Selon ces sourgha, dans les secteurs de Potou et
de Sakal, par exemple, les conditions de vie sont meilleures qu'à
Gandiol. Dans ces secteurs, en dehors des engagements préalables (le
partage et la prise en charge), le repas est mieux servi qualitativement et
quantitativement. Le sourgha bénéficie également
d'un hébergement chez son associé. Alors qu'à Gandiol,
l'hébergement chez l'employeur n'est pas partout assuré (cf.
photos 14 et 15).
81
1.3. Contraintes relatives aux intrants et aux
crédits
En raison de la cherté des produits chimiques, les
maraîchers du Gandiolais prennent le risque d'utiliser n'importe quel
type d'engrais mis à leur disposition. Le plus souvent, ce sont des
engrais non adaptées aux exigences du milieu ou de la
variété cultivée. Il en résulte une
détérioration de la qualité des produits
récoltés et une mévente sur les marchés de la
ville. Par exemple, les oignons appelés « gagne mbaye
» ne supportent pas les opérations de grande mobilité.
Ils sont gorgés d'eau et pourrissent vite en quelques jours (cf. photo
24).
Photo 24 : La pourriture, première cause de la
mévente des oignons

Cliché : P. THIAM, mars 2005 à Mouit
Gandiol
Quelques oignons pourris déterrés des plantations
par le sourgha en mars 2005. Le produit était en abondance
sur
le marché et le producteur, explique son employé, avait
choisi d'attendre quelques semaines, le temps que les prix
montent. Le mois
de mars correspond à une période où la première
récolte est déjà prête. La variété
« gagne
mbaye » très fragile, ne pouvant pas
résister la chaleur, la pourriture s'ensuit.
Ils sont cultivés en saison froide entre
novembre/décembre et février. Ainsi, après la
première semaine qui suit la récolte entre février et
mars, les producteurs sont obligés de les vendre à bas prix (120f
en mars 2005) aux premiers commerçants qui se présentent devant
eux. Les bana-banas, premiers clients qui interviennent dans la zone,
sont conscients de ce fait. Dès la récolte de cette
variété, ils fixent leur prix aux producteurs. Là
où les maraîchers demandent 170 francs le kg, ils leurs proposent
100, 110 ou au maximum 120 francs. Ceux-ci, au bout d'une semaine, ne pouvant
plus tenir, préfèrent la vente à perte que le
pourrissement. En une semaine donc, le prix d'un kg d'oignon blanc peut
basculer jusqu'à 70 ou 75 francs. Dès le mois de juin,
après la récolte de la seconde saison d'oignon, les
maraîchers peuvent vendre leur produit jusqu'à 250 voir 300 francs
le kg.
Les semences recherchées par les maraîchers ne
sont pas toujours disponibles au moment voulu. Très souvent, le paysan
est obligé de se contenter de ses propres semences qu'il
82
a laissées fleurir dans sa parcelle
maraîchère. Cette pratique affaiblit la graine et rend les
produits de la prochaine récolte fragile.
L'utilisation excessive des engrais procure des rendements
élevés, mais à long terme, elle baisse la fertilité
des sols. L'engrais chimique est utilisé une fois pour les
pépinières et chaque semaine pendant un mois 15 jours
après les semis (enquêtes personnelles 2004). Le surplus d'engrais
sur les terres de cultures fragilise la structure du sol qui devient de plus en
plus sensible à l'érosion pluviale : l'eau, au lieu de
s'infiltrer dans le sol, ruisselle et emporte sur son passage tous les
éléments nutritifs. Quant à la fumure organique, elle est
utilisée avant ou au début des pépinières. Elle est
déposée en surface (cf. photo 6). Ce dépôt de fumier
en surface engendre une perte d'azote dans l'air, sous le soleil et une
brûlure du feuillage des plantes. Le milieu se dégrade ainsi et
progressivement, perd ses aptitudes écologiques.
2. Les contraintes techniques face à une
agriculture toujours tributaire des aléas climatiques
2.1. Contraintes relatives au transport et au stockage
2.1.1. Contraintes induites par le transport
Malgré la réfection des pistes de production
(axes Tassinère - Lahlar, Gandon - Ndiébène Toubé
Wolof, Ndiawsir - Leybar, Ngaye Ngaye - Ndiakhère) en 2004, par le PNIR
(voir carte n°7), le facteur transport constitue toujours un
véritable handicap pour l'écoulement des produits agricoles.
« Il ne suffit pas qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des
véhicules qui les empruntent » et en toutes saisons (Blanc P. C.,
1985, p : 247). Dans la plupart des villages enquêtés, le manque
de moyen de transport constitue un des facteurs principaux limitant
l'écoulement de la production agricole. Certains villages, souvent de
grands producteurs maraîchers, sont presque inaccessibles. Le village de
Ricotte qui est l'un des principaux pôles maraîchers du Gandiolais
reste très enclavé. Ce village n'a qu'une seule ouverture, c'est
la route qui passe par Ndiol Gandiol. C'est une piste tortueuse et très
étroite, dont la traversée devient impossible en hivernage. Dans
les villages situés au bord de la route, la limite reste
l'évacuation des produits récoltés entre les champs et les
points de collectes.
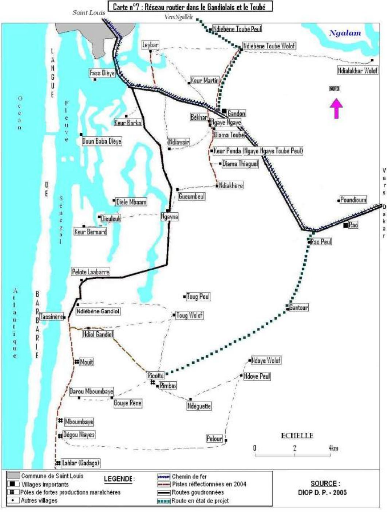
,Sr,if,t f.r?rrn?
ICarte n°7 : Réseau mintier dans
le Bandialais et le Taub&
4 'crskl ~rir
n
n i
Aildeye'Poled]
413n
ECHELLE
ü 2
tle3ileulr --
tl_
Leur 6er~ral
Feint taabarre
INdièrie1arldlal I
ii Nall Gandicll I
1
P % r 11 i""
Ill 1 11 M
it IMeoite
·
I it
arau #dbuumbat 4Plmbax
Ir
auye
Ene.
·
n a
a
FAbournbaye
4111.akhr {Gadaga}
=Commune de Saint Louis LEGEF,(E _ [1.Cfierkiin de
Fer
III Villages impartarM t9 l Pistes réfeclonnies
err 2004
WiPôtes de Fartes productions naraicheres F=
Routes goudronnées
'..1 Autres Ralte en Etat de projet
50U.KCL DIQP D. P. - 2005
#ldlaFkhar oW
t
i~hrNr~iwr~
2
ILnl _ - - - _ , _ . _ Hdiébéna
Toubé 1UaEofr
ial=T
I4reu-Perida(Nga eF~a T
--\-111H(Liihtre
GuawidieulI
rasa bieya
~fOk 4 arnj
I
iT-u1I
1
n ;'Iüug Paul
Ton Wolk
Ndéguette
83
84
Les pistes sableuses et tortueuses empêchent toute
circulation automobile (photo 25-26) et les produits récoltés
doivent être évacués sur l'unique piste qui joint
Tassinère à Lahlar (photo 27), par portage animal (dos
d'âne, charrette) ou individuel. Ces mêmes moyens de transfert sont
utilisés pour joindre les champs à la piste principale. Les
jeunes filles sont le plus souvent sollicitées dans cette
activité (photo 28). Il en résulte une manutention difficile et
un risque de pertes avant même la vente des produits.
L'ouverture annoncée de la route Ricotte - Gantour -
Rao Peul serait très bénéfique, dans la mesure où
elle permettrait une évacuation plus facile des produits
maraîchers vers le parc de stockage de Rao Peul. Cette route permettrait
également, à partir de Rao Peul, de créer une large
ouverture de la production agricole du Gandiolais et à partir de
là, tous les produits pourront être facilement
écoulés vers l'intérieur du pays.
2.1.2. Contraintes relatives au stockage
Les produits, une fois évacués sur la route
principale, sont stockés à l'air libre dans des sacs de 35
à 40 kg. Ces sacs sont achetés à Dalifor ou Thiaroye par
les bana-banas à 125f le sac. Ils sont vendus localement aux
maraîchers à 150f l'unité (photo 29). Dans chaque village
entre Mouit, Mboumbaye, Ricotte, Dégou Niayes et Lahlar, plusieurs
dizaines de tonnes sont Photo 29 : Un parc de stockage d'oignons
à Mboumbaye Gandiol
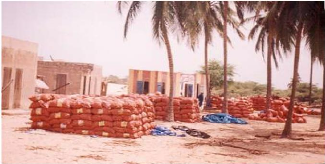
Cliché : P. D. Diop, juillet 2005
Après la récolte, les maraîchers stockent
leurs produits sur les lieux de dépôts qu'on trouve dans chaque
village producteur. C'est là qu'ils attendent les éventuels
clients (bana-banas).
stockées. Ces produits, se conservent difficilement et
ont du mal à concurrencer réellement la production
importée du reste des Niayes (Potou, Mboro et le Sud des Niayes dans les
régions de Dakar et Thiès), de la Vallée et des produits
importés des Pays-Bas.
85
Planche 5 : Les pistes de production entre les
villages et les parcelles maraîchères
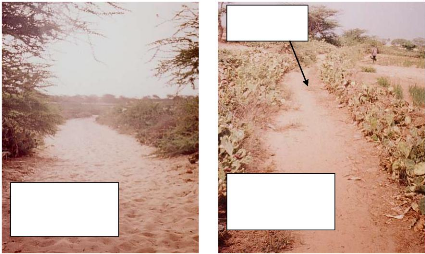
Piste qui rallie le village de Lahlar aux champs maraîchers
situés à l'Est
Piste de 50 à 60 cm de large
Des deux côtés de cette piste se trouvent des
parcelles d'oignon (Mboumbaye)
Photos 25-26 : Dans le Gandiolais,
les champs maraîchers sont accessibles par des pistes sablonneuses,
étroites et tortueuses. Ces pistes, impraticables pour les
véhicules lourds en raison de leur largeur d'environ 3 mètres
maximum, sont empruntées uniquement par les piétons ou les
charrettes.
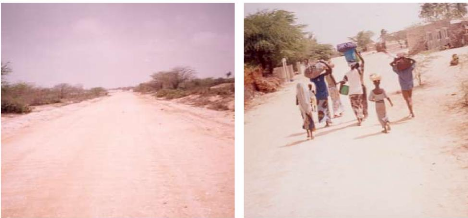
Photos 27 : Cette piste constitue
l'unique voie Photo 28 : Les femmes de tout
âge jouent un
principale qui rallie le Tassinère à
l'extrême pôle important dans le transport des produits entre
Sud du Gandiolais (Lahlar). En hivernage, elle les champs et les
villages maraîchers. A défaut des la
est presque impraticable. charrettes, c'est toute famille qui se
mobilise (photo
prise à Dégou Niayes).
Clichés : P. D. Diop, juillet 2005
86
L'organisation humanitaire CARITAS, qui a très vite
compris qu'il manquait à un grand nombre d'agriculteurs du Gandiolais et
de Toubé une formation idoine aux techniques de conservation des
produits agricoles, a tourné une bonne partie de ses interventions vers
la lutte contre le pourrissement des oignons. En effet, elle est
financièrement intervenue dans la zone, durant les années 1987,
en construisant des hangars de séchage. L'objectif était
d'améliorer les conditions de stockage et d'en étaler la vente,
en sorte d'éliminer le risque de saturation du marché et
d'effondrement des prix (Bonnardel R., 1992 : 202). Dès les
premières années qui ont suivi les constructions, grâce aux
séchoirs, le pourrissement rapide des bulbes, connu jusque là, a
pu être évité et les maraîchers ont plus ou moins pu
maîtriser le pourrissement. Malheureusement, faute d'un entretien et
d'une politique de suivis sur les constructions, la quasi-totalité des
séchoirs, « aux parois à claires-voies, où
l'aération est bien assurée » (ibidem) bâtis en dur,
se sont avec le temps dégradés. Ces hangars sont aujourd'hui
devenus des lieux de refuge du bétail ou utilisés pour d'autres
objectifs. Certains sont transformés en boutique (photo 30) ou en
dancing (photo 31) et d'autres se sont à moitié démolis
(photos 32-33). Ils sont visibles le long de l'axe Ndiébène
Gandiol - Tassinère au bord de la route qui dessert le Gandiol. Depuis
1987, date de la construction de ces hangars, le Gandiolais ne
bénéficie d'aucun autre soutien favorable à la
conservation de produits maraîchers. Il est aujourd'hui confronté
à ce problème de conservation et de pourrissement qui devient de
plus en plus aigu. Avec l'ouverture prochaine de l'agropôle de Fass, la
population maraîchère du Gandiolais pourrait trouver un moyen plus
durable pour la conservation, voire l'écoulement des produits
maraîchers.
L'agropôle est situé à quelques
kilomètres de Fass, un village de la communauté rurale de Mpal.
Le site est à moins de 500 mètres au Nord de la route nationale
n° 240. Il est le fruit d'une coopération entre l'Etat
du Sénégal et le Royaume Espagnol. L'agropôle couvre une
superficie de 40 ha41. Il est composé d'un centre agricole et
d'un abattoir moderne.
Le centre agricole abrite une salle équipée de
machines qui servent au conditionnement des fruits et légumes et des
chambres froides pour la conservation de ces produits agricoles. Les produits
qui seront conditionnés dans le centre agricole sont l'oignon, les
tubercules (la pomme de terre et la patate douce), la tomate, les haricots
verts et les fruits (pastèque, melon, mangue).
40 Voir le mémoire de Ndèye Souna
Dièye (en cours de rédaction) sur l'agropôle : une
industrie agroalimentaire décentralisée de la zone des Niayes ou
stratégie de développement de production agricole (le
maraîchage). Analyse de la dynamique d'insertion de l'agropôle dans
un espace d'accueil.
41 Sur les 40 ha que couvre l'espace octroyé
à l'agropôle de Fass, 20 ha seulement sont pour le moment
exploités.
87
Planche 6 : L'état actuel des
séchoirs construits à Gandiol en 1987 par la CARITAS
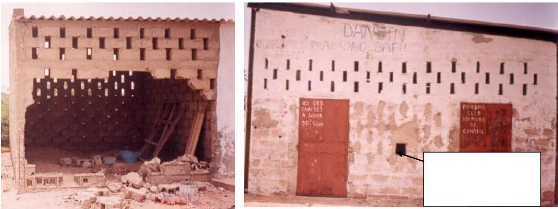
Ce vide sert à vendre, à partir de
l'intérieur du « dancing », des tickets d'entrée.
Photos 32 et 31 : À
Tassinère, les deux séchoirs d'oignons qui ont été
construits par la CARITAS en 1987 ont vu leurs objectifs orientés pour
d'autres fins. L'un est complètement démoli, alors que l'autre
est devenu un « dancing » pour les jeunes. Ces photos sont prises
à l'entrée de Tassinère de part et d'autre de la route
goudronnée.
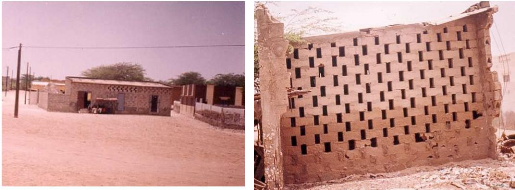
Photos 30 et 33 : Ces séchoirs,
construits également pour la conservation de l'oignon par la CARITAS
à Ndiébène Gandiol, n'ont bénéficié
d'une bonne politique de suivi. Le séchoir de la photo 30 est
transformé en une boutique par un habitant du village. Sur la photo
numéro 33, les trois quarts du séchoir se sont démolis
à cause du sel sur le sol, faute d'entretien.
Clichés : P. D. Diop, juillet 2005.
88
La chambre froide permettra de conserver les produits pour des
durées qui peuvent varier de 7 jours à 3 ans (par exemple
l'oignon peut être conservé pendant 3 ans). Les produits de
l'agropôle seront destinés à ravitailler les marchés
locaux et l'exportation. Le stockage des produits de l'agriculture et de
l'élevage, la présentation de produits de très bonne
qualité sur les marchés internationaux et la
compétitivité sont des objectifs assignés à
l'agropôle. Quant à l'élevage, il bénéficie
d'un abattoir moderne, un enclos avec des abreuvoirs et d'une salle de
congélation. L'abattoir dispose d'une station d'épuration et une
station d'incinération.
La station d'épuration permettra de
récupérer et de traiter les eaux usées, qui pourront
servir à des usages agricoles. L'eau sera dégraissée puis
décantée. Les particules seront transformées en produits
fertilisant, l'eau décantée servira à l'irrigation des
plantes. Le sang sera récupéré et pourra être
transformé sous forme d'aliments pour la volaille ou sous forme
d'engrais pour fertiliser les sols. La création de l'agropôle,
destinée à faciliter la conservation et l'écoulement des
produits locaux doit permettre au Gandiolais et à l'ensemble du Delta et
de Niayes de pouvoir produire, conditionner et commercialiser plus
facilement.
2.2. Contraintes relatives à la
commercialisation
Dans l'ensemble des villages du secteur de Gandiol, la
production d'oignon est entièrement mise en vente. Malgré la
valeur des produits, le Gandiolais souffre toujours de l'absence d'un
système de commercialisation efficace. La vente se fait le plus souvent
localement et de manière informelle.
Photo 34 : L'unique route qui rallie Gandiol à la
ville de Saint Louis et du reste du pays
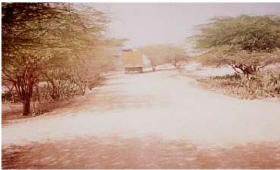
Cliché : P. D. Diop, juillet 2005
Les Bana-banas (marchants ambulants) sont les seuls
partenaires commerciaux des maraîchers du Gandiolais. Ce sont eux qui
affrètent les camions et viennent acheter les produits. A défaut,
les maraîchers s'associent en petits groupes de trois ou quatre personnes
pour pouvoir transporter par camion leur produit jusqu'au marché
urbain.
89
Aucune structure publique ou privée n'intervient dans
l'aval de la filière. Dans la majorité des cas, les producteurs
commercialisent eux-mêmes l'oignon jusqu'à Dakar ou à
Kaolack. Des camions sont affrétés individuellement ou par de
petits groupes de paysans (photo 34). Le producteur ou le représentant
du groupe accompagne le chargement. Arrivé à destination
(Thiaroye, Dalifort à Dakar), la marchandise est confié à
un coxeur qui joue le rôle de coutier et se charge de trouver un acheteur
et de négocier le prix. Pour chaque sac vendu, le coxeur gagne 500f,
quel que soit le prix de vente. En pleine période de récolte
(mars avril jusqu'à fin mai), le prix du gros42 se maintient
dans la fourchette de 80 à 150 francs/kg dans la zone de production
(vente locale) et jusqu'à 200 francs/kg dans les marchés de
consommation (Dakar, Kaolack). La fixation des prix prend en
considération, outre la distance de transport, la qualité des
infrastructures (pistes, routes), le contrôle routier
(municipalités, police) et la nature de la culture. Les
maraîchers, malgré l'indispensable travail que réalisent
les bana-banas dans le processus de commercialisation, dont la
circulation de l'information sur les prix, sur l'existence de stock, sur des
acheteurs potentiels, passent parfois des moments difficiles avec eux. Les
bana-banas ont une part relativement importante dans la
commercialisation et la mise en vente des produits sur le territoire. Ils
peuvent proposer aux maraîchers d'acheter le produit à 150 f/kg au
maximum (150.000f francs la tonne), mais sur les marchés de
consommations, ils réussissent à écouler la marchandise
à 200f/kg au minimum, soit 200.000 francs la tonne.
Le principal problème du maraîcher Gandiolais est
celui des débouchés, surtout pour l'oignon qui constitue le gros
de la production. La zone est desservie par une seule route goudronnée
qui permet, à partir de l'actuel hôtel Mame Coumba Bang,
d'accéder au réseau routier national. Même si des travaux
de réfection ont été effectués en 2004, cette voie
n'est pas valorisée par des routes secondaires qui
désenclaveraient les villages producteurs.
Economiquement, les maraîchers du Gandiolais ne tirent
pas beaucoup de la vente de leurs produits dans les marchés de la
capitale régionale. La vente en ville n'est que l'affaire des femmes. En
raison de l'absence d'une bonne structuration, les produits également
abondants qui viennent du village de Bango et du quartier de Khor, sont
aisément écoulés sur le marché, contrairement
à ceux du Gandiolais.
Ceci est imputable au système informel de vente
qu'adoptent les femmes, malgré l'importance et la variété
des produits vivriers qu'elles fournissent aux citadins. D'après elles,
le principal problème rencontré sur le marché Saint
Louisien, c'est la fluctuation des prix.
42 Le prix au kilogramme pour la vente en gros.
90
Conclusion de la deuxième partie
Le secteur agricole du Gandiolais bénéficie
d'une large disponibilité de terres de culture. Mais l'accès et
la mise en valeur à ces terres reste un handicape pour la multiplication
des parcelles cultivables. L'obtention et la mise en valeur d'une parcelle ne
justifient pas une bonne campagne agricole. Le producteur du Gandiolais est un
paysan pauvre qui n'a que la terre comme source de revenus. Par
conséquent, il lui fait subir une forte pression pour augmenter sa
production agricole et en même temps accroître ses rendements.
Ainsi, différentes techniques de gestion des terres sont
utilisées. Cette population n'a qu'un seul souci : comment faire pour
produire chaque année un peu plus ? De ce fait, les méthodes de
gestion adoptées favorisent, à long terme, la dégradation
des sols et fragilisent la qualité des produits locaux. Les contraintes
liées aux réalités socio-économiques du milieu s'y
ajoutant, les stratégies adoptées et les orientations possibles
feront l'objet d'une analyse dans la troisième partie. A partir des
principales contraintes auxquelles sont confrontées les exploitants,
ainsi que des possibilités d'amélioration, on tentera de proposer
aux exploitants d'autres stratégies.
91
Troisième partie
*******
Quelles perspectives pour
l'agriculture du Gandiolais ?
92
CHAPITRE I
Stratégies à adopter pour atténuer
les problèmes de l'agriculture du Gandiolais
1. Le canal du Gandiolais, pour une nouvelle dynamique
agricole Dans l'optique d'optimiser les nouvelles opportunités offertes
par la remise en eau de la vallée de Ndialakhar, de nouveaux projets de
développement agricole et pastoral sont en attente. Il s'agira dans ce
chapitre de décrire le canal et les perspectives qu'il dessine.
1.1. L'alimentation du Gandiolais en eau agricole, via le
canal
L'approvisionnement en eau agricole a toujours
été un besoin crucial dans la zone du Gandiolais. Sur cette bande
de terre, depuis plusieurs générations, la question de l'eau est
restée un problème épineux. La construction du canal
permettra sans doute d'y apporter une solution. Le projet ne date pas
d'aujourd'hui. Il y a 13 ans, l'Association pour le Développement du
Gandiolais et Toubé (A.D.G.T.)43 avait initié des
études pour promouvoir la résolution de la lancinante question de
l'eau dans la contrée44. Plusieurs organismes tels que le
ministère de l'hydraulique et des O.N.G. ont été mis
à contribution. Ainsi, plusieurs perspectives ont été
dégagées dans le but d'alimenter la zone du Gandiolais en eau
agricole. Ce n'est que durant les années 2000 que l'Etat décide
de prendre en charge la réalisation de l'ouvrage d'une longueur
d'environ 8,5 km (cf. planche n°7), confié à l'Agence de
Promotion du Réseau Hydrographique National (A.P.R.H.N.) et à la
SAED, qui se chargent respectivement de la construction du canal et de
l'aménagement de la vallée de Ndialakhar.
Parmi ces perspectives dégagées, trois variantes
avaient été identifiées (DIOP D., 1998 : 50-51).
- La première variante serait passée par
l'alimentation du Ndiael qui serait relié au lac de Guiers par des
canaux et au système des trois marigots. Avec toutes les contraintes que
comporte l'alimentation du Ndiael (nature du substrat, importance de
l'évaporation) afin de transférer l'eau vers le Gandiolais, cette
variante n'a pas été retenue.
43 L'Association pour le Développement du
Gandiolais et de Toubé représente l'association la plus
importante de la zone. Elle compte aujourd'hui plus de 6.000 membres et
regroupe l'ensemble des villages du Gandiolais et de Toubé.
44 Entretiens avec quelques responsables et membres
fondateurs de l'A.D.G.T. à Ndiébène Gandiol (Gounge, 19
mars 2004), à Ngaye Ngaye, Ndiakhère, Gandon .
93
Planche 7 : La réalisation du canal du
Gandiolais pour une nouvelle dynamique agricole
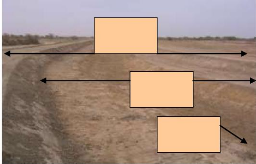
Largeur en gueule 20m
Largeur au miroir 12m
Largeur au plafond 4m
Photo 35 : à 2 km au Sud de la
route nationale 2, la mise en eau de ce canal de 20m de large sur plus de 8km
de long permettra de revitaliser les vallées mortes du Gandiolais et de
relancer l'activité agricole et pastorale de la zone.

Le Ngalam
Ouvrage de prise
Photos 36 et 37 : à plus de 8km de
la route nationale 2, le Ngalam, défluent du fleuve
Sénégal, est la source d'alimentation du canal. L'ouvrage de
prise en eau, déjà construit donne une idée sur la
prochaine ouverture du canal.
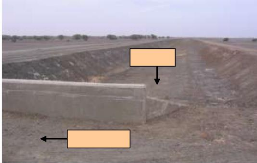
Passerelle
Canal
Photo 38 : à 2km au Sud de la
route nationale 2, quelques passerelles distantes de 2km sont construites sur
le canal pour permettre aux piétons et troupeaux de traverser le
canal.
Clichés : G. Magrin, avril 2005
94
- La seconde variante devait passée par l'alimentation
de la cuvette de Gueumbeul à partir du fleuve Sénégal.
Cette cuvette serait réhabilitée avec l'installation d'un ouvrage
de tête sur le fleuve à la bifurcation des chenaux de
remontée de la mer ou de la crue. Les risques liés à la
probable disparition de l'écosystème de mangrove, à la
pollution et à la complexité de l'ouvrage, ont fait
également exclure cette option.
- La troisième variante, celle qui a été
retenue, est l'alimentation du Ngalam par un canal de jonction entre ce cours
d'eau permanant et les anciens axes hydrauliques de la zone, à
réhabiliter. Bien que cette option comporte des risques existants, elle
présente cependant moins de complications que les
précédents. Ainsi, cette solution peut être
envisagée à trois niveaux (cf. carte n°8).
Carte n°8 : Les différentes zones humides
dans le Delta du Sénégal
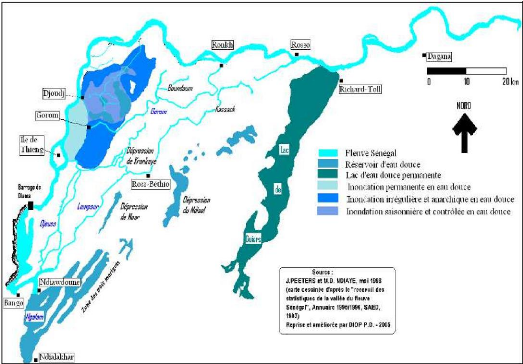
- dans le court terme, une partie de l'écoulement du
Ngalam en aval de Ndiawdoune sera déviée à partir de
Ndialakhar vers la zone en question (voir Bâ H., 2005 : 43). Toutefois,
l'écoulement ne pourra se faire que temporairement, pendant la
période de crue ;
- dans le moyen terme, il s'agira de renforcer l'alimentation
de l'axe Gorom-Lampsar par un canal à partir du réservoir de
Diama ;
95
- dans le long terme, l'écoulement pourra se faire de
manière pérenne, mais il devra être lié à la
mise en place effective du schéma hydraulique générale du
Delta.
Compte tenu de l'urgence du problème de l'eau dans le
Gandiolais, ces différents scénarios pourront être
envisagés graduellement en vue de solutionner ce problème.
1.2. Localisation et aire d'influence du canal
1.2.1. Le site d'accueil du canal
La zone du projet de la remise en eau de la vallée de
Ndialakhar est située sur la rive gauche du fleuve
Sénégal, au Sud des dépressions des trois marigots, de la
vallée de Ndialakhar jusqu'à la dépression du Gandiolais.
S'agissant de l'emplacement proprement dit de ce canal, il est localisé
un peu avant la grande boucle de Rao en venant de Saint Louis (cf. carte 9).
C'est le bief amont. Pour ce qui est du bief aval, il s'étend de la
dépression de Rao Peul, exutoire du bief amont jusque dans le Gandiolais
par l'intermédiaire des voies d'eau naturelles plus ou moins
discontinues.
Le bief amont comprend deux sous parties (Diop D., 1998 : 52)
:
- la première va des rives du Ngalam sur une distance
de 2km. Ici, s'identifie un plateau sur lequel aucune voie d'eau n'est
nettement matérialisée. Ainsi, on peut dire que ce plateau joue
le rôle de ligne de partage des eaux entre le Ngalam et le Gandiolais.
- A la limite de ce plateau et sur un peu plus de 6km, la
seconde partie se matérialise par une série de dépressions
plus ou moins continues jusqu'à la route nationale 2. De là, au
Sud de la route nationale 2, la vallée prend sa forme plus
encaissée.
Avec la réalisation de ce canal de Gandiolais, de
nouvelles perspectives agricoles se dessinent pour la population locale. Parmi
les attentes liées à ce canal il y a la revitalisation des
vallées mortes : bassin de Rao Peul, vallée de Ndialakhar,
vallée du Gandiolais l'introduction de nouvelles techniques de
productions agricoles avec comme objectif principal accroître la
production agricole en l'intensifiant et enfin le renforcement de la couverture
végétale pour la stabilisation des dunes.
96
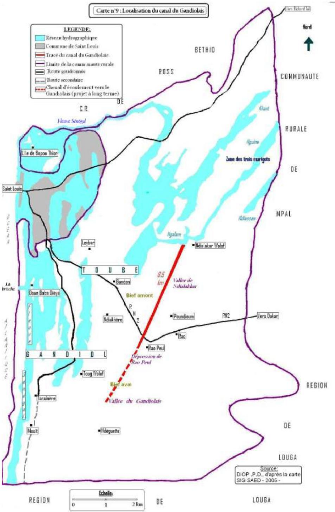
97
1.2.2. L'aire d'influence du Canal
Schématiquement, le canal prend sa source dans le
Ngalam sur une longueur d'environ 8,5km, traverse la vallée de
Ndialakhar, passe sous la route nationale 2 avant de déboucher sur le
bassin de Rao Peul. Il s'ouvre enfin sur la zone du Gandiolais pour ennoyer un
bassin qui collectera aussi les eaux de ruissellement. De ce bassin, l'eau va
couler par gravitation dans un chenal qui traverse toute la vallée du
Gandiolais (figure 9). L'eau ainsi versée dans le bassin naturel y
demeure pendant plusieurs mois avant de s'infiltrer et/ou de
s'évaporer.
Un important chenal naturel devra ensuite permettre
d'évacuer cette eau vers le Gandiolais, dans le but de permettre aux
populations de la localité d'être suffisamment ravitaillée
en eau douce. La recharge des nappes et la désalinisation
subséquente sont fortement recherchées par le canal, qui envisage
de contribuer au développement socio-économique de la zone. Le
canal du Gandiolais, qui devra alimenter la vallée de Ndialakhar, le
bassin de Rao Peul et la vallée du Gandiolais, constitue aujourd'hui un
espoir patent pour une nouvelle dynamique socio-économique de la
communauté rurale. Il permettra à la SAED d'engager des travaux
d'aménagement dans la communauté rurale de Gandon. Cette zone,
depuis plusieurs décennies, est victime d'une dégradation
combinée des ressources naturelles (eau, sol et
végétation) par les contraintes climatiques et la progression
persistante de la salinisation.
1.3. Le canal et le développement du secteur
agricole
Le canal ne se fera pas sans des impacts sur son site
d'accueil et sur son environnement proche (voir Tropica, 2001 : 19-22).
Quelques uns d'entre eux méritent une attention particulière.
1.3.1. Les impacts positifs
La zone du canal est caractérisée par une
évolution du régime hydrologique vers une réduction des
apports des crues du fleuve Sénégal du fait des barrages et d'une
salinisation des aquifères et du sol. Ce projet qui consiste à
remettre en eau la vallée du Gandiolais permettra ainsi « le
déversement de 25 millions de m3 d'eau pendant la
période d'hivernage où la crue favorise un surplus d'eau »
(TROPICA, 2001 : 2). La remise en eau de la vallée du Gandiolais doit
offrir les conditions de développement de la zone à travers des
facilités d'accès à l'eau douce, à des terres plus
aptes à l'agriculture et l'élevage. La faune aviaire retrouvera
de vastes étendues d'eau douce et une ressource de nourriture.
Figure n°9 : Représentation
schématique du dispositif de la remise en eau de la vallée du
Gandiolais
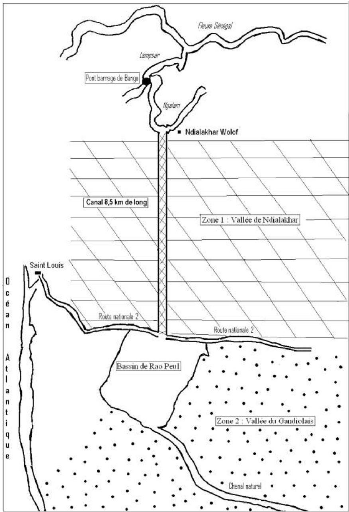
Source : Document du projet - Diop P. D.- 2005
98
99
Ainsi, le Gandiolais pourra servir de base de repli aux
oiseaux durant les périodes d'assèchement et de nettoyage des
plans d'eau du parc de Djoudj. En effet, l'apport d'eau du canal favorisera la
désalinisation des sols et des nappes qui seront rechargées, donc
plus facilement utilisables pour des usages agricoles. Avec l'alimentation du
canal, les nappes de la vallée du Gandiolais seront
réalimentées et adoucies, le biseau salé abaissé et
les régimes hydriques naturels reconstituées (TROPICA, 2001 :
29).
1.3.2. Les impacts négatifs
Le développement de l'agriculture axé sur le
maraîchage va engendrer des maladies hydriques dues aux pollutions et aux
intoxications des eaux par les pesticides et les engrais. La forte demande en
terre pour l'agriculture va stimuler la spéculation foncière et
la restriction des terres disponibles, ainsi que les conflits
d'intérêt entre éleveurs et agriculteurs.
Le reboisement des abords du canal, pour éviter
l'ensablement de l'ouvrage à ciel ouvert, pourra provoquer la baisse de
la nappe si le choix des espèces végétales se porte sur
les phréatophytes (des espèces dont l'évolution exige
beaucoup d'eau) comme le palétuvier ou l'eucalyptus. Au niveau de la
vallée du Gandiolais, le développement agricole risque
d'engendrer des problèmes liés à la pollution par les
résidus d'intrants agricoles, avec une eutrophisation comme
conséquence finale. Les activités agricoles induites par la
remise en eau de la vallée se feront avec une forte utilisation de
produits phytosanitaires et d'engrais chimiques qui risquent de provoquer la
contamination et/ou la salinité des sols. Enfin, la présomption
que les terres dans la partie qui sera traversée par le canal seront
mises en valeur va stimuler des attitudes d'appropriation qui pourraient
générer des conflits autour du foncier, d'où l'importance
de revoir les décisions qui ont été arrêtées
avec l'élaboration d'un Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols
(POAS).
100
2. Le POAS pour un rapprochement entre l'agriculture
et les autres activités
Pour amoindrir les difficultés liées à la
question foncière et à la cohabitation entre l'agriculture et
l'élevage, la communauté rurale de Gandon a décidé
de mettre en place un Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols (POAS) pour
une gestion durable et équitable des ressources foncières. En
conséquence, pour le respect des règles définies par le
POAS, certaines mesures doivent être prises en compte.
2.1. Définition et objectif du POAS
2.1.1. Définition
Le POAS est « considéré comme un cadre
directeur guidant les gestionnaires locaux pour l'analyse, la planification et
la réalisation de l'aménagement et du développement
à l'échelle locale. C'est en même temps un outil de
dialogue, entre les populations et les institutions, qui peut ainsi enrichir la
conduite de toute opération d'aménagement et de
développement en regards des contraintes de l'occupation de l'espace ou
de leurs répercussions sur celle-ci ». (D'Aquino et al., 2001 :
204). En d'autres termes, le POAS est un outil qui permet aux
communautés rurales de mieux maîtriser leurs terres. Le POAS
permet de définir différents types de zones à vocation
multiple par l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de
gestion des terres.
2.1.2. Objectifs du POAS
La communauté rurale de Gandon a toujours
été une zone agro-pastorale. C'est avec l'effet persistant de la
salinité sur les terres de culture et les sols que les agriculteurs
maraîchers, en avançant du littoral vers les dunes, ont
occupé les parcours pastoraux. C'est ainsi que l'élevage a du mal
à retrouver ses anciennes zones de parcours. En essayant de maintenir
leur activité sur les anciennes zones, aujourd'hui occupées par
l'agriculture, les éleveurs se heurtent souvent aux paysans. Pour
dénouer ce problème, des conventions s'imposent pour une
cohabitation harmonieuse C'est dans cette perspective que s'inscrit le POAS de
la communauté rurale de Gandon.
Les objectifs visés par le POAS sont multiples. Il s'agit
:
- d'installer au niveau des collectivités locales un
pôle de négociation avec les partenaires, de
101
concertation avec les populations et de compétences
pour la gestion collective des ressources locales ;
- de définir des règles
collectives concernant la gestion de l'eau et des terres, reconnues et
soutenues par tous les acteurs institutionnels et étatiques ;
- enfin le POAS cherche à mettre
progressivement en place une planification décentralisée du
développement local, par les collectivités locales et en
concertation avec le développement et la recherche (D'Aquino et al.,
2001 : 204).
D'une manière générale, les résultats
attendus sont de trois ordres :
« - des règles consensuelles pour la gestion de
l'espace et des ressources ;
- une organisation pour le suivi et le contrôle de
l'application des règles ;
- des supports cartographiques appuyant et concrétisant
les deux autres éléments » (ibidem).
2.2. Dispositif d'application pour la réussite du
P.O.A.S.
Le Plan d'Occupation et d'Affectation des Sols de la
communauté rurale de Gandon, dans sa première phase
d'élaboration par la SAED et le conseil rural avec la participation
effective des différentes couches sociales, a identifié et
défini quatre zones d'occupation des sols.
? La zone agro-pastorale à priorité agricole (ZAPA)
? La zone agro-pastorale à priorité élevage (ZAPE) ? La
zone pastorale (Z.P.)
? La zone d'habitation (Z.H.)
Compte tenu des préoccupations des différentes
couches de la société (élevage, agriculture, habitation),
le POAS, le conseil rural et la population locale ont réussi à
mettre en place ce zonage défini comme suit :
Dans la ZAPA, le déplacement du bétail est
interdit pendant toute l'année en dehors des pistes qui lui ont
été réservées. Toute divagation sera punie sur la
base d'une estimation des dégâts qui seront remboursés et
d'une pénalité pour manquements aux règles du POAS.
Toutefois, le parcours du bétail est toléré en toute
saison dans tout l'espace non cultivé. Par conséquent,
l'éleveur est entièrement responsable des préjudices que
son troupeau pourrait causer aux champs et à proximité.
Dans la ZAPE, pendant toute l'année et dans toute la
zone, le parcours du bétail est autorisé. Cependant, la pratique
agricole est tolérée à condition que les champs soient
regroupés par village ou par groupe de villages, selon un schéma
arrêté par les chefs de
102
villages concernés. Ce regroupement des champs se fera
en concertation avec les désignés des éleveurs. Toute
divagation commise sur les champs situés sur le site retenu est
systématiquement punie sur la base d'une estimation des
dégâts qui seront remboursés en cas d'un probable
échec de l'arrangement à l'amiable.
La Z.P. est exclusivement réservée au
bétail pour toute l'année. Toute sorte de pratique susceptible
d'entraver l'exercice de ce droit est interdite et passible d'une
pénalité pour manquement aux règles du POAS. La pratique
de l'agriculture est strictement interdite dans cette zone, sous peine
d'amende.
La Z.H. quant à elle est constituée par les
sites actuels des villages et hameaux qui leurs sont rattachés et des
zones d'extension définies par le POAS ou sur les plans de lotissement
validés par celui-ci. Les zones d'habitation sont prioritairement
destinées à l'occupation humaine pour l'habitat et les
infrastructures villageoises. Toute forme d'occupation susceptible de
gêner cet usage est strictement interdite. En effet, l'installation sur
une Z.H. est soumise au préalable à une autorisation du conseil
rural ou d'une autorité dûment mandaté par ce dernier (C.R
.Gandon, 2004 : 4-5).
D'autres points ont été retenus par le POAS. Il
s'agit, entre autres, d'un certain nombre de points d'eau officiellement
reconnu comme points d'abreuvement du bétail et d'un certains nombre de
couloirs officiels d'accès du bétail aux points d'eau pastoraux.
Le POAS autorise également l'accès du bétail aux parcours
post-culturaux. De ce fait le conseil rural devra dresser une liste de champs
destinés à la vaine pâture45. Le POAS a
également arrêté une liste de pistes de production pour
l'accès aux villages, champs et points d'eau. Il est retenu dans le POAS
que le conseil rural, conformément à la loi 64-46 de
l'année 1964, devra veiller au suivi rigoureux des
désaffectations foncières pour s'assurer de la mise en valeur
effective et dans les délais requis par la loi, et d'un respect de la
superficie et de la zone effectivement affectée.
Une telle décision ne se fera pas sans
difficultés. Les populations de la communauté rurale de Gandon
ont toujours considéré que les terres héritées de
leurs grands-parents ne peuvent en aucun cas revenir de droit à la
commission domaniale. C'est ainsi que lors des séances de travail tenues
dans les locaux de la maison communautaire entre le conseil rural, la SAED et
la population locale, pour l'élaboration du POAS, cette dernière
s'en est prise à plusieurs prises à la commission domaniale,
refusant toute possibilité de désaffectation. De même les
éleveurs avaient mal vu la réduction des parcours pastoraux,
classés comme ZAPA
45 Vaine pâture : droit de faire paître
son bétail sur des terrains non clos dont on n'est pas
propriétaire, après la récolte.
103
au profit des agriculteurs. Ainsi, pour que le POAS remplisse
sa mission, il lui faut un dispositif garantissant l'application de ses
règles de gestion de l'espace. C'est à ce titre que le conseil
rural de Gandon privilégie le dialogue pour une meilleure
compréhension des objectifs du POAS. Ainsi, les actions à
entreprendre mettent l'accent sur :
- la sensibilisation : il s'agit de renforcer le dispositif de
communication pour toucher le maximum de personnes. Le POAS ne pourra occuper
sa place que lorsque la population aura un niveau d'information sur son
utilité. Par conséquent, les personnes influentes qui prennent
part aux rencontres décisionnelles, doivent rendre compte à leur
population respective des décisions issues de ces rencontres et de leurs
importances. Les structures locales de développement, la
communauté rurale et les organisations comme Plan Sénégal,
devront tenir des séances d'information et de sensibilisation sur le
POAS, à l'occasion des événements socioculturels
organisés dans les villages et des grandes fêtes de retrouvaille
(tabaski, maouloud).
- l'appropriation du plan : une bonne compréhension du
POAS peut aboutir à une adhésion définitive de la
population. Elle est également indispensable pour le suivi et la bonne
tenue de l'opération. Il faut également insister sur la position
de chaque acteur et le rôle que chacun doit jouer pour situer les
responsabilités et mieux garantir la pérennité du
processus.
En plus, toute prise de décision et tout projet de
développement intervenant dans la communauté rurale doivent
être orienté par le POAS ; par exemple le P.L.D. de la
communauté rurale de Gandon, rédigé en 2001 par le Plan
Sénégal et repris en 2002, devrait être
révisé et y intégrer les données du POAS pour une
meilleure spatialisation de la zone.
- la formation des acteurs à l'analyse de la
cartographie : les différents acteurs devrait être en mesure de
lire et d'interpréter les cartes afin de pouvoir faire appliquer les
recommandations du POAS.
Pour amoindrir les litiges fonciers qui risquent de devenir
plus fréquents avec la mise en valeur de la vallée du Gandiolais
et du Toubé, la bonne gouvernance s'impose comme un préalable
avant toute autre décision. Dans ce cas, les responsables locaux doivent
être beaucoup plus conscients des pouvoirs qui leurs sont
assignés. Le faible niveau d'étude des conseillers ruraux
constitue une entrave, car l'instruction joue un rôle majeur sur les
compétences des collectivités locales.
Les populations devraient également être
associées aux prises de décision relatives aux affectations des
sols. En organisant des séances de concertation avec les populations
locales, les conseillers ruraux seraient en mesure d'anticiper sur les
conflits, en prévoyant la résolution d'éventuels litiges
fonciers.
104
CHAPITRE II
Quelques orientations possibles pour un meilleur
développement agricole durable
Les quelques orientations qui suivent ont trait aux moyens
d'accroître ou de rendre plus accessibles les possibilités de
satisfaction des besoins du producteur. A partir de quelques
éléments principaux, on tentera de dégager un certain
nombre d'orientations qui pourraient permettre aux exploitants de la
communauté rurale de Gandon, notamment ceux du Gandiolais et du
Toubé, de surmonter les contraintes évoquées ci-dessus.
1. Actions à mener pour la relance du secteur
agricole dans le Gandiolais
À la suite de l'analyse des différents
problèmes de l'agriculture, des perspectives attendues dans «
l'après-canal » et de règles définies par le POAS,
quelques orientations peuvent être retenues pour le développement
de l'agriculture dans le Gandiolais.
1.1. Promouvoir la redynamisation du secteur agricole
L'accès aux facteurs de productions tels que la terre,
les intrants, le matériel agricole pose un problème au niveau de
la communauté rurale de Gandon. Cette situation constitue un facteur de
blocage pour l'évolution du secteur agricole dans la zone. Une nouvelle
dynamique agricole dans la communauté rurale notamment dans le
Gandiolais et le Toubé, nécessite l'amélioration de la
tenure foncière, la redynamisation des structures villageoises et
l'allégement des conditions d'accès aux crédits financiers
et aux intrants.
1.1.1. Améliorer les conditions d'accès
au foncier
La loi 64-46 du 17 juin 1964 stipule en son article premier
que « toutes les terres non classées dans le domaine public, non
immatriculées et dont la propriété n'a pas
été transcrite à la conservation des hypothèses
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
constituent de plein droit le domaine national ». Au niveau de la
communauté rurale, les terres du terroir sont exploitées pour
l'habitat rural, l'agriculture, l'élevage, ... Ces terres sont pour le
domaine national, inaliénables et sont exclues de toute vente. Mais
cette loi est très limitée dans son application. Une meilleure
connaissance de la disponibilité des terres, de leur répartition
et de
105
leurs caractéristiques s'avère plus que
nécessaire pour une utilisation judicieuse des sols. Par
conséquent, le conseil rural devait renforcer sa collaboration avec les
services techniques (comme l'ANCAR et le PLAN) par l'organisation des
séminaires pour la formation des conseillers ruraux, notamment ceux de
la commission domaniale et pour la mise sur pied d'une base de données
consistantes, qui pourra faciliter l'application adéquate et
systématique des règles définies par le POAS. Le conseil
rural pourrait également initier ou encourager des rencontres de
sensibilisation entre la communauté rurale, les paysans et les
partenaires privilégiés pour faire comprendre aux conseillers,
aux paysans et aux populations en général, les textes et
principes de la loi sur le domaine national. Il sera tenu en même temps
d'encourager les paysans pour qu'ils se sentent en sécurité dans
leur exploitation en vu d'une meilleure protection des sols. Ces derniers
doivent aussi reconnaître la primauté du conseil rural dans la
gestion des terres.
1.1.2. Redynamiser les structures villageoises
On assiste de plus en plus à une prolifération
d'organisations villageoises à caractère coopératif et/ou
associatif. Ces structures, animées par une réelle dynamique
d'organisation, méritent d'être motivées. Le recours au
crédit permettrait aux producteurs, dans l'incapacité de financer
leur investissement, d'accéder à des moyens de production qui
augmenteraient la productivité de leur travail. En vue d'apaiser les
difficultés relatives à l'accès au crédit, les
paysans doivent asseoir une gestion sociale de l'activité agricole en
s'associant pour faire de gros investissements et rendre en même temps le
mécanisme de production performant. Les paysans ne sont pas les seuls
acteurs de développement. La communauté rurale étant le
principal agent de développement de la zone, est astreinte à
mettre sur pied les mécanismes de base nécessaires pour asseoir,
accompagner et soutenir le développement et la croissance
économique. Il lui appartient également d'appuyer et d'encourager
les organismes de financement, en jouant le rôle de facilitateur entre
eux et les producteurs locaux, pour la mise en place des structures de
crédit agricole, la création d'institutions chargées de
faire le suivi de l'information scientifique véhiculée par les
partenaires au développement. Pour cela, l'important semble être
pour elle la promotion d'organisations locales efficaces et
représentatives, capables d'apporter des appuis adaptés aux
producteurs, de défendre leurs intérêts et d'exprimer une
demande sociale dans des cadres de concertations. Le raffermissement des
relations entre les différents mouvements associatifs des villages du
Gandiolais et du Toubé assurerait leur promotion économique et
sociale auprès des partenaires au développement en vue
d'éventuelles interventions des organismes de
106
financement dans la zone.
Les financements dont bénéficient les
populations de la communauté rurale de Gandon demandent un certain
nombre de conditions d'accès aux crédits. Cela suppose au
préalable l'obtention d'une reconnaissance juridique pour les G.I.E. et
les O.P. En outre, toute personne demandant un prêt doit remplir divers
formulaires (annexe 5), ce qui est une condition d'exclusion pour la
majorité des paysans de la zone.
L'ANCAR, dans les taches qui lui sont dévouées,
essaye de propulser l'agriculture par le biais de petits projets de
développement. Elle a joué un rôle important dans ce sens
en initiant les producteurs sur les techniques d'accès au financement.
Plusieurs structures, particulièrement les G.P.F., sont, grâce
à l'appui de l'ANCAR, en mesure de remplir une fiche de projet ou de
proposer un canevas pour un éventuel financement.
L'objectif recherché dans la redynamisation des O.C.B.
c'est d'ouvrir des possibilités d'auto-création d'emploi à
l'importante main-d'oeuvre sous-utilisée ou au chômage et de faire
revenir la population partie en exode rural. Tl s'agira également de
permettre aux plus défavorisés de s'intégrer dans des
structures où ils pourront trouver une capacité d'actions
grâce au soutien mutuel. Leur force permettra aussi de rompre
l'éternel cercle vicieux « faible revenu - faible épargne -
faible investissement », pour arriver à entrer dans un cycle de
croissance. Enfin, une bonne structuration des O.P. aiderait les plus pauvres
à gagner leur autonomie, tant individuelle que collective.
Il faudrait, de la part de la communauté rurale, une
planification des actions prioritaires sur lesquelles ces organisations vont se
baser pour travailler et permettre aussi un développement harmonieux de
cette zone et une agriculture plus performante. La définition de ces
actions prioritaires doit émaner de la population locale et non
être parachutée par ces structures. Ceci permettrait
d'éviter des pertes de finances, d'énergie et de temps.
1.1.3. Possibilités de conditions
d'accès aux prêts
Les enquêtes menées sur le terrain ont
révélé que même si les systèmes de culture et
les techniques culturales sont uniformes dans tout le Gandiolais, il n'en est
pas de même pour les conditions de vie des populations. Par
conséquent, des innovations convenant à un exploitant peuvent ne
pas convenir à un autre. De ce fait, les organismes de financement
(comme la CARITAS, le PLAN Sénégal), dans le cadre de leurs
accords de partenariat, pourrait chercher à créer, en
collaboration avec les populations locales, une « banque de crédit
» qui ne demande aucune garantie et qui s'adresse exclusivement aux plus
pauvres de sa localité,
107
notamment la main-d'oeuvre infortunée et n'ayant
presque pas de terre. Le fonctionnement de cette banque pourrait être
basé sur quelques principes.
Tout d'abord, ceux qui veulent obtenir un crédit
doivent constituer un groupe partageant les mêmes préoccupations
et ayant les conditions similaires d'existence. Ces organismes doivent au
préalable faire subir une formation à quelques membres de chaque
groupe ; cette formation, portant sur les règles et les
procédures de fonctionnement de la banque, permettrait à cette
dernière de s'assurer de la bonne compréhension de chaque groupe
de son système de fonctionnement et de leur capacité à
lire et à écrire.
Du fait qu'il est actuellement impossible d'intervenir dans la
zone sans passer par la communauté rurale, cette dernière devrait
jouer le rôle de facilitateur. Ainsi, la banque estimant que c'est
à elle d'aller vers les gens et non l'inverse, privilégiera les
contacts directs et les visites de proximité sans intermédiaire,
mais avec le cautionnement du conseil rural. Cette banque demandera à
tous ses membres de faire une épargne au préalable. Par rapport
au mouvement de ce compte, la banque décidera sur le montant à
prêter aux membres de chaque groupe. Les bénéficiaires d'un
financement seraient libres de choisir le domaine dans lequel ils vont
s'investir (agriculture, élevage, pêche, artisanat, commerce),
pourvu qu'ils réussissent à rembourser à temps et à
épargner pour leur propre compte. En fonction de leurs connaissances et
de leur savoir-faire, suite à la formation préalable de quelques
uns de ses membres, le groupe devra ainsi décider des activités
qu'il va exercer pour s'assurer un revenu, même en cas de mauvais
résultats, et élaborer le plan d'utilisation du prêt de
chacun de ses membres. Cette technique permettra aux producteurs d'être
de plus en plus autonome et à long terme de pouvoir assurer leur propre
financement.
2. Les alternatives possibles pour le secteur
agricole
Cette analyse portera sur les choix envisageables pour
surmonter les contraintes identifiées dans la zone du Gandiolais et de
Toubé et qui constituent une entrave à l'évolution du
secteur agricole. De cette analyse, on parviendra à définir une
approche susceptible de lever les contraintes qui pèsent sur le secteur
agricole.
2.1. Alternatives paysannes
Dans la recherche de solutions susceptibles d'atténuer les
contraintes de développement,
les groupes bénéficiaires, c'est-à-dire
les acteurs, doivent être les premiers responsables des choix et de la
conduite des activités de développement. En effet, les acteurs
sont les mieux à même de définir leurs besoins et de
connaître les ressources dont ils disposent et d'identifier
108
les contraintes qu'ils rencontrent. Si l'on pense et agit pour
eux, ils ne se sentiront pas responsables et seront peu motivés pour
assurer le succès des actions qu'ils considèrent le plus souvent
comme leur étant imposées. Les paysans sont à la base de
l'exécution de toutes les activités de développement en
monde rural. Ils sont assez conscients des difficultés auxquelles ils
sont confrontés. Par conséquent, ils doivent être en mesure
d'exprimer leurs difficultés et de définir leur
priorité.
Néanmoins, ils jugent nécessaire l'intervention
de l'Etat dans certains volets. Ils sollicitent l'appui de l'Etat dans la
gestion des facteurs de production (intrants, matériels agricoles) et
dans la création de magasins pour le stockage de leur semence et
produits agricoles. Dans le Gandiolais, les maraîchers éprouvent
beaucoup de difficultés pour gérer les facteurs de production
d'une culture commerciale comme l'oignon. La gestion de cette
variété nécessite des moyens financiers suffisants et des
infrastructures adéquates. Ce qui n'est pas à la portée de
tous les paysans du Gandiolais où on note un déficit pointu
d'organisations paysannes. L'accès aux intrants agricoles est aussi un
problème de taille. Les maraîchers du Gandiolais ne
bénéficient d'aucune structure de financement en intrants. Pour
un soutien financier, ils se rapprochent des mutuelles de Mpal, Rao ou
Mboumbaye, dont ils jugent les conditions difficiles. De ce fait, ils
souhaiteraient que les conditions soient allégées au
bénéfice de tout le monde. Tout en cherchant à redynamiser
les sections villageoises surtout dans le volet financier, les maraîchers
sollicitent l'appuie de l'Etat dans le volet commercial afin qu'ils puissent
eux-mêmes régulariser leurs prix. Les prix aux producteurs, aux
ambulants et aux marchés de consommation sont nettement
différents. Les producteurs n'ont aucune information sur les
mécanismes de la promotion de leur production. Ils soulignent qu'ils
sont victimes d'une exploitation (sans précédent) par les
bana-banas. La révision des prix de cession des produits
agricoles locaux et des prix au producteur est aussi au centre des
préoccupations paysannes. Le prix de cession des produits d'oignon est
de 200f/kg soit 8.000f le sac de 40kg et 200.000f la tonne, alors que le prix
au producteur varie entre 80 et 170f/kg (pour la vente locale) soit en moyenne
5.000f le sac de 40kg et 125.000f la tonne. Pour chaque tonne vendue dans les
marchés de consommation, le bana-bana y gagne en moyen 75.000
francs par rapport au prix d'achat au producteur. La régularisation des
prix et l'achat des produits locaux par l'agropôle de Fass, permettraient
aux producteurs de tirer plus de revenus sur la vente tout en limitant les
opérations commerciales irrégulières et en leurs
défaveurs, effectuées par les bana-banas.
109
2.2. Alternatives des mutuelles locales : l'exemple de
celle de Mboumbaye
Les mutuelles sont les seuls partenaires financiers directs
des maraîchers du Gandiolais. Elles cherchent à appuyer tous les
secteurs de développement, particulièrement celui de
l'agriculture. L'exemple de la mutuelle de Mboumbaye est illustratif. Devenue
un acteur de taille dans les activités développement
socio-économiques de la localité, la mutuelle de Mboumbaye doit
être impliquée dans la recherche d'une approche susceptible de
relancer le développement de l'agriculture. Cette mutuelle,
malgré les efforts qu'elle déploie dans le secteur agricole,
connaît pourtant des difficultés qu'elle tente de solutionner.
Tableau 8 : Difficultés et solutions
proposées par la mutuelle de Mboumbaye
|
DIFFICULTES
|
PROPOSITIONS
|
|
Absence ou retard du remboursement des dettes par les
bénéficiers.
|
Plus grand sérieux des paysans et autres clients.
|
|
Difficultés liées à la commercialisation
des produits et vente informelles aux bana- banas
|
Avoir une bonne maîtrise de la production :
éviter la surproduction au niveau des marchés locaux et
nationaux, trouver des partenaires en aval de la filière
|
|
Concurrence des régions productrices
d'oignons et l'importation des oignons européens
(l'oignon Hollandais).
|
Mise en place par l'Etat d'un système de
péréquation des prix pour rendre plus attractif le prix au
producteur et suspendre ou régulariser les produits d'importation.
|
Source : Enquêtes personnelles 2005
Pour surmonter ces difficultés, la mutuelle propose des
orientations pour la consolidation de ses intérêts et de ceux des
producteurs (cf. tableau 8). Néanmoins, les non remboursements
volontaires ou involontaires sont des pratiques courantes auxquelles se livrent
certains producteurs. Ces pratiques faussent les objectifs de la mutuelle. De
ce fait, les maraîchers doivent respecter tous les engagements qu'ils
avaient avancés avec la mutuelle. Certains maraîchers, sous
estimant les rendements tirés de leur récolte, prétendent
parfois de ne pas pouvoir payer entièrement leur dette en raison d'une
mauvaise campagne agricole.
110
2.3. Propositions de quelques partenaires au
développement
Certaines structures comme l'IRA, la CARITAS et l'ANCAR,
jouent un rôle important dans l'encadrement de l'agriculture du
Gandiolais. Ce sont des organisations décideurs dont les propositions
mérites d'être prises en compte dans la recherche de solutions ou
d'alternatives appropriées pour la relance de la culture
maraîchère. La CARITAS, a toujours mené des recherches pour
l'introduction de nouvelles variétés d'oignon plus productives
dans le Gandiolais. L'IRA également participe à la lutte contre
les insectes et animaux dévastateurs des plantes ou récoltes.
Restauration amendement
Tableau 9 : Difficultés et alternatives de la
production maraîchère dans le Gandiolais, d'après l'IRA, la
CARITAS et l'ANCAR.
|
DIFFICULTES
|
ALTERNATIVES
|
|
Baisse de la fertilité des sols
|
Restauration des sols par une pratique du
labour amélioré, amendement minéral
et
organique
|
|
Baisse des rendements
|
Fourniture de semences de bonne qualité et
adapté aux conditions agricoles
|
|
Cherté des intrants et faiblesse du prix au
producteur
|
Co-gestion de la filière entre les mutuelles, les
producteurs et l'Etat
|
|
Vétusté du matériel agricole et du
système de production agricole
|
Mise en place d'un vaste programme de renouvellement en
matériel agricole par un prix abordable et modernisation du
système de production par l'introduction de nouvelles techniques de
cultures.
|
|
Problème de stockage en période d'abondance sur
les marchés locaux et nationaux, pourriture
des produits mal stockés et baisse des
rendements
agricoles.
|
Construction d'abris séchoirs afin d'éviter les
risques de pourriture, produire en fonction de la demande sur les
marchés et des possibilités de commercialisation, orienter la
destination d'une bonne partie des produits de vente vers l'agropôle de
Fass qui devra être considéré comme premier partenaire
commerciale.
|
Source : enquêtes personnelles 2004
111
Ces structures, compte tenu des réalisations qu'elles
ont eu à faire dans la zone et des échecs notés,
détiennent une certaines expérience qui leurs permet de proposer
quelques orientations. Ainsi, elles ont fait une liste des difficultés
que connaît la culture maraîchère dans le Gandiolais et ont
recommandé des propositions qui peuvent les atténuer (cf. Tableau
9).
L'analyse des différentes propositions formulées
par les acteurs au développement montre l'ampleur des contraintes de
développement agricole dans le Gandiolais. Elle a en outre montré
que les acteurs concernés par l'agriculture du Gandiolais pourraient
être les premiers responsables dans le choix des actions à mener
pour améliorer leur niveau de vie et résoudre les
problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est pourquoi la
recherche de solutions, susceptibles de corriger ou d'atténuer les
difficultés que connaît l'agriculture, est nécessaire pour
la prise en compte de l'intérêt de tous les acteurs de la
filière. Une telle démarche peut atténuer les
déséquilibres et permet à chacun de profiter des
retombées de la culture maraîchère.
Conclusion de la troisième partie
Il ressort au terme de l'étude de cette partie, que le
Gandiolais et la communauté rurale en général,
malgré toutes les contraintes qui s'opposent à l'évolution
de l'activité agricole, entrent dans une nouvelle phase de
révolution agricole. Avec la réalisation du canal du Gandiolais,
l'application des règles définies par le POAS et l'ouverture
prochaine de l'agropôle de Fass, le secteur agricole de la zone va
connaître une nouvelle tournure. A cela, s'ajoutent les
différentes propositions avancées par les paysans, les mutuelles
existantes et les partenaires au développement qui interviennent au
niveau de la communauté rurale. Pour un avenir meilleur du secteur
agricole dans la communauté rurale, notamment dans le Gandiolais et le
Toubé, les producteurs doivent tenir compte les recommandations qui ont
été formulées par des partenaires qui, techniquement
maîtrisent mieux qu'eux les contraintes auxquelles le milieu fait
face.
112
CONCLUSION
Au terme de cette étude, on a pu prendre conscience de
l'existence dans la zone du Gandiolais et de Toubé d'une dynamique
agricole ancienne qui, désormais, doit faire face à de nouvelles
mutations socio-économiques. Le regard porté sur les pratiques
agricoles dans le Gandiolais et le Toubé montre une situation alarmante
qui n'incite guère à l'optimisme du fait des contraintes qui
pèsent sur cette zone.
A y regarder de près, les principales contraintes au
développement de l'agriculture concernent autant la dégradation
des paramètres environnementaux et économiques que les mesures
d'accompagnement. L'absence ou l'insuffisance de structures d'encadrement du
fait des contraintes physiques du milieu, des échecs
répétitifs de certaines structures d'interventions (comme la
CARITAS), expliquent les interventions très limitées dans la
zone. A ceux-là s'ajoutent la cherté des facteurs de production
(semences, engrais, produits phytosanitaires, etc.). Il en résulte de
larges superficies sous-exploitées, une chute de la production et une
faiblesse des rendements.
L'absence de structure adéquate de stockage, la
dégradation ou l'état de délabrement des séchoirs,
conjugués aux mauvaises conditions d'organisation de la vente et les
problèmes d'écoulement sur les marchés urbains, ont
largement influé sur les rendements de la production agricole, du fait
des pertes considérables de produits maraîchers stockés
(pourrissement) et de la baisse des prix
Malgré toutes ces insuffisances, il n'en demeure pas
moins qu'il existe quelque part des progrès assez notoires. On peut
noter parmi ceux-ci la diversification des produits maraîchers (oignon,
carotte, tomate, etc.), avec certes une large dominance des oignons, les
efforts fournis dans la gestion de la fertilité des sols avec les
systèmes de rotation des cultures, la jachère. Même si les
conditions du milieu se dégradent, il est indispensable qu'une autre
démarche soit adoptée pour permettre la réappropriation de
la filière par les producteurs.
Ces démarches passeraient nécessairement par une
meilleure organisation des producteurs qui permettrait de conclure des accords
avec les partenaires au développement qui interviennent dans le secteur
agricole au niveau de la communauté rurale de Gandon. Grâce
à cette organisation, ils pourront parvenir à réorganiser
le système vente qui, localement a toujours été en faveur
des bana-banas. Une sécurisation de la production avec la
création d'infrastructures de stockage est également
indispensable. Dès à présent, les producteurs, la
communauté rurale et leurs partenaires peuvent ensemble penser à
une réintroduction d'un
113
autre mécanisme de régulation des crédits
de campagne pour permettre à tout producteur d'y accéder,
c'est-à-dire modérer les conditions de prêts. Il s'agira
également pour l'Etat d'arrêter ou de limiter les importations
durant les périodes d'abondance. Cette décision permettrait
l'écoulement rapide de la production agricole et encouragerait davantage
la production locale.
La mise en eau de la vallée du Gandiolais et
l'ouverture de l'agropôle de Fass, permettront de contourner ou
d'amoindrir toutes ces contraintes qui entravent l'évolution du secteur
agricole dans le Gandiolais et le Toubé. Avec la réalisation du
canal du Gandiolais, la communauté rurale de Gandon pourra
désormais entrer dans une véritable phase de mutation agricole
avec l'introduction d'une nouvelle technique de production agricole dans le
Gandiolais qu'est l'agriculture irriguée. De même,
l'agropôle de Fass permettra peut être de résoudre les
problèmes de stockage et d'écoulement des produits
maraîchers qui, en dehors des contraintes physiques et
socio-économiques, constituent une donnée centrale de
l'équation pour la durabilité du système
maraîcher.
Malgré toutes les contraintes physiques et
socio-économiques, le Gandiolais garde toujours sa réputation
d'une zone de maraîchage par excellence. Pour concrétiser au
bénéfice de la population locale tous les espoirs placés
sur les disponibilités en eau de «l'après-canal », tous
les acteurs de développement de la localité doivent agir de
concert afin d'atteindre le bien être auquel ils aspirent depuis
plusieurs décennies.
114
BIBLIOGRAPHIE
Aw A. T., 1997, Les zones humides
résiduelles du Delta du fleuve Sénégal, Saint Louis
(Sénégal), mémoire de maîtrise de géographie
de l'université Gaston Berger, 115p.
Aw F. Z., 1999, Evolution de l'environnement
du bas Delta du fleuve Sénégal et durabilité du
systèmes de production horticole Gandiolais, Saint Louis
(Sénégal), mémoire de maîtrise de géographie
de l'université Gaston Berger, 105p.
Ba H., 2005, Décentralisation et
développement local Perspectives d'aménagement de la
dépression du Ndiasséou (la zone des Trois Marigots) dans la
Communauté Rurale de Gandon, mémoire de
maîtrise de géographie de l'université Gaston Berger, 122
p.
Ba M., 1988, Hydrologie de l'estuaire du
Sénégal impact du Barrage de Diama in rapport final
E.P.E.E.C. U.N.E.S.C.O., division science de la mer, P.N.U.D. Dakar, pp.
16-32.
Ba M., 1998, Aménagements hydro
agricole et activités pastorales dans la vallée de
l'Anambé : l'exemple de la communauté rurale de Mampatim,
Saint Louis (Sénégal), mémoire de maîtrise de
géographie de l'université Gaston Berger, 121p.
Barusseau J. P., MIichel P., Sall M., 1993,
L'après barrage dans la vallée du Sénégal .
modifications hydro-dynamiques et sédimentologiques .
conséquences sur le milieu et les aménagements hydro
agricoles, France, Résultats des travaux du projet campus, P. U. de
Perpignan, 234p.
Blanc P. C., in ALTERSIAL
(Ensia-Gret), CERED (Cerna), MSA (ORSTOM), 1985, Nourrir les
villes en Afrique Sub-saharienne, (dir.), Paris,
Harmattan, pp 247-250
Bonnardel R., 1992, Saint Louis du
Sénégal . mort ou naissance ?, Paris, Harmattan, 424p.
Chambers R., 1990, Développement rural . la
pauvreté cachée, Paris, Karthala, 375p.
CARITAS, 2004, « Journée CARITAS
Sénégal, Saint Louis les 6 et 7 mars 2004 », 6p.
C.R. Gandon, 2004, « Présentation
de la communauté rurale de Gandon », document de synthèse
des programmes et réalisations, 12p.
C.R. Gandon, 2004, « Plan d'Occupation
et d'Affectation des Sols : règles d'occupation et de gestion des sols
», SAED/conseil rural de Gandon, Saint Louis Sénégal, 9p.
C.R. Gandon, 2003, « Synthèse du
rapport du diagnostic participatif approfondi de la Communauté Rurale de
Gandon », Cadre Local de Concertations des Organisations de Producteurs de
la communauté rurale (C.L.C.O.P.), 20p.
C.R. Gandon, 2001, « Plan local de
développement (PLD) de la communauté rurale de Gandon »,
Umbrella support unit Plan International Octobre Novembre 2001, 178p.
Dia I., 2002, Décentralisation et
développement local . perspectives pour un aménagement
115
durable de la dépression de Boar dans le Delta du
fleuve Sénégal, Saint Louis (Sénégal),
mémoire de maîtrise de géographie de l'université
Gaston Berger, GIRARDEL, 102p.
Diagne A. P., 1998, Cartographie
d'évolution de la mangrove de Saint Louis (effets de la
sécheresse et impacts potentiels du barrage de Diama), Saint Louis
(Sénégal), mémoire de maîtrise de géographie
de l'université Gaston Berger 116p.
Diallo I., mars 2003, Appui aux acteurs
de développement local, association des volontaires du
progrès, Montlhéry, France, 72p.
Diallo G. D., 1994, Résultats des
enquêtes sur le maraîchage dans la communauté rurale de
Gandon, Saint Louis (Sénégal), Inspection de l'agriculture,
28p.
Diatta I., 2004, L'ouverture d'une
brèche à travers la langue de Barbarie (Saint Louis du
Sénégal). Les autorités publiques et les
conséquences de la rupture, mémoire de maîtrise de
géographie de l'université Gaston Berger, 119p.
Dièye N. S., 2005, Agropôle
: une industrie agroalimentaire décentralisée de la zone des
Niayes ou stratégie de développement de production agricole (le
maraîchage). Analyse de la dynamique d'insertion de l'agropôle dans
un espace d'accueil, mémoire de maîtrise de géographie
(en cours de rédaction) de l'université Gaston Berger.
Diop D., 1998, Eau et environnement dans
le Gandiolais : impacts potentiels de la remise en eau d'une ancienne zone
humide, Saint Louis (Sénégal), mémoire de
maîtrise de géographie de l'université Gaston Berger,
123p.
Diouf B. T. O., 1995, Eau et
environnement dans la réserve de Djeuss- Lampsar : Problématique
d'une gestion de la ressource hydrique, Saint Louis
(Sénégal), mémoire de maîtrise de géographie
de l'université baston Berger, 79p.
D'Aquino et al., 2001, « Vers une
dynamique endogène de gestion de l'espace pastoral et irrigué :
l'opération pilote P.O.A.S. dans le Delta du fleuve
Sénégal » in, élevage et gestion de parcours au
Sahel, implication pour le développement, Verlag ulrich E. Grauer,
Beuren, Sttuggart / Allemagne, pp 201-208.
Dresch J., 1982, Géographie des
régions arides, France, Presse Universitaire de France (P.U.F.),
277p.
Dugauquier F., Hecq J., 1990,
Périmètres irriguées villageois en Afrique
sahélienne, France, Condé-sur-Noireau, 234p.
Fall I., 1999, Adaptabilité et
durabilité du système de production dans la cuvette de Pont
Gendarme (Delta du fleuve Sénégal), Saint Louis
(Sénégal), mémoire de maîtrise de géographie
de l'université Gaston Berger.
Faye A., 1996, Les critères des
gestions des ressources en eau dans le delta du fleuve
Sénégal,
116
thèse de 3ème cycle, U.C.A.D., 210p.
Houma Y., 1994, Les contraintes à
la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal,
Saint Louis (Sénégal), Rapport de stage pour le DEA de
géographie, ISRA, 47p.
IRA, 1984, « Etude de faisabilité
de projet de développement agricole dans le Delta », Saint Louis
(Sénégal), régie par la loi n° 84/37 du 11 mai 1984,
siège social provisoire : Touba Léona Sor BP 236 Saint Louis
(Sénégal), direction de la coopération.
I.R.A., 1995, « Etude monographique des
villages de Ndiakhère et de Gueumbeul », Saint Louis
(Sénégal), PTC/SEN/4454 (A), communication pour l'environnement,
32p.
I.R.A., 1970, « Note sur les
perspectives d'évolution des cultures maraîchères dans le
bas Delta », IRA, Saint Louis (Sénégal), 8p.
I.R.A., 2003, « Programme
régional de développement agricole de la région de Saint
Louis », octobre 2003, Direction Régionale du Développement
Rural de Saint Louis, 60p.
Kroll R., 1994, Les cultures
maraîchères, Paris, Moissonneuse et Larousse, 219p.
Lebeau R., 2000, Les grands types de
structures agraires dans le monde, Paris, Armand Colin, 181p.
Magrin G., Traoré B., 2003, «
Conflits et régulation pour la gestion des ressources naturelles
à l'heure des décentralisations : nouveaux enjeux pour la
recherche d'accompagnement ». Proposition du GIRARDEL pour l'appel
d'offres de l'Agence Universitaire de la Francophonie (A.U.F.), Pôles
d'excellence régionale en formation et en recherche.
Mangane P. M., 2004, Contribution
à l'étude des stratégies de gestion de l'environnement
péri urbaine .
· utilisation des déchets pour la
valorisation de l'agriculture péri urbaine à Saint Louis,
mémoire de maîtrise de géographie de l'université
Gaston Berger, 152p.
Mercoiret M. R. / Bosc M. P., 1994, « Les
organisations paysannes, acteurs du développement », revue externe
à mi-parcours, CIRAD-SAR, Montpellier France, 13 p. MIichel P.,
Sall M., 1984, « Dynamique des paysages et aménagements de
la vallée alluviale du Sénégal », in..., Le
développement rural en question : paysages, espaces ruraux,
systèmes agraires : Maghreb-Afrique noire- Malaisie, Paris, ORSTOM,
pp. 89-109.
Nahal I., 1998, Principes d'Agriculture
durable, Paris, ESTEM, 256p.
Ndiaye A., 2000, Contribution au
diagnostic des facteurs et des contraintes de développement de la
culture de l'arachide dans la communauté rurale de Keur Baba
(Département de Kaolack), mémoire de maîtrise de
géographie de l'université Gaston Berger, 128 p.
Ndiaye A., 1996, Delta du fleuve
Sénégal : désengagement de la SAED et autogestion paysanne
.
· l'exemple de la cuvette de Boundou, Saint Louis
(Sénégal), mémoire de maîtrise de géographie
de l'université Gaston Berger, 155p.
117
Ndiaye A., 1973, Le Gandiolais,
l'estuaire, la langue de Barbarie, étude géomorphologique,
U.C.A.D., département de Géographie, mémoire de
maîtrise, 88p.
Ouatara D., 1989, Volet d'appui à
la production maraîchère et protection de l'environnement :
actualisation de la situation agricole et la culture de légumes dans le
Gandiolais, Saint Louis (Sénégal), Rapport technique, CECI,
39p
Rigod M., 2004, Tourisme et
développement local autour de Saint Louis du Sénégal : une
association pertinente ?, mémoire de maîtrise,
université Louis Lumière Lyon, 184 p.
Roche D., 2003, « Le
développement en milieu local. De quoi parle-t-on ? », in Les
cahiers de Girardel n°1, pp. 73-86.
Sarr C. S., 2004, Géographie et
écologie de la région de Saint Louis, Saint Louis
(Sénégal), formation de guides au Syndicat d'Initiative et de
Tourisme, 7p.
Seck B., 1995, Systèmes de
production agricole et gestion des terroirs villageois dans la moyenne
vallée : l'exemple de la communauté rurale de Médina
Ndiathbé, arr. de Cas-Cas, Saint Louis (Sénégal),
mémoire de maîtrise de géographie de l'université
Gaston Berger, 105p. Sène EL., 1991, La
vulgarisation agricole dans le Delta du fleuve Sénégal (Cas de la
zone de Lampsar), SAED, Saint Louis (Sénégal),
mémoire de fin d'études, école nationale des cadres ruraux
de Bambey, Direction de la formation et de la recherche - SAED, 110p.
Sy B.A., 1995, Dynamique éolienne
actuelle dans le Delta du fleuve Sénégal (contribution à
l'étude géomorphologique du Sénégal
septentrional), thèse de 3ème cycle,
département de géographie UCAD, 251p.
Thioune El M., 2005, L'exploitation des
salines littorales du Gandiolais (bas Delta du fleuve Sénégal :
une activité en sursis ?), mémoire de maîtrise de
géographie (en cours de rédaction) université Gaston
Berger de Saint Louis.
Thior P., 1998, L'invasion des plantes
adventices et désherbasse chimique dans les aménagements hydro
agricoles du Delta du fleuve Sénégal : évaluation des
risques de pollution, saint Louis (Sénégal), mémoire
de maîtrise de géographie de l'université Gaston Berger,
77p.
TROPICA, 2001, « Etude des impacts sur
l'environnement du projet de gestion des ressources naturelles du Gandiolais
», rapport d'étude, Dakar Sénégal, SICAP villa 20,
35p.
Vennetier P., 1991, Les villes d'Afrique
tropicale, Paris, Masson, 244p.
Yves C., 1998, L'agriculture dans le
monde, Paris, Armand Colin, 96p.
118
SITES DE RECHERCHE
http://www.seneportal.com
http://www.globenet.org/horizon-local/
http://www.sapie.com
www.fao.org
Webmaster@fao.org
lesoleil@lesoleil.sn
http://www.sapie.com
SIGLES ET ACRONYMES
A.D.G.T. : Association pour le Développement du
Gandiolais et du Toubé
A.D.P.E.S. : Association
sénégalaise pour une Dynamique de
Progrès Economique et
Social
ANCAR : Agence Nationale de
Conseil Agricole et Rural
A.U.F. : Agence Universitaire
de la Francophonie
CAR : Conseil Agricole et
Rural
CECI : Centre canadien d'Etude
et de Coopération Internationale
C.E.R.P. : Centre d'Expansion
Rural Polyvalent
C.L.C.O.P. : Cadre Local de
Concertation des Organisations de
Producteurs
CROUS : Centre Régional
des OEuvres Universitaires de
Saint Louis
D.E.A. : Diplôme d'Etude
Approfondie
D.R.D.R. : Direction
Régionale pour le Développement
et la Recherche agricole
F.A.I. : Fonds d'Appui à
l'Innovation
FED : Fonds Européen de
Développement
FIR : Fonds d'Investissement
Rural
FIT : Front Inter
Tropical
F.J. : Foyer des Jeunes
G.I.E. : Groupement
d'Intérêt Economique
GIRARDEL : Groupe
Interdisciplinaire de Recherche pour
l'Appui à la planification
Régionale et au
Développement Local
G.P.F : Groupement de
Producteur Féminin
IRA : Inspection
Régionale de l'Agriculture
ISRA : Institut
Sénégalais de Recherche
Agronomique
L.S.H. : Lettres et Sciences
Humaines
119
O.C.B. : Organisation
Communautaire de Base
O.J.F. : Organisation des
Jeunes Filles
O.N.G. : Organisation Non
Gouvernementale
O.P. : Organisations de
Producteurs
P.O.A.S. : Plan d'Occupation
et d'Affectation des Sols
P.A.V.G.T. : Programme
Agricole des Villages de
Gandiol et de Toubé
P.D.R.H. : Projet de
Développement des Ressources
Humaines
P.L.D. : Plan Local de
Développement
PNAT : Plan National
d'Aménagement du Territoire
PNIR : Programme National
d'Infrastructure Rurale
PNUD : Programme des Nations
Unies pour le Développement
P.P.M.E.H. : Projet de
Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises
R.N.2 : Route Nationale
numéro 2
SAED : Société nationale
d'Aménagement et d'Exploitation des
terres du Delta et de la
Vallée du fleuve Sénégal
UCAD : Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
U.F.R. : Unité de
Formation et de Recherche
U.G.B. : Université
Gaston Berger
120
TABLES DES ILLUSTRATIONS
Liste des cartes :
Carte n°1 : Le Gandiolais, de contact entre les Niayes et le
Delta 6
Carte n°2 : Zonage de la communauté rurale de Gandon
d'après le POAS 8
Carte n°3 : Situation des villages du Gandiolais et de
Toubé 31
Carte n°4 : Typologie agricole du Gandiolais et de
Toubé 35
Carte n°5 : Secteur couvert par la mutuelle de Mboumbaye
53
Carte n°6 : Sites distinctes de maraîchage dabs le
Gandiolais et le Toubé 74
Carte n°7 : Réseau routier dans le Gandiolais et le
Toubé 83
Carte n°8 : Les différentes zones humides dans le
Delta du Sénégal 94
Carte n°9 : Localisation du canal du Gandiolais 96
Liste des figures :
Figure n°1 : Evolution de la hauteur pluviométrique
à Saint Louis (1995-2004) (en mm) 21
Figure n°2 : Evolution de la vitesse moyenne mensuelle des
vents en m/s (1995 à 2003) 22
Figure n°3 : Typologie des sols dans la communauté
rurale de Gandon 24
Figure n°4 : Facteurs et effets de l'évolution de la
salinisation des terres du Gandiolais et de
Toubé 26
Figure n°5 : Composition ethnique de la population de la
communauté rurale de Gandon 32
Figure n°6 : Répartition de la population de la
communauté rurale de Gandon par secteur
d'activités 33
Figure n°7 : Occupation traditionnelle des terres de culture
dans le Gandiolais et le Toubé 46
Figure n°8 : Proportion des populations du Gandiolais et de
Toubé qui utilisent qui utilisent
les techniques de maintien de la fertilité des sols (en %)
48
Figure n°9 : Représentation schématique du dispositif
de remise en eau de la vallée du
Gandiolais 97
Liste des tableaux :
Tableau n° 1: Températures moyennes mensuelles
(1995-2003) 17
Tableau n°2 : Moyenne mensuelle de l'humidité
relative (1995-2003) 18
Tableau n°3 : Moyenne mensuelle de l'évaporation en
mm (2002-2003) 18
121
Tableau n°4 : Moyenne mensuelle de la pluviométrie en
mm (1995-2004) 20
Tableau n°5 : Hauteurs pluviométrique et nombre de
jours de pluies entre 1995 et 2004 20
Tableau n°6 : Répartition des sites
de production agricole dans la ville de Saint-Louis 38
Tableau n°7 : Présentation des conseillers ruraux de
la communauté rurale de Gandon 45
Tableau n°8 : Difficultés et alternatives de la
mutuelle de Mboumbaye 109
Tableau n°9 : Difficultés et alternatives de la
culture maraîchère dans le Gandiolais d'après
l'ANCAR, l'IRA et la CARITAS 110
Liste des photos :
Photo n°1: Les effets du sel sur les terres du Gandiol 27
Photo n°2 : le maraîchage (ou l'oignon) à
Mboumbaye 37
Photo n°3 : le maraîchage (ou l'oignon) à
Lahlar 37
Photo n°4: Plusieurs hectares mis en valeur avec la seule
variété d'oignons 37
Photo n°5 : Mode de conservation de l'oignon 41
Photo n°6 : Quelques sacs de fumure animale
déjà achetés pour la saison des pluies 50
Photo n°7 : Mutuelle d'épargne et de crédit de
Gandiol 52
Photo n°8 : Méthode d'utilisation des produits
phytosanitaires dans le Gandiolais 54
Photo n°9 : L'arrosage traditionnel 57
Photo n°10 : Plusieurs centaines de mètres à
faire entre le puits et les assiettes 57
Photo n°11 : Le mode de puisage traditionnel 57
Photo n°12 : Le "goutte à goutte", une système
d'irrigation moderne en test dans le
Gandiolais 59
Photo n°13: Terres de cultures abandonnées à
cause du sel 61
Photo n°14: Aperçu sur le matériel qui compose
la case des sourgha 63
Photo n°15: Une case installée à
l'intérieur d'une parcelle d'oignon 63
Photo n°16: La tomate plantée dans l'oignon 63
Photo n°17: Une parcelle de tomate à Mboumbaye 63
Photo n°18: Une parcelle de carotte à Mouit 63
Photo n°19 : Produits agricoles locaux transformés
par le G.I.E. Sukaly Gandon 65
Photo n°20: Exposition de quelques produits du G.I.E. Taty
Mbaye de Békhar 69
Photo n°21: Des bouteilles fabriquées par l'ANCAR
69
Photo n°22: La diversité des produits du G.I.E. Taty
Mbaye 69
Photo n°23: Projet de reboisement des femmes en concert avec
la réserve de Gueumbeul 71
122
Photo n°24 : La pourriture, première de la
mévente de l'oignon 81
Photo n°25 : Une piste de production à Lahlar
85
Photo n°26 : Une piste de production à Mboumbaye
85
Photo n°27 : La piste principale qui mène vers les
villages de Gandiol 85
Photo n°28 : Le portage sur la tête, un moyen de
transport régulièrement utilisé 86
Photo n°29 : Un parc de stockage d'oignons à
Mboumbaye Gandiol 84
Photo n°30 : Un séchoir devenu une boutique 87
Photo n°31 : Un séchoir transformé en
dancing 87
Photo n°32 : Un séchoir à moitié
démoli 87
Photo n°33 : Un séchoir sous les effets du sel
87
Photo n°34 : Les camions affrétés par les
bana-banas pour l'évacuation des produits
locaux 88
Photo n°35: Le tracé du canal d'une longueur de
plus de 8 km 93
Photo n°36 : Le Ngalam, source d'alimentation du canal du
Gandiolais 93
Photo n°37 : L'ouvrage de prise sur le Ngalam 93
Photo n°38 : Une passerelle construite sur le canal 93
123
TABLE DES MATIERES
Dédicaces 2
Remerciement 3
Sommaire 4
Introduction 5
Problématique 9
Méthodologie 13
PREMIERE PARTIE : Le Gandiolais et le Toubé, un
cadre physique et humain,
favorable à l'activité agricole
16
Chapitre I : Caractéristiques du milieu
physique et dynamique du secteur agricole dans le
Gandiolais et le Toubé 17
1. L'influence des facteurs climatiques sur les
pratiques agricoles 17
1.1. Le régime thermique 17
1.1.1. La température 17
1.1.2. L'humidité relative 18
1.1.3. L'évaporation 18
1.2. Le régime pluviométrique 19
1.3 Le régime des vents 22
2. Le Gandiolais, une zone écologique
vulnérable 23
2.1. Typologie des sols 23
2.2 Les ressources hydriques 25
2.2.1. Les eaux de surface 25
2.2.2. Les eaux souterraines 27
2.2.3 Le couvert végétal 28
Chapitre II : Données
socio-économiques et systèmes de production agricole dans le
Gandiolais et le Toubé 29
1. L'environnement et le milieu agricole 29
1.1. L'histoire du peuplement 29
1.2. La répartition spatiale de la population 30
1.3. La composition et la structure de la population 30
1.3.1. La composition 30
1.3.2. La structure 32
124
2. Agriculture et autres activités
génératrices de revenus 33
2.1. L'agriculture 34
2.1.1. Les cultures sous pluies 34
2.1.2. Les cultures maraîchères 36
2.2. L'élevage et la pêche 39
2.2.1. L'élevage 39
2.2.2. La pêche 40
2.3. Le commerce et l'exploitation du sel 40
2.3.1. Le commerce 40
2.3.2. L'exploitation du sel 41
Conclusion de la première partie 42
DEUXIEME PARTIE : Facteurs explicatifs de
l'évolution et des contraintes du
système de production agricoles dans le
Gandiolais et de Toubé 43
Chapitre I : Dynamique des systèmes de
production agricoles 44
1. Analyse de l'évolution de la production
agricole 44
1.1. Le régime foncier 44
1.1.1. L'accès à la terre 44
1.1.2. Les contraintes liées à l'accès
à la terre 46
1.2. Les pratiques culturales 47
1.2.1. Les méthodes de fertilisation des terres
agricoles 47
1.2.1.1. La rotation des cultures 48
1.2.1.2. L'utilisation de l'engrais 49
1.2.1.2.1. L'engrais organique (ou la fumure animale) 49
1.2.1.2.2. L'engrais chimique 51
1.2.1.3. Les produits phytosanitaires 54
1.2.1.4. La jachère 55
1.2.2. Les méthodes d'irrigation 56
1.2.2.1. L'arrosage 56
1.2.2.2. Les pompes Djambar 56
1.2.2.3. L'irrigation moderne 58
1.3. Les modes d'exploitation des terres de culture 60
1.3.1. La location de la parcelle 60
1.3.2. L'emploi de la main d'oeuvre 62
125
1.3.3. Le système de partage (ou le métayage) 62
2. Les mutations du secteur agricole 64
2.1. Les cultures « hors sols » 64
2.2. La dynamique des organisations communautaires de base 66
2.2.1. Les formes d'organisations paysannes 66
2.2.2. Le rôle des organisations communautaires de base
67
2.2.3. Aperçu sur les actions des organisations de
producteurs 68
2.2.3.1. Les groupements de producteurs féminins 68
? Le G.I.E. Taty Mbaye 68
2.2.3.2. Les associations de jeunes 72
2.2. Dynamiques induites dans le secteur agricole par les
partenaires au développement 72
2.2.1. L'apport des partenaires au développement dans le
secteur agricole 72
2.2.2. Facteurs explicatifs des contre-performances dans les
interventions 76
Chapitre II : Quelques contraintes de production
agricole dans le Gandiolais dans le
Gandiolais 79
1. Les contraintes d'ordre social du secteur agricole
dans le Gandiolais pauvre 79
1.1. Contraintes socio-économiques 79
1.2. Contraintes relatives à la main-d'oeuvre 80
1.3. Contraintes relatives aux intrants et aux crédits
81
2. Les contraintes techniques face à une
agriculture toujours tributaire des aléas
climatiques 82
2.1. Les contraintes relatives au transport et au stockage 82
2.1.1. Contraintes induites par le transport 82
2.1.2. Contraintes relatives au stockage 84
2.2. Contraintes relatives à la commercialisation 88
Conclusion de la deuxième partie 90
TROISIEME PARTIE : Quelles perspectives pour
l'agriculture dans le
Gandiolais 91
Chapitre I :
Stratégies à adopter pour atténuer les problèmes de
l'agriculture du
Gandiolais 92
1. Le canal du Gandiolais, pour une nouvelle dynamique
agricole 92
1.1. L'alimentation du Gandiolais en eau agricole, via le canal
92
1.2. La localisation et l'aire d'influence du canal 95
126
1.2.1. Le site d'accueil du canal 95
1.2.2. l'air d'influence du canal 97
1.3. Le canal et le développement du secteur agricole
97
1.3.1. les impacts positifs 97
1.3.2. Les impacts négatifs 99
2. le POAS pour un rapprochement entre l'agriculture
et les autres activités 100
2.1. Définition et objectifs du POAS 100
2.2.1. Définition 100
2.2.2. Objectifs 100
2.2. Dispositif d'application pour la réussite du POAS
101
Chapitre II : Quelques orientations possibles
pour un meilleur développement agricole
durable 104
1. Actions à mener pour une relance du secteur
agricole dans le
Gandiolais 104
1.1. Promouvoir la redynamisation du secteur agricole 104
1.1.1. Amélioration des conditions d'accès au
foncier 104
1.1.2. Redynamiser les structures villageoises 105
1.1.3. Possibilité de condition d'accès aux
prêts 106
2. Les alternatives possibles pour le secteur
agricole 107
2.1. Alternatives paysannes 107
2.2. Alternatives des mutuelles locales : l'exemple de celle
de Mboumbaye 109
2.3. Propositions de quelques partenaires au
développement 111
Conclusion de la troisième partie 111
Conclusion 112
Bibliographie 114
Sites de recherches 118
Sigles et acronymes 118
Tables des illustrations 120
Tables des matières 123
Annexe 127
| 


