SECTION HOMOGENE LENTICULAIRE
Numéro des pièces : NZA : 67, 18, 17, 13, 1,
29, 11, 7, 23 & NZK : 134, 123, 4, 129, 144, 133, 141
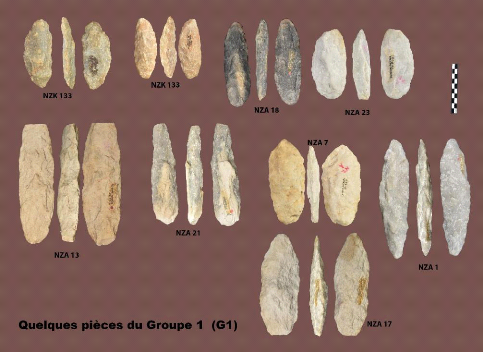
Figure 21 Quelques pièce du Groupe 1. Photos M-J
Angue.
Description générale de la morphologie des
pièces (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.)
35
16 pièces sont présentes dans ce groupe. Ces
pièces présentent plusieurs plans de symétrie : selon
l'axe longitudinal, selon l'axe transversal et selon le plan d'équilibre
bifacial. Pour l'orientation, au vu de la symétrie des pièces,
nous avons choisi l'extrémité la plus arrondie comme partie
proximale. La face qui présente la convexité la plus importante
est considérée ici comme la face supérieure.
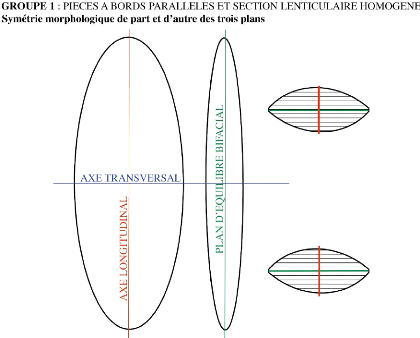
Figure 22 Schéma de la structure volumétrique
des pièces du Groupe 1
Matières premières
Nous avons identifié neuf pièces en quartzite et
sept pièces en grès. Les quartzites ne forment pas un groupe
homogène mais sont tous assez adaptés à la taille (absence
de plans de fracture naturels et d'inclusions, stigmates de taille lisibles) ;
on distingue trois groupes:
- Quartzite blanc à gris à texture et composition
très homogène à éclat important (N=6)
- Quartzite blanc à texture et composition très
homogène, très opaque et sans éclat (N=2) - Quartzite
beige mouchetés de concentration de grains blanchâtres (N=1)
En ce qui est des pièces en grès, elles vont de
noire à grise. Cinq d'entre elles présentent des grains grossiers
et une seule présentent des grains plus fins. Une pièce ne
présente pas la même homogénéité, on peut y
observer des inclusions de grains noirs et blancs.
36
Etat des surfaces
Notre assemblage regroupe 11 pièces entières et
cinq pièces cassées sur les extrémités. Les
pièces ne présentent pas un état d'altération
homogène. Mais dans ce groupe, les tranchants restent assez frais et les
émoussés sont peu prononcés. Néanmoins trois
pièces présentent des arrêtes plus émoussées,
une a un aspect plus lustré et quatre témoignent de certaines
zones qui ont subi une altération de la couleur des roches. En effet,
elles présentent des zones plus rougeâtres qui font écho
à la couleur des sédiments.
Données métriques (Tableau 4)
Ce groupe présente une certaine variabilité
métrique, malgré une certaine homogénéité en
termes d'élongation. Il est composé de grandes pièces, une
seule étant moins longue que 10cm. NZA 23 présente une largeur et
une épaisseur moins importante. A contrario la pièce la plus
grande, NZA 1, n'est ni la plus large ni la plus épaisse. Cela
suggère qu'elle est la plus allongée et la plus fine de cet
assemblage. Les indices d'élongation de notre groupe qui à la
fois contient des pièces de Nzako Kono et Nzako Ambilo, sont bien
supérieurs à ceux de l'ensemble des types de pièces
bifaciales de ces deux sites. La moyenne d'élongation de faciale des
pièces bifaciales de NZA est 2,149 pour celle de NZK 1,9488, alors que
pour le Groupe 1 elle est de 2,922. Pour la finesse NZA 3,889 et NZK 4 ,76 pour
le groupe 1 elle est de 5,10 (Mesfin et al., 2020).
Ainsi ce premier groupe se distingue de son assemblage
d'appartenance par un aspect beaucoup plus fin.
Tableau 4 Données métrique Groupe 1(en
cm)
|
Groupe 1
|
Longueur
|
Largeur
|
Epaisseur
|
Elongation
|
Elongation
|
|
(face)
|
(profil)
|
|
|
|
Max.
|
24,5
|
7,1
|
4,5
|
4,18
|
7,36
|
|
Min.
|
8,7
|
4,2
|
2,8
|
2,07
|
3,10
|
|
Moyenne
|
16,98
|
5,81
|
3,34
|
2,92
|
5,10
|
37
Données productionnelles 1.5.1. Les
supports
11 pièces n'ont pas pu faire l'objet d'une
identification du support car les négatifs d'enlèvement et les
retouches ont totalement recouvert les surfaces originelles du support. Quatre
pièces sont façonnées sur éclat et une pièce
est façonnée sur plaquette. Sur cette dernière, les
surfaces naturelles résiduelles sont visibles sur les deux faces.
Concernant les pièces sur éclats, elles témoignent d'une
production de grands éclats qui semblent décortiqués
(>10cm).
1.5.2. Les séquences de façonnage
Au sein du Groupe 1, toutes les pièces sont
façonnées sur l'entière périphérie mais les
intensités de réduction sont variables. Seule la pièce NZA
1(Figure 25) présente une intensité de réduction en trois
générations superposées sur chaque face. La
majorité, soit huit pièces, renseigne une séquence de
réduction en deux générations qui est homogène sur
les deux faces. Deux pièces se distinguent avec une intensité de
réduction différente entre les deux surfaces, une face par deux
générations et l'autre ne présentant qu'une seule
génération d'enlèvements. Enfin, les dernières
pièces révèlent une intensité de réduction
moins importante sur les deux faces avec seulement une génération
par face.
En ce qui est du façonnage nous observons
principalement un façonnage alternant dit « bord/bord » et un
façonnage successif dit « face/face ». Neuf pièces sont
façonnées bord/bord, avec des points d'impacts visibles sur les
bords des deux faces. Six pièces paraissent façonnées
face/face avec des points d'impacts qui ne sont plus visibles que sur une seule
face ce qui nous indique que celle-ci est la dernière face
façonnée. Pour une pièce, NZA 29, nous n'avons pas pu
déterminer les étapes du façonnage car celle-ci est
retouchée sur toute sa périphérie.
1.5.3. La retouche
Six pièces de notre assemblage n'ont pas
été retouchées, elles présentent des bords
rectilignes avec des enlèvements rasants. Les dix autres sont
retouchées. Les retouches sont localisées à quatre
endroits différents :
- Quatre pièces présentent une retouche
localisée sur une seule moitié de la pièce, principalement
en partie distale mais prolongée sur chacun des deux bords. La retouche
n'est pas standardisée et peut être uni- ou bifaciale.
- Trois pièces présentent une retouche
périphérique non standardisée avec des étendues
parfois unifaciales et parfois bifaciales,
38
- Deux pièces présentent deux zones de retouches
distinctes, une distale et une latérale. Sur une pièce la
retouche latérale est bifaciale.
- Une pièce présente différentes zones de
retouches distinctes sur toute sa périphérie.
Une pièce présente une retouche parallèle
très fine et une autre avec une retouche subparallèle. Les huit
autres pièces ont une retouche abrupte avec les négatifs
d'enlèvements de retouches très visibles et
pénétrants dans la matière. Huit pièces
possèdent un enlèvement abrupt à l'extrémité
proximale, une seule pièce a ce méplat au niveau de
l'extrémité distale et une à la fois à
l'extrémité distale et proximale.
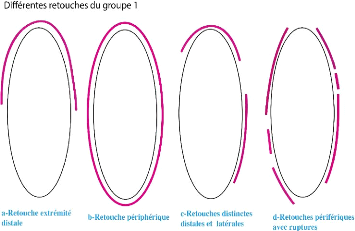
Figure 23 Les retouches du groupe 1
1.5.4. Description des potentielles parties actives (Figure
24)
Les pièces du Groupe 1 sont toutes des pièces
bifaciales « support d'outil » car présentant plusieurs UTFt a
grande majorité de nos pièces (Groupe 1a) présentent une
UTFt1 distale avec l'aménagement d'une pointe qui distingue ce groupe
des autres. L'UTFt1 est continuée, sans rupture, par des tranchants
latéraux ici nommés UTFt2. Aussi cinq pièces
présentent des cassures distales qui interrogent leur probable
utilisation. Sur leurs bords latéraux nous localisons des UTFt2 avec un
fil de coupe rectiligne et tranchant mais nous ne pouvons pas être
certains de la présence d'une UTFt1. La partie proximale est
aménagée avec une sorte de méplat déjà
évoqué plus haut. Ce méplat est très court et
récurrent sur plusieurs pièces et nous nous demandons s'il s'agit
d'un aménagement spécifique lié à la
préhension ou à l'emmanchement. Nous pouvons difficilement
considérer cette partie proximale comme une UTFp car elle ne se
39
distingue pas par un sous volume particulier et aucune
véritable rupture de délinéation n'est observée
entre les trois UTF.
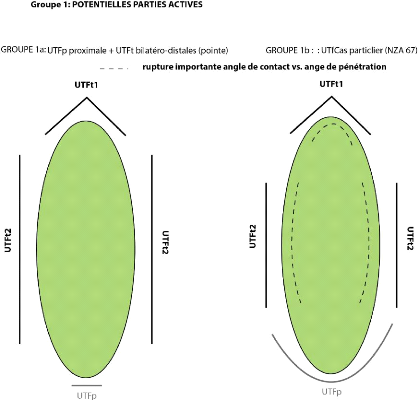
Figure 24 Schéma synthétique des UTF du Groupe
1
A contrario une seule pièce (NZA 67, Groupe 1b) semble
avoir un aménagement distal moindre car son extrémité
distale n'est pas aussi pointue que le reste des pièces qui ne sont pas
cassées. Mais une importante rupture des angles se fait entre l'UTFt1 et
l'UTFt2 dont le fil de découpe est concave sur les deux bords
latéraux avec des angles entre 62° et 95°. L'UTFp de cette
pièce semble aménagé aussi avec un uniquement
enlèvement proximal abrupt mais associé à un volume
beaucoup plus important que le reste du Groupe 1.
1.5.5. Exemples de fiche technique d'une pièce.
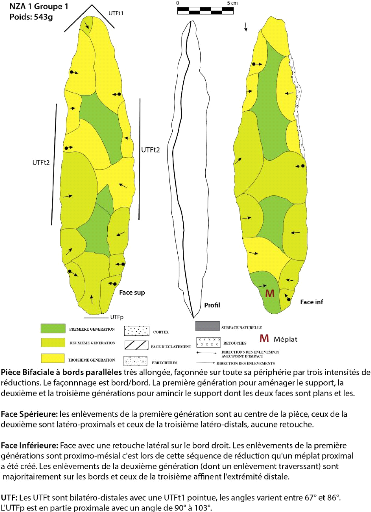
40
Figure 25 Schéma diacritique de la pièce NZA
1
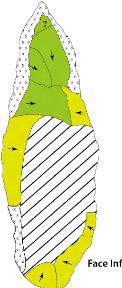
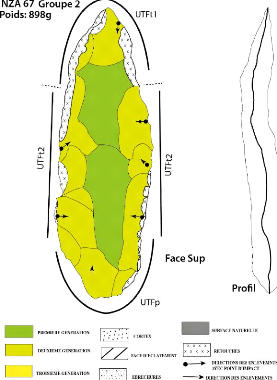
NZA 67 Groupe 2
Poids: 898g i
UTFt1 (E
_1
UTFp
Face Sup
Profil
PREMIERE GENFR,ATION
DEFXIEME GENERATION
TROISIEME GENERATION
CORTEX
FAfF D'FCT ATTMENT
ERIECHURES
SURFACE NATURELLE
x x N x X% x x %
RETOITCTIES
DIRECTIONS DES ENLE'EMN'TS AVEC POINT D'IMPACT
DIRECTION DES ENLEVEMENTS
V/
5 cm
RUPTURE DE DELINEATION
41
Piièce bifaciale du Groupe 2 avec deux
générations d'enlèvements sur les deux faces d'un
façonnage face/face car les points d'impacts ne sont plus visible que
sur une face. Ces enlèvements sont centripètes. Cette
pièce est façonnée sur un grand éclat en
grès.
Face Supérieure: La premiière
génération d'enlèvement a permi d'aménager le
support avec deux grands enlèvementset la deuxième dont les
enlèvement de façconnage sont sur toute la
périphérie a aider à l'amincissement du support. Cette
face plus convexe que l'autre est la dernière à etre
façonnée. L'étendue de la retouche est
latéro-distale et latéro-proximal.
Face Inférieure: la première
génération se localise sur la partie distale qui a
été plus réduite que la partie proxiamle où la
deuxième génération a permi de l'amincir
légèrement avec sur le bord gauche une retouche
latéro-proximale. Une surface de la face d'éclament reste visible
n'ayant pas subit d'autres enlèvements lors de ce façonnage
UTF: Une UTFt1 distale avec un angle variant
entre 62° et 76° présente une rupture de
délinéation avec les UTFt2 sur les bords latéraux avec un
angle entre 80° et 95.
UTFp dont l'angle se situe entre 107° et 115°. Aucune
UTF localisé sur les bords latéraux.
Figure 26 Schéma diacritique NZA 67.
42
2. GROUPE 2 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES ET
SECTION PROXIMALE TRIEDRIQUE.
Numéro des pièces : NZA : 34 ;40 ; 162 ; 39 ; 47
& NZK : 133 ; 84 ; 127.

Figure 27 Quelques Pièces du Groupe 2. Photos M-J
Angue.
Description générale de la morphologie des
pièces Figure 28
Huit pièces ont été regroupées
dans le Groupe 2 (Figure 27). Selon les critères morphologiques. Ces
pièces possèdent un plan de symétrie et deux plans
d'asymétrie. Elles sont symétriques selon et l'axe longitudinal
et asymétriques selon l'axe transversal et le plan d'équilibre
bifacial. Elles présentent une rupture morphologique entre la partie
proximale et distale. En effet, la moitié proximale est
triédrique avec l'agencement de trois surfaces bien distinctes, tandis
que la partie distale présente deux surfaces aménagées
avec une section plano-convexe. Cette partie distale est moins épaisse.
Seule une pièce présente quatre surfaces - et non trois - en
partie proximale (NZK 84). Nous avons choisi la partie la plus fine comme
extrémité distale et la plus robuste comme
extrémité proximale. Notre face supérieure sera celle avec
une convexité plus importante, ce qui est aussi la particularité
de ces pièces.
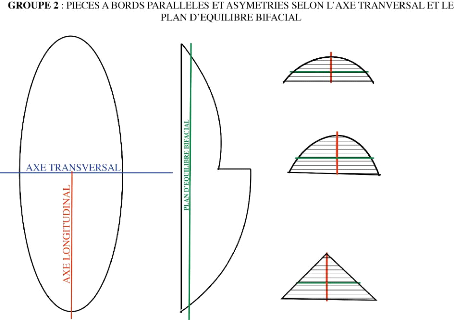
43
Figure 28 Schéma de la structure volumétrique
du Groupe 2
Matières premières
Au sein de ce groupe il y a quatre pièces en
grès, trois pièces en quartzite et une pièce en
grés-quartzite. Les pièces en grès n'ont pas toutes une
texture homogène. Trois sont grises avec des grains grossiers dont deux
sont corticales à l'extrémité proximale. Et une rose avec
des grains plus fins et cortical à l'extrémité proximal.
Les trois pièces en quartzites ont une texture très
homogène grenue. Une blanche, une grise et une rose avec présence
de cortex. L'unique pièce en grès quartzite présente des
inclusions de quartz blanc zébré.
Etat des surfaces
Six pièces sont entières et deux brisées
en une extrémité. Les pièces de notre assemblage
présentent un état de conservation homogène. Mise à
part une sur huit qui a subi une altération colorimétrique et
présente un aspect qui tend vers le rouge due certainement à la
couleur des sols ferralitiques retrouvés de RCA.
Données métriques
Les pièces du Groupe 2 sont dimensionnellement
variables. Toutes présentent une longueur comprise entre 10 et 20cm.
Nous notons une variabilité importante pour l'épaisseur. La
44
moyenne de nos indices du Groupe 2 est
légèrement inférieure à celle de l'ensemble des
pièces bifaciales des sites NZK et NKA. Ce groupe se caractérise
donc par une robustesse plus importante que les autres types de pièces
bifaciales présentent dans les assemblages d'appartenance.
Tableau 5 Données métriques du Groupe 2
|
Groupe 2
|
Longueur
|
Largeur
|
Epaisseur
|
Elongation
|
Elongation
|
|
(face)
|
(profil)
|
|
|
|
Max.
|
19,6
|
7,6
|
5,6
|
2,98
|
5,33
|
|
Min.
|
10,9
|
4,4
|
2,1
|
1,91
|
2,76
|
|
Moyenne
|
15,45
|
5,81
|
4,35
|
2,65
|
3,67
|
Données productionnelles 2.5.1. Les
supports
Cinq pièces sont façonnées sur
éclats. Une pièce semble avoir été
façonnée sur un bloc (NZA 40). En effet, l'aspect anguleux de la
surface naturelle est toujours visibles en partie proximo-latérale. Deux
pièces sont intégralement façonnées et donc leur
support est classé comme indéterminable.
2.5.2. Les séquences de façonnage
Au sein du Groupe 2, sept pièces ont été
façonnées sur toute la périphérie et sur les deux
faces. Une pièce présente un seul enlèvement sur la face
inférieure (NZA 34). Ainsi nous notons un partage équitable entre
deux principaux modes de réduction.
- Une réduction en deux générations
d'enlèvements sur les faces supérieures et idem sur les faces
inférieures (N=4).
- Une réduction en trois générations
d'enlèvements sur les faces supérieures (N=4) dont deux
pièces présentent trois générations
d'enlèvement sur la face inférieure et deux pièces
comportent deux générations d'enlèvements sur cette
même face.
Toutes les pièces du Groupe 2 présentent des
points d'impacts sur deux faces, ils nous renseignent un façonnage par
alternance entre les deux faces.
Ces différentes générations
d'enlèvements de façonnage ont conféré à cet
assemblage la morphologie qui la distingue des autres groupes. En effet en
partie distale, les enlèvements sont
45
très couvrants et souvent traversants, ils permettent
d'amincir la partie distale en laissant épaisse la partie proximale
où il y a très peu d'enlèvements. Les enlèvements
des parties mésiales et proximal se font sur deux des trois surfaces.
Ils ne sont pas envahissants et les négatifs sur les surfaces
inférieures sont très réduits suggérant une
recherche et une maitrise de l'obtention des surfaces planes. Bien qu'il n'y
ait un peu de variabilité dans les modalités de façonnage,
le Groupe 2 présente une variabilité technique en ce qui concerne
la technique de façonnage employé pour l'obtention du volume
désiré.
2.5.3. La retouche
Cinq pièces de notre assemblage n'ont pas
été retouchées. Pour les trois pièces
retouchées, Nous avons deux catégories. On observe des
négatifs de retouche abrupte fortement concaves qui créent un
denticulé latéral. C'est une caractéristique de ce groupe.
On observe également des retouches mixtes où la face
inférieure plane présente souvent des retouches plus ou moins
envahissantes.
Description des potentielles parties actives
En ce qui est du Groupe 2, l'analyse TF a également mis
en exergue deux sous-groupes. Le premier (Groupe 2a) réunit cinq
pièces : l'UTFt1 distale et l'UTFt2 latérale se retrouvent
combinées sans aucune rupture brute de délinéation ; les
angles varient graduellement entre
75° et 95°. La base est aménagée avec
un minimum d'enlèvements de façonnage lui reservant une masse et
un volume important comparé aux extrémités distales et
latérales. Nous localisons l'UTFp en partie proximale.
Le deuxième sous-groupe (Groupe 2b) réunit trois
pièces. L'UTFt localisée sur la partie distale de la pièce
(80-90°) est une pointe plus fine que celle retrouvée dans le
Groupe 2a. Celle-ci est bien circonscrite avec une rupture avec les bords
latéraux dont les angles ne semblent pas retravaillés. La base
est aussi assez volumétrique, nous y localisons l'UTFp où il n'y
a que quelques enlèvements lui permettant de garder un volume plus
important que celui de l'extrémité distale.
Le point commun de ces deux sous-groupes est
l'aménagement d'une pointe bien qu'elle soit plus importante au sein du
Groupe 2b, l'aménagement d'une base plus massive afin d'obtenir une
UTFp.
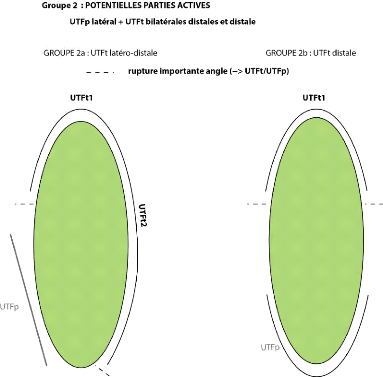
46
Figure 29 UTF Groupe 2
47
Exemples de fiche technique d'une
pièce.
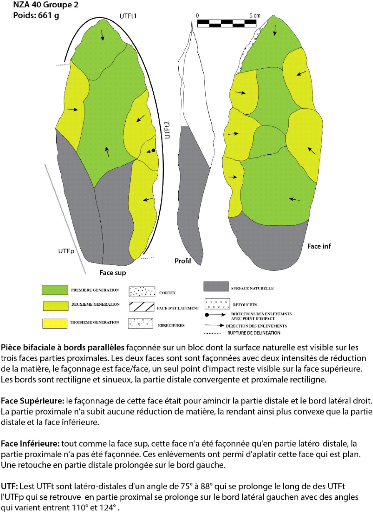
Figure 30 Schéma diacritique NZA 40
Groupe 3 : Pièces bifaciales à bords
parallèles Plano convexe
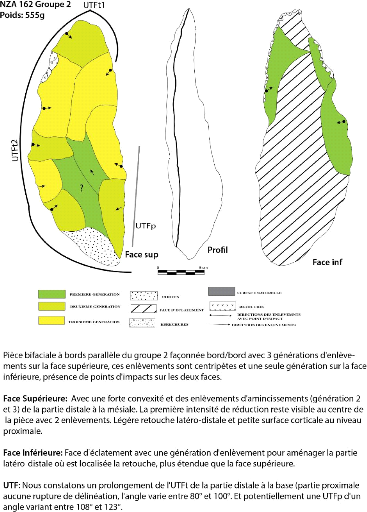
Figure 31 Schéma diacritique de NZA 162
48
49
3. GROUPE 3 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES ET A
SECTION PLANO-
CONVEXE
Numéro des pièces : NZA : 147, 118, 80, 16,
44 & NZK : 136
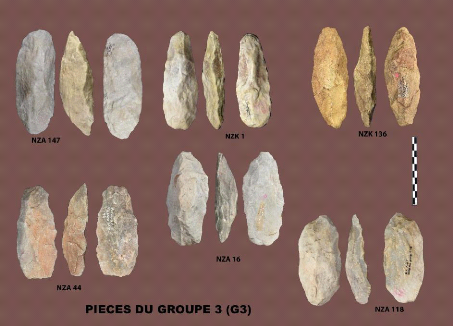
Figure 32 Pièces du Groupe 3. Photos M-J
Angue.
Description générale de la morphologie des
pièces
Le groupe 3 est représenté par six
pièces. Ce sont des pièces bifaciales avec une face
inférieure principalement plane et une face supérieure convexe.
Elles présentent deux plans de symétrie selon l'axe longitudinal
et l'axe transversal mais asymétriques selon le plan d'équilibre
bifacial. Elles présentent une section une section plano-convexe
générale qui tend légèrement vers lenticulaire aux
extrémités. Afin d'orienter nos pièces, nous avons choisi
la partie la plus fine comme extrémité distale et la plus
épaisse comme l'extrémité proximale.
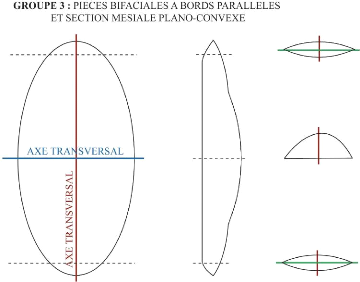
50
Figure 33 Schéma de la structure volumétrique
du Groupe 3
3.1.1. Matières premières
Cet ensemble est représenté par les deux
principales matières premières, à savoir le grès et
le quartzite. Les pièces sont équitablement
représentées. Trois pièces sont en quartzite blanc grenu.
Une pièce NZA 118 présente une variation de couleur de blanc
à gris. Nous avons un soupçon pour la pièce NZA 16
où la texture de cette partie n'est pas la même. Les trois autres
pièces en grès n'ont pas la même couleur, elles vont de
gris à beige avec une texture grenue. NZK 1 semble présenter une
surface naturelle, car les enlèvements les plus rentrants
révèlent sa couleur qui est plutôt beige et la surface qui
la recouvre est blanche, ce qui nous permet de dire que c'est certainement une
plaquette.
3.1.2. Etat des surfaces
Parmi les pièces de ce groupe, aucune ne
présente de cassure distale ni latérale. Un émoussé
important des arrêts est observé sur l'ensemble des pièces.
:
- NZA 147 seule semble très roulé rendant la
lecture de la pièce casi-impossible. Il y a des ébréchures
sur toute la partie distale et le long d'un bord latéral allant
jusqu'à l'extrémité proximale.
51
- NZA 44 a subi une altération de couleur de la roche
devenue rougeâtre sur sa face supérieure.
- NZK 136 présente aussi une altération de la
couleur de la roche, passée à jaunâtre sur l'ensemble de la
pièce mais une partie de la face inférieure a aussi une couleur
marron.
3.1.3. Données métriques
Au vu des indices d'élongation de ce groupe, nous
constatons que ses pièces sont épaisses et peu allongées.
Bien que ce soit toutes des grandes pièces toute supérieures
à 12cm en longueur. Néanmoins ce groupe est moins fin mais plus
allongé comparé à l'ensemble des pièces bifaciales
des sites NZA et NZK.
Tableau 6 Données métriques Groupe 3
|
Groupe 3
|
Longueur
|
Largeur
|
Epaisseur
|
Elongation
|
Elongation
|
|
(face)
|
(profil)
|
|
|
|
Max.
|
22,8
|
9,1
|
7,3
|
2,64
|
4,33
|
|
Min.
|
12,1
|
4,9
|
3,2
|
2,21
|
3,10
|
|
Moyenne
|
15,33
|
6,21
|
4,41
|
2,47
|
3,58
|
Données productionnelles 3.2.1. Les
supports
Trois pièces de notre assemblage façonné
sur toute la périphérie et sur les deux faces n'ont pas pu faire
l'objet d'une identification de support. Deux pièces identifiées
sur éclat et une autre sur plaquette NZK 1.
3.2.2. Les séquences de façonnage
Notre groupe présente deux types d'intensités de
réduction lors du façonnage :
- Une première réduction est faite en deux
générations d'enlèvements (N=4). Sur ces quatre
pièces, trois sont faites en deux générations sur les deux
faces et une présente une séquence de réduction à
deux générations uniquement sur la face supérieure et la
face inférieure avec une génération
d'enlèvement.
- La deuxième séquence de réduction est
un façonnage à trois générations
d'enlèvements sur la face supérieure et deux
générations d'enlèvements sur la face inférieure
(N=2).
52
Le façonnage dominant avec quatre pièces est
alternant. Les pièces ont un fil de coupe de sinueux serré
à sinueux large. Les deux pièces restantes sont
façonnées une face après une autre, une seule face
présente des points d'impacts, ces dernières ont un fil de coupe
sinueux large.
Nous pouvons dire de notre Groupe 3 qu'il témoigne de
différentes méthodes de façonnage. Une diversité
technique au sein de ce petit assemblage qui, nous pouvons déjà
le dire n'est pas différent des deux premiers groupes qui sont eux aussi
diversifiés...
3.2.3. La retouche
Cinq pièces du Groupe 3 ont été
retouchées. Nous avons décidé de les nommer : retouche
périphérique ; retouche proximal et retouche
proximo-latérale.
- NZK 136 est la seule pièce avec une retouche
périphérique et bifaciale. Le long du fil de la pièce nous
retrouvons une retouche très fine au niveau de sa partie distale puis
abrupte dès la partie mésiale et ce jusqu'à la base
proximale.
- Deux pièces NZA 16 et NZA 44 présentent une
retouche principalement proximale unifaciale très abrupte mais pas
envahissante.
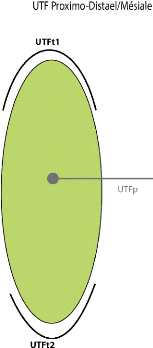
Figure 34 UTF Groupe 3
- NZA 147 et NZA 118 sont des pièces avec
une
retouche unifaciale proximale et latérale fine et non
envahissante.
Description des potentielles parties actives
L'assemblage constituant le Groupe 3 présente un groupe
techno-fonctionnel homogène. Nous notons en premier l'absence de pointe
sur toutes les pièces et sur les deux extrémités,
celles-ci sont arrondi et fines. La partie mésiale est plus convexe que
les autres groupes. Il y a une volonté de façonner les bords et
les extrémités sans couvrir le milieu de la pièce, ce qui
lui procure un bombement particulier. Nous avons déterminé
l'extrémité distale comme l'UTFt1 et l'extrémité
proximale comme l'UTFt2 faisant ainsi de la partie mésiale une UTFp.
Nous pensons qu'il était possible d'utiliser l'une ou l'autre
extrémité comme Unité Techno-Fonctionnelle Transformative
tout en tenant la
53
pièce par sa partie mésiale. Les angles des
bords qui sont sinueux n'ont pas d'angle important pour l'obtention d'un fil
tranchant (100°-120°).
Exemples de fiche technique d'une
pièce
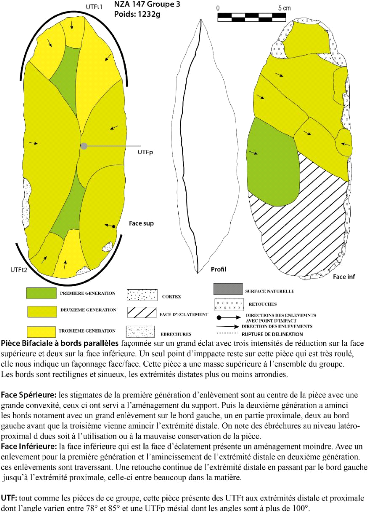
Figure 35 : Schéma diacritique de NZA147
54
4. GROUPE 4 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES A
SECTIONS
LENTICULAIRE ET PLANO-CONVEXE
Numéro des pièces : NZA : 153, 212, 29 &
NZK :3.

Figure 36 Pièces du Groupe 4. Photo M-J Angue.
Description générale de la morphologie des
pièces. (Figure 37)
Le Groupe 4 est représenté par quatre
pièces. Elles sont symétriques selon l'axe transversal mais
présentent aussi une asymétrie selon l'axe longitudinal. La
section de la moitié distale est lenticulaire tandis que la section de
la moitié proximale est plan-convexe. Pour ce groupe,
l'extrémité la plus arrondi est considérée comme
une partie proximale. La face avec une convexité plus importante est la
face supérieure.
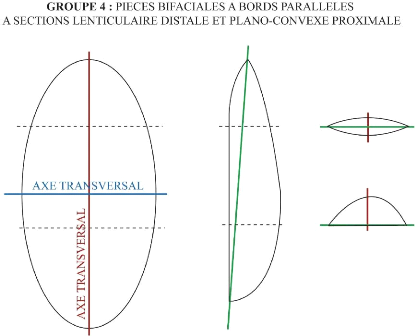
55
Figure 37 Schéma de la structure volumétrique
du Groupe 4
4.1.1. Matières premières
Les matières premières de ce groupe ne sont pas
différentes des autres groupes. Deux pièces sont en grès
de couleur grise à texture grenue. Deux pièces sont d'une
matière première que nous appellerons grés-quartzite car
la texture de celles-ci n'est ni totalement celle d'un grès, ni celle
d'un quartzite. Sa couleur varie de blanche à beige.
4.1.2. Etat des surfaces
Au niveau des surfaces de ces supports, nous observons
différents états de conservation. Deux pièces de notre
assemblage présentent d'importantes ébréchures : une
à l'extrémité distale NZA 153 et l'autre à
l'extrémité proximale, NZA 212. Deux pièces sont
cassées : NZA 153 à l'extrémité proximale et NZK 3
à l'extrémité distale et une seule pièce est
entière, NZA 29. Trois pièces de cet assemblage présentent
un émoussé des bords plus prononcés.
Les pièces du Groupe 4 présentent une patine
différente : une pièce a une patine jaunâtre (NZA 212).
Trois pièces ont une patine rougeâtre avec inclussions de petits
nodules ferreux dans la matière qui pourraient être des
concrétions post dépositionnels.
56
4.1.3. Données métriques
Le Groupe 4 est composé majoritairement de grandes
pièces. Une pièce seule fait moins de 10cm, il s'agit de NZA 212.
Cette dernière, qui est à la fois la moins large et la moins
épaisse est aussi la plus fine et allongée de son groupe. NZA 153
est la pièce dont la longueur, l'épaisseur et la largeur sont
supérieur au reste du groupe.
Si nous comparons ces résultats à l'ensemble des
pièces bifaciales des sites NZA et NZK comme nous l'avons fait avec les
trois premiers groupes, nous remarquerons que les pièces du Groupe 4
sont nettement moins fines que l'ensemble des sites NZA et NZK. L'indice
d'élongation du profil des pièces de ce groupe est de 3,58 tandis
que celui de NZA est de 3,88 et de 4,76 pour NZK. En ce qui est de l'indice
d'élongation de face, le groupe 4 est au-dessus avec un indice de 2,58,
alors que les indices de référence de NZA est de 2,14 et de NZK
est 1,49. Cet assemblage est donc globalement allongé mais robuste de
profil par rapport que l'ensemble des pièces bifaciales des deux
sites.
Tableau 7 Donnée métrique Groupe 4
|
Groupe 4
|
Longueur
|
Largeur
|
Epaisseur
|
Elongation
|
Elongation
|
|
(face)
|
(profil)
|
|
|
|
Max.
|
24,5
|
11
|
7,3
|
3,19
|
4,11
|
|
Min.
|
9,5
|
4,5
|
3,2
|
2,11
|
2,98
|
|
Moyenne
|
16,9
|
6,7
|
4,72
|
2,58
|
3,58
|
Données productionnelles 4.2.1. Les
supports
L'ensemble de nos pièces est façonné sur
éclat, trois pièces présentent une face
d'éclatement en face inférieure. Une pièce présente
une surface corticale à son extrémité proximale. La
pièce NZA 153 (Figure 38) témoigne d'une production de grand
éclat au point où nous sommes demandés s'il n'a pas servi
de nucléus pour débitage d'éclats (<10 cm). Sachant que
l'un n'empêche pas l'autre, cette pièce bifaciale demeure pour
nous une des plus différentes de toutes nos pièces
sélectionnées.
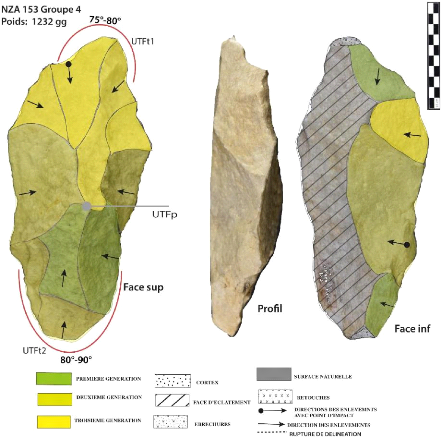
57
Figure 38 Schéma de la pièce NZA 153, grand
éclat.
4.2.2. Les séquences de façonnage
Les pièces du Groupe 4 sont façonnées en
deux générations d'enlèvements : une sur la face
supérieure et une sur la face inférieure. Les méthodes de
façonnage sont identiques à celles du Groupe 1, à savoir
un façonnage alternant par bord. Les deux pièces restantes sont
façonnées par un façonnage successif.
4.2.3. La retouche
Trois pièces du Groupe 4 n'ont pas été
retouchées. Car le façonnage a produit une
délinéation avec un fil sinueux large à laquelle une
retouche n'était peut-être pas nécessaire. Seule NZA 212
présente une retouche qui s'étend de l'extrémité
distale au bord latéral gauche. C'est une
retouche large et étendue dont les négatifs se
distinguent à ceux des enlèvements de façonnage par leur
plus petite taille.
Description des potentielles parties actives
Nous distinguons deux sous-groupes techno-fonctionnels. Le
premier sous-groupe (Groupe 4a) présente des extrémités
proximales rectilignes. Les bords latéraux sont sinueux larges sur un
bord et rectiligne sur l'autre. L'absence d'UTFt latérales et le
bombement dorsal en partie mésiale suggèrent que cette
dernière soit l'UTFp. Le deuxième sous-groupe (Groupe 4b) se
distingue par ses extrémités avec un aménagement proximal
dont les bords sont convergents.
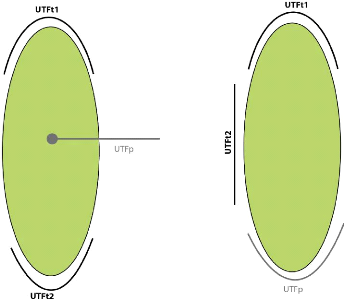
58
Figure 39 Schémas techno-fonctionnels du Groupe 4
Les bords concavo-
convexe présentent une rupture de
délinéation obtenue avec un seule enlèvement au niveau du
bord latérale gauche d'un angle entre 800-950.
Ainsi nous avons déterminé comme UTFt1 l'extrémité
distale en rupture avec l'UTFt2 sur un bord latéral et l'UTFp au niveau
de l'extrémité proximale.
59
Exemple de fiche technique d'une pièce
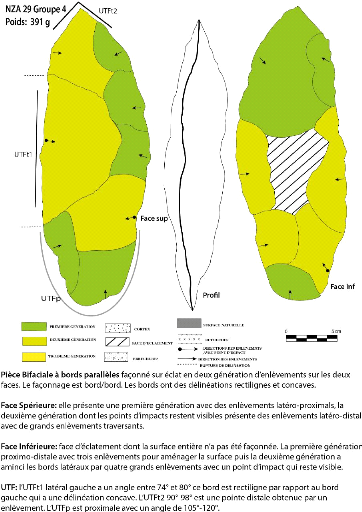
Figure 40 Schéma diacritique NZA 29
60
5. GROUPE 5 : PIECES BIFACIALES A BORDS PARALLELES A
SECTION PLANO-
CONVEXE
Numéros des pièces : NZA : 27 & NZK :
51, 132
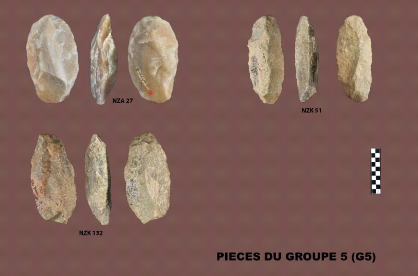
Figure 41 Pièces du Groupe 5. Photo M-J Angue.
Description générale de la morphologie des
pièces
Le groupe 5 est constitué de trois pièces. Ces
trois pièces présentent un plan de symétrie selon l'axe
transversal et deux plans d'asymétrie : un selon l'axe longitudinal et
un selon le plan d'équilibre bifacial. Cela est due à la
morphologie différenciée des bords latéraux : un bord est
à biseau simple tandis que le bord latéral opposé est
à biseau double. Afin d'orienter nos pièces, nous avons choisi
l'extrémité la plus volumineuse comme partie proximale. La face
la plus convexe est considérée comme face supérieure.
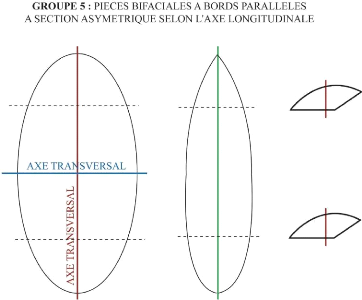
61
Figure 42 - Schéma de la structure du Groupe 4
5.1.1. Matières premières
Les pièces constituant notre assemblage sont toutes en
grès. Les deux pièces de NZK sont de couleur grise et sombre avec
des grains grossiers, une des pièces (NZK 132) a une texture plus
brillante que l'autre. Les stigmates de tailles étant bien lisibles et
sans plans de fracture, nous pouvons dire que ce grès était
adapté à la taille. L'unique pièce de NZA quant à
elle est un grès beige et gris avec des inclusions de couleur blanche,
cette pièce est brillante avec des grains très fin. Ce
grès semble lui aussi bien adapté à la taille.
5.1.2. Etat des surfaces
Les pièces du Groupe 5 sont toutes entières. NZA
132 et NZK 27 présentent une patine superficielle rougeâtre ; NZA
51 présente une altération qui tend vers le noir rappelant
plutôt une exposition à l'air libre avec circulation d'eau tandis
que NZA 27 présente des ébréchures de son
extrémité distale à son bord latéral gauche.
5.1.3. Données métriques
NZA 27 est la pièce de l'assemblage qui présente
toutes les mesures maximales et tous les indices minimaux. Cela fait d'elle la
pièce la plus robuste et la moins allongée de son groupe.
62
La pièce la plus fine et allongée est NZK 132
avec les indices d'élongation les plus élevés.
Globalement, au vu des moyennes des indices de cet assemblage, il en ressort
que ce dernier est moins allongé et robuste par rapport aux
pièces bifaciales des deux sites.
Tableau 8 Donnés métrique Groupe 5
|
Groupe 5
|
Longueur
|
Largeur
|
Epaisseur
|
Elongation
|
Elongation
|
|
(face)
|
(profil)
|
|
|
|
Max.
|
12,1
|
7
|
3,7
|
2,45
|
3,32
|
|
Min.
|
10,17
|
4,6
|
3,1
|
1,72
|
3,27
|
|
Moyenne
|
11,19
|
5,76
|
3,4
|
1,98
|
3,29
|
Données productionnelles 5.2.1. Les
supports
Les trois pièces du Groupe 5 sont
façonnées sur éclats. Les surfaces d'éclatements se
distinguent des surfaces qui ont subi des enlèvements
postérieurs. NZK 51 présente une surface naturelle en partie
mésiale de sa surface supérieure.
5.2.2. Les séquences de façonnage
Cet assemblage, aussi petit soit-il, ne présente pas
une homogénéité dans son intensité de
réduction. Le premier sous-groupe (N=1) présente une seule
génération d'enlèvements sur la face supérieure et
sur la face inférieure. Le deuxième (N=2) présente deux
générations d'enlèvements sur la face supérieure et
une génération sur la face inférieure.
Les deux pièces de NZK ayant les arrêtes
très émoussées, aucun stigmate n'est lisible pour nous
permettre de distinguer quelle face a été façonnée
en premier ou bien si elles ont été façonnées
alternativement. NZA27 quant à elle, est une pièce
façonnée bord/bord c'est-à-dire une face et une autre en
même temps. Les points d'impacts sont restés lisibles sur les deux
faces.
5.2.3. La retouche
Les pièces de ce groupe ne présentent pas de
retouche ou celles-ci ne sont plus lisibles. Seule la pièces NZA 27
présente des ébréchures comme nous l'avions
déjà indiqué plus haut.
63
Description des potentielles parties actives
Nos pièces présentent des
extrémités arrondies qui ne sont pas aménagées, des
bords latéraux rectilignes d'un côté et sinueux de l'autre.
Les faces inférieures ont fait l'objet de grands enlèvements
à la fois pour la moitié proximale plane et la moitié
distale plus convexe. Les bords latéraux où se trouvent la face
plane ont des angles compris entre 80° et 95° nous les avons
considérés comme les UTFt. Pour NZA 27 cet UTFt se prolonge sur
l'extrémité distale. Les bords latéraux où il y a
une convexité en face inférieure ont des angles compris entre
100° et 120°, ce sont les parties considérées comme
UTFp au vu de leur volume plus important. Cette UTFp a été
aménagée par un seul enlèvement d'un côté de
la pièce lui conférent cet épaississement.
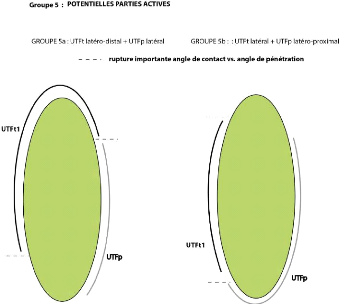
Figure 43 UTF Groupe 5
Exemple de fiche technique d'une pièce
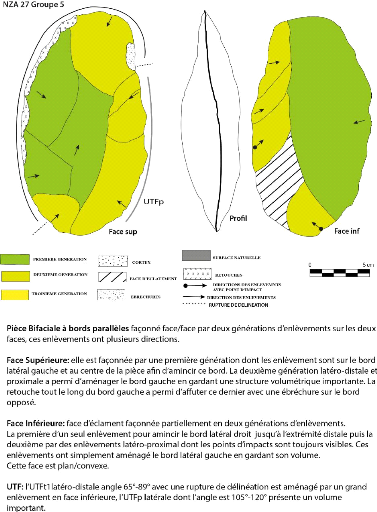
64
Figure 44 Schéma diacritique NZA 27
6. GROUPE 6 : PIECES TRIFACIALES A DOS A BORD BORDS
PARALLELES
Numéros des pièces : NZK : 57 &NZA :
192
Description générale de la morphologie des
pièces
Ce groupe est constitué par une pièce par site.
Ces deux pièces sont asymétriques selon l'axe transversal, l'axe
longitudinal et selon le plan d'équilibre bifacial. Ces pièces
présentent une face supérieure, une face inférieure et un
méplat latéral. La face supérieure est la face la plus
convexe et la partie proximale sera celle qui est également plus
convexe, faisant de la partie distale la plus fine.
6.1.1. Matières premières

Figure 45 Pièces du Groupe 6. Photos M-J
Angue.
65
Les pièces de cet assemblage sont de la même
matière première qui est le grès. NZA 192 est de couleur
gris clair sont mouchetés de grains blancs et la roche est grenue. NZK
57 présente des grains plus fins et de couleur beige, avec
présence de surface naturelle blanche au niveau de
l'extrémité proximale.
6.1.2. Etat des surfaces
Le Groupe 6 ne semble pas homogène dans son état
de conservation. En effet NZA 192 ne présente pas une forte
altération avec une patine jaunâtre sur la surface de la
pièce qui est légèrement émoussée mais
entière. NZK 57 présente une altération de la couleur
uniquement sur la face supérieure, celle-ci est rougeâtre. Elle
est aussi légèrement émoussée.
6.1.3. Données métriques
Le Groupe 6 est constitué de petites pièces
comparées aux groupes précédent, la plus grande fait
à peine 10cm (NZA 192). Cette dernière a les mesures les plus
élevées mais son indice de
66
67
profil indique qu'elle est la plus fine mais pas la plus
allongée. NZK 57, malgré ses mesures les plus petites, semble
être la plus allongé et la plus robuste.
Cet assemblage est donc considéré comme peu
allongée et robuste par rapport à l'ensemble des pièces
bifaciales de ces deux sites qui peuvent être très fines et
très allongées.
Tableau 9 Données métriques Groupe 6
|
Groupe 6
|
Longueur
|
Largeur
|
Epaisseur
|
Elongation
|
Elongation
|
|
(face)
|
(profil)
|
|
|
|
Max.
|
10,4
|
5,3
|
3,3
|
2
|
3,15
|
|
Min.
|
7,6
|
3,8
|
3
|
1,96
|
2,53
|
|
Moyenne
|
9
|
4,55
|
3,15
|
1,98
|
2,84
|
Données productionnelles 6.2.1. Les
supports
Les deux pièces de ce Groupe 6 sont
façonnées sur éclat. NZK 57 présente toujours une
face d'éclatement qui a marginalement été
façonnée. NZA 192 est toujours constitué de son bulbe sur
la face inférieure ainsi que des ondulations qui nous montrent
l'orientation de la pièce qui diffère de l'axe morphologique de
l'outil. En effet le bulbe du support éclat est localisé en
partie distale de l'outil.
6.2.2. La retouche
Les pièces de cet assemblage présentent une
retouche sur le bord latéral gauche. La retouche de NZA 192 est
très fine et rasante le long du fil, celle-ci n'est présente que
sur la face supérieure. NZK 57 présente une retouche bifaciale
pénétrante dont les négatifs se confondraient aux
enlèvements de façonnage.
6.2.3. Les séquences de façonnage
Cet assemblage présente un seul type d'intensité
de réduction, elle se fait en deux générations
d'enlèvement sur la face supérieure. NZA 192 est
façonnée par alternance sur deux surfaces contiguës, la
surface supérieure et le méplat latéral. Cependant, la
face inférieure e n'est pas façonnée NZK 57 qui a subi un
seul enlèvement distal en surface inférieure permettant d'amincir
cette partie de la pièce. Le groupe se distingue donc par des surfaces
inférieures très peu modifiée.
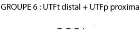

Description des potentielles parties actives
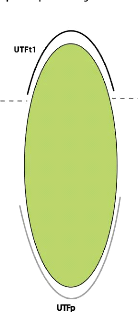
Figure 46 UTF Groupe 6
Les pièces de notre assemblage n'ont pas les même
UTFt. L'aménagement de la partie distale de NZK 57 la rendant plus fine,
démontre une volonté de créer une partie active. L'angle
de cet UTFt distale se situe entre 80° et 90° avant la rupture de
délinéation qui augmente cet angle
jusqu'à 125°.
L'extrémité
proximale étant aussi volumineuse que les deux bords latéraux
dont les angles varient entre 100° et 128° et à la vue du
manque de délinéation, nous avons considéré que
cette partie serait l'UTFp qui se prolongerait d'un bord à un autre en
passant par la partie proximale.
La pièce de NZA 192 présente une seule rupture
de délinéation entre l'extrémité distale non
aménagée et le bord latéral droit. Le bord gauche semble
se prolonger avec la partie distale sans aucune rupture avec celle-ci, ni
même avec la partie proximale aménagée pour garder le
même fil dont les angles se trouvent entre 80° et 98°. Ce
prolongement extrémité distale /bord latéral gauche est
l'UTFt. L'UTFp se localise au bord latéral droit prolongé
jusqu'à la base, cette dernière dont le volume se distingue de
l'UTFt possède des angles entre 100° et 120°.
68
V. INTERPRETATION ET DISCUSSION
1. SYNTHESE DE RESULTATS (TABLEAU 10)
1.1. La production
Au terme de notre étude, nous avons pu observer une
variabilité aussi bien dans la production, dans les morphologies que
dans les supports utilisés. Rappelons que les matières
premières identifiées (grès et quartzite) reflètent
l'environnement local et présentent une aptitude à la taille
similaire, suggérant un faible impact dans la variabilité
productionelle. Néanmoins, elles ont pu induire une variabilité
dans la production des supports (éclats, plaquette et bloc) avec une
dominance nette des supports-éclats (seulement une pièce est
façonnée sur bloc et deux sur plaquette). Le fait que la taille
bifaciale soit intervenue sur ce type de support démontre une
volonté de travailler des supports présentant des critères
volumétriques prédéfinis : de grands éclats
(>10cm) avec deux surfaces opposées, une surface lisse et une surface
bombée (la surface ventrale), ainsi que des bords tranchants.
Pour l'obtention de ces pièces à bords
parallèles, le façonnage est largement bifacial et
périphérique, et se fait à l'aide de deux à trois
générations d'enlèvements, bifaciales ou sur une face.
Cela suggère que les supports ont déjà une structure
volumétrique pré-définie qu'il suffit de façonner
par quelques enlèvements seulement, afin d'obtenir un outil aux
sections, convexités et symétries désirées.
La retouche que l'on observe au sein de certains groupes est
principalement latérale et distale (voire souvent latéro-distale
quand elle se prolonge sans rupture). Les bords latéraux sont ainsi
privilégiés pour la retouche et on y localise des UTFt, pouvant
conduire à des des affutages/réaffutages de ses parties actives.
En outre, quelques pièces du Groupe 1 présentent une retouche
périphérique.
Au final, il semble qu'il n'y ait pas de stratégie
d'aménagement par une retouche standardisée, suggérant
plutôt l'emploi de la retouche pour régulariser les bords.
69
1.2. Les données métriques
(Figure 47)
Les assemblages entiers de pièces
bifaciales à bords parallèles de N'Zako Kono et Ambilo nous
révèlent une variabilité assez importante. En effet, la
diversité de formes liées à la structure
volumétrique a déjà été mise en avant par la
distinction des six groupes morpho-structurels. Cette diversité
morpho-structurelle se dessine à travers l'agencement des
différentes surfaces, des sections et de leurs variations au fil de
l'axe longitudinal. Les données morphométriques quant à
elles, viennent témoigner de la variabilité existante au sein de
chacun des six groupes par des données chiffrées,
quantifiées.
Les indices d'élongation de profil et de face nous
montrent que le Groupe 1 contient les pièces les plus fine et
allongées de tout l'assemblage, le Groupe 6 serait le moins
allongé et le Groupe 5 le plus épais. Le Groupe 4 regroupe les
pièces plus épaisses et allongées.
Ces pièces aux structures différentes n'ont en
commun que leurs bords parallèles, leurs techniques de production et le
fait qu'elles viennent des mêmes sites. A part cela, nous pouvons dire
qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui les éloignent les unes
des autres. Pourtant, elles sont toutes classées dans la typologie
du core-axe.
1.3. Les données
techno-fonctionnelles
L'analyse techno-fonctionnelle que nous avons appliquée
à ce matériel, nous renseigne les différentes UTFt et UTFp
possibles sur ces pièces (Tableau 10). Ces données nous
permettent d'identifier les potentiels objectifs techno-fonctionnels que
peuvent refléter ces outils dit core-axes. Les UTFt se
localisent sur les extrémités distales et proximales avec
aménagement de pointe qui suggère des outils perçants et
des tranchants distaux convexes. Des UTFt sont présentes sur les bords
latéraux avec des délinéations concaves, convexes,
concavo-convexes, rectilignes obtenues par le façonnage et une retouche
irrégulière. Ces différentes morphologies d'UTFt
suggèrent une diversité fonctionnelle au sein des
différents groupes de cet assemblage. En effet l'utilisation de ces
outils peut varier selon les besoins de l'utilisateurs.
Quant aux UTFp, on les retrouve également sur les bords
latéraux avec un façonnage permettant d'aménager une
structure volumétrique qui sera différente de l'autre bord. Leurs
localisations sont aussi mésiale, proximale et
proximo-latérale.
2. COMPARAISON INTRA ASSEMBLAGE... ... de la
production
Le grès est la matière dominante dans les
Groupes 2, 5 et 6 tandis que le quartzite domine dans le Groupe 1. Les Groupe 3
et 4 ont un nombre de pièces égales pour les deux
matières
70
premières. Les Groupes 1et 3 se démarquent quand
même avec deux pièces en plaquette et le groupe 2 est le seul au
sein duquel il y a une pièce taillée sur bloc.
Les groupes 1,2,4 et 5 présentent majoritairement un
façonnage bord /bord lorsque dans le Groupe 6 domine le façonnage
face/face. Le Groupe 4 est impartial les deux techniques de façonnages.
Le Groupe 5 est le seul où l'on retrouve une intensité de
réduction en une génération d'enlèvement sur les
deux faces. Tous les autres groupes sont façonnés avec une deux
générations d'enlèvements non homogènes, car des
fois en face supérieure il y a deux générations et en face
inférieure une seule. Le Groupe 2 présente une réduction
en deux et trois générations d'enlèvements
également non homogènes sur les deux faces. Les Groupes 1 et 3
présentent les pièces les plus retouchées de l'assemblage.
On retrouve plus ou moins de la retouche aussi dans le Groupe 4. Par contre les
Groupes 2, 5 et 6 ne présentent aucune retouche.
Les outils.
Malgré toutes les caractéristiques qu'ont en
commun ces pièces, au niveau fonctionnel, il en ressort une multitude
d'outils possibles. Comme nous l'avons déjà évoqué,
nous pensons que ces pièces auraient pu simplement être des
supports d'outils. La variabilité des Unités Techno-Fonctionnelle
au sein de chaque groupe se dessine aussi sur l'ensemble du corpus (Tableau
10).
En ce qui est des UTF communes, les Groupes 2 et 6
présentent une homogénéité des UTFt distales et
UTFp proximales. Ce sont les seuls à avoir ce couple d'UTF qui montre
que les pièces possèdent au final un seul outil pouvant
être emmanché ou préhensé. Les Groupes 3 et 4 qui
ont des sections plano-convexes sont les deux groupes possédant le
couple UTFt proximale et distale avec une UTFp mésiale. Ces groupes
quant à eux nous montrent des pièces avec deux outils, un en
partie distale et un autre en partie proximale. Ils nous suggèrent soit
un emmanchement mésiale, soit une préhension à cette
partie en alternant l'utilisation des outils par exemple. Les Groupes 1, 2 et 4
ont en commun des UTFp proximal.
Ceci dit il y a des particularités au sein de chaque
groupe tel que le Groupe 5 qui a des pièces avec des UTFt
latéro-distales et latérales combinées à des UTFp
proximo-latérale (le seul groupe à avoir cette UTFp) et
latérale. Les pièces de ce groupe ont un seul outil. Le Groupe 2
est le seul à posséder une UTFt proximo-distale. Le
façonnage ayant aminci l'un des bords latéraux se prolonge
à ses extrémités distales pouvant avoir des angles de
65° pour certaines pièces, cette partie active est opposée
à un autre bord qui le plus souvent a une concentration plus importante
du volume. Ces pièces possèdent des outils pouvant être
tenus à la main. A contrario le Groupe 1 nous montre une
diversité d'outils, c'est le seule Groupe à posséder
des
71
UTFt bilatérales et distales associées à
une UTFp proximale. Le terme de supports d'outils irait bien à ce groupe
dont les pièces pourraient être emmanchées en partie
mésiale ou proximale.
Plusieurs types d'outils suggèrent plusieurs fonctions,
sans des études de tracéologie, nous ne pouvons pas nous
aventurer à affirmer des fonctions pour ces outils. Nous pouvons
émettre des hypothèses nous basant sur le travail ayant
déjà été fait par certains chercheurs tels que
(Mcbrearty and Brooks, 2000; Rots and Van Peer, 2006; Taylor, 2016) mais aussi
nous basant sur notre corpus.
3. CONFRONTATION A LA LITTERATURE EXISTANTE.
Pour une révision de la typologie.
Au regard de toute cette diversité, il convient de
revenir aux questions qui ont motivé ce travail : qu'est-ce que le
core-axe ? Est-il prudent de continuer à appeler toutes ces
pièces bifaciales ayant des bords parallèle core-axe
alors que l'approche typologique est aujourd'hui souvent
considérée comme obsolète? Les core-axes sont-ils
un groupe homogène dans le temps et l'espace ? Les tout premiers
core-axes sangoens sont-ils les mêmes que l'on retrouve au
début de l'Holocène pour les sites tshitoliens ? toutes ces
interrogations nous poussent à penser qu'il serait peut-être tant
de re-définir ce qu'est le core-axe, ou encore faire une
typologie des core-axes en définissant au préalable les
caractères morphométriques, structureles et fonctionnels. Ainsi
nous pourront y voir un peu plus claire sur ces outils emblématiques du
Sangoen-Lupembien.
Nos données obtenues à partir des assemblages de
Nzako suggèrent que cette catégorie d'objets lithiques
présente une grande variabilité productionnelle, et
morphométrique et une importante diversité morpho-structurelle et
techno-fonctionnelle qui s'opposent à la vision homogène des
core-axes rendues par les typologies passées. Cela peut en partie
expliquer le manque de consensus dans les définitions du core-axe
exposées dans la partie II.
72
Tableau 10 Synthèse des données des
groupes
|
GROUPES
|
G 1
|
G 2
|
G 3
|
G 4
|
G 5
|
G 6
|
|
CATEGORIES
|
|
|
Matières premières
Et
Supports
|
Grès
|
+
|
++
|
+
|
+
|
++
|
++
|
|
Quartzite
|
++
|
+
|
+
|
+
|
-
|
-
|
|
Eclat
|
++
|
++
|
++
|
++
|
++
|
++
|
|
Bloc
|
-
|
+
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Plaquette
|
+
|
-
|
+
|
-
|
-
|
-
|
|
Façonnage et retouche
|
Bord/bord
|
++
|
++
|
+
|
++
|
++
|
-
|
|
Face/face
|
+
|
-
|
+
|
+
|
-
|
++
|
|
1 Génération
|
-
|
-
|
-
|
-
|
+
|
-
|
|
2 Générations
|
++
|
+
|
++
|
++
|
++
|
++
|
|
3 Générations
|
+
|
+
|
+
|
-
|
+
|
-
|
|
Retouche
|
++
|
-
|
++
|
+/-
|
-
|
-
|
|
Unités
Techno
Fonctionnelles
|
UTFt latérale
|
-
|
-
|
-
|
-
|
++
|
-
|
|
UTFt bilatérale
|
++
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
UTFt Proximal
|
-
|
-
|
++
|
++
|
-
|
-
|
|
UTFt distale
|
++
|
+
|
++
|
++
|
-
|
++
|
|
UTFt proximo-distale
|
-
|
++
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
UTFt latéro-distale
|
-
|
-
|
-
|
-
|
++
|
-
|
|
UTFp latérale
|
-
|
+
|
-
|
-
|
++
|
-
|
|
UTFp Proximale
|
++
|
++
|
-
|
+
|
-
|
++
|
|
UTFp Proximo-latérale
|
-
|
-
|
-
|
-
|
++
|
-
|
|
UTFp Mésiale
|
-
|
-
|
++
|
++
|
-
|
-
|
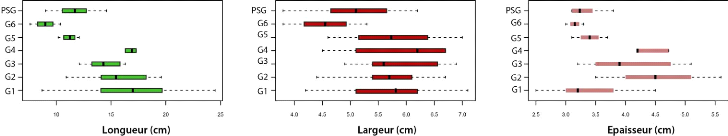
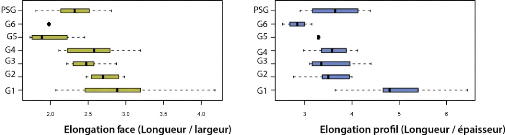
73
Figure 47 Variabilité morphométrique du corpus
Nzako.
74
La question de l'industrie forestière et de
l'emmanchement
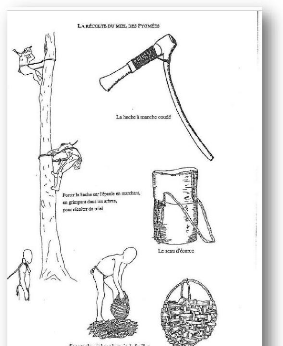
Depuis près d'un siècle, les pièces
bifaciales du Bassin du Congo, et notamment les core-axes ont
été attribuées à une spécialisation
régionale de l'outillage au couvert forestier ; c'est l'hypothèse
d'une « industrie forestière », d'un Middle Stone Age
régional dit « faciès forestier » (Clark, Cormack, and
Chin 2001; Taylor 2016; Mortelmans 1957; Breuil n.d.). Cela est dû
à la concentration des pièces dites core-axes dans le
bassin du Congo, où l'on retrouve la grande forêt
équatoriale - qui d'ailleurs laissait sceptique quant au fait d'y
trouver des sites archéologiques à cause de la densité de
son couvert végétal. Cela peut également se comprendre par
l'importance des parallélismes établies entre les outils des
populations sub-actuelles et actuelles et préhistoriques de la
région d'étude. Néanmoins, notre étude
techno-fonctionnelle qui nous révèle plusieurs type d'UTFt nous
rappelle que plusieurs fonctions sont potentiellement associées à
ces outils. En effet, il est possible qu'ils aient servi pour le travail du
bois comme le suggèrent Barham 2001; Clark 1963; Clark and Brown 2001
mais ils auraient tout aussi bien servi pour découper de la viande ou
des végétaux, pour creuser le sol, ou creuser les mines pour
extraction de matière première comme le suggère Rots and
Van Peer 2006 pour les core-axes de Sai Island.
Figure 48 : Exemples d'utilisation d'une herminette par
les populations chasseurs-cueilleurs de République Centrafricaine
(Bahuchet, 1989)

La herminette qui est un outils que l'on compare souvent
aux core-axes (MATOUMBA, 2013) comme à celle de Mumyeme
(Pétrequin and Pétrequin 1990) suggèrent des outils de
type core-axe qui sont emmanchés.
Des populations actuelles de
chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale utilisent aussi un outil
qui s'apparente souvent au core-
75
axe pour son profil symétrique. Ces haches
sont mise en action par leur manche coudé et servent pour plusieurs
fonctions (Bahuchet, 1989.)
Cette question nous semblent importante dans le contexte
actuel du débat à savoir : quel rôle joue l'Afrique
centrale dans le développement de comportement moderne des Homo
sapiens ? L'emmanchement avait déjà été
suggéré à Kalambo Falls (Barham and Smart, 1996; Taylor,
2016) et a Sai Island (Rots and Van Peer, 2006). Qui sont les outils
emmanchés omniprésents en Afrique centrale dans les
activités que ce soit, agricoles ou de prédation pour
l'acquisition des ressources sauvages ou encore les activités
artisanales comme la sculpture ? Nous pensons qu'en effet ces pièces
bifaciales à bords parallèles auraient pu être
emmanchées tels que l'on proposé certains auteurs.
Nos pièces présentent une seule partie
préhensive qui est toujours associée à une ou à
plusieurs parties actives. Aussi la récurrence d'un méplat
proximal au sein du Groupe 1 interroge davantage cet emmanchement. A partir de
l'étude des différentes Unités Techno-Fonctionnelles de
notre assemblage nous avons combiné des couples d'UTFt et UTFp qui nous
permette de proposer des possibilités d'emmanchement de ces
pièces bifaciales à bords parallèles.
Nous avons cinq cas qui se présentent à nous. le
cas 1 concerne des outils avec des UTFt proximo-distales dont l'emmanchement
pourrait être mésiale avec différentes positions du manche.
Le cas 2 dont l'UTFp est latérale s'associe à des UTFt
latérales et latéro-distales , ici l'outil peut être
emmanché ou tenu à la main. Les cas 3 et 4 intègrent des
outils avec des UTFt bilatérales et distales, ceux-ci peuvent
potentiellement avoir le même type d'emmanchement au regard de leurs UTFp
proximale et proximo-mésiale. Tout cela suggère une multitude
d'outils possibles...
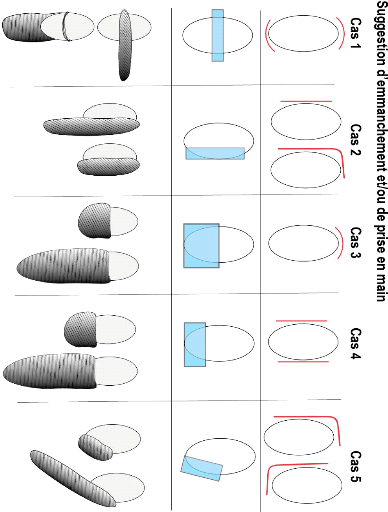
76
Figure 49 Suggestion d'emmanchement
77
78
| 


