|
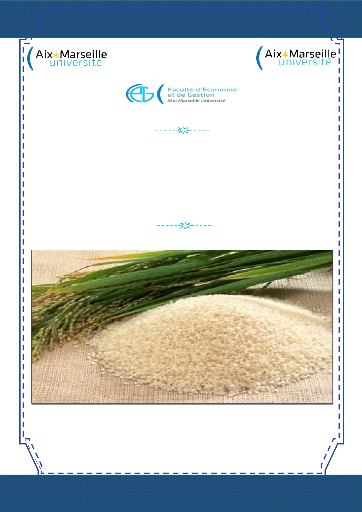
INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS
MASTER 2
Economie appliquée
Spécialité
Management et évaluation des projets et des
programmes publics
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
Analyse des programmes de développement du
secteur
agricole, particulièrement des programmes
d'autosuffisance
en riz pour l'amélioration de la
sécurité alimentaire
au Sénégal.
Présenté et soutenu publiquement par
:
M. ABDOUL AZIZ SY DIOUF
Professeur encadrante :
Mme KANDIL FERIEL
Septembre 2015
1
Dédicaces
Je dédie ce travail à mon
défunt père EL Hadji Gorgui DIOUF que la mort nous a
arraché à mon
absence, juste un mois après avoir
quitté le pays. Ta disparition fait un immense vide dans nos
vies.
Puisse le Bon Dieu le Tout Puissant t'accorder son Pardon, sa Sainte
Miséricorde et t'accueillir en
son Vaste Paradis.
MES PARENTS
ü Notre défunt père, conseiller, ami,
confident El Hadji Gorgui DIOUF que la mort nous a arraché le 17 octobre
2013, un modèle d'homme honnête, juste, pieux, digne,
généreux, cultivé, courageux qui n'a jamais cessé
durant sa mission sur terre à nous enseigner le comportement d'un bon
musulman. Durant toute sa vie, il n'a ménagé aucun effort pour la
réussite de ses enfants. Rien ni personne, même pas la mort, ne
pourront effacer en chacun de nous l'empreinte que tu as laissée. Que
Dieu le Miséricordieux l'accueille dans son paradis !!!
ü Notre mère Fatou GAYE dit Néné Gaye,
une femme très brave qui a sacrifié toute sa vie pour notre
réussite pour les nobles valeurs qu'elle ne cesse de nous inculquer et
pour tous les sacrifices qu'elle consent.
Puisse Dieu lui prêter longue vie et
l'assister constamment !
MES FRERES ET SOEURS : Mamadou, Maty,
Mame Seynabou, Ismaïla, Mandeme, Gnilane, Mass,
Ibrahima, Adja,
Mouhamed, Mingue et Fallou pour leur soutien indéfectible aux moments
les plus
difficiles. Vous qui m'avez appris le sens de la famille, de
l'unité, de la fraternité; reconnaissez ici
mon profond amour.
Ma reconnaissance envers vous est inestimable. Puissent-ils
bénéficier
éternellement de l'assistance et de la
protection divine.
Que Dieu nous garde encore uni pendant longtemps,
dans le bonheur, la prospérité et la
réussite.
MA GRAND-MERE, MES ONCLES, TANTES, COUSINS, COUSINES,
NEVEUX ET AMIS.
!!! A tous ceux qui n'ont jamais cessé de me
soutenir et de m'encourager !!!
2
Remerciements
Ce travail est l'aboutissement d'un long cheminement scolaire
qui a nécessité de la part de nombreuses personnes des sacrifices
pour notre personne et qu'il nous fait plaisir de remercier.
Nous exprimons notre profonde gratitude à Madame Feriel
KANDIL, Responsable du Master MEPPP pour son soutien, sa disponibilité,
son assistance et sa participation active dans la formation.
Nous exprimons également nos sincères remerciements
à Monsieur Raymond MALLET, Coordonnateur de Stages et à travers
lui, l'ensemble du personnel enseignant, technique et administratif de
l'I.S.M.O.
Nous tenons à rendre un hommage à :
? Dr BESNARD Olivier, PDG de l'entreprise
BIOPHYTECH et maître de stage ;
? Jean Alain EYSSERIC, Agronome formé
en Bio-Dynamie et consultant à BIOPHYTECH ; ? Dr BILLAZ
René Président AVSF, anciens chercheur à IRAM et directeur
scientifique du CIRAD.
Nos remerciements vont à l'endroit de tout le personnel
de l'incubateur d'entreprises BOND'INNOV de Paris, de l'IRD Bondy et de
Dakar.
!!! A tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réussite de ce document !!!
3
Résumé
Ce document de mémoire porte sur l'analyse des
programmes de développement du secteur agricole, particulièrement
des programmes d'autosuffisance en riz pour l'amélioration de la
sécurité alimentaire au Sénégal. Cette étude
concerne principalement le secteur rizicole.
Au terme de notre analyse, nous avons pu constater que
l'agriculture occupe près de 60% de la population active du pays,
contribue pour environ 16,7% à la formation du PIB et constitue la base
des sources de revenu de la majorité des pauvres des zones rurales. Sa
place est considérable dans la réalisation de la
sécurité alimentaire des ménages, compte tenu de
l'importance de l'autoconsommation dans les stratégies des
ménages agricoles. Le développement de l'agriculture notamment de
l'agriculture irriguée, est une priorité constante des pouvoirs
publics et pourrait permettre à d'améliorer la
sécurité alimentaire et jouer un rôle majeur dans la lutte
contre la pauvreté.
Le secteur rizicole occupe une place de choix dans
l'économie sénégalaise et la consommation alimentaire des
ménages urbains et ruraux. Le riz occupe une place de choix dans les
habitudes alimentaires du pays à tel point que l'alimentation des
ménages sénégalais est aujourd'hui dominée
incontestablement par ce produit : 80 kg contre 90 kg pour toutes les autres
céréales confondues à savoir le mil, le sorgho, le
maïs, le blé et le fonio. Le Sénégal est loin de
couvrir le 1/3 des besoins estimés à 900.000 tonnes par an, avec
une demande qui ne cesse d'augmenter.
Cependant, le secteur rizicole est confronté à
de nombreuses problèmes telles que les baisses de la
pluviométrie, de la productivité et des productions, la faiblesse
des rendements, la dégradation et l'appauvrissement des sols, la faible
disponibilité des intrants de qualité, la vétusté
de l'équipement agricole, la régression du paquet technologique,
le niveau faible d'encadrement des producteurs, la faiblesse des revenus
limitant la capacité d'épargne et d'investissement, les
coûts élevés des facteurs de production limitant
l'intensification agricole, les marges maigres et l'endettement des
producteurs...
Pour remédier à cette situation, des actions
concrètes doivent être engagés pour passer à des
systèmes plus productifs. De plus, les contraintes actuelles, sociales,
économiques et politiques, doivent être levées. Des
changements de politiques seront nécessaires non seulement pour obtenir
de plus forts rendements mais également pour encourager les
investissements dans des secteurs de l'agriculture, particulièrement au
secteur rizicole sénégalais qui regorgent beaucoup de
potentialités en termes de disponibilité de terres et d'eau du
Fleuve Sénégal sur toute l'année.
4
Summary
This brief paper is an analysis of the development programs of
the agricultural sector, particularly rice self-sufficiency programs for
improving food security in Senegal. This study mainly concerns the rice
sector.
At the end of our analysis, we observed that agriculture
occupies almost 60% of the active population, contributes about 16.7% to the
GDP and is the basis of the sources of income of the majority of rural poor.
His place is considerable in achieving household food security, given the
importance of consumption in the strategies of farm households. The development
of agriculture including irrigated agriculture, is an ongoing priority of the
government and could help to improve food security and play a major role in the
fight against poverty.
The rice sector occupies a prominent place in the Senegalese
economy and food consumption of urban and rural households. Rice occupies a
prominent place in the eating habits of the country to the point that the power
of Senegalese households is now unquestionably dominated by product: 80 kg
against 90 kg for all other cereals combined namely millet, sorghum, maize,
wheat and fonio. Senegal is far from covering 1/3 of needs estimated at 900,000
tonnes per year, with demand keeps increasing.
However, the rice sector is facing many problems such as
decreases in rainfall, productivity and production, low yields, degradation and
soil depletion, the low availability of quality inputs, the obsolescence
agricultural equipment, regression of the technology package, the low level of
support for producers, low incomes limiting the savings and investment
capacity, high cost of production factors limiting agricultural
intensification, the thin margins and indebtedness of farmers ...
To remedy this situation, concrete actions must be incurred to
move to more productive systems. Furthermore, current, social, economic and
political, must be lifted. Policy changes will be needed not only to get higher
yields but also to encourage investment in agriculture, particularly the
Senegalese rice sector teeming lot of potential in terms of availability of
land and water of the River Sénégal throughout the year.
5
SOMMAIRE
Sigles et abréviations 9
Introduction 13
PARTIE I : Présentation de l'étude
15
I. Contexte de l'étude 15
II. Problématiques 16
III. Objectifs 18
IV. Méthodologie 19
4.1 Méthode et outils 19
4.1.1 Revue bibliographique 19
4.1.2 Entretiens préliminaires et réunions 20
4.1.3 Outils de collectes de données 20
4.1.4 Analyse et Traitement des données, rédaction
20
PARTIE II : Présentation générale du
riz 21
I. GENERALITES 21
II. DESCRIPTION BOTANIQUE 21
1. Morphologie du riz 21
2. Description des organes 22
2.1 Les organes végétatifs 22
2.2 Les organes de reproduction 22
3. Principaux types de riz et catégories des grains 24
4. Types de riziculture 24
5. Cycle de développement 24
6. Ravageurs et maladies du riz 25
6.1 Les ravageurs 25
6.2 Les maladies 25
PARTIE III : Présentation de la structure
d'accueil 27
I. Généralités 27
II. Domaines d'expertises ou de compétences 27
III. Partenaires en Afrique de l'Ouest 28
PARTIE IV : Place et état des lieux du secteur
rizicole au Sénégal 29
I. Importance de la filière rizicole au
Sénégal 29
II. La production rizicole nationale 29
1.
6
Productions en quantités 29
2. Zones et systèmes de production 31
3. Organisation, structuration et acteurs de la filière
32
4. Circuits de commercialisation du riz 32
III. Evolution de la demande en riz et dépendance aux
importations 33
1. Evolution de la demande en riz 33
2. Dépendance aux importations 34
IV. Analyse SWOT de développement du secteur 35
PARTIE V : Politiques, stratégies de
développement agricole et sécurité
alimentaire 37
|
I.
|
Contexte et enjeux
|
37
|
|
II.
|
|
La sécurité alimentaire
|
38
|
|
1.
|
Recours à l'Agriculture pour assurer la
sécurité alimentaire
|
38
|
|
2.
|
Contraintes à la réalisation de la
sécurité alimentaire
|
39
|
|
2.1
|
Contraintes naturelles
|
39
|
|
2.2
|
Contraintes socio-économiques
|
39
|
|
2.3
|
Contraintes politiques
|
39
|
|
3.
|
Opportunités qui s'offrent à nous
|
40
|
|
3.1
|
Le Retour à l'agriculture
|
40
|
|
3.2
|
Démocratie
|
40
|
|
3.3
|
Réformes économiques
|
40
|
|
3.4
|
Mondialisation et échanges régionaux
|
41
|
|
3.5
|
Nouvelles technologies de l'information et la biotechnologie
|
41
|
|
4.
|
Mise en place d'indicateurs d'évaluations performants
|
42
|
|
5.
|
Difficultés dans le suivi de la sécurité
alimentaire continuent d'entraver la mise en place de
|
politiques efficaces 42
6. Enjeux du développement rural pour la
sécurité alimentaire au Sénégal 43
IV. Analyse de l'évolution des politiques de
développement agricole au Sénégal depuis
l'indépendance à nos jours 43
1. Politiques Agricole (P.A), 1958 43
2. Etatisation à outrance création de l'ONCAD
(1966), Création de la SONACOS (1975) et de
la SONAGRAINE (1981-1988) 44
3. Nouvelle Politique Agricole (NPA, 1984) 45
4. Lettres et Déclarations de Politique de
Développement Agricole (LDPDA, 1994), et
Programme d'Ajustement du Secteur Agricole (PASA, 1995) 47
5. Programme de Relance Agricole 1997, Accord Etat-CNIA,
1997-2001 47
6. 7
Elaboration d'une Lettre de Politique de Développement de
la Filière Arachide (LPDFA,
2003) 49
7. La Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP, 2004) 50
8. Le Plan Retour Vers l'Agriculture (Plan REVA, 2006), La
Grande Offensive Agricole pour
la Nourriture et l'Abondance (GOANA, 2007) 52
9. SCA, 2008 54
10. Programme National d'Investissement Agricole (PNIA, 2010),
Programme Agricole
Quinquennal (PAQ, 2011) 56
11. Stratégie Nationale de Développement
Economique et Social (SNDES, 2012), Document de Politique Economique et Sociale
(DPES, 2011), Documents de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP, 2000) 58
12. Programme d'Accélération de la Cadence de
l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS, 2014)
60
PARTIE VI : Politiques et stratégies de
développement de la filière rizicole
63
I. Importance du riz et enjeux de développement de la
filière 63
1. Place du riz dans la production nationale
sénégalaise 63
2. Place de choix de la filière dans l'élaboration
de stratégie et politique de développement
pour l'amélioration de la sécurité
alimentaire et réduction de la pauvreté. 63
3. Analyse de l'évolution de la consommation et
dépendance aux importations 64
II. Analyse de l'impact et situation actuelle du Programme
National
d'Autosuffisance en Riz à l'horizon 2017
65
1. Programme National d'Autosuffisance en Riz à l'horizon
2017 (PNAR, 2017) 65
2. Des résultats déjà prometteurs pour la
réussite du PNAR à l'horizon 2017 66
Conclusion 68
Recommandations 70
Bibliographie 73
Annexes 77
8
Liste des tableaux et figures
Figure 1: Plant de riz 21
Figure 2 : Production en tonnes de riz au
Sénégal depuis 2004 30
Tableau 1 : Production, Superficies, Rendements,
Demande intérieure de 2004 à 2015 30
Figure 3 : Carte de la Vallée du Fleuve
Sénégal 31
Figure 4 : Schéma du circuit de
commercialisation du riz local 33
Figure 5 : Evolution de la production par rapport
à la demande, de 2004 à 2014 34
Figure 6 : Importations de riz en quantités
(Tonnes) et en valeurs (FCFA), de 2002 à 2013 35
9
Sigles et abréviations
ANREVA : Agence Nationale de gestion et de
mise en oeuvre du Plan REVA
ANSD : Agence Nationale de Statistique et de
la Démographie
APCR : Association des Présidents de
Communautés Rurales
ARFA : Association pour la Recherche et la
Formation en Agro-Ecologie
AVSF : Agronomes et
Vétérinaires sans Frontières
BM : Banque Mondiale
BNDS : Banque Nationale de
Développement du Sénégal
CA : Chiffre d'Affaires
CEDEAO : Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest
CNCAS : Caisse Nationale de Crédit
Agricole du Sénégal
CNIA : Comité National
Interprofessionnel de l'Arachide
CEDEAO : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
CIRAD : Centre de coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement.
CNCR : Conseil National de Concertation et de
Coopération des Ruraux
CNUCED : Conférence des Nations Unies
sur le Commerce Et le Développement
DAC : Domaines Agricoles Communautaires
DAPSA : Direction de l'Analyse, de la
Prévision et des Statistiques Agricoles
DISEM : Division des Semences
DPES : Document de Politique Economique et
Sociale
DSRP : Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté
FAO : Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
FIDES : Fond d'investissement pour le
Développement Economique et Social
10
FIL : Fonds d'investissement local
FMI : Fonds Monétaire International
FNOPS : Fédération Nationale
des Opérateurs Privés du Sénégal
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
GOANA : Grande Offensive Agricole pour la
Nourriture et l'Abondance
IAMM : Institut Agronomique
Méditerranéen de Montpellier
IESOL : Intensification Ecologique des Sols
cultivés en Afrique de l'Ouest
INERA : Institut de l'Environnement et de
Recherches Agricoles
INRA : Institut National de la Recherches
Agronomique
IPAR : Initiative Prospective Agricole et
Rurale
IRAM : l'Institut de Recherches et
d'Applications des Méthodes de développement
IRD : Institut de Recherche pour le
Développement
ISRA : Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles
LOASP : Loi d'Orientation
Agro-Sylvo-Pastorale
LPDA : Lettre de Politique du
Développement Agricole
LPDFA : Lettre de Politique de
Développement de la Filière Arachide
NPA : Nouvelle Politique Agricole
OCDE : Office Nationale de Coopération
et d'Assistance pour le Développement
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement
ONCAD : Office national de coopération
et d'assistance pour le Développement
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PA : Politiques Agricole
PAP : Plan d'Actions Prioritaires
PAQ : Programme Agricole Quinquennal
11
PAS : Politique d'Ajustement Structurel
PASA : Programme d'Ajustement Structurel du
secteur Agricole
PDDAA : Programme Détaillé de
Développement de l'Agriculture en Afrique
PDG : Président Directeur General
PI : Plan d'Investissement
PIB : Produit Intérieur Brut
PISA : Programme d'Investissement du Secteur
Agricole
PNAR : Programme National d'Autosuffisance en
Riz
PNDA : Programme National de
Développement Agricole
PNIA : Programme National d'Investissement
Agricole
PNIR : Programme National d'Infrastructures
Rurales
PRACAS : Programme
d'Accélération de la Cadence de l'Agriculture
Sénégalaise
PREF : Programme de Redressement Economique
et Financier
PSAOP : Programme des Services Agricoles et
d'appui aux Organisations de Producteurs
PSE : Plan Sénégal Emergent
REVA : Retour Vers l'Agriculture
SAED : Société
d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta du fleuve
Sénégal
SCA : Stratégie de Croissance
Accélérée
SENCHIM : Sénégalaise de
Chimie
SISMAR : Société Industrielle
Sahélienne de Matériels agricoles et de représentations
SNDES : Stratégie Nationale de
Développement Economique et Social
SODEFITEX : Société de
Développement et des Fibres Textiles du Sénégal
SODEVA : Société de
Développement et de Vulgarisation Agricole
SOMIVAC : Société de Mise en
Valeur de la Casamance
12
SONACOS : Société Nationale de
Commercialisation des Oléagineux du Sénégal
SONAR : Société Nationale
d'Approvisionnement du Monde Rural
SPIA : Société des Produits
Industriels et Agricoles
SRP : Stratégie de Réduction de
la Pauvreté
STN : Société des Terres
Neuves
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UE : Union Européenne
UM : Université de Montpellier
UNCAS : Union Nationale des
Coopératives Agricoles du Sénégal
UNIS : Union Nationale des
Interprofessionnels de Semences
13
Introduction
L'analyse de la situation et des perspectives sur la
sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest montre un écart
croissant entre les besoins de consommation et de nutrition et les
disponibilités alimentaires au niveau global des pays, des
ménages et des individus. La faiblesse des gains de productivité
dans la production alimentaire et des capacités d'importation
constituent les contraintes majeures à la réalisation de la
sécurité alimentaire. Les aléas climatiques, le faible
ratio capital-travail, combiné avec un faible niveau de capital humain,
et les fortes fluctuations des prix constituent des obstacles importants
à la croissance des productivités agricoles La réalisation
de la sécurité alimentaire demeure un défi à
relever en Afrique subsaharien notamment au Sénégal où une
frange importante de la population est sous-alimentée.
Au Sénégal, le secteur agricole occupe une place
déterminante au plan de l'économie nationale, de l'emploi, des
revenus des ménages ruraux, de l'équilibre de la balance
commerciale et de la sécurité alimentaire des populations.
L'agriculture sénégalaise demeure encore un des secteurs les plus
importants de l'activité économique du pays. Elle occupe
près de 60%1 de la population active du pays et continue de
rester le principal levier pour le développement des autres secteurs et
contribue pour 16,7% 2 à la formation du produit
intérieur brut et absorbe en moyenne environ 10% du programme
d'investissements publics3. La croissance du secteur agricole
devient ainsi le préalable à l'amélioration de la
situation alimentaire.
La place de l'agriculture est considérable dans la
réalisation de la sécurité alimentaire des ménages,
compte tenu de l'importance de l'autoconsommation dans les stratégies
des ménages agricoles et du rôle joué par les
marchés de proximité des produits vivriers pour nourrir les
populations urbaines. Cependant, le secteur agricole sénégalais
reste toujours confronté à une crise profonde et persistante qui
se traduit notamment par la stagnation de la production agricole globale, par
la précarité de la situation alimentaire de nombreux
ménages et par une forte prévalence de la pauvreté en
milieu rural. Toutefois, le retour de l'agriculture comme secteur prioritaire
dans les programmes des Etats et des bailleurs de fonds, l'avènement de
la démocratie, les changements de politiques économiques, la
mondialisation de l'économie, les nouvelles technologies de
l'information et de la biotechnologie constituent des atouts pour la
1 Document de Stratégie pour la croissance et
la Réduction de la Pauvreté II, 2006-2010 & DIAO, 2009.
2 ANSD, Agence Nationale de Statistique et de la
Démographie, 2012.
3 Document de Stratégie pour la croissance et
la Réduction de la Pauvreté II, 2006-2010
14
relance de la production agricole dans la sous-région
en l'occurrence au Sénégal en vue d'amélioration de la
sécurité alimentaire.
Le riz est une matière première agricole
emblématique de la consommation alimentaire des pays pauvres notamment.
Cette céréale est consommée à la fois par les pays
producteurs, exportateurs et importateurs. Comme toute matière
première agricole, le riz est soumis à des rendements
quantitativement bornés et surtout aux aléas climatiques. Le
chaos économico financier de 2008 nous invite à
réfléchir sur le rôle des politiques publiques dans le
maintien de la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres.
L'exemple du riz en Afrique subsaharienne notamment au Sénégal
est intéressant à plusieurs titres : les comportements des
économies locales sont multiples, certains pays ayant maintenu et
développé une culture locale du riz tandis que d'autres ont
joué la carte de l'importation.
Cette présente étude va donc permettre de
réaliser l'état de la situation actuelle du secteur agricole
sénégalais, d'analyser l'évolution des politiques et
stratégies de développement agricole depuis l'indépendance
à nos jours, de démontrer l'importance et la priorité
accordée à la filière rizicole pour assurer la
sécurité alimentaire et d'analyser la situation actuelle des
programmes encours de soutien au secteur rizicole. Ainsi, nous allons à
travers ce document procéder dans un premier temps à la
présentation de l'étude, de la filière
étudiée et de l'organisme d'accueil. Dans un deuxième
temps, nous aborderons la place et priorité accordé à la
filière riz ainsi que la nécessité de développer le
secteur rizicole au Sénégal. Enfin, nous allons procéder
à l'analyse l'importance et le rôle des politiques et
stratégies de développement du secteur rizicole ainsi que leurs
impacts sur la sécurité alimentaire.
15
PARTIE I : Présentation de l'étude
I. Contexte de l'étude
En Afrique de l'Ouest, le secteur agricole occupe une place
déterminante au plan des économies nationales, de l'emploi, des
revenus des ménages ruraux, de l'équilibre de la balance
commerciale et de la sécurité alimentaire des populations et des
Nations. La place de l'agriculture est considérable dans la
réalisation de la sécurité alimentaire des ménages,
compte tenu de l'importance de l'autoconsommation dans les stratégies
des ménages agricoles et du rôle joué par les
marchés de proximité des produits vivriers pour nourrir les
populations.
La réalisation de la sécurité alimentaire
durable en Afrique sub-saharienne notamment au Sénégal demande
une croissance rapide du secteur agricole. L'analyse de la situation et des
perspectives sur la sécurité alimentaire montre un écart
croissant entre les besoins de consommation et de nutrition et les
disponibilités alimentaires des ménages. La faiblesse des gains
de productivité dans la production alimentaire et des capacités
d'importation constituent les contraintes majeures à la
réalisation de la sécurité alimentaire. La croissance du
secteur agricole devient ainsi le préalable à
l'amélioration de la situation alimentaire.
Cependant, les aléas climatiques, le faible ratio
capital-travail, combiné avec un faible niveau de capital humain, et les
fortes fluctuations des prix constituent des obstacles importants à la
croissance des productivités agricoles. Le retour de l'agriculture comme
secteur prioritaire dans les programmes de développement,
l'avènement de la démocratie, les changements de politiques
économiques, la mondialisation de l'économie, les nouvelles
technologies de l'information et de la biotechnologie constituent des atouts
pour la relance de la production agricole sénégalaise.
Le Sénégal, comme la plupart des autres pays
subsahariens, fait face à une situation alimentaire relativement
difficile. L'écart entre la production nationale et les besoins
croissants de la population n'a pas cessé de se creuser au fil des
années. Seule une stratégie d'augmentation rapide de la
productivité agricole est à même d'enclencher un processus
de croissance économique rapide mieux repartie nécessaire
à la réalisation de la sécurité alimentaire et
à la lutte contre la pauvreté. Ainsi, le Sénégal a
pris l'option de faire de l'agriculture le principal levier de son
développement économique et social compte tenu de son importance
dans
16
l'atteinte de la sécurité alimentaire. Dans ce
secteur agricole, le riz constitue une denrée stratégique majeure
dans les options de politique macro-économique.
Le riz occupe une place de choix dans les habitudes
alimentaires du pays à tel point que l'alimentation des ménages
sénégalais est aujourd'hui dominée incontestablement par
ce produit. Le Sénégal est loin de couvrir le tiers des besoins
en riz qui sont estimés à 900.000 tonnes par an. La demande du
marché national ne cesse d'augmenter. Ainsi, à l'horizon 2017,
les besoins de consommations des ménages sont estimés à
1,6 millions de tonnes soit environ 1,08 millions de tonnes de riz
blancs4. Le développement de l'agriculture, et notamment de
l'agriculture irriguée en l'occurrence de la riziculture, devient alors
une priorité constante des pouvoirs publics.
II. Problématiques
Base de l'alimentation et un des secteurs les plus importants
de l'activité économique, l'agriculture occupe près de 60%
de la population active du pays, contribue pour environ 16,7% à la
formation du PIB et constitue la base des sources de revenu de la
majorité des pauvres des zones rurales. Elle constitue un secteur de
création de richesse et de réduction de
l'insécurité alimentaire au Sénégal, en particulier
pour les populations rurales. En effet, la population sénégalaise
étant estimé à 12,874 millions d'habitants connaît
un taux de croissance annuel de 2,5%. Elle serait de 15,7 millions en 2020 et
18,9 millions en 20305. Toutefois, le Sénégal devra
faire face à l'augmentation de la pauvreté et
l'insécurité alimentaire en développant le secteur
agricole notamment la riziculture. L'agriculture dispose d'un important
potentiel pour contribuer significativement à l'augmentation des revenus
des ménages et à la réduction de
l'insécurité alimentaire du pays.
Le développement du secteur rizicole doit permettre
d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, de lutte
contre la pauvreté et de développement rural que s'est
fixé le pays. La place de l'agriculture est considérable dans la
réalisation de la sécurité alimentaire des ménages,
compte tenu de l'importance de l'autoconsommation dans les stratégies
des ménages agricoles et du rôle joué par les
marchés de proximité des produits vivriers pour nourrir les
populations urbaines. Dans une région où le seuil de
pauvreté dépasse les 40% de la population, les conditions de
marché et les efforts engagés durant la dernière
décennie, ont pourtant permis de
4, DIOUF W. (Février 2015), Coordonnateur
Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR) & KANTE S. (Mars 2015),
Directeur de la SAED, Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement
Rural 5 PSE, 2014 : Prévisions ONU
17
rétablir la compétitivité de la
production locale, de productivité avec un rendements de 6 Tonnes/ha et
de créer les conditions favorables à de nouveaux investissements
dans l'agriculture irriguée6. Le développement de
l'agriculture, et notamment de l'agriculture irriguée, est une
priorité constante des pouvoirs publics et pourrait jouer un rôle
majeur dans la lutte contre la pauvreté et à améliorer la
sécurité alimentaire.
Cependant, l'agriculture notamment le secteur rizicole est
confronté à de lourdes tendances telles que la baisse de la
pluviométrie, la baisse de la productivité et des productions, la
faiblesse des rendements, les marges maigres des prix aux producteurs,
l'endettement croissant des populations rurales; des contraintes techniques que
constituent la dégradation et l'appauvrissement des sols, la faible
disponibilité de semences de qualité, la vétusté du
matériel agricole, la régression du paquet technologique, le
niveau faible d'encadrement ; et des contraintes financières et
économiques par la faiblesse des revenus limitant la capacité
d'épargne et d'investissement, les coûts élevés des
facteurs de production limitant l'intensification agricole, l'endettement des
producteurs...
Ces tendances et contraintes continuent de peser sur ses
performances. Conjuguées à d'autres facteurs à savoir la
mauvaise organisation des circuits de commercialisation, l'enclavement des
zones de production, le manque d'infrastructures de stockage et de
transformation, toutes ces faiblesses sont à l'origine du
déséquilibre financier et de l'absence de
compétitivité des filières dont la filière rizicole
et expliquent, pour une large part, la très forte prévalence de
la pauvreté en milieu rural. En outre, le pays reste dépendant
des importations, pour satisfaire une demande en constante augmentation du riz.
La part des quantités de riz importé représente 80% de la
consommation nationale en riz alors que la production nationale n'en couvre que
30%.
Entre 1961 et 2012, les importations en riz ont grimpé
de plus de 700%. D'où cette dépendance de l'extérieur de
plus en plus accrue une denrée aussi stratégique, ce qui expose
le Sénégal à une "précarité de l'offre et
à la saignée des devises". Les importations de riz coûtent
cher au Sénégal, se situant chaque année autour de 124
milliards de FCFA environ plus de 189 millions d'euros soit le cinquième
environ du budget national qui est à l'ordre de 2.800 milliards FCFA,
équivalent à plus de 4,2 milliards d'euros. De 130 milliards de
francs CFA injectés dans l'importation de riz en 2005, on est
passé à 179 milliards en 20097. Avec une moyenne de
6 AFD Agence Française de Développement
(2011)
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/18901
7 DIOUF W. (Février 2015), Coordonnateur
(PNAR), Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural
18
834.484 tonnes par an sur la période 2004 à
2013, les importations de riz se chiffrent en moyenne, à 165 milliards
FCFA par an8. Les fortes potentialités hydro-agricoles de la
vallée du fleuve Sénégal avec une superficie de 240.000 ha
permettraient pourtant de couvrir environ 70% des besoins nationaux. Seulement
25% de la superficie soit 60.000 ha aménagées et mises en valeur,
ne permette de couvrir qu'une part des besoins de consommation et contraint le
Sénégal à dépendre majoritairement des importations
de riz asiatiques.
Ces importations restent toujours maintenues à un
niveau élevé durant cette décennie, malgré les
efforts fournis pour développer de la production locale avec un fort
incident sur la balance commerciale représentant ainsi 7% des
importations totales et 33% des importations de biens alimentaires9.
Cette dépendance alimentaire du Sénégal vis-à-vis
des importations, est donc structurelle. La variation des prix internationaux
du riz rend le Sénégal particulièrement vulnérable
d'autant plus que la part du riz dans les consommations progresse
d'année en année. La sécurité alimentaire
dépend donc aujourd'hui d'une relance de la production nationale de
céréales dont le riz est l'élément principal. Pour
corriger cette situation, le gouvernement sénégalais avait mis en
place des programmes de développement de la filière rizicole,
visant à atteindre l'autosuffisance en riz, dont le PNAR qui vise une
production de 1,6 million de tonnes de paddy, soit 1,080 million de tonnes de
riz blanc à l'horizon 201710.
III. Objectifs
L'objectif général de cette étude est de
réaliser une analyse technico-économique des dossiers de
financements de la recherche ou du transfert de technologie en lutte biologique
dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au
Sénégal. Il s'agit de façon plus spécifique :
" d'étudier les différentes filières
agricoles notamment la filière rizicole,
" de diagnostiquer le secteur agricole
sénégalais
" d'étudier l'évolution et
réaliser l'état des lieux des politiques de développement
agricole. " d'analyser les politiques de développement
du secteur agricole.
" de réaliser un état des lieux de
la situation d'insécurité alimentaire.
" d'analyser les programmes d'appui au
développement du secteur rizicole pour la sécurité
alimentaire.
8 IPAR, Etat des lieux des impacts des importations de
riz sur la commercialisation du riz local. Janvier 2015.
9 Agence Nationale de Statistique et de la
Démographie : Note d'Analyse du Commerce Extérieur, 2006-2013
10 DIOUF W. (2015), Coordonnateur Programme National
d'Autosuffisance en Riz (PNAR), Ministère de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural
ü
19
de participer à l'élaboration, la rédaction
et la finalisation des documents de synthèse. IV.
Méthodologie
Dans cette partie, sera décrit la méthode et les
outils qui seront utilisés pour répondre à la question
centrale de l'étude : Pourquoi les politiques de développement
n'ont toujours pas parvenues à développer l'agriculture
sénégalaise notamment le secteur rizicole pour l'atteinte de
l'autosuffisance en riz, afin de contribuer à l'amélioration de
sécurité alimentaire des populations ; et quels devenir pour les
programmes d'appui au secteur rizicole.
4.1 Méthode et outils
La démarche méthodologique adoptée s'est
articulée autour de la revue bibliographique, de l'identification et de
la collecte des données disponibles au niveau de l'entreprise ou en
dehors relatives au domaine de l'étude, des entretiens avec des
responsables des structures partenaires et des personnes ressources
évoluant et/ou travaillant dans le domaine des filières et du
développement durable dans les zones rizicole, de l'analyse et le
traitement des données et de la rédaction des documents. Cette
démarche a conduit ainsi, à :
? quantifier la production et localiser les
zones de production rizicole.
? analyser les systèmes de production et
identifier les acteurs des filières
? identifier et caractériser les acteurs
et/ou partenaires,
? décrire et quantifier les importations
de riz,
? analyser l'impact des importations du riz sur
l'économie nationale
? analyser la demande des consommateurs de riz
sur le marché nationale
? de réaliser l'analyse SWOT du secteur
agricole notamment rizicole
? de réaliser les situations actuelles et
perspectives des programmes actuels de soutien au
développement du secteur rizicole.
4.1.1 Revue bibliographique
La revue bibliographique est faite au niveau des
bibliothèques (IAMM, CIRAD, IRD, INRA, UM1, SUPAGRO), du centre de
documentation de la société Biophytech, de l'Agence Nationale de
Statistique et de la Démographie (ANSD), de la Direction de l'Analyse,
de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA), de l'Institut
Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), de la
Société nationale d'Aménagement des Terres du Delta et de
la Vallée du Fleuve Sénégal (SAED), à la douane
sénégalaise et à travers l'internet. Elle aura pour
20
objectif de permettre une meilleure compréhension du
sujet à partir d'analyses documentaires, mais également
d'informations à partir de la collecte de données disponibles
relatives au sujet: documents de projets, rapports d'études, bilans
disponibles, comptes rendus de réunions, articles etc.
4.1.2 Entretiens préliminaires et
réunions
Les premiers entretiens et réunions se sont
déroulés à la société Biophytech et
auprès de certaines personnes ressources PDG de l'entreprise ;
Président AVSF, chercheur et ancien directeur scientifique du CIRAD,
à l'Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de
développement (IRAM) du Sénégal; des Partenaires de
l'entreprise, etc..., des responsables des associations et des structures
sénégalaises du secteur agricole notamment les structure d'appui
au développement rizicole. Ces entretiens et réunions ont permis
d'avoir un aperçu et une vision plus large du fonctionnement des
différentes filières en l'occurrence de la filière
rizicole, des programmes élaborés par l'Etat en vue de
développer le secteur rizicole, d'identifier les différentes
acteurs oeuvrant pour le développement de la filière, en vue de
réaliser l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017 pour contribuer
à assurer la sécurité alimentaire.
4.1.3 Outils de collectes de données
Des guides d'entretiens spécifiques aux acteurs ont
été élaborés durant les trois premières
semaines du stage. Ils ont été soumis aux différents
acteurs, lors des entretiens dans le but de collecter le maximum d'informations
relatif aux besoins de la présente étude.
4.1.4 Analyse et Traitement des données,
rédaction
L'ensemble du travail d'analyse et de traitement des
données se fait surtout avec l'aide du logiciel tableur Excel.
La rédaction du document et la présentation s'effectueront
respectivement avec l'aide des logiciels Word et PowerPoint.
21
PARTIE II : Présentation générale
du riz
I. GENERALITES
Le riz est la céréale la plus cultivée
et la plus importante dans le monde. Il entre dans l'alimentation humaine et
constitue une nourriture de base pour la grande partie de la population. Pour
plus de la moitié de la population mondiale, le riz ne fournit pas moins
de 50 % des calories de l'alimentation. Le riz est une graminée,
autogame, de grande taille, qui croît plus facilement sous les climats
tropicaux. C'est une plante qui pousse dans des environnements forts divers,
mais croîtra plus rapidement et plus vigoureusement en milieu chaud et
humide. Les variétés cultivées dans la plupart des pays
appartiennent au genre Oryza, comptant une vingtaine d'espèces
dont deux seulement présentent un intérêt agricole pour
l'homme : Oryza sativa, riz commun asiatique présent dans la
plus part des pays rizicoles dans le monde et dont la quasi-totalité des
variétés cultivées lui appartienne, grâce notamment
à la grande plasticité de cette espèce et à ses
caractéristiques gustatives ; Oryza glaberrima, espèce
annuelle originaire d'Afrique occidentale, du Niger au
Sénégal.
II. DESCRIPTION BOTANIQUE
1. Morphologie du riz
On distingue deux sous espèces : Oryza japonica
dont les grains sont ronds et la paille courte ; et Oryza indica
avec des grains longs et minces et une tige de grande taille.

Figure 1: Plant de riz 11
11 Source : CNUCED Conférence des Nations Unies
sur le Commerce Et le Développement, 2011
Http://Www.Unctad.Info/Fr/Infocomm/Produits-Agricoles/Riz/Description/
22
2. Description des organes 2.1 Les organes
végétatifs
- La racine : au début de la
germination, la première racine est la radicule. Pourvue tout d'abord
d'un manchon de poils absorbants, elle se ramifie dès qu'elle atteint 2
à 3cm de longueur et constitue les racines primaires issues du grain.
Ces racines ont une vie éphémère. C'est surtout dans les
15 premiers centimètres du sol qu'il y a plus de racine. Des racines
secondaires apparaissent au cours de la croissance de la plante. Elles prennent
naissance sur les premiers bourgeons (noeuds) de la base de la tige qui peuvent
se développer sur des noeuds supérieurs de la tige et formant de
véritables racines adventives. En tout, un pied de riz comprend plus de
2000 racines, dont chaque racine porte 10 à 30 radicelles et ces
dernières portent elles-mêmes de très nombreux poils
absorbants.
- La tige : la première ébauche
de la tige au moment de la germination est la tigelle. Elle est entourée
à sa sortie de l'embryon par un fourreau de couleur pâle, la
coléoptile. La première feuille apparaît après la
coléoptile d'une forme cylindrique. A maturité, la hauteur de la
tige se mesure à partir du niveau du sol, c'est à dire du collet,
à l'extrémité des panicules. La tige est divisée en
entre-noeud, court à la base et plus grand vers le sommet. L'entre-noeud
donne des tiges secondaires, puis tertiaires, etc. formant le tallage du riz.
Une touffe de riz a de 3 à 60 tiges qui peuvent atteindre de 50 cm
à 1,5m de long selon les variétés.
- Les talles : à la partie
inférieure de la tige primaire, et à la base de chaque feuille,
se trouve un bourgeon qui normalement donne naissance à une tige
secondaire, ou talle. Les bourgeons de ce talle donnent naissance à des
tiges tertiaires, quaternaires, etc. C'est l'ensemble de ces talles qui
constitue, à partir d'un seul plant, la touffe de riz.
- La feuille : une tige de riz fournit au
cours de sa croissance 10 à 20 feuilles dont 5 à 10 seulement
vivent et les autres se dessèchent au fur et à mesure du
développement de la plante. La dernière feuille avant la panicule
s'appelle feuille paniculaire. Les principaux organes de la feuille sont : le
limbe, la gaine dont la séparation est marquée par une ligule et
une auricule. Les feuilles ont 8 à 15 mm de large et de 30 cm à
1m de long suivant les variétés.
2.2 Les organes de reproduction
- La panicule : elle a une longueur de 10
à 40 cm. La description et la reconnaissance d'une variété
reposent principalement sur la morphologie de la panicule. Sa taille est
limitée par
23
le noeud de la feuille paniculaire à sa partie
inférieure et par le dernier grain à la partie supérieure.
Le pédoncule ou collet est la partie comprise entre le noeud paniculaire
et la première ramification ; l'axe qui le prolonge et qui porte les
ramifications s'appelle rachis. La limite entre le pédoncule et le
rachis est marquée par le noeud paniculaire. Sur le rachis se trouvent
les ramifications primaires ou racènes, se subdivisant en ramifications
secondaires ou racémules. Les racémules supportent les
épillets ou grains, eux-mêmes rattachés au racémules
par un pédicelle.
- L'épillet : son nombre est variable
et peut atteindre une centaine communément il est appelé grain et
rattaché aux racémules par un pédicelle. La forme du
pédicelle (droit ou oblique) détermine la plus ou moins grande
facilité du grain de pouvoir se détacher de la panicule. Les
variétés à pédicelle oblique et épais sont
difficiles à battre. L'épillet porte deux glumes à la
partie inférieure. Le grain lui-même est enveloppé par deux
glumelles qui donnent la balle de riz au moment du décorticage. A
l'extrémité supérieure de l'épillet, la
réunion des deux glumelles forme le bec ou apex. La barbe ou aristation
est le prolongement de la nervure centrale de la glumelle inférieure.
Certaines variétés ont des épillets barbus. Elles sont
appelées aristes et celles sans barbes sont dites mutiques. Les
glumelles sont, suivant les variétés plus ou moins
épaisses ce qui a pour effet d'agir sur la durée de la
germination, le poids spécifique du paddy et son rendement à
l'usinage (en moyenne 100 kg de paddy contiennent 20 kg de balles).
L'épaisseur des glumelles joue également un rôle de
protection contre la pénétration des insectes du grain
(charançon).
- La fleur : chaque épillet
possède une fleur. Elle est autogamie, c'est à dire
présentant des organes mâles et femelles. Les organes mâles
comprennent six étamines. Les organes femelles sont constitués
par l'ovaire surmonté de deux stigmates plumeux. La période de
fécondation s'appelle anthèse. Le développement de
l'ovaire, après fécondation, donne naissance au grain comportant
le caryopse avec ses téguments et l'embryon.
- Le grain ou paddy : c'est le fruit obtenu
après la fécondation de l'ovaire. Le grain de riz est
constitué par les enveloppes glumes et glumelles, les téguments,
le caryopse ou albumen contenant de l'amidon et l'embryon. Le riz cargo est le
grain débarrassé de ses enveloppes externes, après
décorticage. Le riz blanchi est le grain débarrassé de ses
téguments après blanchissage. Les téguments donnent le son
et la farine. Sur la partie externe du caryopse, on trouve le tégument
ou péricarpe. Ce tégument coloré en rouge donne les
variétés dites "riz rouge ". Et cette couleur disparaît
plus ou moins pendant l'opération de blanchissement.
3. 24
Principaux types de riz et catégories des
grains
Il existe plusieurs types de riz dont les principaux sont
constitués par le riz brun ou riz complet qui est un riz entier
débarrassé de son enveloppe extérieure fibreuse et non
comestible ; le riz décortiqué et poli appelé riz blanc ;
le riz avec une couche de son rouge appelé riz rouge ; le riz noir. Sous
le son se trouve un grain blanc. Il existe d'autres types de riz comme le riz
arborio ; les riz aromatiques, parfumés naturellement sont beaucoup plus
savoureux que les autres variétés de riz étant
donné leur goût particulier. Le riz basmati est l'un des plus
connus et les plus appréciés ; le riz à parfum de jasmin
est aussi très estimé. Les catégories de grains peuvent
être regroupées selon leurs dimensions : le riz à grain
long supérieur à 6 mm, le riz à grain moyen entre 5
à 6 mm, le riz à grain court ou riz à grain rond de 4
à 5 mm.
4. Types de riziculture
La culture du riz, ou riziculture, est pratiquée dans
un éventail très large de conditions climatiques et
hydrologiques. Cette diversité des milieux s'accompagne d'une grande
diversité des pratiques culturales et des variétés
utilisées. On distingue deux grands écosystèmes rizicoles
en fonction du régime hydrique : les rizières
caractérisés par la présence temporaire d'une lame d'eau
qui couvrent 88% des superficies rizicoles; et les écosystèmes
non aquatique où le riz est cultivé, comme les autres
céréales, sur des sols exondés et drainés et qui
représentent 12% des superficies mondiales et 40% en Afrique. Ainsi,
différentes types de cultures sont pratiquées : la riziculture
inondée de bas-fond, la riziculture en terrain non-inondé, la
riziculture irriguée et la riziculture en eau profonde. La culture du
riz en terrain non-inondé est la plus ancienne ; mais elle ne produit
pas les énormes rendements fournis par les rizières
inondées, qui se sont imposées partout où le climat le
permet.
5. Cycle de développement
D'un point de vue agronomique, on peut scinder le cycle
végétatif du riz en trois phases : la phase
végétative, la phase reproductive et la phase de maturation. La
phase végétative s'étend de la germination à la fin
du tallage, période de croissance où le riz a la
possibilité d'émettre des tiges secondaires et tertiaires donnant
naissance à autant de panicules. La phase reproductive comporte
l'initiation paniculaire, la montée des panicules dans les gaines
appelée montaison, l'émergence des panicules appelée
épiaison, la floraison et la fécondation.
Le cycle végétatif des variétés
actuelles oscille entre 90 et 120 jours en fonction de la
variété, de la température et de la sensibilité
à la longueur du jour. Selon la durée du cycle
végétatif, on
25
a généralement les variétés de riz
précoce ou de cycle court 90 à 120 jours, de riz de cycle moyen
120 à 150 jours.
6. Ravageurs et maladies du riz 6.1 Les
ravageurs
Les ravageurs du riz sont très nombreux, en particulier
les insectes. On estime ainsi à une centaine le nombre d'espèces
d'insectes qui attaquent le riz, dont une vingtaine causant des pertes
économiques significatives. En Asie, les pertes de récoltes
occasionnées par les différents types de ravageurs (virus,
bactéries, champignons, insectes, et deux groupes d'adventices). Ainsi,
les mauvaises herbes causent 10 à 20 % de pertes de récoltes,
divers champignons pathogènes 5 à 10 %, certains insectes 0,1
à 5 %, des bactéries 0,1 à 1 %, et une maladie virale
moins de 0,1 %12. En effet, il existe de nombreux insectes nuisibles
ou ravageurs qui peuvent endommager gravement ou détruire une culture de
riz ou une récolte. Ce sont principalement les nématodes, les
acariens, des insectes tels que les coléoptères, les
orthoptères, les hémiptères, les
lépidoptères, les diptères, les thysanoptères.
La plupart de ces insectes ravageurs ne sont nuisibles pour la
culture de riz que durant un stade précis de leur développement.
Cependant, tous les insectes ne sont pas tous des ravageurs pour la culture du
riz. Certains peuvent réduire ou contrôler la population de
ravageurs. Il s'agit des insectes auxiliaires regroupant principalement les
insectes entomophages parasites et les insectes entomophages prédateurs.
D'autres provoquent des dégâts à presque tous les stades de
la culture du riz, en dévorant les grains après semis, en
déracinant les jeunes plantes à la germination, en suçant
les grains au stade laiteux et en les dévorant à la
maturité. Les dégâts peuvent être très
importants, atteignant la quasi-totalité de la récolte en
l'absence de mesure de protection. Parmi ces ravageurs, nous pouvons citer les
oiseaux granivores, les rongeurs.
6.2 Les maladies
La plupart des maladies du riz sont d'ordre
bactériennes, fongiques, virales, des maladies diverses et
désordres physiologiques. Les principales catégories de
pathogènes qui sont à l'origine des maladies sont les
champignons, les bactéries, les virus et les nématodes. Ces
pathogènes se propagent en général à
l'intérieur ou sur les semences et plants infectés ou encore sont
disséminés par le vent, l'eau, par le biais d'animaux ou de
l'homme. Au Sénégal, les
12 IRD, Mars 2000 : « Mesurer Les Nuisances Des
Ravageurs Du Riz En Asie Tropicale Pour Etablir Des Priorités De Lutte
».
principales maladies du riz sont la pyriculariose, le
flétrissement des gaines, l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et la
pourriture des gaines13. Certains microorganismes ne sont cependant
pas des nuisibles mais sont des auxiliaires reconnus ; c'est le cas de la
bactérie Bacillus thuringiensis qui attaque des populations
d'insectes ravageurs. En dehors des maladies parasitaires causées par
les organismes vivants, le riz peut être affecté par des
dysfonctionnements physiologiques dus à des carences ou toxicités
d'éléments nutritifs.
26
13 Diarra, 1992
27
PARTIE III : Présentation de la structure
d'accueil
I. Généralités
Localisée dans le Parc Scientifique Agropolis à
Montferrier-sur-Lez, l'entreprise Biophytech a été
créée par M. Olivier Besnard, Docteur ès sciences. Depuis
20 ans, les laboratoires Biophytech développent des solutions innovantes
de biocontrôle et biofertilisation, par des produits issus de
procédés biotechnologiques (fermentations, extractions, etc...).
Ce sont notamment des micro-organismes bénéfiques, tels que le
champignon Trichoderma
sp. et de biomolécules qui
sont découvertes, caractérisées chimiquement,
formulées et expérimentées agronomiquement.
Trichoderma est un champignon filamenteux cosmopolite très
abondant dans les sols, les humus et sur les débris
végétaux en décomposition. Le genre Trichoderma
regroupe un ensemble de champignons imparfaits saprophytes qui se
retrouvent couramment dans le sol, sur le bois mort, les débris
végétaux et les organes aériens des plants.
Bien qu'il soit considéré comme un contaminant
universel, Trichoderma peut être utilisé en lutte
biologique contre des champignons phytopathogènes tels que Botrytis
cinerea ou Sclerotinia sclerotiorum... Trichoderma a la
capacité d'attaquer les agents pathogènes via différents
modes d'action : l'antibiose, la compétition, le parasitisme... Les
colonies de Trichoderma ont une croissance très rapide et envahissent
facilement les milieux de culture. L'enrichissement des composts avec le
Trichoderma et son utilisation comme amendement organique permet
d'améliorer la qualité du sol et de stimuler le
développement et la défense naturelle des plantes.
II. Domaines d'expertises ou de
compétences
Basée sur les derniers concepts de la recherche
agronomique, Biophytech spécialisée dans les services de de
recherche et développement dans le domaine de la protection des
végétaux, valorise des brevets avec l'INRA-Supagro, le CIRAD et
l'IRD, qui emploie 4 collaborateurs pour un CA de 300 K€ en ventes
produits.... Les brevets et publications sont une preuve du potentiel
d'innovation élevé de la société. Biophytech
réalise des travaux scientifiques et de tests en conditions
réelles d'inventer une gamme de produits basée sur des plantes et
extraits végétaux et destinés à la protection des
cultures. Elle sélectionne, produit par fermentations et vulgarise
l'emploi de micro-organismes fongiques afin de fertiliser et protéger
les plantes.
28
Ainsi, elle vise à contribuer à une agriculture
durable en rendant ses produits disponibles pour les agriculteurs et les
producteurs de fruits et légumes.
Son investissement dans la recherche et le
développement lui ont permis d'asseoir sa maitrise dans le domaine des
microorganismes d'intérêt agronomiques et des métabolites
de protection des plantes. Dans l'objectif d'apporter son expertise dans la
protection des cultures, et plus particulièrement sur les
microorganismes bénéfiques, tels que le champignon
Trichoderma sp. dont de nombreuses études ont mis en avant le
rôle d'agent de biocontrôle, Biophytech s'investit à la
recherche et le développement dans le domaine des microorganismes
d'intérêt agronomiques et des métabolites de protection des
plantes à travers l'amélioration de la qualité des
composts par adjonction de micro-organismes du genre Trichoderma.
III. Partenaires en Afrique de l'Ouest
Dans le but de promouvoir des alternatives aux produits
phytosanitaires chimiques par la lutte biologique et de vulgarise l'emploi de
micro-organismes fongiques afin de fertiliser et protéger les plantes
par l'adoption de pratiques agro-écologiques dans le souci du respect de
l'environnement, Biophytech a été amené à
développer des partenariats avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est
ainsi qu'elle a commencé à opérer des processus de
transfert de technologie dans trois pays : le Burkina-Faso, le
Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Au Burkina, un GIE dénommé BIOPROTECT- B a
été créé entre Biophytech et l'ONG ARFA à
Fada N'Gourma, pour faciliter le transfert de technologies par la mise en
commun de moyens des deux sociétés fondatrices. Il
développe de nouvelles formules de pesticides, de fertilisation des sols
et de protection biologique des cultures et participe également à
la formation de maraîchers locaux à la protection des
récoltes avec des solutions préservant les sols. Un consortium a
été créé avec d'autres acteurs de la filière
: deux ONG en France AVSF & MICROFEL, deux centres publics de recherche
agronomiques INERA & IRD, deux unions de producteurs Burkinabés
«Neerbuli » & « Maasom ».
Au Sénégal, le laboratoire mixte international
« IESOL » associe l'ISRA et l'IRD. C'est une plateforme scientifique
et technique, et de formation en science du sol pour une augmentation de la
production agricole et la préservation de l'environnement en Afrique de
l'Ouest. Les recherches menées ont pour objectif finalisé de
contribuer au développement d'une ingénierie écologique
dans la gestion des sols cultivés.
29
Chapitre IV : Place et état des lieux du secteur
rizicole au Sénégal
I. Importance de la filière rizicole au
Sénégal
La filière rizicole occupe une place de choix dans
l'économie sénégalaise et la consommation alimentaire des
ménages urbains et ruraux. Depuis l'indépendance en 1960, la
consommation de riz au Sénégal a augmenté de près
de 1000% en quatre décennies et se situe actuellement à environ
à près d'un million de Tonnes. L'accroissement
démographique et l'urbanisation croissante avec le changement de
comportements alimentaires ont augmenté les besoins de consommation en
riz qui atteignent aujourd'hui 74 kg par personne par année et supplante
désormais les céréales sèches qui constituaient la
base de l'alimentation en milieu rural.
Le riz occupe une place de choix dans les habitudes
alimentaires du pays à tel point que l'alimentation des ménages
sénégalais est aujourd'hui dominée incontestablement par
ce produit : 80 kg contre 90 kg pour toutes les autres céréales
confondues à savoir le mil, le sorgho, le maïs, le blé et le
fonio. Le Sénégal est loin de couvrir le tiers des besoins en riz
qui sont estimés à 900.000 tonnes par an. Pour obtenir une tonne
de riz blanc, il faut une production de 1,48 tonne de riz paddy. La demande du
marché national ne cesse d'augmenter. Ainsi, à l'horizon 2017,
les besoins de consommations des ménages sont estimés à
1,6 millions de tonnes soit environ 1,08 millions de tonnes de riz
blancs14.
II. La production rizicole nationale 1. Productions en
quantités
La production nationale de riz s'est nettement
améliorée durant ces dernières années, passant de
190500 tonnes de paddy en 2006 à près de 630.000 tonnes en 2014,
soit 380.000 tonnes de riz blanc environ. Beaucoup de facteurs dont
l'augmentation des superficies emblavées, l'intensification des
cultures, l'amélioration de la productivité sont à
l'origine de cette progression.
14, DIOUF W. (Février 2015), Coordonnateur
Programme national d'autosuffisance en riz (PNAR) & KANTE S. (Mars 2015),
Directeur de la SAED, Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement
Rural
30
Tableau 1 : Production, Superficies, Rendements, Demande
intérieure de 2004 à 2015
|
Années
|
Superficies (ha)
|
Rendements (Kg/ha)
|
Productions
Paddy (T)
|
Equivalent
riz blanc (T)
|
Demande
(T)
|
Taux de
couverture
|
|
2004/05
|
81 486
|
2 476
|
201 744
|
133 151
|
782 219
|
17%
|
|
2005/06
|
97 779
|
2 854
|
279 080
|
184 193
|
832 974
|
22%
|
|
2006/07
|
85 037
|
2 240
|
190 493
|
125 725
|
896 123
|
14%
|
|
2007/08
|
80 312
|
2 408
|
193 379
|
127 630
|
921 538
|
14%
|
|
2008/09
|
125 329
|
3 257
|
408 219
|
269 425
|
970 972
|
28%
|
|
2009/10
|
139 388
|
3 602
|
502 104
|
331 398
|
1 010 215
|
33%
|
|
2010/11
|
147 208
|
4 103
|
604 043
|
398 668
|
1 063 302
|
37%
|
|
2011/12
|
109 177
|
3 717
|
405 824
|
267 844
|
1 105 543
|
24%
|
|
2012/13
|
117 729
|
3 989
|
469 649
|
309 968
|
1 161 839
|
27%
|
|
2013/14
|
108
|
4 018
|
436 153
|
287 861
|
1 215 784
|
24%
|
|
2014/15
|
|
|
630 000
|
|
|
|
En 2013, elle avait atteint 436.153 tonnes de paddy contre une
production annuelle moyenne de 483.555 tonnes sur une période de cinq
dernières années, de 2009 à 2013. En outre, la production
locale, obtenue essentiellement à partir du riz irrigué dans le
nord et le sud du pays, s'est accrue de 28 % en 2014 et est en constante
hausse15.
|
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100
000
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004/05
|
2005/06
|
2006/07
|
2007/08
|
2008/09
|
2009/10
|
2010/11
|
2011/12
|
2012/13
|
2013/14
|
2014/15
|
Figure 2 : Production en tonnes de riz au
Sénégal depuis 2004 16
15 DIOUF W. (Février 2015), Coordonnateur
Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR), Ministère de
l'Agriculture et de l'Equipement Rural.
16 Source : DAPSA 2014 et calculs de l'auteur
31
2. Zones et systèmes de production
Au Sénégal, la caractéristique principale
de la riziculture est qu'elle repose essentiellement sur de petites
exploitations familiales avec une superficie moyenne par exploitant entre 1 et
2 hectares. Elle est pratiquée dans les zones du Nord et Sud. En
fonction des zones, les systèmes de production diffèrent et sont
largement dominés par de petits producteurs de type familial. Toutes
fois, l'essentiel de la production rizicole est réalisée dans la
Vallée du Fleuve Sénégal.

Figure 3 : Carte de la Vallée du Fleuve
Sénégal
Ainsi, on distingue deux systèmes de production majeurs
: la riziculture irriguée et la riziculture pluviale.
La riziculture irriguée : elle est
pratiquée dans la vallée du fleuve Sénégal
où d'importants investissements ont été
réalisés depuis quatre décennies, et dans le bassin de
l'Anambé. Les surfaces mises en valeur tournent autour de 95.000
hectares sur des potentialités de 240.000 hectares et dans le Bassin de
l'Anambé avec 4.180 ha aménagés sur un potentiel de 12.000
ha. Les superficies aménagées représentent moins de 3 % du
potentiel irrigable. Dans ce potentiel aménagé seulement 55 000
ha dans la vallée et 4 000 ha dans l'Anambé sont exploités
en moyenne annuellement. Les rendements moyens sont les plus
élevés du pays avec 5,5 t dans la vallée et 4,5 t/ha dans
l'Anambé17.
17 PNAR, 2011.
32
L'essentiel de la production est assuré par les
producteurs du nord, dans la vallée du fleuve Sénégal.
Ainsi, 71% de la production de riz paddy de la vallée est assuré
par le Delta du fleuve où l'essentiel de la production est
destinée à la commercialisation, qui à lui seul
représente 62% des terres de culture irriguée. Dans la moyenne et
haute vallée, la production est surtout destinée à
l'autoconsommation ; pareillement dans la vallée de l'Anambé
où elle demeure marginale.
La riziculture pluviale : dépendante
de la pluie, localisée dans bas-fond ou de plateau au Sud, dans une bien
moindre mesure dans la région Centre, et généralement
pratiquée de manière traditionnelle à petite
échelle le long des vallées inondables, elle constitue une
activité d'autosuffisance. Kolda, Sédhiou et Ziguinchor
constituent les trois régions du Sud. Ainsi, Kolda dispose d'un
potentiel de 50000 hectares de terres rizicultivables en pluvial dont 16000 ha
réparties dans différentes vallées ; Sédhiou avec
56.000 ha de terres rizicultivables en culture pluviale dont 36 000 ha dans
différentes vallées, et 20.000 ha sur le plateau. Ziguinchor,
regorge un potentiel rizicole est de 116.000 ha.
3. Organisation, structuration et acteurs de la
filière
La forme d'organisation et le degré de structuration
de la filière riz dépendent de la zone agro-écologique et
du système de production. Néanmoins, on peut distinguer sept
activités qui peuvent être considérées comme les
maillons de la chaîne de valeur riz au Sénégal : la
recherche agricole et agroalimentaire, les fournisseurs (intrants,
matériels agricoles et services), le financement, la production de
paddy, la collecte du paddy, la transformation et enfin la commercialisation du
riz blanc. Ainsi, on distingue les acteurs directs constitués par les
producteurs, les commerçants, les Transformateurs et les acteurs
indirects. Ces derniers regroupent les structures de recherche et
vulgarisation, les décideurs politiques, les institutions de
financement, les fournisseurs d'intrants, les prestataires de services, les
consommateurs.
4. Circuits de commercialisation du riz
Au Sénégal, le commerce du riz local ne concerne
que le riz issu de la production en système irrigué, autrement
dit produit dans la vallée et du bassin de l'Anambe. La production en
zone pluviale est principalement destinée à
l'autoconsommation.

PRODUCTEURS
COMMERCANTS « BANA-BANA »
|
|
Riz blanc
Riz étuvé
Riz Paddy
|
|
|

COMMERCANTS
« BANA-BANA
»
ORGANISME / RIZIERS

DETAILLANTS
CONSOMMATEURS
GROSSISTES
&
DEMI-GROSSISTES
33
Figure 4 : Schéma du circuit de
commercialisation du riz local
III. Evolution de la demande en riz et dépendance
aux importations 1. Evolution de la demande en riz
Le Sénégal étant un des plus gros
consommateurs de riz en Afrique de l'Ouest, le pays reste dépendant des
importations, pour satisfaire une demande en constante augmentation de cette
denrée. La production nationale n'en couvre que 30%. Si la consommation
apparente en riz au Sénégal était de 400 000 tonnes en
1995, elle est passée à 800 000 tonnes en 2007, avec 106
milliards de F CFA pour les importations nettes18. Ces
dernières participent pour 16% au déficit
18 Dr. SARR Fallou, CTA (2013) : Analyse du
système de connaissances Post - Récolte au Sénégal:
Cas Du Riz
34
de la balance commerciale et ce phénomène a
tendance à s'amplifier dans le temps car la production nationale
progresse moins vite que la consommation qu'elle ne couvrait qu'à
hauteur de 20% seulement.
|
1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200
000
0
|
|
|
40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
|
|
|
|
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Production Paddy (T)
Demande (T)
Taux de couverture
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
2013/14
Figure 5 : Evolution de la production par rapport
à la demande, de 2004 à 201419
2. Dépendance aux importations
De 1961 à 2012, les importations en riz ont
grimpé de plus de 700%. D'où cette dépendance de
l'extérieur de plus en plus accrue une denrée aussi
stratégique, ce qui expose le Sénégal à une
"précarité de l'offre et à la saignée des devises".
Les importations de riz coûtent cher au Sénégal, se situant
chaque année autour de 124 milliards de FCFA environ plus de 189
millions d'euros soit le cinquième environ du budget national qui est
à l'ordre de 2.800 milliards FCFA, équivalent à plus de
4,2 milliards d'euros, selon des statistiques officielles.
De 130 milliards de francs CFA injectés dans
l'importation de riz en 2005, on est passé à 179 milliards en
2009. Avec une moyenne de 834.484 tonnes par an sur la période 2004
à 2013, les importations de riz se chiffrent en moyenne, à 165
milliards FCFA par an.
19 Direction de l'Analyse, de la
Prévision et des Statistiques Agricoles (2014) et calculs de
l'auteur.
|
1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200
000
0
|
|
|
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0
|
|
|
|
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013
Volume importations (tonnes) Valeur importations
(millions FCFA)
35
Figure 6 : Importations de riz en quantités
(Tonnes) et en valeurs (FCFA), de 2002 à 2013 20
Ces importations restent toujours maintenues à un
niveau élevé durant cette décennie, malgré les
efforts fournis pour développer de la production locale avec un fort
incident sur la balance commerciale représentant ainsi 7% des
importations totales et 33% des importations de biens
alimentaires21. Cette dépendance alimentaire du
Sénégal vis-à-vis des importations, est donc
structurelle.
La variation des prix internationaux du riz rend le
Sénégal particulièrement vulnérable d'autant plus
que la part du riz dans les consommations progresse d'année en
année. La sécurité alimentaire dépend donc
aujourd'hui d'une relance de la production nationale de céréales
dont le riz est l'élément principal. Pour corriger cette
situation, le gouvernement a mis en place le PNAR, visant à atteindre
l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, à travers la production
de 1,6 million de tonnes de paddy, soit 1,080 million de tonnes de riz
blanc22.
IV. Analyse SWOT de développement du
secteur
L'analyse SWOT du secteur rizicole a permis d'identifier
les atouts dont disposent le secteur que ce soit l'existence
de grandes surfaces de terres exploitables, d'un capital humain et
institutionnel compètent, des acteurs diversifies et
complémentaires, d'un système de crédit agricole,
l'augmentation de la demande en riz locale sur le marché ; les
faiblesses en termes
20 Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie. Note d'Analyse du Commerce Extérieur 2006-2013
21 Agence Nationale de Statistique et de la
Démographie : Note d'Analyse du Commerce Extérieur, 2006-2013
22 DIOUF W. (2015), Coordonnateur Programme National
d'Autosuffisance en Riz (PNAR), Ministère de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural
d'encadrement des producteurs, d'appui à la recherche
et de la vulgarisation, du niveau faible d'utilisation d'intrants agricole,
d'équipements et matériels de production jugés le plus
souvent obsolètes, d'investissements, d'absence de politiques
commercialises ; les opportunités qui s'offrent au
secteur en terme de prix incitatif, un environnement international favorable,
une forte demande en riz local, de volonté et de l'abnégation des
partenaires, des initiatives d'appui ; les menaces qui
pèsent notamment sur la commercialisation, l'absence de politique pour
améliorer la qualité du riz local, surtout la concurrence du riz
importe.

? Contexte et environnement international
favorable
? Disponibilité et engagement des
partenaires
? Existence de nombreuses initiatives d'appui
à la filière
? Augmentation de la demande en riz local
? prix incitatif du riz local.
? Enormes potentialités en surfaces de
terres exploitables
? Un capital humain et institutionnel
compètent
? Existence d'un tissu d'acteurs, des
partenaires diversifiés et fortement mobilisés
? Préférence croissante des
consommateurs du riz local
? Existence d'un système de crédit
agricole pour l'irrigue
OPPORTUNITES
FORCES
? Absence de politique
d'amélioration de la qualité des produits notamment
celle du riz local.
? Concurrence du riz importé
? Niveau d'interactions faible entre les
différents acteurs.
? Niveau d'encadrement faible
? Appui insuffisant au secteur de la
recherche et de la vulgarisation
? Vétusté, obsolescence des
matériels et niveau faible des techniques d'utilisation des intrants
? Faiblesse des investissements du secteur
agricole, notamment rizicole
? Absence de stratégies marketing et/ou
de politique commercialisation
? faible capacité de stockage
FAIBLESSES
MENACES
36
37
Chapitre V : Politiques, stratégies de
développement agricole et
sécurité
alimentaire
I. Contexte et enjeux
Généralement en Afrique subsaharienne,
l'insécurité alimentaire résulte de la conjonction de
facteurs multiples et cumulatifs. Elle résulte d'un ensemble de
dysfonctionnements stratégiques et de politiques inappropriées
particulièrement au niveau du secteur agricole. Parmi les facteurs
contribuant à l'insécurité alimentaire, les fortes
fluctuations de la production agricole semblent les plus déterminantes,
non-seulement à travers ses effets sur l'offre mais aussi sur les
revenus réels des pauvres ruraux et urbains. En effet, contribuant pour
près de 90%23 à la couverture des besoins
alimentaires, et constituant la principale source du produit intérieur
brut, les performances du secteur agricole déterminent à la fois
la disponibilité et l'accès aux denrées alimentaires pour
la grande majorité de la population des pays subsahariens. Par
conséquent, l'instabilité du secteur agricole se traduit par de
fortes fluctuations des prix des produits alimentaires, des revenus, des
balances de paiement, et des budgets des Etats.
A long terme, l'instabilité du secteur réduit
les investissements et innovations technologiques dans l'agriculture et le
reste de l'économie. Le faible niveau d'investissement et d'innovations
technologiques perpétue la faiblesse de la productivité des
terres et du travail et se traduit par une pauvreté de la majeure partie
de la population. C'est ce contexte de faible productivité et de
pauvreté structurelle qui conduit à la permanence de
l'insécurité alimentaire en Afrique. En effet, le rendement moyen
des céréales en Afrique demeure toujours faible. Il était
stagnait pendant la période de 1991 à 1998 environ à 1,2
tonne par hectare. D'ici 2020, même en supposant avec optimisme que les
rendements nationaux moyens en céréales augmentent jusque 1,8
tonne par hectare, l'Afrique devra importer entre 25% et 32% de ses besoins en
céréales afin de rester au niveau alimentaire
actuel24.
Pour atteindre ce niveau d'approvisionnement alimentaire, des
efforts importants doivent être réalisés pour la
transformation des systèmes de production vers des systèmes plus
productifs. De plus, les contraintes actuelles, sociales, économiques et
politiques, doivent être levées. Des changements de politiques
seront nécessaires non seulement pour obtenir de plus forts
23 DEMBELE NN, (2001) Projet PASIDMA:
Sécurité alimentaire en Afrique Sub-saharienne: Quelle
Stratégie de Réalisation?
24 FAO (2003) : Gestion de la fertilité des
sols pour la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne.
38
rendements mais également pour encourager les
investissements dans des secteurs de l'agriculture, particulièrement au
secteur rizicole sénégalais qui regorgent beaucoup de
potentialités en termes de disponibilité de terres et d'eau du
Fleuve Sénégal sur toute l'année.
Si une bonne combinaison de politiques de stockage,
d'importations, d'aides alimentaires et de filets de protection sociale permet
de stabiliser les disponibilités et les prix intérieurs, et de
faire face à l'insécurité alimentaire transitoire, seule
la croissance de la productivité du secteur agricole et la mobilisation
de ces gains de productivité pour le développement
économique permettra d'atteindre la sécurité alimentaire
structurelle à moyen et long terme.
Ceci implique la stabilisation et la transformation du secteur
agricole par des investissements publics adéquats pour favoriser la
capitalisation agraire, le développement des marchés et des
échanges, la création des ensembles régionaux et leur
ouverture au marché mondial, et la nécessité de
l'ouverture des marchés des pays de l'OCDE aux produits agricoles
africains pour élargir les débouchés et réduire les
fortes fluctuations des prix nationaux. Ce processus de transformation de
l'agriculture doit être soutenu par le développement des
ressources humaines.
II. La sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire se définit comme
l'accès permanent de tous aux denrées alimentaires
nécessaires pour mener une vie saine et active. La
sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains
ont, à tout moment, un accès physique et économique
à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. La
réalisation de la sécurité alimentaire reste un
défi majeur à relever en Afrique sub-saharienne dont au
Sénégal où la population ne cesse d'augmenter à
vive allure d'année en année. Cette augmentation de la population
a des conséquences importantes notamment une insécurité
alimentaire.
1. Recours à l'Agriculture pour assurer la
sécurité alimentaire
La réalisation de la sécurité alimentaire
durable en Afrique sub-saharienne demande une croissance rapide du secteur
agricole. L'analyse de la situation et des perspectives sur la
sécurité alimentaire montre un écart croissant entre les
besoins de consommation et de nutrition et les disponibilités
alimentaires des ménages. Au Sénégal, la faiblesse des
gains de productivité dans la production alimentaire et des
capacités d'importation constituent les contraintes majeures à la
réalisation de la sécurité alimentaire. La croissance du
secteur agricole devient ainsi le préalable à
l'amélioration de la situation alimentaire.
39
Cependant, les aléas climatiques, le faible ratio
capital-travail, combiné avec un faible niveau de capital humain, et les
fortes fluctuations des prix constituent des obstacles importants à la
croissance des productivités agricoles. Le retour de l'agriculture comme
secteur prioritaire dans les programmes de développement,
l'avènement de la démocratie, les changements de politiques
économiques, la mondialisation de l'économie, les nouvelles
technologies de l'information et de la biotechnologie constituent des atouts
pour la relance de la production agricole sénégalaise. Ainsi,
seule une stratégie d'augmentation rapide de la productivité
agricole est à même d'enclencher un processus de croissance
économique rapide mieux repartie nécessaire à la
réalisation de la sécurité alimentaire.
2. Contraintes à la réalisation de la
sécurité alimentaire 2.1 Contraintes naturelles
Les aléas climatiques constituent un facteur important
de la trop grande variation des productions agricoles. Les 2/3 du continent
sont sujets au risque de sécheresse dû à
l'instabilité des pluies et leur mauvaise répartition dans
l'espace et dans le temps. Or l'eau constitue l'une des principales ressources
agricoles et sa disponibilité détermine la réponse des
cultures aux intrants et autres innovations technologiques. Les changements
climatiques risquent de faire de la disponibilité de l'eau un facteur
plus contraignant dans les années à venir. En dehors des
aléas climatiques, la dégradation des terres et la perte de
fertilité constituent des facteurs limitants de la productivité
agricole.
2.2 Contraintes socio-économiques
La littérature sur le développement agricole au
Sénégal regorge d'une multitude de contraintes
socio-économiques à l'augmentation de la production et de la
productivité. Cependant, l'ensemble de ces contraintes se ramène
à la faiblesse de capitalisation de l'agriculture en termes de moyens de
production et ressources humaines, à des faiblesses institutionnelles,
la manque de d'infrastructure rurale et à la faiblesse des
marchés et des échanges.
2.3 Contraintes politiques
Malgré la globalisation, la réalisation de la
sécurité alimentaire relève de la responsabilité
des Etats. Seuls les Etats sont capables de créer la stabilité
politique et l'environnement économique favorable au
développement agricole par le choix de politiques appropriées et
des investissements qui peuvent induire des investissements privés et
des collectivités locales
40
décentralisées. La sécurité physique
et politique, qui sont les conditions nécessaires pour un
développement agricole, sont toujours rares, avec des impacts
négatif sur les pays voisins.
3. Opportunités qui s'offrent à
nous
Malgré la longue liste des contraintes à la
croissance du secteur agricole, la redécouverte de l'agriculture par le
gouvernement et leurs partenaires, l'avènement de la démocratie,
les changements de politiques économiques, la mondialisation de
l'économie et les nouvelles technologies de l'information et la
biotechnologie constituent des atouts pour la relance de la production agricole
sénégalaise.
3.1 Le Retour à l'agriculture
Après au moins deux décennies de manque
d'attention sérieuse sur le secteur agricole par les états et
leurs partenaires, l'importance de l'agriculture comme moteur de
développement est de plus en plus reconnu dans les déclarations
officielles et dans les dotations budgétaires. Le défi actuel est
de trouver des politiques capables de traduire cette nouvelle volonté
vis-à-vis de l'agriculture en un développement durable et
participatif.
3.2 Démocratie
Beaucoup de pays de la région ont adopté la
démocratie comme modèle d'organisation politique. Ce cadre
politique permet aux organisations professionnelles du secteur privé de
mieux formuler et de communiquer leurs demandes aux décideurs
politiques. La décentralisation issue de la dynamique de
démocratisation, promet un meilleur équilibrage des
investissements entre le monde rural et les centres urbains. Désormais,
le financement local et l'obligation de résultats pour les élus
locaux, exigeront de plus en plus que ces derniers prennent en compte les
besoins des populations rurales dans le choix des priorités
d'investissements et la transparence dans la gestion des programmes locaux.
L'état central devra désormais se concentrer sur la formulation
des orientations générales, les grands investissements, et le
maintien d'un cadre politique, juridique et macro-économique favorable
à la mobilisation des initiatives privées et des énergies
locales.
3.3 Réformes économiques
En réponse à la crise de l'endettement des
années 80-90, la presque totalité des états
ouest-africains ont engagé des réformes macro-économiques
et sectorielles depuis 30 années. Au plan macro-économique, les
réformes ont porté essentiellement sur la réduction des
déficits budgétaires par des mesures de stabilisation, la
libéralisation de l'activité économique par le
41
retrait des états des activités de production,
de commercialisation et de contrôle des prix, l'ouverture des
économies aux échanges extérieurs, et l'adoption de taux
de change moins surévalués. Les réformes fiscales,
tarifaires et non-tarifaires qui ont accompagné ces mesures de
libéralisation, ont permis au marché de jouer un plus grand
rôle dans l'allocation des ressources dans l'économie
sénégalaise.
Les réformes sectorielles relatives au secteur agricole
portaient sur la libéralisation des marchés agricoles des
produits et des intrants, la suppression des subventions à la
consommation et à la production, et le retrait des états de la
commercialisation des produits agricoles et la distribution des intrants et du
crédit agricole. Les reformes sectorielles ont aussi concerné la
suppression des prix garantis au producteur, la réduction des
protections tarifaires et non-tarifaires et la libéralisation des
échanges agricoles. L'ensemble des réformes ci-dessus ont permis
de restaurer la compétitivité de certaines filières
agricoles et de créer des incitations de prix favorables à
l'augmentation de la production.
3.4 Mondialisation et échanges régionaux
Le contexte mondial actuel se caractérise par une forte
intégration des économies nationales aux plans des
échanges et des marchés des capitaux à l'échelle
régionale et mondiale. Les nouvelles technologies de l'information, la
diffusion rapide des technologies, la révolution de transport, et les
politiques volontaristes de libéralisation des échanges à
l'échelle mondiale, sont à l'origine du rythme
accéléré de l'intégration des économies
nationales. La mondialisation offre à l'Afrique sub-sahariennes de
nouvelles possibilités de diversification des exportations. Si
l'intégration des économies offre des opportunités de
diversification des exportations agricoles, elle expose aussi les agricultures
de la sous-région à une forte compétition.
3.5 Nouvelles technologies de l'information et la
biotechnologie
Les nouvelles technologies de l'information et de la
biotechnologie offrent des opportunités réelles dans les domaines
de l'information, de la formation et de l'amélioration
génétique des cultures. L'internet et les
téléphones cellulaires permettent aujourd'hui l'accès
instantané aux informations commerciales et leur diffusion auprès
des producteurs et des opérateurs économiques. La formation et la
vulgarisation à distance offrent d'autres possibilités
d'utilisation des nouvelles technologies de l'information. L'accès
à la documentation scientifique et commerciale à travers
l'internet constitue un autre domaine d'application de ces technologies pour
l'éducation, la recherche et le transfert de technologie. Quant à
la biotechnologie, la transposition des gênes peut permettre
d'accroître la résistance des cultures
42
aux insectes, aux maladies, et au stress climatique qui
risquent de devenir plus sévères avec les changements
climatiques. La biotechnologie offre aussi les possibilités de produire
en fonction des demandes spécifiques de chaque segment du marché
en caractérisant les produits.
4. Mise en place d'indicateurs d'évaluations
performants
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les
êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et
économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
Même si la notion d'accès est désormais mise en avant, on
considère classiquement que la sécurité alimentaire
comporte quatre dimensions ou "piliers" : la disponibilité,
l'accès, la stabilité, l'utilisation.
L'accès traduit la capacité de produire sa
propre alimentation et donc de disposer des moyens nécessaires, ou
capacité d'acheter sa nourriture et donc de disposer d'un pouvoir
d'achat suffisant pour le faire. La disponibilité en quantités
suffisantes d'aliments qu'ils proviennent de la production intérieure,
de stocks, d'importations ou d'aides et en qualité des aliments et des
régimes alimentaires des points de vue nutritionnel, sanitaire, mais
aussi sociaux-culturels. La stabilité traduisant les capacités
d'accès et donc des prix et du pouvoir d'achat, des
disponibilités et de la qualité des aliments et des
régimes alimentaires ; ainsi que l'utilisation des aliments.
Différents indicateurs peuvent être mis en place en fonction des
quatre piliers de la sécurité alimentaire :
y' Disponibilité : production,
calories/jr/pers, quantité, produit sur place ou importé.
y' Accès : au marché
(physique), au portemonnaie (financier) et social (droit à
l'alimentation). y' Stabilité : accès constant
pour tous en tout temps.
y' Utilisation: soins, eau, pratiques
alimentaires.
5. Difficultés dans le suivi de la
sécurité alimentaire continuent d'entraver la mise en place de
politiques efficaces
Le suivi de la sécurité alimentaire et notamment
celui de la pauvreté continue de constituer une barrière à
la mise en place de politiques efficaces, surtout à cause de la
disponibilité limitée des données. Dans de nombreux pays
notamment au Sénégal, la disponibilité, la
fréquence et la qualité des données pour mesurer la
pauvreté restent d'un faible niveau, surtout dans les petits
États et les pays et territoires se trouvant dans une situation fragile.
Des obstacles institutionnels, politiques et financiers entravent la collecte,
l'analyse et l'accès public aux données. Il est
43
urgent d'améliorer les programmes d'enquêtes sur
les ménages pour mesurer la sécurité alimentaire, ainsi
que la pauvreté.
6. Enjeux du développement rural pour la
sécurité alimentaire au Sénégal
La réalisation de la sécurité alimentaire
durable en Afrique sub-saharienne demande une croissance rapide du secteur
agricole. L'analyse de la situation et des perspectives sur la
sécurité alimentaire montre un écart croissant entre les
besoins de consommation et de nutrition et les disponibilités
alimentaires des ménages. Au Sénégal, la faiblesse des
gains de productivité dans la production alimentaire et des
capacités d'importation constituent les contraintes majeures à la
réalisation de la sécurité alimentaire. La croissance du
secteur agricole devient ainsi le préalable à
l'amélioration de la situation alimentaire.
Cependant, les aléas climatiques, le faible ratio
capital-travail, combiné avec un faible niveau de capital humain, et les
fortes fluctuations des prix constituent des obstacles importants à la
croissance des productivités agricoles. Le retour de l'agriculture comme
secteur prioritaire dans les programmes de développement,
l'avènement de la démocratie, les changements de politiques
économiques, la mondialisation de l'économie, les nouvelles
technologies de l'information et de la biotechnologie constituent des atouts
pour la relance de la production agricole sénégalaise. Ainsi,
seule une stratégie d'augmentation rapide de la productivité
agricole est à même d'enclencher un processus de croissance
économique rapide mieux repartie nécessaire à la
réalisation de la sécurité alimentaire.
IV. Analyse de l'évolution des politiques de
développement agricole au Sénégal depuis
l'indépendance à nos jours
1. Politiques Agricole (P.A), 1958
Dès 1954, le Sénégal avait mise en place
une politique agricole favorable au développement des populations
rurales. Les principales caractéristiques de cette politique agricole
étaient par des subventions légères, de très bon
encadrement, d'importants investissements FIDES (Fond d'investissement pour le
Développement Economique et Social), un prix intéressant pour
l'arachide. Cette politique avait permis une rapide augmentation de la
production arachidière commercialisée. Celle-ci passe de 450.000
tonnes en 1948 à 750.000 tonnes en 195825. La
25 HAVARD M. ISRA (1986) Institut
Sénégalaise de Recherches Agricoles, Document de Travail
1986-1
44
recherche, pendant cette période, a
amélioré ses connaissances sur le milieu et a mis au point un
certain nombre de techniques agronomiques dont l'assolement, des
variétés plus résistants, adaptées et productives,
l'utilisation de fumure minérale, densités de plantation,
etc...
A partir de 1958, une politique agricole encore plus favorable
dont l'arachide constituait le point d'ancrage est élaborée. Il
s'agit du Programme Agricole (PA), dont l'objectif principal était
l'accroissement de la production arachidière par l'intensification. En
outre, il devait permettre aux coopératives d'avoir accès non
seulement aux crédits pour l'achat d'intrants à savoir des
engrais, des semences, des matériels agricoles mais aussi aux
subventions pour certains matériels de culture attelée et
quelques formules d'engrais.
En effet, le PA a été le principal levier de
financement de l'agriculture sénégalaise. Il était
financé par le budget de l'Etat à travers des fonds versés
dans les banques nationales, assurait l'approvisionnement à
crédit des paysans en intrants agricoles et devait donc favoriser
l'application des techniques agronomiques d'intensification
élaborées par la recherche. Ce politique agricole a
réellement fonctionné de 1958 à 1980.
2. Etatisation à outrance création de
l'ONCAD (1966), Création de la SONACOS (1975) et de la SONAGRAINE
(1981-1988)
Pendant longtemps, l'Etat a été actif en amont
et en aval de la filière arachidière. A travers le programme
agricole de 1958, il fournissait le crédit aux paysans pour l'achat des
intrants agricoles. Tout le système de gestion était
géré par des structures étatiques dont l'Office Nationale
de Coopération et d'Assistance pour le Développement (ONCAD).
Créée en 1966, elle était chargée de
l'approvisionnement des producteurs en intrants subventionnés et
à crédit, de l'encadrement et de l'assistance aux
coopératives de producteurs et disposait de l'exclusivité de la
commercialisation des grands produits agricoles. A l'image des organismes qui
l'avaient précédé, la mission de l'office était
centrée sur le secteur arachidier. Elle couvrait en particulier
l'encadrement des coopératives, l'approvisionnement du monde rural en
facteurs de production et la commercialisation des produits agricoles bruts. De
1964 à 1984, le système est bâti autour de la Banque
Nationale de Développement du Sénégal (BNDS) qui finance
les sociétés publiques telles que l'ONCAD et les
sociétés régionales de développement.
Cependant, la transformation de l'arachide restait aux mains
d'industries privées. L'importance stratégique de l'arachide pour
l'économie du pays en faisait une affaire de souveraineté
nationale. La mainmise du secteur privé étranger sur les
huileries et sur la vente des produits arachidiers était perçue
autrement par le gouvernement animé par un processus de
45
nationalisation. C'est ainsi fut créée la
Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du
Sénégal (SONACOS) en 1975 dont l'objectif était la prise
en charge de la vente à l'exportation des huiles et tourteaux. Ainsi,
sous les obligations de la puissance publique, les industriels étaient
contraints de céder leur production à la SONACOS. En 1981, cette
dernière procède au rachat des trois établissements
industriels de Dakar, Kaolack, et Ziguinchor, puis en 1988 de celui de
Diourbel. Voulant contrôler la filière d'amont en aval, elle
créa une filiale, la SONAGRAINE qui assurait non seulement la collecte
et le transport des arachides mais aussi la distribution des intrants
agricoles.
En dépit des contraintes du système, les paysans
arrivaient à accéder aux intrants, aux matériels agricoles
à travers des crédits. Des formations étaient
assurées et l'encadrement était présent. Cependant, les
objectifs visés par les autorités publiques étaient loin
d'être atteints. Ainsi, malgré les politiques productivistes
menées partout sur le territoire national et les investissements
très importants réalisés grâce aux aides
extérieures et aux financements de l'Etat, les années 1970 se
terminent par une grave crise de l'agriculture sénégalaise et des
problèmes de gouvernance notoires. L'ONCAD est le symbole du mauvais
fonctionnement du système. Des dysfonctionnements récurrents sont
notés dans le management de l'institution, principale structure
d'encadrement : des dépenses exagérées, une gestion
gabegique avec des charges de fonctionnement représentant 87,2 % du
chiffre d'affaires, un personnel pléthorique avec 4500 employés
là où un effectif de 1609 personnes aurait suffi, un
déficit budgétaire de 72 milliards dont plus de 90 % sont
relatifs aux agios bancaires26. Le 23 août 1980, le
gouvernement décide de dissoudre l'ONCAD. (Mbow, 2009).
3. Nouvelle Politique Agricole (NPA, 1984)
En 1979, le Sénégal s'était engagé
dans une Politique d'Ajustement Structurel (PAS). La période est
caractérisée par une augmentation du cours des intrants agricoles
importés cumulée à une baisse des cours des
matières premières agricoles, aux effets des sécheresses
des années 1969-1973 et du choc pétrolier de 1972. En
réalité, les PAS ont commencé en 1978, avec le Plan de
Stabilisation dont l'objectif majeur était d'arrêter
l'hémorragie que connaissait l'économie
sénégalaise, puis le Programme de Redressement Economique et
Financier (PREF) de 1979 signé avec le Fonds Monétaire
International (FMI) qui entraîne la suppression du PA.
26 DIAGNE D. (2011) : Etude sur le financement de
l'agriculture au Sénégal, de 1980 à 2010 : Plaidoyer pour
une plus grande allocation budgétaire, Rapport Final.
46
L'adoption de la Nouvelle Politique Agricole (NPA) en 1984
s'inscrit dans une volonté de rupture avec les politiques
antérieures. La NPA était bâtie autour de principes
directeurs de l'économie de marché. A cet effet, elle consacre le
retrait de l'État du secteur agricole. L'approvisionnement en intrants
subventionnés des exploitations agricoles fut supprimé,
l'utilisation des engrais en chute brutale à l'exception des producteurs
de coton et de riz qui bénéficiaient encore des
approvisionnements en intrants de la Société de
Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX) et de la
Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta (SAED).
Avec le redimensionnement du capital semencier en arachide, les paysans doivent
garder leurs semences ou les acheter au comptant.
Entre 1980 à 1985, par l'intermédiaire de la
Société Nationale d'Approvisionnement du Monde Rural (SONAR),
l'Etat s'était contenté de rendre disponibles les intrants pour
les achats au comptant et avait massivement désinvesti dans
l'agriculture pluviale, en particulier dans le bassin arachidier.
Accompagné par les discours sur les aménagements hydroagricoles
du Delta du Fleuve Sénégal et sur l'autosuffisance alimentaire
grâce à la riziculture, l'idée de développer
l'agriculture irriguée s'impose. Dans le Delta du Fleuve
Sénégal où tout le potentiel irrigable n'est pas mis en
valeur, la riziculture irriguée constitue la principale composante des
systèmes de production. Les producteurs ont de plus en plus recours au
crédit agricole pour financer les frais de production, l'achat
d'équipements et la réalisation d'aménagements
hydro-agricoles.
Depuis 1987, ces opérations sont assurées par la
Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) qui
a remplacé la Banque nationale de développement du
Sénégal (BNDS). En quatre ans, les sommes injectées sous
forme de prêts ont considérablement augmenté, contribuant
fortement au développement économique régional. Mais
durant les années 90/91, des taux de remboursement plus faibles
compromettent la viabilité de ce système de crédit. La
Nouvelle Politique Agricole a confirmé le désengagement de l'Etat
de l'économie agricole. C'est avant tout un processus de
libéralisation et de privatisation qui se traduit par un
démantèlement du système d'encadrement du monde rural.
Certaines sociétés de développement comme la
Société de Mise en Valeur de la Casamance (SOMIVAC) et la
Société des Terres Neuves (STN) sont dissoutes. Celles qui sont
maintenues, comme la Société de Développement et de
Vulgarisation Agricole (SODEVA) et la SAED sont restructurées et voient
leurs missions, leurs ressources financières et leur personnel fortement
revus à la baisse.
4.
47
Lettres et Déclarations de Politique de
Développement Agricole (LDPDA, 1994), et Programme d'Ajustement du
Secteur Agricole (PASA, 1995)
La NPA de 1984 a été une
accélération du désengagement de l'Etat du secteur
agricole se traduisant par un démantèlement du système
d'encadrement monde rural. La dévaluation du franc CFA intervenue en
1994 a été la mesure la plus radicale d'ajustement structurel se
traduisant par une augmentation brutale des prix des intrants agricoles et une
baisse des prix d'achat des productions agricoles, et donc par un effondrement
de la productivité. En 1995, le Programme d'Ajustement Structurel du
secteur Agricole (PASA), éprouvé par la Banque Mondiale est mise
en oeuvre via la Lettre de Politique du Développement Agricole
(LPDA).
Cette dernière, succédant la NPA vient ainsi
accentuée le degré de désengagement de l'Etat de toutes
les activités économique. Le Programme d'Investissement du
Secteur Agricole (PISA, 1995) supposé regrouper les programmes de
développement retenus pour relancer la production agricole n'a jamais
été approuvé par les bailleurs de fonds. Le gouvernement
du Sénégal a fini par opter pour l'élaboration et
l'approbation des lettres de politiques sectorielles qui servent, en principe
de cadres d'orientation stratégique. C'est ainsi que différentes
lettres de politiques sectorielles concernent le monde rural servent de
référence aux programmes négociés avec les
bailleurs de fonds.
5. Programme de Relance Agricole 1997, Accord Etat-CNIA,
1997-2001
Pour diverses raisons d'ordres économiques, sociales et
politiques, l'État Sénégalais reste toujours
attaché à la culture de l'arachide. En 1997, le gouvernement a
élaboré avec la participation des organisations agricoles un
programme agricole visant à relancer la production. C'est dans un
environnement néo libéral que l'Etat et les bailleurs de fonds
ont tenté de relancer la production agricole. La libéralisation
de la filière amorcée à partir des programmes d'ajustement
structurel a eu comme conséquence une modification de l'organisation de
la filière avec le retrait progressif de l'État, la dissolution
de la SONAGRAINE en 2001 et la privatisation totale de la SONACOS en 2005.
Un accord-cadre fut signé en 1997 entre l'Etat et le
Comité National Interprofessionnel de l'Arachide (CNIA) pour se
désengager des opérations semencières, de collecte, de
transport et de commercialisation afin de rendre la filière plus
compétitive. Le CNIA cesse d'être le maître d'oeuvre des
actions à réaliser et devient maître d'ouvrage en veillant
à la cohérence des interventions sur la filière. En effet,
créé en 1992, il regroupait des services publics et des
opérateurs privés. Après deux ans de fonctionnement, les
uns et les autres avaient opté pour une
48
« privatisation » de la structure pour
accroître son efficacité. Il a fallu trois ans pour qu'un accord
cadre soit signé entre l'Etat, la SONAC0S et le Projet d'appui du CNIA
(1997). Des conventions ou des protocoles ont été signés
entre le CNIA et les structures de recherche, comme l'ISRA et le CIRAD et la
Division des Semences (DISEM).
Le CNIA était constitué de 11 membres : la
SONACOS, la SONAGRAINE, la SENCHIM, la SPIA), l'UNCAS, l'UNIS, la SISMAR, la
FNOPS, la SONAGRO, l'APCR. Il avait pour principal objectif la relance de
l'arachide au Sénégal. Plus spécifiquement, il visait
à sauvegarder les intérêts mutuels, le recours à des
procédures décisionnelles équilibrées qui prennent
en compte les différents centres d'intérêts et les
initiatives porteuses de changements positifs dans l'évolution de la
filière ; la détermination et la fixation du prix plancher en se
référant aux informations relatives à l'évolution
des indicateurs de la filière et des cours mondiaux ; l'animation des
négociations internes à l'interprofession ; la consolidation de
la dotation du compte de soutien pour éviter un effondrement brutal des
cours ; l'amélioration de la productivité ; la
sécurisation des producteurs par le renforcement de leur position dans
la filière ; le respect des statuts, règlements et engagements
souscrits.
Le CNIA a bénéficié de l'expertise des
agents du projet d'appui dans l'organisation, la détermination et la
vulgarisation des indicateurs financiers et économiques de la
filière, dans l'analyse de l'évolution des cours mondiaux de
l'arachide et des produits concurrents tels que le soja et le colza. Le
diagnostic organisationnel du CNIA réalisé en 200427 a
relevé des problèmes de fonctionnement liés notamment
à sa faible autonomie financière et politique, à des
questions sur la représentativité de tous les
acteurs28, à des insuffisances de structuration interne et de
bonne gouvernance. Le Programme de Relance Agricole avait permis de
réduire les dettes paysannes par des moratoires et des réductions
partielles, de bonifier les taux d'intérêt du crédit
agricole et de soutenir les prix modérément des principaux
produits agricoles dont le riz.
C'est ainsi que les demandes de financements de programmes
destinés à relancer la production agricole, auprès des
partenaires au développement ont été approuvées.
v Le Programme des Services Agricoles et d'appui aux
Organisations de Producteurs (PSAOP, 1999) : est une composante
importante du PISA qui comprend également d'autres projets : le
Programme National d'Infrastructures Rurales (PNIR) également soutenu
par la BM, le Programme Sécurité Alimentaire (FAO), etc. Son
objectif principale
27 Union Européenne (UE), 2004
28 Les organisations de producteurs ne sont pas
toutes représentées à travers l'UNCAS
49
est de mettre en place un nouveau système
libéral et décentralisé d'appui au monde rural basé
sur le conseil agricole et donnant un rôle central aux producteurs et
à leurs organisations ;
v Le Programme National d'Infrastructures Rurales
(PNIR, 2000) : destiné à appuyer les communautés
rurales dans la création d'infrastructures rurales et la fourniture des
services publics de proximité aux ruraux, il était
organisé en 4 composantes que sont : l'appui au développement
rural décentralisé, le Fonds d'Investissement local (FIL), le
programme de pistes rurales et la coordination, suivi et évaluation du
projet. Son objectif global était de promouvoir le développement
rural décentralisé et de renforcer la gouvernance locale
D'autres programmes ont concerné également le
secteur rural : Développement de l'agriculture irriguée avec le
financement des programmes de la SAED, appui de l'UE à la filière
arachide, appuis aux collectivités locales qui accompagnent
l'approfondissement de la décentralisation administrative
décidé en 1996 avec la régionalisation.
6. Elaboration d'une Lettre de Politique de
Développement de la Filière Arachide (LPDFA, 2003)
En dépit des réformes initiées
déjà dans le cadre du PASA mis en place en 1995, l'application
stricte de l'Accord-cadre Etat-CNIA de 1997 et malgré tous les
changements importants dans le fonctionnement de la filière arachide,
cette dernière était toujours confrontée à des
contraintes majeures d'instabilité de l'environnement économique
et financier et des difficultés organisationnelles des acteurs de la
filière. L'arachide, du fait du grand nombre d'acteurs sociaux qu'elles
impliquent, occupe une place prépondérante du volet «
Agriculture » dans le Document de Stratégie de Réduction de
la Pauvreté (DSRP) qui vise à atteindre un taux de croissance du
PIB de 7% à 8% par an29, pour la période 2003-2005 et
à réduire la pauvreté d'au moins 15% sur la même
période.
Les objectifs poursuivis dans l'axe création de
richesse portant sur une croissance économique forte, sur
l'amélioration des revenus en milieu rural et sur une croissance
génératrice d'emplois ; la filière arachide pourrait jouer
un rôle important dans l'atteinte de ces objectifs. Conscient qu'il
fallait créer d'amont en aval un environnement économique,
juridique et institutionnel permettant à la filière arachide de
contribuer à la dimension de son potentiel, et à travers un
rôle
29 Ministère de l'Agriculture et de
l'Hydraulique : « Lettre de politique de développement de la
filière arachide », Avril 2003
50
accru de l'initiative privée, à la
réalisation des objectifs de base de la PA, l'Etat à travers le
comité de coordination de la réforme de la filière
arachide avait élaboré en 2003 une Lettre de Politique de
Développement de la Filière Arachide (LPDFA). L'adoption de la
LPDFA dans laquelle l'Etat indique son option de parachever la
libéralisation de la filière, avec comme conséquence,
l'appauvrissement de petits exploitants au profit de grands exploitants
causé par la libéralisation du secteur. Ces réformes
conduisirent finalement à la privatisation de la SONACOS et l'adoption
en mai 2004, de la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) qui
constituera le cadre de développement du secteur agricole pour les 20
prochaines années.
7. La Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP,
2004)
Le Sénégal s'est doté au printemps
200430d'une Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP)
définissant sur 20 prochaines années, le cadre de
développement de l'agriculture et dont l'objectif est d'asseoir le
développement rural sur la modernisation des exploitation agricoles
familiales, tout en promouvant l'entreprenariat agricole. Les organisations
professionnelles agricoles, et notamment le Conseil National de Concertation et
de Coopération des Ruraux (CNCR) ont vu leur demande acceptée et
leur souhait réalisé par l'adoption de cette loi conférant
ainsi un statut juridique aux métiers de l'agriculture et des
organisations professionnelles. La présente loi est articulée
autour de cinq (05) titres et structurée ainsi :
- Le Titre I intitulé «
Dispositions générales » contient deux chapitres relatifs
aux objectifs, priorités et axes de la politique de développement
agro-sylvo-pastoral ;
- le Titre II s'intitule «
Métiers, organisations et exploitations agricoles », et regroupe
trois chapitres traitant de la reconnaissance formelle des métiers de
l'agriculture et des organisations professionnelles agricoles, de la protection
sociale des personnes exerçant les métiers de l'agriculture et du
statut juridique des exploitations agricoles ;
- le Titre III s'intéresse aux «
Stratégies de développement agro-sylvo-pastoral » et
contient huit chapitres relatifs à la réforme foncière,
à la diversification, aux filières et à la
régulation des marchés, à la sylviculture et aux
aménagements forestiers, à la politique de développement
de l'élevage, à la maîtrise de l'eau, au
développement des infrastructures et des services publics en milieu
rural, à la promotion de l'équité sociale et à la
protection contre les calamités naturelles et les risques liés
aux activités agricoles;
- Au Titre IV des « Mesures
d'accompagnement », la loi traite de l'information agricole, de
l'éducation et de la formation aux métiers de l'agriculture, du
renforcement des capacités
30 Vote à l'Assemblée Nationale le 25
mai 2004, promulgation le 04 juin 2004.
51
des organisations professionnelles agricoles, des
organisations de la société civile et des services de l'Etat, de
la recherche et du conseil agro-sylvo-pastoral et du financement du
développement agro-sylvo-pastoral.
- Au titre V des « Dispositions diverses
et finales », la présente loi consacre la création du
Conseil Supérieur d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et annonce la tenue
annuelle d'une Conférence, regroupant l'ensemble des acteurs du monde
rural, présidée par le Chef de l'Etat31.
Les contre-performances du secteur agricole
enregistrées à partir de l'avènement de l'alternance
obligeant les pouvoirs politiques à définir une nouvelle approche
soutenue avec une vision plus globale des questions agricoles, repositionnant
l'agriculture au centre de la stratégie d'une croissance forte et
durable. La LOASP se devait donc de donner une orientation stratégique
globale à l'agriculture sénégalaise sur un horizon de deux
décennies, fondée sur le renforcement des exploitations
familiales. Ainsi, elle constituait la base d'élaboration de programmes
opérationnels à moyen terme, tel que le Programme National de
Développement Agricole (PNDA). Dès lors, elle avait
remplacé l'ensemble des politiques agricoles sectorielles au
Sénégal, et était supposée rendue
opérationnelle par le volet agricole du DSRP devenu par la suite le
DPES, puis la SNDES. Malheureusement, les décrets d'application ont
tardé à se concrétiser.
Les programmes dits « programmes spéciaux »
qui avaient comme objectif global de promouvoir le développement des
filières vivrières et l'évolution vers des systèmes
de production durables en vue d'améliorer les revenus afin d'assurer la
sécurité alimentaire, contribuant ainsi à la lutte contre
la pauvreté, étaient élaborés sans implication des
acteurs et par conséquent n'ont pas donné les résultats
escomptés, malgré les importantes ressources engagées. La
LOASP dans son article 24 stipule : « L'Etat, en concertation avec les
organisations professionnelles agricoles définit et met en oeuvre un
Plan national de diversification des productions agricoles ». Or, la
démarche dans le lancement de ces différents programmes et leurs
stratégies de mise en oeuvre montre que, leur élaboration ne part
pas généralement de l'identification des problèmes
réels des producteurs en termes de diversification de leurs
systèmes de production. Le choix des cultures à promouvoir ne
tient pas nécessairement compte des priorités et objectifs de
production des acteurs des filières ciblées.
31 Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale.
Exposé des motifs
52
D'où la nécessité d'impliqué les
producteurs dans l'identification des filières à appuyer dans le
cadre du développement d'un programme. Il convient de souligner que,
même si les résultats enregistrés par les différents
programmes demeurent insuffisants par rapport aux moyens mobilisés, il
ont permis de relancer ces filières en terme de disponibilité de
facteurs de production tels que semences, engrais..., d'organisation des
acteurs et de structuration.
8. Le Plan Retour Vers l'Agriculture (Plan REVA, 2006),
La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA,
2007)
Né d'une initiative du chef de l'État
sénégalais, le « Plan REVA s'inscrit dans le cadre du
développement durable et consiste à créer une dynamique
nationale de retour massif, durable et soutenu des populations, toutes
catégories confondues, vers la terre afin de faire des métiers de
l'agriculture le soubassement de l'économie nationale et de
l'agriculture le moteur du développement du pays32. Mis en
oeuvre en 2006, ce plan devait permettre de résoudre le problème
du chômage et positionner le pays sur la rampe du développement
agricole, s'articulant ainsi autour de la création de Pôles
d'Emergence agricoles intégrés et la promotion de l'initiative
privée dans le secteur agro-industriel au sens large. Instrument de mise
en oeuvre du DSRP et de la SCA, il devait permettre l'augmentation
significativement de la production agricole notamment horticole et de
répondre aux objectifs de SCA et de lutte contre la pauvreté
En 2006, le Sénégal était marqué
par un l'émergence d'un nouveau phénomène :
l'émigration. Le développement de l'émigration clandestine
qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec les conséquences qui en
découlent et que tout le monde connait, combiné avec le
chômage qui continue de s'accentuer, la faiblesse des revenus des paysans
et la persistance de l'insécurité alimentaire et de la
pauvreté, obligent l'Etat à prendre d'importantes mesures pour
faire face à ce fléaux et remédier à cette
situation. Le gouvernement sénégalais toujours dans sa
volonté politique de faire du secteur agricole, le moteur du
développement économique et social de notre pays a initié
le Plan REVA « Retour Vers l'Agriculture ».
En 2008, il créa une Agence Nationale de gestion et de
mise en oeuvre du Plan REVA (ANREVA) chargée d'assurer l'encadrement,
l'accompagnement et l'effectivité du Plan ; et met en place les
aménagements structurants sur chaque site, la terre, les moyens
logistiques nécessaires, les intrants agricoles ainsi qu'un fonds de
roulement ; les charges liées aux différentes prestations de
service et le crédit accordé au bénéficiaire
devront être remboursés à
32 Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique
Rurale et de la Sécurité Alimentaire, 2006.
53
la fin de chaque campagne. Les objectifs du Plan
étaient donc de lutter contre l'émigration et l'exode rural en
créant les conditions durables de retour volontaire à la terre,
d'améliorer la productivité, développer les
filières agricoles en créant les conditions de valorisation de la
production, d'augmenter les revenus de ruraux, d'appuyer et développer
les initiatives privées agro industrielles...
Le plan REVA visait alors à lutter contre le
phénomène de l'immigration et la pauvreté, à
participer à l''amélioration de la sécurité
alimentaire et assurer la souveraineté alimentaire. L'Espagne, pays le
plus touché de ce phénomène, constitue le principal
bailleur du Plan avait décidé d'apporter un financement de 13
milliards de FCFA pour la création de fermes agricoles ; le Maroc 650
millions FCFA pour la réalisation d'une ferme de 20 hectares. Seuls
10.000.000 d'Euros, l'équivalent de 6,5 milliards de FCFA auraient
été versés dans les caisses de l'Etat, soit la
moitié des 13 milliards promis. Mais les questions à savoir
où était passée l'autre moitié restante ?,
l'intégralité du montant a-t-elle été versé
? demeure toujours en suspense.
Le modèle d'agriculture basé sur une
dépendance forte aux activités agricoles pluviales et un faible
niveau d'investissement a atteint ses limites33, la crise
alimentaire de 2008 ayant montré toutes les insuffisances de ces
politiques à assurer notre sécurité alimentaire. C'est
dans cette circonstance que la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et
l'Abondance (GOANA) a été lancée avec comme axe phare le
PNAR, et dont l'objectif principal était de booster le secteur agricole
par l'augmentation de la production agricole des principales cultures
consommées par les populations dont la culture du riz afin assurer la
sécurité alimentaire, de réduire la dépendance
nationale aux importations et ainsi de garantir la souveraineté
alimentaire. D'un montant de 400 milliards de ressources engagées lors
de sa mise en oeuvre, la Grande Offensive avait permis en 2009 à porter
la production à un record de 350 000 tonnes de riz blanc.
Certes, est de constater que malgré quelques
résultats intéressants enregistrés au vue d'importantes
ressources engagées, la GOANA avait malheureusement été
souvent impacté négativement en étant affectée par
des conflits entre différents acteurs comme l'absence de cohésion
et d'adhésion des producteurs et des organisations de producteurs. Le
Plan REVA, de même que la GOANA n'ont pas permis d'inverser les tendances
lourdes de dépendance du pays aux importations et la faible insertion
des jeunes dans l'agriculture. Les importations ne cessent d'augmenter et
continuent à accentuer la dépendance du pays vis-à-vis de
l'extérieur, même si
33 IPAR - Sénégal (2014) Initiative
Prospective Agricole et Rurale - Résumé Phase 2.
54
à coté on assiste à une timide
augmentation de la production nationale. Cette situation est favorisée
par un déficit de soutien et une faible protection de la production
nationale. Le phénomène d'immigration se développant de
jour en jour, prenne de l'ampleur et constitue aujourd'hui la principale
préoccupation des pays de l'UE, avec récemment la signature d'un
nouvel accord sur les migrants, le 20 Aout 2015 entre la France et la
Grande-Bretagne visant à une plus grande coopération entre la
France et la Grande-Bretagne.
9. SCA, 2008
Depuis l'indépendance, le Sénégal a mis
en oeuvres plusieurs programmes d'ajustement qui ne lui ont pas permis
d'assurer une stabilisation durable de l'économie et d'avoir une
croissance soutenue. Le taux de croissance annuel moyen du PIB avoisinait les
5%. La dévaluation du franc CFA a enclenché un processus de
développement stratégique de la compétitivité, de
partenariat opérationnel avec le secteur privé dans la conception
et l'élaboration et la mise en oeuvre des nouvelles politiques de
développement économiques. A partir des années 2000,
l'amélioration de la qualité du cadre macroéconomique
depuis la dévaluation de 1994 a porté ses fruits, permettant
ainsi d'atteindre des taux de croissance de 5% à 6%34.
Toutefois, malgré les performances enregistrées
à travers l'amélioration et du renforcement de la
compétitivité prix issues de la dévaluation grâce
notamment à la maîtrise de l'inflation, les problèmes de
compétitivité hors pris ou structurelle persistent.
L'accès des marches extérieurs restait toujours difficile, car
contraint par le niveau relativement élevé des coûts des
facteurs de production, l'accès difficile au foncier
aménagé et au financement ainsi que la mauvaise connaissance des
marchés extérieurs.
Face aux défis de la mondialisation et devant mettre
l'accent, conformément aux objectifs du millénaire, sur une
politique de réduction de la pauvreté d'ici 2015, il était
nécessaire d'accompagner cette dynamique de croissance afin d'atteindre
un taux minimal compris entre 7 et 8% et qui permettrait, sur une longue
période de réduire durablement la pauvreté. Ainsi, pour
accompagner cette dynamique de croissance dans un tel contexte de
mondialisation, l'Etat du Sénégal avec l'accord et l'implication
de l'ensemble des acteurs au développement, avait formulé la SCA
basée sur une série de grappes prioritaires à fort
potentiel en termes de croissance, de création de valeur ajoutée,
de compétitivité internationale, d'exportation, de
création de nouveaux emplois.
34 Ministère de l'Économie et des
Finances : Rapport annuel des performances de la SCA, 2013.
55
L'objectif principal de la SCA est de doter le
Sénégal d'un appareil de production restructuré,
bénéficiant d'un cadre macroéconomique stable et sain,
à même de s'adapter aux mutations nées de la
mondialisation, restant sur un sentier de croissance forte,
génératrice d'emplois, et réductrice des
inégalités parce que bâtie sur l'exploitation du plein
potentiel des individus, des communautés de base et des
régions35. Les objectifs essentiels concouraient à
accélérer la croissance économique de la manière la
plus efficace par l'amélioration qualitative de sa structure et à
diversifier les sources pour la sécuriser et la pérenniser. Sa
mise en oeuvre, par implication de l'ensemble des différents acteurs de
la grappe devait permettre de réduire voir éradiquer la
pauvreté.
Ainsi, la SCA venait appuyer les efforts déjà
entamés dans le cadre du DSRP en vue d'atteindre les OMD en 2015, dans
la mesure où elle vise à rendre opérationnel l'axe
création de richesse du DSRP, avec pour vocation la consolidation des
acquis et la création au niveau des entreprises et de l'ensemble du
tissu économique, des conditions préalables à la
réalisation des gains de productivité nécessaires pour
atteindre une croissance d'au moins 7%36 de 2007 à 2015. A
cet effet, elle s'appuyait sur la conduite de réformes portant sur les
déterminants microéconomiques ou structurels de la
compétitivité, autrement dit sur des facteurs impactant la
création de valeur ajoutée des produits "créneaux
porteurs" à avantages comparatifs, dans un environnement des affaires de
classe mondiale en vue d'attirer les investisseurs.
Parmi les cinq grappes identifiées que constituait la
SCA, figure la grappe « Agriculture et Agro-industrie ». Cette
dernière intégrait dans sa mise en oeuvre les objectifs de
sécurité alimentaire et de la GOANA. Reposant sur une vision
cohérente de promouvoir une agriculture et une agro-industrie
intégrées aux chaînes de valeur globalisées, elle
devait contribuer à une croissance durable et créatrice
d'emplois, avec une approche fondée sur la structuration des
filières agricoles en Sous-Grappes, et selon une démarche de
processus participatifs, intégrant tous les acteurs de la chaîne
de valeurs. Elle vise à accroître le potentiel de contribution du
secteur à la croissance du P11B et des investissements privés,
stimuler l'innovation, atteindre une production horticole annuelle 800.000
tonnes avec une part des exportations à plus de 6.25% par an, pour une
valeur de 48 milliards de francs CFA. Ce qui permettrait la réduction du
déficit de la balance commerciale d'au moins 15% et
l'amélioration du P11B de 2%.
35 Auteur : SCA Sénégal
36 Ministère de l'Économie et des
Finances : Rapport annuel des performances de la SCA, 2013.
56
En outre, elle vise la transformation de près de
231.000 tonnes de produits agricoles et d'élevage et de contribuer
à la création de plus de 75.000 emplois directs37.
Loin d'être un programme agricole venu s'ajouter aux initiatives du
gouvernement et des bailleurs, encore moins s'y substituer, la SCA se
présente non comme un outils ou un support sur lequel devrait s'adosser,
un cadre d'analyse permettant de cibler les interventions mais aussi un moyen
efficace de renforcer les différents programmes existants ou à
venir pour une meilleure contribution de la grappe Agriculture et
Agro-industrie à la croissance économique. Elle cherche produire
des indicateurs d'orientation et d'opérationnalisation pour identifier
les « créneaux porteurs » ainsi que les opportunités
stratégiques, les goulots d'étranglement et contraintes à
lever, les zones d'exploitation à potentiels élevés, les
ressources humaines à mobiliser, les activités à mener.
10. Programme National d'Investissement Agricole (PNIA,
2010), Programme Agricole Quinquennal (PAQ, 2011)
A l'instar de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, membres
de CEDEAO38, le Sénégal avait lancé en 2008, le
processus de formulation du Programme National d'Investissement Agricole (PNIA)
avec l'implication de toutes les parties prenantes au développement
rural ou au secteur agricole au sens large. C'est suite à la demande de
la CEDEAO que le Sénégal avait décidé
d'élaborer un programme d'investissement agricole pour rendre
opérationnel le Programme Détaillé de Développement
de l'Agriculture en Afrique (PDDAA). Adopté en février 2010, le
PNIA s'inscrit dans la mise en oeuvre du PDDAA définissant un cadre de
référence commun pour développement agricole avec
l'objectif d'accélérer la croissance, d'assurer la
sécurité alimentaire et d'éliminer la pauvreté et
la faim.
C'est ainsi, trois mois après l'adoption, un processus
post-pacte a été entamé, afin de mettre à en place
un comité technique chargé d'élaborer le Plan
d'Investissement (PI). Ce dernier se présente comme un outil de
planification pour la mise en oeuvre des actions prévues dans le Pacte
et le PNIA et s'inscrit dans la perspective d'une agriculture moderne et
durable, productive et compétitive sur les marchés
intra-communautaires ou internationaux, fondée sur l'efficacité,
l'efficience des exploitations familiales et la promotion des entreprises
agricoles, grâce à l'implication du secteur privé. Sa
démarche repose sur une rationalisation et une meilleure allocation des
investissements publics entre les différentes zones
agro-écologiques.
37 SCA Sénégal
http://www.sca.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=58
38 CEDEAO : Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest
57
Structuré en trois dimensions que sont le cadre
institutionnel pour la mise en oeuvre et le suivi-évaluation du Pacte,
la planification et la coordination des investissements, l'environnement des
investissements, il répartit entités des six programmes
prioritaires du PNIA autour de huit objectifs stratégiques à
savoir la réduction des risques climatiques par la maîtrise de
l'eau, la préservation et gestion durable des autres ressources
naturelles, l'augmenter de la production et l'amélioration de la
productivité globale des facteurs, la valorisation des produits
agricoles par leur transformation, l'amélioration de l'accès aux
marchés des produits agricoles, le renforcement de la recherche pour
l'innovation et le transfert de nouvelles technologies dans la production, la
transformation et la commercialisation, le renforcement des capacités
des différents acteurs, et afin un pilotage et une coordination efficace
dans la mise en oeuvre du PI.
Estimé environ 2 milliards de francs CFA dont 81 % sont
des investissements, le PI dispose d'une enveloppe de 1 346 milliards de francs
; la différence n'étant pas pris en compte dans le PI car
correspondant à des dépenses déjà engagées
dans des projets en cours d'exécution, et dont les effets contribueront
à l'atteinte des objectifs officiels pour le secteur à l'horizon
2015. Sa mise en oeuvre devrait améliorer qualitativement la situation
du secteur agricole, en impactant positivement sur le PIB agricole avec une
croissance moyenne annuelle de 7,2 %, et de 5,1% sur le reste de
l'économie. Ainsi, l'incidence nationale de pauvreté devra
baisser de plus de la moitié de son niveau en 2005, ressortant à
18 % en 202039.
Cependant, la vision du PNIA se voit restreint, limitée
suite à l'élaboration et l'adoption d'un nouveau programme en
2012 : le Programme Agricole Quinquennal (PAQ). Ce dernier apparait comme
restrictif de la vision du PNIA et marque la persistance des mauvaises
pratiques de gouvernance sectorielle. D'un coût global estimé
à plus de 1.616,75 milliards de FCFA40 pour sa
réalisation, le PAQ devait contribuer à la mise en oeuvre du
programme « Yoonu yokkuté » : la voie du véritable
développement. En tant que vision de développement et
composé de différents axes dont les principaux sont la
maîtrise de l'eau, la question foncière, la mécanisation,
la problématique de la mécanisation agricole, l'accès des
produits aux marchés locaux comme internationaux, la
problématique de la recherche-formation, le conseil agricole et rural,
est la partie économique du programme « Yoonu Yokkuté »
qui ambitionne de porter la production de rizicole à près de
1.080.000 tonnes de riz blancs en cinq ans, pour atteindre l'autosuffisance
alimentaire.
39 Processus de mise en oeuvre de l'ECOWAP/PDDAA :
Doc. Programme national d'investissement agricole - Plan d'investissement
2011-2015
40 Selon la même source.
58
11. Stratégie Nationale de Développement
Economique et Social (SNDES, 2012), Document de Politique Economique et Sociale
(DPES, 2011), Documents de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP, 2000)
L'élaboration de la Stratégie Nationale de
Développement Economique et Social (SNDES) sur la période
2013-2017 obéit à la volonté politique d'inscrire le
Sénégal sur la voie du développement. Elle s'effectue dans
un contexte économique mondial difficile, marqué par la
flambée des prix des produits alimentaires et
énergétiques. Suite à la l'élection
présidentielle 2012 qui a vu l'arrivé d'un nouveau régime,
le Document de Politique Economique et Sociale (DPES) prévue pour la
période 2011-2015 n'a pas eu le temps de voir réaliser sa mise en
oeuvre, et s'est vu avorté, car gommé par le régime
nouvellement élu. C'est ainsi que les nouvelles autorités ont
validé à la place et après une actualisation du DPES, la
SNDES qui constitue le cadre consensuel de coordination des interventions
publique. Le nouveau document s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté
et les inégalités sociales et se chargera de définir la
nouvelle vision de politique de développement pour la période
2013-2017.
Après la mise en oeuvre de deux
générations de Documents de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté (DSRP) de 2003 à 2010, le Sénégal
s'était doté d'un nouveau Document de Politique Economique et
Sociale (DPES) pour la période 2011-2015. Le premier Document de
Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté, DSRP-I,
portant sur la période 2003-2005 devait permettre de consolider les
performances économiques des programmes structurels et le
deuxième DSRP-II couvrant la période 2006-2010 s'était
engagé dans la mise en oeuvre de la Stratégie pour la Croissance
et la Réduction de la Pauvreté (SRP). En plus d'avoir permis la
correction de quelques insuffisances aux plans social et politique, le premier
a été un véritable instrument de mobilisation de
ressources et de recentrage des politiques de développement autour
d'objectifs clairement définis et assortis d'indicateurs de performance
et d'impact. Quant au deuxième, il a permis d'associé la
Stratégie de Réduction de la Pauvreté à la
Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) pour une
meilleure réorientation des objectifs de développement
économique et social prenant en compte la réduction des
inégalités sociales et l'accélération de l'atteinte
des OMD.
En 2011, le Sénégal se voulait devenir un pays
émergent en adoptant le DPES articulé autour de trois axes qui
ont pour objectif de mettre le pays sur la voie de l'émergence, dans un
environnement harmonieux et solidaire. C'est ainsi qu'il a été
validé par le gouvernement en accord et avec l'implication de tous les
différentes acteurs et parties prenantes à savoir les bailleurs
de fonds, la société civile, le secteur privé, les
parlementaires ainsi que les élus locaux. Nécessitant un
financement d'un montant total de 5.745 milliards de FCFA pour sa mise en
59
oeuvre dont les 4718 milliards étaient
déjà acquis, le DPES garantissait un développement durable
avec un taux de croissance de 6% à 7% d'ici 2015. Malheureusement, avec
l'arrivée d'un nouveau régime, on assiste à l'adoption
d'une nouvelle stratégie au détriment du DPES.
Aujourd'hui, on ne parle plus de DSRP, ni de DPES mais
plutôt de la SNDES. Adoptée en novembre 2012 par le Gouvernement
et l'ensemble de ses partenaires au développement, Elle repose sur la
vision d'un Plan stratégique Sénégal Emergent (PSE) visant
l'émergence économique à l'horizon 2035. En effet, la
perspective d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement à l'horizon 2015 s'éloigne de plus en plus,
une politique d'aménagement du territoire appliquée
jusque-là inappropriée, une croissance du PIB faible dans un
climat économique terne, sans dynamique, le Sénégal a
décidé d'adopter un nouveau modèle de développement
pour accélérer sa marche vers l'émergence. Pour ce faire,
des ruptures devront être engagées à travers des actions
concrètes, pertinentes, hardis pour satisfaire la forte aspiration des
sénégalais à un mieux-être et permettront d'inscrire
le Sénégal sur la voie de l'Emergence. Cette aspiration se
décline en une vision qui est celle d'« Un Sénégal
émergent en 2035 avec une société solidaire dans un
État de droit »41.
Cette stratégie, dénommée PSE constitue
le référentiel de la politique économique et sociale sur
le moyen et long termes. C'est ainsi que le Plan d'Actions Prioritaires (PAP)
articulé sur la période de 2014 à 2018 a été
mis en place pour opérationnaliser le PSE à travers la mise en
cohérence des axes stratégiques, objectifs sectoriels et lignes
d'actions, avec les projets et programmes de développement dans un cadre
budgétaire. Ce PAP constitue le document de référence des
interventions de l'Etat, des partenaires techniques et financiers, du
partenariat public-privé et de la participation citoyenne, à
moyen terme. Le PSE est évalué à hauteur de 9.686
milliards de FCFA pour sa réalisation, avec un financement acquis de
5738 milliards soit 59,2%. Tandis que la somme restante du financement à
rechercher représente 30,6% et la part à couvrir par les recettes
additionnelles et les économies sur les dépenses correspondant
à 10,2%. Le financement déjà acquis provient de
l'État 56,1%, des Partenaires techniques et financiers 35,8% et du
Privé 8,1%42.
Ainsi, pour favoriser une croissance économique
à fort impact sur le développement humain, le gouvernement du
Sénégal devra alors chercher à consolider les acquis,
notamment en matière de gouvernance démocratique, et de recentrer
les priorités dans la perspective de garantir
41 Plan Sénégal Emergent (PSE) 2014
42 PSE, 2014.
60
durablement la stabilité économique, politique
et sociale. La mise en oeuvre d'un programme d'investissements dans les
secteurs porteurs « créneaux porteurs » est capitale afin
d'impulser une dynamique de croissance forte et soutenue, avec
nécessairement l'implication et l'engagement de tous les acteurs ainsi
qu'une importante mobilisation de ressources financières auprès
des partenaires publics et privés.
12. Programme d'Accélération de la Cadence
de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS, 2014)
Dans le but de relancer la croissance du secteur agricole pour
servir de moteur à la transformation économique et la
réduction de pauvreté et pour faire face aux contraintes à
relever relatives à la dégradation des aménagements et des
infrastructures hydrauliques, à la vétusté des
équipements d'irrigation, à la faiblesse et à
l'inadéquation de financement sur toute la chaine de production, aux
problèmes de commercialisation et de l'enclavement des zones de
production, le Sénégal avait élaboré
récemment en 2014, le Programme d'Accélération de la
Cadence de l'Agriculture Sénégalaise (PRACAS) avec un Plan
d'Action Prioritaire (PAP) pour la période de 2014 à 2018. D'un
coût global de 581 milliards de francs, le PRACAS vise l'autosuffisance
du en riz, parmi d'autres objectifs, et se présente comme étant
le volet agricole du PSE avec pour objectif l'atteinte à moyen terme de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il représente
support catalyseur permettant d'atteindre les objectifs déclinés
dans le PNIA dans des délais plus courts.
Document de base qui constitue, polarise l'essentiel du volet
agricole du PSE, il est décliné en 4 grands axes mettant l'accent
essentiellement sur l'autosuffisance en riz, mais aussi sur le
développement des filières arachidières, le
développement de l'horticulture, le renforcement de la
sécurité alimentaire, entre autres. Mis en oeuvre en vue de la
production de riz blanc de très bonne qualité au
Sénégal, le PRACAS a pour objectif d'atteindre 1,6 million tonnes
de riz paddy, soit 1,08 million tonnes de riz blanc de très bonne
qualité à l'horizon 2017, avec une contribution de 60% attendue
des zones irriguées que sont la Vallée du Fleuve
Sénégal et Anambé, et une participation de 40% des zones
pluviales en l'occurrence du sud du pays. Ainsi, sa mise en oeuvre permettra de
faire 313 milliards d'économies sur le riz et l'obtention de 2 points de
croissance43.
43 SECK A. P, 2014 MAER Sénégal.
61
L'atteinte de ses résultats semble être
conditionnée par la réalisation d'emblavures à plus de
330.000 ha dont 55% proviendront des zones pluviales44. Toutes fois,
pour relever le défi de l'autosuffisance en riz, le PRACAS ambitionne
déjà de réaliser durant la campagne agricole 2014/2015,
900.000 tonnes de riz paddy toutes zones confondues, en ciblant 5 grands
bassins rizicoles dans la stratégie de mise en oeuvre du volet riz,
mettant en oeuvre 90.750 ha dans la Vallée du Sénégal,
3900 hectares dans la Vallée de l'Anambé et 120.000 ha dans la
zone pluviale destinées à la culture du riz45.
La mise en place d'un programme des Domaines Agricoles
Communautaires (DAC) va permettre de renforcer le dispositif avec
l'aménagement de 30.000 ha de terres, équipées
d'infrastructures structurantes de maîtrise de l'eau. L'équipement
sur place sera renouvelé avec du matériel agricole moderne
subventionné à hauteur de 70% sans TVA et comprenant près
de 1.400.000 nouvelles unités de matériels. Il s'agira d'assurer
l'autoconsommation et l'autosuffisance dans les zones de production. Ces
initiatives se traduiront par des impacts significatifs sur la balance
commerciale, en termes de réduction de nos importations, pour au moins
250 milliards de FCFA, tandis que les filières d'exportation devraient
rapporter plus de 150 milliards de FCFA à l'horizon 201746.
Un financement de 74 milliards de FCFA sera nécessaire pour la
réalisation du volet riz et dont 40% déjà disponible dans
les caisses de l'Etat.
Le PRACAS, un outil de développement de l'agriculture
au Sénégal trouvera son succès dans la démarche et
les efforts de l'Etat, les partenaires techniques et financiers et la
société civile. Et par conséquent, la contribution de tout
le monde demeure un facteur essentiel à sa réussite. Toutes fois,
des contraintes majeures sont à relever pour parvenir à atteindre
les objectifs à savoir la vétusté des équipements
d'irrigation et l'insuffisance du matériel de production, le financement
de la production, la problématique des mécanismes de
commercialisation du riz local, l'enclavement des zones de production. A
ceux-là, s'ajoute la forte pression aviaire, l'ensablement des
rizières, l'électrification des stations de pompage, le
coût de l'électricité, l'endettement des producteurs de la
vallée, le problème du foncier qui ne cesse de prendre de
l'ampleur.
Depuis quelques années, le Sénégal est
confronté à d'importants conflits pour l'accès à la
terre. Ces problèmes fonciers sont devenus aujourd'hui si
préoccupants constituent une entrave au
44 Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR),
Rapport 2015 sur l'état des lieux des impacts des importations de riz
sur la commercialisation du riz local.
45 SECK A. P, 2014 MAER Sénégal
46 Gouvernement du Sénégal :
Déclaration de Politique générale du Premier Ministre,
2014.
62
développement agricole en l'occurrence de
l'agro-business. Ils ont été la contrainte majeure à la
réussite de la GOANA qui n'est jamais parvenu à sa
résolution. L'accaparement des terres par des multinationales, des
filiales étrangères et des sociétés privées
dont la plupart l'essentiel de la production est destiné à
l'exportation, apparait comme un phénomène qui hypothèque
l'avenir des générations futures non seulement en privant les
petits paysans de leurs terres, et en les transformant en ouvriers agricoles
travaillant dans ces entreprises. Le modèle d'agrobusiness tel
pratiqué entraîne un transfert massif de terres des exploitations
familiales vers les investisseurs privés. Ce phénomène
s'inscrivant dans la logique de l'agrobusiness orienté principalement
à la recherche de profit constitue une menace à la
souveraineté alimentaire et apparait incompatible voir contradictoire
avec les objectifs de la souveraineté dans la mesure où il se
développe au détriment de l'agriculture familiale.
Pour qu'une agriculture moderne puisse se développer,
il est important que la question du foncier soit résolue. Il faut que la
commission de réforme du foncier vienne avec des propositions
concrètes qui permettent de combiner à la fois l'investissement
du secteur privé et la protection des exploitations familiales.
L'amélioration de la gouvernance foncière devrait permettre un
accès équitable à la terre et remédier à la
situation d'insécurité foncière. Concernant l'endettement
des paysans, il est une libération de crédit de campagne d'un
montant global de 16,3 milliards de FCFA de la part de la CNCAS et des autres
acteurs financiers de la filière. Toutes fois, la réussite du
PRACAS par la réalisation des objectifs fixés, reste
corrélée avec une meilleure implication des partenaires
stratégiques et de toutes les parties prenantes.
63
PARTIE VI : Politiques et stratégies de
développement de la filière
rizicole
I. Importance du riz et enjeux de développement de
la filière
1. Place du riz dans la production nationale
sénégalaise
Le Sénégal est fortement dépendant de
l'extérieur, surtout de par ses importations en riz. La part des
quantités de riz importé représente 80% de la consommation
nationale en riz. Les fortes potentialités hydro-agricoles de la
vallée du fleuve Sénégal avec une superficie de 240.000 ha
permettraient pourtant de couvrir environ 70% des besoins nationaux. Seulement
25% de la superficie soit 60.000 ha aménagées et mises en valeur,
ne permette de couvrir qu'une part des besoins de consommation et contraint le
Sénégal à dépendre majoritairement des importations
de riz asiatiques. Dans une région où le seuil de pauvreté
dépasse les 40 % de la population, les conditions de marché et
les efforts engagés durant la dernière décennie, ont
pourtant permis de rétablir la compétitivité de la
production locale, de productivité avec un rendements de 6 Tonnes/ha et
de créer les conditions favorables à de nouveaux investissements
dans l'agriculture irriguée47. Le développement de
l'agriculture, et notamment de l'agriculture irriguée, est une
priorité constante des pouvoirs publics. L'agriculture irriguée
pourrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et
à améliorer la sécurité alimentaire.
2. Place de choix de la filière dans
l'élaboration de stratégie et politique de développement
pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et
réduction de la pauvreté.
Depuis les années 2000, les autorités
sénégalaises mettent en oeuvre, à travers sa
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), des
politiques et programmes intégrés, dans une démarche
inclusive avec l'objectif d'assurer des conditions d'une croissance soutenue et
durable à même de réduire significativement la
pauvreté et d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). En effet, lors du sommet du Millénaire tenu
du 6 au 8 septembre 2000
47 AFD Agence Française de Développement
(2011)
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/18901
64
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, il s'est
conclu avec l'adoption par les 189 États Membres de la
Déclaration du Millénaire, dans laquelle ont été
énoncés les huit (8) OMD.
Le premier Document de Stratégie pour la
Réduction de la Pauvreté, DSRP-I, portant sur la période
2003-2005 devait permettre de consolider les performances économiques
des programmes structurels et le deuxième DSRP-II couvrant la
période 2006-2010 s'était engagé dans la mise en oeuvre de
la Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté (SRP). En plus d'avoir permis la correction de quelques
insuffisances aux plans social et politique, le premier a été un
véritable instrument de mobilisation de ressources et de recentrage des
politiques de développement autour d'objectifs clairement définis
et assortis d'indicateurs de performance et d'impact.
Quant au deuxième, il a permis d'associé la
Stratégie de Réduction de la Pauvreté à la
Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) pour une
meilleure réorientation des objectifs de développement
économique et social prenant en compte la réduction des
inégalités sociales et l'accélération de l'atteinte
des OMD. L'élaboration de la Stratégie Nationale de
Développement Economique et Social (SNDES) sur la période
2013-2017 obéit à la volonté politique d'inscrire le
Sénégal sur la voie du développement. Elle s'effectue dans
un contexte économique international difficile, marqué par la
flambée des prix des produits alimentaires et
énergétiques.
Au Sénégal, le taux de croissance annuel moyen
du PIB avoisinait les 5%, insuffisant pour réduire la pauvreté.
Pour ce faire, il fallait faire passer sur une longue période ce taux
à un taux minimal compris entre 7 et 8% permettrait de réduire
durablement la pauvreté48. C'est pourquoi, le
Sénégal s'est fixé l'objectif d'augmenter le niveau de la
croissance en formulant une SCA sectorielle basée sur une série
de grappes prioritaires à fort potentiel en termes de croissance, de
valeur ajoutée générée, de
compétitivité internationale, d'exportation, de création
de nouveaux emplois. Parmi les grappes identifiées figure le secteur
Agriculture et Agro-industrie.
3. Analyse de l'évolution de la consommation et
dépendance aux importations
La population du Sénégal étant
estimé à 12,874 millions d'habitants connaît un taux de
croissance annuel de 2,5%. Elle serait de 15,7 millions en 2020 et 18,9
millions en 203049. Toutefois, le Sénégal devra faire
face à l'augmentation de la pauvreté et
l'insécurité alimentaire. L'agriculture dispose d'un important
potentiel pour contribuer significativement à
48 Formulation de la SCA « Agriculture et
Agro-industrie »_Rapport final, Avril 2007.
49 PSE, 2014 : Prévisions ONU.
65
l'augmentation des revenus des ménages et à la
réduction de l'insécurité alimentaire du pays. Base de
l'alimentation et un des secteurs les plus importants de l'activité
économique, elle occupe près de 60% de la population active du
pays, contribue pour environ 16,7% à la formation du PIB (ANSD, 2012) et
constitue la base des sources de revenu de la majorité des pauvres des
zones rurales. Le secteur agricole sénégalais est
multifonctionnel. Le développement du secteur rizicole doit permettre
d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, de lutte
contre la pauvreté et de développement rural que s'est
fixé le pays.
Si la consommation apparente en riz au Sénégal
était de 400 000 tonnes en 1995, elle est passée à 800 000
tonnes en 2007, avec 106 milliards de F CFA pour les importations
nettes50. Ces dernières participent pour 16% au
déficit de la balance commerciale et ce phénomène a
tendance à s'amplifier dans le temps car la production nationale
progresse moins vite que la consommation qu'elle ne couvrait qu'à
hauteur de 20% seulement. Entre 1961 et 2012, les importations en riz ont
grimpé de plus de 700%. D'où cette dépendance de
l'extérieur de plus en plus accrue une denrée aussi
stratégique, ce qui expose le Sénégal à une
"précarité de l'offre et à la saignée des devises".
De 130 milliards de francs CFA injectés dans l'importation de riz en
2005, on est passé à 179 milliards en 200951. La
production nationale permettait de couvrir alors que 30% de la demande du
marché sénégalais. C'est ainsi que les autorités
ont pris l'option politique stratégique d'assurer l'autonomie
alimentaire du pays en riz afin de satisfaire la demande nationale.
II. Analyse de l'impact et situation actuelle du
Programme National d'Autosuffisance en Riz à l'horizon 2017
1. Programme National d'Autosuffisance en Riz à
l'horizon 2017 (PNAR, 2017)
Dans l'objectif d'asseoir le développement rural sur
une exploitation agricole familiale à moderniser tout en promouvant
l'entreprenariat agricole, aux choix formulés en 2000 dans le DSRP et
à ceux contenus dans la SCA de 2005, ont vu le jour différents
programmes de relance de la riziculture initiés par l'Etat en
référence à la Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale
(LOASP, 200452). Parmi ces programmes, figure le Programme National
d'Autosuffisance en
50 SARR Fallou, CTA 2013 : Analyse Du Système
De Connaissances Post - Récolte Au Sénégal: Cas Du Riz.
51 DIOUF W. (Février 2015), Coordonnateur
Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR), Ministère de
l'Agriculture et de l'Equipement Rural
52 Vote A l'Assemblée Nationale Le 25 Mai 2004,
Promulgation Le 04 Juin 2004
66
Riz à l'horizon 2012. Dans sa mise en oeuvre en 2007,
le PNAR prévoyait une production de 500.000 tonnes de riz blanc.
Un an après sa mise en oeuvre, ce programme a vu naitre
la GOANA en 2008. Cette dernière avait surtout mis l'accent sur les
cultures vivrières pour permettre d'assurer la sécurité
alimentaire et accordait une place de choix à la filière rizicole
locale. La consommation nationale était estimée à 600.000
tonnes de riz blanc par an53. Leurs mises en oeuvres ont permis
d'observer des avancées considérables dans le secteur rizicole en
termes d'investissements par le secteur privé national, d'augmentation
de la productivité et de rendement en mettant en place et à la
disposition des producteurs de nouvelles semences améliorées,
d'augmentation des capacités de transformation et des superficies de
production par des aménagements hydroagricoles, de la qualité du
riz et de sa compétitivité sur le marché. Cependant, les
résultats apparaissent très insuffisants pour atteindre les
objectifs.
Ainsi en 2014, dix années après l'adoption de la
LOASP par l'assemblée nationale et toujours dans l'objectif d'atteindre
l'autosuffisance en riz pour assurer la sécurité alimentaire,
l'Etat du Sénégal dans la mise en oeuvre du Programme National
d'Autosuffisance en Riz (PNAR) a injecté 74 milliards de francs CFA soit
environ 112 millions d'euros avec l'objectif d'atteindre l'autosuffisance en
riz à l'horizon 2017 avec une demande de consommation estimée de
1,08 million de tonnes de riz blancs.
2. Des résultats déjà prometteurs pour
la réussite du PNAR à l'horizon 2017
Le Sénégal est loin de couvrir le tiers des
besoins en riz qui sont estimés à 900.000 tonnes par an. Pour
obtenir une tonne de riz blanc, il faut une production de 1,48 tonne de riz
paddy. La demande du marché national ne cesse d'augmenter. A l'horizon
2017, les besoins de consommations des ménages sont estimés
à 1,6 millions de tonnes soit environ 1,08 millions de tonnes de riz
blancs. La PNAR a permis déjà de constater, une année
après sa mise en oeuvre, des avancés importants traduisant son
impact positif dans le secteur primaire. Apres une après une hausse de
2,7% en 2013, l'activité dans ce secteur s'est améliorée
avec une progression de 3,6% en 201454.
Cette progression traduit ainsi le renforcement de la valeur
ajoutée du sous-secteur agricole, qui se voit attribuée une
hausse de 4,7% en 2014 contre 0,4% l'année précédente, en
dépit de
53 S.A.E.D, 2006 : Programme National d'Autosuffisance En Riz
2007-2012 : Contribution De La Vallée Du Fleuve Sénégal
54 DPEE (Mai 2015) : Situation économique et
financière en 2014 et perspectives en 2015.
l'installation tardive de l'hivernage et du déficit
pluviométrique. La mise en oeuvre du PRACAS qui vise à construire
une agriculture compétitive, diversifiée et durable,
conformément aux orientations du Plan Sénégal Emergent
(PSE) a été a profitable et bénéfique au
sous-secteur agricole. Dans ce dernier, la relance notée est
porté principalement par l'agriculture vivrière qui s'est
inscrite en hausse de 6,3% en 2014 contre 1,0% en 2013, à la faveur du
dynamisme de l'horticulture où sont notées des avancées
remarquables et des performances observées dans la production notamment
du riz. Cette dernière, bénéficiant d'un programme visant
l'autosuffisance à l'horizon 2017, s'est nettement confortée
progressant de 28% par rapport à l'année 201355.
En 2015, l'activité dans le secteur primaire devrait
s'améliorer en 2015, sous l'effet, notamment, du renforcement du
sous-secteur agricole. Elle est ainsi projetée à 5,4% en 2015
contre 3,6% en 2014. Le sous-secteur agricole devrait bénéficier
de la mise en oeuvre du PSE à travers le PRACAS, d'importants projets
programmes portant principalement sur des filières bien ciblées
dont le riz, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'augmenter de
manière significative les revenus des producteurs. S'agissant de la
production de riz, elle profiterait, par ailleurs, des importantes
réalisations en termes d'aménagements dans la zone de la
vallée, conjuguées à la volonté politique des
pouvoirs publiques.
67
55 DPEE : Situation économique et
financière en 2014 et perspectives en 2015.
68
Conclusion
Au Sénégal, l'insécurité
alimentaire résulte de la conjonction de facteurs multiples et
cumulatifs autrement dit d'un ensemble de dysfonctionnements
stratégiques et de politiques inappropriées notamment dans le
secteur agricole. Parmi les facteurs contribuant à
l'insécurité alimentaire, les fortes fluctuations de la
production agricole semblent les plus déterminantes, non-seulement
à travers ses effets sur l'offre mais aussi sur les revenus des
populations rurales. L'instabilité du secteur agricole se traduit par de
fortes fluctuations des prix des produits alimentaires, affecte les revenus des
ruraux, les balances de paiement, les budgets de l'Etat et à long terme
réduit les investissements et innovations technologiques dans le secteur
primaire et le reste de l'économie. Le faible niveau d'investissement et
d'innovations technologiques perpétue la faiblesse de la
productivité des terres et du travail et se traduit par une
pauvreté de la majeure partie de la population. C'est ce contexte de
faible productivité et de pauvreté structurelle qui conduit
à la permanence de l'insécurité alimentaire.
La réalisation de la sécurité alimentaire
demeure un défi à relever en Afrique subsaharien notamment au
Sénégal où une frange importante de la population est
sous-alimentée. La situation et les perspectives d'évolution
pointent à une dégradation de la situation actuelle. La
pauvreté à l'échelle du pays, des ménages et des
populations est la principale contrainte à la disponibilité, la
stabilité et à l'accessibilité alimentaire. La croissance
de la productivité agricole, à travers la transformation du
secteur primaire reste fondamentale pour stimuler la croissance
économique qui permettrait de générer les emplois et les
revenus nécessaires à la réalisation de la
sécurité alimentaire. L'augmentation de la production locale est
l'un des moyens les plus sûrs pour se prémunir sur le long terme
contre les fluctuations des prix mondiaux. Toutefois, les performances du
secteur agricole déterminent à la fois la disponibilité et
l'accès aux denrées alimentaires pour la grande majorité
de la population sénégalaise.
Pour y parvenir, d'importantes actions visant à rendre
les systèmes de production plus productifs doivent être mise en
oeuvre tout en essayant de lever les contraintes actuelles d'ordre social,
économique et politique auxquelles est confronté le secteur
primaire. Des changements de politiques agricole seront nécessaires non
seulement pour améliorer les rendements en vue d'une augmentation de la
production mais également pour inciter l'investissement dans le secteur
agricole, particulièrement au secteur rizicole sénégalais.
Les options politiques récentes d'arriver à une autosuffisance en
riz en 2017 confirment les positions édictées par les
décideurs
69
au lendemain de la flambée des prix des denrées
alimentaire des années 2007-2008 qui était devenue une question
de paix, de sécurité et de stabilité nationales. Elles
préconisent le développement de la chaine de valeur du riz local
dans le but d'augmenter la production nationale de façon sensible et
arriver ainsi à une substitution des importations. Au regard des
résultats des études sur la transmission des prix56,
l'augmentation de la production locale demeure l'un des moyens les plus
sûrs pour se prémunir sur le long terme contre les fluctuations
des prix mondiaux.
Les options actuelles, quoique justes sur les principes
comportent des faiblesses dans la stratégie de mise en oeuvre. Elles
privilégient les aspects liés à la production surtout les
aménagements. Même si les décideurs reconnaissent la
nécessité de développer les infrastructures de stockage,
d'améliorer l'environnement institutionnel et financier, et de
résoudre les problèmes d'équipement qui freinent la double
culture, ils accordent une importance limitée à la
commercialisation, à la transformation et au développement de
partenariats d'affaires entre les différents maillons de la chaine de
valeur. Toutefois, si une bonne combinaison de politiques de stockage,
d'importations, d'aides alimentaires et de filets de protection sociale permet
de stabiliser les disponibilités et les prix intérieurs, et de
faire face à l'insécurité alimentaire transitoire, seule
la croissance de la productivité du secteur agricole et la mobilisation
de ces gains de productivité pour le développement
économique permettra d'atteindre la sécurité alimentaire
structurelle à moyen et long terme.
56 M. DIARRA, Fondation FARM : Mécanisme de
transmission de la hausse des prix des céréales depuis les
marchés mondiaux vers les marchés locaux : le cas des
céréales au Mali et au Sénégal, Septembre 2008. V.
MEURIOT, Une analyse comparative de la transmission des prix pour l'orientation
des politiques publiques : le cas du riz au Sénégal et au Mali,
Janvier 2012.
CSA/SIM : Rapport final de l'étude sur la transmission des
fluctuations et le calcul de prix de parité à
l'importation/exportation dans la sous-région : cas pratique du
Sénégal, Janvier 2010.
70
Recommandations
La sécurité alimentaire dépend
aujourd'hui d'une relance de la production nationale de céréales
dont le riz est l'élément principal. Le développement de
l'agriculture, et notamment de l'agriculture irriguée, est une
priorité constante des pouvoirs publics. La mise en place du programme
nationale d'autosuffisance en Riz à l'horizon 2017 par l'Etat
sénégalais, entend une production satisfaisant, pouvant couvrant
la demande à l'échelle nationale. Ainsi, en vue d'apporter des
solutions réalistes aux contraintes relevées et valoriser au
mieux les atouts qui s'offrent, des recommandations concrètes sont
faites sur la base des options stratégiques permettant d'atteindre
l'autosuffisance en riz, à travers le développement du secteur
agricole notamment de l'agriculture irriguée, pour lutter contre
l'insécurité alimentaire au Sénégal.
Dans cette logique, les mesures suivantes sont fortement
recommandées :
1. Augmenter la productivité et la production
agricole particulièrement rizicole par l'amélioration et
l'intensification des systèmes de production par la modernisation en
sécurisant les exploitations agricoles, l'intensification de la mise en
valeur des périmètres irrigués et l'exploitation de
nouveaux périmètres, la mise à disposition à temps
des intrants agricoles de bonne qualité.
2. La mise en valeur des potentialités
hydro-agricoles de la Vallée et le développement de l'agriculture
irriguée à travers une gestion rationnelle de la
ressource en eau, une sécurisation foncière des
aménagements hydro-agricoles, une politique cohérente de
maintenance des infrastructures construites, les moyens adéquats d'une
mise en valeur agricole à travers l'intensification et la
diversification des activités agricoles.
3. La réalisation d'infrastructures et la
modernisation de l'équipement agricole, par
l'amélioration de la gestion et une sécurisation foncière
des aménagements hydro-agricoles, la mise en place des nouvelles
infrastructures socio-économiques et la réalisation et
réhabilitation de nouveaux périmètres rizicoles, le
renforcement de la mécanisation agricole à travers le
renouvellement des matériels et outils de production, le renforcement
des infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation,
le désenclavement et l'électrification des zones de
productions.
4. L'accroissement des investissements du secteur
agricole en stimulant l'investissement privé et l'amélioration de
l'accès au financement rural à travers une
démarche
71
d'opérationnalisation des dispositifs de financements
par la mise en place de politiques d'incitatifs à l'investissement, la
mise en place de fonds de garantie d'investissements et de partenariat avec des
établissements financiers, accompagner les acteurs économiques
par des financements d'activités liées à
l'aménagement des terres, à la production et la
mécanisation, par l'achat de matériels agricoles.
5. La formation, le suivi et l'accompagnement des
acteurs agricoles, ainsi que l'appui à la commercialisation
à travers le renforcement des services publics en milieu rural
pour l'encadrement et le conseil agricole, la formation aux meilleures
techniques hydro-agricoles et de stockage, l'appui aux chaines de valeurs
agricoles et aux organisations professionnelles, des formations sur les
techniques d'utilisation des intrants.
6. Le renforcement de la structuration des
organisations professionnelles et interprofessionnelles par le
développement institutionnel à travers l'élaboration de
politiques de réformes institutionnelles et de structuration et
d'organisation des acteurs, renforcer les initiatives d'appui à la
filière, de développer les capacités organisationnelles et
de gestion des producteurs.
7. L'appui au secteur de la recherche pour stimuler
les processus d'innovations technologiques et la vulgarisation agricole
par approche participative, à travers le renforcement des
structures de recherche en termes de budgets, d'équipements et de
matériels pour permettre la mise au point des nouvelles
variétés de semences plus productifs, plus résistants, et
de techniques améliorées issus de la recherche pour
améliorer la productivité agricole et l'augmentation des
rendements ; à travers des techniques de vulgarisation par le partage
les résultats de la recherche et les savoir-faire avec les producteurs,
mais aussi à les aider à exploiter une plus large part de la
chaîne des valeurs.
8. L'amélioration de la
compétitivité et une meilleure promotion du riz local
par la mise en place d'une politique de valorisation du produit, une
politique de prix à partir du profil du consommateur et/ou
stratégie de marketing mix centré sur la commercialisation,
renforcer l'organisation de la commercialisation et l'efficacité des
circuits de distribution, améliorer le système de
commercialisation et la qualité, réaliser des campagnes de
sensibilisation des consommateurs sur le riz local, renforcer les mesures
d'ordre institutionnel et règlementaire sur la commercialisation du
riz.
9. Le renforcement de l'intégration entre la
chaîne de production et celle de transformation agroalimentaire,
pour incorporer davantage de valeur ajoutée à nos
72
produits, aux fins de promouvoir le « consommer local
» et réduire notre dépendance face aux importations.
10. Favoriser le développement de
l'agrobusiness et la promotion de l'entreprenariat agricole pour
permettre respectivement des chaines de valeur hautement productives et
rentables, qui pourront établir un lien efficace entre les petits et
moyens producteurs et les marchés et la mise en place de politique
d'appui à la promotion de l'entreprenariat agricole pour la
transformation socio-économique des zones rurales afin de rendre le
milieu rural attractif, de réduire significativement l'exode rural.
11. Entreprendre une réforme foncière
qui faciliterait l'accès au foncier, garantirait la
sécurité d'occupation foncière et constituerait un levier
important dans le processus de création de richesse, en
définissant un cadre réglementaire apte à promouvoir la
sécurité foncière des investisseurs par la création
et/ou le renforcement d'une commission nationale de réforme
foncière comme autorité compétente qui
légifère en matière foncière avec un pouvoir
affirmé et renforcé.
12. Instaurer une gouvernance foncière
pour favorise une exploitation optimale des potentialités de la
vallée, en partenariat et avec l'implication des collectivités
locales et les diverses catégories d'utilisateurs de la terre.
13. L'adoption d'une approche intégrée
dans la planification des actions et leurs mises en oeuvre tant au
niveau gouvernemental entre ministères: agriculture, économie,
commerce, que des acteurs à la base : structures d'encadrement et de
recherche, interprofessions, et organisations paysannes.
14. Améliorer la convergence des politiques
à travers un cadre de convergence stratégique de
sécurité alimentaire qui prend en compte et met en synergie
l'ensemble de ces stratégies et politiques sectorielles.
73
Bibliographie
1. Direction de la Prévision et des Études
Économiques (DPEE) Sénégal : « Situation
économique et financière en 2014 et perspectives en 2015
», Rapport 2015.
2. Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) : «
Etat des lieux des impacts des importations de riz sur la commercialisation
du riz local », Rapport 2015.
3. Colen, L., M. Demont, et J. Swinnen (2013), «
Participation des petits exploitants aux chaînes de valeurs agricoles
: Le cas de la production locale de riz au Sénégal »
Dans : Reconstruire le potentiel alimentaire de l'Afrique de l'Ouest, A.
Elbehri (ed.), FAO/FIDA.
4. ISRA Réflexions et Perspectives : « Impact
des cours mondiaux du riz sur la sécurité alimentaire au
Sénégal » Document Vol 6 N°6, 2008.
5. UGPANE Unité de Gestion des Programmes d'Appui aux
Acteurs Non Etatiques : « Problématique de la commercialisation
du riz de la Vallée du Fleuve Sénégal: Quelles pistes de
solutions durables? », Rapport Décembre 2009.
6. Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan :
« Programme Triennal d'Investissements Publics (PTIP) 2015 - 2017 »,
Octobre 014.
7. Gouvernement du Sénégal - FAO : «
Programme National de Sécurité Alimentaire » (PNSA,
phase I 2006-2010), 2006.
8. Ministère de l'Economie et des Finances, PSE :
« Plan d'Actions Prioritaires 2014-2018 »,
9. Gouvernement du Sénégal, SNDES 2013-2017 :
« Sur la rampe de l'émergence », 2012.
10. Gouvernement du Sénégal, DPES 2011-2015 :
«Un Sénégal sur la rampe de l'émergence, dans un
environnement harmonieux et solidaire », version provisoire, Avril
2011.
11. Gouvernement du Sénégal, DPES 2011-2015 :
« Placer le Sénégal sur la rampe de
l'émergence», version Finale, Novembre 2011.
12. Gouvernement du Sénégal, Plan
Sénégal Emergent (PSE), Février 2014
13. CEDEAO/ Processus de mise en oeuvre de l'ECOWAP/PDDAA :
« Programme National d'Investissement Agricole : Plan d'investissement
2011-2015 Sénégal »
14. Ministère Agriculture, Biocarburants et
Sécurité Alimentaire : « Programme National
d'Autosuffisance en riz », 2007.
15. GRET, Politiques agricoles et sécurité
alimentaire : « La loi sénégalaise d'orientation
agro-sylvo-pastorale (LOASP) »
16. CGERV Centre de Gestion et d'Économie Rurale de la
Vallée du Fleuve Sénégal : « Analyse
économique sur la production de riz dans la Vallée: Quelle
lecture de l'évolution de 2006 à 2008? », 2008.
17.
74
FALL A. : « Synthèse des études sur
l'état des lieux chaine de valeur riz au Sénégal »,
2015.
18. DAPS / ONRS Direction de l'Analyse, de la
Prévision et des Statistiques / Observatoire National du Riz au
Sénégal: « Etude bibliographique sur la filière
riz au Sénégal », Rapport Final 2004.
19. VECO West Africa : « Etat des lieux / analyse
des politiques, programmes et projets d'appui à la chaine de valeurs riz
au Sénégal : synthèse des programmes, projets et
études d'impacts des dits projets, programmes », Rapport
Décembre 2014.
20. IFLEX : « Le programme national d'autosuffisance
en riz mis en oeuvre via le dispositif institutionnel du PDMAS »,
Bulletin d'informations 1er semestre, 2011.
21. Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique Rurale
et de la Sécurité Alimentaire, DAPS/JICA : « Etude sur
la Réorganisation et de la Production du Riz », 2006
22. BAME / ISRA Cycle de conférences sur les
Politiques Agricoles : « impacts de la recherche sur le riz dans la
Vallée du Fleuve Sénégal », compte-rendu du 07
juin 2005.
23. AFD Agence Française de Développement :
« Etude sur la compétitivité du riz de la Vallée du
Fleuve Sénégal sur les marches nationaux et régionaux
», Rapport définitif 2009.
24. CGERV Centre de Gestion et d'Economie Rurale de la
Vallée du Fleuve Sénégal : « Diagnostic de la
filière riz, Analyse économique : campagne hivernale riz
2011-2012 ».
25. PRESAO / SRAI : « Analyse de la
compétitivité du riz local au Sénégal»,
Rapport Final Décembre 2011.
26. Ministère Agriculture, Biocarburants et
Sécurité Alimentaire : « Programme national
d'autosuffisance en riz : composante fourniture et installation de
matériel d'irrigation (Phase I) », 2007.
27. Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique
Rurale et de la Sécurité Alimentaire : « Nouvelle
Orientation de la Politique Agricole : Plan REVA Retour Vers L'agriculture
», Juillet 2006.
28. SAED Programme National d'Autosuffisance en Riz 2007-2012
: « Contribution de la Vallée du fleuve Sénégal
», Rapport 2006.
29. DIAGNE D. : « Etude sur le financement de
l'agriculture au Sénégal, de 1980 à 2010 : Plaidoyer pour
une plus grande allocation budgétaire », Rapport Final
2011.
30. Ministère Développement Rural et de
l'Agriculture/Mamour Gaye : « Programme spécial autosuffisance
en riz. Mise en valeur du potentiel irrigable », 2007.
31. Ministère Développement Rural et de
l'Agriculture / SAED : « Programme national d'autosuffisance en riz.
Contribution de la vallée du fleuve Sénégal »,
2007.
32. Ministère de l'Agriculture et de la
Sécurité Alimentaire : « Programme d'autosuffisance en
riz. Commission chargée du foncier et de la production »,
2007.
33.
75
Ministère de l'agriculture et de la
Sécurité Alimentaire, « Programme d'autosuffisance en riz.
Commission transformation et mise en marche du riz local », 2007.
34. Institut International de Recherche sur les Politiques
Alimentaires (IFPRI) : « Simulation des impacts de la politique
d'autosuffisance en riz de l'Afrique de l'ouest »
35. Projet PASIDMA : « Sécurité
alimentaire en Afrique Sub-saharienne: Quelle Stratégie de
Réalisation? », Rapport 2001.
36. République du Sénégal, SCA :
Formulation de la SCA « Agriculture et Agro-industrie »_Rapport
final, Avril 2007
37. CSA / WFP Programme Alimentaire Mondial : «
Marchés et réponses au déficit de production agricole
de la campagne 2011/2012 au Sénégal », Rapport
Février 2012.
38. ENDA Diapol, Etude sur les initiatives de concertation :
« Implications des acteurs ruraux dans la définition des politiques
de développement des filières vivrières en Afrique de
l'ouest et du centre », Rapport Sénégal, Novembre 2010.
39. FONGS Fédération des Organisations Non
Gouvernementales du Sénégal, Cycle de sensibilisation des
étudiants a la souveraineté alimentaire : «
Filière riz au Sénégal : Enjeux et perspectives
», Document Octobre 2008.
40. FALL A. : « Impact du crédit sur le revenu
des riziculteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal »,
Thèse Ecole Doctorale : Economie et Gestion de Montpellier,
Décembre 2006.
41. UEMOA : « Compétitivité des
filières agricoles dans l'espace UEMOA, Plan directeur des
filières prioritaires », Rapport Avril 2007.
42. ISE/UCAD, Rapport provisoire « Évaluation
intégrée des impacts de la libéralisation du commerce sur
la filière riz au Sénégal ». Janvier 2003.
43. ROPPA : « Campagne riz du ROPPA » Pour un
développement durable des filières riz en Afrique de l'Ouest.
http://www.roppa.info/IMG/pdf/Plaidoyer
sur le riz 5.pdf
44. AFD : « Développer l'agriculture
irriguée pour lutter contre l'insécurité alimentaire
»
45. WFP Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies :
« d'Analyse de Marché Sénégal: Commerce du Riz
», Rapport Août 2008.
46. PRIAF RIZ : « Analyse des filières riz par
les organisations professionnelles d'Afrique de l'Ouest », Manuel 2006.
47. PRESAO/SRAI : « Analyse de la
compétitivité de la filière rizicole dans la Vallée
du Fleuve et dans le Bassin de l'Anambé au Sénégal »,
Rapport Final Novembre 2011.
48. A.N.S.D : « Note d'Analyse du Commerce
Extérieur », 2006-2013.
49. I.P.A.R : Rapport « Etat des lieux des impacts
des importations de riz sur la commercialisation du riz local »,
Janvier 2015.
50.
76
Gouvernement du Sénégal, Document de
Stratégie pour la croissance et la Réduction de la
Pauvreté II, 2006-2010.
51. DIARRA M., Fondation FARM : « Mécanisme
de transmission de la hausse des prix des céréales depuis les
marchés mondiaux vers les marchés locaux : le cas des
céréales au Mali et au Sénégal »,
Septembre 2008.
52. Institut des sciences de l'environnement (ISE) : «
Evaluation intégrée de la libéralisation des
échanges et des politiques liées au commerce »,
Novembre 2004.
53. Ministère de l'Economie et des Finances :
Rapport annuel des performances de la SCA, 2013.
54. MEURIOT V., « Une analyse comparative de la
transmission des prix pour l'orientation des politiques publiques : le cas du
riz au Sénégal et au Mali », Janvier 2012.
55. C.S.A/SIM, Rapport final : « Etude sur la
transmission des fluctuations et le calcul de prix de parité à
l'importation/exportation dans la sous-région : cas pratique du
Sénégal », Janvier 2010.
56. C.T.A : « Analyse du Système de
connaissances post - récolte au Sénégal: Cas du riz
», 2013.
57. Gouvernement du Sénégal, Formulation de la
SCA « Agriculture et Agro-industrie » Rapport final, Avril 2007.
58. Gouvernement du Sénégal : «
Déclaration de Politique générale du
1ère Ministre », 2014
59. S.A.E.D, Programme National d'Autosuffisance En Riz
2007-2012 : « Contribution de la Vallée du Fleuve
Sénégal », 2006.
60. I.S.R.A Institut Sénégalaise de Recherches
Agricoles, Document de Travail 1986-1.
61. D.P.E.E, Rapport 2014 : « Situation
économique et financière en 2014 et perspectives 2015
».
62. I.R.D : Rapport Mars 2000 : « Mesurer Les
Nuisances Des Ravageurs Du Riz En Asie Tropicale Pour Etablir Des
Priorités De Lutte ».
63. Ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique,
Rapport Avril 2003 : « Lettre de politique de développement de la
filière arachide ».
64. Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR)
Sénégal, 2014 : « Initiative Prospective Agricole et Rurale,
Résumé Phase 2 ».
65. ECOWAP/PDDAA Processus de mise en oeuvre, Document :
« Programme national d'investissement agricole - Plan d'investissement
2011-2015.
Annexes
Tableau 1 : Filière riz au
Sénégal : Production, Superficies, Rendements, Demande
intérieur de 2004 à 2015
|
Années
|
Superficies (ha)
|
Rendements (Kg/ha)
|
Productions
Paddy (T)
|
Equivalent
riz blanc (T)
|
Demande
(T)
|
Taux de
couverture
|
|
2004/05
|
81 486
|
2 476
|
201 744
|
133 151
|
782 219
|
17%
|
|
2005/06
|
97 779
|
2 854
|
279 080
|
184 193
|
832 974
|
22%
|
|
2006/07
|
85 037
|
2 240
|
190 493
|
125 725
|
896 123
|
14%
|
|
2007/08
|
80 312
|
2 408
|
193 379
|
127 630
|
921 538
|
14%
|
|
2008/09
|
125 329
|
3 257
|
408 219
|
269 425
|
970 972
|
28%
|
|
2009/10
|
139 388
|
3 602
|
502 104
|
331 398
|
1 010 215
|
33%
|
|
2010/11
|
147 208
|
4 103
|
604 043
|
398 668
|
1 063 302
|
37%
|
|
2011/12
|
109 177
|
3 717
|
405 824
|
267 844
|
1 105 543
|
24%
|
|
2012/13
|
117 729
|
3 989
|
469 649
|
309 968
|
1 161 839
|
27%
|
|
2013/14
|
108
|
4 018
|
436 153
|
287 861
|
1 215 784
|
24%
|
|
2014/15
|
|
|
630 000
|
|
|
|

Figure 1 : Espace agricole au
Sénégal57
57 IRD
77

Figure 2 : L'aménagement de la
Vallée du Fleuve Sénégal58
78
58 SAED
| 


