INTRODUCTION GENERALE
01. PROBLEMATIQUE DE
GESTION
Le troisième millénaire connaît un monde
en perpétuelle évolution marqué par de sérieuses
avancées dans tous les domaines. A côté de celles-ci, on
note des conflits entre individus, communautés ou nations - pays
(1(*)) qui les bouleversent
et mettent en péril la paix, l'économie et le social.
La période se marie au concept mondialisation qui sous
- tend le développement de tous les pays par la création de
systèmes de gestion adéquate des ressources tant humaines,
naturelles que minérales. C'est à ce moment que naît le
grand défi, celui de savoir gérer - mieux la bonne gouvernance.
Si les pays plus avancés et les institutions mieux organisées ont
réussi à relever le défi, les pays nantis et leurs
entreprises sont encore très loin de la ligne d'arrivée. Les
politiques, toutes tendances confondues (gouvernants, opposants et rebelles),
font des déclarations, mais ne sont pas en mesure de lier leurs paroles
aux actes qu'ils posent ; il y a aussi le non respect de la parole
donnée. Et la population, naïve, assiste impuissamment à
l'application du machiavélisme au 21 è S., et ce, malgré
les révolutions au fil des périodes de l'histoire. Quelle
horreur !
Partout on crie mégestion. Mais qu'est-ce qui n'est pas
bien géré ? Est-ce le pays ? l'économie ?
les finances ? la forêt ? les hommes ? la faune ? le
sous - sol ? la politique ? la diplomatie ? Disons que toutes
ces interrogations font partie de la bonne réponse.
Cela étant, il y a lieu de considérer que,
hormis les ressources humaines, tout le reste constitue le patrimoine.
Etant donné que toute oeuvre scientifique se veut une
interrogation et/ou une réflexion qui porte soit sur l'homme ou son
environnement, soit sur un fait qui touche l'Etre suprême que certains
philosophes appellent le Transcendant, la nôtre s'intéresse
à la gestion de patrimoine par rapport à l'orientation suivie.
La formation reçue dans le
domaine susmentionné fonde le choix du thème sur lequel nous nous
sommes apaisanti, afin que soit tiré au clair les imperfections y
afférentes.
Le but poursuivi est celui
d'apporter notre contribution, tant peu soit - elle, dans l'assiette de gestion
de ce grand édifice qu'est l'OFIDA.
D'aucuns nous trouveront
très imposteur s'ils n'arrivent pas à appréhender la
portée de notre apport scientifique ; mais, bien d'autres, soucieux
d'apprendre, saisiront l'opportunité que nous leur offrons pour
acquérir des connaissances nouvelles dans la mesure où le savoir
s'apprend.
Nous faisons remarquer en passant
que toute personne physique est, en naissant, d'office possesseur d'un
patrimoine. Ceci conduit à ce que bien le gérer, aidera la
société humaine à se doter spontanément de bons
gestionnaires. Ce qui résoudra bon nombre de problèmes qui se
posent en son sein par rapport à la mégestion. C'est ainsi que
nous en appelons à la prise de conscience, et cela, à l'endroit
de tout congolais en général ; et, de tout responsable du
service douanier en particulier pour qu'il vive et soit en mesure de
répondre aux attentes et des douaniers et du pays.
Notre approche thématique, nous l'astreignons à
l'OFIDA/Province douanière de l'Equateur, afin de bien cerner la
question.
La réflexion repose sur le patrimoine existant et
comment le gère-t-on. L'hypothèse que nous formulons, c'est que
le patrimoine de l'OFIDA Equateur n'est pas géré comme il se
doit.
Nous tâcherons de prouver que cette affirmation tient
debout en vue de la confirmation de l'hypothèse telle
qu'émise.
Toutefois, travail scientifique oblige, nous sommes contraint
à proposer des solutions ou des réponses à
l'interrogation, celle de comment gérer ? ou que faut-il faire pour
arriver à bien gérer le patrimoine ?
Loin de nous la prétention de mettre sur pied une
méthode appropriée ; mais bien au contraire, nous aimerions
que notre apport soit correctionnel pour les uns et modèle pour les
autres. En d'autres termes, que ceux qui essayent de bien gérer fassent
mieux ; et, que ceux -là qui ne sont pas organisés
commencent à tenir bon.
En optant pour s'interroger et réfléchir autour
de la gestion de patrimoine, nous nous sommes dit que la mégestion dans
ce domaine est une des causes majeures qui engendrent des troubles, des
conflits, des envies... dans une société et c'est ce qui bloque,
des fois sans qu'on se rende vraiment compte, le bon fonctionnement d'une
entreprise tant familiale, nationale qu'internationale.
02. TERMINOLOGIE THEMATIQUE
Ici, par terminologie, il faut entendre l'ensemble des termes
clés avec lesquels nous avons pu formuler notre thème. Il y en a
cinq, à savoir : Histoire, Gestion, Patrimoine, Douanes et Accises.
C'est compte tenu des lacunes constatées dans l'usage
de ces mots que nous avons opté pour donner ci-dessous, de façon
explicite, leur signification respective.
1. HISTOIRE
Du latin « historia », l'histoire
appartient au vaste domaine des sciences humaines.
Généralement, l'histoire a pour objet
l'étude des sociétés dans leur cadre spatio-temporel
(2(*)).
C'est à titre que dans « faire de
l'Histoire », J.LEGOFF dit ceci: « tout est objet
d'histoire ».
Le dictionnaire Universel (3(*)) définit l'histoire simplement comme science de
la connaissance du passé. Notons cependant que l'historiographie en est
la méthodologie et que sa scientificité a été
prouvée par son épistémologie.
Pourtant, eu égard à sa vision globale, LEVI
STRAUSS soutient que « tout est histoire » ce qui justifie
la totalité de la science historique.
Toutefois, en tant qu'historien, et cela par
rapport à l'intérêt que nous avons, celui de reconstituer
le passé avec minutie - mieux savoir comment se construisent, perdurent
et évoluent des sociétés dans le temps à travers
des cadres bien définis, nous disons que l'histoire est la
science de la connaissance des faits passés humains qui permet de
scruter le présent pour bien vivre en vue de mieux projeter
l'avenir.
Nous soutenons de surcroît le caractère subjectif
pour le travail de l'historien dans la mesure où il est contraint
à opérer des choix.
2. GESTION
Le concept « gestion » dérive du
verbe gérer. La gestion est l'action ou la manière de
gérer, d'administrer ou de diriger.
Du point de vue managérial, le mot gestion consiste
à mobiliser, à affecter et à gérer les ressources -
entendez humaines, naturelles, minérales, etc. Ce qui conduit aux
conceptions telles que gestion des ressources humaines (GRH), gestion des
ressources naturelles
(GRN ou gestion de l'écosystème), informatique
de gestion ou gestion de banque des données, gestion de
patrimoine (GP)...
H. FAYOL (4(*)) met l'accent sur la fonction administrative de la
gestion. Pour lui gérer, c'est administrer ; et, administrer, c'est
PREOCOCOCO, ce qui veut dire : Prévoir, Organiser, Coordonner,
Commander et Contrôler.
Notons cependant que la réussite de ce schéma
Fayoliste tient de la planification et de l'exécution sans faille du
projet. C'est là que leadership devant conduire les opérations
pose problème.
A l'heure qu'il est, la mégestion dans les affaires
n'est plus à tolérer.
C'est ainsi que la gestion, qui était jadis compris
comme le simple fait de gérer, se conçoit méthodiquement
pour que cesse le dérapage dan s ce domaine du savoir.
3. PATRIMOINE
En latin « patrimonium » désigne
l'ensemble des biens hérités de son père et/ou de sa
mère.
Par extension, le terme signifie les biens, les charges et les
droits (passifs et actifs) évaluables en argent appartenant soit
à une personne, soit à une entreprise, soit à une
communauté ou à un pays.
En droit, le patrimoine d'une personne comprend tous ses biens
et toutes ses obligations (5(*)). Ainsi, tout patrimoine suppose à sa
tête une personne physique ou morale de droit privé ou public.
Les passifs et actifs formant le patrimoine rattaché
à la personne ne signifie pas forcément richesse (6(*)).
Pris comme tel le vocable « patrimoine »
présente une complexité ; d'où la
nécessité de bien le connaître pour mieux le gérer.
Juridiquement parlant, la notion des biens constituant le
patrimoine renvoie à ce qu'ils sont mobiliers et immobiliers (immeubles)
soit par leur nature, soit par leur incorporation, soit par leur
destination.
Aussi faut - il que nous précisions le patrimoine qui
intéresse notre recherche, c'est bel et bien celui de l'OFIDA/Equateur.
En quoi se constitue - t - il et comment le gère - t- on fondent notre
préoccupation - mieux l'objet de notre étude.
4. DOUANE (S)
L'histoire nous apprend que le mot douane qui se dit :
« alqabala » en arabe ;
« portaria » en latin ; et, douana en italien,
signifie :
1. au singulier, l'administration chargée de percevoir
les droits et taxes sur les marchandises à l'entrée (ID) ou
à la sortie (SD) d'un pays.
Pris dans ce sens, il désigne également le lieu
(bureau) où est établie cette administration ;
2. au pluriel, les droits et taxes, y compris les
opérations dus à la traversée ou au passage (7(*)) des marchandises au niveau des
frontières des Etats.
Selon Vital BUNDU PHEMBA (8(*)): « le concept douane englobe l'ensemble des
règles juridiques en application dans le domaine de la fiscalité
indirecte, douanière et accisiènne ».
Nous faisons remarquer en passant que BUNDU évoque un
aspect important dans la mesure où l'administration douanière se
fonde sur des textes légaux et réglementaires.
5. ACCISES
Dans le domaine douanier, les accises signifient impôts
indirects qui ne frappent que quelques marchandises. En d'autres termes, les
accises sont des droits de consommation perçus notamment sur des alcools
et boissons alcooliques, les cigarettes et tabacs fabriqués, les huiles
minérales, les eaux de table et boissons sucrées, les parfums,
les produits de beauté et de maquillage sans hydroquinone ni iodure de
mercure, la communication cellulaire, les véhicules d'occasion, les arts
et ouvrages en caoutchouc synthétique et en matière plastique,
etc.
03. SOURCES ET
DOCUMENTATION
En dehors de textes légaux et de quelques TFE/ENF et
TFC/ISC ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de l'OFIDA en
général, il n'existe pas d'écrit sur l'histoire de la
gestion du patrimoine douanier à l'Equateur.
Alors, pour réussir la rédaction de ce
mémoire, nous nous sommes inspiré des données recueillies
auprès de nos informateurs, de quelques rapports annuels que nous avons
pu retrouver dans les archives à la DP, de la lettre n°
OFIDA/00/081/EQ/2005 du 17 octobre 2005 portant état des lieux de la
DP/EQ, de l'inventaire du patrimoine de l'OFIDA/EQ en 2007 ; et, de notre
expérience en tant que douanier. D'autres données
résultent de nos lectures et de la navigation sur le Net.
Notre travail est aussi étoffé d'affirmations
fiables, issues des travaux de quelques scientifiques épris des
problèmes que ne cesse de susciter la gestion de patrimoine.
04. 04. METHODOLOGIE
EMPLOYEE
Notre approche méthodique s'est servie principalement
de la sociologie, de l'analyse et de la conceptualisation
comme méthodes ; et, pour bien les utiliser, nous avons
recouru aux techniques telles que la descente sur terrain, l'interview, la
critique et la description.
05. 05. PLAN DE
TRAVAIL
Ce mémoire comporte quatre chapitres.
Le premier traite de l'histoire des douanes ; le
deuxième présente l'organisation et le fonctionnement de
l'OFIDA ; le troisième fait état du patrimoine douanier
à l'Equateur ; et, le quatrième décrit le mode de
gestion de ce patrimoine.
Toutefois, une introduction
générale constituée des préliminaires et une
conclusion générale qui se veut critique et conseillère
encadrent lesdits chapitres.
CHAPITRE PREMIER :
HISTOIRE DES DOUANES CONGOLAISES
1.1. SUR LE PLAN INTERNATIONAL
1.1.1. Des origines au 19è Siècle
L'histoire des douanes remonte à l'antiquité
(9(*)). Elle coïncide
avec le deuxième stade de l'évolution de la monnaie, celui de
monnaie marchandise. Période pendant laquelle des pierres
précieuses ont été utilisées pour servir de valeur
d'échange (10(*)).
Les marchands transfrontaliers furent contraints de payer un
tribut aux dirigeants des sociétés étatiques bien avant de
les traverser ou de marchander avec les autochtones sous peine de se voir
refuser le passage, ou soit d'être pillés, soit pris pour des
agresseurs qu'il faut tout simplement éliminer et s'accaparer du butin
de la bataille.
Les princes ou souverains de l'époque avaient bien
compris qu'au delà d'une armée forte pour assurer la
défense de l'Etat ou les conquêtes de terres nouvelles, il a fallu
de l'argent pour faire fasse à certains besoins tels que la prise en
charge des combattants, l'achat des armes, vivre paisiblement...
D'où la perception des impôts sur les
marchandises devant franchir leurs juridictions s'imposait.
Bien avant notre ère, comme dit dans la terminologie,
la douane Romaine fut appelée « portaria » ;
celle des arabes « alqabala » ; les Italiens la
nommèrent « douana »...
Du 5ème au 9ème S., sous
le règne de Clovis (465-511) et de Charlemagne (747-814), en Europe, les
douanes furent appelées du nom de « Tonillum ».
Des lors, l'institution des droits de douane n'eut pas
seulement le but de fournir des recettes budgétaires, mais aussi
l'organisation des mécanismes de l'économie nationale.
Ce rôle secondaire a vu le jour à l'époque
de Saint -Louis (1241-1270) et de Philippe le bel (IV, 1268-1314) qui fit cette
remarque : « la richesse s'accroît si les
frontières sont fermées ». Mais la remarque qui fut
acceptée par ses contemporains, n'eut d'effets que plutard au
17ème S.
Ce fut grâce aux innovations de J.B Colbert (1664),
alors ministre des finances de Louis XIV, qui permirent d'édicter le
tout premier tarif douanier. C'est ce qui fait qu'il soit aujourd'hui
appelé l'initiateur ou le Père de la technique douanière
Par ailleurs, c'est au 18è Siècle que les
douanes nationales connurent leur émergence qui fut renforcée par
la montée du protectionnisme au 19è Siècle.
En ce qui concerne l'EIC, disons que ce fut à
l'époque de l'union personnelle(1885-1908) que Léopold II, roi
des Belges et du Congo, comme tous les autres souverains, rechercha les moyens
financiers pour mettre à profit les richesses que regorgeait le
Congo.
Cette recherche d'argent l'avait conduit à fixer, le 09
avril 1892, le premier tarif des droits d'entrée à l'E.I.C. ce
tarif consistait, dans la fixation, à concurrence de 10 % ad valorem sur
les armes et de la poudre et à concurrence de 6 % ad valorem sur
d'autres produits.
Cependant le décret relatif à
l'établissement de ce tarif exemptait de la taxe pendant une
période de six ans, tous les biens d'investissement, les instruments
scientifiques et les animaux.
Les perceptions des droits d'entrée au Congo ne
s'effectuaient qu'à Banana et à Boma (Bas - Congo) qui ouvrent le
pays à l'Océan Atlantique.
Les douaniers de cette période furent appelés
des gardes frontières selon les dispositions de l'ordonnance n°
33/245 du 31 janvier 1893.
Fort malheureusement, les droits perçus au Congo ne
permettaient pas au souverain de résoudre tous ses problèmes
comme il entendait faire parce qu'au nom de la liberté du commerce dans
le bassin du Congo, certains opérateurs économiques,
ressortissants de pays signataires de l'Acte de Berlin, refusèrent
d'obtempérer à la Législation Léopoldienne.
Leur refus constitua des manques à gagner
énormes pour le roi des belges et du Congo.
Cette situation avait choqué Camille JANSSENS qui,
nommé Administrateur Général au département des
Finances le 25 juillet 1890, écrivit au roi en ces termes :
« le concessionnaire sera le maître ... il traitera les
nègres comme il le souhaite. Ce manque de concurrence me semble
désastreux, tant pour les indigènes que pour
l'Etat. »(11(*))
Et pour montrer son désaccord avec la vision
économique du roi, il démissionna le 17 décembre, plus au
moins cinq mois plus tôt ! ce fut de la pire incitation.
Dès lors, la libre appréciation des
indigènes en rapport avec leurs prestations à la récolte
du caoutchouc entamée en 1891 fut anéantie et des abus furent
perpétrés contre eux par des hommes du roi. D'où
l'appellation caoutchouc rouge pour désigner la mutilation des membres
aux nègres paresseux ou qui essayèrent de résister.
L'on se rappellera les atrocités dont les autochtones
furent victimes pour produire l'or ou le caoutchouc à partir de 1903. De
grâce vers 1906, ces abus sociaux économiques ont
été dénoncés par les missionnaires. Parmi les
activistes des droits de congolais meurtris, nous pouvons citer : E.D.
MOREL qui fit de révélations accablantes à l'encontre du
roi par des écrits dont son livre intitulé : « Red
Rubber » et projection des diapositives photographiques montrant des
congolais mutilés ; les interpellations du gouvernement Belge sur
le Congo par VANDERVELDE, le leader socialiste ; et les pressions des
autres puissances qui aboutirent à l'annexion de l'EIC à la
Belgique, le 18 décembre 1908.
Léopold II mourut le 17 décembre 1909, soit
exactement un an après la naissance du Congo belge. Son neveu, le prince
Albert 1er, lui succéda au trône le 23 décembre
de la même année.
1.1.2. La période de l'union réelle ou du
Congo - Belge (1908-1960)
Compte tenu de l'importance de plus en plus croissante que
revêtait le commerce extérieur du Congo belge, la
réorganisation du service douanier au profit de la métropole
préoccupa le colonisateur. Ce qui fut fait en 1913.
De ce fait, le Gouvernement Belge créa l'Office
Colonial des Douanes à Anvers (12(*)) chargé de percevoir les impôts sur
toutes les marchandises entrant au Congo (13(*)).
Il y a lieu de noter en passant que cet office douanier
était conçu en fonction des intérêts
économiques de la métropole ; et cela, malgré
l'opposition d'autres puissances coloniales, notamment les USA et les Pays -
Bas qui tenaient à la liberté du commerce sur le territoire de
l'E.I.C. tel qu'arrêté lors de la conférence de Berlin de
1885.
Le 05 juillet 1920, les parlementaires Belges votèrent
une loi reconnaissant au Congo - Belge le droit de fixer librement sa taxation
douanière, à condition de respecter le principe
de l'égalité de traitement avec les autres puissances.
Ce qui conduisit à la signature, le 1er
février 1943, de l'ordonnance - loi soumettant les importations au Congo
à un préalable, celui de l'obtention d'une licence
d'importation.
Notons que jusque là, il n'existait pas encore de
réglementation douanière sur le plan international. Ce n'est
qu'en 1947 que c'était tenue à Génève (Suisse), la
conférence d'Etats dont les activités commerciales
représentaient plus de 80 % du commerce mondial, afin de résoudre
les questions y afférentes.
De cette conférence naîtra l'Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce, en sigle GATT
aux fins d'harmoniser les politiques douanières et d'abolir les
restrictions dans les échanges commerciaux.
Pourtant pour le Congo belge, la réglementation
d'échange fut établie par l'Ordonnance du 24 décembre
1952. Cette même année connut la création du Conseil de
coopération Douanière qui deviendra OMD en 1994 (14(*)) ; et, les douanes
Congolaises intégrèrent ledit Conseil jusqu'à ce jour.
Nous y reviendrons au point 4.3. du
4ème chapitre où il sera question des interventions de
l'OMD.
1.2. SUR LE PLAN NATIONAL
L'on constatera qu'avec Léopold II, les droits
d'entrée des marchandises au Congo furent perçus au Congo. Mais
avec le gouvernement de la Belgique, ces mêmes droits se percevaient
à Anvers !
Qu'adviendra - t- il à la colonie qui, venait
d'accéder à sa souveraineté ? Les lignes suivantes
s'en occupent.
1.2.1. Le Service Douanier lors de la
1ère République (1960-1965)
Au lendemain de l'accession des Congolais à la
direction politique du pays, de sérieuses difficultés surgirent
par rapport au transfert de l'ensemble de l'appareil douanier aux
autorités congolaises.
Le service douanier qui, à cette période, fut
organisé en OCD, commença à présenter un
disfonctionnement. Car, à l'export comme à l'import, toutes les
marchandises ne sont déclarées qu'au port d'Anvers (Belgique)
où toutes les formalités et opérations de
dédouanement sont effectuées.
A cela s'ajoute le refus pour le gouvernement Belge de
rétrocéder des devises au Congo.
Devant cette situation de crise, les autorités du Congo
« indépendant » prirent, le 1er juillet
1962, la décision de supprimer l'OCD et de réorganiser
l'institution douanière au Congo en direction des douanes placée
sous la tutelle du ministre des finances.
C'est ainsi que les ordonnances ci - dessous libellés
furent signées :
1) L'ordonnance - loi du 24 mai 1962 portant création
de la Brigade Douanière ;
2) L'ordonnance - loi du 13 janvier 1964 portant
création au sein de la douane d'un service de recherche des infractions
en matière douanière ;
3) L'ordonnance - loi du 04 septembre 1964 portant
création et organisation de la Brigade financière, en vue d'un
bon fonctionnement du service douanier.
1.2.2. De la Direction des Douanes à l'OFIDA (1968
à 1979)
Comme on le sait, l'instabilité politique de la
première République avait atteint son point culminant et il
fallait mettre un terme à cette situation chaotique.
C'est ainsi que Joseph KASA VUBU fut renversé le 24
novembre 1965. Et l'homme fort de ce coup d'Etat ne fut autre personne que le
Lieutenant Général Joseph - Désiré
MOBUTU.(15(*))
Bénéficiant de l'appui des puissances
occidentales qui l'avaient soutenus, ce dernier réussit à mater
les rebellions et la sécession Katangaise, à réorganiser
l'appareil administratif de l'Etat, à recouvrer
l'intégrité du Congo qui était presque balkanisé et
à pacifier les populations.
Toutefois, si des réformes ont réussis dans
beaucoup de secteurs, il n'en était pas ainsi pour le service
douanier.
Nonobstant la prise des ordonnances susmentionnées, les
autorités du nouveau régime constatèrent, trois ans
après, que la douane ne réalisait toujours pas de recettes de
l'ordre voulu. Ce qui amena à la signature de bien d'autres ordonnances,
notamment :
a. l'Ordonnance - loi n° 68/008 du 06 janvier 1968
modifiant le décret du 29 janvier 1949 relatif au régime douanier
et l'ordonnance - loi n°33/9 du 06 janvier 1950 portant règlement
d'exécution du décret précité ;
b. l'Ordonnance - loi n° 68/009 du 06 janvier 1968
modifiant le décret du 11 décembre 1954 relatif au tarif des
droits de sortie ;
c. l'Ordonnance - loi n° 68/007 du 07 janvier 1968
instituant le nouveau tarif « Moniteur congolais », le
1er depuis le 30 juin 1960
La Belgique qui tenait à gérer les douanes
congolaises, va cette fois, dans le cadre des relations internationales,
proposait aux
autorités du nouveau régime son assistance
technique en matière de coopération bilatérale en vue de
maximiser les recettes douanières.
Le Congo rejettera l'offre dans un premier temps. Mais
l'influence de la Belgique comme patrie mère finit par l'emporter.
En 1972, pour raison dite d'efficacité, la
coopération Belge va au Ministère des Finances pour ne s'occuper
que de sa quatrième direction qu'est la Direction des Douanes et
Accises !
Sept ans plus tard, tenant compte d'importantes recettes que
générait la douane et par souci de nationaliser l'institution,
l'autorité Congolaise signa l'ordonnance n° 79-114 du 15 mai 1979
portant création d'un établissement public
dénommé : Office des Douanes et Accises, en
abrégé : OFIDA.
Doté d'une personnalité juridique, l'OFIDA est
soumis aux prescrits de l'ordonnance - loi n° 78/002 du 06 janvier 1978
portant dispositions générales applicables aux entreprises
publiques.
Ainsi créé, nous le verrons au chapitre suivant,
l'OFIDA va s'organiser et fonctionner avec autonomie de gestion sous la
dualité de tutelle technico - administrative des Ministères de
Finances et du Portefeuille.
CONCLUSION
L'histoire des douanes congolaises démontre à
suffisance que le service douanier du Congo est créé à
l'étranger - mieux en Belgique par le Roi Léopold II à
l'époque de l'union personnelle, et cela pour le compte exclusif du
souverain.
L'évolution de ce service comporte quatre
périodes, à savoir :
1. L'Union personnelle (1892 - 1908).
A ce temps là, le service douanier ne consistait
qu'à la perception des droits d'entrée à l'E.I.C. à
Boma et Banana.
2. Le Congo Belge ou
période de l'union réelle (1908 - 1962).
Ce fut l'Office Colonial des Douanes. C'est à cette
période que les parlementaires Belges prirent des actes organisant le
service douanier au congo. Alors qu'en réalité, les perceptions
se faisaient à Anvers pour le compte de la Métropole.
3. La Direction des Douanes (1962 - 1972).
Période d'impasse qui dut son salut à l'intervention de la
Coopération belge en vue de maximiser les recettes à partir de
1972.
4. L'OFIDA (1979 à ce jour). Cette
dernière période connaît des hauts et bas compte tenu des
troubles sur le plan politique. Néanmoins, le service douanier actuel
est vraiment structuré et fonctionne assez bien.
Il y a de quoi se frotter les mains pour ce qui est de
l'apport du service douanier Congolais par rapport à d'autres services
générateurs des recettes en ce qui concerne la formation du
Budget de l'Etat. Nous le verrons au chapitre suivant.
CHAPITRE DEUXIEME :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFIDA
2.1. STATUT ET BASE JURIDIQUE
2.1.1. Du statut
L'OFIDA, né par l'Ordonnance - loi n°079-114 du 15
mai 1979 et soumis aux dispositions de l'Ordonnance - loi n° 78/002 du 06
janvier 1978, est une entreprise publique.
Il est doté d'une personnalité juridique et
jouit de l'autonomie de gestion sous la tutelle administrative du
ministère de Portefeuille et la tutelle technique du ministère
des Finances.
2.1.2. De la base Juridique
Les prérogatives dévolues à l'OFIDA ont
pour base juridique la législation Douanière qui se compose de
(du, de la) :
- Décret du 29 janvier 1948, tel que modifié et
complété à ce jour, portant révision et
coordination du code douanier congolais ;
- Ordonnance - loi n° 33/9 du 06 janvier 1950 portant
règlement du décret précité ;
- Ordonnance - loi n° 90-023 du 25 février 1990
modifiant et complétant l'ordonnance - loi n° 68-010 du 06 janvier
1986 relative aux droits de consommation et au régime des boissons
alcooliques ;
- Décret du 1er Ministre n° 0010 du 12
janvier 1997 relatif au régime douanier zaïrois ;
- Loi n° 08/002 du 16 mai 2008 modifiant et
complétant l'ordonnance - loi n° 68 - 010 du 06 janvier 1968
instituant la perception des droits d'accises ; et, tous les textes
légaux et réglementaires pris pour son fonctionnement.
2.2. DES MISSIONS
Généralement, la douane joue un rôle
essentiel en matière de gestion des intérêts
économiques et commerciaux nationaux, de facilitation des
échanges et de sécurité.
Pour ce faire, les dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance
- loi n° 79 - 114 du 15 mai 1979 portant création de l'OFIDA
stipulent : « Dans les conditions prévues par la loi
n° 78 - 002 du 06 janvier 1978, l'OFIDA est chargé, pour le compte
de l'Etat, de toutes les missions et prérogatives assignées
à l'ancienne administration des douanes et accises ».
Ci - dessous, de façon beaucoup plus claire, les
différentes missions de l'OFIDA.
1°LA MISSION FISCALE
Appelée aussi traditionnelle, consiste à
percevoir, pour le compte du Trésor Public, les recettes (16(*)) sur des marchandises qui
entrent, sortent et celles fabriquées au pays.
Cette mission implique la participation active de l'OFIDA dans
la réalisation du budget de l'Etat Congolais aussi longtemps qu'il
demeure un pays en voie de développement. D'où la
difficulté pour la République Démocratique de Congo
d'accéder à la politique du libre échange comme c'est le
cas dans les pays développés où les recettes
douanières ne jouent plus un rôle important en ce qui concerne la
gestion de la chose publique. Les barrières douanières tendent
à disparaître dans ses pays - nations avec le principe de
regroupement régional.
2° LA MISSION ECONOMIQUE
Elle se traduit par la facilitation des échanges, du
commerce ; l'établissement des statistiques du commerce
extérieur ; l'obligation de faire respecter les accords commerciaux
et la sécurisation de l'espace économique par la collaboration
avec les services spéciaux (DGM, ANR) contre le terrorisme, le
blanchissement de la monnaie, la drogue ...
La politique du protectionnisme oblige et, cela étant,
en vue de protéger les industries locales et rendre leurs produits
compétitifs, l'OFIDA, par mécanisme tarifaire, diminue les taxes
à l'export (17(*)).
3° LA MISSION SOCIALE
Avec la collaboration de l'OCC et du service de
l'hygiène, l'OFIDA s'occupe aussi de la protection de la
société par l'application des mesures concernant la santé,
la morale publique, l'environnement et le patrimoine culturel.
4°LA MISSION SECURITAIRE ET
REPRESSIVE
Se réalise par la surveillance des frontières
et par la lutte contre la fraude et la contrefaçon sous toutes leurs
formes par la recherche, la constatation et la répression des
infractions en matière douanière et accisienne
conformément aux dispositions des articles 2, 12, 13, 92 et autres du
décret du 29 janvier 1949 et de l'ordonnance n° 33/9 du 06 janvier
1950.
5°LA MISSION EDUCATIVE
L'OFIDA se préoccupe de la formation de ses cadres et
agents en vue du renforcement de leurs capacités.
C'est pour cette raison qu'il supporte des employés
étudiants à l'Ecole Nationale des Finances et organise
différentes sessions de formation, afin de faire acquérir au
personnel les nouvelles techniques de gestion dans le domaine des douanes et
accises pour maximiser les recettes, objectif prioritaire pour lequel d'autres
aspects, tels que le social et le patrimoine sont négligés.
2.3. STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ET FONCTIONNEMENT
2.3.0. INTRODUCTION
Dans ce point, nous présentons l'OFIDA à travers
des structures de son organisation administrative et son fonctionnement.
D'abord, tout le cadre organique de l'OFIDA (Annexe 1) au
niveau national qui sera suivi des attributs de quelques structures,
notamment : le Conseil d'administration ; le Comité de
gestion ; le Collège des Commissaires aux comptes ; et, la
Direction Générale (DG) y compris les animateurs pour le premier
bloc ; ensuite, il s'agira du deuxième bloc qu'est les directions
provinciales, et cela du point de vue général parce que plus
particulièrement, c'est la province douanière de l'Equateur, qui
intéresse notre étude ; enfin, au niveau de la base,
nous présenterons le graphique fonctionnel et les
attributions d'un bureau recettes.
Toutefois, nous dirons un mot sur le guichet unique.
2.3.1. AU NIVEAU
NATIONAL
Dans ce bloc, comme annoncé plus haut, nous
avons :
A. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Composé de cinq à neufs membres appelés
administrateurs nommés et révocables par le Président de
la République, le conseil dispose de pouvoir plus étendu en
rapport avec le social et l'économie de l'entreprise,
notamment :
- le statut du personnel
- le budget de l'office
- l'approbation du bilan annuel des activités
- la nomination au grade de directeur
- les révisions de la législation et du tarif
douanier le conseil ne peut siéger que lorsque le quorum est atteint. Le
mandant est de 5 ans renouvelable.
B. LE COMITE DE GESTION
Sont membres de ce comité :
L'Administrateur Délégué
Général (ADG), L'Administrateur Délégué
Général Adjoint (ADGA), L'Administrateur Directeur Technique
(ADT),
L'Administrateur Directeur Financier (ADF) et le
Président de la Délégation Syndicale Nationale (PDSN).
Le comité de Gestion qui veille à
l'exécution des décisions du conseil d'Administration, assure la
gestion de l'office, se réunit sous la Présidence l'ADG au moins
une fois par semaine.
C. LE COLLEGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ses membres sont nommes et révoqués par le
Président de la république. Ils ont pour rôle le
contrôle des opérations financières de l'office.
Sur ce, ils vérifient les livres de caisse et les
valeurs de l'entreprise en s'assurant de la régularité, de la
sincérité des inventaires, des bilans ainsi que l'exactitude des
informations fournies sur les comptes de l'entreprise dans le rapport
adressé au conseil d'administration.
D. LA DIRECTION GENERALE
1). Elle dirige et coordonne, sous la conduite du
comité de gestion, à partir de la capitale toutes les
activités de l'office. C'est d'elle qu'émane les directives
à suivre à tous les niveaux.
En son sein, l'on compte quinze services centraux
appelés divisions. Ces structures, ayant à leurs têtes des
Directeurs centraux ou divisionnaires, sont supervisées par les deux
administrateurs Directeurs (ADF et ADT). Excepté les divisions de
l'Audit interne et juridique qui dépendent de la
délégation générale (cf.A1).
2. LES ANIMATEURS (PDG ou ADG) DE
L'OFIDA
Depuis la création de l'OFIDA en 1979, l'entreprise a
vu défiler à sa tête, quinze dirigeants, au niveau national
dont trois sujets belges et douze compatriotes, nous citons :
|
N°
|
NOMS
|
PERIODE
|
N°
|
NOMS
|
PERIODE
|
|
01
|
Jacques SAVILLE
|
1980 - 1984
|
09
|
Narcisse LEMBO
|
1996 - 1997
|
|
02
|
Robert WATERINKYX
|
1984 - 1985
|
10
|
KAZADI BOKASA
|
1997 - 1998
|
|
03
|
Alain LASAYGUES
|
1985 - 1987
|
11
|
Pascal EPONDO
|
1998 - 1999
|
|
04
|
Charles BOFOSSA
|
1987- 1989
|
12
|
Juvénal LUFUMA
|
1999 - 2001
|
|
05
|
Alexis THAMBWE
|
1989 - 1991
|
13
|
David KALANDE
|
2001 - 2002
|
|
06
|
Prof AZAMA
|
1991 - 1992
|
14
|
Albert KASONGO
|
2002 - 2005
|
|
07
|
Christophe BEYEYE
|
1992 - 1994
|
15
|
Déo RUGWIZA
|
2005 à ce jour
|
|
08
|
Célestin NDOMBI
|
1994 - 1996
|
X
|
|
|
Source : Extrait du discours prononcé
à Mbandaka, le 15 mai 2008 à l'occasion du
29ème
anniversaire de l'OFIDA par Monsieur
Faustin MBENZA, alors Directeur Provincial.
2.3.2 LES DIRECTIONS
PROVINCIALES
1° L'OFIDA dispose de douze Directions Provinciales qui
relèvent de l'autorité directe de l'ADG.
Il s'agit de :
|
N°
|
Province Douanière
|
N°
|
Province Douanière
|
|
01
|
Bandundu
|
07
|
Katanga
|
|
02
|
Bas - Congo
|
08
|
Kin - Aéro
|
|
03
|
Brigade Douanière
|
09
|
Kin - Est
|
|
04
|
Equateur
|
10
|
Nord - Kivu
|
|
05
|
Kasai - occidental
|
11
|
Province Orientale
|
|
06
|
Kasai - oriental
|
12
|
Sud - Kivu
|
Les Directions Provinciales jouissent de l'autonomie de
gestion et bénéficient d'un crédit mensuel pour leur
fonctionnement.
Sur accord des autres membres du comité de gestion, le
conseil d'administration entendu, les Directeurs Provinciaux sont nommés
et relevés de leurs fonctions par l'ADG qu'ils représentent en
Province.
Ils sont responsables de la gestion de toutes les ressources
(humaines, matérielles, financières et patrimoniales) mises
à leur disposition par l'office et sont tenus à
l'exécution des assignations des recettes budgétaires en vue de
la maximisation des recettes.
2° LE COMITE DE DIRECTION
A l'instar du Comité de gestion, il est
institué en provinces, un comité de direction qui, en principe,
doit se réunion sous le DP une fois par semaine et transmettre à
la DG les procès verbaux y relatifs.
Ledit comité se compose de (du) :
- Directeur Provincial
- Sous - Directeur(s)
- Représentant des travailleurs (Président de
DSP).
3° LA DIRECTION PROVINCIALE DE L'EQUATEUR
1) Présentation
La juridiction de la Province Douanière de l'Equateur
équivaut l'étendue tout entière de la province de
l'Equateur (cf. A2).
La Direction Provincial de l'OFIDA / Equateur
comporte deux sous - Directions, sept Inspections dont une Provinciale avec
deux contrôles au Nord et douze Bureaux - Recettes.
2) Organigramme (Cf.
A3)
Actuellement, il n'y a qu'un seul Sous -
Directeur, celui Chargé de la Brigade Douanière qui cumule les
fonctions. Il y a lieu d'affecter un autre pour s'occuper des douanes et
Accises.
3) Les Dirigeants de l'OFIDA / Equateur
(18(*))
Bien avant l'institution de la Direction Provinciale à
Mbandaka, le service douanier fut dirigé par des contrôleurs
Principaux.
Depuis 1980, l'OFIDA / Equateur a vu défiler à
sa tête dix huit Directeurs Provinciaux présentés au
tableau suivant. Nous avons pris soin d'ajouter à cette liste un Sous -
Directeur (ai) qui a fait fonction
de Directeur pendant plus au moins cinq ans, lors de la
dernière guerre civile.
Il s'agit de :
|
N°
|
NOMS
|
PERIODE
|
|
01
|
Ambroise MUKWA
|
Janvier 1980 - février 1981
|
|
02
|
KASONGO
|
Mars 1981 - janvier 1982
|
|
03
|
ELOMBO SILA
|
Janvier 1982 - Septembre 1982
|
|
04
|
BINZANGI (+)
|
Octobre 1982 - Janvier 1983
|
|
05
|
LELO VANGU (+)
|
Janvier 1983 - Mars 1984
|
|
06
|
BIYA MUSIKU
|
Avril 1984 - juillet 1985
|
|
07
|
MAVUNGU PANZU
|
Juin 1985 - février 1986
|
|
08
|
LEMBO KOLOTANGI
|
Mars 1986 - décembre 1986
|
|
09
|
BONTENGO
|
Janvier 1987 - Mars 1990
|
|
10
|
BIDUAYA
|
Juin 1990 - Mai 1992
|
|
11
|
MBWESHANGOL
|
Mai 1992 - Mars 1993
|
|
12
|
BASHALA
|
Avril 1993 - décembre 1995
|
|
13
|
KABWE MABULUKI (+)
|
Janvier 1996 - août 1996
|
|
14
|
MAGUERA
|
Septembre 1996 - janvier 1997
|
|
15
|
MAKAKA
|
Février 1997 - juin 1998
|
|
16
|
LOMPINGA ai
|
Juin 1998 - Mai 2003
|
|
17
|
Stanislas KATALIKA
|
Mai 2003 - mai 2006
|
|
18
|
Faustin MBENZA
|
Mai 2006 - juin 2008
|
|
19
|
Augustin BOZOBI
|
Juin 2008 à jour
|
2.3.3. LES BUREAUX - RECETTES (la
base)
1. Organigramme (Cf. A4)
2. Présentation :
Nous en parlerons au troisième chapitre ou il s'agira
du patrimoine de l'OFIDA à l'Equateur.
Notons tout de même que c'est au niveau de la base qu'on
trouve ces structures. Ils ont à leurs têtes des receveurs
(Vérificateurs de grade) ou des receveurs principaux ayant le grade
statutaire de contrôleur, l'équivalent de Chef de bureau dans la
fonction publique ; tandis que celui d'inspecteur équivaut le Chef
de division.
Il y a lieu de noter qu'à l'OFIDA , de façon
régulière , les perceptions des droits et taxes sont faites
à ce niveau - entendez bureau - recettes ou il est organisé trois
sections , à savoir
- la recette
- la vérification
- la brigade douanière.
a) la section recette
Ayant à sa tête un receveur où receveur
principal (bureau principal), est chargé de percevoir des recettes pour
le compte du Trésor Public, y compris la vente des imprimés dans
le cadre des ressources propres. Nous notifions en passant que le receveur est
responsable des recettes perçues dans son ressort où il a la
charge administrative de tout le personnel en tant que Chef de bureau.
Remarques :
- à ce niveau toutes les recettes perçues
doivent être logées à la banque par le receveur ou son
préposé au plus tard 48 h.
- dans un bureau principal, le receveur principal est
secondé par un receveur, cas de Mbandaka - Ville par exemple.
- A la base, le receveur, le vérificateur et le
commandant ont tous le grade statutaire de vérificateur.
- Sous brigadier, terme usité pour désigner un
agent temporaire qui intervient dans la brigade douanière.
2) la section vérification
Avec un vérificateur comme Chef de cellule, elle
s'occupe de la vérification physique et documentaire des marchandises,
de valeur, des calculs et régularité des perceptions la mise en
vente des imprimés et son produit.
3) la section brigade douanière
Est la branche para - militaire de l'OFIDA. Elle joue la
police douanière(19(*)) dans :
- la surveillance des frontières nationales
- la lutte contre la fraude et la contrefaçon
- la contre vérification, la conduite en douane,
- la recherche, la constatation et la répression des
infractions en matière douanière et accisienne,
- L'établissement des statistiques,
- Le gardiennage du patrimoine.
Le commandant en est le chef. Nous faisons remarquer que,
malgré la primauté du receveur sur le plan administratif, la
brigade douanière ne dépend pas de lui ; elle est
plutôt mise, en province, à la disposition du Directeur Provincial
à qui son rapport mensuel d'activités est adressé.
Lequel rapport permet à l'autorité provinciale
de comparer les données fournies par le receveur dans les pièces
comptables et celles avancées par le commandant, susceptibles de faire
foi. La brigade est tenue de veiller à ce que les agents chargés
de l'acceptation, de la validation et la vérification fassent comme il
se doit leur travail.
2.3.4. LE GUICHET UNIQUE
1°. HISTORIQUE
Le guichet unique est un e nouvelle méthode
informatisée de dédouanement des marchandises sous douane en un
seul endroit avec le concours d'une Banque qui prend soin de ventiler les
recettes dans le compte respectif de tous les services concernés par les
opérations (20(*)).
Utilisant un système automatisé d'exploitation
des données en vue de la production des statistiques du commerce
extérieur, le guichet unique est conçu par le Conseil des Nations
Unies.
En 1981, la CEDEAO avait ému le voeu d'une assistance
technique en la matière. Grâce à l'appui des pays membres,
le conseil créa un système de saisi des informations à la
source aux fins des opérations de dédouanement, afin de garantir
la qualité des statistiques produites.
Le système douanier automatisé appelé
SYDONIA est un logiciel statistique et comptable qui s'adapte à la
réglementation des pays utilisateurs.
Il permet la saisi des déclarations en douane et la
tenue de la comptabilité douanière du commerce
extérieur.
En plus, conformément aux accords signés entre
la RDC et l'OMC, le guichet unique permet la clarté et la
facilité du commerce dans le monde des affaires.
Au Congo Kinshasa, c'est depuis 1999 que le guichet unique est
opérationnel.
2° FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
(21(*))
Le guichet unique, ayant un réseau local avec un
terminal à la DG/OFIDA, fonctionne sous contrôle de l'Inspection
SYDONIA
Le terminal à la DG est relié à plusieurs
ordinateurs qui fonctionnent comme terminaux dans tous les postes de
perceptions douanières : Matadi, Boma, Kin/Aéro, Kasumbalesa
et la DG.
Le système fonctionne sous un langage sémi
compilé appelé ABL3+ (Advasced Business Application Langage).
C'est un langage de programmation du type évolué qui ne
dépend pas de l'ordinateur utilisé. Son langage codé
s'appelle T-Code.
3° DE L'INFORMATIQUE
DOCUMENTAIRE
Le traitement des informations se fait sur base des documents
ci-après :
- Manifeste
- Lettre de transfert Aérien (LTA)
- Note de Freet
- Facture (d'achat des marchandises)
- Note de Débit Comptant (/OCC)
- Bulletin de Préliquidation
- Bordereau de versement en espèce
- Document douanier du COMESA
- Facture Tresco (Entreporiteur)
NOTE : Nous faisons remarquer en passant
que, outre la facilitation du commerce et la production des statistiques
fiables, pour la RDC le guichet unique s'inscrit dans la vision de maximiser
les recettes.
Seulement, notre inquiétude, c'est que si le guichet
unique s'étend à l'ensemble du pays, l'informatisation du service
douanier amènera à coup sûr l'assainissement. Car la
machine aura remplacé un bon nombre des employés.
2.3.5. CONTRIBUTIONS DE L'OFIDA EN
RDC
Il y a de cela trente ans que l'OFIDA, une des trois grandes
régies financières, fonctionne au service de l'Etat congolais.
Hormis les missions qu'il remplit convenablement, ci
après les apports de l'OFIDA sur le plan politique, économique et
social
1° EN POLITIQUE
Outre son intervention sur le plan sécuritaire avec la
collaboration des services spécialisés, l'OFIDA joue un
rôle important dans la facilitation du commerce international.
D'après l'accord de mise en oeuvre de l'Article 7 du GATT (22(*)).
Son adhésion à l'OMD en 1994 atteste sa
participation dans la coopération internationale. De ce fait, les
politiques misent sur le service douanier pour prélever la tension des
intérêts transfrontaliers avec les autres pays du monde
d'où partent ou vont les marchandises. C'est ainsi que différents
accords bilatéraux et multilatéraux sont d'abord pris par les
décideurs en lieu et place des responsables de la douane qui, en
réalité ne sont que des exécutants.
2° EN ECONOMIE
Le protectionnisme mis de côté, l'apport de
l'OFIDA dans la réalisation du budget de l'Etat congolais est
énorme.
De tous les service générateurs des recettes
pour le compte du trésor public, les statistiques (23(*)) font état de plus au
moins 30 % des recettes qui forment le budget national proviennent des
perceptions effectuées et logées à la banque par l'OFIDA
seul.
A titre exemplatif, prenons le dixième de la
période de notre étude, c'est - à - dire les trois
dernières années des trente ans de l'OFIDA (2006, 2007 et
2OO8) :
|
ANNEE
|
ASSIGNATIONS
|
REALISATIONS
|
POURCENTAGE
|
|
2006
|
169.500.000.000 FC
|
199.500.000.000 FC
|
117,70
|
|
2007
|
272.000.000.000 FC
|
277.000.000.000 FC
|
101,84
|
|
2008
|
406.000.000.000 FC
|
424.000.000.000 FC
|
104,43
|
Source : Division des Statistiques et
Documentations/DG
Les performances de l'OFIDA dans ce domaine lui ont valu le
droit au bonus pour ses cadres et agents. Les plus - values sont
calculées et rétrocédées trimestriellement.
Mais pourtant, il a été malheureusement
constaté que les assignations étant réalisées par
les douaniers et à temps voulu, par contre leur droit, celui de
percevoir le bonus n'est jamais payé à terme échu et comme
il se doit .très souvent, ils sont appelés à faire des
pressions pour entrer en possession d'une partie seulement du montant devant
leur revenir. Et cela, toujours après trois à six mois de retard.
3° AU SOCIAL
En plus de la protection de l'environnement et du patrimoine
culturel, l'OFIDA entretien un marché d'emploi. De près de deux
mille employés avant la dernière guerre civile (1998 à
2003 ) qui a failli balkanisé le Congo -Kinshasa , avec une cinquantaine
d'agents pour toute l'Equateur, les trois principales administrations des
belligérants(24(*))ont fait embaucher beaucoup de personnes. Cela
s'explique par le fait que, pour l'Equateur par exemple, la rivière
Ubangui est mitoyenne entre la RDC et les Républiques du Congo Brazza et
de la Centrafrique d'où existence de plusieurs corridors qui facilitent
la fraude en matière douanière.
Ce qui amène l'effectif global à 4.729 douaniers
dont 1.465 femmes, soit 25 %. A ce jour, la province douanière de
l'Equateur compte 177 agents, soit trois fois plus que l'effectif d'avant
guerre.
Pourtant les besoins en ressources humaines se font toujours
sentir compte tenu du fait que la maximisation de recettes l'exige. Mais, avec
l'informatisation de la technique douanière, nous craignons
l'assainissement pour les tout prochains jours.
2.3.6. DES DIFFICULTES
L'OFIDA fonctionne avec comme moyens financiers :
ressources propres et les 5 % des recettes réalisées que doit lui
rétrocède le gouvernement chaque mois.
Mais, le retard dans le versement de ce dû au
compte de l'OFIDA ;les charges dues pour faire tourner l'office ; les
primes et hébergement (PH) à payer à plus de cinq mille
employés qui constituent les ressources humaines devant
produire ;les missions d'étude et les sessions de
formation ;les infrastructures à construire ou à
réfectionner ; des machines et logistique à acheter ;
des retraités pour qui payer les indemnités de sortie ; le
social des agents et de lourds jetons de présence à verser aux
membres du conseil d'administration, du comité de gestion et du
collège des commissaires aux comptes sont autant des problèmes
que pose le fonctionnement de l'OFIDA.
A ces difficultés, il faut ajouter la crise
financière qui frappe le monde des affaires ou les opérateurs
économiques - mieux les usagers de la douane ne sont pas
épargnés.
De ce qui précède, il ressort que quelles que
soient les réalisations de l'OFIDA qui ne cessent de dépasser le
seuil fixé, la mé- gestion de la chose publique d'une part, les
structures budgétivores au sommet de la douane d'autre part, ne
permettent pas aux douaniers de tirer vraiment profit de leur travail ; et
par ricochet, au peuple congolais en faveur de qui le budget doit être
constitué d'y trouver son compte.
Alors, à quoi bon garder des structures harpagonnes au
détriment de la masse laborieuse d'une entreprise publique ?
Pourquoi continuer à garnir le statut d'une organisation étatique
si les revenus ne peuvent profiter qu'aux mégestionnaires au sommet de
l'Etat ?
Nous osons croire qu'il vaut mieux repenser l'organisation et
le fonctionnement du service douanier en RDC.
CONCLUSION
En présentant l'OFIDA - entendez ses structures
organisationnelles et comment fonctionnent - elles, y compris les animateurs,
les apports de l'office tant sur le plan budgétaire que sur le social
des employés, nous avons voulu étaler le service douanier
à telle enseigne que quiconque veut savoir quelque chose en profite.
Les difficultés que nous avons ressorties ayant trait
à son fonctionnement par rapport aux structures mises sur pied
constituent les faiblesses que nous avons pu déceler dans le rouage du
service douanier congolais.
Nous estimons que l'autorité gouvernementale qui tient
encore au protectionnisme afin que les recettes douanières continuent
à former le gros du budget, devra repenser l'organisation et le
fonctionnement de cette entreprise pour que le produit soit au
bénéfice réel du gouvernement et que les producteurs
reçoivent à temps voulu leurs dus.
Car, il est aberrant qu'une institution aussi importante
qu'est l'OFIDA soit la proie de quelques décideurs sans tenir compte de
ce qui devait être effectivement au niveau professionnel et national.
CHAPITRE TROISIEME :
LE PATRIMOINE DE L'OFIDA / EQUATEUR.
3.1. DE L'ACQUISITION
L'administration douanière du Congo - belge avait
construit des immeubles pour servir de bâtiments administratifs et
d'habitations pour les douaniers. Ce fut au temps de l'OCD.
Transformé en Direction des douanes par les
autorités congolaises (1962), le service douanier se voit doter d'office
le même patrimoine. Dès lors, le ministère des finances
faisait octroyer à sa quatrième Direction quelques
infrastructures jusqu'en 1979.
Mais avec la création de l'OFIDA et sur base de
l'autonomie de gestion que lui reconnaît le gouvernement, l'office, outre
les biens hérités de la Direction des douanes, achète ou
construit des immeubles et matériels pour faire fonctionner ses
structures.
3.2. DU PATRIMOINE A LA
DIRECTION PROVINCIALE ET AUX BUREAUX - RECETTES.
Généralement, les bâtiments
utilisés aussi bien comme bureaux (douze en nombre) ou résidences
sont dans un état de délabrement très avancé. Ceci
s'explique par le fait qu'ils ont été construits à
l'époque coloniale.
Il y en a qui sont, à cause de l'intempérie,
dépourvus de toiture depuis belle lurette ; d'autres par contre,
par voie de fait, sont encore jusqu'à ce jour gérés par
des tiers entendez des spoliateurs sans en être
inquiétés.
Pourtant l'OFIDA dispose de toute division dite juridique ou
on retrouve des juristes sensés poursuivre en justice tous les
détracteurs afin de faire rentrer l'office dans ses droits. Alors que
font - ils au juste ? Nous y reviendrons
3.2.1 A LA DIRECTION
PROVINCIALE
a) L'immeuble qui abrite la Direction Provinciale de l'OFIDA/
Equateur sis avenue du Congo n°18 au Centre Ville de Mbandaka (25(*)) est dans un état
défectueux.
Heureusement qu'il venait d'être
réfectionné par Monsieur Augustin BOZOBI EKABOKO, le Directeur
Provincial sous lequel nous rédigeons ce mémoire.
Les possibilités d'accueil y sont très
limitées. Ce qui justifie l'occupation d'un local étroit par une
ou deux Inspections. Ce qui fait que les tables de bureau très
serrées ne permettent pas aux cades et agents y affectés de
circuler librement ou de se poser convenablement.
Il n' y a que neuf locaux pour treize services
organisés. Ne peuvent prétendre disposer d'un cabinet de travail
que le Directeur Provincial, le Sous Directeur, le Comptable des
Dépenses, le Pool Informatique, le Chef du Garage et l'Inspection des
Ressources Humaines et Services Généraux.
Le Secrétariat de Direction par exemple, faute de local
approprié, est logé entre le Pool Informatique et le cabinet du
Directeur Provincial. Imaginez les désagréments administratifs
sur le plan de discrétion !
En ce qui concerne les mobiliers, il est regrettable que nous
puissions noter l'inexistence quasi totale des meubles et équipements de
bureaux dignes pour ce millénaire (le 21e siècle).
Les cellules bureaux sont encombrées des tables,
chaises et étagères en bois et en plastic.
L'archivage au sein de tous les services fait défaut.
Ce qui rend difficile la trouvaille des documents.
Quand même sur le plan de l'informatisation de services,
la Direction Provinciale / Equateur dispose de huit Kit ordinateurs
connectés à l'Internet (VESAT) et d'une photocopieuse.
Il est honteux de noter l'usage d'une vieille machine à
écrire pour remplir les formulaires ayant trait aux mouvements des
employés, leurs commissionnements, décommissionnements ou actions
disciplinaires au secrétariat.
Quant à la logistique, nous faisons savoir que toute
la Province Douanière de l'Equateur n'a qu'une seule jeep, marque :
Mitsubishi (4x4), un groupe électrogène et un bus pour le
transport du personnel à Mbandaka.
Alors que, vu l'immensité de l'espace à couvrir,
à l'Equateur on peut octroyer au moins quatre jeeps et plus ou moins
quinze motos, à raison de : deux jeeps plus six motos pour la
Direction Provinciale ; une jeep plus quatre motos pour le Sud - Ubangui
(Gemena) ; une jeep plus cinq motos pour le Nord - Ubangui y compris au
moins sept Hors - bord avec pirogues pour assurer la surveillance des eaux
mitoyennes (fleuve Congo et rivière Ubangui).
Il y a lieu d'imaginer le niveau de difficultés
qu'éprouvent les douaniers à l'Equateur par rapport aux moyens de
transport pour l'exercice de leurs fonctions.
En dépit de la mouvance motorisée
presqu'inexistante, les efforts que fournissent les douaniers à
l'Equateur méritent des fleurs dans la mesure où les recettes
constatées dépassent toujours le seuil que fixent les
assignations. Il y a de quoi se frotter les mains parce que si dotation en
logistique il y aurait, ils réaliseraient plus.
b) hormis l'actuel bâtiment administratif que l'OFIDA a
acheté à l'époque du Directeur Bontengo, il y a la
résidence du Directeur ou habite le Sous Directeur de la Brigade sur
l'avenue Mundji, parcelle voisine du bar 222 (Métropole) plus deux
immeubles spoliés, à savoir :
1) l'immeuble (rouge) sur l'avenue Libération (ex.
Mobutu), construit par le colon et cédé par le Directeur LELO
VANGU au Gouverneur NGOMA TOTO BWANGI, afin de loger les animateurs (26(*)) à l'époque du
MPR, Parti - Etat vers les années 80. Il est successivement
habité par des agents ou services de la fonction publique. Le
gouvernement provincial vient de le remettre en état, mais pour le
rendre à qui de droit (OFIDA), il exige le remboursement des frais
engagés.
Du Directeur Faustin MBENZA au Directeur Augustin BOZOBI,
en passant par l'équipe de la DG (DSG) dépêchée sur
terrain, plus d'une correspondance a été échangée,
y compris de l'argent versé au gouvernorat à titre de garantie
locative pour le dernier habitant, les politiques ne sont pas encore
prêts de déguerpir...
2) la résistance dans la non rémission de cet
immeuble à l'OFIDA avait conduit à l'achat de l'immeuble YANGA
sous le Directeur BIYA MUSIKU fort malheureusement, les relations personnelles
du Maréchal MOBUTU avaient influé sur le droit à la
propriété. Et, verbalement, il avait intimé l'ordre
à Monsieur NDJOKU EYOBABA, Gouverneur de province à cette
période de faire sortir l'OFIDA et remettre l'immeuble au vendeur. Ce
qui fut fait.
Considérant la primauté de la loi, nous osons
croire que si l'OFIDA se plaint, justice lui sera faite, à la seule
condition de disposer de titre.
3.2.2 AUX BUREAUX - RECETTES
Au niveau de la base, avons - nous dit, les bureaux - recettes
ont pour mission principale la perception des droits et taxes pour le compte du
trésor public.
Nous notifions en passant que, sauf Gemena, Gbadolite et
Dongo, tous les autres bureaux ont été institués pendant
la période du Congo - Belge. Ci - dessous, nous présentons les
douze bureaux - recettes qui forment la province douanière de
l'Equateur.
1. LE BUREAU - RECETTES DE BUMBA
Situé à 637 km de Mbandaka, le bureau - recettes
de BUMBA est une émanation d'Aketi en province Orientale. Son
implantation est due au prolongement du chemin de fer de la CFU avec pour
terminus BUMBA.
L'administration douanière est sous abri du
bâtiment des postes (OCPT) sur l'avenue Mongandenge n°2, cité
de Bumba, Chef - lieu de territoire du même nom dans le district de la
Mongala (Nord - Equateur).
Au code comptable : 412/000, ce bureau n'a que le produit
des T.E. et amendes comme source essentielle de recettes.
L'OFIDA à BUMBA n'a ni immeuble ni mobiliers. Le
secrétaire s'emploie à dactylographier à partir d'une
carcasse de machine à écrire, marque Olympia à grand
chariot, un truc à déclasser. Les receveurs se font fabriquer des
chaises et tables à bois qui laissent à désirer.
Ce bureau dispose d'une succursale que nous avons
implantée à Lisala.
Avec quatre postes de surveillance, notamment : Mongana,
Yakata (Territoire de Lisala), Engengele et Ndobo (Territoire de Bumba) la
succursale fonctionne dans une cabane en pusée érigée
contre le mur du bâtiment qui abrite le Commissariat Fluvial.
A part les deux tables et cinq chaises en bois que le
succursaliste J.M MBAKWANI à fait fabriquer, les agents commis à
Lisala, à travers postes de surveillance, pour travailler, ils
empruntent les mobiliers auprès des autres services (commissariat
fluvial ou OCC). Notons cependant que tout le personnel de ce bureau est
locataire.
2. LE BUREAU - RECETTES DE
DONGO
Né de la dernière guerre civile (1998 à
2003) par le MLC, Dongo est un des points frontaliers entre la RDC et le Congo
- Brazza sur la rivière Ubangui dans le territoire de Kungu, district du
Sud- Ubangui.
Situé à 541 km de Mbandaka, Dongo fut d'abord
l'une des succursales du Bureau recettes de Gemena. Sa situation
géographique a fait qu'il réalise beaucoup de recettes sous
l'administration rebelle du MLC. C'est ce qui fit qu'on lui accorda le statut
de bureau en utilisant le code comptable du bureau recettes de LIBENGE :
407/027.
Lors de la réunification du pays en 2003, les recettes
constatées ont convaincu la hiérarchie de l'OFIDA et le statut de
bureau fut maintenu.
Dongo dispose d'une succursale à Imesse, et de six
poste surveillance : Mokame, Mokolo, Mobambo, Ngona, Bolomo et Lua
(27(*)).
Par effet de la guerre, les immeubles douaniers à Dongo
et Imesse ont été détruits et spoliés.
3. LE BUREAU RECETTES DE GBADO-
LITE
Avec l'érection de Gbadolite en ville et la
construction de l'Aéroport International de Moanda (à cinq km du
centre ville), il y sera institué le bureau recettes en 1989 (28(*)). Un local a été
attribué au service douanier par la RVA. Code comptable : 419/000,
il est situe à 776km de Mbandaka.
Gbangi, Dula et sidi en sont les succursales et Kambo est le
poste de surveillance.
Nous faisons remarquer que le trafic d'influence sous le
Maréchal du Zaïre n'avait par permis au bureau de Gbadolite de
réaliser des recettes.
Le bureau a dû son salut à celles
réalisés au niveau de ses succursales.
En dehors du local de la douane à l'aéroport,
tout le service des douanes à Gbadolite ne fonctionne que dans des
maisons en location. Les quelques mobiliers et matériels de bureau que
nous avons vus n'attendent que leur déclassement.
4. LE BUREAU RECETTES DE GEMENA
Chef - lieu de district du Sud - Ubangui, au code
comptable : 409/074, le bureau de Gemena a été
institué suite à sa position stratégique entre Zongo,
Dongo et Gbado-lite ; et cela, lors de la coopération Belge
(4e Direction) au sein du ministère des finances en 1972 avec
la construction de l'aéroport.
Comme Gbadolite, l'administration douanière à
Gemena ne dispose que d'un seul local au bâtiment de la RVA à
l'aéroport. Il a pour succursale : Akula, Mbari et Mogalo et Binga
comme poste de surveillance.
Donc, la douane et les douaniers y sont locataires.
5. LE BUREAU RECETTES DE LIBENGE
Avec la construction de l'aédrome international, le
bureau de Libenge fut le tout premier à être implanté
à l'Equateur pendant la colonisation. Il a pour code comptable le
403/000. A 541 km de Mbandaka, Libenge possédait un camp ou
étaient construits trois bâtiments mais détruits à
ce jour par des spoliateurs.
Les deux succursales : Elaka et Zambi avec Mauya, Kala,
Izato, Salebo, Coton Congo (beach) et Batanga comme postes de surveillance font
générer à ce bureau assez de recettes (29(*)).
On y trouve des cabanes en pisée construites par des
agents et quelques bâtiments en location ; la résidence du
receveur et le bâtiment administratif y sont spoliés.
6. LE BUREAU RECETTES DE LUKOLELA
Au bord du fleuve Congo à 187 km de Mbandaka, le
bureau de Lukolela est frontalier. 407/027 est son code comptable. Le colon y
avait construit trois immeubles : un bâtiment administratif et deux
résidences occupés par des militaires lors de la guerre
civile, puis par la PNC, un seul vient d'être
récupéré par l'OFIDA (30(*)). Disons que ces bâtiments défectueux
sont dépourvus de mobiliers parce que tout a été
emporté par des inciviques.
Ngombe et Boleli en sont les succursales ; tandis que les
postes de surveillance sont les suivants Irebi, Maberu, Socobelam, Molebu,
Libembe et Lilanga. Certains ne sont par couverts alors que ce sont des
corridors qui facilitent la fraude. D'où la nécessité de
recruter d'autres agents pour ce faire.
7. LE BUREAU RECETTES DE MBANDAKA -
AERO
Le code comptable : 402/071 lui est attribué, un
espace non équipé et sans aménagement dans l'enceinte de
la concession RVA à l'aéroport de Mbandaka est indiqué
pour abriter ce bureau. L'endroit est transformé en lieu d'aisances pour
les éléments de la force aérienne qui y sont
postés.
Malgré le caractère international de cet
aéroport, les activités d'import et d'export ne sont pas
constatées. Tout ce que les douaniers font, c'est la conduite des
produits d'accises (cigarettes et pétrole) de l'aéroport aux
dépôts où ils procèdent par le pointage quantitatif
en vue du prélèvement de statistique, y compris la
vérification des documents et se font payer les heures prestées
dans le cadre des T.E.
Dépourvu de bâtiment administratif,
l'autorité provinciale à la création de l'OFIDA a dû
le placer sous la responsabilité des agents commis au bureau Mbandaka -
postes. Ces derniers sont tenus de différencier les recettes en les
versant à la banque à partir des écritures au moment de
la perception (soit pour le compte de Mbandaka - Aéro ou pour celui de
Mbandaka - Postes).
8. LE BUREAU RECETTES DE MBANDAKA -
POSTES
Fonctionnant au sein du bâtiment des Postes, ce bureau
au code comptable : 408/079 ne réalise presque plus de recettes
parce que les opérations qui y avaient lieu ne se font plus.
Pratiquement, c'est Mbandaka- Aéro qui agit dans
Mbandaka - Postes. C'est un peu le Vatican dans Rome.
Là on peut remarquer juste la présence de deux
tables (formica) et trois chaises en bois plus une armoire le tout est
entassé dans une petite cellule qui ne permet pas d'asseoir les trois
sections qu'organise un bureau recettes.
9. LE BUREAU PRINCIPAL DE MBANDAKA - VILLE
Le code comptable : 401/022 lui est attribué. A
l'instar de Libenge, ce bureau est institué depuis l'époque
coloniale sous la conduite d'un contrôleur principal. Quatre vingts pour
cent des recettes proviennent des accises, à travers les productions de
la brasserie et limonaderie / Bralima de Mbandaka.
A cela il faut ajouter les recettes dues au trafic frontalier
entre la RDC et les localités de Liranga et Makoti - mpoko d'où
partent les tissus imprimés, les produits pétroliers et divers
(Congo - Brazza).
Il y a de cela deux ans que son bâtiment administratif,
dans la concession de l'ONATRA au bord du fleuve Congo, est dépourvu de
sa toiture. Elle a été emportée par
l'intempérie.
Les dix mille dollars américains
décaissés par la DG pour le remettre en état sous le
Directeur Faustin MBENZA ont été désorientés.
Et au lieu de le réhabiliter, on y a construit deux
chalets : un pour la section brigade et l'autre pour les sections recette
et vérification. Avec la chaleur accablante de Mbandaka due au passage
de la ligne de l'Equateur, il est difficile d'y travailler ente 11 H et 14 H.
Imaginez les conditions de travail à cet endroit ou des passants et
gardiens, éléments de la PNC trouvent bon de se soulager dans le
bâtiment sans toiture et à proximité des ces chalets.
Pour ce qui est mobilier, il n'y a que quelques tables et
chaises en bois achetées soit par le receveur, soit par le commandant.
Les archives ne sont pas tenues alors que ce bureau devait servir de
référence, étant donné son ancienneté. Nous
encourageons les démarches tendant à récupérer le
bâtiment rouge pour l'abriter.
10. LE BUREAU RECETTES DE MOBAY - MBONGO
Situé à 800 km de Mbandaka et à 25km de
Gbado-lite, il a pour code comptable : 405/025. Il est frontalier au bord
de la rivière UBANGI et fait face à Mobayi-banga (localité
de la République Centrafricaine).
Le Colonisateur y avait construit un bâtiment
administratif et une résidence pour le receveur. Mais l'on conte que
lors de la construction du barrage de Mobay-mbongo, il paraît qu'il y a
eu un accord entre la SNEL et l'OFIDA pour que lesdits immeubles soient
détruits, afin qu'il soient construits par la SNEL (31(*)). Aujourd'hui, faute de
document pouvant faire preuve de cet accord, la SNEL décline.
C'est dans un chalet au bord de la rivière que l'OFIDA
fonctionne.
11. LE BUREAU RECETTES DE YAKOMA
A 976 km de Mbandaka, son code comptable est 406/026. Il est
institué au bord de la rivière UBANGUI et est frontalier à
la République Centrafricaine. Il organise, outre les traversées
(import et export), le trafic frontalier à travers le marché de
Limbogo (RDC).
Il y a un camp pour les agents avec une résidence pour
le receveur, un terrain où un opérateur économique aurait
consenti pour la construction du bâtiment administratif en faveur de
l'OFIDA sous le receveur TAKI. Les murs élevés souffrent de
manque de toiture. Il est aberrant que de telles initiatives ne soient pas
encouragées par la hiérarchie de l'Office. Nous estimons que
l'autorité devra se faire violence pour reconnaître cette
réalisation afin qu'elle soit inscrite dans son actif.
12. LE BUREAU RECETTES DE ZONGO
Au bord de la rivière Ubangi, la ville de ZONGO qui
fait face à Bangui (capitale de la République Centrafricaine),
est située à 758 km de Mbandaka, son code comptable :
404/024. En matière douanière, c'est le plus important bureau de
la province douanière de l'Equateur. Les crises politiques qui ont
secoué l'Afrique centrale (Tchad, Nigeria, Cameroun, Centrafrique) sont
à la base de baisse sensible des recettes.
Le patrimoine douanier y est carrément spolié
par les politiques. A l'essor de la ville, le bâtiment administratif de
la douane deviendra l'hôtel de ville, la résidence du receveur est
transformée en habitation du Maire de la ville et celle du receveur
adjoint en Inspection Judiciaire.
Il était question de rendre à l'OFIDA ses
immeubles, si et seulement si, l'Etat construit ceux pouvant abriter le Maire,
la mairie et l'Inspection Judiciaire. L'argent y destiné a
été détourné, dit - on.
Le bureau a pour succursale : Mondika et Gbangi qui, pendant
la rébellion du MLC, ont été attribués au bureau de
Gbado-lite (32(*)).
Il est regrettable que l'OFIDA soit locataire à ZONGO.
Pour cela la Mairie a attribué à l'OFIDA un terrain afin d'y
construire les entrepôts, bureau et maisons d'habitation pour agents.
Mais jusqu'à ce jour, l'exécution tarde à venir.
Maba, Regideso, Abattoir, Beach, Nguzaïre et Ambassade en
sont les postes de surveillance.
L'OFIDA/Zongo est contraint de louer des maisons pour abriter
ses services. Pourtant par droit, il peut être rétabli dans ses
droits face au spoliateur (l'Etat Congolais / la Marie).
CONLUSION
Nous nous sommes donné la peine de parcourir toute la
province douanière de l'Equateur en vue de voir et palper du doigt tout
son patrimoine.
L'impuissance de l'OFIDA par rapport à la spoliation de
ses immeubles a retenu notre attention. Le manque d'outils de travail et de
moyens de transport pour assurer la mouvance des agents devant lutter contre la
fraude tout en surveillant les frontières constitue aussi un
sérieux problème.
Nous estimons que l'office est doté de la division
juridique à laquelle revient la charge de suivre et d'intenter contre
les spoliateurs, afin de récupérer ses biens.
Aussi, faut - il que l'OFIDA par sa division des services
généraux programme la construction des infrastructures et la
réhabilitation de celles qui existent en état défectueux
pour que soit assurée aux agents la sécurité dans
l'exercice de leur fonction, et cela dans des conditions les plus humaines avec
des outils de travail appropriés. Car, les quelques matériels
qu'on utilise doivent être déclassés.
CHAPITRE QUATRIEME :
DE LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'OFIDA/EQUATEUR
4.1. NOTION DE GESTION DU PATRIMOINE
L'approche thématique de ce travail a conduit à
la définition de chacun des termes clés notamment gestion et
patrimoine.
Ce dernier ayant un champ beaucoup plus large, il ressort
qu'il faut bien le connaître. Ce qui implique la quantification de ce
qu'on a pour pouvoir le gérer.
La complexité des éléments qui composent
le patrimoine d'une personne physique ou morale exige des aptitudes de la part
du gestionnaire. C'est pourquoi la connaissance préalable de techniques
de gestion en la matière s'avère indispensable.
Cela étant, le gestionnaire du patrimoine devra
être capable de disposer, d'inventorier, de pourvoir, de contrôler,
de déclasser et d'acquérir ce dont on a besoin pour faire
fonctionner l'entreprise.
1°) disposer de
patrimoine, c'est savoir l'arranger, et cela dans un ordre pour
pouvoir l'utiliser à temps voulu. Ici, on fait appel au service de
l'économat, de bibliothèque, d'archivage, etc. Les acquisitions
et les déclassés y sont stocks et rangés
conformément aux normes édictées par le classement.
2°) inventorier le
patrimoine, tenir la statistique du patrimoine permet de
dénombrer, de se rendre compte de l'état des biens (meubles et
immeubles), de leur existence ou disparition, de faire des projections.
3°) pourvoir en biens
patrimoniaux, c'est doter des outils, des moyens, des
infrastructures, de la logistique... en vue de la réalisation d'un
objectif. La notion incarne la mise à disposition.
Sinon, il sera difficile d'atteindre l'objectif poursuivi.
Sur ce, la procédure de cession doit respecter la structure
établie (SG) pour ne pas léser les personnes
responsabilisées.
4°) contrôler le
patrimoine : il ne suffit pas seulement de pourvoir et
d'inventorier les biens. Un contrôle permanent de ceux - ci permet au
gestionnaire de prendre des dispositions pour éviter le dérapage
et, éventuellement, sanctionner les bévues.
5°) Déclasser, c'est le
processus obligatoire qui doit avoir lieu lorsque les mobiliers et immobiliers
sont reconnus amortis, après usage. La démolition est
conseillée pour des immeubles n'ayant plus la garantie de
résister aux intempéries et le déclassement pour les
matériels dépassées ou abîmés.
6°) Acquérir :
l'acquisition de patrimoine dérive soit de l'héritage comme nous
l'avons explicité plus haut, soit des revenus sur base de
bénéfice réalisé, soit des dons et legs. Une
gestion efficiente produit des possibilités pour acquérir le
patrimoine.
Aussi, faut - il que le patrimoine soit bien
géré. L'expertise dans ce domaine nous dicte un devoir, celui
d'assister techniquement les gestionnaires qui pourront mettre à profit
notre savoir, afin de réussir là où bon nombre de
responsables échouent.
4.2. LE MODE DE GESTION DU PATRIMOINE DOUANIER
A l'OFIDA, le patrimoine est géré par la
division des services généraux (DSG) au niveau national sous la
supervision du Président du comité de gestion.
En province, c'est l'inspection chargée des ressources
humaines qui s'en occupe sous la conduite du Directeur Provincial. Ci-dessous,
nous présentons les gestionnaires, les chargés et les gardiens du
patrimoine douaniers tel qu'organisé à l'OFIDA.
4.2.1. LES GESTIONNAIRES
En ce qui concerne le patrimoine douanier, nous
avons :
1°) l'ADG, en tant qu'autorité n°1,
est l'ordonnateur des dépenses pour tous les approvisionnements sur base
de réquisitions des provinces - entendez douanières et des
services centraux et, pour la faisabilité, c'est -à - dire achats
ou cessions, il se remet au Directeur Divisionnaire des services
généraux, afin d'exécuter la décision.
L'autorité est aussi tenue de recourir à des
sanctions contre les abus et, s'il le faut, autoriser des poursuites
judiciaires dans ce domaine.
2°) la Division des Services Généraux
(DSG), c'est à elle que revient la gestion de tout le patrimoine de
l'OFIDA (Cf. A5). La DSG est un des services centraux de l'appareil
administratif douanier. C'est auprès d'elle que toutes les
réquisitions en la matière sont adressées. La lourde
charge assignée à cette division nécessite qu'on y
affecte des gens capables en vue d'une bonne gestion de patrimoine. Il faut
réaliser que la codification et la tenue à jour de la
comptabilité des mobiliers et immobiliers sont autant des obligations
professionnelles.
Malheureusement, nous avons pu constater en dépit de la
structure (DSG) telle qu'organisée, l'inexistence d'outils de travail
(ce qui fait que la codification soit l'initiative externe) ; pas de
comptabilité tenue ; le non respect de procédure dans la
cession (un bien acquis peut être cédé sans qu'il soit
même enregistré par le service concerné de la DSG) ;
des missions d'inventaire ont lieu simplement dans le but de faire rapport au
ministre de portefeuille qui a un droit de regard sur les biens de
l'office ; pas de suivi des dossiers et l'impunité contre les
megestionnaires et détourneurs ... pour ne relever que ces
manquements.
3°) les Directeurs Provinciaux : sont dans
leurs juridictions respectives des personnes à qui incombe la gestion
des biens (meubles et immeubles) appartenant à l'OFIDA. Sur base de
crédit pour le fonctionnement de leurs entités, ils peuvent aussi
pourvoir aux besoins de services.
Lorsque le coût du bien qui manque est
élevé, ils sont tenus de s'adresser à l'ADG qui, à
son tour, demande à la DSG de s'exécuter par rapport à
l'état de besoin présenté. Les DP sont compétents
pour punir les agents et cadres reconnus coupables de détournement des
biens mis à leur disposition pour l'exécution du travail.
De tous les Directeurs qui sont passés à
Equateur, il n'y a qu'un petit nombre qui s'est distingué par le souci
d'acquérir et de bien gérer le patrimoine. On en parlera.
4.2.2 . LES CHARGES DE PATRIMOINE
Nous avons dit plus haut qu'en province, les ressources
humaines et le patrimoine sont au sein d'une même inspection, celle que
les immobilistes de l'administration continuent à appeler :
Inspection du Personne (33(*)) et Services Généraux (IPSG).
En principe, outre l'inspecteur, chef de service et le
contrôleur (CB) qui l'assiste, il doit y avoir deux vérificateurs
dont un chargé de RH et l'autre des SG.
Ce qui revient à dire que l'inspecteur et le
vérificateur des SG sont, de droit, les chargés de patrimoine
sous l'encadrement du premier, le second devra tenir la comptabilité et
connaître, registres à l'appui, les acquisitions, les cessions, la
codification, les déclassés, etc.
A l'Equateur, c'est un Rédacteur, aux aptitudes qui
laissent à désirer, qui tient le patrimoine sous la conduite d'un
contrôleur !
4.2.3 LES GARDIENS DU PATRIMOINE
1° les éléments de la brigade
douanière
En 1964, par souci de lutter contre la fraude en vue de
maximiser les recettes, il a été créé un service de
recherche, appelé : garde frontière au sien de la douane. Sa
réforme aboutit à la création de la Brigade
Douanière par l'ordonnance n° 78- 302 du 06 juillet 1978.
Les dispositions de la décision
n°DG/SG/ADG/028/2003 du 23 Mai 2003 portant réorganisation de la
Brigade Douanière stipulent en leur titre IV portant attributions,
article 5, point 3 : « protection du patrimoine, elle consiste
notamment à :
- Surveiller les entrées et sorties dans les
bâtiments et édifices de l'office ;
- Garder les biens meubles et immeubles appartenant à
l'office ».
Les prescrits de la décision précitée
attribuent aux éléments de la brigade douanière le
rôle de gardiens du patrimoine de l'office.
Or, quelques uns de cette section, ignorant ces dispositions,
trouvent minimisant quand on leur demande de veiller sur le patrimoine en
contrôlant les entrées et sorties tout en gardant les biens de
l'OFIDA.
Nous pensons que le scepticisme n'a pas sa raison
d'être aussi longtemps que les clauses sont claires. Donc, la protection
du patrimoine douanier est l'affaire de la brigade douanière.
4.3. LES INTERVENTIONS DE L'OMD (34(*))
Créée en 1952 sous le nom de Conseil de
Coopération Douanière (CCD), l'OMD (1994) qui lutte contre la
fraude, la drogue, la contrefaçon et la piraterie, met à la
dispositions de ses membres dont la RDC de nouvelles technologies de
l'information et développe un système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises qui contribue à
la facilitation du commerce international ( cf. tarif douanier ).
En développant des normes internationales qui
permettent de sécuriser le mouvement des marchandise et en soutenant ses
membres dans leurs efforts de modernisation via son programme de renforcement
des capacités, l'OMD fournit à ses administrés divers
instruments qui leur permettent d'appuyer leurs pratiques sur des normes
acceptées à l'échelon international...
La coopération douanière stimulée et les
formations organisées par l'OMD préparent les
bénéficiaires à gérer les problèmes
techniques et opérationnels liés à la mise en oeuvre de
nouvelles stratégies.
Ce sont là des éléments patrimoniaux que
l'OMD met à la disposition des douanes congolaises qui doivent bien les
gérer.
Bref, l'OMD, à travers ses travaux qui touchent au
développement des normes, à la simplification et à
l'harmonisation des procédure, à la sécurité de la
chaîne logistique, à la facilitation du commerce international et
ses initiatives en matière de renforcement durable des capacités,
dote le service douanier congolais de manuels, instruments et
compétences pour son bon fonctionnement.
4.4. LES SPOLIATEURS
Spolier quelqu'un, c'est le déposséder, et cela
par force ou par fraude, selon le dictionnaire universel.
Le patrimoine de l'OFIDA connaît des spoliations
ça et là sous l'oeil indifférent de l'autorité et
l'impuissance de certaines personnalités qui oeuvrent au sien de la
division juridique. Les lignes suivantes s'intéressent aux spoliateurs
du patrimoine douanier à l'Equateur.
4.4.1. LES POLITIQUES
Les hommes d'Etat du Congo démocratique ont aussi
joué un rôle négatif sur le patrimoine de l'OFIDA /
Equateur.
1°) A Mbandaka :
a) Immeuble rouge sur AV. Libération (ex.
Mobutu), cédé par le DP LELO VANGU au Gouverneur NGOMA TOTO
BWANGI, afin de loger des animateurs vers les années 80, sera
confisqué jusqu'à ce jour par l'administration publique. Les
démarches entreprises pour sa récupération n'accouchent
que d'une souris.
b) Immeuble YANGA sur av. Zongo, acheté sous le
DP BIYA MUSIKU, fut récupéré par la soeur du vendeur sur
« ordre verbal » du Maréchal du Zaïre au
Gouverneur NDJOKU EYOBABA. Et dire que la vente eut lieu en bonne et due
forme ! Nous exhortons l'autorité douanière et les cadres de
la division juridique de s'y pencher, afin de rétablir l'OFIDA dans ses
droits.
2°) A ZONGO : la réforme administrative de
1982, dite la réforme VUNDUAWA (35(*)) éleva la cité de Zongo au rang de
ville sans penser aux infrastructures. Ce qui a conduit à la
dépossession de la douane : le bâtiment administratif devient
la Marie ; la résidence du Receveur, celle du Maire ; et,
celle du Receveur Adjoint va se convertir en inspection judiciaire.
Toutefois, un terrain a été attribué
à la douane par la Mairie au bord de la rivière Ubangui pour y
construire, et cela sans budget !
3°) A Mobay - mbongo : lors de la construction du
barrage, tout le patrimoine douanier fut détruit par la SNEL avec
promesse de reconstruction. Mais, aujourd'hui la SNEL tient à voir les
documents y afférents pour s'exécuter.
Il apparaît que les douaniers de ce temps là
n'avaient pas usé de prudence pour mettre sur papier cette
convenance !
4.4.2. LES MILITARISES
Par militarisés, il faut entendre l'ensemble des agents
de l'ordre (soldats et policiers) qui par moyen de fait (de retour d'un
échec enregistré au front ou par assaut) se sont accaparés
le patrimoine douanier pendant la dernière guerre civile (1998- 2003)
C'est le caporalisme qui est à la base de ce
comportement incivique qui fait que le soldat se voit supérieur au
civile, donc son Chef malgré le rang et le niveau de ce dernier.
Simplement parce qu'il peut faire usage de son arme et traîner le civile
à sa guise.
L'on retiendra que le caporalisme a réussi à
maintenir les dictateurs au pouvoir jusqu'à maintenant.
Le constat est qu'ils détruisent ou ils arrivent
à déposséder les civils ou l'Etat /OFIDA. Les cas
enregistrés sont ceux de :
1°) LUKOLELA : des trois immeubles, un seul venait
d'être récupéré comme dit plus haut.
2°) DONGO : ils sont encore dans le bâtiment
administratif où fenêtres et portes avaient déjà
été détruits par eux- mêmes. Sauf, celui de la
brigade douanière.
3°) LIBENGE : tout le camp (trois immeubles) est
détruit par les mêmes éléments.
Aussi longtemps que les idées développées
par MONTESQUIEU(36(*))
dans son livre : « l'esprit des lois, 1748 »
soutiennent que le pouvoir arrête le pouvoir, nous trouvons inexplicable
que l' OFIDA soit dépouillé de son patrimoine devant sa structure
d'éminents juristes qu'est la Division juridique par des politiciens et
des militaires.
Que des poursuites judiciaires soient entamées ou,
à défaut de celles - ci, supprimer carrément la fameuse
division qui ne fait rien du tout sur la défense du patrimoine voire
même celle des agents en cas de litiges !
4.5. EVALUATION DE LA GESTION DU PATRIMOINE DOUNIER A
L'EQUATEUR
Le présent point s'occupe de l'évolution dans la
gestion du patrimoine de l'OFIDA / Equateur. Une vision examinative des trente
ans du service douanier sur le plan des ressources tant humaines que
patrimoniales.
4.5.1. DES MOYENS HUMAINS
L'on se demandera peut être pour quelle raison nous
évaluons les humains. Certes, nous l'avons déjà
annoncé : on ne peut pas parler patrimoine sans homme parce qu'il
est lié à lui.
C'est pourquoi quelle que soit la nouvelle technologie de
l'information, pour produire des recettes dont a besoin le gouvernement, le
service douanier utilise des hommes et des femmes.
En 1997, l'OFIDA/ Equateur comptait cinquante- cinq agents
(55). L'effectif sera quadriplé en 2005, soit huit ans après
grâce au recrutement fait par l'administration rebelle du MLC. LA
Décision d'engagement fut signée le 12 décembre de la
même année par Déo RUGWIZA MAGERA (37(*)). Aujourd'hui, y compris les
préavisés pour la retraite, le personnel se constitue de 177
cadres et agents.
Quant au personnel féminin, toute la province compte
une vingtaine ; et, aux commandes, il n'y a que six dont trois receveurs,
un vérificateur, un commandant adjoint et un Chef du pool informatique
à la Direction Provinciale, en l'occurrence Mme Laurentine NLANDU,
épouse de Monsieur Justin MBAGA, Secrétaire de Direction.
Ainsi, sur le plan humain il y a lieu de noter une avance tant
en quantité qu'en qualité, ici par rapport au niveau
d'études, c'est le MLC qui a eu le mérite d'amener à
l'OFIDA / Equateur assez d'instruits.
Fort malheureusement, le social de ces agents et
fonctionnaires de la douane à l'Equateur laisse à désirer
par rapport à leurs collègues d'autres provinces ceci est
dû au manque d'opérations douanières.
En dépit de bonus et P.H. assez consistants, la vie
Chère et le retard dans le paiement de ces dus, le manque quasi total
des douanes (Import, Export) sont de majeures difficultés que
rencontrent les douaniers à l'Equateur. C'est pour toutes ces raisons
qu'il est un peu rare que l'on y rencontre des douaniers qui ne sont par
équatoriens.
Très souvent, ce sont des temporaires qui y prestent en
attendant leur engagement pour partir ailleurs. Et l'Equateur, terre de
passage, se voit vider de non originaires à la première
occasion.
4.5.2. DES IMMOBILIERS
Une régression sensible en ce qui concerne les
immobiliers de l'OFIDA à l'Equateur.
Pour douze bureaux ayant au moins une succursale plus la
direction provinciale, on pouvait compter une trentaine d'immeubles, mais
hormis les spoliés et les détruits, la province douanière
de l'Equateur ne dispose que de neuf bâtiments dont deux
résidences (Receveur de Yakoma et le Sous Directeur à Mbandaka).
Le Directeur Provincial est locataire !
L'OFIDA n'a jamais construit à l'Equateur sauf quatre
maisons achetées dont deux spoliées et deux occupées par
lui (résidence S/D bâtiment administratif de Direction
Provinciale).
Il y a longtemps que les phonies implantées dans les
bureaux- recettes ont cessé d'émettre. De nos jours, ce ne sont
que des traces qu'on peut voir, car les appareils ont été
emportés par des douaniers qui sont restés impunis.
4.5.3 DES RECETTES
Malgré la guerre en Afrique centrale et la notre,
depuis l'unification du pays (38(*)), les recettes présentent une courbe
ascendante par rapport aux assignations. Les réalisations sont toujours
un peu plus que prévues.
4.5.4. DES MOBILIERS
(Cf. éléments patrimoniaux de chaque structure
au chapitre 3e).
Néanmoins, l'informatisation des données qui
vient de faire son entrée à la D.P. n'est qu'administrative. Il
vaut mieux s'en tenir aux normes qu'édicte l'OMD pour endiguer les
pratiques dépassées.
4.5.5. DES STRUCTURES
A la création de l'OFIDA en 1979, avions - nous dit,
l'Equateur comptait neuf bureaux. Actuellement, il y en a douze. Il y a lieu de
noter une évolution dans ce domaine qui fait passer, pour les
dirigeants, de contrôleurs principaux aux directeurs provinciaux.
CONCLUSION
De la notion essentielle pour la gestion de patrimoine, nous
avons analysé le mode mis sur pied par l'OFIDA.
Un examen minitieux nous a permis de constater qu'il y a
négligence du patrimoine en faveur des recettes dont la
réalisation passe pour priorité des priorités.
A l'Equateur, il y a lieu de remarquer de l'évolution
concernant les ressources humaines, les structures et les recettes ;
tandis que les immeubles et les mobiliers et le social souffrent de
régression.
Que l'autorité s'y penche !
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette oeuvre scientifique qui a eu le
mérite d'écrire l'histoire de la gestion du patrimoine, nouvelle
orientation dans le monde des affaires tant privées que publiques, il
est normal que les limites constatées soient étalées en
vue de la vérification de l'hypothèse.
Aussi, faut-il qu'une série des pistes de solution soit
proposée à titre d'apport du connaisseur comme correctif à
l'attention des néophytes.
Concernant le patrimoine douanier qui fonde notre
étude, le constat est amer pour cette grande régie
financière qu'est l'OFIDA. L'accent est surtout mis sur la maximisation
des recettes pour le compte du trésor public. C'est ce qui justifie
l'importance de la contribution de l'office à plus au moins trente pour
cent au budget de l'Etat. Cela est dû au fait que le protectionnisme n'a
pas encore cédé sa place à l'économie de
marché - mieux le libre échange comme c'est le cas dans les pays
développés où l'impôt intérieur forme le
budget national en lieu et place des recettes douanières pour les pays
en voie de développement tel que la République
Démocratique du Congo.
La priorité accordée à la maximisation
des recettes a conduit à ce que le patrimoine douanier ne soit pas bien
géré. Il y existe la négligence pure et simple de la part
de l'autorité. Pour autant qu'il est difficile, voire impossible de
dissocier le patrimoine de l'individu, nous avons pu remarquer qu'à
l'OFIDA, le social n'est pas du tout pris en compte. L'application des bonnes
dispositions que contient la convention collective de l'entreprise souffre de
faisabilité en faveur du personnel, producteur de ces recettes.
En dépit de l'existence de la division des services
généraux, la gestion du patrimoine n'est pas assurée.
L'autorité ne s'y intéresse pas tellement. Il n'y a pas de suivi
ni répression contre les mégestionnaires.
L'immobilisme au sein de la DSG où l'on remarque peu de
motivation face aux spoliateurs conduit à ce que ceux-ci ne soient pas
inquiétés.
Bref, les entrées et sorties des machines,
matériels,équipements et même la logistique se font sans
formalité d'usage ; les archives non organisées et des
inventaires ne sont tenus que lorsqu'il faut faire rapport au Ministère
du Portefeuille.
Il est aberrant que le patrimoine (Immobiliers et mobiliers)
ne soit pas pris en considération, alors qu'il est indispensable pour
l'existence des personnes tant morales que physiques.
Etant donné que gérer, c'est
prévoir ; il vaut mieux que chacun des services de la DSG soit en
mesure d'accomplir sa tâche comme il se doit. L'autorité devra
lutter contre l'impunité et faire le suivi de tous les dossiers ayant
trait au patrimoine de l'entreprise en sachant que l'acquisition, la
cession, l'usage, la maintenance, l'inventaire, le déclassement des
biens et leurs utilisateurs constituent les éléments qui doivent
requérir son attention.
Elle devra aussi savoir que négliger le patrimoine,
c'est détruire à petit feu son entreprise.
Eu égard à ce que nous avons
déploré à l'OFIDA, nous conseillons aux gestionnaires,
quelle que soit la recherche pour l'amélioration de rendement, de
toujours tenir compte de la gestion efficiente du patrimoine et de
l'élément humain qui est reconnu, actuellement, comme
l'investissement le plus important dans ce domaine.
Considérant le vaste champ du concept patrimoine et son
indissociabilité d'avec l'homme, les gestionnaires sont invités
à se gêner s'ils ne sont pas entrain de gérer
convenablement le patrimoine mis à leur disposition, car la survie de
leurs entreprises en dépend.
Un conseil, c'est à prendre ou à laisser, dit -
on. Mais, nous estimons que repenser sa façon de gérer pour agir
convenablement, c'est
de la grandeur en ce sens qu'elle naît de
l'humilité, disposition à s'abaisser pour écouter,
apprendre, mettre en pratique, afin de réussir sa mission, celle de
savoir gérer qui implique la pérennité des
institutions.
Notre désir, à l'instar de Mme MUSANGI(39(*)), c'est que la gestion du
patrimoine soit réorganisée sur des bases modernes et que les
gestionnaires, outre l'amélioration de rendement ou la maximisation des
recettes, y mettent du sérieux pour que les entreprises
récupèrent les biens spoliés et prospèrent avec des
producteurs jouissant d'un bien - être suffisant !
Somme toute, nous exhortons les gestionnaires à faire
mieux. En d'autres termes, à gérer comme il se doit les
ressources tant humaines que matérielles qui sont mises sous leur
gouverne en vue de se passer de la mégestion qui, de nos jours, a pour
conséquence la société qui se gangrène.
En plus, bien des gens conviendraient avec nous que
l'élément humain est et restera au centre de toute
activité productrice à telle enseigne que nulle ne peut
prétendre parler « bonne gestion » lorsque les
conditions de travail et de vie de celui - ci ne sont pas
améliorées. Car, passez - nous l'expression, tout responsable qui
ne se préoccupe que du rendement de l'entreprise n'est pas du tout un
bon gestionnaire.
Ainsi, la douane et le douanier étant
étudiés à titre illustratif en ce qui concerne la gestion
du patrimoine, nous prenons la respectueuse liberté de dire, en
définitive, qu'il convient de ne placer à la tête des
entreprises publiques ou privées que des personnes compétentes en
vue de maintenir l'équilibre entre le rendement et le social, afin que
vive l'emploi et l'employé.
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
A. ARCHIVES
1. Rapports Annuels de l'OFIDA/Equateur : 2005,2006 et
2007
2. Lettre N° OFIDA/00/081/EQ/2005 du 17 octobre 2005 portant
état de lieux de la Province Douanière de l'Equateur, Sé
S. KATALIKA, DP
3. Inventaire du Patrimoine de l'OFIDA/Equateur en 2007
4. Note de Service N° DG/CAB/PDG/98/044 portant structure
et attributions de la Brigade Douanière
5. Instruction N° DG/DV/ADG/011/03 relative à
l'Evaluation en Douane des Marchandises Importées.
B. OUVRAGES
|
01.
|
BORDIN M,
|
La Survie économique et sociale des pays en voie de
développement, Collection Hatier, Paris, 1973, p.136
|
|
02.
|
BUNDU PHEMBA,V.
|
Législation Douanière,
2ème Douane, Cours inédit, ENF, 2005-2006
|
|
03.
|
DELOBEL, C. Adiba, M.(1982)
|
« Bases de Données et Systèmes
Rationnels, Dunod Informatique
|
|
04.
|
DICTIONNAIRE UNIVERSEL,
|
Hachette, Edicef, Paris, 1996
|
|
05.
|
GUYOMAR, A.
|
Economie et Gestion, Ed. Sirey, Paris, 1995, p. 124
|
|
06.
|
FAYOL H.,
|
Gestion de l'Entreprise, 2è Ed.
Hatier, Paris, 1975, p. 108
|
|
07.
|
IMBUSA,
|
Gestion des Ressources Humaines Cours inédit, L2
HGP/ISP/Mbka, 2008-2009
|
|
08.
|
KALAMBAI LUPUNGU,
|
Cours de Droit Civil, « les biens »,
2ème Graduat, UNIKIN, 2008-2009
|
|
09.
|
KALUBI M'KOLA,
|
Cours de Méthodologie de l'Histoire,
1ère Licence HGP/ISP/Mbka, 2007-2008
|
|
10.
|
|
Cours des Relations Internationales I,
1ère Licence HGP/ISP/Mbka, 2007-2008
|
|
11.
|
MORGAN P.
|
Dictionnaire Informatique, 4ème éd.,
LAROUSSE, Paris, 1982
|
|
12.
|
PONCELET. E,
|
Méthode d'Analyse Informatique de Gestion,
éd. FLORE, Canada, 1996
|
|
13.
|
REETERS. E,
|
Conception et Gestion de banque des
données,éd. Organisation, Paris, 1984 p.16
|
|
14.
|
SMITH A,
|
Recherche sur la nature et les causes de la richesse des
nations, 2è éd. Hatier, Paris, 1776, p.27
|
|
15.
|
TSHISUNGU L.
|
Histoire des Institutions Administratives du Congo,
1ère Licence HGP/ISP/Mbka, 2007-2008
|
C. ARTICLES
|
1.
|
M. EBANEA,
|
L'Organisation Mondiale des Douanes en quelques mots, WWW.
Google.Com 2007
|
|
2.
|
MOKANDA - EKA
|
L'Organisation Mondiale des Douanes, ULB, 2007
|
D. TRAVAUX DE FIN D'ETUDES
|
1.
|
NSESE BOFETE G,
|
Conception et réalisation d'une base des données
pour le dédouanement des marchandises, TFE ISC/GOMBE 2006-2007 p.17
|
E. LE NET
WWW. Google.Com 2007
F. LISTE DES INFORMATEURS
|
N°
|
NOMS
|
SEXE
|
AGE
|
FONCTION
|
LIEU ET DATE DE L'INTERVIEW
|
|
01.
|
BOLONGA Isabelle
|
F
|
50 ans
|
CONTROLEUR
|
BR/MBKA-VILLE, le 10/07/2008
|
|
02.
|
BOMBENGA Jean Pierre
|
M
|
63 ans
|
INSPECTEUR
|
DP/OFIDA/EQ, le 11/07/2008
|
|
03.
|
BONTENGO
|
M
|
65 ans
|
DIRECTEUR
|
DG/OFIDA, le 10/11/2008
|
|
04.
|
BOZOBI Augustin
|
M
|
55 ans
|
DIRECTEUR
|
DP/OFIDA/EQ, le 13/03/2009
|
|
05.
|
DIGEBU Thomas
|
M
|
67 ans
|
INSPECTEUR
|
DP/OFIDA/EQ, le 14/07/2008
|
|
06.
|
EKUNDE YABENO
|
F
|
76 ans
|
MENAGERE
|
LIBENGE , le 04/01/2009
|
|
07.
|
KOYATONGU Dieudonné
|
M
|
52 ans
|
CONTROLEUR
|
DP/OFIDA/EQ, le 16/07/2008
|
|
08.
|
LUFETA Félicien
|
M
|
51 ans
|
S/BRIGADIER
|
BR/MBKA -AERO, le 12/08/2008
|
|
09.
|
MAIBENYE Eugène
|
M
|
33 ans
|
RED.PPL.
|
ENF/KIN, le 12/11/2008
|
|
10.
|
MUNGENGA LOKITO
|
M
|
80 ans
|
NOTABLE
|
DONGO, le 27/02/2009
|
|
11.
|
MONGA EKAKALA
|
M
|
78 ans
|
JUGE
|
BUMBA, le 13/04/2009
|
|
12.
|
MONGASSY Danis
|
M
|
60 ans
|
CONTROLEUR
|
BR/MBKA-VILLE, le 15/05/2009
|
|
13.
|
MUSANGI Marie
|
F
|
44 ans
|
CONTROLEUR
|
DG/OFIDA, le 16/11/2008
|
|
14.
|
NGBANGBO Jean Pierre
|
M
|
43 ans
|
VERIDASS
|
BR/LIBENGE, le 04/02/2009
|
|
15.
|
PENZE Eyenga
|
M
|
40 ans
|
REDACTEUR
|
BR/ZONGO, le 15/02/2009
|
|
16.
|
WAGBA NZONDOMIYO
|
M
|
83 ans
|
NOTABLE
|
LIBENGE, le 03/03/2009
|
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE........................................................................................................................................iDEDICACE
........................................................................................................................................ii
AVANT - PROPOS
..........................................................................................................................iii
SIGLES & ABREVIATIONS
..............................................................................................................iv
INTRODUCTION GENERALE
1
01. PROBLEMATIQUE DE GESTION
1
02. TERMINOLOGIE THEMATIQUE
4
03. SOURCES ET DOCUMENTATION
8
04. METHODOLOGIE EMPLOYEE
8
05. PLAN DE TRAVAIL
9
CHAPITRE 1ER : HISTOIRE DES
DOUANES CONGOLAISES
10
1.1. SUR LE PLAN INTERNATIONAL
10
1.2. SUR LE PLAN NATIONAL
15
CONCLUSION
19
CHAPITRE 2ème :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFIDA
20
2.1. STATUT ET BASE JURIDIQUE
20
2.2. DES MISSIONS
21
2.3. STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ET
FONCTIONNEMENT
23
CONCLUSION
40
CHAPITRE 3ième : LE
PATRIMOINE DE L'OFIDA / EQUATEUR.
41
3.1. DE L'ACQUISITION
41
3.2. DU PATRIMOINE A LA DIRECTION PROVINCIAL ET
AUX BUREAU RECETTES.
41
CONLUSION
54
CHAPITRE 4ième : DE
LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'OFIDA/ EQUATEUR
55
4.1. NOTION DE GESTION DU
PATRIMOINE
55
4.2. LE MODE DE GESTION DU PATRIMOINE
DOUANIER
57
4.3. LES INTERVENTIONS DE L'OMD
60
4.4. LES SPOLIATEURS
61
4.5. EVALUATION DE LA GESTION DU
PATRIMOINE DOUNIER A L'EQUATEUR
64
CONCLUSION
67
CONCLUSION GENERALE
68
ANNEXES....................................................................................................
72
BIBLIOGRAPHIE
.........................................................................................73
ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION
PROVINCIALE DE L'OFIDA/EQUATEUR (*)
Directeur Provincial
Secrétariat
Inspection B.D & Contentieux
Inspection
Accises
Inspection
RHSG
Inspection Statistiques & Documentation
Inspection Douanes
& Vérification
Inspection Provinciale
NORD-EQ.
Contrôle
SUD-UBANGI
BR/
MBKA-AERO
BR/
MBKA-POSTE
BR/
MBKA-VILLE
BR/
BUMBA
BR/
GBADOLITE
BR/
MOBAYI-MBONGO
BR/
YAKOMA
BR/
DONGO
BR/
GEMENA
BR/
LIBENGE
BR/
ZONGO
Comptabilité des Dépenses
S/D des Douanes & Accises
S/D de Brigade Douanière
Comité de Direction
Inspection
Comptabilité
Contrôle
NORD-UBANGUI
BR/
LUKOLELA
(*) Conception novatrice compte tenu de ce qui doit
être.
ANNEXE 4 : ORGANIGRAMME D'UN BUREAU -
RECETTES (la base)
Receveur
Commandant
Vérificateur Assistant
Commandant Adjoint
Receveur Adjoint
Brigadier en Chef
Secrétaire
Accepteur
Vérificateur
Brigadiers
Commis
Sous-brigadiers
Huissier
Remarques :
- à ce niveau, toutes les recettes perçues doivent
être logées à la banque par le receveur ou son
préposé au plus tard 48 H.
- dans un bureau principal, le Receveur Principal est
secondé par un receveur, cas de Mbandaka - ville par exemple.
- à la base, le receveur, le vérificateur et le
commandant ont tous le grade statutaire de vérificateur.
- Sous-brigadier, terme usité pour désigner un
agent temporaire qui intervient dans la brigade douanière.
ANNEXE 5 : ORGANIGRAMME DES SERVICES
GENERAUX
B. MAINTENANCE
DIRECTEUR DIVISIONNAIRE
DES SERVICES GENEARUX
COMPTABILITE
SECRETARIAT
INSP. PRODUCTION
S/D APPROVISIONNEMENT
& IMPRIMERIE
INSP. PRODUCTION
S/D BATIMENT & TRANSPORT INTENDANCE & MAINTENANCE
DES SERVICES GENEARUX
INSP. APPRO.
INSP. INTENDANCE
& MAINTENANCE
INSP. BATIMENTS
INSP. BATIMENTS
INSP. BATIMENTS
B. ATELIER
LOBO.
B. GESTION
B. MARCHES
B. PATRIMOINE
B. TELECOM
B. REGIES
B. GARAGE
B. GESTION
DE TRANSPORT
C. Impression
C. Rognage
C. Reluire
C. Etude &
Programmation
C.Comptabilité
C. M.P
C. Magasin
& stock
C.Commande
& Achat
C. Economat
C. Mobiler & Immobilier
C.Personnel
C.Inventaire
C. Electro-
Mécanique
C. Electric
C. Froid
C.Protection Immo
et Gardienage
C. Centr.
Ale. Tél.
C. Phonie
C.Plomberie
C. Maçonnerie
C. Menuiserie
C. Mécanique
Auto.
C.Electricité
Auto.
C.Tolerie
C. Pièces
De rechange
C. Pièces
De rechange
C.
Consommable
C. Charoi
Auto
ANNEXE 1 : CADRE ORGANIQUE DE
L'OFIDA
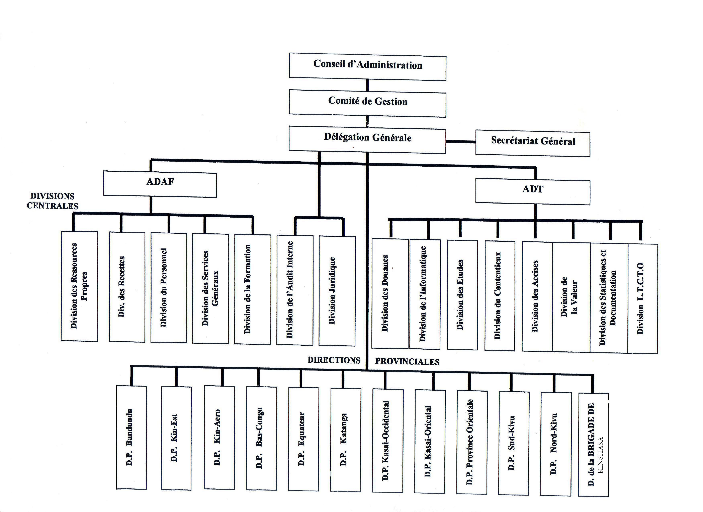
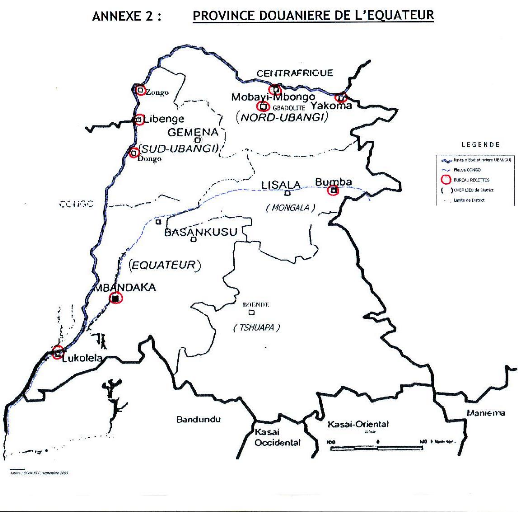
* 1 KALUBI M'KOLA, Cours
d'Histoire des Relations Internationales, 1ère Licence
HGP/ISP Mbka, 2007-2008.
* 2 KALUBI M'KOLA,
Méthodologie de l'Histoire, 1ère Licence HGP/ISP
Mbka, 2007-2008.
* 3 Dictionnaire Universel,
Edicef, Paris, 1996.
* 4 FAYOL H., Gestion de
l'entreprise, Ed. Hatier, Paris, 1925, p.108.
* 5 KALAMBAI LUPUNGU, Cours de
Droit Civil, les biens, 2ème Graduat, UNIKIN,
2008 - 2009
* 6 Dans la mesure où
tant peu soit - il, toute personne physique dès sa naissance à sa
mort a un patrimoine.
* 7 Transit ou Cabotage
* 8 BUNDU PHEMBA V :
Législation Douanière, 2ème Douane,
Cours inédit, ENF, 2005-2006
* 9 GUYOMAR, A., Economie et
Gestion, Ed. Sirey, Paris, 1995, p.124
* 10 SMITH A, Recherches
sur la nature et les causes de la richesse des nations,
2ème éd.Hatier, Paris,
1776, p.27
* 11 HOCHSCHILD A, cité
par KALUBI M'KOLA, les relations extérieures de la
RDC , éd. Betras,
Kin 2009, p.20
* 12 Ville, centre industriel
et 3è port Européen en Belgique
* 13 GUYOMAR, A., Op.
Cit ; p. 26
* 14 M. EBANEA,
L'Organisation Mondiale des Douanes en quelques mots, WWW.
Google.Com 2007.
* 15 Président de la
République (du 24 novembre 1965 au 16 mai 1997)
* 16 Celles de l'OFIDA et
celles des autres services tels que DGI, OGEFREM, OCC, etc.
* 17 BORDIN M, la survie
économique et sociale des pays en voie de développement,
Collection Hatier,
Paris, 1973, p. 137.
* 18 Données recueillies
auprès de Dieudonné KOYANGU, à la D.P./Mbandaka, juillet
2008.
* 19 Note de service
N°DG/CAB/PDG/98/044 portant structure et attributions de la Brigade
Douanière.
* 20 De Augustin BOZOBI
EKABOKO, interviewé à la DP/MBANDAKA, en Mars 2009.
* 21 NSESE BOFETE G, Conception
et réalisation d'une base des données pour le dédouanement
des marchandises,
TFE, ISC/Gombe, 2006-2007,
p. 17
* 22 Cf. Instruction N°
DG/DV/ADG/011/03 relative à l'évaluation en douane des
marchandises importées.
* 23 MOKUTU BANGO, A ;
Apports budgétaires des régies financières, TFE, ISC,
2007-2008, p.15
.
* 24 Gouvernement, MLC/J.P
BEMBA et RCD/ Azarias RUBERWA
* 25 Immeuble acheté par
l'OFIDA sous le D.P. Bontengo auprès de Mr PADOUA, sujet portugais.
* 26 Propos rapportés
par MONGASSY MUNGONGO, à Mbandaka, 2008 - 2009.
* 27 Eugène MAIBENYE,
interviewé à Kinshasa, novembre 2008.
* 28 Propos recueillis
auprès de Dieudonné KOYATONGU, à la DP/Mbandaka, juillet
2008.
* 29 Propos recueillis
auprès de PENZE EYENGA, à Zongo, février 2009..
* 30 LUFETA, interviewé
à la DP/Mbandaka, août 2008.
* 31 Propos recueillis
auprès de J.P BOMBENGA IFALA à la DP/Mbandaka, juillet 2008.
* 32 JP NGBANGBO,
interviewé à Libenge, février 2009.
* 33 IMBUSA, Gestion des
ressources humaines, cours inédit, L2HGP/ISP/MBKA, 2008-2009
* 34 MOKANDA - EKA ;
L'organisation mondiale des douanes en quelques mots, ULB, 2007.
* 35 TSHISUNGU L. ;
Histoire des institutions administratives du Congo, L1 HGP,
ISP/MBKA, 2007 - 2008
* 36 Charles MONTESQUIEU,
écrivain et parlementaire français (1689 - 1755).
* 37 ADG de l'OFIDA de 2005
à 2009.
* 38 Période historique
de 1+4, c'est - à - dire un Président assisté de quatre
Vice-Présidents (Joseph KABILA,
JP BEMBA, Arthur ZAIDI NGOMA, YERODIA NDAMBA et Azarias RUBERWA
qui ont conduit la RDC de 2003 à
2006.
* 39 Contrôleur, Chef de
bureau à l'Inspection du Patrimoine/DSG/DG.
| 


