|
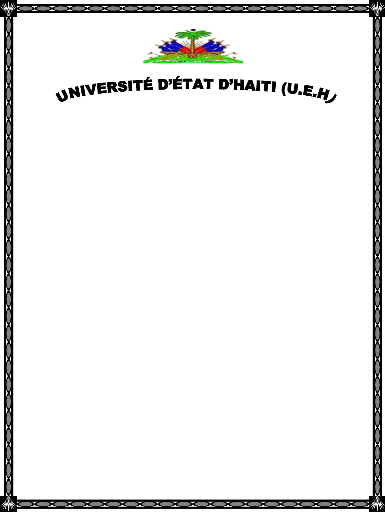
FACULTÉ D'ETHNOLOGIE(FE)
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU
DÉVELOPPEMENT(DSD)
Sujet de recherche : Conditions socio-économiques des
paysans de Lociane, une Section de la Commune de Thomassique.
Mémoire présenté par Frantz ISIDOR
Promotion 2020-2022
Pour l'obtention du grade de Maître en Sciences du
Développement
Sous la direction du professeur Jean-Maxius BERNARD, Ph. D.
Février 2024

Université d'État
d'Haïti
Faculté d'Ethnologie
Département des Sciences du
Développement
Ce mémoire de maîtrise intitulé :
Conditions socio-économiques des paysans de Lociane, une
Section de la Commune de
Thomassique
Préparé par :
Frantz ISIDOR
A été évalué par un jury
composé des professeurs suivants :
M. Lamarre CADET, Ph. D.
Président
M. Jean-Maxius BERNARD, Ph. D.
Directeur de Recherche
M. Adma DESSEIN, Ph. D.
Lecteur critique
II
Table des Matières
Antécédents vi
Résumé 1
Introduction générale 2
1.-Justification de l'étude 5
2.-Problématique 7
3.-Principaux objectifs de l'étude 11
4.-Structuration de l'étude 13
Chapitre I. Cadre conceptuel et méthodologie de
la recherche 14
1.1.-Cadre théorique et conceptuel 14
1.2.-Revue de littérature 16
1.3.-Méthodologie de recherche 22
1.3.1.-Collecte de données 25
1.3.2.-Méthode utilisée pour la collecte de
données 26
1.3.3.-Méthode d'analyse et d'interprétation des
données 27
1.4.-Contextualisation de l'observation ethnographique 27
1.4.1.-Rapport descriptif du paysage observé 29
1.4.2.-Grille d'observation 38
1.5.-Contrainte sur le terrain de recherche 41
Chapitre II. Lociane et conditions
socio-économiques des paysans 42
2.1.-Géo-localisation de la frontière
Haïti-République Dominicaine 42
2.2.-Thomassique et la 2e Section Lociane 44
2.2.1.-Délimitation 46
2.2.2.-Localisation de la Commune de Thomassique 46
2.2.3.-Localisation directe de la Section communale de Lociane
47
2.2.4.-Histoire de Thomassique et la 2e Section
Lociane 47
2.3.-Voies de pénétration dans la 2e
Section Lociane 50
2.3.1.- Comparaison entre des localités de la
2e Section Lociane 53
2.4.-Facteurs de développement des conditions
socio-économiques des paysans de Lociane 53
2.4.1.-Intégration des forces actives dans
l'économie productive 54
2.4.2.-Appropriation de l'espace territorial en
développement 58
2.4.3.-Cheminement socio-historique de l'acteur local et sa
place fonctionnelle 60
III
2.4.4.-Caractéristique particulière dans
l'éclosion de la couche paysanne haïtienne 62
2.4.5.-Activités économiques des paysans de
Lociane 64
2.4.6.-Tenure de la terre 66
2.4.7.-Engloutissement de l'économie du pays 68
2.4.8.- Conséquence de la réalité des
secteurs économiques disjonctés 69
Chapitre III. Gestion de la frontière
Haïti-République Dominicaine 71
3.1.-Différentes théories sur la
thématique de la frontière 72
3.1.1.-Approche traditionnelle de la notion de
frontière 72
3.1.2.-Considération sur l'approche moderne du
phénomène de frontière 73
3.1.3.-Préférence accordée à
l'utilisation des approches post-modernes de la frontière 74
3.2.-Question de la délimitation de la ligne
frontalière Haïti-République Dominicaine 81
3.2.1.-Rapports Haïtiens et Dominicains 82
3.3.-Contexte socio-historique de la frontière
Haïti-République Dominicaine. 84
3.3.1.- À partir de l'action de Toussaint Louverture
86
3.3.2.- À l'ère de l'indépendance
d'Haïti 87
3.3.3.-Situation qui découle de l'indépendance
de la République Dominicaine 89
3.4.-Négociation sur la ligne frontalière
Haïti-République Dominicaine 90
3.5.-Considération sur l'évolution
hégémonique de la Dominicainie par rapport à Haïti
93
3.6.-Systématisation de la discrimination raciale
à l'égard de l'Haïtien 95
3.7.-Regard sur les Puissances internationales dans les
relations entre Haïti et la République Dominicaine
97
3.7.1.-Insouciance des autorités haïtiennes
vis-à-vis de la frontière 100
Chapitre IV. Décentralisation et organisation
des collectivités territoriales 102
4. 1.-Rappel historique du fondement de la
décentralisation en Haïti 104
4.1.1.-Fondement légal de la décentralisation en
Haïti 104
4.1.2.-Approche théorique de la décentralisation
106
4.1.3.-Théorie juridique de la décentralisation
107
4.2.-Responsabilité des ordonnateurs dans la gestion de
la finance dans le cadre de la décentralisation 108
4.2.1.-Prégnance de la corruption : l'érection
des institutions efficaces de contrôle 108
4.3.-Organisation de l'administration centrale de
l'État 109
4.3.1.-Finance dans le processus de la décentralisation
110
4.4.- Rôle de l'État dans la mise en place de la
décentralisation : dotation des collectivités territoriales
des
moyens de concevoir de véritables politiques publiques
112
iv
4.4.1.-Définition du concept de la collectivité
territoriale 113
4.4.2.-Définition fondamentale dans la conception de
l'État 114
4.4.3.-Définition des choix stratégiques de
développement économique en matière de politiques
publiques 117
4.4.4.-Politique publique : de la naissance à
l'acception moderne 118
4.5.-Condition nécessaire à
l'implémentation de la décentralisation 119
4.5.1.-Distinction entre intérêt
général et affaires locales 121
4.5.2.-Question de l'autonomie de gestion des
collectivités territoriales 121
4.5.3.- Organisation de la Section communale Lociane sur le
plan politique 122
Chapitre V. Résultat de l'étude
123
5.1.-Rapport de proximité des autorités de la
collectivité territoriale avec la population 124
5.2.-Certains aspects anthropologiques du politique 127
5.3.- Responsabilité manifestée par le paysan
dans la sphère du développement local 128
5.4.- Organisation sociale à Lociane 130
5.5.-Représentation du commerce des produits agricoles
dans la frontière de la 2e Section Lociane par
rapport à la dynamique interne 133
5.6.-Impact de l'importation des produits agricoles sur la
production du paysan haïtien 135
5.7.-Accès aux services vitaux 137
5.7.1.-Eau 137
5.7.2.-Soin de santé 138
5.7.3.-Éducation 139
5.7.4-Encadrement agricole 140
5.8.-Perception de l'État haïtien dans son abandon
du monde paysan dans l'opinion des paysans. 142
5.8.1.-Ressources humaines 145
Conclusion 148
Perspectives propositionnelles 154
Limites de l'étude 155
Références bibliographiques
157
Annexe 169
V
Liste des abréviations, sigles et
acronymes
AFPEC Académie de Formation et de Perfectionnement des
Cadres
AF Année Fondamentale
ASEC Assemblée de la Section Communale
CASEC Conseil d'Administration de la Section Communale
CEA Conseil d'État du Sucre (c'est un sigle d'un organe
dominicain)
CFPB Contribution Foncière des Propriétés
Bâties
CFGDCT Contribution au Fonds de Gestion et de
Développement des Collectivités Territoriales
CSCCA Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif
CTE Hinche Centre Technique d'Exploitation de Hinche
CT Collectivité Territoriale
DINEPA Direction Nationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement
GVCM Global Vision Citadelle Ministries
IDH Indice de Développement Humain
IGF Inspection Générale des Finances
IHSI Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique
Km, Km2 et mm Kilomètre, Kilomètre
carré et millimètre
MAE Ministère des Affaires Étrangères et
des cultes
MARNDR Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
MDE Ministère De l'Environnement
MICT Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Territoriales
MEF Ministère de l'Économie et des Finances
MENFP Ministère de l'Éducation Nationale et de
la Formation Professionnelle
MPCE Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe
MPP Mouvement Paysan Papaye
MSPP Ministère de la Santé Publique et de la
Population
NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication
ODD Objectifs de Développement Durable
ODPSL Organisation pour le Développement des Paysans de
la 2e Section Lociane
OJUDT Organisation des Jeunes pour l'Unité et le
Développement de Thomassique
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OREPA Centre Office Régional d'Eau Potable et
d'Assainissement du Centre
PIB Produit Intérieur Brut
PLD Partido de la Liberacion Dominicana
PNUD Programme des Nations Unies pour le
Développement
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
TI Transparency International
SMCRS Service Métropolitain de Collecte des
Résidus Solides
SNGRS Service National de Gestion des Résidus
Solides
UCREF Unité Centrale de Renseignement Financier
ULCC Unité de Lutte Contre la Corruption
USAID United States Agency for International Development
vi
Antécédents
La présente étude est dédiée
à :
1) La mémoire de Franck ISIDOR, mon père,
François ISIDOR, mon grand-père, Maurice BRUN, mon
grand-père maternel et Lucita DUBUISSON (man François),
ma grand-mère paternelle, en souvenir des valeurs sacrées de
courage au travail inculquées en moi.
2) Clermana JOSEPH (man Maurice), ma
grand-mère maternelle, qui vit encore1 plus d'un
siècle, combattante de toujours.
3) Ma mère Irlande BRUN, une bâtisseuse
d'avenir. Elle ne cesse jamais de serrer ses reins aux mille cordes de passion,
d'amour, de tendresse pour alimenter mon coeur d'énergie
nécessaire à surmonter les épreuves de la vie. D'autant
qu'elle m'a doté d'une éducation digne qui a fait de moi ce que
je suis aujourd'hui.
4) Mon épouse Gina CASIMIR, la manifestation de son
indéfectible soutien m'a souvent été d'une double
force.
5) Mes filles jumelles Gihandris Hassia, Nahandris Irlandie
et mon garçon Rybklussen Yka-Ludrantz.
6) Mon frère Wensky ISIDOR et ma soeur Guerdeline
ISIDOR qui m'ont toujours gratifié de tout accompagnement
nécessaire et suffisant pour pouvoir valoriser mes aptitudes aux
études universitaires et le côté intellectuel de la
famille.
7) Mon Oncle Hubert ISIDOR, agronome, dont l'assistance dans
l'adversité est un arbre donnant des fruits précieux pour
l'avenir.
8) Natacha JEAN, une amie distinguée parmi mes
condisciples de la promotion 2000-04 de l'École Supérieure
d'Infotronique d'Haïti.
9) La mémoire de Maître Rosalès TRISTANT,
pour la consécration de sa vie à l'enseignement, en particulier,
celui du Droit aux élèves-avocats de l'École du Barreau de
Petit-Goâve.
1 Par grâce, elle vit sa deuxième année
après le siècle au moment de la réalisation de ce travail
de mémoire. Longue vie à elle !
VII
Remerciements
Tout projet d'étude confronte une réalité
de sacrifice et de passion. Ce qui caractérise la force de sa
réalisation. Sans doute, notre travail ne saurait être
réalisé sans l'aide et le soutien de mes proches de
manière générale.
Je tiens à leur adresser mes plus sincères
remerciements, et à tous ceux qui ont apporté leur soutien
à son élaboration, en particulier :
Au Professeur Jean-Maxius BERNARD Ph. D., pour ses
suggestions, conseils et critiques en tant que responsable du
Département des Sciences du Développement et comme professeur
accompagnateur. Des remarques ont été précieuses et
indispensables pour orienter la recherche et aboutir aux résultats
trouvés.
Au Doyen ad intérim de la Faculté d'Ethnologie,
Professeur Claude Mane DAS ; tous les professeurs ayant participé et
contribué à ma formation, pour m'avoir inculqué les
valeurs et compétences pour pouvoir contribuer aux réflexions sur
la problématique du développement en Haïti.
Comment ne pas adresser, de manière spéciale,
des remerciements aux professeurs de méthodologies Ilionor LOUIS, Ph. D.
et Jean Mary LOUIS S.J. / Ph. D. ;
À l'ensemble de mes camarades du DSD de la promotion
(2020-2022) et autres amis pour leurs conseils avisés ;
À toute la communauté thomassiquoise et
particulièrement les habitants de la 2e Section Lociane qui
ont collaboré à la réalisation de cette étude et
à tous ceux que j'ai omis involontairement, ils sont tous dans mon
coeur, je leur adresse mes plus profonds remerciements.
VIII
Avant-propos
Il serait fastidieux et même impossible
d'énumérer toutes les difficultés de la vie en Haïti.
Parler des déplacements forcés et les violences physiques,
psychologiques auxquels la population s'expose sous le simple fait qu'elle vit
dans tel ou tel autre endroit qui puisse tomber sous la domination totale des
bandes criminelles lourdement armées s'avère franchement
écoeurant.
Les gangs armés extorquent, vandalisent, tuent,
lynchent, incendient, pillent, volent, violent, kidnappent et
rançonnent... sous les yeux passifs et impuissants de l'État
central et des administrations locales. À travers la plupart des
Départements du pays, toute la population haïtienne vit des moments
d'effroi devant la terreur des criminels notoires opérant en toute
impunité. Qui ne les a pas qualifiés de terroristes dont les
actes ignobles n'émeuvent en rien des structures répressives du
Gouvernement se faisant ainsi leur complice. En droit, il est admis le principe
de responsabilité criminelle par omission. De par ce principe, n'y
a-t-il pas lieu de questionner l'indifférence des gouvernants de
l'État central et des agents des collectivités territoriales ?
C'est le signe d'une inertie coupable dans cette prolifération des gangs
armés qui commettent de manière plus directe et inimaginable des
actes terroristes2 caractérisant une haine
invétérée contre la société
haïtienne.
De mon état de déplacé forcé et
involontaire de mon lieu d'habitation à Pernier 17-A, où je
m'étais installé depuis 2005, il m'est nullement besoin
d'exprimer les chances que j'ai eues de pouvoir réaliser ce travail
malgré le choc psychologique confronté en m'accommodant à
de nouvelles résidences, parfois même à encourir des nuits,
ô combien instructrices dans les locaux de la Faculté de Droit et
des Sciences Économiques de Port-au-Prince.
2 Selon la Convention internationale du 9
décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme ,
dans son article 2.1 (b), un acte terroriste se définit comme «
tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou
toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités
dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou par son
contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».
1
Résumé
L'histoire d'Haïti3 - Kiskeya ou Bohio est
marquée par des évènements qui déterminent la
frontière entre les deux Républiques partageant l'île du
même nom. Des moments conflictuels à la dialectique diplomatique,
un nouvel ordre s'impose. Par exemple, l'intervention du Président Fabre
Nicolas Geffrard, survenue en juillet 1861 dans l'affaire Rubalcava, constitua
des actions fortement imprégnées des objectifs formels pour
restaurer l'indépendance de la République Dominicaine et
renforcer celle de la République d'Haïti. La
nécessité pressante de créer et de maintenir des relations
de coopération entre ces deux Républiques exige des efforts de
relever le niveau de gestion et d'autonomie dans la décentralisation des
collectivités territoriales en général, et surtout celles
se trouvant sur la frontière. Des deux côtés, il importe de
mettre en place des structures susceptibles d'assurer la production nationale.
Ce, pour équilibrer des échanges commerciaux, culturels et
même diplomatiques. Eu égard au constat fait, la République
Dominicaine a pris le devant dans la course au développement : son
économie est sortie bénéficiaire de ces échanges.
Qu'est-ce qui justifie cette avance ? La décentralisation ne peut-elle
pas contribuer à la dynamisation des régions frontalières
?
Le transfert de compétences dans le processus de la
décentralisation interpelle les décideurs de l'État. Il
leur incombe de définir de nouvelles politiques publiques visant
l'amélioration des conditions socio-économiques des masses
paysannes. Le cas de la deuxième Section Lociane, regroupant des
localités rurales de la Commune de Thomassique, est
révélateur. Dans cette Section communale, comme dans toutes les
autres, la gestion de l'espace territorial se fait grandement sentir quant aux
besoins exprimés par la population locale, surtout dans le cadre de sa
participation dans le développement local.
La présente étude titrée : conditions
socio-économiques des paysans de Lociane, une Section de la Commune de
Thomassique participe aux réflexions sur la nécessité
de permettre aux paysans haïtiens d'avoir plus de possibilité
financière et gestionnaire pour prendre en main leur destin.
Mots-clés : Frontière,
État, condition socio-économique, décentralisation,
participation, masses paysannes, développement local, politique
publique, collectivité territoriale.
3 La dénomination Haïti-Kyskeya ou Bohio
désigne l'île d'Haïti. Des historiens en désignent le
nom que les premiers habitants naturels donnèrent à cet espace
insulaire caractérisé par ses hautes montagnes.
2
| 


