|

1
Année scolaire : 2024-2025
Université de Paris
Master 2 : Didactique de l'Histoire et de la
Géographie
Mémoire de recherche Master 2
UNE APPROCHE DU TERRITOIRE DANS
L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE IVOIRIEN : LE
CONCEPT D'IDENTITÉ
Présenté par TRAORÉ DRISSA
Sous la direction de M. GUILHEM LABINAL
Maître de Conférences en géographie, CY
Paris Cergy Université
DÉDICACE
2
AÌ toi Ramatou, pour ta
présence, ton soutien et ta patience.
3
REMERCIEMENTS
Avant d'aborder cette étude, je tiens à
remercier tous ceux qui ont contribué à son élaboration.
J'exprime tout d'abord mon infinie gratitude au Professeur Guilhem Labinal qui
a accepté l'encadrement de ce travail. Veuillez bien trouver ici
Professeur, l'expression de ma profonde gratitude.
Je tiens à remercier aussi le Professeur Pascal Clerc,
c'est par son biais que j'ai pu rentrer en contact avec mon encadrant.
Mes remerciements vont aussi à l'endroit du Professeure
Caroline Leininger-Frézal pour sa disponibilité durant mes
débuts lors de ma formation de master.
Je remercie vivement tous mes enseignant.e.s pour la
qualité de la formation reçue lors de ce master en didactique
À tous mes élèves du Collège
Moderne Péhé, je tiens à dire merci pour leur
disponibilité lors de mes enquêtes.
4
INTRODUCTION
Tout étudiant de Master de recherche démontre
ses capacités intellectuelles et scientifiques en réalisant un
mémoire, c'est une étape très cruciale dans la
carrière de l'étudiant. Ainsi, il doit travailler sur un
thème intéressant et par les résultats de sa recherche, il
apporte sa modeste contribution à l'évolution scientifique.
Par ailleurs, j'ai connu le Master 2 didactique de l'histoire
et de la géographie par le biais de ma femme qui elle-même l'a
connu par l'intermédiaire de son collègue, qui est professeur
d'histoire-géographie au Lycée Moderne Port Bouët à
Abidjan. J'ai immédiatement demandé le nom de l'université
en charge de la formation, pour candidater à cette formation innovante
dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je suis professeur de
Collège. J'enseigne au Collège Moderne Péhé dans le
département de Toulépleu, dans la région du Cavally
(Guiglo) depuis le 06 janvier 2020. Dans l'optique d'améliorer mes
pratiques de classe en histoire-géographie et d'engager une recherche
qui aboutira sur la thèse, même si pour le moment, je suis qu'au
niveau du mémoire, que j'ai décidé de faire un master en
didactique d'histoire et de géographie. Ma spécialité en
perspective est la didactique de la géographie ce qui sous-entend que ce
travail de mémoire fait référence à la
géographie scolaire. À cet effet, mon étude est
axée sur l'analyse des manuels scolaires. Ce contenu des manuels
scolaires porte sur la notion du territoire plus particulièrement le
concept d'identité. En Côte d'Ivoire depuis la mort de
Félix Houphouët Boigny, toutes les crises vont prendre une tournure
identitaire. C'est en cela que Richard Banégas (2010, p. 222) affirme
que :
« On mesure encore la puissance mobilisatrice du registre
identitaire dans la crise ivoirienne où, face à la
rébellion des Forces nouvelles réclamant des papiers
d'identité pour les populations nordistes discriminées, on a vu
se développer dans le Sud un mouvement social d'ampleur inédite,
celui des Jeunes patriotes maniant indistinctement le registre anticolonialiste
de la libération nationale et celui ethnonationaliste de l'autochtonie
et de l'ivoirité. »
De sa version originelle, « Le concept d'ivoirité
apparaît pour la première fois en 1945 à Dakar, avec des
étudiants ivoiriens » (Vidjannangni, 2011, p. 42). Il faut attendre
jusqu'en 1974 pour voir son apparition dans la société avec
Niangoran-Porquet (Thiémélé, 2009 ; Vidjannangni, 2011).
La Côte d'Ivoire doit participer à la construction culturelle de
l'Afrique. Ainsi, selon son premier géniteur : « l'ivoirité
est ce que les Ivoiriens devaient apporter comme valeurs spécifiques
à la construction de l'unité africaine »
(Thiémélé, 2009, p. 75). L'ivoirité était
l'identité culturelle des Ivoiriens. Dans la revue Ethics, Jean-Marie
Adiaffi définit l'ivoirité
5
comme étant « l'ensemble des valeurs spirituelles,
esthétiques, ethniques, matérielles, intellectuelles
constituées par tous les peuples de Côte d'Ivoire. Elle transcende
métaphysiquement toutes les ethnies » (Adiaffi, 1997, p. 75
cité par Kipré, 2002, p. 93) rapporté par (Bayle &
Domergue-Cloarec, 2007, p. 40 ; Vidjannangni, 2011, p. 44). Ainsi,
l'ivoirité dans sa version originelle a une approche culturelle qui
s'enracine à l'origine. L'ivoirité avait pour but de donner une
identité nationale à la Côte d'Ivoire, qui allait regrouper
toutes les ethnies des quatre grandes aires culturelles. Voilà pourquoi
Pierre Kipré (2002, p. 93) affirme que :
« Le concept caractérise un processus
d'identité nationale qui est de nature géographique, culturelle
et civique ; un processus dynamique parce que fondée sur le dialogue
permanent des cultures en Côte d'Ivoire et sur leur enrichissement
réciproque ... un processus qui tire sa dynamique d'une part des
traditions d'hospitalité des peuples qui composent aujourd'hui ce pays
et, d'autre part de leur volonté de développement. Il doit
pouvoir déboucher sur un type spécifique de culture africaine et
sur des rapports au monde qui tournerait le dos à toutes les formes
d'exclusions » cité par (Vidjannangni, 2011, p. 44).
La dimension politique de l'ivoirité va faire naitre
des luttes sociales et politiques qui se sont manifestées par des luttes
pour ou contre une identité. Ces luttes se sont traduites par la remise
en cause d'une identité. Ainsi, en Côte d'Ivoire à chaque
élection présidentielle, la lutte du rapport au pouvoir et de
l'identité fait des milliers de morts. Cette dimension politique de
l'identité est une situation préoccupante en Côte
d'Ivoire.
Par ailleurs, pour Jean-François Thémines
(2020b) l'importance accordée au territoire est due aux finalités
actuelles de la géographie scolaire. Car elle vise à la
responsabilisation et à la compréhension de la structuration des
espaces du local au mondial (Thémines, 2020b). « La
géographie scolaire sélectionne et organise en effet ses contenus
et ses démarches d'abord en fonction de finalités de formation
civique, intellectuelle et sociale, assignées par la
société à l'École [...] La promotion du territoire
dans la géographie scolaire est au service de la formation civique et
intellectuelle des élèves [...] Penser le monde en territoires,
c'est confronter les élèves, par l'étude de l'espace
terrestre, à la pluralité des valeurs, la diversité des
représentations, la plasticité des cultures et des
identités » (Thémines, 2020, p.13). Enseigner les
territoires, c'est alors faire découvrir et comparer des espaces
d'échelles différentes. C'est comprendre les enjeux spatiaux, les
conflits fonciers et les acteurs d'aménagements (Thémines,
2020a). Ainsi que Maryvonne Dussaux (2017, p. 241) qui affirme que : «
chacun a sa propre représentation du territoire en fonction de la place
qu'il y occupe, de sa propre vision de l'avenir [...] L'absence de dialogue
territorial cultive les inégalités, les divisions et
l'intolérance ». De ce fait, « la géographie scolaire a
pour fonction, quant à elle, de construire des identifications
6
d'individus à différentes collectivités
[...] La particularité des enjeux du lien territoire-identité en
géographie scolaire provient de ce que la diversité des ancrages
et des références identitaires est constitutive du rapport des
élèves avec les espaces à enseigner »
(Thémines, 2020b, p. 33). On conçoit aisément le
rôle important de l'école dans la cohésion territoriale
(Ayed, 2018). L'éducation des élèves aux territoires
pourrait permettre à l'avenir de réduire les
inégalités spatiales et de lutter contre les divisions sociales
pour aboutir à une identité territoriale collective. Alors, dans
la géographie scolaire, le concept d'identité doit être
suffisamment et correctement pris en compte.
7
PARTIE 1 : GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES,
IDENTITÉ ET ÉDUCATION EN CÔTE D'IVOIRE
I. DE LA GÉOGRAPHIE RÉGIONALE CLASSIQUE
À LA GÉOGRAPHIE
DES TERRITOIRES
1. De la région au territoire
L'utilisation du terme territoire dans le vocabulaire
géographique est récente. Selon certains auteurs comme (Di
méo,1998, Chivalon,1999) cités par (Ripoll & Veschambre,
2015), l'apparition importante du terme en géographie peut toutefois
être attribuée à Claude Raffestin avec la parution de
« pour une géographie du pouvoir » en 1980. Cependant pour
Bernard Elissalde (2002) : « c'est plutôt du côté du
groupe Dupont, avec l'édition 1982 de Géopoint « Les
territoires de la vie quotidienne » qu'il faut rechercher l'entrée
officielle du territoire en géographie. Parmi ces pionniers du
territoire, il faut également mettre en avant Joël Bonnemaison qui
dès 1981 a publié « Voyage autour du territoire dans
l'Espace géographique » (Ripoll & Veschambre, 2015). De ce
fait, la décennie 1980 est caractérisée par des usages
pionniers du territoire dans les différents travaux. Cependant, à
cette période sur la totalité des travaux en géographie
l'« espace » et la « région » l'emportent nettement
sur le « territoire » comme l'affirme les auteurs :
« Dans le catalogue de l'UFR de géographie de
l'Université de Caen, les trois premiers ouvrages dont le titre comporte
territoire (en dehors de l'expression aménagement du territoire) sont
parus en 1980, 1981 et 1982, mais pour un total de 10 ouvrages seulement
classés en géographie sur l'ensemble de la décennie. De
même, dans les intitulés de DEA, espace l'emporte encore
très largement sur territoire en 1989 » (Ripoll & Veschambre,
2015).
Seuls les intitulés de colloque, logiquement le premier
canal de diffusion large des modes et paradigmes, enregistrent plus nettement
ce succès naissant et le favorisent : alors que le territoire est
totalement absent des intitulés de la période 1980-1981, 10 ans
plus tard, il est aussi prisé que l'espace et devance déjà
la région, comme indiqué dans le tableau suivant :
8
Années
|
1980/1981
|
1989/1990
|
2000/2001
|
|
Région et dérivés
|
2
|
6
|
0
|
|
Espace et dérivés
|
4
|
10
|
14
|
|
Territoire et dérivés
|
0
|
9
|
23
|
|
Nombre de colloques répertoriés
|
49
|
163
|
123
|
Tableau 1 : Les notions de régions, espaces et
territoires dans les intitulés de colloque ( Bulletin d'intergéo
cité par Ripoll & Veschambre, 2015, p. 271? 291)
Dans le tableau au début de la décennie 1980, la
notion de région et dérivés est en régression 2
contre 4 pour espace et dérivés et 0 pour territoire et
dérivés. C'est au début de la décennie 1990, qu'on
aura l'usage du territoire et dérivés dans les colloques. Il faut
attendre la décennie 2000 pour voir l'ancrage de la notion de territoire
et dérivés dans les colloques et l'usage confirmé de la
notion de l'espace et la disparition de la notion de région et ses
dérivés dans les colloques. L'usage de la notion du territoire ne
se fera pas sans conséquence.
Ainsi, en 2001 lors des concours, les épreuves de la
géographie régionale seront remplacées par la
géographie des Territoires comme cela a été indiqué
par (Ripoll & Veschambre, 2015).
En géographie, le territoire est tout espace
approprié. De ce fait, tout est territoire. Selon, l'usage premier du
mot territoire à l'époque moderne, Maryvonne Le Berre donne trois
éléments qui peuvent définir un territoire. La
domination (le pouvoir) qui s'exerce sur une aire
géographique qui a des limites. Dans ce cas, une portion
de l'espace devient un territoire (Le Berre, 1995, p. 603). Cette
définition du territoire peut être recevable dans une certaine
approche du territoire. Dans leur dictionnaire, Jacques Lévy et Michel
Lussault (2003) donnent d'abord, huit premiers sens au mot territoire. Ensuite,
ils font des critiques de chacune d'elle. De ce fait, une définition
unique du territoire se placerait probablement en porte-à-faux par
rapport aux autres définitions. Néanmoins, les auteurs vont
proposer une neuvième définition. À partir de quatre
approches se sont le « territoire » comme la forme matérielle
et symbolique, le « territoire » comme forme d'appropriation et le
« territoire » comme configuration spatiale puis le « territoire
» comme l'auto-référence. Pour les auteurs, le territoire
est un espace approprié qui permet la construction identitaire et existe
à des scalaires différentes. Quant à (Brédif,
2021), il développe aussi quatre approches du territoire. Selon lui, le
territoire est d'abord les limites du territoire de répartition des
éléments biophysiques (plantes ou les animaux) ; c'est aussi
l'espace juridico-politique de (l'État-nation), où l'État
exerce son autorité politique ; ensuite c'est un lieu d'appropriation et
de la construction identitaire individuelle ou collective et enfin c'est aussi
un ensemble de lieux interconnectés dans le système de la
mondialisation économique. Par ailleurs, l'entrée du
9
territoire par « l'espace » est un territoire
cartographiable (Pesqueux, 2009) c'est le territoire administratif. Le
territoire fait objet de découpage administratif. La souveraineté
et l'autorité d'un État s'exerce sur ce territoire. De là,
il a des frontières plus ou moins formelles. Il est
désigné comme un espace délimité où vivent
les gens sous une autorité politique. Ainsi, l'État se
légitime d'une part, de l'intérieur en soumettant sa population
sous son autorité et d'autre part, de l'extérieur en se faisant
reconnaitre par les autres États. Nous avons l'approche du territoire
comme un système. Ainsi, les auteurs comme Elsa Filâtre, (2021) et
Alexandre Moine (2006) considèrent le territoire comme un système
complexe. Ce système est évolutif et composé d'acteurs,
d'espace géographique et de systèmes de représentations.
La géographie est une science du territoire, différencié
de lieux reliées par un réseau (Brunet, 1995). La
différenciation des lieux suppose une production spatiale. Le territoire
est aménagé en des lieux différents pour des objectifs
différents et tous ceux-ci bien agencés et organisés pour
former des réseaux. Ce territoire s'appuie sur la théorie de
l'allemand Christaller. C'est le lieu de la réalisation des projets, des
rapports de force sur l'objet. La chose « territoire » devient un
enjeu et source de conflit.
Le territoire est fait d'espace culturel et de symbole
identitaire. Autrement dit, c'est un espace de représentation sociale.
Il se construit à partir d'un attachement et de sentiment d'appartenance
autour d'un paysage très souvent sacralisé. Le territoire
vécu est un territoire où vivent la population. La population est
enracinée à ce territoire qui est au coeur de son
identité. Chaque communauté se singularise par son
identité sur un territoire donné. Ainsi sur ce territoire,
l'identité résulte d'un sentiment d'appartenance de la
collectivité à des formes spatiales particulières. Ce
sentiment d'appartenance partagé par le collectif permet l'unité
sur ce territoire. Ainsi, le territoire est d'abord un lien avant d'être
une frontière. Le territoire est avant tout un lieu d'identification ou
d'appartenance ; l'appropriation se positionne au second plan (Bonnemaison et
al., 1995). Ces auteurs ont donné une définition plus ou moins
complète du territoire. Le territoire est un géo-système,
un espace approprié et constitué de différents lieux (Da
cunha, 2021, p. 14 cité par Hertig, 2012). C'est dans la même
logique mais avec une définition plus élaborée que Guy Di
Méo (1996, p. 40) affirme que : « Le territoire est une
appropriation à la fois économique, idéologique et
politique de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation
particulière d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur
particularité. » Dans cette approche de Guy Di Méo, nous
retrouvons les trois approches épistémologiques du territoire
dans le cadre éducatif comme développé par (Girault &
Barthes, 2016).
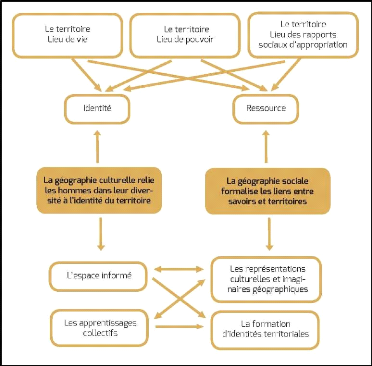
10
Figure 1 : Les différentes acceptations du territoire
(Girault & Barthes, 2016)
Ainsi, comme le présente la figure, le territoire est
soit un lieu de vie, soit un lieu de pouvoir ou encore un lieu des rapports
sociaux. Le territoire est un concept englobant en géographie. Dans
cette étude, je vais m'intéresser au territoire dans une approche
identitaire.
2. Territoire et identité : une dualité
géographique
L'identité est vue sous une dimension spatiale. Les
sociétés transforment leurs espaces de vie qui prennent des
formes idéologiques et culturelles. Dans cette relation entre le
territoire et identité, pour Benoît Raoulx (2022) l'espace est
« mise en mots ». L'espace est construit avec des marqueurs
symboliques qui dit tout sur la vie de cette société. Ainsi,
l'espace construit varie d'une société à une autre en
fonction de sa spatialité. Ces marqueurs symboliques constituent
l'identité de la société. Elle s'attache à ce
territoire à travers ces géosymboles. Selon France
Guérin-Pace (2006), l'homme s'attache à un ensemble de lieux.
C'est en cela que Reph affirme que : « Identity of place is much a
function of intersubjective intentions and experiences as of
11
the appearances of buildings and scenery, and it refers not
only to the distinctiveness of individual places but also to the sameness
between different places » (Relph, 1986, p. 44 cité par Stock,
2006, p. 3). Il y a autant de lieux que d'identités. C'est l'ensemble de
ces lieux qui constituent l'identité territoriale. En géographie,
l'identité se construit et se reconstruit à travers la mise en
place sur le territoire des géosymboles idéologiques d'une
communauté. Ainsi, l'identité territoriale d'une
société, c'est la manière dont elle construise son
identité sociale à travers le territoire. Le territoire est
produit par la société. De ce fait, l'identité d'un
territoire est un produit social. « Le territoire est donc la mise en
pensée et en pratique de l'identité des collectifs humains »
(Boyer-Araújo & Stoll, 2019, p. 4). Le territoire est porteur de
signes culturels et idéologiques, alors chargé de valeurs qui
permet la construction de l'identité individuelle et collective (Fourny,
2008). Le territoire permet de comprendre comment les différents acteurs
pensent, se racontent et pratiquent l'espace géographique. La
société incruste son identité dans le territoire. De ce
fait, l'identité influe sur la construction du territoire et vice versa.
Plusieurs groupes d'identités différentes peuvent habiter un
même territoire. Alors, la relation que chaque groupe va entretenir avec
ce territoire va être différente. Voilà pourquoi, le
sentiment d'appartenance est une question fondamentale dans la réflexion
sur les territoires, quand il est pris dans sa dimension identitaire Luc
Gwiazdzinski (1997) citée par Guérin-Pace (2006, p. 299). Le lien
entre le territoire et l'identité s'effectue sur le plan de
l'appartenance, c'est-à-dire dans une fonction symbolique à
travers des géosymboles.
3. Les quelques dérives de l'identité
territoriale en Côte d'Ivoire
L'identité territoriale peut faire naitre une sorte de
« chauvinisme exacerbé » chez les habitants d'un territoire
donné. De cette façon, on aura un repli de soi et une fermeture
sur l'extérieur. Une identité territoriale statique dans le temps
et dans l'espace est un élément négatif pour les
populations (Di Méo, 2008a). En Côte d'Ivoire, il suffit d'une
petite querelle au sujet de la forêt (la terre des ancêtres) entre
un autochtone et un allogène pour que l'allogène soit
traité « étranger local » ou d'« étranger
national » en fonction de l'ethnie de l'allogène. Si ce dernier est
de groupe d'ethnie « Dioula » les gens du Nord, il est
considéré comme un étranger dans une dimension nationale.
En revanche, qu'il est de groupe ethnique Mandé du Sud ou Akan, il est
traité d'étranger à une échelle locale. De ce fait,
l'identité territoriale conduit directement à un nationalisme
exacerbé, au tribalisme, à l'ethnisme, entraînant de facto,
l'exclusion (Ardrey R.,1966 cités par Bonnemaison et al., 1995, p. 34)
des autres ethnies. De plus, lorsque les géosymboles se rapportent
à une seule communauté. Les autres communautés n'ayant pas
les
12
mêmes valeurs sociales et culturelles se voient exclure
dans le pays. C'est le cas en Côte d'Ivoire, où les
chrétiens ont été privilégiés par les
différentes autorités dans les idéologies spatiales. Par
conséquent, en Côte d'Ivoire, un « vrai ivoirien » doit
être un chrétien.
Il faut ajouter aussi que l'identité territoriale sert
aussi d'instrument pour les politiques. Les politiques peuvent s'appuyer sur
les peuples ayant le même sentiment d'appartenance à un territoire
pour avoir plus de militants et d'étendre leur domination spatiale.
Très souvent, le politique est aussi attaché à ce
territoire. Le politique manipule des populations en s'appuyant sur la religion
ou l'ethnie. Par la territorialité, les politiques contrôlent et
influencent une aire géographique (Sack, 1986 & Guermond, 2006).
Par ailleurs, l'identité territoriale peut être
source de conflit, opposant deux communautés et freiner le
développement de projets territoriaux (Thouément & Charles,
2011). En Côte d'Ivoire, l'identité territoriale a plutôt
confronté les autorités villageoises d'ethnie «
ébrié » en plein agglomération abidjanaise au
gouvernement dans le cadre de la destruction d'une partie
d'Adjamé-village pour l'agrandissement de la voie.
4. Une géographie des territoires axée sur
l'aménagement du territoire en Côte d'Ivoire
Au lendemain de l'indépendance, l'État va
initier plusieurs programmes de développement économique
national. Ces programmes de développement passent par la mise en valeur
de tout le territoire, d'où l'aménagement du territoire. De ce
fait, l'État a lancé deux grands projets de développement
régional : au centre, l'Autorité pour l'aménagement de la
vallée du Bandama (AVB) en 1969 et au sud-ouest, l'Autorité pour
l'aménagement de la région du sud-ouest (ARSO) en 1969, à
côté de ces deux grands projets, nous avons aussi la «
fête tournante des indépendances1». Le
développement est ainsi fortement lié à l'espace. Car, la
dimension spatiale est prise en compte dans les conditions de
l'amélioration des populations. De ce fait, les géographes sont
associés aux grands projets d'aménagement territorial. Ainsi, le
paradigme du développement en géographie ivoirienne a un ancrage
dans l'aménagement du territoire. Comme l'affirme Irène Kassi
(2010, p. 80) : « La quasi-totalité des thèses et
mémoires soutenus à l'IGT2, depuis sa création,
s'y réfèrent. Les étudiants mis à contribution
participent à une
1 Une ville était choisie pour abriter la
célébration de la fête de l'indépendance. Ainsi,
celle-ci bénéficiait des projets d'aménagement d'envergure
pour l'occasion.
2 Institut de géographie tropicale
13
géographie des problèmes que pose le
développement et surtout son absence pour les populations locales et sur
la dynamique territoriale. Ils abordent des thématiques aussi diverses
que variées. » Les mémoires de maîtrise sont
mentionnés dans le tableau ci-dessous.
|
Domaines
|
Thématiques
|
Nombre de
mémoires
|
|
Géographie urbaine
|
Aménagement du territoire et la politique urbaine
|
112
|
|
Géomorphologie
|
La dynamique des sols, dégradation des
ressources physiques et
récessions
pluviométriques,
|
74
|
|
Océanographie
|
Activités portuaires, pêche et aquaculture, les
études maritimes, la politique maritime
|
40
|
|
Population et
développement
|
Infrastructures et équipements, la cartographie,
l'exode rural, les migrations, le genre
|
39
|
|
Aménagement rural
|
Economie rurale, économie agricole, économie
pastorale
|
46
|
|
Environnement
|
Gestion des ressources naturelles, environnement santé,
profil environnemental, les risques naturels
|
40
|
Tableau 2 : Les thématiques sur les mémoires de
maitrise à l'IGT (Kassi, 2010, p. 80)
L'aménagement du territoire est la thématique la
plus abordée. Car, l'aménagement du territoire est l'un des
thèmes les plus étudiés par les géographes
ivoiriens. Ainsi, par l'aménagement du territoire, ils vont
répondre aux problèmes de développement local. Par
ailleurs, pour Jean-Yves Piot (2007, p. 43) : « L'aménagement du
territoire n'est en rien une science, ni une technique, encore moins un art.
» Alors, l'aménagement n'est rien d'autre qu'un concept de la
géographie. Car, aménagement n'est jamais associé à
un autre concept que celui de territoire. L'aménagement du territoire
est une compétence attribut à l'État et aux
collectivités territoriales. Dans ce cadre, le territoire est un lieu de
pouvoir E...] (Girault & Barthes, 2016). En outre, dans la
géographie scolaire aussi l'aménagement du territoire occupe une
place importante dans l'enseignement du primaire jusqu'au lycée.
Sanaliou Kamagaté (2020) dans son article
intitulé « L'aménagement du territoire dans les programmes
de géographie du système scolaire ivoirien », l'auteur
montre l'enseignement dispensé aux élèves sur le concept
d'aménagement du territoire en Côte d'Ivoire.
14
Au primaire, dès la classe de CE1, les
élèves sont initiés à l'apprentissage de la
maitrise du concept d'aménagement du territoire à travers les
thèmes comme le milieu physique, l'organisation administrative et les
disparités spatiales.
Au secondaire, l'aménagement du territoire est
enseigné aux élèves dans plusieurs classes notamment en
5ème, 4ème et 1ère. Les
intitulés des différentes leçons sont consignés
dans le tableau ci-dessous.
|
Leçons
|
|
|
|
5ème
|
L'impôt et l'aménagement du territoire ivoirien
|
|
|
|
4ème
|
La déconcentration administrative en Côte
d'Ivoire
|
|
|
|
La décentralisation administrative en Côte
d'Ivoire
|
|
|
|
Les insuffisances de l'organisation administrative
développement de la Côte d'Ivoire
|
dans
|
le
|
|
1ère
|
L'organisation administrative de la Cote d'Ivoire
|
|
|
|
L'aménagement du territoire ivoirien
|
|
|
Tableau 3: Les leçons évoquant
l'aménagement du territoire au secondaire
En 5ème, les élèves apprennent
à percevoir l'importance de l'impôt dans l'aménagement du
territoire. Ils retiennent que la mise en valeur du territoire est
financée par l'impôt que paye la population.
En 4ème, les apprenants sont
enseignés sur les aspects techniques de l'aménagement du
territoire que sont la déconcentration administrative territoriale et la
décentralisation administrative territoriale. Ils sont amenés
à connaitre les acteurs de l'aménagement du territoire et leurs
compétences.
En 1ère, les enseignants approfondissent ce
que les élèves ont appris dans les classes antérieures.
Comme l'affirme Sanaliou Kamagaté (2020) : « Les connaissances
acquises en aménagement du territoire au premier cycle, notamment en
classe de 4ème sont approfondies » en première.
En Côte d'Ivoire, la géographie universitaire et la
géographie scolaire définissent le territoire soit comme un
territoire administratif ou soit comme un territoire approprié. Dans le
milieu universitaire, le territoire est aussi évoqué de
manière sous-adjacente à travers les études sur les
conflits fonciers sans toutefois mettre un accent particulier sur la notion de
l'identité. Les géographes sont restés muets face à
la question identitaire ou la crise identitaire en Côte d'Ivoire
(Guermond, 2006).
15
II. GÉOGRAPHIE ET IDENTITÉ : UNE
DIVERSITÉ D'APPROCHES
Pour Bernard Elissalde (2002, p. 197) : « une
géographie des territoires exigerait de descendre à une analyse
à la fois plus fine que les grands thèmes de la géographie
classique (ville, région, pays, ruraux, quartiers, vallées), mais
aussi plus flous (le territoire du loup), voire ubiquiste et idéelle (le
territoire du vide). » La géographie des territoires dans une
approche identitaire résulte de la géographie politique, de la
géographie culturelle et de la géographie sociale. Ainsi, le
schéma disciplinaire de mon étude se présente comme suit
:
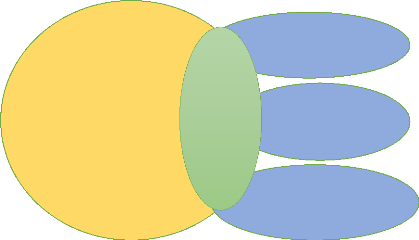
Géographie des Territoires
tude
Notre champ d' é
Géographie sociale
Géographie culturelle
Géographie politique
Figure 2 : Schématisation du champ disciplinaire de
notre étude
1. 16
La géographie sociale et
identité
La géographie sociale, c'est la géographie de
l'action et des acteurs (Séchet et Veschambre, 2006 cités par
Golly, 2017, p. 14). Aucune étude sur le territoire ne peut se faire
sans les acteurs. « L'objet de la géographie sociale est
l'étude des relations entre rapports sociaux et rapports spatiaux »
(Di Méo, 2008b, p. 1). Elle s'intéresse aux pratiques et aux
représentations sociales (Blanchard et al., 2021) et spatiales. En
effet, elle s'intéresse aux grandes questions sociales qui impliquent
l'espace géographie. Puisque, l'identité est une des questions
sociales évidemment liées au territoire. Les différents
outils de la géographie sociale permettent de cerner et d'identifier la
nature de l'identité. Les représentations spatiales se font
grâce aux médiateurs identitaires comme le lieu, le paysage, le
territoire (Di Méo, 2002a). Selon Guy Di méo (2017)
rapporté par André Joyal, (2017) abordé la question de
l'identité en géographie sociale c'est comme si, on avait
l'intention de dresser les uns contre les autres. Voilà pourquoi il a
intitulé son livre « le désarroi identitaire. Une
géographie sociale. »
2. La géographie culturelle
La géographie culturelle est la géographie qui
s'intéresse à la relation culturelle que l'homme entretient avec
le territoire. Ou encore avec la géographie culturelle, la culture est
au centre de la relation que l'homme entretient avec le territoire. Pour faire
court, on peut affirmer que c'est lorsqu'on voit la culture sous un aspect
territorial. Son objet d'étude est la culture. Alors, « l'approche
culturelle invite les géographes à se pencher sur le
problème des identités, des modalités de leur construction
et de leur signification » (Claval & Staszak, 2008, p. 6). La
géographie culturelle réunit les hommes dans leur
diversité à l'identité du territoire. Gottmann parle d'une
géographie « iconographie. » Pour lui : « L'iconographie
est un ensemble d'éléments d'ordre culturel qui font
l'unité d'un peuple » (Bonnemaison et al., 2000, p. 52). La
géographie culturelle étudie les images culturelles qui
s'incarnent dans des territoires qui sont des vecteurs d'identités.
Voilà pourquoi, elle s'intéresse à la question des
identités liées au territoire.
2.1. La notion de culture dans cette étude
Les questions identitaires sont liées à la
question de la culture. La culture se voit partout ainsi il y a de
l'identité pour tous (Cuche, 2016). La culture permet au
géographe de comprend le territoire, de le lire et de déceler ce
qui s'y « passe ». En effet, elle fournit aux hommes les
17
moyens d'organiser leur espace. C'est un canal qui permet de
marquer la différence entre les ethnies. « Le concept de culture en
tant qu'instrument de structuration des communautés, déterminant
autant les conditions d'appartenance au groupe que les différences entre
les groupes » (Bonnemaison et al., 2000, p. 54). La culture est à
la fois un lien et une borne. D'abord, elle rassemble tous ceux qui ont le
même sentiment d'appartenance et elle fait preuve de borne, lorsqu'elle
est utilisée pour marquer la différence entre deux groupes de
sentiment d'appartenance différent. Ensuite, dans une vision pas
toujours saine, elle peut être utilisée pour permettre à un
groupe de dominer un autre groupe ou d'être sous son emprise. Par
ailleurs, il faut savoir que toutes les cultures se valent. Chaque culture
renferme une croyance et une moralité. Elle n'est pas le fruit du
hasard. Elle se construit dans le paysage ou sur le territoire. C'est tout ce
qui n'est pas inné chez l'homme (Claval & Staszak, 2008). Chaque
communauté a une culture qui la singularise des autres
communautés. En un mot, la culture permet la construction
d'identité collective. « La culturelle est l'âme d'un peuple
» (Bonnemaison et al., 2000, p. 84). Selon Sauer la culture, dans son
acception très large, c'est l'ensemble de l'expérience humaine,
spirituelle, intellectuelle et matérielle (idem). Les problèmes
culturels sont abordés par le paysage. Pour essayer de comprendre le
sens du paysage, c'est le point de vue culturel (Berque, 1984).
2.2. Le concept de paysage en géographie
culturelle
L'intérêt pour le paysage commence avec le
développement de la géographie régionale et de
l'étude des genres de vie (Paquette et al., 2005). C'était une
géographie naturelle qui s'intéressait à la
végétation, c'est-à-dire aux différentes formes du
paysage et à la répartition du paysage en fonction des types de
sols. Cette approche naturaliste va s'élargir en intégrant une
approche environnementaliste (le relief, le climat...). Ce milieu naturel est
constitué de ressources. La géographie va s'intéresser
aussi à l'étude de l'exploitation de ces ressources par l'homme.
De ce fait, le paysage va être délaissé au profil de la
région économique. C'est avec l'émergence de la
géographie culturelle, que la réflexion sera menée autour
du territoire (Paquette et al., 2005). La géographie culturelle comme
l'étude du sens (global et unitaire) qu'une société donne
à sa relation à l'espace et à la nature : relation que le
paysage exprime concrètement (Berque, 1984). En géographie
culturelle, le paysage est un espace vécu. La dimension culturelle
s'inscrit dans la matérialité et l'immatérialité du
territoire. Ces deux dimensions interagissent pour donner un aspect singulier
au territoire. C'est cet aspect particulier du territoire qui est le paysage
culturel. Le paysage culturel résulte de la synthèse
18
des facteurs naturels, socio-économiques et culturels
(figure 3). Selon Carl Sauer, un passage naturel devient avec le temps un
passage culturel à cause de la mobilité démographique, de
la densité de population, de l'habitat, de la production et de la
communication (Sanguin, 1984).
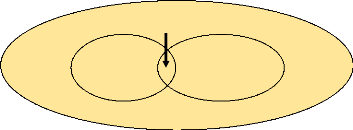
Natural Setting
Cultural
Time
Human
Intervention
Figure 3 : Le paysage culturel comme une constante
interaction entre l'intervention humaine et le milieu naturel
(O'Hare,1997. p.34 cité El Fasskaoui, 2014)
Le paysage culturel est le milieu naturel qui est
marqué par l'intervention humaine. Il nait des interactions des
éléments d'ordre social et des éléments naturels.
Ainsi, à travers le paysage culturel se voit une corrélation
entre la nature et la culture. Selon Brahim El Fasskaoui (2014, p. 34) la
définition du paysage culturel est donnée pour la première
fois en 1925 par Carl Sauer le père de la géographie culturelle
américaine : « The cultural landscape is fashioned from the natural
landscape by cultural group. Culture is the agent, the natural areas is the
medium, the cultural landscape is the result ». De ce fait, le paysage
culturel est à la fois un espace social, culturel et naturel. Le
triangle du paysage culturel se construit à travers ces trois
espaces.
CULTURE
(Savoir, Savoir-être, Savoir-faire ancestraux)
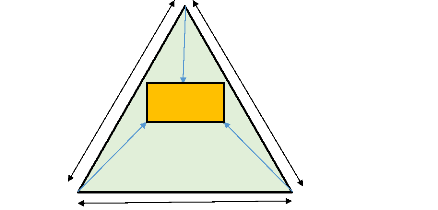
PAYSAGE
HOMME
(Sol, Terre, végétation...)
Paysage culturel
Figure 4 : Le triangle du paysage culturel
19
L'homme se sert du paysage naturel comme support pour
transmettre des savoirs, savoir-être et des savoir- faire ancestraux
(culture). Autrement dit, il utilise le paysage pour mettre en scène des
valeurs culturelles. Le lien culturel formé avec la coïncidence de
la culture et la nature est le paysage. L'homme construit le paysage, ainsi, il
le fait en fonction de son appartenance socioculturelle. Selon le
géographe américain John Brinckerhoff Jackson,
le paysage est « une succession de traces, d'empreintes qui se
superposent sur le sol. Il est, en ce sens, comme une oeuvre d'art ; la terre,
le sol, la nature sont les matériaux que les hommes mettent en forme
selon des valeurs culturelles qui sont différentes dans le temps et dans
l'espace » citée par (Domingues, 2006). Et ce paysage culturel
n'est pas figé. Il se développe avec les aspirations de la
communauté qui le crée. Le paysage résulte de la
construction sociale et culturelle. Les mosquées centenaires du type
soudanais dans le paysage de la région du Nord mettent en scène
les valeurs culturelles religieuses islamiques de la population. La
construction du paysage relève l'identité de la communauté
qui l'a construit. Le paysage a une valeur identitaire quant-il désigne
à la fois un seul territoire et un seul groupe social (Sgard, 1997). Ce
paysage est objet d'unité de ce groupe social et fait sa
particularité. De ce fait, le groupe social dégage un sentiment
d'attachement à ce paysage. Dès lors, on parlera de paysage
identitaire. Comme c'est le cas avec les ponts de liane dans les paysages des
ethnies Yacouba, la construction de ces paysages résultent d'un
savoir-faire socio-culturel. Le paysage identitaire permet à une
communauté de s'identifier à une culture, à une
société, de se situer dans le temps et dans l'espace. Le paysage
est la porte d'entrée pour comprendre les liens tissés entre la
communauté et leur territoire. Les poissons sacrés permettent de
comprendre le lien que puisse plusieurs ethnies avec leur espace. Il y a une
codification du paysage dans un système de valeurs par la
société. Ainsi, Anne Sgard (1997) attribué trois grands
types de valeurs au paysage : une valeur marchande, une valeur patrimoniale et
une valeur identitaire. On peut aussi faire une catégorisation du
paysage : paysage-cadre de vie ; paysage-identité ; paysage-ressource et
paysage-patrimoine (Bonnemaison et al., 2000). Le paysage identitaire est le
fait qu'une société dégage un sentiment d'appartenance
à une espèce naturelle (haut-lieu, végétation,
eau...) ou à une oeuvre humaine particulière et
emblématique. L'identité de la communauté s'exprime
à travers cet élément naturel ou humain. Cet
élément peut être sacré ou non. Il est un objet
culturel, car en dehors du paysage, il n'y a pas de culture. Dans la
région du Nord, les roches sacrées de Shien low sont les objets
culturels de cette communauté.
Le paysage identitaire peut être aussi un objet de
marketing territorial. Dans la promotion du tourisme, il peut être
utilisé comme un logo (Sgard, 1997). On parlera de
l'instrumentalisation
20
de l'identité territoriale au service de
l'attractivité touristique (Bayed & Sedra, 2020). En Côte
d'Ivoire, on peut citer le pont de liane et la basilique notre dame de
Yamoussoukro. À cet effet, un paysage peut avoir à la fois une
fonction identitaire et une fonction marchande avec la caution de la
communauté, qu'il représente. Cependant, il n'y a pas lieu de
confondre un logo publicitaire qui a uniquement une valeur monétaire
à un paysage identitaire (Sgard, 1997).
Le paysage identitaire peut être aussi encore un lieu
patrimonial. Ce paysage qui résulte de la mémoire collective peut
être menacé de disparaitre pour cela les actions politiques seront
entreprises pour l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il sera
protégé et préservé. Ainsi, le paysage identitaire
se trouve être un patrimoine socio-culturel. Je pense à la
mosquée centenaire de Kong qui a été construite en terre
à l'époque soudanais, c'est-à-dire au XVIIème
siècle. Ici, il ne faudrait pas confondre un paysage patrimonial tout
court à un paysage identitaire. À titre d'exemple comme paysage
patrimonial, je peux citer le parc national de Taï qui est inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, n'est pas pour autant un paysage
identitaire.
Voilà défini le paysage identitaire, il a une
fonction interne et une fonction externe selon (Sgard, 1997). La fonction
interne, c'est le rôle que joue le paysage auprès du groupe
social. C'est la relation que tisse le groupe social avec le paysage. Quant
à la fonction externe, c'est l'image que le groupe social veut donner de
lui à l'extérieur.
2.3. Quel lien entre le Paysage, Identité et Culture
en Côte d'Ivoire ?
Le territoire est une production sociale. Or, la culture est
en l'homme. Donc, la culture produit du territoire en formant des
différents paysages. Le paysage, empreinte de la culture (Berque, 1984 ;
Houssay-Holzschuch, 2005). En effet, la culture chrétienne a
favorisé la construction de la Basilique. Chaque visiteur à
Yamoussoukro sait automatiquement qu'il est dans une ville qui est
foncièrement ancrée dans la religion chrétienne. Tout
comme la culture musulmane a permis la construction de la mosquée de
Kong. Tous les visiteurs dans la ville de Kong ont la même l'impression.
Mais, aussi dans la culture, on retrouve du paysage. Dans ce cas, on dira que
la mosquée de Kong fait partir de la religion musulmane ou encore que la
Basilique fait partir de la religion chrétienne. Chaque
communauté religieuse aura un sentiment d'appartenance pour les deux
villes ou les deux paysages. Par conséquent, la culture tout comme le
paysage induisent la construction de l'identité collective (voir
figure).
21
On a aussi le paysage « naturel », il n'a pas
été créé grâce à une intervention
humaine. Les « bois sacrés » ou les « forêts
sacrées », on les retrouve plus ou moins un peu partout en
Côte d'Ivoire. Ils ont tous des caractères mystérieux,
sacrés et secrets toutefois avec des rôles différents d'une
ethnie à une autre ethnie. N'est-elle pas cela même
l'identité ? Ce que j'ai de semble aux autres et ce qui me
différencie des autres.
En Côte d'Ivoire, « les bois sacrées »
sont des vecteurs de l'identité « des sénoufo ». En
pleine ville à Korhogo, l'espace urbain est aménagé en
prenant en compte le paysage du « bois sacrée » qui est
clôturé avec un portail. Les « sénoufo »
étant des sociétés d'initiations, c'est à
l'intérieur de ces forêts que le jeune « sénoufo
» est initié à porter les masques. L'initiation est
secrète, les masques sont sacrés d'où tout le
caractère sacré de ces paysages. Chez les « sénoufo
», il faut « faire » ce paysage de « bois sacré
» pour être considérée comme un « garçon
», c'est-à-dire un « homme ».
Comme « forêt sacrée », je peux citer
celle du village « Kambli » dans le département de
Toulépleu. La « forêt sacrée » abrite une colline
appelée « Tounan ». Cette forêt sacrée est
adorée par la population. Elle a un lien mystique, historique,
protectif, substantif avec la population. Les villageois de « kambli
» se sentent forts avec à ce paysage, situé à
l'entrée du village qui les protège des éventuelles
physiques et mystiques. Les guéré de « kambli »
où qu'ils se retrouvent sur la planète terre ne jurent que par
« Tounan ». Ainsi, ils s'identifient à ce passage. Les
paysages véhiculent une puissante charge identitaire. L'homme devient ce
que la culture en fait et inversement. Comme cela a été
démontré par Augustin Berque qui a mené des travaux sur la
relation forte entre l'homme et le paysage (Berque, 1984 ; 1990 ; 1994 ; 1995)
mentionné par (Bonnemaison et al., 2000). Le rôle que joue le
paysage dans la construction des identités culturelles est
fondamental.
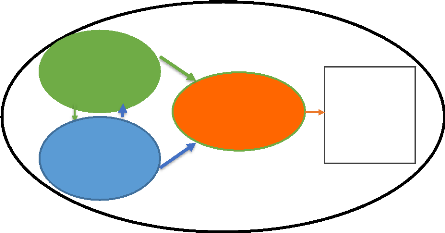
Paysage
(culturel ou
identitaire) Sentiment
d'appartenance
Fff
Culture
Territoire
Identité
territoriale
22
Figure 5 :La construction de l'identité territoriale
en géographie
Les ethnies se définissent en fonction des lieux
où ils vivent. Ils s'identifient dans une représentation
collective au paysage en lui attribuant une valeur identitaire. La
communauté décide de « vivre ensemble » sur ce
territoire autour de ce paysage. Car, la communauté a
développé un sentiment d'appartenance à ce territoire par
l'intermédiaire du paysage.
La culture des peuples mobilise un grand nombre d'acteurs et
sont des marqueurs d'une identité territoriale. Voilà pourquoi
Claire Guiu (2007, p. 39) affirme que : « la pratique folklorique
fonctionne donc comme un pôle d'unification émotionnel et
d'intégration de l'ensemble de la population. Elle participe à la
narration d'une identité régionale et à la construction
d'un soi, d'un même, d'un soi-même comme un autre. » En effet,
la culture est essentielle pour la construction et la reconstruction de
l'identité.
Il peut aussi arriver que le paysage et la culture ne font
qu'un, c'est-à-dire que la culture est incluse dans le paysage et
inversement. Ce passage fait partir de l'identité culturelle des
peuples. Il va dégager une puissante charge identitaire. Cette
identité paysagère va construire une identité
territoriale. En Côte d'Ivoire, le paysage et la culture sont des
vecteurs de l'identité territoriale « villageoise » ou «
rurale ».
23
2.4. Le système culturel ivoirien
L'espace vécu n'est pas strictement la région.
Il est vécu par la communauté qui y est installé. C'est un
espace de différenciation, il marque la différence entre les
membres de la communauté qui l'habite. C'est un espace de dualité
entre la frustration et la joie puis d'haine et d'amour. « ...c'est un
vécu qui n'est pas le même pour tous selon les classes sociales,
les métiers ou les identités culturelles » (Bonnemaison et
al., 2000, p. 58). Chaque ethnie a un rapport différent avec l'espace.
Un individu peut fréquenter plusieurs lieux dans l'espace tout en ayant
des rapports différents avec chacun d'eux. Son espace de vécu,
c'est la somme de ces lieux et le rapport d'affection qu'il éprouve pour
ses lieux. L'espace perçu est perçu inégalement. Pour
Armand Fremont, c'est l'ensemble de l'« espace de vie » et de l'
« espace social » auxquels s'ajoutent les valeurs psychologiques qui
s'attachent aux lieux et qui unissent les hommes à ceux-ci par des liens
immatériels (Frémont, 1974, p. 49). C'est un espace dynamique en
continuelle changement. Il est transformé par la culture.
L'espace culturel est différent de l'espace
vécu. Un espace culturel est un paysage construit sur un espace naturel.
Autrement dit, l'espace culturel est un paysage culturel. L'espace culturel est
un produit social. Il est construit par un groupe culturel. C'est la
transformation de la nature vierge en paysage culturel. Un espace culturel est
caractérisé par des géosystèmes. Un
géosystème c'est l'élément emblématique,
sacré d'un lieu.
L'aire culturelle est un espace dans lequel plusieurs ethnies
ayant des traits culturels communs vivent ensemble. En Côte d'Ivoire,
c'est le regroupement de plusieurs groupes ethniques dans un espace
donné sur des bases historiques et culturelles. La langue est un trait
culturel essentielle dans la construction des aires culturelles. Chaque groupe
ethnique correspond à une aire culturelle. Ainsi, chaque groupe ethnique
a le même foyer culturel. Le foyer est le berceau d'origine. « Une
aire culturelle peut se définir comme un espace relativement
homogène, à l'intérieur duquel se retrouve l'association
dominante de certains traits culturels » (Bonnemaison et al., 2000, p.
97). Ou encore, c'est l'espace de l'usage, du contrôle et des pratiques
d'un groupe ethnique.
Ainsi, l'espace vécu correspond à la Côte
d'Ivoire. L'espace vécu a donné naissance à deux espaces
culturels (la région savanicole « les gens du Nord » ou «
nordistes » et la région forestière « les gens du Sud
» ou « Sudistes »). Les aires culturelles sont regroupées
au sein de l'espace vécu et l'espace culturel.
24
3. La géographie politique
La géographie politique s'intéresse à la
relation que le pouvoir entretient avec l'espace. Le rapport entre la politique
et le territoire est étroit. La géographie politique est la
politique des États expliquée par le milieu. Elle
s'intéresse aux idéologies spatiales. Comme cela a
été confirmé par Jean Brunhes sa définition :
« Nous demandons, quant à nous, à réserver le nom de
géographie politique à l'étude générale et
synthétique des facteurs et conditions géographiques du
développement des sociétés politiques, c'est-à-dire
des États » (Lévy et al., 1990, p. 7). L'État se
trouve au coeur de la géographie politique. Elle aborde essentiellement
la politique interne d'un pays ou d'État. De ce fait, elle
s'intéresse à la délimitation des États, leur vie
politique globale et locale ; l'assise territoriale des clans ; tribus ;
ethnies ou nations, ou encore des langues et des religions (De Montbrial,
2004). Pourtant, les clans ; les tribus ; les ethnies ; des langues et les
religions sont des identités. Partant de là, l'identité
est un objet de la géographie politique. C'est la description du
territoire socioculturel à des échelles différentes.
3.1. Paysage politique au coeur du discours territorial
ivoirien
Il y a une relation étroite entre la construction des
paysages et les autorités politiques. Le paysage culturel devient un
paysage politique à la suite des actions gouvernementales, des
collectivités territoriales et de l'aménagement territoriale.
Dès lors, le paysage politique est l'empreinte de l'idéologie et
des considérations politiques sur le passage culturel. Les
autorités politiques impriment leurs idéologies sur le paysage.
Cependant, les pouvoirs publics ne sont pas les seuls à politiser le
paysage. Les groupes ethniques tendent parfois à politiser leur paysage
immédiat. On peut évoquer aussi des sociétés
où les croyances idéologiques (religieuses) sont dogmatiques et
celle dont les croyances idéologiques sont moins dogmatiques en tout cas
pas évidentes. La première société va
sécréter des paysages politiques ce qui parait plus
évident. Mais contre toute attente la deuxième
société aussi va pondre des paysages politiques liés
à des considérations religieuses (Sanguin, 1984). Comme ce fut le
cas, avec la construction de la Basilique Notre Dame de la Paix en Côte
d'Ivoire à Yamoussoukro. L'idéologie spatiale évince la
réalité sociétale. Par ailleurs, l'auteur reconnait le
paysage politique a trois niveaux. D'abord, au national c'est-à-dire le
macro-dimension, c'est là où les idéologiques politiques
ont un impact sur le pays entier, ça peut être la
décentralisation, la déconcentration ou encore le
découpage territorial à des fins administratives. Ensuite, au
régional (méso-dimension), l'État peut
préférer une région à une autre. Par
conséquent, il va
25
octroyer plus de soutien économique et politique
à celle région par rapport à l'autre. La région Sud
ou la région forestière de la Côte d'Ivoire est la plus
développée grâce au soutien et à la volonté
politique étatique. Enfin, la dimension locale (micro-dimension), dans
l'identité locale de la population, il est inclus les différentes
forces politiques du pays très souvent par l'action de la
décentralisation. Elle permet aux différents partis politiques
d'étendre leur influence au niveau local, grâce aux
élections municipales. Ainsi, le paysage politique est influencé
différemment par les acteurs politiques locales et nationales. Ces
paysages politiques susmentionnés sont constitués
d'éléments. Les éléments du paysage politique sont
les frontières, les paysages publics, les sites et monuments publics
puis les édifices de services publics. En Côte d'Ivoire, la
quasi-totalité de ces éléments sont présents dans
la zone Sud du pays au détriment de la zone Nord. Or, ces
éléments du paysage politique véhiculent des valeurs
religieuses, sociales et politiques au sein de la population qui les abritent.
De ce fait, les formes paysagères sont instrumentalisées dans la
construction du discours territorial. Les éléments du paysage
sont pertinents dans la compréhension du paysage politique.
3.2. Le lien fort entre l'identité, le territoire et
la politique en Côte d'Ivoire
En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays
africains la religion, l'ethnie et la région sont intimées
liées à la chose politique. Les militants de chaque parti
politique partagent essentiellement la même religion, la même
identité ethnique et proviennent de la même région que les
leaders de chaque parti politique. D'abord, les « nordistes » ou les
« gens du nord », musulmans et de groupes ethniques «
Mandé-Nord » et « Voltaïques » sont affiliés
à Alassane Ouattara, lui-même musulman, « nordistes » et
d'ethnie « Dioula ». Ensuite, les « sudistes » ou les
« gens du sud », chrétiens catholiques et de groupe ethnique
« Akan » notamment les « baoulé » sont des partisans
d'Henry Konan Bédié qui est lui-même chrétien
catholique, « sudiste » et « baoulé ». Enfin, les
« gens du centre-ouest », chrétiens et de groupe ethnique
« Krou » sont les fervents partisans de Laurent Gbagbo. Il est
chrétien, de groupe ethnie « Krou » d'ethnie
Bété puis les « gens d'extrême ouest »,
chrétiens et groupe ethnique « Mandé-Sud » sont les
partisans de Mabri Toikeusse qui est musulman « converti », provenant
de l'ouest et aussi de groupe ethnique « Mandé-Sud ». La liste
des leaders politiques n'est pas exhaustive. J'ai retenu que les quatre leaders
politiques les plus influents en fonction des aires culturelles comme
indiqué sur le tableau.
26
Groupes ethniques
|
Religions
|
Partis politiques
|
Leaders politiques
|
|
Akan
|
Catholiques
Musulman
|
PDCI-RDA
|
-FHB et Bédié décédés
(Baoulé)
Tidjane Thiam
(Baoulé et petit-fils de FHB)
|
|
Mandé-nord
|
Musulman
|
RHDP
|
-Alassane Ouattara (Dioula)
|
|
Krou
|
Depuis 1998
Pentecôtiste
En 2021
catholique
|
PPA-CI
|
-Laurent Gbagbo (Bété)
|
|
Mandé-Sud
|
Chrétien
Musulman
|
UDPCI
|
-Feu Guéï Robert (Yacouba) -Abdallah Mabri Toikeusse
(Yacouba)
|
Tableau 4 : Identité ethnique et religieuse des
principaux leaders politiques en Côte d'Ivoire
En Côte d'Ivoire, les ethnies s'identifient aux leaders
politiques issus de leur groupe ethnie ou ethnie ayant la même religion.
Les partis politiques et les leaders politiques constituent des vecteurs
d'identité territoriale.
Par ailleurs, l'islam est la première religion
officielle par ses fidèles. Mais, paradoxalement la religion catholique
est la plus privilégiée par la république (Coulibaly,
1995). Le discours politique consistait à faire la promotion de
l'église catholique au sein de la population et cela passait d'abord par
son propre groupe ethnie « Baoulé ». Le discours territorial
présente une Côte d'Ivoire, un pays catholique. La religion tout
comme l'ethnie est un enjeu politique dans un pays comme la Côte
d'Ivoire.
La colonisation a laissé à la Côte
d'Ivoire une structuration particulière de son territoire. Elle a
divisé volontairement le territoire en deux régions selon des
aspects géographiques, économiques, religieux et culturelles.
Cette stratégie territoriale a mis en place une zone savanicole au nord
et une zone forestière au sud peuplée respectivement des
populations musulmanes et chrétiennes. Les européens sont
rentrés en contact avec les Ivoiriens par le sud par le biais de
l'océan Atlantique. De ce fait, sa population bénéficie en
premier de l'instruction
27
scolaire. L'urbanisation de la zone forestière est
favorisée par le développement de l'économie de plantation
(café, cacao...) (Chauveau & Dozon, 1985). La zone savanicole est
marginalisée et orientée dans les cultures moins
spéculatives. Elle est importance dans la fourniture de la main-oeuvre
pour la mise en valeur des plantations et la construction des infrastructures
socio-économiques dans la zone forestière. Cet inégal
développement entre le Sud et le Nord pendant la période
coloniale va perdurer même après les indépendances.
Malgré quelques tentatives d'action de développement en faveur du
Nord initiées par Houphouët, les disparités entre le Nord et
le Sud vont exister (Coulibaly, 1995).
III. PAYSAGE ET IDENTITÉ DANS LA GÉOGRAPHIE
SCOLAIRE IVOIRIENNE
1. Paysage et identité
1.1. Les différents types de paysages identitaires
dans les manuels scolaires ivoiriens
Dans les manuels scolaires de géographie, le paysage
joue un rôle très important dans l'enseignement. Il permet
l'apprentissage des élèves. Car, c'est un support pour illustrer
des concepts comme l'identité. En Côte d'Ivoire, dans les manuels
de collège, les paysages identitaires sont multiples et
diversifiés. En effet, les paysages identitaires sont presque
présents dans toutes les collections de manuels scolaires de la
6ème à la 3ème d'une part et d'autre
part, ces paysages identitaires sont multiformes ; on dénombre des
photographies, des images et parfois des cartes. Bien vrai que la carte ne soit
pas au sens strict un paysage. Mais, dans un sens plus large, le paysage est
« l'aspect visible de l'espace géographique » (Granier, 2003,
p. 20). En plus, l'explication d'un paysage identitaire peut être
polysémique et difficile. Pour cela, il faut avoir recours à des
documents complémentaires (par exemple une carte) néanmoins le
choix de la carte doit être bien fait et précis. Cette carte
favorisera la compréhension du paysage (Granier, 2003). En outre, dans
les manuels de géographie, le paysage identitaire est de plusieurs
natures (touristiques, culturels, naturels et agraires). Par conséquent,
ces paysages identitaires ont une double fonction. En effet, ces paysages ont
une valeur marchande et une valeur identitaire. La Basilique de Yamoussoukro
qui est illustrée comme un objet de marketing territorial, est aussi un
paysage identitaire religieux. C'est pareil aussi avec le pont de liane et
28
la cascade de Man qui sont utilisés comme des paysages
marchands, pourtant se sont aussi des paysages identitaires culturels. Dans les
manuels de géographie, on a aussi les paysages identitaires agraires.
1.2. L'identité dans les manuels de
géographie ivoiriens
Dans les manuels scolaires de géographie, le concept
d'identité a adopté deux postures d'une question socialement
vive. Certaines identités sont traitées et d'autres sont
évoquées de manière masquée. Les identités
ethnique et régionale sont traitées. L'identité ethnique
est abordée dans une leçon dont l'étude porte sur la
population ivoirienne.
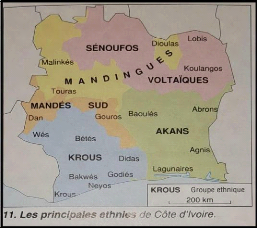
Figure 6 : extrait du manuel scolaire de 3ème,
Hatier/ CEDA, Hors collection, page 69, 1994
L'identité ethnique est enseignée en apprenant
aux élèves que la Côte d'Ivoire a une population composite.
Il est enseigné aux apprenants la répartition des cinq aires
culturelles (aire culturelle Krou, aire culturelle Akan, aire culturelle
Voltaïque ou Gür, aire culturelle Mandé Sud et Mandé
Nord). Par conséquent, les élèves apprennent que chaque
aire culturelle est constituée d'un ensemble d'ethnies qui ont des
traits culturels communs et historiques et qu'il existe plus de 60 ethnies en
Côte d'Ivoire.
Quant à l'identité régionale, elle est
abordée dans les leçons portant sur l'organisation administrative
dans le développement de la Côte d'Ivoire en classe de
4ème. La territorialisation a permis à la Côte
d'Ivoire d'avoir 31 régions comme indiqué sur la figure.
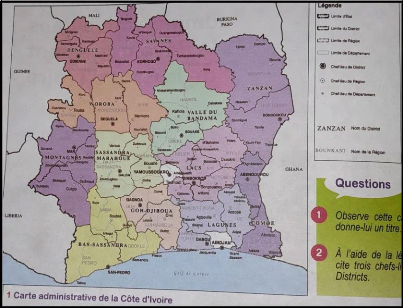
29
Figure 7 : extrait du manuel de 4ème, Vallesse, Ecole
Nation et Développement, page 82, 2019
L'État a procédé au découpage du
territoire en se focalisant sur « les référents identitaires
»3. Ces référents identitaires sont d'ordres
géographique, historique et culturel. « Ce sont ces
éléments qui constituent le ciment de l'identité et du
sentiment d'appartenance » (Lapointe, 2005, p. 2) chez les
élèves pour leur région. La territorialisation et la
dénomination des régions sont au centre de ce modèle de
construction identitaire chez les élèves. La Côte d'Ivoire
est partie de 16 régions pour être à 31 régions
depuis mai 2018. Ce processus de territorialisation mis en place répond
plus aux besoins des systèmes d'organisation administrative (la
déconcentration et la décentralisation) qu'à la
construction identitaire des élèves. Plusieurs régions
sont créées plus ou moins de toutes pièces. Cela
présente un caractère artificiel du découpage
réalisé par l'État qui est un producteur d'un «
déficit identitaire » (Dupoirier & Schajer, 1994, p. 333).
Cependant, dans ce même article sur la base d'un questionnaire, ces
auteurs ont démontré que la création de plusieurs
régions n'est pas un handicap identitaire.
Par ailleurs, les identités religieuses,
géographiques et agricoles sont évoquées de manière
masquée. Ces identités sont abordées à travers les
études portant sur l'étude économique de la Côte
d'Ivoire. Ainsi, l'identité religieuse est abordée dans le cadre
du développement
3 (Alex Mucchielli, 1986) cité par (Lapointe,
2005, p. 4)
30
touristique. L'identité agricole est illustrée
lors des cours sur l'activité agricole du pays. Quant à
l'identité géographique, elle est abordée dans
l'étude porte sur les régions économiques de la Côte
d'Ivoire. Dans mon étude, je vais m'intéresser essentiellement
à ces identités implicitement abordées dans les manuels
scolaires.
2. Les concepts à l'étude
2.1. La définition du concept du manuel scolaire
Le manuel scolaire est un matériel pédagogique
et didactique de base, il améliore la qualité de l'enseignement
et de l'apprentissage. En Côte d'Ivoire, le système
éducatif manque de moyens. L'usage des manuels scolaires est un
impératif. Car, c'est un livre pédagogique et didactique
composé essentiellement de leçons portant sur des notions et des
concepts destinés à l'enseignement, à l'apprentissage des
apprenants et au perfectionnement pédagogique des enseignants. Cette
définition est plus proche de celle de Joseph Poth (1997) qui met
l'accent sur la dimension didactique et pédagogique du manuel. Quant
à celle donnée par (Hussain Bilhaj (2016) tiré dans le
Petit Robert (2003), il met en exergue essentiellement que l'aspect didactique
du manuel scolaire. Il est bon de savoir que quelle que soit la
définition donnée au manuel scolaire, il a un aspect
pédagogique et/ou didactique. Ainsi, le manuel est utile tant pour les
élèves que pour les enseignants. Par ailleurs, la production des
manuels scolaires s'appuie sur des savoirs scientifiques et aussi sur des
réalités sociales. Son contenu transmet des idéologies et
des valeurs de citoyenneté aux élèves. Comme l'explique
des spécialistes de l'histoire de l'éducation :
" d'une certaine manière, le manuel est le miroir dans
lequel se reflète l'image que la société veut donner
d'elle-même ; mais, même si l'image qu'il renvoie est
nécessairement schématique et parfois obsolète, le manuel
est révélateur, par ce qu'il dit autant que par ce qu'il tait, de
l'état des connaissances d'une époque ainsi que des principaux
aspects et stéréotypes d'une société." (Choppin et
Pinhede,1997, p. 46 cités par Niclot, 2002, p. 104).
Le contenu des manuels scolaires s'est des connaissances
qu'une société donnée souhaite transmettre à des
niveaux scolaires d'apprentissage (Abassi & Brugeilles, 2016). C'est un
livre qui invite toute la société à sa conception et
à son usage. Dès lors, le manuel scolaire peut être aussi
défini comme un outil didactique et pédagogique important qui
offre à l'élève un ensemble de connaissances dans son
apprentissage. Il sert de référent pour l'enseignant dans la
préparation de ses cours et à la maison, les parents s'en servent
pour renforcer et suivre l'apprentissage de leurs enfants. Le manuel scolaire
est un livre spécial de toute la société ou
31
un livre national. Il peut être aussi
considéré comme un patrimoine national. Il a une fonction
scolaire et un rôle sociopolitique (Affolter & Sperisen, 2023).
2.2. Les fonctions des manuels scolaires
Les deux fonctions fondamentales des manuels scolaires sont la
fonction sociopolitique et la fonction scolaire.
Parlant de la fonction sociopolitique, le manuel scolaire est
un livre institutionnel par conséquent, les savoirs contenus dans les
manuels sont reconnus. En outre, ils témoignent des valeurs sociales, du
traitement actuel des connaissances et des conceptions sociales de la formation
et de l'éducation qui sont considérés comme reconnus et
légitimes (entre autres par l'État) à une époque
donnée (Waiter, 2003, p 12 ; Knopke, p 39-40 cités par Affolter
& Sperisen, 2023). Cependant, les savoirs contenus dans les manuels
scolaires ne reflètent pas toujours la réalité de la
société. Ils reflètent plutôt la vision que le
politique souhaite pour sa société. Pour eux, la meilleure
manière de véhiculer une idéologie à toute une
génération est de l'inclure dans les manuels scolaires. À
cet effet, les politiques influencent le contenu des manuels en incluant leur
idéologie ou leur vision de la société qui doit être
enseignée aux élèves qui sont l'avenir du pays. Les
manuels scolaires en véhiculant les considérations politiques et
les idéologies garantissent aux autorités politiques sa large
diffusion au sein de la population. Alors, les manuels scolaires sont
instrumentalisés par les gouvernements. Ils se servent des manuels comme
des outils de propagande (Memaï & Rouag, 2017). Car, les manuels
scolaires construisent des sentiments d'exclusion et d'inclusion chez les
élèves. En un mot, ils permettent la construction d'une
identité chez l'élève. L'État joue un rôle
fondamental dans le processus de création des manuels scolaires.
Quant à la fonction scolaire, les manuels scolaires
assument trois fonctions principales (Seguin, 1989). Une fonction «
d'information » cela implique une sélection des connaissances
à transmettre en fonction du niveau de l'apprenant de telle sorte que
leur enseignement soit facile et progressif. Une fonction de «
structuration et d'organisation de l'apprentissage », le manuel propose
une certaine progression de l'acquisition des connaissances et une organisation
en blocs successifs d'unités d'enseignement. Et, une fonction « de
guidage de l'apprentissage », les élèves sont guidés
dans leurs apprentissages soit par la répétition, la
mémorisation ou une activité réflexive.
La fonction des manuels scolaires ne se limite pas qu'à
l'enseignement et à l'apprentissage. Dans leur fonction, ils prennent en
compte aussi des aspects d'évaluation. Les manuels scolaires
32
ont des pages consacrées à l'évaluation
cela permet à l'enseignant de vérifier les connaissances
enseignées aux élèves et de faire une remédiation
si nécessaire.
2.3. La conception des manuels scolaires de
géographie en Côte d'Ivoire
La Côte d'Ivoire a une conception fortement
centralisée et impérative des manuels scolaires. Les manuels
scolaires sont le fruit d'une construction pédagogique entre les
Inspecteurs Généraux de l'Éducation Nationale (IGEN), les
Inspecteurs de l'Enseignement Secondaire, les Encadrants pédagogiques et
les Enseignants de terrain. Pourtant, la géographie scolaire se
réfère à son homonyme qui est la géographie
universitaire pour concevoir le savoir scolaire. Or, comme le dit Boly Yves
Doba (2021), les IGEN étant tous d'anciens enseignants d'histoire
géographie, ceux-ci n'ont pas bien perçu l'évolution de
l'objet de la géographie qui s'est faite dans le monde universitaire.
Pascal Clerc souligne bien cette situation lorsqu'il dit à propos du
changement de l'objet de la géographie :
C'est une science qui a presque que changé d'objet, son
objet c'était la terre le monde physique le relief le climat les eaux
etc., aujourd'hui c'est devenu les sociétés et l'espace des
sociétés. Et ça, c'est quelque chose de très
perturbant pour les enseignants puisque d'une certaine manière on ne
leur a pas dit que ces changements étaient aussi considérables
(Pascal Clerc, 12 novembre 2014,
https://www.youtube.com )
rapporté par (Doba, 2021, p. 80).
Ainsi, dans son mémoire, a interviewé plusieurs
enseignants du supérieur et de manière commune ils ont tous
dénoncé le fait de ne pas être associés à la
rédaction des manuels scolaires. En plus, des connaissances nouvelles
sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire tardent à
être intégrées dans les programmes et manuels scolaires
d'histoire.
Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, les manuels que doivent
utiliser les enseignants sont choisis par les autorités
éducatives.
33
2.4. Les fonctions des manuels scolaires de
géographie en Côte d'Ivoire
Les manuels scolaires sont un moyen pour le gouvernement de
promouvoir sa vision de la société. En géographie, le
modèle de développement économique est
véhiculé à travers les manuels scolaires. L'attention de
l'élève est détournée aussi vers les perspectives
de développement du pays. Le manuel est le canal pour le gouvernement a
communiqué les sujets qu'il trouve lui-même importants pour les
élèves.
Le gouvernement adopte son modèle de citoyen aux grands
thématiques de la géographie. Ainsi, sa fonction politique
influence négativement sur sa fonction scolaire. Les manuels scolaires
de géographie sont quasiment utilisés que par les enseignants.
Ils les utilisent pour préparer leur cours. Les manuels scolaires sont
exploités pour extraire les supports de cours (texte et
iconographie).
Les élèves ivoiriens n'utilisent pratiquement
pas les manuels scolaires en géographie. Les élèves n'y
trouvent pas d'utilité. Car, ces manuels scolaires en géographie
n'ont plus de partie réservée aux travaux pratiques (étude
de cas) et au magazine ou du moins ceux de maintenant ou bien pour faute de
moyens financiers. Cependant, Il faut relever qu'à même la
présence de quelques exercices. À vrai dire, les manuels
scolaires n'ont pas une fonction évaluative.
Pourtant, l'inspecteur disciplinaire scolaire, Monsieur
N'guessan affirme que : « Le manuel scolaire est un tout. Il peut
être utilisé avant, pendant et après le cours »
Ainsi, le manuel scolaire se trouve au coeur de l'enseignement
ivoirien. L'élève peut l'utiliser avant en le feuilletant
à la maison, pendant à la séance du cours et après
pour s'exercer. Pour l'inspecteur disciplinaire scolaire, Monsieur Tah, le
manuel scolaire a une structure intéressante. Il est conçu en
fonction des programmes éducatifs. Quant à l'inspecteur
disciplinaire scolaire, Monsieur Doué, c'est la boussole de
l'enseignant. C'est ce qui l'oriente dans la préparation du cours.
2.5. Les livrets d'activités : Complément des
manuels scolaires de géographie en Côte d'Ivoire
Chaque manuel scolaire en géographie à son
livret d'activité. Dans chaque leçon proposée, on donne
une série d'exercices. La fonction évaluative des manuels
scolaires de géographie est attribuée aux livrets
d'activités en géographie. Ainsi, les enseignants vont utiliser
les livrets
34
d'activités pour préparer leurs
éventuelles évaluations formative et sommative. Quant aux
élèves, ils vont utiliser les livrets d'activités pour
s'exercer au quotidien à la maison et préparer les
différents devoirs. De sorte que, les élèves trouvent plus
utiles les livrets d'activités que les manuels scolaires en
géographie.
2.6. La perception du paysage des élèves
Le paysage a été le principal objet de l'analyse
géographique particulièrement, avec les courants de la
géographie culturelle et de la géographie politique. Voilà
pourquoi, elles accordent une place importante aux faits de perception dans
l'organisation de l'espace (Claval, 1974). Pour percer le mystère,
l'intention cachée ou l'intention implicite de l'organisation de
l'espace, du paysage et du territoire, il serait intéressant de
procéder par une approche perceptive. « On ne peut parler du
paysage qu'à partir de sa perception » (Collot, 1986, p. 211).
Ainsi, la perception du paysage, c'est la manière dont le paysage est
vu. Cela sous-entend que le paysage est perçu différemment par
les individus. Le perçu dépend de la sensibilité de
chacun. C'est le passage de l'objectif au subjectif (Berque, 2016). Dans la
perception, on passe du réel à l'idéelle, d'une
idée à une autre idée et le lien est étroit. Il
serait inopportun de dichotomiser le subjectif de l'objectif, car la relation
est trajective (Berque, 2016). Pour Renée Rochefort (1974, p. 205) :
« Ce n'est pas le paysage objectif qui influence les comportements, mais
le subjectif ou, mieux, l'idée qu'on a d'un paysage. » De ce fait,
le paysage est chargé de valeurs socioculturelles. Il véhicule un
message. Il revient à chacun d'interpréter ou de donner une
signification à ces messages. Les comportements sont fonction de
l'imagination qu'on se fait du paysage ou la signification qu'on lui donne.
Raison pour laquelle, Bailly indique que « c'est un processus actif qui
fait appel à tous les sens de l'homme puisque les messages
transformés en action agissent indirectement sur le monde réel
» citée par (Dupré, 2006). La perception du paysage permet
de découvrir le sentiment qui est éprouvé pour un
territoire, ce qui fait que l'homme est enraciné à un territoire
ou qui en l'éloigne. Elle qualifie ou disqualifie, valorise ou
dévalorise, permet de connaitre ou méconnaitre et aimer ou
haïr un territoire. Ou encore, elle construit un sentiment d'exclusion
sociale ou d'inclusion sociale. Alors, la perception du paysage ce n'est pas de
reproduit le paysage, c'est plutôt l'image mentale du paysage qui est
recherché. La perception du paysage, c'est la compréhension du
paysage qui fait appel aux mécanismes sensoriels et personnelles (figure
8)
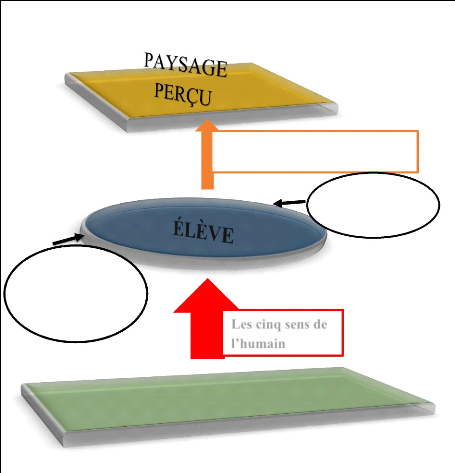
LES
MANUELS SCOLAIRES
PAYSAGE
RÉEL
Les moyens de communication (écrit, oral
...)
Les cinq sens de l'humain
Les facteurs sociaux
35
Figure 8. Le schéma de la perception du paysage par
les élèves à travers les manuels scolaires
Le schéma de la perception du paysage par les
élèves est l'inter agissement des contenus des manuels scolaires
et des facteurs sociaux sur l'élève qui va lui permettre
d'élaborer des images mentales du paysage. À partir des contenus
des manuels scolaires, l'élève se construit une image ou une
représentation mentale des paysages. Naturellement, les
représentations mentales d'un paysage ou d'un territoire changent d'un
individu à un autre. Mais, si la plupart des images mentales des
élèves valorisent ou qualifie un paysage à un autre, cela
ne peut être que l'effet des contenus des manuels scolaires qui
conditionnent la perception du paysage par les élèves. La
perception des paysages par les élèves est donc le fruit du
contenu des manuels scolaires et des facteurs sociaux. La perception des
paysages par les élèves repose sur des critères
d'appréciations ou de répulsions subjectifs, qui relèvent
des contenus des manuels scolaires et
36
des facteurs sociaux. Le paysage s'appréhende par la
vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût qui sont les cinq sens
de l'homme. Dans mon étude, la vue est le sens dominant pour
appréhender le paysage
3. Dans les programmes et institution de l'école
3.1. La définition du programme scolaire en
Côte d'Ivoire
C'est un exposé écrit et publié,
rédigé par le ministère de l'éducation, qui
détaille les savoirs que doivent apprendre et acquérir les
élèves. Le programme scolaire est la sélection et
l'organisation d'expériences d'apprentissage jugées importantes
pour le développement personnel et communautaire des
élèves. Le programme englobe les connaissances, les valeurs, les
attitudes et les compétences qui doivent être bien
sélectionnées et séquencées de manière
appropriée, dans le respect des besoins d'apprentissage et de
développement, à différents âges et à
différents stades de l'éducation. En effet, le programme scolaire
se présente aussi comme un inventaire, une liste récapitulative
de ce qui doit être fait lors d'un cursus de formation.
En Côte d'Ivoire, le programme en
histoire-géographie est composé d'au moins de deux thèmes
et chaque thème peut regrouper au minimum trois leçons.
Par ailleurs, les programmes sont regroupés en cinq
domaines. Chaque domaine est constitué d'un ensemble de disciplines.
|
Domaines
|
Disciplines
|
|
Langues
|
Français, Espagnol, Allemand et Anglais
|
|
Sciences et Technologie
|
Mathématiques, Sciences physiques, Sciences de la vie
et de la Terre puis Technologie
|
|
Univers social
|
Histoire, Géographie, Éducation aux droits de
l'Homme et la Citoyenneté (EDHC) et Philosophie
|
|
Arts
|
Arts plastiques et Éducation musicale
|
|
Développement Éducatif,
Physique et Sportif
|
Éducation, Physique et Sportive
|
Tableau 5 : Les cinq domaines du programmes scolaires
ivoiriens (
http://dpfc-ci.net
/?page_id=63)
L'Histoire, la Géographie, l'Éducation aux
droits de l'Homme et la Citoyenneté (EDHC) puis la Philosophie sont les
disciplines scolaires qui ont pour référence les Sciences
Humaines et
37
Sociales. Elles participent dans l'ensemble, à
l'éveil des consciences des apprenant.e.s tout en les préparant
à leurs responsabilités citoyennes.
3.2. L'évolution des programmes scolaires en
Côte d'Ivoire
En Côte d'Ivoire, les IGN ont une maîtrise totale
sur la rédaction des programmes scolaires. La société
ivoirienne écrit les programmes d'enseignement selon ses besoins
à long ou à court terme. De ce fait, ces programmes prennent en
compte les réalités sociologiques et économiques de la
société. Leur contenu change en fonction de l'évolution de
la société. En outre, leur contenu se fait aussi en se
référant à leur discipline universitaire. De ce fait, ces
programmes assurent une formation adéquate aux élèves avec
les besoins de la société ivoirienne et tout en leur permettant
de s'adapter aux dynamismes mondiaux. Partant de là, les programmes
éducatifs connaissent un processus dynamique en Côte d'Ivoire.
|
Périodes
|
Les programmes éducatifs
|
|
1893 à 1960
|
programmes à caractère colonial
|
|
1960-1975
|
programmes de construction nationale, axés sur la
méthode traditionnelle d'enseignement qui suscitent et entretiennent la
passivité des élèves
|
|
1977-1995
|
programmes rénovés basés sur la
méthode active qui place l'élève au centre du processus
enseignement apprentissage ;
|
|
1995-2002
|
programmes mettant l'accent sur la formation des citoyens
responsables imprégnés des réalités de leur pays et
ouvert au monde
|
|
2003-à ce jour
|
Programmes éducatifs axés sur l'approche par les
compétences dans un contexte de scolarisation obligatoire de 6 à
16 ans (Loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015 portant modification de la
loi n°95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement).
|
Tableau 6 : Evolution des programmes éducatifs
ivoiriens de 1893 à ce jour (
https://dpfc-ci.net/wp
content/uploads/2022/IMPLANTATION-PROGRAMMES-EDUCATIFS-RECADRES)
À partir de 1960, les grands axes du programme
d'enseignement vont être changés en fonction des principaux
besoins de la société et des changements de méthode
d'enseignement. Comme, on peut le voir dans le tableau, après les
indépendances, l'éducation ivoirienne sera focalisée sur
la construction nationale. Cependant, force est de constater que les objectifs
ambitieux dont se sont fixés les différentes autorités
ivoiriennes dans la formation des élèves laissent à
désirer. Ces objectifs ne furent pas atteints dix années
après l'indépendance, le tableau suivant résume les
politiques éducatives élaborées pour réformer le
système éducatif des années 1970 au début des
années 1980.
|
PLANS
|
1971-1975
|
1976-1980
|
1981-1985
|
|
Finalités
|
Société plus égalitaire
|
Identité culturelle du pays Économie nationale
-Société ouverte
|
Bien-être des Ivoiriens
|
|
Buts
|
Égalité de chance des citoyens
|
- Promotion de l'intégration nationale
- Promotion de l'ouverture à l'international
|
-L'éducation au service du développement
-Promotion de l'ouverture à l'international
|
|
Objectifs
|
-Accès de chacun à l'emploi
-Ivoirisation4 des cadres
-Réduction du retard scolaire des filles
|
-Développement de la personnalité et des aptitudes
-Ivoirisation des cadres -Stabilité des familles -Développement
du travail manuel
-Promotion des valeurs culturelles locales -Promotion de
l'excellence.
|
-Formation à l'emploi
-Ivoirisation des cadres
-Développement de l'entreprenariat national
-Amélioration du rapport coût-efficacité du
système éducatif.
|
Tableau 7 : Finalités, buts et objectifs de
l'école ivoirienne (Hauhouot, 2015 cité par Doba, 2021, p.
52)
Ces finalités, buts et objectifs n'ont pas
été atteints pour plusieurs raisons. En effet, le système
éducatif ivoirien est confronté à de multiples
difficultés d'ordre politique, professionnel, social et financier.
3.3. Les partenaires financiers internationaux du
système éducatif ivoirien
Les financeurs, qui sont les unités qui financent le
système éducatif, divisées en trois grands groupes : les
administrations publiques (centrale, régionales et locales), le secteur
privé (ménages, sociétés et institutions à
but non?lucratif comme les ONG locales) et le reste du monde (prêts et
dons des bailleurs et partenaires techniques, ONG internationales).
Par ailleurs, quant à Philippe Jonnaert, il a mis
l'accent uniquement sur les financeurs internationaux de l'éducation
ivoirienne. À cet effet, l'auteur parle des partenaires
bilatéraux et les partenaires multilatéraux. La figure ci-dessous
présente ces partenaires.
38
4 Ivoirisation : c'est un processus qui consistait
à nommer des nationaux comme cadre dans l'administration au lendemain
des indépendances
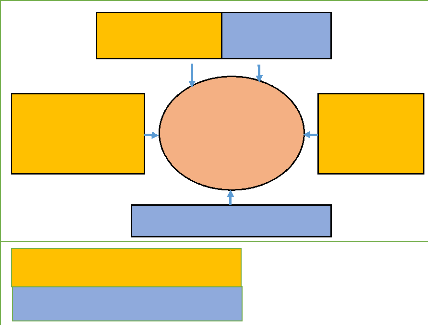
AGENCES
BILATERALES
AGENCES
MULTILATERALES
INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
INTERNATIONALES
FINANCEMENT
DE
L'ÉDUCATION
IVOIRIENNE
AGENCES DES
NATIONS
UNIES
PARTENAIRES PRIVÉS
PARTENAIRES MULTILATERAUX
PARTENAIRES BILATERAUX
39
Figure 9 : Les partenaires internationaux intervenants
dans le système éducatif ivoirien (Jonnaert, 2014 cité par
Doba, 2021, p. 56)
Les partenaires bilatéraux sont les pays occidentaux,
les pays arabes, des organisations de la société civile, des
fondations privées et des ONG internationales qui agissent à
partir des agences bilatérales. Quant aux partenaires
multilatéraux se sont les agences onusiennes et les institutions
financières internationales qui interviennent à partir des
agences multilatérales.
Le système éducatif ivoirien est financé
en grande partie par les partenaires internationaux. Et cela à des
conséquences sur le contenu des manuels scolaires. L'étude de la
France dans les pays africains présente la France comme une puissance
économique. Au fil des années, le système éducatif
ivoirien est parti des programmes à caractère colonial pour
aboutir à des programmes accordant une place importante à la
Côte d'Ivoire. Malgré, ces changements significatifs, la France
demeure de manière explicite ou implicite dans les manuels scolaires
ivoiriens notamment en Histoire et en Géographie. En effet,
l'étude de la France en classe de terminale fait son retour dans le
programme éducatif ivoirien. Voilà pourquoi, les manuels
scolaires en Côte d'Ivoire, depuis les indépendances
jusqu'à nos jours, sont soupçonnés d'être des
vecteurs de rapports de domination. Autrement dit, des outils de
colonialité. Car ils contribuent à la perpétuation des
rapports de domination entre les ex-colonies et l'ex-
40
colonisateur (Philippe, 2023). Cette présence
prépondérante de la France dans les manuels scolaires ivoiriens
s'explique par le fait que la France soit l'un des premiers sinon le premier
financeur dans le système éducatif ivoirien. Selon le Plan
Sectoriel de l'Éducation 2015-2025 de la Côte d'Ivoire : « la
France finance à elle seule 52.34 % de l'apport des partenaires
financiers sur la période 2017-2020 » (Doba, 2021, p. 58). Quant
à l'aide financière des pays arabes, cela a permis
l'intégration et la prise en compte des écoles coraniques dans le
système éducatif formel ivoirien. Pour ce qui concerne, les
autres partenaires bilatéraux, nous avons la Corée du Sud, le
Japon, la Chine, l'Espagne et l'Allemagne. La Corée du Sud, le Japon et
la Chine sont étudiés comme des modèles de puissances
économiques. Par contre, l'allemand et l'espagnol sont
étudiés comme des langues étrangères à
partir de la classe de quatrième et l'anglais c'est en classe de
sixième. L'Union Européenne est la principale agence
internationale a financé l'éducation en Afrique. En ce qui
concerne, les partenaires multilatéraux, notamment les agences
internationales (Doba, 2021). Les institutions financières
multilatérales qui financent dans le système éducatif
ivoirien sont essentiellement la Banque Africaine de Développement (BAD)
et la Banque Mondiale (BM). La BAD intervient plus dans la construction des
établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Par exemple, dans les
villes de l'intérieur, on peut trouver des collèges ou
lycées dénommés « Collège ou Lycée BAD
de ..... ». La BM est le bailleur de fonds des financements pour la
confection des manuels scolaires par l'intermédiaire de l'État
ivoirien.
Aux vues de tout ce qui précède, il est clair
que l'écriture des programmes et la conception des manuels scolaires
sont fortement influencées par l'extérieur.
41
PARTIE II : CADRE MÉTHODOLOGIQUE
I. HYPOTHÈSES ET POSITIONNEMENT
1. Problématique
Un concept est une représentation mentale
générale et abstraite d'un objet stabilisé dans une
communauté de savoirs à un moment déterminé
(Chartrand & Godelieve, 2009). Ces concepts ne s'inventent pas ex-nihilo,
ils sont construits au fur et à mesure des avancées de chaque
science, il en va de même pour la géographie. Un concept est un
construit scientifique. Voilà pourquoi dans la pensée
vygotskienne, l'école est le lieu privilégié pour
acquérir les concepts scientifiques. En effet, l'enseignement efficace
d'une discipline scolaire en particulier la géographie scolaire se fait
à travers la transformation ou la transposition didactique des concepts
scientifiques. Entrer par les concepts, c'est travailler sur le sens des mots,
leur évolution et leur intégration pour avoir un discours
géographique adéquat (Molines, 2000). Donc, pour avoir un
raisonnement géographique logique et organisé, il est important
de connaitre et de maitriser les concepts de la géographie scolaire. Par
ailleurs, en géographie, tout se ramène à un espace
donné ou un territoire donné. De ce fait, le territoire est le
pain de la géographie (Brunet, 1995) même si elle n'est pas
l'unique science qui s'intéresse au territoire. Il reste un concept
indispensable de la géographie scolaire auquel il convient de mettre en
place des stratégies d'enseignement. Car, son enseignement passe par une
éducation à la formation du citoyen. Cela rend ses enjeux
importants et nombreux. C'est un construit social, à la fois
résultat dynamique, ressource et enjeu de production sociale d'un milieu
identifié physiquement et par les diverses significations qui lui sont
attribuées (Joublot Ferré, 2017). Guy Di Méo (2002b, p.
293) affirme que : « [...] le territoire, instrument de domination est
parfois mobilisé comme un outil de régulation des rapports
sociaux et politiques. Il masquerait les conflits de classes et les
contradictions sociales derrière l'écran, derrière
l'apparence d'une adhésion et d'une identité territoriale
collective. » Ainsi, la notion du territoire à travers le concept
d'identité permet de comprendre les conflits sociétaux.
Voilà pourquoi, la question identitaire est au coeur des crises
successives qu'a connues le pays. Pourtant, la Côte d'Ivoire avec ses
nombreuses ethnies enseigne à travers la géographie scolaire le
concept d'identité à ses élèves, futurs citoyens.
Ainsi, dans une approche didactique pour comprendre la politique identitaire
ivoirienne, je vais analyser le concept d'identité dans les manuels
scolaires de géographie. Pour cela, mon sujet s'intitule : « une
approche du territoire dans l'enseignement scolaire ivoirien : le concept
d'identité ».
42
Dès lors, l'interrogation que je me pose est de savoir
: quel est le lien entre territoire et identité dans la
géographie scolaire ivoirienne?
Pour répondre à cette question centrale,
l'étude s'articulera autour de deux axes principaux :
-Comment le concept d'identité est-il abordé
dans les manuels scolaires?
-Quelles sont les perceptions que se font les
élèves du paysage des régions forestières et ceux
des paysages savanicoles?
2. Objectifs et hypothèses de recherche
2.1. Objectifs de recherche
Objectif général
-Montrer que le lien entre identité et territoire est
faible dans la géographie scolaire ivoirienne.
Objectifs spécifiques
-Montrer que le concept d'identité prend de multiples
facettes dans les manuels scolaires ivoiriens.
-Montrer que les élèves ont une meilleure
perception du paysage des régions forestières que celle des
régions savanicoles ivoiriennes.
2.2. Hypothèses de recherche
Hypothèse générale
-Le lien faible entre identité et territoire dans la
géographie scolaire ivoirienne est lié à la volonté
politique éducative ivoirienne.
Les autorités éducatives décident
d'occulter l'étude de l'identité. Elle est une question
socialement vive en Côte d'Ivoire. Pour cela, le territoire n'est pas
pris dans toute sa dimension dans la géographie scolaire.
43
Hypothèses spécifiques
-Le concept d'identité dans les manuels scolaires a de
multiples facettes parce que dans les manuels scolaires l'identité n'est
pas que territoriale. Elle est aussi polarisée.
Dans la géographie scolaire bien que le concept
d'identité ne soit pas traité officiellement. Les auteurs vont
privilégier une idéologie religieuse catholique dans les contenus
du manuel d'un côté et d'un autre côté,
l'étude de l'économie de la Côte d'Ivoire sera
polarisée sur les paysages identitaires et les produits agricoles
identitaires de la région du Sud.
- Les élèves ont une meilleure perception des
paysages de la région forestière contrairement à la
région savanicole de la Côte d'Ivoire à cause de la
manière dont le concept d'identité est enseigné dans les
manuels scolaires de géographie et des facteurs sociaux.
L'enseignement du concept d'identité fait que les
élèves connaissent mieux la région du Sud. Dans les
manuels scolaires, l'identité est enseignée à travers le
développement des activités économiques du pays. Pourtant
dans les manuels, ces activités sont focalisées sur la
région forestière. Les paysages identitaires et les produits
identitaires agricoles de la région forestière sont plus promus
dans les manuels et dans la société ivoirienne.
3. Ma posture de recherche : praticien-chercheur ou
prof-chercheur
La posture de praticien-chercheur est un analyseur « qui
met en relief beaucoup de questions et de situations qui se posent à
tout chercheur » (De Lavergne, 2007). Dans le cas d'un enseignant, «
la recherche peut avoir une foison de finalités dont le changement de
paradigme, l'adaptation de stratégies de façon contextuelle, des
propositions curricula » (Kouadio, 2022, p. 35) et des analyses de manuels
scolaires. La posture de « praticien-chercheur » est un professionnel
et un chercheur qui mène des recherches dans son domaine professionnel
ou dans un domaine professionnel similaire. Ainsi, l'expression de «
praticien-chercheur » signifie qu'une double identité est
revendiquée, sans que l'une des deux prennent le pas sur l'autre (De
Lavergne, 2007, p. 29). En effet, pour l'auteure il y a une
égalité entre deux postures et aussi une
simultanéité entre les deux mondes comme si c'était le cas
d'un doctorant-praticien-chercheur définit par (De Saint-Martin et al.,
2014). Par ailleurs, pour ces auteures « le praticien-chercheur est un
praticien devenu chercheur » (De Saint-Martin et al., 2014, p. 4),
c'est-à-dire un professionnel qui devient un chercheur. Un
praticien-chercheur va entamer des recherches sur sa pratique professionnelle
au quotidien. « L'entrée en recherche du professionnel s'origine
dans sa
44
pratique et la nécessité ressentie d'approfondir
sa réflexion pour améliorer son travail. Sa recherche est donc
déterminée à la fois par ses intérêts
professionnels et sa curiosité intellectuelle » (De Saint-Martin et
al., 2014, p. 5). Dans le cadre de l'enseignement, la recherche va permettre
à l'enseignant de comprendre les objectifs implicites des notions et
concepts qu'il enseigne. Car, le chercheur analyse ce que le praticien ne voit
pas (De Saint-Martin et al., 2014, p. 6), il voit ce que le praticien ou le
professionnel ne voit pas. Le praticien et le chercheur n'ont pas
forcément les mêmes objectifs. Le professionnel a une
expérience sur le terrain que le chercheur n'a pas. Cela permet au
chercheur de recadrer et de se poser les bonnes questions. «
L'expérience du praticien alimente les questionnements du chercheur
» (De Saint-Martin et al., 2014, p. 8). Les résultats du chercheur
permettent au praticien de s'améliorer dans sa pratique professionnelle.
L'analyse du chercheur bouleverse les certitudes du praticien dans ses routines
quotidiennes (De Saint-Martin et al., 2014, p. 8). Dans ce cas, il n'y a pas de
rapport d'égalité entre les deux postures. Ma posture de
praticien ou de professeur m'a permis de travailler dans un milieu dont j'ai la
connaissance. Cela a facilité ma position de chercheur et en justifiant
mon objet de recherche (De Saint-Martin et al., 2014) et permis de faire une
enquête rapide. Quant à ma posture de chercheur qui est celui d'un
chercheur dont le champ de recherche porte sur le concept d'«
identité » qui sera analyser dans les manuels scolaires de
géographie et un questionnement a été adressé aux
élèves du secondaire. Par ailleurs, quand un professeur
(enseignant de Collège) entreprend une recherche sur son milieu
professionnel, il est un « professeur-chercheur » (Gaujal, 2016
cité par Kouadio, 2022). Ses implications et surimplications
opèrent un double mouvement, sur sa recherche et sur sa pratique (De
Saint-Martin, 2013, p. 461). Mes implications et surimplications se sont faites
à plusieurs niveaux. Dans chaque classe choisie pour mon enquête,
j'ai choisi de manière aléatoire 30 élèves dans
chaque classe. Ma posture de praticien (professeur) a profité à
ma posture de chercheur. Car lors de l'enquête, chaque jour, j'ai
regroupé 30 élèves dans une classe en leur remettant le
questionnaire. J'ai pris le temps de leur expliquer les enjeux de
l'enquête et à répondre aux préoccupations de
certains élèves. Et là, j'ai vu ma posture de praticien et
de chercheur s'entremêler. Les élèves étaient
surpris de ma posture de chercheur qui interdisait à ma posture de
praticien de ne pas citer d'exemples concernant certains points sur le
questionnaire comme le voulaient certains élèves.
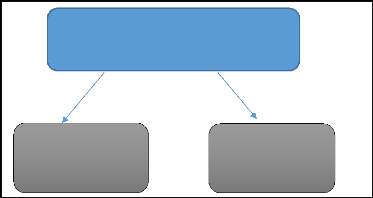
Dans les manuels scolaires
Praticien-chercheur ou prof-chercheur
Un questionnaire et
un entretien avec
les
élèves
45
Figure 10 : Les lieux d'exercice de ma posture de
praticien-chercheur
4. Les biais possibles dans cette étude
La difficulté dans la classification des
différents types d'iconographiques présents dans les manuels
scolaires et la fonction attribuée à chaque iconographique ont pu
être rencontrées. Puisque, la volonté réelle des
concepteurs de ces manuels ne sont pas connues. Donc, il peut y avoir des biais
d'interprétation (Dominique, Legros et Perret, 2018). En plus, pour un
concept comme l'identité, les mêmes iconographies auront sans
doute des fonctions différentes avec d'autres auteurs. Par ailleurs,
mener des études sur l'identité dans son propre pays, si on n'y
prend pas garde, notre analyse peut glisser facilement de l'objectivité
à la subjectivité.
Par ailleurs, la perception des paysages par les
élèves est difficile à appréhender et ne peut pas
être totale, car elle relève tant de la subjectivité des
élèves que des savoirs scolaires qu'ils reçoivent.
Cependant, les questionnaires vont m'aider à saisir une certaine
réalité de la perception des paysages par les
élèves.
Mes élèves enquêtés se trouvent
dans l'espace culturel « Krou » plus précisément
d'ethnies « guéré ». De ce fait, les
élèves d'ethnies « guéré » sont les plus
nombreux dans les classes. Cela a rendu difficile notre
échantillonnage
46
II. PROTOCOLE DE RECHERCHE
1. Échantillonnage de mes corpus
1.1. Le corpus des manuels scolaires
Je vais d'abord m'intéresser aux manuels scolaires de la
classe de sixième à la troisième.
Pourquoi les classes de collège ? Car, je suis
enseignant de collège. Ensuite, il convient de préciser les
manuels scolaires sélectionnés pour cette analyse. Je compte
étudier les manuels scolaires en fonction des trois dernières
collections utilisées dans le système éducatif ivoirien.
Cela me donne un total de trois générations de manuels scolaires.
Autrement dit, une somme de douze manuels scolaires. Enfin, je vais choisir le
corpus des manuels de la collection Hors collection, des manuels de la
collection L'Afrique et Le Monde et des manuels de la collection École
Nation et Développement (Tableaux)
|
Titre
|
Auteurs
|
Editeurs
|
Année
|
Niveau scolaire
|
Nombre de pages
|
Thématiques abordées
|
|
Géographie
|
Une équipe
de
pédagogues africains
|
HATIER/CEDA
|
1992
|
5ème
|
191
|
-L'Afrique L'Amérique -L'Asie
|
|
Géographie
|
Une équipe
de
pédagogues africains
|
HATIER/CEDA
|
1993
|
4ème
|
191
|
-L'Europe
-L'Afrique de
l'ouest
|
|
Géographie
|
Une équipe
de
pédagogues africains
|
HATIER/CEDA
|
1994
|
3ème
|
175
|
-L'Afrique
-La Côte
d'Ivoire
-Le Nigéria
-L'Afrique du
Sud
|
Tableau 8 : Les manuels de la collection Hors
collection
47
Manuels
|
Auteurs
|
Editeurs
|
Année
|
Niveau scolaire
|
Nombre de pages
|
Thématiques abordées
|
|
Histoire -
Géographie
|
Une équipe
d'enseignants africains
|
HATIER /CEDA
|
1998
|
5ème
|
176
|
-La Côte
d'Ivoire, -L'Afrique de l'Ouest
|
|
Histoire -
Géographie
|
Une équipe
d'enseignants africains
|
HATIER
INTERNATIONAL/CEDA
|
2002
|
4ème
|
191
|
-Géographie régionale de la Côte d'Ivoire
-Les
ensembles
régionaux et
les
regroupements
à caractère
économique
|
|
Histoire- Géographie
|
Une équipe
d'enseignants africains
|
HATIER/CEDA
|
1999
|
3ème
|
191
|
-La Côte
d'Ivoire : étude économique -L'économie
des pays
développés
-Un exemple
de coopération Nord-Sud
|
Tableau 9 : Les manuels de la collection l'Afrique et le
Monde
48
Manuels
|
Auteurs
|
Editeurs
|
Année
|
Niveau scolaire
|
Nombre de pages
|
Thématiques abordées
|
|
Histoire- Géographie
|
Une équipe
d'enseignants ivoiriens
|
NEI-CEDA
|
2017
|
5ème
|
168
|
-L'homme et
son milieu en
Côte d'Ivoire -Les conséquences
des activités
économiques sur l'environnement
|
|
Histoire- Géographie
|
Une équipe
d'enseignants ivoiriens
|
Vallesse
|
2019
|
4ème
|
134
|
-L'organisation administrative
dans le
développement
de la Côte
d'Ivoire
-Les
regroupements économiques en
Afrique de
l'Ouest et en
Europe : Exemples de la CEDEAO et de l'UE
|
|
Histoire- Géographie
|
Une équipe
d'enseignants ivoiriens
|
Vallesse
|
|
3ème
|
|
-Étude économique de la Côte d'Ivoire
-L'Afrique face
à la
mondialisation
|
Tableau 10 : Les manuels de la collection École Nation
et Développement
49
1.2. La perception du paysage
La perception des paysages est réalisée avec
deux classes de troisième et deux classes de quatrième du
Collège Moderne Péhé. La perception des
élèves permettra de montrer le degré de sentiment et de
connaissance que les élèves ont pour les deux grandes
régions géographiques. Cela se mesure par la connaissance
spécifique qu'ils ont sur chaque région.
Ce questionnaire a été réalisé
avec 120 élèves, d'octobre à décembre. Lors de mes
enquêtes, je n'ai pas prévenu les élèves à
l'avance que j'allais leur soumettre à un questionnaire. Ainsi, je
venais parfois dans une salle aux heures auxquelles où ils n'avaient pas
cours et je sélectionnais 30 élèves selon mes
critères si possibles. D'abord, je les disposais de telles sortes qu'ils
ne puissent pas communiquer. Ainsi, je mettais un élève par table
et la table suivante servait d'écarter entre lui/elle et le ou la
prochain.e. Ensuite, je distribuais les questionnaires. Enfin, je les
expliquais que ce n'est pas pour les évaluer que c'était pour
juste connaitre leur point de vue sur certaines questions pour mon
enquête.
Selon des critères de choix tel que : la religion,
l'ethnie, le genre
|
Classes
|
4ème 1
|
4ème 2
|
3ème 1
|
3ème 2
|
|
Garçons
|
18
|
13
|
20
|
11
|
|
Filles
|
12
|
17
|
10
|
19
|
|
Malinké
|
5
|
4
|
4
|
4
|
|
Sénoufo
|
4
|
5
|
4
|
5
|
|
Baoulé
|
4
|
4
|
5
|
4
|
|
Ebrié
|
5
|
4
|
4
|
4
|
|
Guéré
|
4
|
4
|
5
|
4
|
|
Bété
|
4
|
5
|
4
|
4
|
|
Autres ethnies
|
4
|
4
|
4
|
5
|
|
Musulman.e.s
|
10
|
18
|
14
|
15
|
|
Chretien.ne.s
|
20
|
12
|
16
|
15
|
|
Total
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Tableau 11 : Echantillonnage des élèves
à enquêter
50
2. Mode d'analyse
2.1. Analyse théorique des manuels scolaires
Je vais procéder à une analyse de contenu des
manuels scolaires (Annexe 1). L'analyse des contenus de manuel scolaire a
essentiellement des enjeux pédagogiques et didactiques. Dans cette
étude, il s'agira de mettre en lumière les enjeux politiques,
sociologiques et idéologiques puis économiques du concept
d'identité. « L'analyse de contenu permet de faire un inventaire
méthodique et quantitatif des informations contenues dans un document,
afin de dégager le sens et de classer ce qui y est contenu. Elle permet
d'éviter le recours à l'intuition et aux impressions personnelles
» (Muchielli, 1998 cité par Nazair, 2016, p. 42).
Pour faire un inventaire méthodique de ces
informations, j'ai élaboré une grille d'analyse de manuel
scolaire (voir annexe) selon certains critères :
-Présentation du manuel : (Niveau, Auteurs, Collection)
;
-Nature des documents liés à l'identité :
relever les textes et iconographies (ensemble de représentation visuelle
(paysage, carte...) qui relèvent de l'identité ;
-Thématique ou leçon évoquée pour
illustrer le document : Thème où le document identifié a
servi d'illustration ;
-Présence des mots liés à l'identité
: relever les mots liés à l'identité dans la leçon
;
-Présence des mots liés au territoire : relever les
mots liés au territoire dans la leçon ;
-Dans le lexique, les mots liés à
l'identité ou au territoire : faire une analyse systématique des
mots se trouvant dans les pages du lexique à la fin du manuel pour
identifier les mots liés à l'identité ;
-Pages : indiquer le numéro des pages où les
documents ont été illustrés ;
-Synthèse : donner le type d'identité ;
interpréter l'objectif explicite ou implicite de l'illustration ;
analyser le discours territorial ; analyser la perception des
élèves à travers ces images. Ainsi, la figure qui suit
présente le corpus de manuel scolaire.
Manuel scolaire
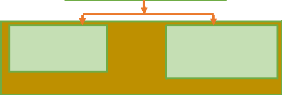
Texte relatif à la culture
IDENTITÉ
Iconographique
(Paysage, culture,
tableau, carte)
Figure 11 : Le schéma du corpus du contenu de manuel
scolaire
51
Les images occupent une place primordiale dans les manuels
scolaires en Histoire-Géographie quel que soit le niveau. Eu
égard à cela dans cette étude, l'analyse du concept
d'identité se fera à travers les illustrations. Car, les
iconographies occupent une place importante dans la composition
matérielle des manuels (Choppin, 1992 ; Dominique, Legros et Perret,
2018). Le manuel scolaire en géographie est un objet culturel. De ce
fait, je vais analyser ces images comme des représentations sociales et
culturelles traduisant un regard sur la société ivoirienne et les
éléments que l'on souhaite souligner dans l'instruction.
Cependant, il faut savoir que les images de paysage présentent dans les
manuels n'ont pas uniquement un but esthétique. Ces illustrations ont
des buts majeurs qui sont pédagogique, didactique (Dominique, Legros et
Perret, 2018) et politique. Analyser le concept d'identité en
géographie scolaire, c'est interpréter le discours territorial en
analysant les images de ces paysages et faire le portrait du type
d'élève que cette société veut former. Car, «
l'analyse paysagère permet de rendre compte de la singularité des
lieux » (Bohoussou, 2023, p. 54).
2.2. Analyse théorique de la perception des
élèves
Je vais leur soumettre un questionnaire (Annexe
2) et un entretien (Annexe 3). D'abord, mon objectif sera de
connaître les savoirs ethnoculturels (religion) des élèves.
Après cela, je dois qualifier la perception territoriale des
élèves. L'intérêt est de savoir si les
élèves ont la même connaissance de la région
savanicole et de la région forestière.
L'entretien se fera en fonction des réponses
données par les élèves lors du questionnaire. Par exemple
:
J'ai vu que tu as choisi la religion (chrétienne,
musulmane ou animiste) comme la religion la plus pratiquée en Côte
d'Ivoire.
Dis-moi, pourquoi penses-tu que cette religion est la plus
pratiquée ? ou encore Où as-tu appris cela ?
PARTIE III. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET
ANALYSES
52
Dans cette étude, je m'intéresse essentiellement
aux identités relevant de la population ivoirienne. Même, si
parfois il arrive que je m'intéresse à des leçons ne
traitant pas de la Côte d'Ivoire, c'est que de manière indirecte
l'iconographie est liée à la question identitaire ivoirienne.
I. UNE IDENTITÉ RELIGIEUSE FAVORISÉE DANS LA
GÉOGRAPHIE
SCOLAIRE
1. L'identité religieuse Baoulé
mobilisée au service du tourisme
Certains auteurs se sont inscrits dans cette analyse
réductrice de la Basilique en mettant au premier plan sa
monumentalité dont l'aspect religieux est relégué au
second plan. On pourrait dire que selon Bénédicte Tratnjek, la
basilique est un marqueur spatial qui permet la construction de
l'identité nationale ivoirienne. Car l'auteure affirme que :
« ...Pour les Ivoiriens, l'édifice ne
reflète pas seulement une appartenance religieuse, ni même
seulement un lieu. C'est un espace géosymbolique chargé de
valeurs identitaires et de connotations nationales auxquelles tous les
Ivoiriens (chrétiens ou musulmans) se réfèrent. La
basilique est également, dans leurs coeurs, l'inscription spatiale du
pouvoir du premier président de la Côte d'Ivoire
indépendante. La monumentalité est ici mise au service de
l'identité nationale. L'architecture et le politique sont intimement
liés : la basilique est un marqueur du pouvoir dans l'espace, qui forge
et reflète une identité ivoirienne » (Tratnjek, 2011, p.
5).
Il faut rappeler que la construction de la basilique fit objet
de sévère critique par la population. Dans un pays comme la
Côte d'Ivoire qui est multiethnique et pluriconfessionnel, quelle que
soit l'ampleur d'un tel édifice religieux, elle ne peut pas être
un référent commun dans une société
multiculturelle. Par conséquent, la basilique est un géosymbole
religieux uniquement que pour la communauté catholique. C'est un «
réfèrent identitaire religieux-catholique » (Dan, 2020, p.
205) pour la majorité des Baoulés. Raison pour laquelle, en
Côte d'Ivoire, dans les manuels scolaires de géographie, pour
aborder la notion d'identité, les auteurs ont usé d'une politique
qui consiste à faire passer les paysages identitaires comme des atouts
touristiques. Les paysages identitaires sont mobilisés au profit du
tourisme. Ainsi, officiellement ces paysages sont vus comme des atouts
touristiques. Mais selon Ahmadou Kourouma et Gilles Carpentier (2004, p. 91),
« Houphouët-Boigny se battit pour sauver sa basilique de Yamoussoukro
» parce
53
qu'elle « avait une mission importante. Elle devait
arrêter l'expansion de l'islam, bloquer son avancée vers le Sud
chrétien de la Côte d'Ivoire. » La géographie scolaire
est aussi le creuset de la construction des identités. Les
autorités publiques ont pu utiliser la Basilique Notre Dame de la Paix
de Yamoussoukro et la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan comme des atouts
touristiques dans les différents manuels scolaires de géographie
pour construire l'identité catholique. En utilisant ces édifices
religieux comme des atouts touristiques, cela permettait à l'État
d'éviter « les questions sensibles » (Avon, 2015) dans un pays
pluriconfessionnel comme la Côte d'Ivoire. Ces images sont
présentées à travers les figures suivantes :
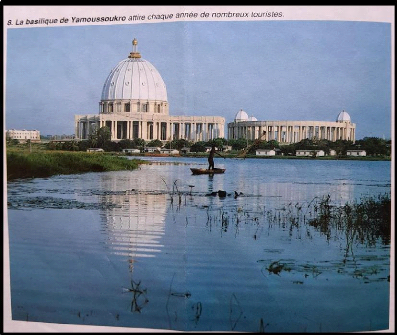
Figure 12 : extrait de la page 112 du manuel de 3ème
Hatier/CEDA, Hors collection, 1999
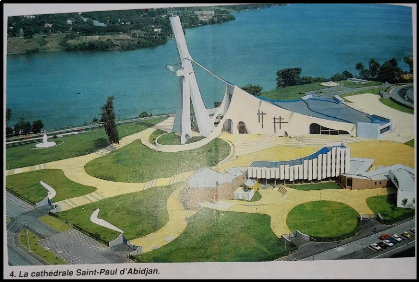
54
Figure 13: extrait de la page 126 du manuel 3ème
Hatier/CEDA, L'Afrique et le Monde, 1999
La fonction première de ces deux édifices est
une fonction religieuse et non touristique. Et, c'est cette fonction
première que les auteurs vont essayer de faire véhiculer en
utilisant ces paysages religieux comme des attraits touristiques. Bien qu'ayant
évoqué d'autres atouts touristiques, il faut noter que ces
paysages religieux sont omniprésents dans les collections des manuels
scolaires. Il faut rappeler que les deux présidents de la Côte
d'Ivoire sont des Baoulés et de confession religieuse catholique comme
la plupart des Baoulés. Officiellement, « l'action religieuse du
gouvernement ivoirien est protéiforme » (Simonet, 2010, p. 409).
Pourtant, le discours politique est différent du discours spatial. La
démonstration de l'attachement de l'État à la religion
catholique s'est faite aussi à travers des marqueurs spatiaux. Comme le
disait Marie Miran-Guyon (2013, p. 8) : « Les signes les plus visibles en
ont été la construction du sanctuaire marial de Yopougon, de la
cathédrale St Paul du Plateau et surtout de la monumentale basilique
Notre Dame de la Paix à Yamoussoukro, réplique grandeur nature de
Saint Pierre de Rome. » Un autre fait marquant, aucune mosquée
n'est utilisée pour une quelconque illustration même pas la
mosquée centenaire de Kong qui est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, construite en 1751. Pourtant, cet édifice compte tenu de son
originalité fera un atout touristique important si elle était
valorisée au même titre que la Basilique. Ces paysages religieux,
insérés dans les contenus des manuels scolaires, étaient
de nature à développer l'image d'une Côte d'Ivoire
chrétienne et catholique. Le paysage de la Basilique et de la
Cathédrale Saint-Paul
55
d'Abidjan a donc été introduit de nombreuses
fois dans les manuels scolaires de géographie. À
l'évocation de Yamoussoukro comme une ville secondaire pour
décongestionner Abidjan, c'est bien le paysage de la Basilique qui est
utilisé pour faire l'illustration.
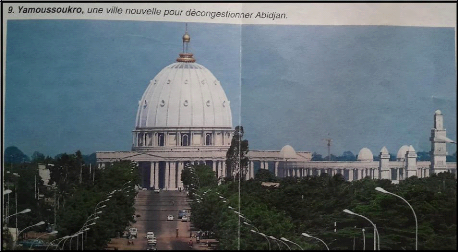
Figure 14 : extrait à la page 143 du manuel de
4ème, CEDA/HATIER, L'Afrique et le Monde
D'aucuns considèrent que « L'instrumentalisation
politique du religieux faite par l'État ivoirien et le manque de
politique véritable de gestion des pratiques religieuses rend compte de
cette situation » (Dan, 2020, p. 220). Il est vrai que ces édifices
sont souvent présentés comme des atouts touristiques, ainsi que
nous allons le voir dans la section 2. La Côte d'Ivoire est
présentée, en effet, telle un pays catholique aux
élèves.
56
2. Le catholicisme : identité religieuse
favorisée
Une déclaration du Directeur de cabinet Adjoint du
Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la
sécurité précise que :
« L'État ivoirien est non confessionnel. Il ne
professe aucune foi,
n'adhère à aucune religion, ne donne investiture et
privilège particulier
à aucune communauté de croyance
»5rapporté par (Dan, 2020, p. 212).
À partir de cette déclaration, la Côte
d'Ivoire semble être présentée comme un pays laïque
dans lequel l'État reconnait une réalité
pluriconfessionnelle. Or Tiémoko Coulibaly (1995, p. 144) affirme de son
côté que : « ...sous le long règne
d'Houphouët-Boigny, la République a tout particulièrement
été investie par la religion du Prince, le catholicisme, alors
que l'islam est officiellement la première religion du pays par le
nombre de ses fidèles.» De ce fait, certains considèrent que
les dignitaires de la religion islamique se comportent comme « des chefs
d'une communauté minoritaire, qui recherchent les bonnes grâces du
pouvoir politique » (CADN, 1963, p. 22 cité par Simonet, 2010, p.
409). Mais le pouvoir politique semble avoir accordé une large place
à la croyance catholique. Certaines actions montreraient ce sentiment de
différence établi entre la religion catholique et la religion
musulmane. « Houphouët dit aux arabisants qu'ils n'entraient pas en
ligne de compte dans les projets de développement ivoiriens »
(Miran-Guyon & Touré, 2012, p. 13). Ainsi on trouve, dans les
manuels scolaires de géographie, des éléments qui
témoignent de l'affirmation d'une croyance religieuse
particulière, catholique, dans la structuration de l'identité
ivoirienne. Par ailleurs, Marie Miran-Guyon (2013, p. 5) affirme qu'en histoire
: « les manuels parlaient d'islam en des termes plutôt
défavorables à cette religion, dépeinte sous l'angle des
djihads et de la violence. » Si dans les manuels d'Histoire, il est
développée l'image dépréciative de l'Islam. Dans le
manuel de géographie en abordant la diversité religieuse de
l'Afrique où la Côte d'Ivoire est présentée comme un
pays catholique. La stratégie d'enseignement était d'occulter
officiellement toute idée d'une identité religieuse sur les
leçons portant sur la Côte d'Ivoire. Mais, paradoxalement sur une
leçon portant sur la population de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est
affichée comme un pays catholique. Comme cela est présenté
sur la figure suivante :
5 Rapport de la conférence sur Religions et
Droits Humains : Thème « la laïcité de l'Etat de
Côte d'Ivoire », Allocution de Monsieur le Directeur de Cabinet
Adjoint du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la
sécurité.
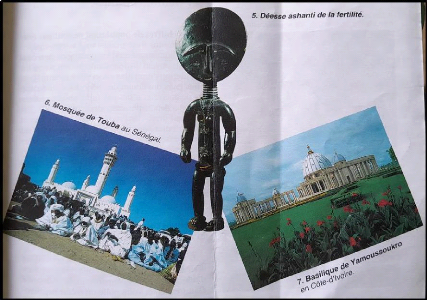
57
Figure 15 : extrait de la page 23 du manuel de
5ème, Hatier/CDEDA, Hors collection
Ce faisant, la Côte d'Ivoire semble ainsi
attachée à une identité religieuse catholique,
malgré sa diversité ethnique et religieuse. C'est pourquoi Marie
Nathalie Leblanc écrit que « Tout récemment la Côte
d'Ivoire était perçue comme un pays catholique, bien que dans les
faits cette identité religieuse soit un plutôt un construit
politique qu'une réalité démographique. Cette construction
politique découle de l'affiliation religieuse du premier
Président de la république Félix Houphouët Boigny,
des liens privilégiés maintenus avec la France et de la
construction de la basilique de Yamoussoukro dans les années 1980 »
(Leblanc, 2003 rapporté par Dan, 2020, p. 212?213). Il pensait sans
doute qu'avec les moyens financiers mis à la disposition de
l'église catholique, les Ivoiriens finiront par l'accepter comme la
religion officielle ivoirienne. C'est pour cette raison Thierry Dan (2020, p.
212) affirme que : « Dans l'imaginaire sociale, le rapport du
président Félix Houphouët Boigny à la religion
chrétienne catholique donne à croire que la Côte d'Ivoire
était vue comme un pays catholique.
Par la construction de la basilique, il s'agit de rendre
visible une identité religieuse catholique qui est minoritaire dans le
paysage ivoirien. Le catholicisme est une religion minoritaire en Côte
d'Ivoire. Comme le disait Marie Miran-Guyon (2013, p. 5) : « fortement
minoritaire auprès de la population. » Donc, l'omniprésence
des paysages de la basilique et du cathédrale Saint-Jean dans les
manuels scolaires de géographie ne reflète pas la
réalité de la société ivoirienne. Il reflète
plutôt l'idéologie religieuse et culturelle que les auteurs
souhaitent faire adhérer la
58
population ivoirienne. La présence récurrente
des iconographiques religieuses catholiques dans les manuels parait garantir sa
bonne promotion auprès des élèves. Par ailleurs, entre
1987 et 2002, la question de la laïcité et la place des musulmans
dans la société est devenue une question vive (Miran-Guyon, 2013)
ou une question socialement vive. Car certains dignitaires musulmans ont
critiqué cette posture étatique de la laïcité en
Côte d'Ivoire.
Dans les années 1980, Houphouët bloqua
d'importants transferts de fonds en provenance de la Banque islamique de
développement et retarda jusqu'en 1993, l'ouverture de relations
diplomatiques officielles avec l'Arabie Saoudite (Miran-Guyon, 2013). Nombreux
sont les musulmans qui se sentirent marginalisés pour des raisons
ethno-politique. Le processus qui présente la Côte d'Ivoire comme
un pays catholique au niveau continental, se retrouve dans l'étude de
l'Europe dès lors que la Pologne est mobilisée pour
présenter l'Europe comme un continent catholique, le continent de
référence de toutes civilisations modernes aux africains. La
figuration du pape, emblématique de la communauté catholique, a
été utilisée à cette fin dans des sections
présentant les caractéristiques économiques de la Pologne,
sans pour autant que le lien ne soit établi (cf. Photographie)
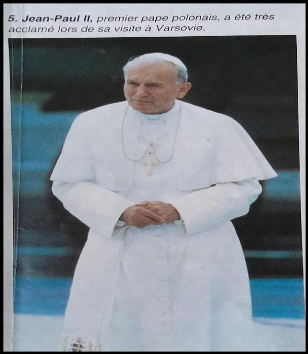
Figure 16 : extrait de la page 125 du manuel de
4ème, Hatier/Ceda, Hors collection, 1994
59
3. La présence des paysages et images religieux
catholiques dans les manuels scolaires
Dans les manuels scolaires de la géographie scolaire,
la notion de l'identité religieuse est effacée dans toutes les
leçons portant sur l'étude de la Côte d'Ivoire. Aucuns
documents textuels n'abordent cette notion dans les manuels. Ces marqueurs
spatiaux religieux ont été introduites explicitement dans les
manuels scolaires à travers des paysages et des images comme des
attraits touristiques. En effet, sur le plan national, ces paysages sont des
atouts touristiques.
Cependant, au niveau continental, c'est-à-dire sur une
leçon portant sur la population africaine, le Sénégal est
présenté comme un pays musulman, la Côte d'Ivoire comme un
pays catholique avec ces mêmes marqueurs spatiaux religieux et le
Bénin comme un pays animiste. À cet effet, la notion de
l'identité religieuse est traitée seulement au niveau africain
dans la collection Hors collection en 1993. Un autre fait marquant est
qu'après cette année, dans toutes les leçons portant sur
la population africaine, la notion de l'identité religieuse est
occultée.
|
Iconographies Classes
|
Paysages
|
Images
|
Pages
|
|
Basilique Notre Dame de la Paix
|
Cathédrale Saint- Paul d'Abidjan
|
Pape
|
|
5ème
|
1
|
|
|
23
|
|
4ème
|
1
|
|
1
|
165 ; 125
|
|
3ème
|
1
|
1
|
|
112 ;110
|
Tableau 12 : Fréquence de l'affichage des marqueurs
religieux dans la collection Hors collection
|
Iconographies Classes
|
Paysages
|
Images
|
Pages
|
|
Basilique Notre Dame de la Paix
|
Cathédrale Saint- Paul d'Abidjan
|
Pape
|
|
5ème
|
1
|
|
|
143
|
|
4ème
|
|
|
|
|
|
3ème
|
1
|
1
|
|
127 ;126
|
Tableau 13 : Fréquence de l'affichage des marqueurs
religieux dans la collection L'Afrique et le monde
60
Iconographies Classes
|
Paysages
|
Images
|
Pages
|
|
Basilique Notre Dame de la Paix
|
Cathédrale Saint- Paul d'Abidjan
|
Pape
|
|
5ème
|
1
|
|
|
106
|
|
4ème
|
|
|
|
|
|
3ème
|
1
|
|
|
102
|
Tableau 7 : Fréquence de l'affichage des marqueurs
religieux dans la collection Ecole Nation et Développement
On constate qu'au fil des années, l'influence des
idéologies religieuses catholiques diminuent. Avec la collection «
Hors collection », nous sommes vers la fin du règne de
Houphouët qui est un fervent catholique et le bâtisseur de la
Basilique notre Dame de Yamoussoukro et du Cathédrale Saint-Paul
d'Abidjan. Ensuite, la collection « L'Afrique et le monde »
correspond à la gouvernance de Bédié qui est lui
Baoulé et catholique comme son prédécesseur, d'où
la forte présence des édifices catholiques dans les manuels de
géographie. Enfin, après ces deux présidents catholiques
et Baoulé, dans la collection « École, Nation et
Développement », la marque des édifices catholiques va se
limiter seulement qu'à la basilique notre Dame de Yamoussoukro. Et la
place que celle-ci occupe dans les manuels est réduite. En effet, le
format de l'image de la basilique dans la collection « Hors collection
» était de (15 cm x 13 cm) ( Figure 12) pour être aujourd'hui
avec la collection « École, Nation et Développement »
à (9cm x 6 cm).

Figure 17 : Extrait à la page 102 du manuel de
3ème, Vallesse, Ecole Nation et Développement,
2020
Dans les manuels scolaires, parmi les édifices religieux,
la Basilique de Yamoussoukro est la plus illustrée. Comme cela est
présenté à travers le graphique ci-dessous :
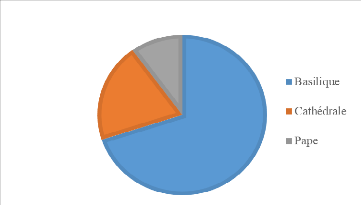
61
Graphique 1 : Proportion des édifices religieux
catholiques dans les manuels scolaires
La Basilique de Yamoussoukro représente 70% des
édifices catholiques utilisées comme contenu scolaire. Quant
à la Cathédrale, elle est utilisée à 20% et l'image
du Pape correspond à 10%.
4. La place de l'identité de la région Nord
dans le développement économique de la Côte d'Ivoire
4.1. Une identité marginale de la région Nord
dans le
développement de l'économie de
plantation
La Côte d'Ivoire est divisée en deux
régions sur le plan géographique, économique, naturel et
socioculturel. Ainsi, on distingue la région forestière et la
région des savanes. Par des initiatives politiques, il y a eu la
disparité entre les deux régions géographiques. En effet,
la région du Nord se voit être caractérisée par des
inégalités économiques et sociales. Pourtant, selon
Cathérine Aubertin (1983, p. 23) : « Le Nord ivoirien,
région de savane, n'a pas toujours été jugé
sous-développé par rapport au Sud, région de forêt.
Avant 1939, son activité économique et ses infrastructures n'ont
rien à envier au Sud ». L'activité commerciale et agricole
étaient bien développées avec des cultures comme le coton,
le sisal, le kapok, le karité, le sésame. Et, la région
avait les infrastructures économiques et sociales les mieux
structurés. Par exemple : en 1912-1913 elle exporte vers la côte
300 tonnes de riz, 4 tonnes de coton, 7 tonnes de
62
caoutchouc, du maïs, des arachides, du beurre de
karité et des peaux » (Largaton Ouattara, 1972) rapporté par
(Aubertin, 1983, p. 27). En un mot son niveau de développement
était équivalent à celui de la région Sud. Entre
1945 et 1946, la France pour satisfaire à ses besoins de matières
premières va décider de spécialiser chacune de ses
colonies à une culture agricole ; ainsi la Côte d'Ivoire fut
consacrée à la culture café-cacao (Aubertin, 1983).
Dès lors, seule la Basse côte fait l'objet d'investissement public
au détriment de la zone de savane. L'autorité coloniale avait
décidé d'attribuer un autre rôle à la région
Nord. C'est ainsi que bien que la France soit une grande importatrice de coton,
sa culture ne fut pas encouragée. En plus, les cultures d'exportation
secondaires le sisal, le kapok, le karité et le sésame furent
simplement abandonnées (Aubertin, 1983). À cet effet, le
développement de l'économie de plantation axé sur la
culture café-cacao dans la zone forestière a eu comme
conséquence directe la marginalisation de la région Nord de la
Côte d'Ivoire. Le développement de l'économie de plantation
conduit à la structuration du territoire ivoirien en deux grandes
régions avec des rôles distincts. La région Nord est
destinée maintenant à fournir de la main-oeuvre pour la mise en
valeur des plantations de café et de cacao. Le Nord est vu comme un
réservoir de main-d'oeuvre (Aubertin, 1983, p. 23 ; Chauveau &
Dozon, 1985, p. 66). Après, l'indépendance ce modèle de
développement économique basé sur une économie de
plantation du binôme café-cacao sera entretenu par les
autorités ivoiriennes. Même si dans les années 1974, les
autorités ivoiriennes vont initier des investissements pour
réduire le déséquilibre économique et social entre
les deux régions. La région n'a pas jusqu'à présent
amorcer de développement économique, et les infrastructures et
les usines qui couvrent son territoire comblent essentiellement son retard au
vu des statistiques équipements (Aubertin, 1983, p. 48). Avec ce
modèle de développement « économie de plantation
» concentrée sur une seule région et polarisé
à Abidjan, les disparités régionales sont alarmantes et
source de mécontentement politique et ethnique (Aubertin, 1983, p. 44).
Raison pour laquelle Pierre Chauveau et Pierre Dozon (1985, p. 65) pensent que
: « L'économie de plantation est un bon «
analyseur » de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un objet
à plusieurs entrées et plusieurs dimensions qui nous permet de
passer du local au global, de l'économie au politique, des ethnies
à l'État tout en conservant la trame d'un récit
historique. » C'est dans cette logique Mamadou Bamba et Akréli
Marcel Ossohou (2024, p. 17) affirment que : « L'identité nationale
de la Côte d'Ivoire (...) s'est largement faite autour de
l'économie de plantation. » Dans la géographie scolaire,
l'identité de la Côte d'Ivoire est étudiée à
travers les études portant sur les activités économiques
notamment agricole (économie de plantation) et touristique. « Le
développement économique est la notion centrale de la
géographie scolaire ivoirienne. » (Doba, 2021, p. 72). Dans les
manuels scolaires, l'agriculture
63
(économie de plantation) occupe une place importante
dans les études portant sur le développement économique.
Le modèle de développement économique enseigné fait
plus la promotion du café-cacao et des autres cultures de rente de la
région du Sud que de la région du Nord. À cet effet, les
cartes et les paysages utilisées par les auteurs pour enseigner
l'importance de l'agriculture dans le développement économique ou
promotion l'économie de plantation contribue à attribuer une
identité marginale à la population du Nord.
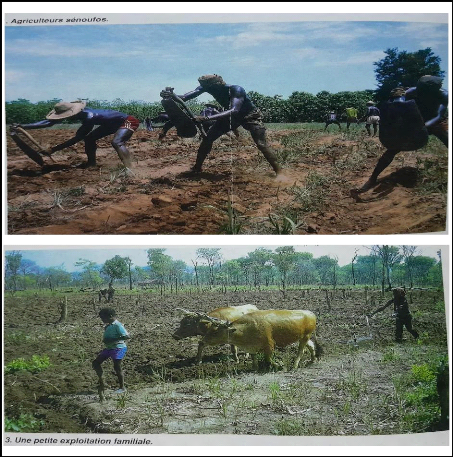
Figure 18 : extrait de la page78-80 du manuel de 3ème,
Hatier/CEDA, Hors collection
Ces images identitaires dépréciatives ou
dévalorisantes présentent les paysans du Nord exerçant une
agriculture archaïque dans des conditions pénibles, dont la
production est essentiellement destinée à la subsistance. Par
conséquent, ces iconographies effacent les paysans du Nord dans la
contribution à l'économie de plantation est qui le creuset de la
société ivoirienne. Car,
64
l'économie de plantation est un élément
central de la société ivoirienne (Chauveau & Dozon, 1985, p.
65). Dans le discours scolaire, les ethnies sont liées à un
modèle agricole et à un type de production agricole. Voilà
pourquoi la (Figure 18) affiche l'ethnie de la communauté paysanne. Par
conséquent, aux yeux des élèves, dans l'effort du
développement économique du pays, les ethnies du Nord auront une
identité dépréciative.
Par ailleurs, les paysans du Sud sont
représentés à travers des paysages identitaires
valorisants.
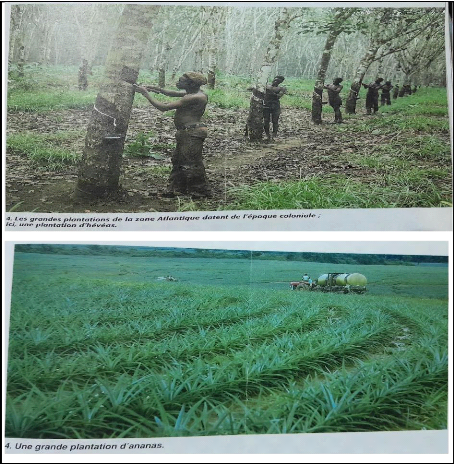
Figure 19 : extrait des pages 95 et 81 des manuels de
4ème et 3ème , Hatier/Ceda, L'Afrique et le
monde puis Hors collection
Ces images identitaires mélioratives ou valorisantes
présentent les paysans du Sud exerçant une agriculture moderne
dans des conditions satisfaisantes, dont la production est essentiellement
65
destinée à la spéculation. Ces paysages
montrent aux élèves que c'est seulement la communauté
agricole du Sud qui participe à l'effort du développement
économique de la Côte d'Ivoire. Cette mise en relief des
catégories ethniques liées à l'activité agricole
dans les manuels scolaires attribue une identité marginale aux paysans
du Nord.
Même les produits agricoles identitaires sont
illustrés différemment dans le manuel scolaire de
géographie. Le coton qui est une identité agricole des paysans du
Nord est dans un processus de régression et dévalorisant
contrairement aux cultures d'exportation (café, cacao,
hévéa...) qui sont des identités agricoles des paysans du
Sud, sont encadrées et valorisées par les auteurs. Le manuel
scolaire de géographie est un canal idéal pour les auteurs de
valoriser et de dévaloriser certaines identités agricoles
nationales. À travers ces illustrations, les auteurs affichent à
l'élève le choix du modèle de culture d'exportation de
l'État. À cet effet, les élèves vont accorder plus
de la valeur aux cultures d'exportation du Sud qui favorisent le
développement économique du pays. Par conséquent, ces
groupes ethniques seront vus comme importants aux yeux des élèves
dans l'organisation politique, sociale et économique du pays.
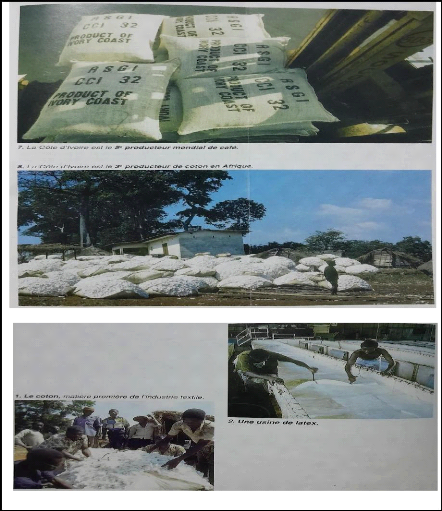
66
Figure 20 : extrait des pages 83 et 96 du manuel de
3ème, Hatier/Ceda, Hors collection, 1994
Les auteurs du manuel en associant ces identités
agricoles du Nord et du Sud décident de les comparer. Leur illustration
dans le manuel montre que l'identité agricole du Sud est
privilégiée que celle du Nord. En effet, le café est
présenté dans des sacs bien disposé sur un chariot,
prêt à être exporté. Et, le caoutchouc est
présenté en usine en état de transformation. Quant au
coton, il est illustré avec moins de considération. Il est
déposé sur des sacs à l'air libre et à même
le sol, les uns empilés sur les autres de manière
dévalorisante. Ces illustrations dévalorisantes de
l'identité agricole du Nord le « coton » ne peut pas
être le fruit du hasard. Elle pourrait contribuer à
inférioriser l'identité des paysans du Nord auprès des
élèves. Le second enjeu de
67
ces iconographies présente le coton comme la seule
culture d'exportation de la région Nord, ce qui est loin la
réalité. Dans les manuels scolaires, il y a de la manipulation
des informations au mépris de la réalité comme je l'ai
démontré un peu plus haut. Pourtant, la région du Sud est
présentée avec une diversité de produits agricoles
identitaires. Les auteurs vont faire aussi la promotion du cacao en montrant de
manière systémique le processus de transformation de la
fève de cacao jusqu'au chocolat comme indiqué sur la figure
suivante.
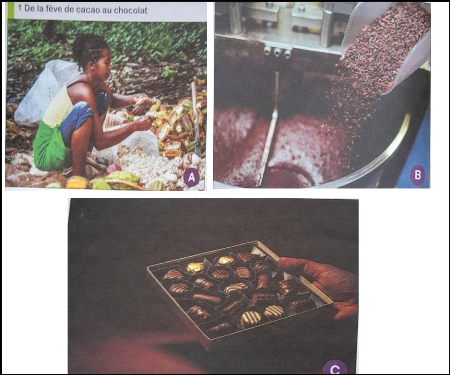
figure 21 : extrait de la page 94 du manuel de 3ème,
Vallesse, Ecole Nation et Développement, 2020
La manière de véhiculer ces identités
agricoles dans les manuels constituent des références pour
l'État et contribuent à la construction des
représentations sociales et économiques de la
société ivoirienne.
Par ailleurs, la géographie savante tout comme son
référent la géographie scolaire divise le territoire
ivoirien en deux régions naturelle, économique, sociale voire
politique (figure 22). Cette division du territoire à tendance a
attribué une identité marginale à la population de la
région Nord. Car, cette division exclue la région Nord dans le
processus du développement de l'économique du pays. La
région Nord est présentée comme dépendante de la
région Sud. Cette
68
situation renforce l'identité de la population du Sud
auprès des élèves, tandis que l'identité de la
population du Nord est marginalisée.
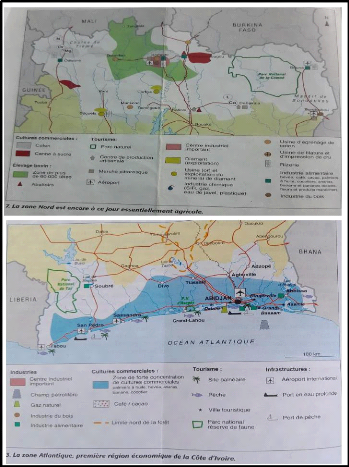
Figure 22 : extrait des pages 94-98 du manuel scolaire 4
ème, Hatier/Ceda, L'Afrique et le monde, 2002
Dans la géographie scolaire, la région Nord est
présentée comme une zone où l'agriculture est
insuffisamment modernisée avec un secteur industriel quasi inexistant.
En outre, le retard économique de la zone est imputé à des
conditions naturelles contraignantes. Comme cela est démontré
dans la leçon 2 : LE MILIEU TROPICAL IVOIRIEN de la classe de seconde.
Ces cours sont mis en ligne par le ministère de l'éducation
nationale dont les enseignants, les élèves et les parents peuvent
consulter sur
école-ci.org.
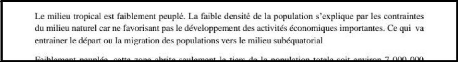
69
Encadré 1 : extrait de la leçon sur le milieu
tropical ivoirien de la classe de seconde (
ecole-ci.org)
Cette affirmation est due à l'approche
déterminisme de la géographie scolaire ivoirienne selon laquelle
le milieu naturel influence la répartition de la population. Plusieurs
leçons affirment cette approche déterminisme de la
géographie scolaire. Il est bien de rappeler qu'en Côte d'Ivoire,
seul l'ouest a un relief de montagne. Le Nord a un climat tropical sec, une
végétation de savane et un relief de haut plateau. Alors, le
rôle des facteurs naturels est très insignifiant dans le
sous-développement du Nord. Raison pour laquelle Catherine Aubertin,
(1983, p. 24) affirme que : « une région n'est pas naturellement
pauvre. Une région se structure, devient « riche » ou «
pauvre », essentiellement dans le cadre de l'évolution des rapports
socio-économiques dans lesquels elle est insérée ».
La région Nord a été insérée dans une
organisation économique qui lui est désavantagée et elle a
modifié son organisation sociale. Dans le contenu des manuels scolaires,
toute cette réalité sur la région Nord est
écartée lors de son étude économique et sociale.
Par conséquent, cela donne une identité de dépendance au
Nord vis-à-vis de la région Sud. Les gens du Nord sont
étiquetés par une identité marginale par les apprenants.
En effet, les agriculteurs du Nord sont perçus seulement comme des
producteurs d'une agriculture de subsistance et la région Nord est
présentée comme une localité naturellement pauvre. Les
paysans du Sud sont présentés avec une identité ascendante
sur les paysans du Nord. Car, la région Sud est vue en tant que la
première région économique avec un secteur agricole
puissant et un secteur industriel moderne. C'est selon cette logique que
Memaï Atfa et Rouag Abla affirment que :
« À travers les connaissances, mais aussi à
travers les opinions sur l'organisation sociale et politique d'un pays, le
manuel comporte des appels qui s'adressent à l'élève, lui
suggèrent ce qu'il faut aimer et respecter et ce qu'il faut haïr et
mépriser. Le manuel participe ainsi à la construction du
système de valeurs de l'élève. Il lui transmet des
modèles d'identification, lui trace des idéaux et l'oriente,
contribuant ainsi au renforcement de son Surmoi »
(Ansart, 1984, cité par Cromer et Hassani-Idrissi, 2011, p. 2
rapportés par Memaï & Rouag, 2017, p. 2)
Les contenus des manuels scolaires sont des canaux de la
promotion des cultures d'exportations du Sud et la diffusion de
l'idéologie de l'économie de plantation auprès des
apprenants. Les contenus des manuels sont conformes aux idées, aux
valeurs et aux normes que le pouvoir veut
70
transmettre et inculquer aux jeunes apprenants (Calindere,
2010, p. 17). La population du Sud est reconnue comme le groupe national
d'appartenance par les apprenants. Le contenu des manuels scolaires a
contribué activement à cela. L'illustration des iconographies
affiche la population Nord avec une identité marginale.
4.2. Identité exclusive de la région du Nord
dans le développement de l'activité touristique
Dès la première décennie après
l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la politique touristique s'est
affirmée à partir du plan quinquennal de développement
touristique. Alors, les autorités vont créer un Ministère
d'État du tourisme qui aura des structures techniques (SIETHO, ICTA)
pour piloter ses projets entre 1988 et 1990 (Aphing-Kouassi, 2001, p. 7;
Kouadio et al., 2019, p. 321). L'État va mettre en place deux
modèles de développement touristique : la promotion du tourisme
balnéaire dans les villes côtières (San Pédro,
Grand-Bassam et Jacqueville...) et celui du tourisme de découverte dans
les villes de l'intérieur (Degui et al., 2019, p. 284). Pour atteindre
ces objectifs dès 1992, les gouvernements successifs vont se lancer dans
plusieurs programmes de relance de l'activité touristique. Pour diffuser
sa seconde vision de développement, les autorités ivoiriennes
vont faire la promotion de l'activité touristique à travers les
manuels scolaires. Pour illustrer les connaissances sur le tourisme ivoirien
dans les manuels scolaires, les paysages identitaires sont utilisés pour
cela. Ces paysages identitaires sont polarisés sur les paysages de la
population du Sud. À cet effet, la contribution de la population Nord
est exclue dans le développement de l'activité touristique.
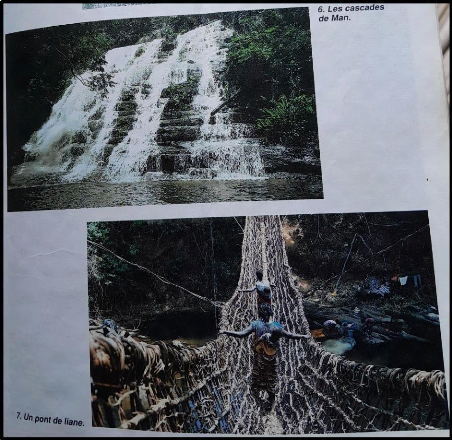
71
Figure 23 : extrait de la page 112 du manuel de
3ème, Hatier/CEDA, Hors collection, 1994
Ces paysages sont des identités culturelles des yacouba
un groupe ethnique de l'aire culturelle Mandé sud installé
à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les paysages identitaires des
populations du Nord sont invisibles dans les manuels comme des atouts
touristiques pour amorcer le développement économique. Pourtant
dans la région Nord, on peut citer le mont Korhogo, les tisserands de
waraniéné, la case aux fétiches de Niofouin, les scupteurs
du quartier Kôkô, les roches sacrées de Shien low, les
collines jumelles de Boundiali et les nombreuses mosquées centenaires
(Kong, Tengrela, Kouto, Nambira) qui sont toutes inscrites au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Aucun.e élève interviewé.e ne sait
dans quelle ville du Nord ces mosquées centenaires inscrites au
patrimoine mondial de l'UNESCO se trouvent-elles.
72
En plus, les autorités vont utiliser dans les manuels un
haut lieu historique dans la ville de Grand Bassam qui est la première
capitale de la Côte d'Ivoire, située dans la région Sud.
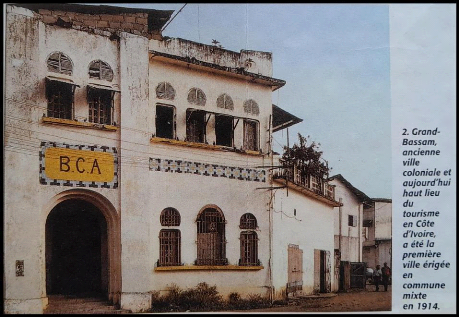
Figure 24 : extrait de la page 91 du manuel de 4ème,
Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002
Ce haut lieu bien que n'étant pas naturel, est un
paysage identitaire de la population du Sud plus particulièrement du
groupe ethnique N'zima. Ces paysages identitaires coloniaux ont permis à
la ville de Grand-Bassam d'être inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO tout comme la mosquée de Kong. Mais, celle-ci n'y figure pas
dans les manuels scolaires. Cet état de fait construit chez les
apprenants un sentiment d'exclusion et de dépendance de la population
Nord.
Par ailleurs, l'iconographie que les auteurs des manuels
doivent utiliser tel un attrait touristique de la population Nord, est
utilisée pour illustrer une activité désorganisée,
dévalorisante qui développe une économie souterraine,
c'est-à-dire une activité informelle.
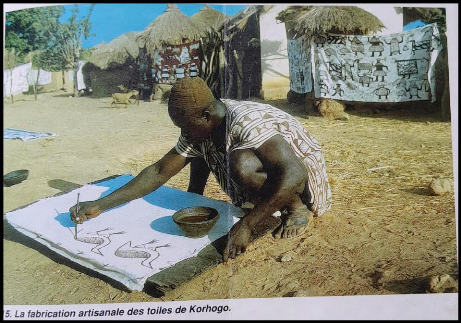
73
Figure 25 : extrait de la page 105 du manuel de 3ème,
Hatier/CEDA, Hors collection, 1994
Cette activité pittoresque de la population Nord attire
des milliers de touristes. Elle est une des identités du peuple
Sénoufo. Le Sénoufo peint son histoire sur ces toiles,
c'est-à-dire, elle retrace sa culturelle immatérielle et
matérielle. Le marché pittoresque de la région Nord est un
attrait à fort potentialité touristique. Mais, paradoxalement,
cette image est utilisée dans un contexte qui la dénude de sa
capacité touristique en la mettant dans une situation
dévalorisante. Dans ce cas, chez les élèves
l'identité de la population Nord comme activité contribue qu'au
niveau secondaire au développement de l'économie du pays. Le
contenu des manuels scolaires conditionne les élèves à
ceux qu'ils doivent aimer ou haïr, à ceux qu'ils doivent
s'identifier ou se différencier.
Même quand les auteurs décident d'utiliser un
paysage du Nord comme un attrait touristique. Le Parc National du Comoé
un paysage patrimonial est un attrait touristique. Ce paysage est
illustré de manière ambigüe comme nous pouvons le voir sur
la figure suivante.
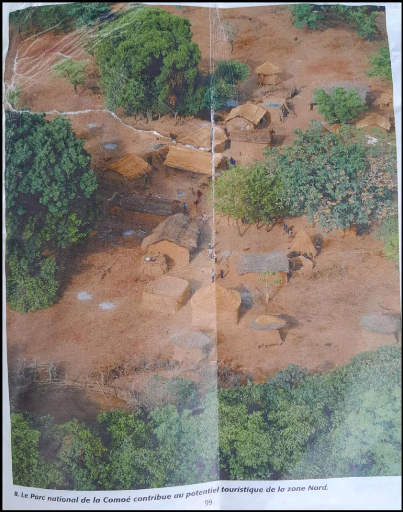
74
Figure 26 : extrait de la page 99, du manuel de 4ème,
Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002
Comment un élève peut-il percevoir la
capacité touristique d'un parc de faune et de la flore illustrer de
cette manière ?
Un parc est un espace protégé et interdit.
Bizarrement, ce parc est pris en image avec presqu'un village à
l'intérieur. En outre, la capacité touristique d'un parc s'est
les espèces animales et végétales que ce parc abrite,
pourtant ce parc est utilisé dans les manuels sans aucune espèce
animale. Ce paysage du parc de la Comoé illustré dans les manuels
scolaires lui faire perdre sa valeur touristique aux yeux des
élèves.
75
II. IDENTITÉ ET TERRITOIRE : SUPPORTS D'ENSEIGNEMENT
ET PERCEPTION DES ÉLÈVES
1. Les mots liés à l'identité et au
territoire dans les manuels scolaires
1.1. Les mots liés à l'identité dans
les manuels scolaires
|
Classes
|
Mots
|
Thématiques abordés
|
|
Dans la leçon
|
Dans le lexique
|
|
5ème
|
Diversité religieuse
|
Apartheid ; Cosmopolite ; créole ; discrimination
(raciale) ;
ethnocide ; ghetto ;
linguistique ; Lusophone ; pagode ;
ségrégation ; Hispanophone
|
-L'Afrique -L'Amérique -L'Asie
|
|
4ème
|
|
Nationalité ;
|
-L'Europe
-L'Afrique de l'ouest
|
|
3ème
|
Groupes ethniques ; aire
culturelle ; étrangers ;
économie de la Côte
d'Ivoire ;
La savane dans le nord ; la forêt dans le sud,
|
Autochtones ; fellah
|
-L'Afrique
-La Côte d'Ivoire -Le Nigéria
-L'Afrique du Sud
|
Tableau 14 : Les mots liés à l'identité
dans la collection Hors collection
C'est ici que la question de l'identité religieuse est
traitée. Et, elle est traitée au niveau continental et la
Côte d'Ivoire a été désignée comme un pays
catholique. Et, c'est la seule fois que l'identité religieuse fut
traitée dans les manuels scolaires. En classe de 3ème,
l'identité ethnique est traitée. Les cinq aires culturelles sont
identifiées sur une carte, les principales ethnies sont
identifiées. Quant à l'économie du pays qui est
identifiée par les auteurs comme
76
l'identité du pays. Elle est identifiée sur les
paysages identitaires dans les cours portant sur l'économie du pays.
|
Classes
|
Mots
|
Thématiques abordés
|
|
Dans la leçon
|
Dans le lexique
|
|
5ème
|
Ethnies ; étrangers ; les
régions du Sud ; les
régions du nord
|
Autochtones ; ethnie Lusophone ; lagune
|
-La Côte d'Ivoire -L'Afrique de l'Ouest
|
|
4ème
|
Territoriale (régionale) ;
régions économiques
|
|
-Géographie régionale de la Côte d'Ivoire
-Les ensembles régionaux et les regroupements à
caractère économique
|
|
3ème
|
Age ; économie du pays
|
Nationalité
|
-La Côte d'Ivoire : étude
économique
-L'économie des pays
développés
-Un exemple de coopération Nord-Sud
|
Tableau 15 : Les mots liés à l'identité
dans la collection L'Afrique et le Monde
Dans cette collection, l'identité ethnique est
traitée. C'est dans ce cadre que le terme autochtone est
évoqué dans le lexique.
L'identité territoriale (régionale) est
évoquée dans le cadre du découpage administratif. En
effet, les différentes régions portent les noms des hauts lieux
(la région du Tonkpi (montagne)) ; de fleuve (la région du
Cavally) ; des masques (la région du Poro et la région du
Tchologo).
77
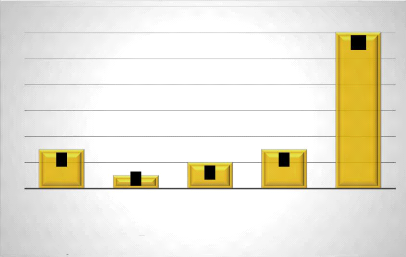
IDENTITÉ
GÉOGRAPHIQUE
3
IDENTITÉ RELIGIEUSE
1
IDENTITÉ ETHNIQUE
2
IDENTITÉ RÉGIONALE
3
IDENTITÉ AGRICOLE
12
78
Classes
|
Mots
|
Thématiques abordés
|
|
Dans la leçon
|
Dans le lexique
|
|
5ème
|
La région de savane ; la région de forêt
|
Catégorie(ou classe) d'âge
|
-L'homme et son milieu en Côte d'Ivoire
-Les conséquences des
activités économiques sur
l'environnement
|
|
4ème
|
Territoriale (régionale),
les présidents de la
république
|
République
|
-L'organisation
administrative dans le
développement de la Côte
d'Ivoire
-Les regroupements
économiques en Afrique de
l'ouest et en Europe :
Exemples de la CEDEAO et de l'UE
|
|
3ème
|
La population ; économie du pays
|
|
Étude économique de la Côte d'Ivoire
-L'Afrique face à la
mondialisation
|
Tableau 16 : Les mots liés à l'identité
dans la collection Ecole, Nation et Développement
Comme dans les manuels précédents,
l'identité du pays qui est identifiable à travers les
études sur l'économie de la Côte d'Ivoire, ainsi que,
l'identité régionale dans le cadre du découpage
administratif du territoire. Dans cette collection, la question de
l'identité ethnique est confiée au binôme de la
géographie scolaire qui l'histoire.
Dans les différentes collections, la notion
d'identité n'a pas été évoquée ni au cours
des leçons ni dans le lexique. Le seul mot qui est relié
directement à l'identité et mentionné dans les
leçons et aussi dans le lexique est l'ethnie. La seule identité
traitée dans les manuels scolaires de la géographie est
l'identité territoriale ethnie.
Par ailleurs, la figure suivante donne la part de chaque type
d'identité identifié dans les différentes collections.
Graphique 2 : Diagramme de la part de chaque type
d'identité identifié dans les manuels
Comme indiqué, l'identité agricole du pays qui
est pris comme l'économie du pays est le plus évoquée dans
les manuels scolaires. La plupart des iconographies identitaires sont
associées à des leçons traitant l'économie du
pays.
L'identité géographique se rapporte aux
leçons sur le milieu physique ivoirien où celle-ci, est
scindée en deux régions géographiques (ou deux
régions naturelles) quant à l'identité territoriale
(régionale), il relève des leçons sur l'organisation
administrative sur du territoire national. Le nom des 31 régions de la
Côte d'Ivoire est donné en fonction des référents
géographiques identitaires de chaque région.
Ensuite, l'identité ethnique est la seule à
être évoquée explicitement dans les manuels scolaires. Elle
est traitée dans les leçons portant sur la population ivoirienne.
La population ivoirienne est composée de plus de 60 ethnies et les
foyers de peuplement des quatre groupes ethniques sont
précisés.
Enfin, pour ce qui concerne l'identité religieuse, elle
n'a jamais été traitée dans une leçon portant
directement sur la Côte d'Ivoire. Elle a été plutôt
dans une leçon sur la population africaine. Ainsi, la Côte
d'Ivoire est imagée comme un pays catholique à travers
l'iconographie de la Basilique notre Dame de Yamoussoukro.
79
1.2. Les mots liés au territoire dans les manuels
scolaires
|
Classes
|
Mots
|
Thématiques abordés
|
|
Dans la leçon
|
Dans le lexique
|
|
5ème
|
|
|
-L'Afrique -L'Amérique -L'Asie
|
|
4ème
|
|
Agglomération, Conurbation, décentraliser,
enclavement ; Etat-
providence ; milieu
de vie ; NPI ;
rurbanisation ; urbanisation
|
-L'Europe
-L'Afrique de l'ouest
|
|
3ème
|
Milieu, urbanisation, ville
|
Aménagement du
territoire ; plan
directeur
|
-L'Afrique
-La Côte d'Ivoire -Le Nigéria
-L'Afrique du Sud
|
Tableau 17 : Les mots liés au territoire dans la
collection Hors collection
Dans cette collection « Hors collection », le
concept territoire n'est pas mentionné directement ni dans les
leçons, ni dans le lexique. Cependant, dans le lexique de la classe de
3ème, la notion d'aménagement est liée au
territoire. Où, l'État conçoit des plans directeurs pour
maîtriser la croissance des villes. On a un État qui est le seul
aménageur territorial. Ici, L'approche du territoire est une ville.
Par ailleurs, le milieu est un territoire « cadre vie
» délimité par des caractéristiques physiques.
80
Classes
|
Mots
|
Thématiques abordés
|
|
Dans la leçon
|
Dans le lexique
|
|
5ème
|
Milieu, pays,
urbanisation, villes, aire culturelle
|
Agglomération ; citadin ;
enclavement ;
immigration ; plan
directeur ;
urbanisation
|
-La Côte d'Ivoire -L'Afrique de l'Ouest
|
|
4ème
|
Région ; pays ;
préfectures, sous-
préfectures,
départements ; villages ;
districts, commune
|
|
-Géographie régionale de la Côte d'Ivoire
-Les ensembles régionaux et les regroupements à
caractère économique
|
|
3ème
|
Urbanisation ; pays ;
ville ; ressources
naturelles, environnement
|
Agglomération ; conurbation ; décentraliser ;
enclavement ;
mégalopole ; Etat-
providence ; NPI ;
rurbanisation ; urbanisation
|
-La Côte d'Ivoire : étude
économique
-L'économie des pays
développés
-Un exemple de coopération Nord-Sud
|
Tableau 18 : Les mots liés au territoire dans la
collection L'Afrique et le Monde
Comme évoqué précédemment, les
principales ethnies de la Côte d'Ivoire sont évoquées et
l'espace culturel (aire culturelle) des cinq grands groupes de peuples sont
identifiés.
Les ressources naturelles sont des atouts naturels que sont
les sols, le relief, la végétation, les climats, l'hydrographie
et le sous-sol qui dont l'exploitation engendre des activités
économiques. L'environnement est considéré comme un
élément de ressource. Le territoire ivoirien est divisé en
districts, région, préfectures, sous-préfectures,
départements, villages (dans le cadre de la déconcentration) et
aussi en communes et en départements (dans le cadre de la
décentralisation). Dans la géographie scolaire ivoirienne, «
l'étude du territoire privilégie la gestion administrative des
territoires » (Doba, 2021, p. 72). Par ailleurs, un fait nouveau est que
l'État n'est pas le seul acteur de l'aménagement du territoire
maintenant, il y a aussi la commune et le département.
81
Classes
|
Mots
|
Thématiques abordés
|
|
Dans la leçon
|
Dans le lexique
|
|
5ème
|
Milieu physique ; pays ;
ressources en eau ;
environnement ;
aménagement du
territoire
|
Disparités régionales
|
-L'homme et son milieu en Côte d'Ivoire
-Les conséquences des
activités économiques sur
l'environnement
|
|
4ème
|
Les circonscriptions
administratives ; les
collectivités territoriales ;
|
Centralisation administration ; chef du village ; chef-lieu de
district ; de région
ou de sous-
préfecture ; décentralisation
administrative ; disparités
régionales ; Préfet ;
Sous-préfet
|
-L'organisation
administrative dans le
développement de la Côte
d'Ivoire
-Les regroupements
économiques en Afrique de
l'ouest et en Europe :
Exemples de la CEDEAO et de l'UE
|
|
3ème
|
Les atouts naturels (le
milieu physique ;
ressources du sous-sol)
|
|
-Étude économique de la Côte d'Ivoire
-L'Afrique face à la
mondialisation
|
Tableau 19 : Les mots liés au territoire dans la
collection Ecole, Nation et Développement
En 5ème, dans la géographie scolaire
ivoirienne, les ressources naturelles influencent l'installation des
populations. La géographie scolaire ivoirienne a un discours
déterministe. C'est dans cette même logique Armand Emmanuel
Bohoussou (2023, p. 50) dit que : « La géographie scolaire
ivoirienne est dominée par le concept de milieu géographique.
» Elle s'intéresse aussi à l'impact des activités
humaines sur le milieu. On peut dire que : « L'étude du milieu
naturel occupe une bonne place dans les programmes scolaires, cette
étude est toujours couplée à celle des activités
économiques » (Doba, 2021, p. 73). Par ailleurs, en plus, de
l'État et de la commune, il y a aussi la région comme acteur
d'aménageur.
82
In fine, dans les manuels scolaires étudiées,
les notions de l'identité et de l'identité territoriale sont
absentes. Quant à la notion de territoire, il est mentionné dans
les programmes et les manuels scolaires dans le cadre de l'aménagement
du territoire. Cependant, dans les manuels, il est étudié sur le
plan national comme un pays, un district, une région, une commune, une
préfecture, une sous-préfecture et un village. Certes, le concept
de ressource territoriale est aussi absent mais la notion de ressource est
présente dans les manuels scolaires. Dans la géographie scolaire
ivoirienne, la notion du territoire est étroitement liée à
l'aménagement du territoire qui se fait au niveau national par
(l'État) et local par la (région, commune) pour réduire
les disparités régionales ou permettre le développement
économique et social des régions. Le territoire est abordé
comme un espace politico-administratif sous la gestion d'une autorité
politique. Comme l'affirme Armand Emmanuel Bohoussou (2023, p. 49) :
« La présence du terme territoire dans les
programmes ne fait pas référence au concept territoire de la
géographie. Le territoire est utilisé ici pour désigner
une portion de l'espace terrestre, une entité administrative et
politique faisant souvent référence à la région
dont on décrit les acteurs politiques sans indiquer leurs actions
spatiales. »
2. La connaissance ethnoculturelle des
élèves
2.1. La religion la plus pratiquée en Côte
d'Ivoire selon les élèves De manière
générale, tous les élèves reconnaissent qu'il y a
une diversité religieuse en Côte
d'Ivoire. Leur divergence intervient dans le cadre de celle qui
est la plus pratiquée.
|
Religion Classes
|
Christianisme
|
Islam
|
Animiste
|
I.-C.
|
I.- A.
|
C.-A.
|
A.-C.-I.
|
|
4ème 2
|
11
|
6
|
2
|
7
|
1
|
2
|
1
|
|
4ème 1
|
17
|
10
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
3ème 1
|
14
|
10
|
4
|
1
|
|
|
1
|
|
3ème 2
|
20
|
1
|
9
|
|
|
|
|
|
Total
|
62
|
27
|
15
|
9
|
2
|
3
|
2
|
Tableau 20 : Les religions les plus pratiquées en
Côte d'Ivoire selon les élèves
En classe de 4ème2, 11 élèves
pensent que le christianisme est la religion la plus pratiquée en
Côte d'Ivoire, contre 6 élèves pour l'Islam, 2
élèves pour animiste, 7 élèves pour
(Islam-Christianisme), 1 élève pour (Islam-Animiste), 2
élèves (Christianisme-Animiste) et 1 élève pour les
trois religions.
83
En classe de 4ème 1, 17 élèves
positionnent le christianisme en premier, pour 10 élèves c'est
l'islam et un élève pense que c'est respectivement soit
(Islam-Christianisme ; Islam-Animiste ; Christianisme-Animiste).
En classe de 3ème 1, 14 élèves
voient le christianisme comme la première religion, tandis que 10
élèves pensent que c'est l'islam. L'animiste est
considérée comme la première selon 03 élèves
puis l'islam-christianisme et l'islam-christianisme-animiste sont premiers
selon chacun 01 élève.
Pour 20 élèves de la classe de
3ème 2, la première religion est le christianisme, 20
élèves choisissent l'islam comme la première religion et
un élève positionne l'animiste en tête.
Ainsi, dans toutes les classes qui ont fait l'objet
d'enquête, les élèves considèrent le christianisme
comme la religion la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. Cela donne
le graphique suivant :
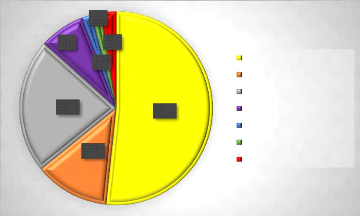
22%
7%
12%
2%
2%
3%
52%
Christianisme Animiste
Islam
Islam-Christianisme Islam-Animiste Islam-Chrsitianisme-Animiste
Christianisme-Animiste
Graphique 3 : Proportion des religions pratiquées en
Côte d'Ivoire selon les élèves
Parmi les 120 élèves questionnés, 52%
pensent que la religion chrétienne est la plus pratiquée en
Côte d'Ivoire. Selon l'élève Kouadio Grâce en classe
de 3ème 2 c'est parce que la plupart des Ivoiriens sont des
chrétiens (entretien réalisé le 10 février 2025).
Un autre élève ajoute aussi que : « Monsieur parce qu'en
Côte d'Ivoire, il y a plusieurs chrétiens. Mais, où as-tu
appris cela ? À l'église » (Entretien avec
l'élève Péhé Franck, en 4ème 1).
Quant à Nikiema Sanata, elle affirme que : « Parce que non
seulement moi-même, je suis chrétien aussi. Donc, je suppose que
et puis il y a beaucoup d'églises où je vais il y a les
chrétiens. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, l'Islam est aussi
pratiqué. Mais le christianisme est plus pratiqué en Côte
d'Ivoire que l'Islam.
84
C'est parce que moi-même je fais partir du christianisme
aussi. » (Entretien réalisé le 11 février 2025).
Selon ces élèves d'ethnies Baoulé et Guéré,
le christianisme est la religion la plus pratiquée. Car pour eux les
Ivoiriens sont des chrétiens. Vu qu'eux-mêmes, ils sont des
Ivoiriens et chrétiens.
Pour Ouattara Djié Sali, l'élève en
classe de 4ème 2, elle pense que le christianisme est le plus
pratiqué. Parce que les chrétiens sont nombreux en Côte
d'Ivoire que les musulmans. J'ai regardé juste à la
télévision (Entretien réalisé le 14 février
2025). Cette élève est influencée par la grande place
qu'occupe la religion chrétienne dans les médias depuis
l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comme le disait Thierry Roy
(2008, p. 18) : « Les médias publics semblaient vouloir suivre
cette volonté en accentuant la couverture des fêtes catholiques et
en minimisant l'importance des fêtes musulmanes. » Dami Pohema,
l'élève en classe de 3ème 1 qui me
répond en ces termes : « Monsieur parce que dans la plutard des
villes où je suis parti. Il y avait beaucoup d'églises. Et puis
c'était le christianisme qui était le plus pratiqué »
(Entretien réalisé le 14 février 2025). Elle est
influencée par le discours spatial notamment par les politiques. En
Côte d'Ivoire, les idéologies spatiales ont accordé une
place importance à la religion chrétienne. Cette
élève a été influencée par la basilique dans
le paysage ivoirien.
Sur les 120 élèves enquêtés, c'est
seulement 22% d'élèves qui ont répondu que l'islam est la
religion la plus pratiquée en Côte d'Ivoire. Les
élèves sont influencés par les privilèges tant
spatiaux, médiatiques et au niveau scolaire accordés aux
élèves. Depuis l'indépendance, les autorités
politiques vont calquer le calendrier scolaire du colonisateur. Ainsi, les
élèves voient qu'à l'occasion des fêtes religieuses
chrétiennes, ils sont en congés. Contrairement, avec la religion
musulmane où c'est le jour de la fête qui est
désigné jour férié. Il faut attendre des
années de revendication pour voir des événements majeurs
comme « la nuit du destin » être considérés comme
jour férié en islam. Quant à la religion animiste, 12% des
élèves ont considéré cette religion comme la plus
pratiquée. Malgré la place qu'occupe la religion
chrétienne et la religion musulmane, la religion animiste demeure dans
le paysage ivoirien. Même si elle n'est pas sous les projecteurs.
85
2.2. La perception des ethnies chez les
élèves
J'ai demandé aux élèves
enquêtés de me citer 04 ethnies de la Côte d'Ivoire. Leurs
différentes réponses ont été prescrites dans le
tableau suivant :
|
04 ethnies
du Sud
uniquement
|
02
ethnies du Nord et du Sud
|
03
ethnies du Sud et 01 ethnie Nord
|
02 ethnies du Sud
et 01
Nord
|
02 ethnies
du Sud
uniquement
|
03 ethnies
Sud
uniquement
|
Rien dit
|
|
4ème 1
|
10
|
4
|
13
|
|
|
|
3
|
|
4ème 2
|
15
|
00
|
7
|
|
|
|
8
|
|
3ème 1
|
11
|
6
|
7
|
1
|
2
|
|
3
|
|
3ème 2
|
8
|
1
|
11
|
1
|
1
|
4
|
4
|
|
total
|
44
|
11
|
38
|
2
|
3
|
4
|
18
|
Tableau 21 : La perception des ethnies en fonction des
régions géographiques selon les élèves
Sur les 120 élèves interrogés, 44
élèves ont cité uniquement que 4 ethnies originaires du
Sud. 11 élèves ont cité respectivement 2 ethnies
originaires et du Sud. 03 ethnies du Sud et 01 ethnie du Nord ont
été cités par 38 élèves. 02
élèves seulement ont évoqué le nom de 2 ethnies du
Sud et 1 ethnie du Nord. 03 élèves ont mentionné
uniquement que 2 ethnies du Sud. 04 élèves ont
évoqué 03 ethnies originaires du Sud uniquement et 18
élèves n'ont rien cité. Il ressort de ces
résultats, qu'aucun élève n'a cité uniquement 04
ethnies originaires du Nord comme cela a été le cas avec les
ethnies originaires du Sud. En outre, aucun élève n'a
évoqué plus de 02 ethnies originaires du Nord. À cet
effet, les ethnies du Sud sont largement évoquées par les
élèves. Comme cela est illustré dans le graphique suivant
:
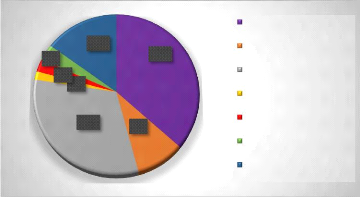
3%
2%
2%
32%
15%
02 ethnies du Sud
9% uniquement
03 ethnies Sud uniquement
37%
04 ethnies du Sud uniquement
02 ethnies du Nord et du Sud
03 ethnies du Sud et 01 ethnie Nord
02 ethnies du Sud et 01 Nord
Rien
86
Graphique 4 : Diagramme de la part des ethnies en fonction
des zones géographiques selon les élèves
37%, 3% et 2% d'élèves ont évoqué
respectivement 04 ethnies originaires uniquement du Sud, 03 ethnies originaires
uniquement du Sud et 02 ethnies originaires uniquement du Sud.
32%, 9% et 2% d'élèves ont cité
respectivement (03 ethnies du Sud et 01 ethnie du Nord), (02 ethnies du Sud et
02 ethnies du Nord) et (02 ethnies du Sud et 01 ethnies du Nord). 15% des
élèves n'ont rien cité comme ethnie. Ce qui donne 63,5%
d'élèves qui ont cité des ethnies originaires du Sud
contre 21,5% d'élèves qui ont évoqué des ethnies
originaires du Nord. Cela est matérialisé sur la figure suivante
:
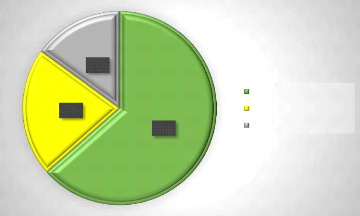
22%
15%
63%
Ethnies originaires du Sud Ethnies originaires du Nord Rien
Graphique 5 : Diagramme de la part des ethnies originaires
du Sud et du Nord cité par les élèves
Les élèves ont une meilleure connaissance des
ethnies de la zone forestière que celle de la zone de savane. En plus,
le Baoulé est l'ethnie le plus évoquée par les
élèves. En ce qui concerne, les ethnies originaires du Nord, les
élèves ont évoqué essentiellement le Dioula et le
Sénoufo.
87
3. La perception territoriale des élèves
L'économie de plantation est au coeur de la
compréhension de la société ivoirienne. Cette
économie de plantation va créer des disparités sociales,
économiques et spatiales en Côte d'Ivoire.
3.1. La connaissance des cultures agricoles commerciales de
la région du Nord et du Sud chez les élèves
J'ai demandé aux élèves de citer 02 cultures
agricoles commerciales dans la zone du Nord et aussi dans la zone du Sud. Leurs
différentes réponses sont consignées dans le tableau
ci-dessous :
|
Cultures de rente
Classes
|
02
Cultures Sud
|
02
cultures Nord
|
01
culture Sud
|
01
culture Nord
|
Je ne sais pas culture Nord
|
Je ne sais pas culture Sud
|
|
4ème 1
|
12
|
6,5
|
2
|
5,5
|
2
|
3
|
|
4ème 2
|
11
|
6
|
1
|
5
|
4
|
2
|
|
3ème 1
|
13,5
|
87,5
|
00
|
4
|
2
|
1
|
|
3ème 2
|
12,5
|
9
|
3,5
|
4
|
2
|
00
|
|
Total
|
49
|
30
|
6,5
|
18,5
|
10
|
6
|
Tableau 22 : Deux cultures de rente en fonction des
régions économiques selon les élèves
49 élèves et 30 élèves ont
respectivement cité 02 cultures Sud et 02 cultures Nord. Tandis que, 6,5
élèves et 18,5 élèves ont évoqué
à l'égard de chacune 01 culture Sud et 01 culture Nord.
Cependant, 16 élèves n'ont rien cité comme culture de la
zone Sud ni de la zone Nord. Ce qui donne comme figure :
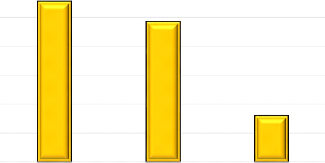
55,5
48,5
16
Cultures Sud Cultures Nord Non déterminée
60 50 40 30 20 10
0
88
Graphique 6 : Le poids des cultures de rente en fonction des
régions Nord et Sud citées par les élèves
La figure montre que 55,5 élèves ont cité
des cultures d'exportation de la zone forestière. Et, 49,5
élèves ont évoqué des cultures d'exportation de la
zone savanicole. Puis, 16 élèves n'ont évoqué ni
les cultures d'exportation de la région Sud et Nord.
Par ailleurs, les élèves ont
évoqué comme culture d'exportation du Sud : le café, le
cacao et l'hévéa souvent aussi le palmier à l'huile et la
noix de coco. Pour les cultures d'exportation du Nord, ils ont essentiellement
mentionné le coton et la canne à sucre parfois aussi l'anacarde.
De manière générale, il y a eu une diversité de
culture commerciale du sud citées par les élèves d'une
part et d'autre part, ils ont aussi cité plus de cultures commerciales
provenant de la zone forestière. En effet, les apprenants ont une
meilleure connaissance des éléments de la zone
forestière.
89
3.2. La connaissance des villes de la région du Nord
et du Sud de la Côte d'Ivoire chez les élèves
Il a été demandé aux apprenants de citer
02 villes de la région du Nord et 02 villes de la région du Sud.
Ainsi, les réponses des élèves ont été
consignées dans le tableau ci-dessous.
|
Région du Nord
|
Région du Sud
|
|
02 villes
|
01 ville
|
ND
|
02 villes
|
01 ville
|
ND
|
|
4ème 1
|
2,5
|
6
|
7
|
13,5
|
1
|
0
|
|
4ème 2
|
5
|
7,5
|
2,5
|
14
|
0,5
|
0,5
|
|
3ème 1
|
3,5
|
4
|
7,5
|
14
|
0,5
|
0,5
|
|
3ème 2
|
2,5
|
7
|
5,5
|
14,5
|
0,5
|
00
|
|
Total
|
13,5
|
24,5
|
22,5
|
56
|
2,5
|
1
|
Tableau 23 : Le nombre des villes de la région du Nord
et du Sud cité par les élèves
Dans la région du Nord : 13,5 élèves ont pu
citer correctement 2 villes du Nord. 24,5 élèves ont pu citer
qu'une seule ville du Nord et 22,5 élèves n'ont pas
répondu à la question.
Dans la région du Sud : 56 apprenants ont cité
d'une manière correcte 2 villes du Sud. C'est seulement 2,5
élèves qui ont cité qu'une ville du Sud et un
élève n'a pas répondu à la question.
Le graphique suivant met cela en exergue :
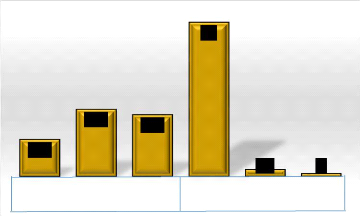
02 villes 01 ville ND
13,5
Région du Nord
24,5
22,5
02 villes 01 ville ND
56
Région du Sud
2,5
1
90
Graphique 7 : Poids des villes de la région du Nord et
du Sud selon les élèves
Le graphique montre que les élèves connaissent
plus les villes du Sud que celle du Nord. En effet, ils ont été
nombreux à citer deux villes du Sud. Quant aux villes du Nord, les
élèves ont été plutôt nombreux à citer
qu'une seule ville du Nord. Par ailleurs, les élèves
considèrent dans la région du Nord, la ville de Korhogo seulement
comme une ville importante en Côte d'Ivoire. Quant aux régions du
Sud, pour eux, toutes les villes de la région du Sud sont importantes.
Car les élèves vont citer les villes à faible
démographie de la région du Sud comme des villes importantes en
Côte d'Ivoire, en occultant les villes « chefs-lieux de
région » de la zone du Nord qui ont une démographie
importante que certaines villes de la zone du Sud
énumérées par les élèves.
91
CONCLUSION GÉNÉRALE
À l'issu de mon travail de recherche, il y a lieu de
retenir que deux hypothèses ont fait l'objet de vérification.
Ainsi, il a fallu faire des analyses de manuel scolaire afin de collecter les
informations susceptibles de confirmer ou infirmer la première
hypothèse émise d'une part et d'autre part, j'ai mené des
enquêtes de terrain auprès des élèves pour pourvoir
vérifier la deuxième hypothèse. À cet effet, je
vous soumets les résultats obtenus au terme de mon étude.
Première hypothèse de recherche : le
concept d'identité dans les manuels scolaires a de multiples facettes
parce que dans les manuels scolaires l'identité n'est pas que
territoriale. Elle est aussi polarisée.
Dans l'analyse du manuel, j'ai constaté que des
édifices religieux comme la Basilique notre Dame de Yamoussoukro et la
Cathédrale Saint Paul d'Abidjan ont été
évoquées dans plusieurs collections de manuel comme des atouts
touristiques sur les leçons portant sur la Côte d'Ivoire d'une
part et d'autre part, cette même Basilique notre Dame de Yamoussoukro est
prise pour désigner la Côte d'Ivoire un pays Catholique dans une
autre leçon cette fois-ci portant sur l'Afrique. En vrai, la Côte
d'Ivoire n'est pas un pays Chrétien encore moins catholique. Cela montre
que les auteurs ont une volonté de présenter la Côte
d'Ivoire, un pays catholique.
Sinon, bien que la Basilique ait une capacité
touristique, sa fonction première est religieuse et c'est ce qui est
mise en avant officieusement. Raison pour laquelle des mosquées
centenaires avec leur architecture qui date de l'époque soudanaise et
inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO ni figurent pas dans les manuels.
Pourtant, elles ont aussi des capacités touristiques aussi bien que la
Basilique.
Par ailleurs, l'analyse des manuels scolaires a
démontré que l'identité du pays est
véhiculée à travers les études portant sur le
développement des activités économiques du pays.
L'identité du pays sera polarisée sur les identités de la
population forestière. Ainsi, l'analyse des manuels a permis de voir que
l'étude de l'économie de plantation renforce l'identité de
la population de la région forestière. Cette étude va
faire une promotion valorisante des planteurs du Sud à travers des
paysages identitaires agricoles et de leurs produits agricoles identitaires. De
ce fait, l'identité de la population de la région savanicole va
être marginalisée dans l'étude du développement de
l'économie de plantation.
Depuis la période coloniale, la Côte d'Ivoire a
été spécialisée dans la culture du
café-cacao. Ainsi, son économie sera basée sur la culture
du café-cacao. Voilà pourquoi, les planteurs du
92
café-cacao et les produits café-cacao sont assez
valorisés dans les manuels scolaires, c'est-à-dire leur
identité.
Pourtant, dans la région savanicole, il y a aussi des
cultures d'exportation ou de rente que sont le coton, le karité,
l'anacarde, la mangue et la canne à sucre.
En outre, l'analyse des manuels scolaires a permis aussi de
voir que dans les études menées sur le développement de
l'activité touristique, seuls les paysages identitaires de la population
de la zone forestière sont utilisés comme des atouts
touristiques. De ce fait, les paysages identitaires de la population de la
région savanicole vont être purement et simplement exclus. Et,
cela a constitué à donner une identité d'exclusion
à la population du Nord dans le développement économique
touristique de la Côte d'Ivoire. Pourtant, dans cette région du
nord, on peut citer les tisserands de Kanguélé et de
waraniéné, les vestiges de la maison de Samory
Touré, la case aux fétiches de Niofouin, les vanniers de
Torgokaha, les roches sacrées de Shien Low et de Gbadjoudouo puis la
mosquée séculaire de Kong bâtie en 1741 qui est la plus
vieille mosquée de la Côte d'Ivoire, inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Une véritable promotion des produits agricoles
identitaires, des agriculteurs et des paysages identitaires du Nord dans les
manuels permettrait d'intégrer l'identité de la population de la
région du Nord dans le développement des activités
économiques de la Côte d'Ivoire.
Deuxième hypothèse : Les
élèves ont une meilleure perception des paysages de la
région forestière contrairement à la région
savanicole de la Côte d'Ivoire à cause de la manière dont
le concept d'identité est enseigné dans les manuels scolaires de
géographie et des facteurs sociopolitiques.
Les ethnies de la région forestière
(région du Sud) sont les premières a embrassé la religion
chrétienne. Car elles sont les premières à entrer en
contact avec les européens. Voilà pourquoi, l'idéologie
spatiale de la région forestière est fortement marquée par
les symboles religieux catholiques. L'autorité politique a fait
bénéficier notamment la religion catholique de tous les
privilèges comme si elle était la religion officielle.
Les élèves considèrent le christianisme
originaire de la région forestière comme la religion la plus
pratiquée en Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai demandé aux
élèves de citer quatre (04) ethnies de la Côte d'Ivoire,
ils ont cité plus d'ethnies originaires de la région
forestière. Ce qui est marquant, c'est que 44 élèves ont
cité uniquement que les ethnies de la région Sud et aucun
élève n'a cité plus de deux (02) ethnies originaires de la
région du Nord.
93
Par ailleurs, l'économie de la Côte d'Ivoire est
basée essentiellement sur l'agriculture. Cette économie est
désignée comme l'identité du pays. Alors, j'ai
demandé aux élèves de citer respectivement (02) cultures
agricoles commerciales de la région du Nord et du Sud. Plus
d'élèves ont cité les cultures commerciales de la
région forestière que ceux de la région de Savane. En
outre, lorsque j'ai demandé aux élèves de citer deux (02)
villes de la région du Sud et de la région du Nord. Là
également, ils ont davantage évoqué plus les villes du
Sud.
Il ressort que mes élèves enquêtés
ont une meilleure connaissance de la région du Sud que celle de la
région du Nord.
Par ailleurs, cette étude a été
réalisée avec des élèves qui vivent en milieu rural
(dans une sous-préfecture) d'une part et d'autre dans une
localité située à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Si le
même questionnaire était adressé à des
élèves vivants en milieu urbain puis au Nord, à l'Est ou
au Sud de la Côte d'Ivoire probablement on aurait eu des réponses
différentes à certaines questions. Car, les élèves
en Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes réalités en
fonction du milieu et de la localisation géographique.
En Côte d'Ivoire, l'éducation aux territoires
n'est pas réellement entrée dans les programmes scolaires. Dans
la géographie scolaire, la notion de territoire n'est pas
étudiée de manière holistique. Certaines dimensions
indissociables de la notion du territoire telle celle de l'identité ne
sont pas encore prises en compte par la géographie scolaire. La faible
intégration des savoirs de la géographie des territoires dans la
géographie scolaire ivoirienne résulte de la volonté
politique des autorités. Le concept d'identité est une question
socialement vive dans la société ivoirienne. De ce fait, les
autorités vont décider d'occulter de manière
générale le concept d'identité dans les manuels.
Cependant, pour une meilleure intégration de la notion
du territoire dans la géographie scolaire, il va falloir étudier
le territoire comme cadre de vie, lieu de pouvoir et lieu des rapports sociaux
d'appropriation comme indiqués par (Girault & Barthes, 2016). Cela
permettra de ne pas aborder le territoire uniquement dans une approche
politico-administrative comme c'est le cas actuellement dans la
géographie scolaire ivoirienne. Dans ce cas, la notion du territoire
sera prise dans toutes ses acceptations possibles (ressource et
identité) dans la géographie scolaire. Car, en plus de la
transmission du savoir, l'éducation aux territoires va amener les
apprenants à devenir des citoyens responsables, capables de faire face
aux questions identitaires que se posent la société tous les
jours. En Côte d'Ivoire, l'identité est liée aux conflits
d'ordre politiques, ethniques et économiques et est objet de
manipulation et de propagande. Pour ce
94
faire, son introduction dans le programme scolaire exige de la
neutralité dans le contenu des manuels scolaires. Les autorités
éducatives ivoiriennes doivent introduire aussi dans les manuels des
édifices religieux musulmans et animistes telles que les nombreuses
mosquées séculaires inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO
dont la plus ancienne qui date de 1741 ou la case des fétiches de
Niofouin, les roches sacrées de Shien Low pour ne citer que ceux-ci. Ces
édifices religieux ont aussi d'énormes potentialités
touristiques. Les paysans du Nord doivent être présentés
avec une fière allure d'une part et d'autre part, les produits agraires
identitaires du Nord sont à promouvoir davantage dans les études
portant sur le développement économique du pays. Cela permettra
d'enseigner une identité d'inclusion aux apprenants et d'avoir comme
contenu une identité qui est territoriale.
95
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE
Abassi, E., & Brugeilles, C. (2016). Chapitre 6. Genre et
manuels scolaires en Afrique et en France. In
M. Jacquemin, D. Bonnet, C. Deprez, M. Pilon, & G. Pison
(Éds.), Être fille ou garçon (p. 155?177). Ined
Éditions.
https://doi.org/10.4000/books.ined.4182
Affolter, S., & Sperisen, V. (2023, juin). Racisme et
représentation de la diversité sociale dans les
manuels scolaires. Commission fédérale
contre le racisme (CFR), Inselgasse 1, CH-3003
Berne. www.ekr.admin.ch
Aphing-Kouassi, N. G. (2001). Le tourisme littoral dans le
Sud-Ouest ivoirien [Géographie, Cocody].
tel.archives-ouvertes.fr/tel-00282992.
Aubertin, C. (1983). Histoire et Création d'une
Région « Sous développée» : Le Nord Ivoirien.
Cahiers ORSTOM, XIX(1), 23?57.
Avon, D. (2015). Le fait religieux dans les manuels scolaires
d'histoire en France: Études, Janvier(1), 55?56.
https://doi.org/10.3917/etu.4223.0055
Ayed, C. B. (2018). Education et territoire. Retour sur un objet
sociologique mal ajusté. Les sciences de l'éducation-Pour
l'Ere nouvelle, 51(1), 15?35.
Bamba, M., & Ossohou, A. (2024). Les immigrants dans l'essor
de l'économie de plantation en pays
Krobou au Sud côte d'Ivoire, de 1920 à 1950.
Revue Internationale Dônn, 4(2), 14?28.
https://revuedonni.wordpress.com
Banégas, R. (2010). Mobilisations sociales, crises
identitaires et citoyenneté en Afrique. ALTERNATIVES SUD,
17, 221.
https://www.cetri.bePDFMobilisations
sociales, crises identitaires et citoyenneté en Afrique
Bayed, H. E., & Sedra, D. (2020). L'instrumentalisation de
l'identité territoriale au service de l'attractivité.
Organisation et Territoires, octobre 2020(5), Article 5.
https://doi.org/10.48407/IMIST.PRSM/ot-n5.22154
Bayle, B., & Domergue-Cloarec, D. (2007). Côte
d'Ivoire, 1993-2003 : Autopsie d'une déchirure. Université
Paul Valéry-Montpellier III.
96
Berque, A. (1984). Paysage-empreinte, paysage-matrice :
Éléments de problématique pour une géographie
culturelle. L'Espace géographique, 13(1), 33-34.
https://doi.org/10.3406/spgeo.1984.3890
Berque, A. (2016). Perception de l'espace, ou milieu perceptif?
L'Espace géographique, 45(2), 168-181.
https://doi.org/10.3917/eg.452.0168
Bilhaj, H. (2016). Le manuel scolaire et son rôle dans
l'action d'enseignement en classe de F.L.E en Libye. Norsud.
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03081361
Blanchard, S., Estebanez, J., & Ripoll, F. (2021).
Géographie sociale : Approches, concepts, exemples (Armand
Colin). Armand Colin.
Bohoussou, A. E. (2023). La place des concepts dans la
géographie scolaire ivoirienne : Analyse des pratiques enseignantes dans
la construction du concept d'espace urbain en classe de première
[Mémoire de didactique de la géographie, Université
Paris-Cité].
www.
academia.edu/121554140
Bonnemaison, J., Cambrézy, L., & Quinty-Bourgeois, L.
(1995). Le territoire, lien ou frontière? :
Identités, conflits ethniques, enjeux et recompositions
territoriales. Université Paris-Sorbonne-ORSTOM, 819.
Bonnemaison, J., Lasseur, M., & Thibault, C. (2000). La
géographie culturelle: Cours de l'Université Paris IV-Sorbonne,
1994-1997. Editions du C.T.H.S.
Boyer-Araújo, V., & Stoll, E. (2019). Correspondance
entre territoires et identités : Une construction patrimoniale ? In
Territoires et identités: Une construction patrimoniale (IRD,
Vol. 4, p. 3-11). Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
https://www.cairn.inforevue-autrepart-2017-4-page-3.htm
Brédif, H. (2021). La métamorphose des territoires.
In Réaliser la terre : Prise en charge du vivant et contrat
territorial (p. 516). Éditions de la Sorbonne.
Brunet, R. (1995). La géographie, science des territoires
et des réseaux. Cahiers de géographie du Québec,
39(108), 477.
https://doi.org/10.7202/022523ar
97
Calindere, O. C. (2010). L'identité nationale et
l'enseignement de l'histoire. Analyse comparée des contributions
scolaires à la construction de l'identité nationale en France et
Roumanie (1950-
2005) [Science politique, Montesquieu; Bucarest].
theses.hal.science/tel-00547326v1
Chartrand, S.-G., & Godelieve, D. konnick. (2009). La
clarté terminologique pour plus de cohérence et de rigueur dans
l'enseignement du Français (suite). Québec
Français, 154, 143-145. http//
id.erudit.org/iderudit/1844ac
Chauveau, J.-P., & Dozon, J.-P. (1985). Colonisation,
économie de plantation et société civile en Côte
d'Ivoire. Cahiers ORSTOM, XXI(1), 63-80.
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/19895
Claval, P. (1974). La géographie et la perception de
l'espace. L'Espace géographique, 3(3), 179-187.
https://doi.org/10.3406/spgeo.1974.1479
Claval, P., & Staszak, J.-F. (2008). Où en est la
géographie culturelle? : Introduction. Annales de
géographie, n° 660-661(2), 3-7.
https://doi.org/10.3917/ag.660.0003
Collot, M. (1986). Points de vue sur la perception des paysages.
L'Espace géographique, 15(3), 211-217.
https://doi.org/10.3406/spgeo.1986.4144
Coulibaly, T. (1995). Démocratie et surenchères
identitaires en Côte-d'Ivoire. Politique africaine,
58(1), 143-150.
https://doi.org/10.3406/polaf.1995.5882
Cuche, D. (2016). La notion de culture dans les sciences
sociales (5e éd). la Découverte.
Dan, T. (2020). La Regulation De La Religion Dans Le Village
D'akouai Santai, Sous-Prefecture De Bingerville (cote D'ivoire) : Une Reponse a
La Dynamique Du Systeme Politique a L'echelle Nationale. REVUE
INTERNATIONALE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'EDUCATION, 014,
201-222.
De Montbrial, T. (2004). Qu'est-ce que la géographie
politique ?: Commentaire, Numéro 107(3), 649-658.
https://doi.org/10.3917/comm.107.0649
De Saint-Martin, C. (2013). Implication et surimplicatIon du
praticien-chercheur. Fractal: Revista de Psicologia, 25(3),
461-474.
98
De Saint-Martin, C., Pilotti, A., & Valentim, S. (2014). La
réflexivité chez le Doctorant-Praticien-Chercheur. Une situation
de Liminalité. Revue pluridisciplinaire de sciences humaines et
sociales Interrogations ?, 19, 12. hal.science/
hal-03753806v1.
revue-interrogations.org/La-reflexivite-chez-le-Doctorant
Degui, J.-L., Kouadio, K. A., Essan, K. V., &
Aloko-N'guessan, J. (2019). Diagnostic de l'offre touristique dans la
région du sud-est de la Côte d'Ivoire : Cas des
départements de Grand-Bassam et d'Adiaké. Revue Ivoirienne de
Géographie des Savanes, 6, 283.
Di Méo, G. (Éd.). (1996). Les territoires du
quotidien. L'Harmattan.
Di Méo, G. (2002a). L'identité : Une
médiation essentielle du rapport espace / société.
Géocarrefour, 77(2), 175?184.
https://doi.org/10.3406/geoca.2002.1569
Di Méo, G. (2002b). Que faire du territoire ? In Y. Jean
& C. Calenge (Éds.), Lire les territoires (Maison des
sciences de l'homme « VILLES ET TERRITOIRES », p. 289?293). Presses
universitaires François-Rabelais.
https://doi.org/10.4000/books.pufr.1817
Di Méo, G. (2008a). Le rapport identité/espace.
Eléments conceptuels et épistémologiques.
https://shs.hal.science/halshs-00281929
Di Méo, G. (2008b). Une géographie sociale entre
représentations et action. Représentation, Action,
Territoire, 23(Numéro Spécial), 13?21.
https://doi.org/halshs-00281573
Doba, B. Y. (2021). La diffusion des Savoirs de la
Géographie des risques dans l'enseignement secondaire en Côte
D'Ivoire [Mémoire de didactique de géographie,
Université Paris-Cité].
http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.12343.85929
Domingues, C. (2006). Quand le paysage se mêle de
l'identité. Hispanística XX, 23, 215?231.
Dialnet-QuandLePaysageSeMeleDidentite-3428011
Dominique, Legros et Perret. (2018). Les illustrations dans les
manuels scolaires : Approches descriptives,diachroniques et
épistémologique. DIversité REcherches et
terrains, 10, 100.
https://www.unilim.fr/dire
99
Dupoirier, E., & Schajer, H.-D. (1994). L'identité
Régionale problèmes théoriques perspectives politiques. In
L'identité politique : [2e séminaire de formation doctorale,
Amiens, 1992-1993] (CURAPP, p. 330?344). Presses universitaires de
France.
Dupré, S. (2006). Perceptions et représentations
géographiques: Un outil pour aménager les forêts
touristifiées ? Téoros. Revue de recherche en tourisme,
25(2), Article 2.
https://journals.openedition.org/teoros/1457?lang=fr
Dussaux, M. (2017). L'éducation au Territoire In
Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « éducations A
» Sous la direction de Angela Barthes, Jean Marc Lange et Nicole
Tutiaux-Guillon L'Harmattan, 978-2343-12678-4. Hal-02010477.
El Fasskaoui, B. (2014). Le paysage culturel : Vers une approche
globale du patrimoine ? Actes du 9ème colloque maroco-allemand de
Meknès 2014, 43, 33?34.
https://www.researchgate.net/publication/337654093
Elissalde, B. (2002). Une géographie des territoires.
L'information géographique, 66(3), 193?205.
https://doi.org/10.3406/ingeo.2002.2810
Filâtre, E. (2021). Développer la conscience
géographique des élèves en enseignant à partir de
l'espace proche [Géographie]. Toulouse 2 Jean-Jaurès.
Fourny, M.-C. (2008). Identité et aménagement du
territoire. Modes de production et figures de l'identité de territoires
dans les récompositions spatiales. In J.-C. Nemery, M. Rautenberg, &
F. Thuriot (Éds.), Stratégies identitaires de conservation et
de valorisation du patrimoine (p. 144). L'Harmattan.
Frémont, A. (1974). Recherches sur l'espace vécu.
L'Espace géographique, 3(3), 231?238.
https://doi.org/10.3406/spgeo.1974.1491
Girault, Y., & Barthes, A. (2016). Postures
épistémologiques et cadres théoriques des principaux
courants de l'éducation aux territoires.
Éducation relative à l'environnement, 13(2).
https://doi.org/10.4000/ere.755
100
Golly, A.-R. (2017). Métropolisation et
territorialisation de l'élevage à Abidjan [Géographie
Urbaine, Université Alassane Ouattara-Université Paris 1]. HAL
Id: tel-01783957.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01783957
Granier, G. (2003). Le paysage dans l'enseignement de la
géographie scolaire. Études Normandes, 52(3),
16-22.
https://doi.org/10.3406/etnor.2003.1507
Guérin-Pace, F. (2006). Sentiment d'appartenance et
territoires identitaires. Espace géographique,
tome 35(4), 298-308.
WWW.cairn.info/revue-espace-geographique-2006-4-page-298.htm Guermond, Y.
(2006). L'identité territoriale : L'ambiguïté d'un concept
géographique. Espace
géographique, 35(4), 291.
https://doi.org/10.3917/eg.354.0291
Guiu, C. (2007). Pratiques folkloriques dans les « Terres de
l'Èbre » : Représentations et mises en scène de la
ruralité. Norois, 3(204), 39-52.
https://doi.org/10.4000/norois.1424
Hertig, P. (2012). Didactique de la géographie et
formation initiale des enseignants spécialistes. Institut de
Géographie.
Houssay-Holzschuch, M. (2005). La géographie
culturelle,émergence et enjeux. In L. Martin & S. Venayre
(Éds.), L'histoire culturelle du contemporain : Actes du colloque de
Cerisy. Nouveau monde éditions.
Joublot Ferré, S. (2017). Processus de formation des
identités territorialisées d'élèves du secondaire
par les pratiques de géographie scolaire : Un éclairage à
partir d'une recherche-action en contexte franco-romand. Belgeo,
2-3, 1-12.
https://doi.org/10.4000/belgeo.19288
Joyal, A. (2017). Di Méo, Guy (2017) Le désarroi
identitaire. Une géographie sociale. Paris, L'Harmattan, 224 p. (ISBN
978-2-34-310866-7). Cahiers de géographie du Québec,
61(173), 383.
https://doi.org/10.7202/1049385ar
Kamagaté, S. (2020). L'aménagement du territoire
dans les programmes de géographie du système scolaire ivoirien.
La revue de Géographie de l'Université Jean Lorougnon
Guédé de Daloa, 2.
https://revuegeo-univdaloa.net/fr/publication/lamenagement-du-territoire-dans-les-programmes-de-geographie-du-systeme-scolaire
101
Kassi, I. (2010). La géographie au Sud : État des
lieux en Côte d'Ivoire. In C. Bouquet (Éd.), Les
géographes et le développement: Discours et actions (p.
73-86). Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
https://doi.org/10.4000/books.msha.11190
Kipré, P. (2002). Les discours politiques de
décembre 1999 à l'élection d'octobre 2000. In Marc Le
Pape, Claudine Vidal Côte d'Ivoire : L'année terrible, 1999-2000
(p. 93). Éd. Karthala.
Kouadio, J.-P. O. (2022). L'éducation au
Développement Durable(edd) dans le Secondaire général en
Côted'Ivoire : Approche curriculaire en géographie
[Didactique de la géographie, Université
Paris-Cité et ENS d'Abidjan]. HAL Id:tel-03718054.
//theses.hal.science/tel-03718054
Kouadio, K. A., Tchetche, N., & Gogbe, T. (2019).
Développement du potentiel touristique dans la Ville balnéaire de
San Pedro (Côte D'Ivoire). Laboratoire de Recherche sur la Dynamique
des Milieux et des Sociétés, 23-13 année,
321-331.
Kourouma, A., & Carpentier, G. (2004). Quand on refuse on
dit non : Roman. Éd. du Seuil.
Lapointe, P. L. (2005). Géographie, histoire et
définition d'une identité régionale : Le cas de
l'Outaouais. Histoire Québec, 11(2), 4-17.
https://id.erudit.org/iderudit/11105ac
Lavergne, C. D. (2007). La posture du praticien-chercheur: Un
analyseur de l'évolution de la recherche qualitative. Recherches
Qualitatives, hors série(3), 28-43.
http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v3/Delavergne-FINAL2
Le Berre, M. (1995). Territoires. In Antoine Bailly, Robert
Ferras, Denise Pumain (dir.), Encyclopédie de géographie
(2è ed, p. 603). Economica.
Lévy, J., Guillorel, H., Duboscq, P., Kofman, E.,
Pailhé, J., & Buléon, P. (1990). Espèces d'espaces
politiques. Espaces Temps, 43(1), 4-18.
https://doi.org/10.3406/espat.1990.3741
Lévy, J., & Lussault, M. (2003). Dictionnaire de
la géographie et de l'espace des sociétés (Belin).
Belin. Memaï, A., & Rouag, A. (2017). Le manuel scolaire :
Au-delà de l'outil pédagogique, l'objet politico-
social. Éducation et socialisation. Les Cahiers du
CERFEE, 43, Article 43.
https://doi.org/10.4000/edso.2014
102
Miran-Guyon, M. (2013). Gloire et déboires de la
laïcité en Côte d'Ivoire au prisme de l'imaginaire social
musulman. In L'Afrique des laïcités: État, religion et
pouvoirs au Sud du Sahara (Holder Gilles; Sow Moussa, p. 13). Editions
Tombouctou; Institut de recherche pour le développement.
Moine, A. (2006). Le territoire comme un système complexe
: Un concept opératoire pour l'aménagement et la
géographie. Espace géographique, 35(2), 115.
https://doi.org/10.3917/eg.352.0115
Molines, G. (2000). Conept, notions et raisonnements dans la
géographie enseignée. L'information géographique,
64(4), 377?381. //
www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_2000_num_64_4_2726
Nazair, P. (2016). Théories et pratiques
pédagogiques dans les manuels scolaires québécois de
niveau primaire [Sociologie, Québec].
https://archipel.uqam.ca/8940/1/M14477
Niclot, D. (2002). L'analyse systémique des manuels
scolaires de géographie et la notion de système manuel.
Travaux de l'Institut Géographique de Reims, 28(109),
103?131.
https://doi.org/10.3406/tigr.2002.1438
Paquette, S., POULLAOUEC-GONIDEC, P., & DOMON, G. (2005). Le
paysage, une qualification
socioculturelle du territoire. Revue de la culture
matérielle, 62(Fall/Automne), 60?72.
https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/view/18061
Pesqueux, Y. (2009). La notion de territoire. Colloque
Propedia-Observatoire économique des banlieues.
ttps://hal.science/hal-00479794v1/file/Notion_de_territoire
Philippe, N. R. (2023). Colonialité et manuels scolaires
en Côte d'Ivoire de 1960 à nos jours. Internationale du
chercheur, 4(4), 989?1015.
https://www.revuechercheur.com/index.php/home/article/view/810/698
Piot, J.-Y. (2007). Propositions pour une formation des
acteurs à la compréhension des enjeux spatiaux
[Géographie]. provence (AIX-Marseille 1).
103
Poth, J. (1997). La conception et la réalisation des
manuels scolaires : Initiation aux techniques d'auteurs (ED/0435/2).
UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116071_fre
Raoulx, B. (2022). De la « région » au «
territoire » ? Quelques repères pour penser la mise en mots de
l'espace canadien. Études canadiennes / Canadian Studies,
92, 9-39.
https://doi.org/10.4000/eccs.5475
Ripoll, F., & Veschambre, V. (2015). Le territoire des
géographes. In B. Cursente & M. Mousnier (Éds.), Le
territoire du médiéviste (Presses universitaires de Rennes,
p. 271-291). Presses universitaires de Rennes, Presses Universitaires de
Rennes.
Rochefort, R. (1974). La perception des paysages. L'Espace
géographique, 3(3), 205-209.
https://doi.org/10.3406/spgeo.1974.1483
Roy, T. (2008). Identité, polarisation et conflit: Le
cas de la Côte d'Ivoire [Science économique]. Library and
Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada.
Sanguin, A.-L. (1984). Le paysage politique : Quelques
considérations sur un concept résurgent.
L'Espace géographique, 13(1), 23-32.
https://doi.org/10.3406/spgeo.1984.3889
Seguin, R. (1989). L'Élaboration des manuels scolaires: Guide
méthodologique. UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086964_fre
Sgard, A. (1997). Qu'est-ce qu'un paysage identitaire?
colloque de valence, 23-24.
https://shs.hal.science/halshs-00270702
Simonet, T. (2010). Les composantes du pouvoir de Félix
Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire (19581965). Outre-mers,
97(368), 403-420.
https://doi.org/10.3406/outre.2010.4512
Stock, M. (2006). Construire l'identité par la
pratique des lieux. De Biase A. & Alessandro Cr. » Chez nous
». Territoires et identités dans les mondes contemporains, Editions
de la Villette,; halshs-00716568.
https://shs.hal.science/halshs-00716568
Thémines, J.-F. (2020a). Enseigner les territoires comme
processus et enjeux. In Savoire et savoir enseigner le territoire (p.
77-132). Presses universitaires du Midi.
104
Thémines, J.-F. (2020b). Le territoire en
géographie; la géographie des territoires. In Savoir et
savoir enseigner le territoire (p. 13-51). Presses universitaires du
Midi.
Thiémélé, R. B. (2009). Ivoirité,
Identité culturelle et intégration africaine : Logique de
dédramatisation d'un concept. Synergie Afrique centrale et de
l'ouest, 3, 75-83.
Thouément, H., & Charles, E. (2011).
L'identité, frein ou moteur de développement territorial ?
Une méthodologie d'analyse; Exemples de la Région capitale de
Bruxelles et de Québec [1ère Conférence
Intercontinentale d'Intelligence Territoriale].
»Interdisciplinarité dans l'aménagement et
développement des territoires», Gatineau, Canada.
https://shs.hal.science/halshs-00958349
Tratnjek, B. (2011, mars 22). Carte postale de la basilique de
Yamoussoukro [Cartes postales du
monde]. Les cafés
géographiques.
cafe-geo.net/article.php3?id_article=2160.halshs-00581543
Vidjannangni, A. (2011). La complexité de la
question identitaire en Côte d'Ivoire [Science politique].
Québec.
105
SIGLES ET ACRONYMES
ARSO : Autorité de la Région du Sud-Ouest
ARSO : Aménagement de la Région du Sud-Ouest
BAD : Banque d'Afrique pour le Développement
DPFC : Direction de la Pédagogie et de la Formation
Continue
EDHC : Éducation aux Droits des Hommes et à la
Citoyenneté
EPS : Éducation Physique et Sportive
ICTA : Ivory Coast travel agency
IGEN : Inspection Générale de l'Éducation
Nationale
IGT : Institut de Géographie Tropicale
INS : Institut National de la Statistique
MINTOUR : Ministère du Tourisme
SIETHO : Société Ivoirienne des Expansions
Touristiques et Hôteliers
UNESCO : United Nations Education, Science and Culture
Organisation
TABLE DES MATIÈRES
|
DÉDICACE
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
PARTIE 1 : GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES, IDENTITÉ
ET ÉDUCATION EN CÔTE D'IVOIRE
|
2
3
4
7
|
|
I.
|
|
DE LA GÉOGRAPHIE RÉGIONALE CLASSIQUE À LA
GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES
|
7
|
|
1.
|
De la région au territoire
|
7
|
|
2.
|
Territoire et identité : une dualité
géographique
|
10
|
|
3.
|
Les quelques dérives de l'identité territoriale en
Côte d'Ivoire
|
11
|
|
4.
|
Une géographie des territoires axée sur
l'aménagement du territoire en côte d'ivoire
|
12
|
|
II.
|
|
GÉOGRAPHIE ET IDENTITÉ : UNE DIVERSITÉ
D'APPROCHES
|
15
|
|
1.
|
La géographie sociale et identité
|
16
|
|
2.
|
La géographie culturelle
|
16
|
|
|
2.1. La notion de culture dans cette étude
|
16
|
|
|
2.2. Le concept de paysage en géographie culturelle
|
17
|
|
|
2.3. Quel lien entre le Paysage, Identité et Culture en
Côte d'Ivoire ?
|
20
|
|
|
2.4. Le système culturel ivoirien
|
23
|
|
3.
|
La géographie politique
|
24
|
|
|
3.1. Paysage politique au coeur du discours territorial ivoirien
|
24
|
|
|
3.2. Le lien fort entre l'identité, le territoire et la
politique en Côte d'Ivoire
|
25
|
|
III.
|
|
PAYSAGE ET IDENTITÉ DANS LA GÉOGRAPHIE SCOLAIRE
IVOIRIENNE
|
27
|
|
1.
|
Paysage et identité
|
27
|
|
|
1.1. Les différents types de paysages identitaires dans
les manuels scolaires ivoiriens
|
27
|
|
|
1.2. L'identité dans les manuels de géographie
ivoiriens
|
28
|
|
2.
|
Les concepts à l'étude
|
30
|
|
|
2.1. La définition du concept du manuel scolaire
|
30
|
|
|
2.2. Les fonctions des manuels scolaires
|
31
|
|
|
2.3. La conception des manuels scolaires de géographie en
Côte d'Ivoire
|
32
|
|
|
2.4. Les fonctions des manuels scolaires de géographie en
Côte d'Ivoire
|
33
|
|
|
2.5. Les livrets d'activités : Complément des
manuels scolaires de géographie en Côte
|
|
|
|
d'Ivoire
|
33
|
|
|
2.6. La perception du paysage des élèves
|
34
|
|
3.
|
Dans les programmes et institution de l'école
|
36
|
|
|
3.1. La définition du programme scolaire en Côte
d'Ivoire
|
36
|
|
|
3.2. L'évolution des programmes scolaires en Côte
d'Ivoire
|
37
|
|
|
|
106
|
107
3.3. Les partenaires financiers internationaux du système
éducatif ivoirien 38
PARTIE II : CADRE MÉTHODOLOGIQUE 41
I. HYPOTHÈSES ET POSITIONNEMENT 41
1. Problématique 41
2. Objectifs et hypothèses de recherche 42
2.1. Objectifs de recherche 42
2.2. Hypothèses de recherche 42
3. Ma posture de recherche : praticien-chercheur ou
prof-chercheur 43
4. Les biais possibles dans cette étude 45
II. PROTOCOLE DE RECHERCHE 46
1. Échantillonnage de mes corpus 46
1.1. Le corpus des manuels scolaires 46
1.2. La perception du paysage 49
2. Mode d'analyse 50
2.1. Analyse théorique des manuels scolaires 50
2.2. Analyse théorique de la perception des
élèves 51
PARTIE III. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET ANALYSES 52
I. UNE IDENTITÉ RELIGIEUSE FAVORISÉE DANS LA
GÉOGRAPHIE SCOLAIRE 52
1. L'identité religieuse Baoulé mobilisée
au service du tourisme 52
2. Le catholicisme : identité religieuse favorisée
56
3. La présence des paysages et images religieux
catholiques dans les manuels scolaires 59
4. La place de l'identité de la région Nord dans
le développement économique de la Côte
d'Ivoire 61
4.1. Une identité marginale de la région Nord
dans le développement de l'économie de
plantation 61
4.2. Identité exclusive de la région du Nord
dans le développement de l'activité touristique
70
II. IDENTITÉ ET TERRITOIRE : SUPPORTS D'ENSEIGNEMENT ET
PERCEPTION DES ÉLÈVES 75
1. Les mots liés à l'identité et au
territoire dans les manuels scolaires 75
1.1. Les mots liés à l'identité dans les
manuels scolaires 75
1.2. Les mots liés au territoire dans les manuels
scolaires 79
2. La connaissance ethnoculturelle des élèves
82
2.1. La religion la plus pratiquée en Côte d'Ivoire
selon les élèves 82
2.2. La perception des ethnies chez les élèves
85
3. La perception territoriale des élèves 87
3.1. La connaissance des cultures agricoles commerciales de
la région du Nord et du Sud
chez les élèves 87
108
3.2. La connaissance des villes de la région du Nord
et du Sud de la Côte d'Ivoire chez les
élèves 89
CONCLUSION GÉNÉRALE 91
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 95
SIGLES ET ACRONYMES 105
TABLE DES MATIÈRES 106
TABLE DES FIGURES 109
TABLE DES TABLEAUX 110
TABLE DES GRAPHIQUES 110
TABLE DES ANNEXES 111
TABLE DES ENCADRÉS 111
ANNEXES 112
109
TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Les différentes acceptations du territoire
(Girault & Barthes, 2016) 10
Figure 2 : Schématisation du champ disciplinaire de notre
étude 15
Figure 3 : Le paysage culturel comme une constante interaction
entre l'intervention humaine et le
milieu naturel (O'Hare,1997. p.34 cité El Fasskaoui, 2014)
18
Figure 4 : Le triangle du paysage culturel 18
Figure 5 :La construction de l'identité territoriale en
géographie 22
Figure 6 : extrait du manuel scolaire de 3ème, Hatier/
CEDA, Hors collection, page 69, 1994 28
Figure 7 : extrait du manuel de 4ème, Vallesse, Ecole
Nation et Développement, page 82, 2019 29
Figure 8: Le schéma de la perception du paysage par les
élèves à travers les manuels scolaires 35
Figure 9 : Les partenaires internationaux intervenants dans le
système éducatif ivoirien (Jonnaert,
2014 cité par Doba, 2021, p. 56) 39
Figure 10 : Les lieux d'exercice de ma posture de
praticien-chercheur 45
Figure 11 : Le schéma du corpus du contenu de manuel
scolaire 50
Figure 12 : extrait de la page 112 du manuel de 3ème
Hatier/CEDA, Hors collection, 1999 53
Figure 13: extrait de la page 126 du manuel 3ème
Hatier/CEDA, L'Afrique et le Monde, 1999 54
Figure 14 : extrait à la page 143 du manuel de
4ème, CEDA/HATIER, L'Afrique et le Monde 55
Figure 15 : extrait de la page 23 du manuel de
5ème, Hatier/CDEDA, Hors collection 57
Figure 16 : extrait de la page 125 du manuel de 4ème,
Hatier/Ceda, Hors collection, 1994 58
Figure 17 : Extrait à la page 102 du manuel de
3ème, Vallesse, Ecole Nation et Développement, 2020
60
Figure 18 : extrait de la page78-80 du manuel de 3ème,
Hatier/CEDA, Hors collection 63
Figure 19 : extrait des pages 95 et 81 des manuels de
4ème et 3ème , Hatier/Ceda, L'Afrique et
le
monde puis Hors collection 64
Figure 20 : extrait des pages 83 et 96 du manuel de 3ème,
Hatier/Ceda, Hors collection, 1994 66
figure 21 : extrait de la page 94 du manuel de 3ème,
Vallesse, Ecole Nation et Développement, 2020
67
Figure 22 : extrait des pages 94-98 du manuel scolaire 4
ème, Hatier/Ceda, L'Afrique et le monde,
2002 68
Figure 23 : extrait de la page 112 du manuel de 3ème,
Hatier/CEDA, Hors collection, 1994 71
Figure 24 : extrait de la page 91 du manuel de 4ème,
Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002 72
Figure 25 : extrait de la page 105 du manuel de 3ème,
Hatier/CEDA, Hors collection, 1994 73
Figure 26 : extrait de la page 99, du manuel de 4ème,
Hatier/CEDA, L'Afrique et le monde, 2002 74
110
TABLE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Les notions de régions, espaces et territoires
dans les intitulés de colloque ( Bulletin
d'intergéo cité par Ripoll & Veschambre, 2015,
p. 271?291) 8
Tableau 2 : Les thématiques sur les mémoires de
maitrise à l'IGT (Kassi, 2010, p. 80) 13
Tableau 3: Les leçons évoquant l'aménagement
du territoire au secondaire 14
Tableau 4 : Identité ethnique et religieuse des principaux
leaders politiques en Côte d'Ivoire 26
Tableau 5 : Les cinq domaines du programmes scolaires ivoiriens (
http://dpfc-ci.net /?page_id=63)36
Tableau 6 : Evolution des programmes éducatifs ivoiriens de 1893
à ce jour (
https://dpfc-ci.net/wp
content/uploads/2022/IMPLANTATION-PROGRAMMES-EDUCATIFS-RECADRES)
37
Tableau 7 : Finalités, buts et objectifs de l'école
ivoirienne (Hauhouot, 2015 cité par Doba, 2021, p
52) 38
Tableau 8 : Les manuels de la collection Hors collection 46
Tableau 9 : Les manuels de la collection l'Afrique et le Monde
47
Tableau 10 : Les manuels de la collection École Nation et
Développement 48
Tableau 11 : Echantillonnage des élèves à
enquêter 49
Tableau 12 : Fréquence de l'affichage des marqueurs
religieux dans la collection Hors collection 59
Tableau 13 : Fréquence de l'affichage des marqueurs
religieux dans la collection L'Afrique et le
monde 59
Tableau 14 : Les mots liés à l'identité dans
la collection Hors collection 75
Tableau 15 : Les mots liés à l'identité dans
la collection L'Afrique et le Monde 76
Tableau 16 : Les mots liés à l'identité dans
la collection Ecole, Nation et Développement 77
Tableau 17 : Les mots liés au territoire dans la
collection Hors collection 79
Tableau 18 : Les mots liés au territoire dans la
collection L'Afrique et le Monde 80
Tableau 19 : Les mots liés au territoire dans la
collection Ecole, Nation et Développement 81
Tableau 20 : Les religions les plus pratiquées en
Côte d'Ivoire selon les élèves 82
Tableau 21 : La perception des ethnies en fonction des
régions géographiques selon les élèves 85
Tableau 22 : Deux cultures de rente en fonction des
régions économiques selon les élèves 87
Tableau 23 : Le nombre des villes de la région du Nord et
du Sud cité par les élèves 89
TABLE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Proportion des édifices religieux
catholiques dans les manuels scolaires 61
Graphique 2 : Diagramme de la part de chaque type
d'identité identifié dans les manuels 78
Graphique 3 : Proportion des religions pratiquées en
Côte d'Ivoire selon les élèves 83
Graphique 4 : Diagramme de la part des ethnies en fonction des
zones géographiques selon les
élèves 86
Graphique 5 : Diagramme de la part des ethnies originaires du Sud
et du Nord cité par les élèves 86
Graphique 6 : Le poids des cultures de rente en fonction des
régions Nord et Sud citées par les élèves
88
Graphique 7 : Poids des villes de la région du Nord et du
Sud selon les élèves 90
TABLE DES ANNEXES
Annexe 1 : Grille d'analyse des manuels 112
Annexe 2 : Questionnaire pour les élèves 113
Annexe 3 : Guide d'entretien pour les élèves 114
Annexe 4 : Couverture du manuel 5ème NEI-CEDA, 2017 Annexe
5 : Couverture du manuel
4ème Vallesse, 2019 114
Annexe 6 : Couverture du manuel de 3ème, Vallesse, 2020
Annexe 7 : Couverture du manuel
5ème, HATIER/CEDA, 1998 115
Annexe 8 : Couverture du
manuel 4ème, CEDA/HATIER, 2002 Annexe 9 : Couverture du manuel
3ème,CEDA/HATIER, 1999 116
Annexe 10 : Couverture du manuel, Hatier/CEDA, 1992 Annexe 11 :
Couverture du manuel 4ème,
Hatier/CEDA, 1993 116
Annexe 12 : Couverture du manuel 3ème, HATIER/CEDA, 1994
117
TABLE DES ENCADRÉS
111
Encadré 1 : extrait de la leçon sur le milieu
tropical ivoirien de la classe de seconde (
ecole-ci.org) ... 69
112
ANNEXES
|
Présentation du
manuel.
|
Niveau : Auteurs : Collection :
|
|
Nature des
documents liés
à
l'identité
|
|
|
Thématique ou leçon
évoquée pour
illustrer le
document
|
|
|
Présence des mots
liés à l'identité
|
|
|
Présence des mots
liés au territoire
|
|
|
Dans le lexique, les
notions liées
à
l'identité
|
|
|
Dans le lexique, les
notions liées au
territoire
|
|
|
Pages
|
|
|
Synthèse
|
|
Annexe 1 : Grille d'analyse des manuels
113
Classe : Établissement :
Ethnie : Âge :
I- CONNAISSANCE ETHNOCULTURELLE
1-Parmi ces religions laquelle est la plus pratiquée
par les Ivoiriens ?
a- Christianisme
b- Islam
c- Animiste
2- Cite 04 ethnies de la Côte d'Ivoire
.....................................................................................................................
II- PERCEPTION TERRITORIALE DES ÉLÈVES
1-Cite les (04) quatre cultures agricoles commerciales de la
Côte d'Ivoire
2-Cite 02 cultures agricoles de la Côte d'Ivoire dans la
:
Zone du Nord :
Je ne sais pas
Zone du Sud :
Je ne sais pas
3-Cite 02 villes de la Côte d'Ivoire dans la :
Zone du Nord :
Je ne sais pas
Zone du Sud :
Je ne sais pas
4-Cite 05 villes importantes de la Côte d'Ivoire selon toi
:
Annexe 2 : Questionnaire pour les
élèves
1-
J'ai vu que tu as choisi la religion (chrétienne,
musulmane ou animiste) comme la religion la plus pratiquée en Côte
d'Ivoire.
Dis-moi, pourquoi penses-tu que cette religion est la plus
pratiquée ? ou encore Où as-tu appris cela ?
2- Il y a une mosquée qui est construite depuis le
17ème siècle en terre et inscrite au patrimoine
culturelle de l'UNESCO.
Dans quelle ville de la Côte d'Ivoire se trouve-t-elle
?
3- Entre la région Nord et la région Sud de la
Côte d'Ivoire, laquelle participe-t-elle au développement de la
Côte d'Ivoire ? Pourquoi.
Annexe 3 : Guide d'entretien pour les
élèves
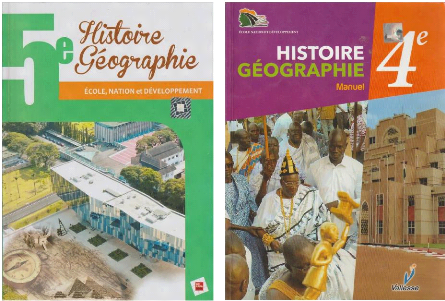
114
Annexe 4 : Couverture du manuel 5ème NEI-CEDA, 2017
Annexe 5 : Couverture du manuel 4ème Vallesse, 2019
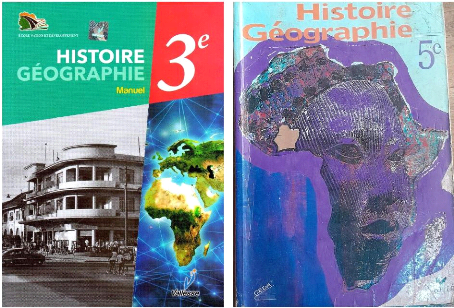
115
Annexe 6 : Couverture du manuel de 3ème, Vallesse,
2020 Annexe 7 : Couverture du manuel 5ème, HATIER/CEDA, 1998
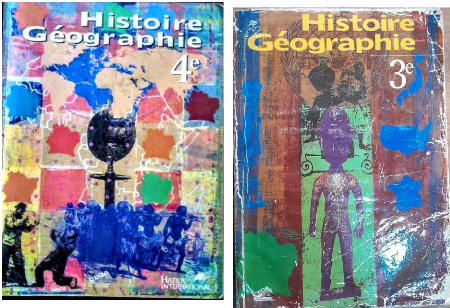
116
Annexe 8 : Couverture du manuel 4ème, CEDA/HATIER,
2002 Annexe 9 : Couverture du manuel 3ème,CEDA/HATIER, 1999
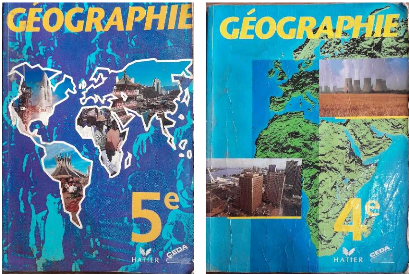
Annexe 10 : Couverture du manuel, Hatier/CEDA, 1992 Annexe 11
: Couverture du manuel 4ème, Hatier/CEDA, 1993
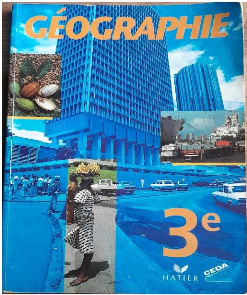
117
Annexe 12 : Couverture du manuel 3ème, HATIER/CEDA,
1994
| 


