Chapitre 1 :
Présentation du milieu d'étude
Ce premier chapitre est consacré à la
présentation du milieu. Il se débute par une fine
présentation géographique générale
c'est-à-dire la situation du milieu dans l'espace géographique.
Nous avons par la suite décrit son cadre physique et par la fin, voire
son aspect humain.
1.1. Situation du milieu d'étude
Notre milieu d'étude est le long de l'île de
Diamniadio à Faoye. Il se situe à cheval entre le
Département de Fatick et celui de Foundiougne de la Région de
Fatick (Sénégal). Il occupe une partie de la Commune de Djirnda,
une bonne partie de la Commune de Fimela et celle de Djilasse et une petite
portion de la Commune de Loul Sessene. Notre milieu d'étude est
constitué principalement de deux (2) localités. Le village de
Diamniadio au Sud avec1265 habitants en 2023 et la localité de Faoye au
Nord (1316 habitants). Il est parcouru du Sud au Nord par un cours
d'eauméandrique permanant, long de plus de 30 km, appelé bolong
ou marigot de Faoye. Le milieu d'étude s'étend sur une superficie
de 172,22 km² et comporte plusieurs unités
morphologiques telles que : les tannes, la vasière nue, la
vasière à mangrove, les chenauxde marée et les
cordons sableux. Il est limité au Nord et au Nord-est par les villages
de Ndoff et Sakhor Tocan et le marigot de Silif. Il est parcouru du Sud au
Sud-est par le fleuve Saloum. Il est limité au Sud-ouest par les
îles de Mar et à l'Ouest par le marigot de Simal. Avec une
altitude qui varie entre -4 et 11m, ce milieu d'un relief très base est
compris entre les latitudes 14°3'0'' et 14°13'30'' Nord et les
longitudes 16°31'0'' et 16°37'0'' Ouest.
Carte 1:Situation du milieu
d'étude
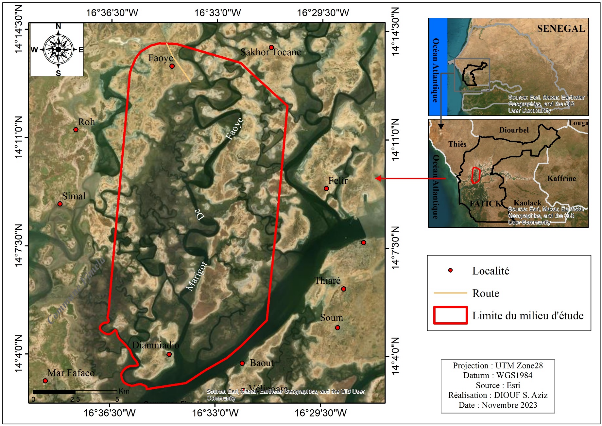
1.2. Le cadre physique
Il s'agit de l'étude de la géologie, la
géomorphologie, la pédologie, de la végétation, de
l'hydrologie et des conditions climatiques du milieu d'étude.
1.2.1. Géologie
Du point de vue géologique, le delta du Saloum s'est
développé vers 5500 BP sur la partie ouest du bassin
sédimentaire sénégalo-mauritanien ou bassin
secondaire-tertiaire, qui lui-même, recouvert par les dépôts
récents du Quartenaire.
1.2.1.1 Le bassin
sédimentaire secondaire et tertiaire
Un vaste bassin sédimentaire dont les sédiments
et les roches sédimentaires datent du Crétacé à
l'époque récente occupe plus des deux tiers du
Sénégal. Ce bassin est désigné sous le nom du
bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, Stancoff A et al
(1985). Il s'étant au plus de 500 kilomètres depuis, la
côte jusqu'au bouclier du Sénégal oriental et se repose sur
un substratum d'âges plus anciens dont le sommet correspond aux
formations de l'ère primaire. On considère que toute la
séquence repose sur des sédiments et des roches
sédimentaires datant du Précambrien au Dévonien, Stancoff
A et al (1985). Mais seules les formations du Crétacé
Supérieur et du Tertiaire affleurent dans les régions
occidentales du Sénégal, Michel P (1973). Les terrains anciens,
birimiens à paléozoïques, n'affleurant qu'au Sud-est du pays
à la frontière avec la Guinée et le Mali, Faye B (2017).
Le bassin secondaire-tertiaire est largement recouvert par des
dépôts récents allant du Pliocène (sommet du
Tertiaire) au quaternaire. Il est composé principalement en surface par
des sédiments et des roches sédimentaires tertiare-quarternaires,
à l'exception d'une petite enclave de sédiments du
Crétacé Supérieur dans le Cap Vert. L'histoire structurale
du bassin n'est pas aussi simple. Il est largement faillé en particulier
dans la direction NE/SW et il est ou légèrement plissé ou
il est simplement affaissé par endroit, Stancoff A et al (1985). Le
bassin sénégalo-mauritanien est largement ouvert à l'Ouest
sur l'atlantique. Il serait né au mésozoïque pendant la
transgression Atlantique naissante. Lors de l'ouverture de l'Atlantique, c'est
lerejet de failles transformâtes qui provoque l'effondrement de la marge
et la mise en place desbassins sédimentaires côtiers (Jacobi et
Hayes, 1982 ; cité par Mariline Diara en 1999). Son histoire remonte du
Crétacé au Tertiaire. Au Crétacé, le bassin est
bien développé sur l'arrière-pays, Diara M (1999). A l'Est
et au Sud-est, il est limité par la chaîne hercynienne des
Mauritanides et le bassin de Taoudéni. Au Sud par le bassin de
Bové et au Nord et au Nord-Est par le bassin d'Aaiun et la dorsale de
Reguibat.
| 


