4.5.1.1.3. Les impacts sur les végétations
Les végétations dans le milieu sont de deux
types : la végétation submersible (la mangrove) et la
végétation immersible (le couvert continental). La dynamique
progressive des unités morphologiques, notamment les tannes, la
vasière nue et les cours d'eau, a entrainé d'une part la
mortalité de la mangrove et de l'autre part le recul
végétation continentale. En effet, d'une part, la concentration
du sel dans le sol rend non seulement difficile l'absorbation de l'eau par la
végétation continentale mais aussi le sel est très
néfaste pour la majorité des plantes. Cette dégradation
chimique, conjuguée avec la pression anthropique sur cette formation
continentale, font que la végétation du milieu se disparait
progressivement. Selon la population paysanne, plus de 70% de la disparition de
plantes (les grandes plantes essentiellement), est l'oeuvre de la dynamique
saline qui se manifeste par la croissance des tannes dans le milieu. Les
plantes les plus touchées sont le Baobab, le Guitakh, le Cocotier et le
Sidem d'après les paysans. Cette dégradation de la
végétation continentale se voit nettement par l'analyse des
cartes diachroniques qui montre une décroissance de -34,94% entre 1972
et 2020 de cette unité d'occupation du sol. De l'autre part, la
mortalité de la mangrove se manifeste par la disparition des
palétuviers, laissant sur place le développement de la
vasière nue et des tannes. En effet, même si la mangrove est une
formation très résistante à la salinité, son
degré de résistivité à une limite. Elle ne peut
voir son développement que si la teneur en sel est de 60g/l pour le
genre Rhizophora et 80g/l pour le genreAvicennisa (ADG, 2012, cité par
Mamadou Sy en 2017) au moment où le taux de salinité est de 57g/l
à Diamniadio selon l'EPEEC (1982), cité par Ndaw Fatou (2014).
Cette salinité qui accroit de l'embouchure vers l'amont, est de 62,7 %
à Ndagane, 64,4 % à Foundiougne et 82,2 % à Kaolack
d'après l'EPEEC (1982). Ce qui fait que le taux de salinité est
forcément plus important à Faoye, peut-être même
supérieur à 65 %. Et c'est justement ce qui justifie la
mortalité du genre Rhizophora de Faoye vers Diamniadio. Jusqu'à
2007, la mangrove qui est complètement disparue à Faoye en 2020,
se voyait le long du marigot de Faoye près de cette localité.
Elle a passé de 7,88 à 6,31 % entre 2007 et 2020 au moment
où les tannes passent de 19,36 à 25,99 % et la vasière nue
de 15,87 à 23,87 % pendant cette période. Cette mortalité
de la mangrove, laissant la place à la vasière nue et plupart aux
tannes, a à son tour des effets négatifs sur la faune marine mais
aussi sur les activités économiques menées par l'homme. La
rareté voire même l'extinction de certaines espèces marines
comme les poisons par exemple qui se reproduits essentiellement au niveau de
cet écosystème marin.
Carte 20:Evolution de la mangrove et
de la végétation continentale de 1972 à 2020
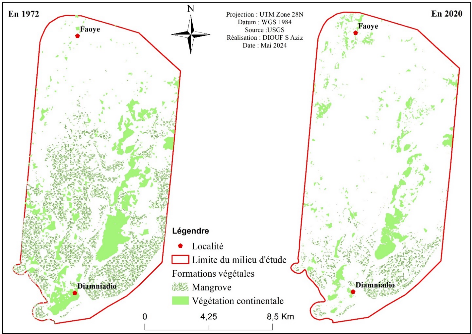
La dynamique régressive des unes et progressive des
autres unités paysagères a donc des effets
généralement nuisibles sur l'écologie du milieu
d'étude. Ils se traduisent en grande partie la dégradation des
terres, que la salinisation extrême des ressources en eau, la
mortalité de la mangrove ainsi que la régression de la
végétation continentale. Ces contraintes écologiques
freinent le plus souvent le développement économique et le
bien-être de la population paysanne.
| 


