|
~ I ~
RÉSUMÉ ET MOT CLES
Nous avons le réel Plaisir de vous présenter
les contenus de notre travail qui marque la fin de notre cursus
académique intitule « facteurs associés aux faibles
traitements de l'eau dans l'aire de santé Kamulumba ».
Cette étude a pour but d'identifier les facteurs
associés au faible traitement de l'eau dans l'aire de santé
Kamulumba.
Pour y parvenir nous nous sommes fixés ce but les
objectifs spécifiques ci-après :
· Décrire les caractéristiques Socio
démographiques des enquêtés ;
· Déterminer la proposition des habitants
traitant l'eau dans la zone de santé de Kamulumba ;
· Établir le lien entre les facteurs
associés et faibles utilisation des méthodes de traitement de
l'eau dans la zs de Kamulumba ;
Cette étude vise à analyser les facteurs
associés au faible traitement de l'eau dans l'aire de santé de
KAMULUMBA Etat.
La méthode utilisée dans cette étude
est la méthode de
questionnaire appuyée par la technique d'interview
directe avec un questionnaire d'enquête comme instrument de collecte des
données dont la taille d'échantillon est de 384
enquêtés.
Après analyse et interprétation des
données, l'étude a mis en exergue 6 facteurs influencent ; Il
s'agit de sexe (X2 cal 4.5 (X2 tab 3,841) et taille de
ménages(X2cal 8.3 X2 tab 5,991,
employé(X2 cal 6,4 X2 tab3,841, types
d'employé((X2cal 10,2 X2 tab 5,991 au ddl=2) ,
niveau revenu (X2cal 12,5 X2 tab 5,991au ddl=2 et la
sensibilisation(X2cal 6,1 X2 tab 3,841 au ddl=1,
~ II ~
connaissance de traitement de l'eau(X2 cal 8,3
X2 tab 3,841 au ddl=1), différents maladies liées
à l'eau non traité (X2cal 15,6 X2 tab 3,841
au ddl=1) et la pratique de traitement de l'eau(X2cal 12,1
X2 tab 3,841 au ddl=1), manque d'accès aux services de
santé (X2cal 9,1 X2 tab 3,841 au ddl=1), la
distance ( cal 7.5 X2 tab 5,991 au ddl=2), les méthodes
utilisées pour le traitement de l'eau(X2cal 9,0 X2
tab 7,815 au ddl=3), l'accès aux produits de traitement de l'eau
(X2cal 12.8 X2 tab 3,841 au ddl=1).
MOT CLÉS
facteurs associés ; Traitement de l'eau ; Aire de
santé ;
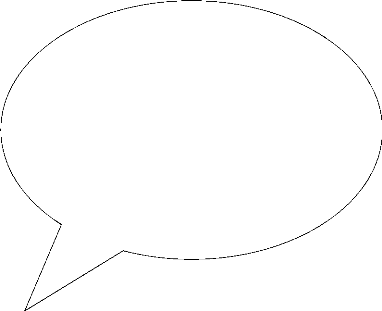
L'eau c'est la force motrice de toute la nature.
Léonard de Vinci 2015
~ III ~
TTIÇR2tT3-(T
~ IV ~
DÉDICACE
A mes parents : LUKUKUMU Samy et NGALULA Chantal pour leur
amour, leur soutien et leur encouragement tout au long de mon parcours
académique.
MBUYI LUKUKUMU Jacques
MBUYI LUKUKUMU jacques
~ V ~
REMERCIEMENTS
Nous remercions en premier lieu le Dieu qui nous a
donnée à la fois la volonté, le courage et la patience
afin d'élaborer ce mémoire de fin d'études.
Nos vifs remerciements au professeur KAYEMBE MPUTU John pour
nous avoir été le Directeur de notre mémoire et surtout
pour ses conseils et orientations durant les moments délicats.
Nous n'oublions pas de remercier toutes nos Autorités
académiques et administratives de l'ISTM/Kananga ainsi que nos
enseignants pour leur engagement envers notre excellente formation et leur
dévouement à l'éducation.
Bien évidement nos remerciements se doivent d'aller
à notre codirecteur Chef de travaux Emmanuel MUKOMA KANKU pour sa
rigueur scientifique et son amitié dont les moments les plus difficiles,
sur le plan scientifique tant qu'humain.
Nous exprimons également nos gratitudes à tous les
comités de gestion de l'ISTM/Kananga pour leurs efforts
qu'ils nous ont fournis depuis la première année d'études
jusqu'à la fin de nos études.
Enfin, nous remercions vivement nos amis Junior NDUMBI, Pierre
TSHIAMPANYA, Grâce TSHIENDENDA, Joseph TULOMBE, Rocky KALUBI, Jacques
MADI, Aiglon MUKENYI et Théodore NTULO pour qui nous ont beaucoup
soutenus durant les moments difficiles, et ne spéciale remerciements par
ma chérie Astrid NTUMBA.
~ VI ~
SIGLES ET ABREVIATIONS
APE : Alimentation en Eau Potable
FAO : Fond and Agriculture (Organisation des
Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FOSA : Formation Sanitaire
H : Hypothèse
ODD : Objectif de Développement Durable
OMD : Objectif du Millénaire pour le
Développement
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PNUD : Programme de Nations-Unies pour le
développement
|
PNUE
l'environnement
|
: Programme des Nations-Unies pour
|
UNESCO : Organisation des Nations-Unies pour l'Education,
la Science et la Culture
UNICEF : Fond de Nations-Unies pour l'enfance
WHO : Word Health Organisation
~ VII ~
LISTE DES TABLEAUX
3.1.1. TABLEAU 1. REPARTITION DES ENQUETES SELON
LES FACTEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES 28
Erreur ! Signet
non défini.
3.1.2. Tableau 2 FACTEURS INDIVIDUELS ..33
3.1.3. TABLEAU 3
REPARTITION DES ENQUETES SELON
LES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 34
3.1.4. TABLEAU 4 :
REPARTITION DES ENQUETES SELON
LES FACTEURS SOCIO-
CULTURELS 36
3.1.5. TABLEAU 5 : REPARTITION DES ENQUETES SELON
LES FACTEURS SANITAIRES .32
3.1.6. TABLEAU 6 : REPARTITION DES
ENQUETES SELON LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET'
STRUCTURELS ...37
III.2. ANALYSE BI-
VARIEES ..38
3.2.1. TABLEAU 7 : RELATION ENTRE FACTEURS SOCIODEMOGRAPHIQUES ET
TRAITEMENT DE L'EAU....38
3.2.2. TABLEAU 8 : RELATION ENTRE LES FACTEURS
INDIVIDUELS ET LE TRAITEMENT D'EAU ...39
3.2.3. TABLEAU 9 :
RELATION ENTRE LES FACTEURS
SOCIO-ECONOMIQUES ET LE TRAITEMENT DE L'EAU 41
3.2.4. TABLEAU
10 : RELATION ENTRE LES FACTEURS
SOCIO-CULTURELS ET LE TRAITEMENT DE L'EAU .41
3.2.5. TABLEAU
11 : RELATION ENTRE LES FACTEURS SANITAIRES TE LE TRAITEMENT DE
L'EAU 43
3.2.6 TABLEAU 12 : RELATION ENTRE LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX,
STRUCTURELS ET LE
TRAITEMENT DE L'EAU 45
- 1 -
INTRODUCTION
ENONCE DU PROBLEME
L'eau est une source naturelle vitale, essentielle à
l'inexistence de toute forme de vie sur terre. Elle est définie comme un
liquide incolore, inodore et insipide à l'état pur, formé
de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène (H20) (Gleick,
1996). Elle couvre environ 70% de de la surface du globe terrestre, bien que
seulement une petite fraction, estime à 2,5% soit l'eau douce utilisable
par l'homme (UNESCO, 2020).
A l'échelle mondiale, 15% des patients contractent une
infection pendent leur séjour à l'hôpital, cette proportion
étant bien plus grande dans les pays à faible revenu. La mauvaise
gestion des eaux usées urbaines, industrielles et agricoles implique
pour des centaines de personnes une contamination dangereuse ou une pollution
chimique de l'eau potable. La présence naturelle des produits chimiques,
notamment l'arsenic et fluorure, en particulier dans les eaux souterraines,
peut également avoir une incidence sur la santé, tandis que
d'autres produits chimiques, comme le plomb, peut être
libérés dans l'eau potable en quantités importantes en
raison de leur présence dans les éléments du réseau
d'approvisionnement.
On estime que, chaque année, plus de 829.000 personnes
meurent de diarrhée à cause de l'insalubrité de l'eau
potable et du manque d'assainissement et d'hygiène. Cependant, la
prévention de la diarrhée est en grande partie possible et on
pourrait par exemple, éviter chaque année la mort de 297 000
enfants de moins de 5 ans si on luttait contre ces facteurs de risque. La
diarrhée est la maladie la plus connue associée aux aliments et
à l'eau contaminée, mais elle n'est pas la seule. En 2017, plus
de 200 millions de personnes avaient besoin d'un traitement préventif de
la Schistosomiase, une maladie aigue et chronique causée par des vers
parasites qui peuvent être présent dans l'eau (OMS 2022).
L'eau joue un rôle fondamental dans les fonctions
biologiques, écologiques, sociales et économiques. Elle est
nécessaire pour l'hydratation du corps humain, la digestion, la
régulation de la température corporelle, mais aussi pour les
activités agricoles, industrielle, domestiques et sanitaire (WHO,
2017).
~ 2 ~
Dans les écosystèmes, l'eau permet à
suivre les plantes, des animaux et assure le fonctionnement des cycles naturels
comme le cycle de l'eau, le photosystème et la purification naturelle
des sols (FAO, 2016). Elle est également un facteur clé dans la
résilience face aux changements climatiques et aux catastrophes
naturelles.
Sur le plan socio-économique ; l'eau est au coeur des
enjeux de développement. Elle influence directement à
santé publique, la sécurité alimentaire,
l'éducation (notamment la scolarisation des filles), et la
stabilité des communautés (UN-Water, 2021). Un accès
fiable et équitable à l'eau a d'ailleurs été
reconnu comme un endroit humain fondamental par la Nation Unies depuis 2010
(United Nations, 2010). Cependant, malgré son importance, environ 2,2
milliards des personnes dans le monde n'ont pas accès à des
services d'eau potable gérés en toute sécurité, ce
qui soulève d'importants défis pour la durabilité des
sociétés humaines et de l'environnement (OMS et UNICEF, 2021).
La crise multiforme des maladies hydriques suscite
l'intérêt de nombreux chercheurs. Chacun d'eux aborde le sujet
selon ses propres opinions et orientations, en s'intéressant aux divers
aspects de l'eau. L'existence de ces études montre qu'il est possible de
mener un travail approfondi sur la qualité et la conservation de l'eau
de boisson, répondant ainsi aux besoins des populations
confrontées à l'eau non potable.
Depuis l'apparition de la planète Terre, aucune vie
n'est possible sans eau. Les activités humaines dépendent
étroitement de ce fluide vital. Les risques auxquels sont exposés
les consommateurs se multiplient tout au long du parcours de l'eau, depuis la
source jusqu'à la destination finale. Cependant, pour garantir la
santé des populations, l'approvisionnement en eau potable seul ne suffit
pas. L'assainissement et l'adoption de bonnes pratiques en matière de
gestion de l'eau de boisson constituent des éléments essentiels
pour améliorer la santé publique. (Nkamisha Tshombe J. 2018).
Au niveau mondial, les eaux de la planète se
répartissent ainsi : 97 % sont salées et 3 % sont douces. Parmi
cette eau douce, 77,2 % sont emprisonnées dans les glaciers, 22,2 % sont
souterraines et seulement 0,6 % se trouvent dans les cours d'eau. En Afrique,
70 % de cette 0,6 % d'eau douce est disponible pour la
Kananga, capitale de la province du Kasaï-Central en
République Démocratique du Congo, est une ville d'environ 1,5
million d'habitants. Malgré la
~ 3 ~
consommation. Cette eau destinée à l'usage
humain possède des propriétés chimiques
spécifiques, avec des concentrations maximales admissibles
définies par des guides de référence. (Yolande Ofoueme B.,
2015)
Dans le monde, 1,4 milliard de personnes n'ont pas un
accès satisfaisant à l'eau potable, dont 450 millions en Afrique.
Les pays riches disposent en moyenne de 1 500 m3 d'eau par an et par
habitant, contre seulement 100 m3 dans les pays pauvres. (Kertous
Mourad, 2005).
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des
millions de personnes en Europe consomment une eau contaminée, souvent
sans le savoir. L'OMS estime que 14 personnes meurent chaque jour des suites de
maladies diarrhéiques liées à la mauvaise qualité
de l'eau, à l'insuffisance de l'assainissement et au manque
d'hygiène. (OMS, 2018)
Dans les pays en développement, les difficultés
d'accès à l'eau potable et à l'eau pour d'autres usages
domestiques entraînent de longs trajets entre les domiciles et les
sources d'approvisionnement. La rareté de cette ressource vitale conduit
souvent à l'utilisation de latrines rudimentaires et à une forte
incidence de pathologies hydriques, notamment les diarrhées,
particulièrement chez les enfants. (PNAEPA, 2018).
En Afrique, la consommation quotidienne d'eau par individu est
estimée entre 10 et 20 litres par jour, contrairement à la
recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé qui exige au
minimum 80 litres par jour pour les besoins (ménage, hygiène,
boisson, etc.) Leocadie Odoulahi (2009). L'Algérie était
classée à la seizième place des pays les plus
touchés par le manque d'eau potable, avec une disponibilité
inférieure à 500 m3 par an et par habitant. ( Nkamisha
Tshombe J., 2018)
La République Démocratique du Congo, pays
d'Afrique possédant les ressources hydrauliques les plus importantes,
fait toutefois face aujourd'hui à une crise aiguë
d'approvisionnement en eau potable. En effet, seuls 26 % de la population
congolaise ont accès à une eau potable salubre. (Cairn O.,
2013).
suivants :
~ 4 ~
richesse en ressources en eau de la région
(rivières, lacs et nappes phréatiques), la ville fait face
à de graves difficultés d'approvisionnement en eau potable. Les
problèmes sont similaires à ceux rencontrés dans d'autres
villes du pays : un manque d'infrastructures modernes, des services
d'assainissement inadéquats et un accès limité à
des solutions de traitement de l'eau efficaces. Le réseau
d'approvisionnement en eau de Kananga est largement obsolète, et
l'extension de ces infrastructures est insuffisante pour répondre
à la demande croissante de la population urbaine. Selon un rapport de
l'UNICEF en 2019, moins de 35 % des habitants de Kananga ont accès
à de l'eau potable provenant d'un réseau public et traité.
Le reste de la population dépend de sources alternatives, telles que des
puits, des rivières, des réservoirs collecteurs ou même des
sources naturelles souvent non traitées. (UNICEF, 2019)
L'aire de santé de Kamulumba, situé dans la
ville de Kananga, fait face à des défis similaires à ceux
des autres quartiers de la ville, mais il présente également des
particularités en termes d'accès à l'eau potable et de
gestion des ressources en eau. Le quartier, qui abrite une grande population
urbaine et un nombre important de ménages dans des conditions de
précarité, rencontre des problèmes liés à
l'approvisionnement en eau, la qualité de l'eau et l'assainissement. Le
réseau d'approvisionnement en eau à Kamulumba est limité.
Une grande partie de la population dépend de sources d'eau non
traitées, telles que les puits traditionnels, les rivières et les
forages peu profonds, qui sont souvent contaminés par des
matières organiques, des déchets humains et des produits
chimiques. L'accès à l'eau potable de qualité reste donc
un défi majeur. (ONG Eau Vive, 2020.)
3. BUT ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
a) But de l'étude
Le but général de cette étude est
d'identifier et d'analyser les facteurs associés aux faibles traitements
de l'eau dans l'aire de santé de Kamulumba.
b) Objectifs spécifiques
Pour atteindre ce but général, l'étude se
fixe les objectifs spécifiques
~ 5 ~
· . Décrire les caractéristiques
sociodémographiques des enquêtés ;
· . Déterminer la proposition des habitats
traitant l'eau dans la zone de santé de Kamulumba ;
· . Etablir le lien entre les facteurs associés
et faible utilisation des méthodes de traitement de l'eau dans la zone
de santé de Kamulumba.
JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE
L'accès à une eau potable salubre constitue un
besoin fondamental pour la santé humaine et le développement
socio-économique. Dans l'aire de santé Kamulumba, comme dans de
nombreuses zones urbaines de Kananga, une large partie de la population
dépend de sources d'eau non traitées, telles que les puits, les
rivières ou les réservoirs collecteurs, exposant ainsi les
habitants à des maladies hydriques telles que la diarrhée, le
choléra et la fièvre typhoïde (WHO, 2020).
Cette étude trouve de multiples intérêts
pour une certaine catégorie des personnes à savoir :
· . Pour nous, ce travail nous permet d'approfondir
notre compréhension des enjeux liés au traitement de l'eau.
· . Pour les Autorités sanitaires, les
données émanant de nos recherches les aideront de prendre des
dispositions pour lutter contre ces problèmes de traitement de l'eau
dans le ménage de Kamulumba.
· . Pour les futurs chercheurs, elles constituent un
support de référence et aussi une base de données et une
référence bibliographique.
~ 6 ~
4. DÉLIMITATION DU TRAVAIL
a) Délimitation dans le temps
L'étude porte sur une période précise afin
de rendre les données pertinentes et comparables. Elle couvre la
période de janvier 2025 à juillet 2025.
b) Délimitation dans l'espace
La recherche se limite dans l'aire de santé de Kamulumba,
situé dans la ville de Kananga, province du Kasaï-Central, en
République Démocratique du Congo.
5. DOMAINE ET TYPE
D'ÉTUDE
a) Domaine de l'étude
L'étude s'inscrit dans le domaine de la santé
publique et de l'épidémiologie environnementale, plus
précisément dans le sous-domaine de la gestion de l'eau et de
l'hygiène (WASH - Water, Sanitation, and Hygiène).
b) Type d'étude
Notre étude est de type descriptif simple
corrélationnel à visée analytique.
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
divisé et trois chapitres :
? Le premier parle de la revue de littérature ;
? Le deuxième s'article de la méthodologie de
recherche ;
? Et enfin le dernier parle de présentation des
résultats et la discussion.
~ 7 ~
CHAPITRE. I. RECENSION DES ÉCRITS PERTINENTES
OU REVUE DE LA LITTÉRATURE
DEVIS DE LA RECHERCHE
Nous avons mené une étude descriptive simple
à visée analytique. L'étude cherche à
évaluer les facteurs associés au faible traitement de l'eau dans
l'aire de santé Kamulumba. Le lieu choisi pour notre étude est
l'aire de santé Kamulumba dans la province du Kasaï central.
I. I. DÉFINITION DE CONCEPTS I.1. 1. Facteurs
associés
Le terme « facteur » désigne un
élément, une condition ou une caractéristique qui peut
influencer l'occurrence ou l'intensité d'un phénomène.
Dans le cadre de cette étude, les facteurs se réfèrent aux
éléments qui expliquent la faible utilisation des méthodes
de traitement de l'eau par les ménages du quartier Kamulumba. (Rosa
& Clasen, 2010).
1.1.2 Traitement de l'eau
Le traitement de l'eau désigne l'ensemble des
procédés physiques, chimiques ou biologiques visant à
rendre l'eau propre à la consommation humaine en éliminant ou en
réduisant les contaminants dangereux pour la santé. Dans le cadre
domestique, le traitement de l'eau inclut des méthodes telles que
l'ébullition, la filtration, la chloration, ou l'utilisation de
solutions à base d'argent colloïdal. (Rosa & Clasen, 2010).
I.1.4. Aire de santé
Une aire de santé est une zone géographique
spécifique qui est délimitée pour la gestion des services
de santé. Elle est généralement définie par des
critères démographiques et géographiques et est
responsable de la fourniture de soins de santé à une population
donnée. Les aires de santé sont souvent organisées autour
d'un centre de santé de référence qui coordonne les
activités de santé, assure le suivi des indicateurs sanitaires et
facilite l'accès aux soins. (OMS, 2007).
~ 8 ~
I.2 GÉNÉRALITÉS SUR L'EAU
L'eau
Nom féminin du latin aqua, l'eau est un corps incolore,
inodore, insipide, liquide à la température ordinaire. L'eau est
considérée par les anciens comme l'un des quatre
éléments de base avec le feu, l'air et la terre. L'eau est un
élément central du corps humain, puisqu'elle en est le principal
constituant. La quantité d'eau dans le corps humain varie d'une personne
à l'autre selon plusieurs facteurs (corpulence, âge et sexe
notamment) et représente environ 60% du poids d'un individu.
Elle est le substrat fondamental des activités
biologiques el le constituant le plus important des êtres vivants (70% de
leurs poids en moyenne). La majeure partie de l'eau (97%) est contenue dans les
océans, et est salée, ce qui la rend inutilisable pour l'Homme
(Assouline et Assouline, 2007). Les 3% d'eau douce restants ne sont toutes fois
pas entièrement disponibles pour l'homme. En effet, environ 68,3%de
celle-ci se présente à l'état solide dans les glaciers et
31,4% seulement se trouve à l'état liquide dans les nappes
phréatiques, les lacs d'eau douce, les rivières et l'eau contenue
dans la matière vivante, etc. une faible proportion de ces 31,4% est
sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère (Assouline et Assouline,
2007).
L'eau est indispensable à l'équilibre de
l'organisme. Pour compenser les pertes en eau (via l'urine, la
transpiration...), nous nous hydratons à travers l'eau que nous buvons
et les aliments que nous mangeons. Pour boire et satisfaire ses besoins
d'hygiène, chaque personne a besoin, chaque jour de 20 à 50
litres d'eau. Si l'eau douce est vitale pour la santé, elle l'est
également pour les écosystèmes qui nous fournissent notre
alimentation.
Le maintien de sa qualité est donc essentiel. Or, l'eau
peut être source de risques si elle n'est pas de qualité
suffisante ou si certains éléments susceptibles de transmettre
des maladies s'y développent. (Assouline, 2007)
Eau potable :
Est une eau que l'on peut boire sans risque pour la
santé. C'est-à-dire une eau bonne pour la consommation, elle doit
être limpide, incolore, fraiche, inodore, pouvoir cuire les
légumes sans les durcir et donner avec le savon une mousse
~ 9 ~
onctueuse sans grumeaux, surtout elle doit être pauvre
en chlorure, ne renferme ni nitrates, ni nitrites, ni ammoniaque, ni aucun
microbe pathogène. L'eau potable est une eau qui doit être
exemptée de microorganismes pathogènes et de substances toxiques
en vue de la préserver, contenir une certaine quantité de sels
minéraux et de microorganismes saprophytes.
Elle doit par ailleurs être limpide, incolore et ne
présente aucun goût ni odeur désagréable (O.M.S,
1986). L'eau potable est toute eau qui ne porte pas atteinte à la
santé du consommateur, quelques soit son âge ou son état
physiologique, et ce à court terme et à long terme. Les
caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques doivent
être conformes à des normes de potabilité (Ramband et
Dellatre, 1992).
Selon l'OMS, l'eau potable est celle dont la consommation est
sans danger pour la santé, mais pour que l'eau soit qualifiée
potable, elle doit satisfaire à des normes relatives aux
paramètres organoleptiques (odeur, couleur, morbidité, saveur),
physico-chimiques (température, potentiel d'hydrogène),
microbiologiques (coliformes fécaux et totaux streptocoques
fécaux). D'après le code algérien des eaux du 16/07/1983
dans son article 57 chapitre 1, une eau est dite potable lorsqu'elle n'est pas
susceptible de porter atteinte à la santé de ceux qui la
consomment.
Elle ne doit pas contenir de substances chimiques en
quantité nuisible à la santé publique ni de germes
pathogènes. Elle doit être inodore, incolore et agréable
à boire. En général on adopte les normes de l'O.M.S, ces
normes sont assez tolérantes vis-à-vis de certains
critères. Les plus utilisés sont les critères
physico-chimiques et les critères toxicologiques. Il importe à
chaque pays, d'établir sa propre législation, en fonction des
critères locaux et du degré de son développement. Les
standards référence dans ce domaine différent donc, selon
les époques et les pays. (OMS 2011)
Les normes de qualité d'une eau potable sont
données :
? Selon les normes algériennes relatives à la
qualité d'eau de consommation humaine (décret exécutif
n° 11-125 JO N°18 du 23mars 2011).
? Selon les valeurs guide de l'OMS en 2006.
? Caractéristiques d'une eau potable.
'- 10 '-
L'eau destinée à la consommation humaine doit
répondre aux règlements généraux d'hygiène
et à toutes les mesures propres pour préserver la santé de
l'homme.
a) Couleur
Une eau potable ne doit pas présenter une couleur,
cependant la coloration de celle-ci est due généralement à
la présence de substance colorées provenant essentiellement : De
la nature présence de substances minérales en particulier le fer
et le manganèse.
De l'eutrophisation (développement excessif d'algues
et de plancton) ainsi la décomposition des matières
végétales.
De l'industrie chimique (teinture et l'industrie textile).
Une coloration de l'eau est indésirable, car elle
provoque toujours un doute sur sa potabilité. Elle doit être
éliminée pour la rendre agréable à boire
(Degremont, 1989).
b) Odeur
Toute odeur est un signe de pollution ou de présence
de matières organiques en décomposition. L'odeur peut être
définie comme : L'ensemble des sensations perçues par l'organe
olfactif en flairant certaines substances volatiles.
La qualité de cette sensation particulière est
provoquée par chacune de ces substances (Rodier, 2005).
c) Goût et saveur
Le goût peut être défini comme l'ensemble
des sensations gustatives, olfactives et de sensibilité chimique commune
perçue lors de la boisson est dans la bouche (Rodier, 2005).
La saveur peut être définie, comme l'ensemble des
sensations perçues à la suite de la stimulation par certaines
substances solubles des bourgeons gustatifs (Rodier, 2005). Les maladies
liées à l'eau sont des pathologies causées par la
consommation ou le contact avec de l'eau contaminée. Ces maladies
peuvent être d'origine bactérienne, virale, parasitaire ou
chimique. Voici une liste des
Guerrant, R. L. et al. (1999). Infectious diarrhea in
developed and developing countries. The Journal of Clinical
Investigation.
'- 11 '-
principales maladies liées à l'eau, avec les
auteurs ou références scientifiques appropriés (notamment
les organisations internationales et les chercheurs qui ont travaillé
sur ces maladies) :
? 1. Choléra
Agent pathogène : Vibrio
cholerae
Transmission : ingestion d'eau ou d'aliments
contaminés
Auteur(s)/Références :
World Health Organization (WHO, 2023)
Sack, D. A., Sack, R. B., et al. (2004). Cholera. The
Lancet.
2. Typhoide (fièvre typhoide)
Agent pathogène : Salmonella typhi
Transmission : ingestion d'eau ou d'aliments
contaminés
Auteur(s)/Références :
Crump, J. A., & Mintz, E. D. (2010). Global trends in
typhoid and paratyphoid
Fever. Clinical Infectious Diseases. WHO (2020)
3. Dysenterie (bacillaire ou amibienne) Agents pathogènes
:
Bacillaire : Shigella spp.
Amibienne : Entamoeba histolytica
Transmission : eau ou aliments souillés
Auteur(s)/Références :
~ 12 ~
WHO
4. Hépatite A et E
Agent pathogène : Virus de l'hépatite A ou E
Transmission : eau contaminée (voie
oro-fécale)
Auteur(s)/Références :
WHO (2022). Hepatitis A and E Fact Sheets
Lemon, S. M. et al. (1991). Hepatitis A virus.
Fields Virology.
5. Diarrhées infectieuses
Causes : virus (rotavirus, norovirus), bactéries,
parasites
Transmission : ingestion d'eau contaminée
Auteur(s)/Références :
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply,
Sanitation
and Hygiene (WASH)
Black, R. E. et al. (2010). Global, regional, and
national causes of child mortality.
The Lancet.
6. Bilharziose (schistosomiase)
Agent pathogène : Schistosoma spp.
: Transmission : contact avec de l'eau douce infestée
de larves de parasites
Auteur(s)/Références
WHO (2023). Schistosomiasis Fact Sheet
Gryseels, B. et al. (2006). Human schistosomiasis.
The Lancet.
7. Dracunculose (ver de Guinée)
Agent pathogène : Dracunculus medinensis
~ 13 ~
Transmission : ingestion d'eau contenant des
crustacés infectés (cyclopes) Auteur(s)/Références
:
CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
Hopkins, D. R. et al. (2002). Dracunculiasis eradication: and
now, Sudan. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
8. Giardiase
Agent pathogène : Giardia intestinalis
Transmission : eau contaminée par des kystes du
parasite
Auteur(s)/Références :
Adam, R. D. (2001). Biology of Giardia lamblia.
Clinical Microbiology Reviews.
WHO (2020)
9. Cryptosporidiose
Agent pathogène : Cryptosporidium parvum
Transmission : eau contaminée
Auteur(s)/Références :
Current, W. L., & Garcia, L. S. (1991).
Cryptosporidiosis. Clinical Microbiology Reviews.
10. Légionellose
Agent pathogène : Legionella pneumophila
Transmission : inhalation d'aérosols d'eau
contaminée (ex : douches, climatiseurs)
Auteur(s)/Références :
Fields, B. S. et al. (2002). Legionella and Legionnaires'
disease. Clinical Microbiology Reviews.
Sources générales recommandées :
~ 14 ~
OMS (WHO) : https://www.who.int/
Les caractéristiques d'une bonne eau, notamment pour la
consommation humaine, sont liées à sa qualité physique,
chimique et microbiologique. Voici les principales :
1. Caractéristiques physiques
Incolore : L'eau ne doit pas avoir de couleur visible.
Inodore : Aucune odeur suspecte (pas d'odeur de chlore, de
moisi, ou d'oeufs pourris).
Sans goût désagréable : Elle doit avoir
un goût neutre ou légèrement minéral selon sa
composition.
Claire et limpide : Sans turbidité (pas de particules
en suspension visibles à l'oeil nu).
Température agréable : Idéalement entre
8 °C et 12 °C pour la consommation.
2. Caractéristiques chimiques
pH neutre ou légèrement alcalin : Entre 6,5 et
8,5.
Faible teneur en nitrates : Moins de 50 mg/L (selon l'OMS et
les normes européennes).
Absence de métaux lourds toxiques : Plomb, mercure,
arsenic, cadmium, etc. Teneur modérée en minéraux (sels
minéraux) :
Calcium et magnésium : Bon pour les os et les muscles
(mais pas en excès). Sodium : Faible teneur recommandée (< 200
mg/L).
Résidu sec : Indique la minéralisation
(inférieur à 500 mg/L pour une eau faiblement
minéralisée).
Absence de substances chimiques polluantes : Pesticides,
hydrocarbures, solvants, etc.
~ 15 ~
3. Caractéristiques microbiologiques
Absence totale de micro-organismes pathogènes :
Pas de coliformes fécaux (ex. : E. coui),
Pas de bactéries pathogènes,
Pas de virus ou de parasites.
L'eau potable doit être stérile du point de vue
sanitaire.
4. Sécurité sanitaire
Conforme aux normes de l'OMS ou aux réglementations
nationales (ex : normes européennes, normes canadiennes, etc.).
Contrôlée régulièrement par des
laboratoires accrédités.
Bonus : Autres critères importants
Origine contrôlée : Eau de source ou eau
minérale naturelle avec traçabilité. Stable dans le temps
: Pas de variation brusque de qualité.
Respect de l'environnement : Captage durable, sans impact
négatif sur l'écosystème local.
Voici les étapes principales du traitement de l'eau
potable, depuis sa captation jusqu'à sa distribution :
1. Captation de l'eau
Source : rivière, lac, nappe souterraine, barrage, etc.
L'eau brute est prélevée et acheminée vers
une station de traitement. ?? 2. Dégrillage / Prétraitement
Retrait des gros déchets (branches, feuilles,
plastiques...) à l'aide de grilles ou de filtres mécaniques.
~ 16 ~
?? 3. Coagulation - Floculation
Coagulation : ajout de produits chimiques (ex. : sels
d'aluminium ou de fer) qui
font agglomérer les particules fines.
Floculation : formation de flocs (amas de particules) plus gros,
faciles à éliminer.
?? 4. Décantation
L'eau repose dans de grands bassins.
Les flocs formés se déposent au fond
(sédimentation).
L'eau claire surnageante est récupérée.
?? 5. Filtration
L'eau passe à travers des filtres (sable, charbon actif,
graviers...). Cela élimine les dernières particules en
suspension.
?? 6. Désinfection
Des agents désinfectants sont ajoutés pour tuer
les micro-organismes pathogènes. Exemples : chlore, ozone, rayons UV.
Cette étape garantit la potabilité de l'eau
jusqu'au robinet.
?? 7. Stockage et Distribution
L'eau traitée est stockée dans des
réservoirs ou châteaux d'eau.
Elle est ensuite acheminée via les canalisations jusqu'aux
consommateurs.
?? (Parfois) Étapes supplémentaires
Selon la qualité de l'eau de départ :
Adoucissement (contre le calcaire)
Défluoration / Dénitrification
Désalinisation (dans les régions
côtières)
~ 17 ~
Osmose inverse (eau très polluée ou
salée)
La conservation de l'eau est un ensemble de pratiques, de
techniques et de comportements visant à utiliser l'eau de manière
plus efficace, à réduire les gaspillages et à
préserver cette ressource vitale pour les générations
actuelles et futures.
Pourquoi la conservation de l'eau est-elle importante ?
Rareté de l'eau douce : Moins de 3 % de l'eau sur Terre
est douce, et moins de 1 % est directement accessible (rivières, lacs,
nappes phréatiques peu profondes).
Croissance démographique : Plus de population = plus de
besoins en eau pour boire, cultiver, produire.
Changement climatique : Il provoque des sécheresses,
des pénuries et une baisse de la qualité de l'eau.
Pollution : Les eaux usées non traitées et les
produits chimiques contaminent les ressources.
Agriculture intensive : Elle consomme près de
70 % de l'eau douce disponible à l'échelle
mondiale.
?? Objectifs de la conservation de l'eau
Réduire le gaspillage d'eau.
Assurer un accès équitable à l'eau
potable.
Maintenir l'équilibre écologique des milieux
aquatiques.
Prévenir les conflits liés à l'eau.
??? Principales méthodes de conservation de l'eau 1.
À l'échelle domestique
Réparer les fuites rapidement.
Installer des robinets et des douches à faible
débit.
Falkenmark, M. & Rockström, J.
(2004). Balancing Water for Humans and Nature: The New Approach in
Ecohydrology.
~ 18 ~
Utiliser des toilettes à faible consommation d'eau.
Réutiliser l'eau grise (eau de lavabo, douche) pour
l'arrosage. Collecter l'eau de pluie.
2. En agriculture
Irrigation au goutte-à-goutte : très efficace, car
elle limite l'évaporation.
Choix de cultures adaptées au climat local.
Paillage : pour retenir l'humidité du sol.
Stockage de l'eau de pluie pour l'irrigation.
3. En industrie
Recyclage et réutilisation de l'eau dans les processus
industriels. Utilisation de technologies moins consommatrices d'eau.
Traitement des eaux usées pour une réutilisation
sécurisée. Cadres légaux et politiques
Les gouvernements, ONG et organisations internationales comme
l'ONU, l'OMS, et l'UNESCO mettent en oeuvre des politiques de gestion
intégrée de l'eau, notamment à travers les ODD
(Objectifs de Développement Durable),
en particulier :
ODD 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et
à l'assainissement ?? References et auteurs clés
UNESCO (2023). Rapport mondial des Nations Unies sur
la mise en valeur des ressources en eau.
Gleick, P. H. (1998). The World's Water: The Biennial
Report on Freshwater Resources.
~ 19 ~
World Bank (2021). Water in Circular Economy and
Resilience.
La conservation de l'eau n'est pas seulement une question
environnementale : c'est une nécessité économique, sociale
et éthique. Elle nécessite une action collective : citoyens,
agriculteurs, industries et États doivent coopérer pour garantir
une gestion durable de l'eau.
L'eau Et La Santé :
L'eau contaminée et le manque d'assainissement
entraînent la transmission des maladies, comme le Choléra, la
Diarrhée, la Dysenterie, l'Hépatite A, la Fièvre
typhoïde, et la poliomyélite. L'insuffisance ou l'absence des
services d'alimentation en eau et d'assainissement ou leur mauvaise gestion
expose les personnes concernées à des risques évitables
pour leur santé. C'est particulièrement vrai dans les
établissements de santé où les patients et le personnel
courent un risque supplémentaire d'infection et de maladie lorsqu'il n'y
a pas de services d'alimentation en eau, d'assainissement et
d'hygiène.
| 


