|
INTRODUCTION GENERALE
La protection de l'environnement est devenue l'un des enjeux
majeurs des relations internationales contemporaines. Plus aucun acteur
politique, économique ou social ne s'en passe, même si c'est plus
par démagogie que par conscience1(*). De plus, le citoyen se sent d'autant plus
concerné par la dégradation de la nature qu'il est à
même de remarquer que l'environnement reprend place dans le champ visuel
du citadin2(*). Force est
donc de constater qu'aujourd'hui
La protection de l'environnement a fini par s'imposer
à la conscience universelle comme une
nécessité3(*).
Ce constat fait suite à la prise de conscience par
l'opinion publique mondiale de l'urgence d'une protection de l'environnement,
qui nécessite une coordination et une coopération internationale.
Le processus du développement durable s'inscrit dès lors comme un
exemple du communautarisme international face à la
mondialisation4(*).
Comme l'a souligné la Cour Internationale de Justice
dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros5(*) ,
Au cours des âges, l'homme n'a cessé
d'intervenir dans la nature pour des raisons économiques et autres. Dans
le passé, il l'a souvent fait sans tenir compte des effets sur
l'environnement. Grâce aux nouvelles perspectives qu'offre la science et
à une conscience croissante des risques que la poursuite de ces
interventions à un rythme inconsidéré et soutenu
représenterait pour l'humanité - qu'il s'agisse des
générations actuelles ou futures - de nouvelles normes et
exigences ont été mises au point, qui ont été
énoncées dans un grand nombre d'instruments au cours des deux
dernières décennies. Ces normes nouvelles doivent être
prises en considération et ces exigences nouvelles convenablement
appréciées, non seulement lorsque des États envisagent de
nouvelles activités, mais aussi lorsqu'ils poursuivent des
activités qu'ils ont engagées dans le passé.
En effet, depuis une trentaine d'années, l'outil
juridique, tout particulièrement le droit international, est
sollicité pour protéger l'environnement et devient, selon
Elisabeth DOWDESWELL, ancienne Directrice générale du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'un des instruments les plus
effectifs pour former et renforcer le consensus dans la communauté
internationale en vue de faire face aux problèmes mondiaux de
l'environnement les plus aigus. Ce droit met en interaction tous les acteurs de
la vie internationale (Etats, OIG, Collectivités territoriales
décentralisées, Associations de protection de l'environnement,
populations, etc.) qui ont chacun un rôle à jouer dans la gestion
de l'environnement6(*).
La compréhension de ce sujet nécessite que nous
l'abordions d'abord dans un cadre théorique (I), ensuite dans un cadre
épistémologique (II).
I. CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE
Envisager cette étude dans son cadre théorique
recommande tout d'abord que nous la placions dans son contexte et que nous en
définissions les concepts fondamentaux (1). Bien après, revisiter
les différentes études connexes nous permettra de ressortir
l'originalité de notre étude par l'intérêt qui s'y
dégage, et de procéder à une bonne délimitation de
cette étude (2).
I.1. Contexte de l'étude et clarifications
conceptuelles
Phénomène de mode ou simple
nécessité de développement, le problème de la
protection de l'environnement tient à vrai dire des deux.
Phénomène de mode, les préoccupations environnementales
apparaissent comme l'expression d'une «conscience
retardataire» sur le progrès de l'humanité7(*) à une époque
où se faisaient jour des revendications de toute sorte. En effet, le
« droit à un environnement de
qualité » que la célèbre Déclaration
de Stockholm de 1972 promeut au rang de droit de l'homme8(*) n'est reconnu officiellement sur
le plan international que depuis une époque récente9(*). La protection de
l'environnement est aujourd'hui ancrée dans les moeurs au point
d'inspirer la réglementation d'activités quotidiennes :
gestion de l'eau, de l'air ; lutte contre le bruit ;
l'élimination des déchets ménagers, industriels ; la
gestion des emballages plastiques etc. ...
Au-delà du phénomène de mode, la gestion
de l'environnement n'a cessé de prendre de l'importance10(*) ; sur la scène
internationale, le débat sur l'environnement est sans doute celui qui
rencontre le plus aisément un large consensus, voire une
véritable solidarité. Il semble aujourd'hui que la
référence au triplet
« population-environnement-développement »
est indispensable pour appréhender les problèmes du monde actuel
dans toute leur complexité. Nécessité de
développement assurément à une époque où
l'accès à la modernité et au bien-être, ou tout au
moins à la croissance économique, passe inéluctablement
par la maitrise des procédés de préservation du patrimoine
naturel. D'où la prise de conscience du lien intime entre le
développement et l'environnement11(*). La notion
d' « écodéveloppement »12(*) se renforce donc comme le
montre la Conférence de Rio de Janeiro de Juin 1992, consacrée
à une réflexion sur le développement rationnel et durable
étayée par l'écologie13(*).
Cette aspiration à protéger l'environnement
contre les atteintes de l'homme n'est pas restée l'apanage des pays
riches. La conscience des pays en voie de développement (PVD) de la
nécessité de préserver leur environnement existait
déjà au lendemain des indépendances, mais elle est bien
plus manifeste depuis la Conférence de Rio de 1992. D'ailleurs au
Cameroun, les notions
d' « écodéveloppement » et de
« développement durable »14(*) naissent manifestement au
lendemain de ladite Conférence avec la consécration, par la Loi
Constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution
du 03 juin 1972, et la Loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant Loi-cadre
Relative à la gestion de l'environnement, de la nécessité
de protéger l'environnement, considéré comme un
« patrimoine commun de la nation »15(*). Dans le même ordre
d'idée, le processus de décentralisation est
déclenché aux fins de renforcer la démocratie et la bonne
gouvernance au niveau local16(*). La Loi de la décentralisation participe
alors de ce renforcement par les collectivités territoriales que sont
les communes et les régions dont la « mission est de
promouvoir le développement économique, social, sanitaire,
culturel éducatif et sportif de la
collectivité »17(*). Si les Communes et les Communautés Urbaines
ont commencé à faire leurs preuves depuis leur création,
les Régions dont la mise en place tarde encore18(*), viendront compléter le
puzzle des institutions décentralisées qui ont pleine
compétence en matière de gestion de l'environnement. De fait, de
ces institutions, les populations en attendent beaucoup. D'abord
l'amélioration du cadre démocratique, ensuite, et
précisément, l'amélioration de leurs conditions de vie qui
dépendent de la possibilité pour elles de jouir ou de vivre dans
un environnement décent19(*).
D'après BOURDIEU, PASSERON et CHAMBOREDON,
« Un objet, si partiel et si parcellaire soit-il, doit être
défini, construit, conquis... »20(*). Ainsi la
définition des concepts que renferme notre sujet devrait nous permettre
de situer les prémisses de notre recherche. En effet, une
définition est un préalable analytique qui permet d'éviter
des confusions, des erreurs, ou des débats inutiles21(*). La définition du
conceptd' « environnement » auquel on ajoute
ceux de « protection » et
de « collectivités territoriales
décentralisées » est donc nécessaire.
L'étude du droit de l'environnement suppose que l'on se
détermine préalablement sur une définition de ce concept
sur lequel bien de querelles étymologiques ou
épistémologiques s'y affrontent22(*). En effet, la notion d'environnement a en
réalité un contenu peu précis23(*),
voire floue24(*). Pour
éviter toute confusion, il convient de la distinguer des notions
voisines telles que la nature25(*), la qualité de la vie26(*), l'écologie27(*), lesquelles en
réalité expriment une nuance fondamentale. De plus, les notions
de « milieu », et « cadre de
vie », ne sont pas plus claires que celles d'environnement.
Elles traduisent plutôt la synonymie qui est fréquemment
établie entre environnement et d'autres notions voisines
(biosphère, écosystème, nature, etc.) d'une part et
l'opposition qui existe entre les thèses anthropocentristes et
égocentriques (qui subordonnent la protection de l'environnement
à la satisfaction des intérêts de l'homme, du commerce, de
l'industrie) et les thèses éthiques et éco-centriques (qui
préconisent la protection de l'ensemble de la nature pour
elle-même et qui préfèrent parler de milieu, de
biosphère etc. ...) d'autre part28(*).
De fait, le terme
« environnement » ne fait pas l'objet d'une
définition générale universellement admise au sein de la
doctrine. Déjà, le Petit Robert de la Langue Française le
définit à la fois comme « l'ensemble des
éléments constitutifs du milieu d'être vivant »
et comme « l'ensemble des éléments
constitutifs du paysage artificiel crée par l'homme »29(*). Pour Gérard
CORNU, il s'agit de l' « ensemble des composantes d'un
milieu déterminé que la législation de protection
désigne »30(*). Toutefois, la Loi-cadre sur l'environnement
entend par environnement :
L'ensemble des éléments naturels ou
artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils
participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités
humaines31(*).
Mettant en emphase les difficultés de
définition, la plupart des textes (contraignants ou non) portant sur
l'environnement se limitent à faire la liste des éléments
qui le constituent32(*).
La jurisprudence pour sa part définit ce concept comme
L'espace ou vivent les êtres vivants et dont
dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris
pour les générations à venir33(*).
Sans entrer dans d'infinies controverses doctrinales, nous
retiendrons ici la définition que nous offre Maurice KAMTO et pour qui
ce terme désigne
L'ensemble de la nature et des ressources y compris le
patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les
activités socioéconomiques et pour le meilleur cadre de
vie34(*).
Cette définition prend en compte les
éléments traditionnels de l'environnement tels la nature et les
ressources naturelles, et intègre les éléments nouveaux
issus de la Déclaration de Rio, en l'occurrence le patrimoine culturel
et les ressources humaines35(*).
Le terme « protection », qui
dérive du latin « protectio », signifie
« action de protéger contre un agresseur ou un
danger »36(*). Ce termerenvoie en effet soit à l'acte de
protéger et les résultats de cette protection, soit au dispositif
ou à l'institution qui protège37(*). Sous cet angle, protéger c'est non seulement
prendre toute mesure utile afin de préserver ou défendre
l'environnement des dangers qui le menacent38(*) mais également prendre
toutes mesures permettant de soutenir ou de favoriser, par une aide, son
développement39(*).
La protection de l'environnement doit donc être entendue
dans un sens large qui englobe
Toutes les actions de sauvegarde proprement dites des
milieux naturels et artificiels, mais également tous les aspects
liés à la gestion rationnelle des ressources, à la
prévention et à la réparation des atteintes au cadre de
vie, englobant éventuellement la protection des monuments et des sites
et de l'urbanisme de manière accessoire dans le cadre de
l'écologie dite urbaine40(*).
Ainsi, la protection de l'environnement peut de ce fait se
faire par divers moyens : politiques, technologiques, scientifiques,
juridiques etc. Les moyens juridiques passent par la formulation de trois
grands types de règles : des règles préventives qui
règlementent les rapports des différents acteurs de
l'environnement ; des règles répressives qui sanctionnent la
violation des premières ; et des règles curatives qui
organisent la réparation des dommages causés à
l'environnement. Le droit met également en place des institutions
chargées de coordonner ou de contrôler le respect des
règles de protection instituées. Considérée sous
cet angle, la protection en tant qu'ensemble de règles
préventives, répressives et curatives que le droit aménage
semble mieux rendre compte de la réalité qui nous
intéresse.
Compte tenu de l'importance qui lui est reconnu, la protection
de l'environnement doit être intégrée dans les processus de
développement économiques et sociaux41(*) ; autant qu'elle doit
être prise en compte par les collectivités territoriales dans
l'exercice de leurs compétences42(*).
Définir le concept de
« collectivitéterritoriale
décentralisée » commande que soit au
préalable levée toute ambigüité entre les notions de
collectivitéterritoriale décentralisée et
collectivité locale43(*). En effet l'Etat, collectivité
territoriale, n'est pas une collectivité locale. Mais abstraction faite
de l'Etat, les collectivités territoriales sont tous exactement des
collectivités locales44(*). Pour peu qu'on s'en réfère à
l'étranger, on se rend compte que le Conseil Constitutionnel
français ne fait pas de distinction entre les notions de
collectivité territoriale et collectivité locale. Ainsi dans sa
décision sur la Corse45(*), il emploie le terme collectivité
locale ; alors que dans sa décision « Territoire
Nouvelle-Calédonie »46(*) il employait le terme collectivité
territoriale. Ainsi selon cette jurisprudence du Conseil Constitutionnel
français, les deux termes sont interchangeables, voir synonymes. C'est
donc fort de cela que de manière récurrente, il est fait usage
indistinctement des expressions collectivité territoriale,
collectivité locale et collectivité territoriale
décentralisée. Aussi ferons-nous dans le cadre de ce travail
usage, indistinctement, de ces deux expressions.
L'on peut alors définir collectivité
territoriale comme
[Une institution] de droit public correspondant à
des groupements humains géographiquement localisés sur une
portion déterminée du territoire national, auquel l'Etat a
conféré la personnalité juridique et le pouvoir de
s'administrer par des autorités élues47(*).
Pour la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, en son
article 55 alinéa 1, les collectivités territoriales
décentralisés de la République sont limitativement
énumérées. Ce sont les communes et les régions.
Pour ce qui est des collectivités communales, on en
distingue trois variantes : les communes ordinaires, les communes
d'arrondissement et les communautés urbaines48(*). La commune ordinaire est la
collectivité décentralisée de base au Cameroun49(*). Par ailleurs, la commune
d'arrondissement est l'appellation donnée aux communes de grande ou
moyenne agglomération urbaine (par exemple : commune
d'arrondissement de Douala 1er, 2e 3e etc.)
dont l'ensemble forme une communauté urbaine. On comprend donc que la
communauté urbaine est un ensemble d'au moins deux communes
d'arrondissement50(*).
La collectivité régionale quant à elle
est une collectivité territoriale décentralisée
constituée de plusieurs départements. Son assise territoriale est
celle des régions.
I.2 Revue de la littérature, intérêt et
délimitation de l'étude
Le droit international de l'environnement connait depuis 1972
un traitement doctrinal de plus en plus impressionnant. Le droit camerounais de
l'environnement quant à lui connait un essor particulier depuis la
participation du Cameroun à la conférence de Rio. Le Professeur
Maurice KAMTO, dans un ouvrage51(*), ne fait aucune allusion aux collectivités
locales quand il analyse les institutions de protection et de promotion de
l'environnement. On aurait pu croire qu'à l'époque où il
commettait cet ouvrage, les préoccupations environnementales au niveau
local ne se faisaient pas tant ressentir encore que le Cameroun venait de
rentrer dans l'ère écologique impulsée par le
Conférence de Rio de 1992. Pour sa part Stéphane DOUMBE
BILLE52(*), fait une
longue analyse sur les institutions de protection de l'environnement.
Même s'il observe que les collectivités locales ont un rôle
crucial dans la mise en oeuvre du droit international de l'environnement,
l'auteur ne précise pas les procédés par lesquels elles
accomplissent la mission qui leur incombe en la matière. Autrement dit,
il ne nous renseigne pas de façon claire sur
« comment » les collectivités locales s'engagent
dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'environnement. On
aurait également pu croire que les urbanistes nous renseigneraient
davantage sur les politiques locales de protection de l'environnement. Or,
Célestin BOMBA53(*)
met un accent particulier plutôt sur l'incidence du développement
urbain sur l'environnement au Cameroun ; alors que Barthelemy KOM
TCHUENTE54(*) faisant des
communes le centre d'impulsion de gestion de l'environnement au Cameroun,
rappelle qu'elles sont au centre des préoccupations environnementales en
tant qu'acteur. Aucune réflexion n'est toujours faite sur les moyens de
mise en oeuvre de la protection de l'environnement à la disposition des
collectivités locales. Mais Maurice KAMTO revenant dans une étude
récente55(*),
souligne que les collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun disposent d'importants pouvoirs
d'action en matière de protection de l'environnement ; ce qui fait
d'elles des instruments de mise en oeuvre du droit international de
l'environnement. Paul DASSE56(*) partage cet avis lorsqu'il s'intéresse aux
compétences des collectivités locales en matière de
gestion de l'environnement marin et côtier notamment de la voirie des
baignades, de l'hygiène et de la salubrité. Mais aucune mention
n'est toujours faite sur les politiques élaborées par ces
collectivités. Mais comment sont prises en compte les
préoccupations environnementales dans cette entreprise de ville
nouvelle ?
On aurait pensé trouver une réponse dans les
thèses et les mémoires consultés. En effet, Louis
Bernard TCHUIKOUA57(*)
s'intéresse plus à la gestion des déchets ménagers
à Douala qu'aux politiques déployées par les
collectivités locales. Chantal Marie NGO TONG58(*) semble répondre
à notre préoccupation, mais à moitié, lorsqu'elle
évoque la coopération intercommunale comme moyen de gestion des
problèmes environnementaux en milieu urbain. Cette question de la
coopération décentralisée semble préoccuper la
doctrine. Car si Jean Christophe LUBAC59(*) s'attache au problème juridique que pose la
coopération décentralisée au niveau international dans son
analyse, Guy MVELLE MINFENDA60(*) s'attarde quant à lui sur les exigences de
l'aide française dans la coopération décentralisée.
Cette question ne manque pas moins d'alimenter d'autres
réflexions61(*). On
remarque avec force que les questions environnementales sont examinées
dans le cadre de cette coopération, mais cette technique n'est pas la
seule à même de résoudre les problèmes
environnementaux de notre cité. Antoine NGAMALEU NDJIADEU62(*) et Bernard EDOUA
BILONGO63(*) se
rapprochent de notre sujet sans le traiter. Si le premier postule en effet que
les collectivités locales participent à la protection de
l'environnement marin, car elles ont compétences générales
pour l'aménagement du territoire communal, le second centre son
attention sur les fondements et les critères de la répartition
des compétences entre l'Etat et les collectivités locales. Ainsi
l'administration locale peut édicter des normes relatives au maintien de
l'ordre public dont les composantes essentielles sont la salubrité, la
tranquillité et la sécurité publique ; ceci dans la
mesure où elles maitrisent les problèmes environnementaux
auxquels font face les populations. A s'en tenir à la réflexion
sobrement menée par Antoine NGAMALEU, les collectivités
territoriales sont des acteurs principaux dans la lutte contre les
dégradations des ressources naturelles, et à ce titre, elles
disposent d'une large marge de manoeuvre pour prendre des mesures de protection
de l'environnement. MATCHUM KOAGNE64(*) partage pleinement cet avis lorsque dans son
mémoire, en analysant les mécanismes juridiques de protection de
l'environnement contre les nuisances sonores, elle s'intéresse plus aux
communes, et leur rôle en tant qu'acteurs principaux en matière
d'environnement au Cameroun. On se retrouve la peu à peu
rapproché de notre sujet.
Il est souhaitable de faire état de l'actualité
de cette thématique avant de s'appesantir sur son
intérêt.
L'actualité de ce sujet est marquée par
l'adoption de nouveaux textes sur la décentralisation, qui depuis 2004
revitalisent le processus de la décentralisation au Cameroun. Lesquels
textes confient aux collectivités territoriales
décentralisées des missions importantes en matière
d'environnement. En se référant à l'étranger, nous
nous rendons évidement compte de ce que la protection de l'environnement
par les collectivités locales est l'objet de plusieurs débats au
sein des deux chambres du parlement français depuis la Grenelle
II65(*). D'ailleurs, la
commission du développement durable a présenté ses comptes
rendus devant le sénat le 24 octobre 2012. Il ressort de ces rapports
que les acteurs de protection de l'environnement au premier chef desquels se
trouvent les collectivités territoriales doivent renforcer leurs
capacités dans la lutte contre la dégradation des ressources
disponibles au niveau local. Au Cameroun, cela ne fait l'objet d'aucun doute
que la question préoccupe aussi les pouvoirs publics. Quelques textes
réglementaires transférant certaines compétences aux
communes en matière d'environnement témoignent de ces
préoccupations.
L'intérêt qui en découle est d'abord
scientifique, car peu ou presque pas d'études ont été
menées sur la question au Cameroun. En outre, cette étude
revêt un intérêt pratique perceptible tant sur le plan
juridico-social et que sur le plan écologique.
Sur le plan juridico-social, compte tenu des
compétences transférées aux collectivités locales
en matière d'environnement dans le cadre de la décentralisation,
nous partons du constat de la proximité de ces collectivités aux
populations, et des attentes de ces dernières en ce qui concerne leur
épanouissement dans un environnement sain et propice à leur
bien-être, pour nous interroger sur la capacité de ces
collectivités à remplir leur mission. Ainsi ne manquerons-nous
pas de passer en revue les conventions internationales, régionales ainsi
que les lois nationales en matière d'environnement, toutes pertinentes
pour y apprécier le degré de prise en compte de la protection de
l'environnement, et la place accordée aux collectivités
territoriales dans cette entreprise de protection. Car, empruntant l'expression
à Laurent GRANIER,
Seule une réflexion des juristes [...] sur
leur patrimoine juridique peut montrer la voie du progrès dans un
domaine qui, bien que souvent très technique, reste dépendant de
la volonté politique des Etats66(*).
Sur le plan écologique, cette analyse permettra de
déterminer les limites et les failles dans le domaine de gestion des
ressources au niveau local afin de contribuer à la mise en place d'un
système de protection adéquat et adapté, car
l'environnement est exposé à divers types d'atteintes
aujourd'hui. Cette étude permettra aussi de mesurer le degré
d'implication des collectivités décentralisées dans la
protection de leur environnement, dans la lutte contre la pauvreté, dans
l'amélioration de la santé de sa population et dans
l'éducation afin de suggérer des solutions et des pistes
d'amélioration pour un environnement sain et profitable à tous.
Le droit international de l'environnement fourmille de
conventions multilatérales (universelles et régionales) et
bilatérales toutes visant l'uniformisation des droits nationaux en la
matière. L'intégration des normes internationales dans la
législation interne commande pour leur mise en oeuvre leur adaptation
à l'évolution actuelle67(*) et aux réalités locales
particulières. La décentralisation68(*), voie dans laquelle de
nombreux pays, parmi lesquels le Cameroun, se sont résolument
engagés69(*),
semble la meilleure option pour l'opérationnalisation du droit
international de l'environnement car les collectivités ont un
rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement du fait de
leur connaissances du milieu et de leur pratique70(*). Le processus de
décentralisation pose désormais le problème de la gestion
desdites ressources au niveau des unités
décentralisées71(*), et évoque subrepticement la
problématique de la ville durable72(*). Ainsi, par le
mécanisme de transfert de certaines compétences par l'Etat aux
collectivités territoriales en matière d'environnement,
l'administration centrale implique davantage celles-ci dans la mise en oeuvre
effective du Droit international de l'environnement. L'élaboration d'un
Agenda 2173(*) à
l'échelon des collectivités est une réelle
opportunité74(*).
D'ailleurs, les enjeux liés à la préservation de
l'environnement étant désormais au coeur des
préoccupations planétaires, la disponibilité effective
d'un Agenda 21 pour la ville, apparaît de plus en plus comme un
préalable aux négociations avec les partenaires au
développement. De fait, la mise sur pied d'un Agenda 21 local est
largement tributaire de l'élaboration de politiques locales
cohérentes.
L'étude des politiques locales a toujours
été un parent pauvre à tel point que leur existence fut
mise en doute par de nombreux auteurs75(*) . Mais l'avènement de la
décentralisation au Cameroun a favorisé « le retour
au local »76(*). Un local appelé à devenir le lieu
d'impulsion du changement. D'ailleurs, la prise en compte du local remonte dans
les années 1950 et évoque la province dans les travaux
d'historiens tels AGULHON77(*) et CORBIN78(*). Le local s'inscrit aussi dans l'espace des
géographes et ses divisions territoriales, tels que le village, les
bourgs, la ville, lieux d'ancrage et nouvelles échelles d'analyse.
Cette notion sur le plan politique traduit une hiérarchisation entre
l'Etat et les entités locales dont les attributions et les
prérogatives sont restées limitées jusqu'à la
décentralisation. Le local est perçu comme un lieu de
collaboration, de coopération et de complémentarité avec
le pouvoir central pour plus de démocratie et d'efficacité de
l'action de l'Etat.
Le local ne sera plus considéré comme un
point d'ancrage du conservatisme et de l'archaïsme escamoté par une
culture politique qui ignore les particularismes ; il se pense
désormais comme un lieu de changement, développant des dynamiques
propres, porteuses d'innovation et de modernité. Ainsi entendu, le local
permet d'appréhender le fait social total. Le local devient un support
d'analyse, révélateur des mécanismes à la fois
politiques et juridiques. Les entités locales sont donc des institutions
à qui échoit de premier chef la résolution des questions
environnementales. Toutefois, l'on observe parfois, et ce de façon assez
symptomatique, que la carence des politiques nationales mises en oeuvre ou bien
leur inadéquation ne favorise pas toujours le zèle des
collectivités territoriales décentralisées dans l'adoption
ou la mise en oeuvre de leurs politiques propres.
Il ne s'agira pas, dans la présente étude, de
faire état des différentes politiques publiques en matière
d'environnement au Cameroun ; mais tout simplement d'analyser celles mises
en oeuvre par les collectivités territoriales en la matière au
regard de la législation nationale.
Cette délimitation n'est pas suffisante pour mener
à bien cette étude. Il importe pour des soucis de
commodité de délimiter très clairement le cadre
spatio-temporel de notre étude. En effet, le cadre spatio-temporel est
un pendant essentiel pour toute étude juridique. Ainsi, comme nous le
fait remarquer le Professeur Magloire ONDOA,
Tout travail de recherche prend la forme et la valeur d'un
commentaire et d'une systématisation théorique de l'état
du droit à un moment donné, dans un contexte précis et sur
un problème juridique donné79(*).
Ainsi, sa détermination judicieuse postule que soient
cernés séparément les deux aspects. C'est pourquoi nous
mettrons successivement l'accent sur le cadre spatial et le facteur temporel
pour une maitrise exacte la protection de l'environnement par les
collectivités locales au Cameroun.
La recherche que nous nous proposons de mener a pour cadre
spatial la Ville de Douala ou la Communauté Urbaine de Douala80(*). C'est une collectivité
dont nous avons bonne connaissance, tant au niveau des moeurs et des habitudes
des populations que des pratiques administratives. Tout comme les autres villes
en voie de développement, la Ville de Douala connaît un
étalement de plus en plus grand et rapide. Et
généralement, plus la ville s'agrandit, plus les problèmes
d'environnement s'intensifient. Il ressort que l'environnement en milieu urbain
est une composante essentielle de la vie urbaine. Dans le cas spécifique
de la ville de Douala, cet environnement est nécessaire et indispensable
pour l'épanouissement des populations.
En outre, pour ce qui concerne le cadre temporel, cette
dernière commence avec le vent du libéralisme et de la conscience
écologique qu'a connu le Cameroun. Concrètement, on situe cette
étude à partir du lendemain de la Conférence de Rio de
199281(*), plus
précisément de 1994 à 2013. Ceci permettra
d'évaluer d'une part les différentes politiques mises en oeuvre
par la Ville de Douala en vue d'assurer la protection et la promotion de
l'environnement, et d'autre part le degré d'implication de celle-ci dans
cette entreprise de protection et de promotion de l'environnement.
II. CADRE EPISTEMOLOGIQUE DE L'ETUDE
Dans cette rubrique, nous partirons des considérations
méthodologiques (1) pour poser la problématique et
l'hypothèse de notre travail (2).
II.1. Considérations méthodologiques
Comment parvenir au résultat escompté ?
Telle est la question qui détermine le choix d'une démarche
méthodologique. Le Professeur Maurice KAMTO écrivait
déjà que
Le problème de la méthode est au centre de
tout oeuvre scientifique, [tant il est vrai que] la méthode
éclaire les hypothèses et détermine les
conclusions82(*).
L'analyse critique que nous portons sur la protection de
l'environnement par les collectivités territoriales
décentralisées au Cameroun est essentiellement juridique. Elle
requiert de ce fait une démarche juridique fondée sur l'analyse
systématique des normes en vigueur, au regard des situations qu'elles
sont censées régir, des problèmes que suscitent leur
application et des solutions administratives ou jurisprudentielles que
rencontrent ces derniers. Elle est traduite dans le cadre de cette étude
par la dogmatique83(*) et
la casuistique84(*). Cette
méthode exégétique classique semble limitée pour
une appréhension satisfaisante de la question qui nous occupe. Aussi
envisageons-nous une approche pluridisciplinaire. Déjà que le
droit de l'environnement est une discipline transversale qui emprunte en
même temps à plusieurs autres branches du Droit et des autres
sciences.
Ainsi, à côté du Droit tant international
qu'interne, nous aurons recours à la Science politique, et plus
précisément aux politiques publiques85(*) qui se justifie ici par notre
ambition d'inscrire notre travail dans une perspective empirique et
évaluative. Si la première nous permet de
« décrire et de comprendre ce qui est »86(*), la seconde, quant
à elle nous permet de « déterminer la valeur ou
l'utilité de ce qui est »87(*). Il s'agit avec cette méthode de
procéder à une analyse de l'existant et de faire une prospective.
Tel travail pourra éventuellement nous ouvrir les portes d'une
perspective normative où il s'agira de « recommander des
voies futures d'action pour résoudre des
problèmes »88(*).
A côté de cette méthode d'exploitation des
données collectées, nous envisageons dans notre démarche
de collecte des informations, de procéder à la recherche
documentaire qui consiste à recourir à tout écrit sur
lequel porte notre sujet de mémoire dans le but de
Connaitre ce qui a déjà été
étudié, débattu, mis en avant ; les thèses et
les hypothèses proposées ; les principales
interprétations ou constructions théoriques89(*).
Elle a été effectuée à travers
l'étude et l'analyse des principales publications existantes : lois
et règlements, articles de la doctrine, études ou rapports,
thèses et travaux universitaires, ouvrages publiés. En outre, par
l'observation directe, nous avons tenté « d'enregistrer de
façon précise et systématique, objectivement les
activités auxquels se livrent les gens dans leur cadre
normal »90(*).
Il s'agissait d'observer de près les modes de vie,
d'organisation et de fonctionnement des populations et des institutions de la
Ville de Douala. En assistant autant que de besoin à certaines
réunions de travail dont l'accès était autorisée,
il a été possible d'analyser l'attitude générale
des acteurs en présence vis-à-vis des sujets débattus. La
technique de l'entretien91(*) a permis de compléter et de mieux comprendre,
expliquer et éclairer les données recueillies à partir
d'autres sources.
II.2. Problématique et hypothèse de
l'étude
De tout ce qui précède, la présente
étude vise à répondre à la question suivante :
S'il est constant que la décentralisation vise à impliquer les
populations dans la gestion de leurs affaires à travers les
collectivités locales, for est de se demander quelle place occupe la
protection de l'environnement dans les attributions de ces dernières au
Cameroun d'une part, et comment elles procèdent à la mise en
oeuvre effective de cette protection d'autre part.?
Avec la consécration constitutionnelle de la
décentralisation et aussi de la protection de l'environnement depuis
1996, l'on aurait pu s'attendre à ce que, compte tenu de la
proximité aux préoccupations des populations et des
déséquilibres affectant l'environnement, d'importantes
attributions soient transférées aux collectivités
territoriales par le pouvoir central. Mais pour le moment, nous n'en sommes
encore qu'à la loi d'orientation qui n'a pas encore touché
l'épineuse question de transfert des compétences.
En dépit de cette situation, les collectivités
territoriales décentralisées en général et le
Communauté Urbaine de Douala en particulier assurent leur mission de
protection de l'environnement au moyen de politiques qu'elles élaborent
et conformément aux normes en vigueur au Cameroun.
En effet, la politique de protection de l'environnement
élaborée par la ville de Douala est prise en compte dans le
processus de maturation et de mise en oeuvre des politiques publiques
sectorielles. Dans ce processus, l'inscription d'un problème
(préservation du milieu de vie par exemple) dans l'agenda y tient une
place de choix. Reprenant l'analyse de COBB et ELDER, Jean PADIOLEAU
définit en effet l'agenda comme :
L'ensemble des problèmes perçus comme
appelant un débat public, voir l'intervention des autorités
politiques légitimes»92(*).
On distingue en effet deux types d'agendas : un agenda
systémique (ou conjoncturel) par lequel les problèmes font leur
entrée dans le champ du forum politique ; un agenda institutionnel
ou gouvernemental permettant aux problèmes d'être inscrits dans le
champ de l'action administrative. Dès lors, les politiques de protection
de l'environnement des CTD se matérialisent par des décisions
tantôt portées sur les «agendas
institutionnels » et sur un « agenda
conjoncturel »93(*) des pouvoirs publics.
La vérification de cette hypothèse centrale
passe par deux grands axes que sont : le cadre normatif et institutionnel
de protection de l'environnement au Cameroun d'une part, et les
mécanismes opérationnels de protection de l'environnement dans la
ville de Douala, d'autre part.
PARTIE I :
CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
Le droit de l'environnement constitue sans nul doute un droit
relativement jeune au Cameroun. Ses principales bases ont été
posées au cours des années 1990 au lendemain de la CNUED de Rio
en 1992. Sans contingence existait-il avant cette date de nombreuses
règles visant à protéger l'environnement et ses
composantes, fut-ce des règles coutumières traditionnelles ou
celles issues de la colonisation ou bien encore celles élaborées
au lendemain des indépendances94(*). Toutefois, il ne s'agissait que des textes
disparates et isolés destinés à tel ou tel secteur de
l'environnement, et adoptés au gré de l'apparition des
problèmes spécifiques de l'environnement. C'est seulement
après 1990 que ce droit s'est réellement affirmé notamment
avec l'apparition dans le dispositif normatif camerounais des textes de
portée générale ou sectorielle visant à assurer une
protection globale du milieu naturel, ou bien consacrés à des
domaines entiers de l'environnement comme les forêts, la faune, l'air,
l'eau, les déchets etc. ...Outre ces textes d'origine nationale, il
convient de mentionner un grand nombre de conventions internationales -
à vocation universelle ou régionale - consacrées à
la gestion du milieu naturel auxquels fait partie le Cameroun et qui ont
acquis force juridique au plan national du fait de leur application par les
autorités nationales95(*).
En adoptant ainsi une série de textes, et en
s'engageant dans des conventions internationales tous relatifs à la
préservation de son environnement naturel, le Cameroun, à
l'instar des autres pays africains,était et reste convaincu que le droit
de l'environnement constitue l'outil efficace à la protection de la
nature et de ses ressources. C'est pourquoi il a mis en place un dispositif
institutionnel destiné à faciliter la mise en oeuvre de ce
droit96(*) ; il n'est
pas à négliger la coopération institutionnelle dans
laquelle le gouvernement de République s'est largement engagé aux
fins de renforcement de ce droit encore jeune et lacunaire97(*). Cette coopération,
rappelons-le, est la résultante de la poussée conjuguée de
l'opinion publique et des politiques des pays occidentaux, notamment les USA
où la Environmentpolicy venait d'être votée ;
et l'impact d'autre part de la Conférence de Stockholm98(*).La coopération
institutionnelle est donc reconnue depuis Stockholm comme un Principe
de droit de l'environnement99(*). On pourrait à ce niveau constater que la
protection de l'environnement au Cameroun bénéficie d'une
attention soutenue de la part des autorités publiques
nationales100(*). Alors
de tout point de vue, le cadre normatif de protection de l'environnement est le
substrat même des dispositifs conventionnels (chapitre 1) et
institutionnels (chapitre 2)de préservation du milieu naturel au
Cameroun.
Chapitre 1
Cadre normatif de protection de l'environnement au
Cameroun
Le droit de l'environnement au Cameroun, comme dans la plupart
des pays africains, se caractérise par l'abondance et la
diversité des principes et règles relatifs à la
préservation du milieu naturel et du cadre de vie. En effet, afin de
juguler les graves problèmes auxquels il se trouve confronté, le
Cameroun s'est doté au cours des deux dernières décennies
d'un véritable dispositif juridique destiné à lutter
contre les dégradations de l'environnement et de promouvoir un
véritable développement durable sur son territoire. A
côté de ces dispositifs nationaux (section 1), et face au
phénomène d'internationalisation du droit de
l'environnement101(*)
dont le but est l'harmonisation des règles de protection de la nature au
niveau mondial, régional et sous régional pour des raisons tant
éco-systémiques qu'économiques et
socioculturelles102(*),
le Cameroun a adopté plusieurs instruments juridiques internationaux de
protection (section 2) l'intégrant par le mécanisme de
ratification103(*) dans
son ordonnancement juridique interne.
SECTION 1. LES DISPOSITIFS NATIONAUX
Bien que relativement jeune, le droit camerounais de
l'environnement connait depuis quelques années une vitalité
singulière. Confiné pendant longtemps à quelques
règles sectorielles disparates héritées le plus souvent de
la colonisation, ce droit connait en effet un développement significatif
depuis la participation du Cameroun à la CNUED à Rio en
1992 ; développement qui s'est traduit en effet par la
multiplication d'instruments législatifs et règlementaires
relatifs à la conservation du milieu (paragraphe 2), et par la tendance
de plus en plus marquée des pouvoirs publics à recourir à
ce droit pour mieux lutter contretoutesformes de dégradation de la
nature. Toutefois, tout ce dispositif normatif environnemental trouve son
fondement dans la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant modification
de la Constitution du 02 juin 1972 (paragraphe 1) qui jette dès lors les
bases juridiques104(*)
de protection de l'environnement.
Paragraphe 1 : La constitution, fondement
de la protection de l'environnement au Cameroun
L'évolution constitutionnelle récente au
Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, n'a pas seulement
été marquée par le souci de codifier le
changement de régime politique, à l'instar de ceux imposés
dans le jeu des transitions démocratiques ; mais aussi par le souci
de réduire ou tout au moins de mettre fin à la
débâcle écologique105(*). Derrière cette volonté
constitutionnelle de protéger l'environnement se dessine un vaste
mouvement de constitutionnalisation du droit de l'environnement106(*)(A) qui participe des
mesures toutes nouvelles de préservation de la nature au Cameroun. Cette
constitutionnalisation ne présente pas moins des enjeux et portée
qui interpellent vivement notre attention (B).
A. La constitutionnalisation du droit de
l'environnement au Cameroun : Un constat
L'idée d'introduire dans le texte constitutionnel de
nouvelles dispositions autres que celles qui visent à organiser les
pouvoirs se traduit de manière générale par la prise en
compte d'un intérêt jugé fondamental par le constituant et
pour la nation. On pourrait donc s'exclamer à raison avec Michel PRIEUR
que l'environnement est entré dans la constitution107(*). En effet dansla
volonté de protéger constitutionnellement l'environnement
trouve-t-on le fondement constitutionnel de la protection de l'environnement au
Cameroun (2). Mais qu'est-ce que la constitutionnalisation ? (1)
1. Le concept de constitutionnalisation du
droit
Si on envisage laconstitutionnalisation comme l'action
conférant valeur constitutionnelle à un texte ou à un
principe108(*)ou encore
comme le changement de valeur d'une norme préexistante qui devient
constitutionnelle, il faut dire que ce mécanisme procède le plus
souvent de l'élévation dans la hiérarchie des
normes109(*),
résultant soit d'une révision constitutionnelle, soit de
l'adoption d'une nouvelle Constitution, soit enfin d'une décision du
juge constitutionnelle. Si le Doyen FAVOREU marque sa préférence
pour ce dernier mode de constitutionnalisation dans sa contribution sur la
«constitutionnalisation du droit»110(*) dans l'ouvrage relatif
à La constitutionnalisation des branches du droit111(*), en ce qui concerne le
droit de l'environnement, la révision de la Constitution est le moyen le
plus usité pour procéder à sa constitutionnalisation.
Ainsi donc, c'est après les révisions
opérées dans de nombreuses Constitutions africaines au lendemain
de 1990, parmi lesquelles celle du Cameroun du 18 janvier 1996, qu'apparaissent
pour la première fois les dispositions destinées à la
protection de l'environnement.
2. Le fondement constitutionnel de la protection de
l'environnement au Cameroun
L'introduction de l'environnement dans la Constitution du 18
janvier 1996 est non seulement remarquable en raison de son objet malgré
le retard pris par le Cameroun en la matière, mais aussi du fait de
l'imprécision du contenu des dispositions constitutionnelles.
D'ailleurs, comme l'affirme le Doyen PRIEUR,
Le développement du droit de l'environnement comme
instrument nouveau de protection (...) est naturellement lié à la
reconnaissance des valeurs fondamentales généralement
consacrés dans des Déclarations des droits et libertés
publiques112(*).
La reconnaissance de la protection de l'environnement comme un
principe éthique113(*)fait acquérir à celui-ci une
dimension supérieure qui ne peut être que de l'ordre de la
Constitution.
Ainsi, l'insertion de l'environnement dans la Constitution lui
confère une véritable dimension constitutionnelle. Bon nombres de
Constitutions africaines ont adopté à peu près les
mêmes formulations unifiées par référence à
l'article 24 de la Déclaration desDroits de l'Homme et des
Peuples114(*). Cette
référence à l'environnement se trouve formulé dans
la Constitution du Cameroun, et plus précisément en son
préambule en ces termes :
Le peuple Camerounais [est] résolu
à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être
de tous. [...] Toute personne a droit à un environnement sain. La
protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à
la défense et la promotion de l'environnement115(*).
Cette formulation du constituant camerounais n'est pas sans
effet direct. D'une part, il existe désormais sans
référence explicite un droit à l'environnement
garantie par la Constitution et reconnue aux particuliers et aux
groupes116(*) ; d'autre part, l'obligation imposée
à tous les acteurs et surtout à l'Etat et ses
démembrements de «défendre et de conserver le milieu
naturel au profit des générations présentes et
futures»117(*).
La sauvegarde du milieu naturel trouve son assise profondément
ancrée dans le texte constitutionnel. Il n'est donc pas sans
exagération de postuler que les collectivités locales au Cameroun
tirent leurs sources de compétence depuis la constitution. D'ailleurs,
il est clair avec l'article 26 de la loi Constitution dispose d'une part que
le régime des ressources naturelles est du domaine de la loi118(*), et d'autre part que le
législateur est compétent pour la détermination des
compétences et des collectivités territoriales
décentralisées119(*).
Toutefois, les dispositions relatives à l'environnement
n'étant pas self-executing120(*), il faut procéder donc toutes les fois
que besoin se fera ressentir à l'adoption de textes précisant la
portée des dispositions contenues dans la Constitution. On pourrait donc
présumer à juste titre que l'insertion dans la norme fondamentale
d'un objet environnemental imprécis laisse présumer une
compétence législative. C'est ainsi que, pour permettre au
peuple camerounais121(*) de veiller à la protection de
l'environnement, la Constitution dispose que le «régime des
ressources naturelles... ressortit du domaine de la loi»122(*).Quels sont les enjeux
d'un tel mécanisme et sa portée sur droit de l'environnement et
sur le droit en général ?
B. La constitutionnalisation du droit de
l'environnement au Cameroun : Quels enjeux et quel
avenir ?
1. Les enjeux de la constitutionnalisation de
l'environnement au Cameroun
L'effectivité du droit de
l'environnementconstitueactuellement sans nul doute l'un des plus grands
défis auxquels se trouve confronté le Cameroun en matière
de réalisation des OMD123(*), fixéslorsdu Sommet extraordinaire des chefs
d'Etats et de gouvernements des Nations Unies en 2000. Le développement
d'un droit constitutionnel de l'environnement pourrait
représenter de premier abord une réponse à
l'ineffectivité du droit de l'environnement ; toutefois même
si la doctrine s'est attachée à souligner le caractère
inutile124(*) ou
illusoire125(*) de la
constitutionnalisation de ce droit, l'on peut se permettre d'affirmer que ce
mécanisme permet de pallier à l'ineffectivité de droit
international de l'environnement, dépourvu le plus souvent des
mécanismes juridictionnels qui en assurent le respect126(*).
En outre, la reconnaissance du droit à un
environnement sain érige celui-ci au niveau d'un droit et d'une
liberté fondamentale, au même titre que la liberté d'aller
et venir, ou le droit de propriété. Il peut s'agir d'un droit
individuel ou d'un droit collectif, qui est, selon les cas, défendu par
des procédures différentes. Ce droit établit un lien fort
entre l'homme et son environnement, lien original qui n'est subordonné
à aucune condition de lien de propriété ou de lien
économique. Cette reconnaissance aurait des effets sur le droit d'agir
devant l'administration ou devant le juge civil, pénal ou administratif,
pour se plaindre d'une atteinte à son environnement.
L'intérêt pour agir des particuliers (formulation individuelle) et
des associations et groupements divers (formulation collective) serait
facilité.Ainsi, tout citoyen aurait un droit subjectif et un
intérêt à agir pour le défendre non seulement en cas
d'atteinte personnelle, mais aussi en cas d'atteinte collective,
c'est-à-dire, même quand l'intéressé n'est pas
touché « directement » dans son bien-être. Il ne s'agit
pas d'une garantie absolue de respect du droit dans la pratique, mais, au
moins, la norme fournit des instruments solides afin d'assurer
l'effectivité du droit subjectif à l'environnement sain. Le
respect des procédures d'information et de participation en seraitaussi
consolidé.
En définitive, la constitutionnalisation permet de
donner force juridique à certains principes consacrés au niveau
mondial ou régional dans des instruments non normatifs. De plus, aux
côtés des principes non normatifs du droit international de
l'environnement, il existe des principes normatifs dont la violation n'est pas
ou est difficilement sanctionné d'un point de vue juridique. A cet
égard, ce mécanisme permet une application de la Constitution par
les juridictions constitutionnelles et ordinaires. Alors, si on peut admettre
qu'il procède de l'ineffectivité de ce droit,
l'effectivité des règles internationales revient donc
désormais à l'organe de concrétisation de la Constitution,
à savoir le législateur.
2. La portée de la constitutionnalisation :
de l'élargissement des compétences du législateur à
la promotion d'un droit de l'environnement et d'un droit de l'homme à
l'environnement
Bien que la Constitution soit la clé de voûte de
tout système normatif, ses dispositions relatives à la protection
de l'environnement ne sont toutefois pas toujours claires. En abordant la
question de la protection de l'environnement dans le Préambule, le
constituant de 1996 reste flou dans ses dispositions, quand bien même
dans l'article 26 il confère au législateur la
responsabilité d'édicter des normes en la
matière127(*).
En effet, la référence à l'intervention
du législateur128(*)peut être donc interprétée comme
la détermination d'une compétence exclusive pour fixer les
limites d'une part, et comme une condition de l'effectivité de ce droit.
Ainsi, lorsque le texte constitutionnel proclame que le domaine des
ressources naturelles ressorti du domaine de la loi, il attribue pleine
compétence au législateur de légiférer dans le
domaine de l'environnement. D'ailleurs, le foisonnement législatif en la
matière au Cameroun nous en dit long. Les lois sur l'eau, les
déchets, l'air, le sol, la faune et la flore, les forêts, etc.
illustrent pleinement ce déploiement129(*). Il est donc clair de parler d'une véritable
promotion du droit de l'environnement de serait-ce qu'au niveau
législatif.
Par ailleurs, le mécanisme de constitutionnalisation
prend la forme de l'élaboration des droits fondamentaux qui se
définissent par la réunion d'éléments
suivants : l'existence des permissions dont la violation par un acte
législatif ou infra législatif est sanctionnée par un
organe de contrôle130(*). Cette «fondamentalisation» des
principes liés à l'environnement correspond à leur
vocation première : protéger l'individu.Et nous
voila situé dans le champs des droits de l'homme : le droit de
l'individu à un environnement sain pour son épanouissement.
Finalement, loin de limiter le rôle du
législateur, la constitutionnalisation du droit de l'environnement
protège et confirme sa compétence. Ce processus est avant tout
envisagé comme une réaction à l'ineffectivité du
droit international dans la protection de l'écosystème dont la
responsabilité revient exclusivement au législateur national.
Paragraphe 2 : Les instruments législatifs
et réglementaires
C'est d'abord de façon inconsciente et par des voies
détournées que le droit camerounais postcolonial s'est
intéressé à la protection de l'environnement. En effet, la
nécessité d'une gestion efficiente des ressources naturelles
notamment, les ressources énergétiques et minières, a
suscité l'élaboration de nombre de lois en la matière dans
les années 60. Toutefois les premiers textes à connotation
environnementale proprement dite datent de la fin de la décennie 80 et
concernent la gestion des déchets toxiques. Dès 1994, l'arsenal
juridique en matière d'environnement et des forêts connaît
un renforcement couronné en 1996 par la constitution et la loi cadre en
la matière. Nous notons que le droit camerounais de l'environnement
connait en effet un développement significatif depuis la participation
du Cameroun à la Conférence de Rio de 1992131(*). Ce foisonnement normatif se
traduit évidement par la multiplication des textes législatifs
(A) et réglementaires (B) relatifs la préservation du milieu. Ce
qui a fait du Cameroun depuis plusieurs années déjàun
vaste chantier normatif en la matière132(*).L'épineuse question qui nous
intéresse dans cette analyse reste de savoir quelle place le
législateur, dans ces différents instruments à analyser,
accorde aux collectivités locales.
A. Les instruments législatifs de
protection de l'environnement
Plusieurs textes de lois constituent l'essentiel de la
législation dans le domaine desressources naturelles au Cameroun. Ainsi,
s'inscrivant dans un vaste mouvement d'adoption des textes sectoriels que
connait bon nombre de pays francophones133(*), le Cameroun emboite le pas à la tendance
générale à adopter de véritablescodes ou
lois spécifiques sur la gestion et la protection de
l'environnement, qualifiées à tort ou à raison de
Lois-cadres environnementales134(*). Notre prétention ici n'est pas
d'analyser tout le dispositif législatif,nous marquons un
intérêt somme toute particulier sur la loi-cadre environnementale
adoptée en 1996 (1) avant d'analyser les lois sectorielles dont la
pertinence se révèle manifeste dans le cadre de la
présente étude (2).
1. La Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement de 1996135(*)
A la lecture de la loi n°96/12 du 05 août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, le
législateur a reconnu que la présente loi fixe le cadre juridique
général de la gestion de l'environnement au Cameroun136(*). Elle est la base juridique
de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles au Cameroun. Elle
constitue l'unique cadre réglementaire général dans ce
domaine. Elle avait été conçue pour couvrir l'ensemble des
préoccupations environnementales, et devrait donc être
complétée par des lois sectorielles à l'instar de celle du
14 juillet 2006 relative aux établissements classés dangereux ou
encore à celle du 21 avril 2003 sur des règles régissant
la biodiversité. Elle permet une bonne compréhension des normes
et principes fondamentaux en matière environnementale. Cette loi est
ainsi en phase avec les normes du droit international de l'environnement dont
elle reprend les principes cardinaux. C'est le cas par exemple avec les normes
édictées dans la CDB, la CCNUCC ou le Protocole de Kyoto. En
effet, la loi-cadre réglemente un grand nombre de secteurs de
l'environnement : l'atmosphère, les eaux continentales et les
plaines d'inondation, le littoral et les eaux maritimes, les sols et sous-sol,
les établissements humains, les installations classées dangereux,
insalubres ou incommodes et des activités polluantes, les
établissements classés, les substances chimiques nocives et/ou
dangereuses, les nuisance sonores et olfactives et la gestion des ressources
naturelles et la conservation de la diversité biologique.
Par ailleurs, son caractère de cadre de
référence flexible sied bien aux exigences d'un contexte
interinstitutionnel dans lequel les questions environnementales sont
obligées d'être traitées. La loi-cadre marque donc son
caractère innovateur, par des dispositions précises inscrivant le
pluralisme des normes dans le corps même du texte.
En outre, cette loi relève un certain nombre
d'obligations générales qui incombent à des institutions
publiques ou privées, notamment dans le cadre de la sensibilisation des
populations sur les problèmes liés à l'environnement. Un
ensemble de principes fondamentaux sur l'environnement y sont
présentés dans leurs contenus, il s'agit des principes de
précaution, pollueur-payeur, de participation, de prévention, de
responsabilité et de subsidiarité. Le titre 2 de ce texte fixe la
question de l'élaboration, de la coordination et du financement des
politiques de l'environnement. Le titre 3 en rapport avec la Gestion de
l'environnement, présente le plan national de gestion de l'environnement
(Chapitre 1), l'étude d'impact environnemental (Chapitre
2), la protection des milieux récepteurs (Chapitre 3) que
sont : l'atmosphère, les eaux continentales et les plaines
d'inondation, le littoral et les eaux marines, les sols et sous-sols, les
établissements humains. Il porte également sur les
établissements classés dangereux, insalubres ou in commodes et
des activités polluantes (Chapitre 4), c'est ce qui explique la
précision apportée dans ce chapitre sur les déchets, les
établissements classés, les substances chimiques, nocives et/ou
dangereuses, les nuisances sonores et olfactives. Le chapitre 5
réglemente la gestion des ressources naturelles et de la conservation de
la diversité biologique et son chapitre 6 envisage le problème
des risques et des catastrophes naturelles. Le titre 4 porte sur la mise en
oeuvre et le suivi des programmes, le titre 5 sur les mesures incitatives et le
titre 6 sur la responsabilité et les sanctions en matière de
gestion de l'environnement.
Dans le cadre de sa mise en oeuvre, cette loi a prévu
soixante-sept décrets d'application. Bien plus,
plusieurscompétencessont nécessaires. Il s'agit
précisément : de la compétence exécutive
exercée par le Président de la République à qui
revient la charge de définir la politique nationale de
l'environnement ; et les Administrations ministérielles parmi
lesquelles celle en charge de l'environnement a la prééminence.
L'autorité législative compétence de prendre d'autres
textes de loi qui facilitent davantage la mise en oeuvre de de celle-ci, et
quand à l'autorité judiciaire son rôle intervient dans la
constatation et la sanction des infractions. En outre, la participation des
collectivités territoriales décentralisées est cependant
prévue dans la gestion de l'environnement. Il y est d'ailleurs prescrit
que le Gouvernement met en oeuvre la politique nationale en matière
d'environnement de concert avec les collectivités territoriales
décentralisées137(*).Cette participation des collectivités est un
impératif de la décentralisation qui vise à associer les
populations locales sur l'ensemble du territoire national.
2. Les lois sectorielles régissant
l'environnement au Cameroun
Le foisonnement normatif qu'a connu le Cameroun au lendemain
des indépendances démontre la multitude de son arsenal
législatif. Ainsi, outre la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972 et la loi n° 96/12 du
05 aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement,
plusieurs autres textes constituent l'essentiel de la législation dans
ce domaine. Il s'agit notamment de :
· Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 portant
régime de l'eau (Loi régissant les ressources en eau et fixant la
liste des substances nocives dont le rejet, l'immersion et le
déversement dans l'eau sont interdites ainsi que toutes les
modalités d'exécution des Evaluations d'Impacts sur les eaux de
surface et les eaux souterraines) ;
· Loi n° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative
à l'activité semencière ;
· Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la flore qui fixe entre
autres des règles encourageant l'exploitation forestière durable
(plans d'aménagements, suppression des petits permis de coupe ;
· La loi n°2003/003 du 21 avril 2003 portant
protectionphytosanitaire ;
· La loi n°2003/007 du 10 juillet 2003
régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun ;
· La loi n°2001/014 du 23 juillet 2001 relative
à l'activité semencière ;
· La loi n°89/09 du 27 novembre 1989 portant sur les
déchetstoxiques et dangereux ;
· La loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de lafaune et de la pêche;
· La loi n°2003/006 du 21 avril 2003 sur des
règles régissant labiodiversité ;
· Ordonnance N° 99/001/ du 31 août 1999
complétant certaines dispositions de la loi N° 94/01 du 20 Janvier
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche ;
· Loi n°2000/02 du 17 avril 2000, relative aux
espaces maritimes de la République du Cameroun ;
· Loi n°2000/17 du 19 décembre 2000 portant
réglementation de l'inspection sanitaire ;
· Loi n°2003/006 du 21 avril 2003 portant
régime de la sécurité en matière de biotechnologie
moderne au Cameroun ;
· Loi n°2001/02 du 17 avril 2001 portant code
Minier ; qui traite des mesures à prendre pour limiter l'impact
négatif de l'exploitation minière sur les terres ;
· Loi n°98/015 du 14 Juillet 1998 relatives aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
A ce droit abondamment législatif, s'ajoutent des
textes règlementaires qui sont pris soit par le Président de la
république ou le Premier ministre pour s'assurer de l'application de ces
lois.
B. Dispositif réglementaire en
matière d'environnement
La mise en oeuvre du cadre juridique environnemental se heurte
à des contraintes majeures liées à l'insuffisance des
textes d'application devant préciser les modalités pratiques
d'exécution des dispositions d'ordre général.
Les textes d'application pris par l'exécutif
(décrets, arrêtés, décisions, circulaires) sont
destinés à fournir des indications propres à l'application
des lois sectorielles ou de la loi cadre. Une loi, quelle qu'elle soit, et ce
en dépit des principes environnementaux palliatifs, ne peut être
efficace si les textes d'application n'existent pas.
En effet en matière d'environnement vert et des
forêts, seul le secteur de la biodiversité (flore et faune) est
suffisamment outillé en textes d'application, au contraire de la
désertification qui ne dispose que d'un texte d'application. Bien plus
et en dépit des textes internationaux ratifiés par le Cameroun et
les lois existantes, il n'existe aucune réglementation récente et
d'actualité en matière de ressources biologiques et de protection
des écosystèmes marins et côtiers et en ce qui concerne le
patrimoine culturel et l'aménagement du terroir.
Le tableau ci-dessous énumère, sans toutefois
être exhaustif, les différents règlements pris par le
Cameroun depuis près de20 ans déjà.
|
PERIODE
|
TEXTES D'APPLICATION
|
|
1995
|
1. Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant
les modalités d'application du régime de la faune
|
|
2. Décret N° 95 / 531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
(MINEF)
|
|
1996
|
3. Décret N° 96/642/PM du 17 septembre 1996 Fixant
l'assiette et les modalités de recouvrement des droits de redevances et
taxes relatifs à l'activité forestière
|
|
1998
|
4. Décret N° 98 /345 du 21/12/98 portant
organisation du Ministère de l'environnement et des forêts
|
|
1999
|
5. Décret N° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant
les modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi
n°94 /01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la
faune et de la pêche ;
6. Décret N° 99/370 du 19 mars 1999 relatif au
Programme de Sécurisation des Recettes Forestières ;
7. Décret N°99/818/PM du 09 novembre 1999 fixant
les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements
classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
8. Décret N°99/820/PM du 09 novembre 1999 fixant
les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales à
l'exploitation des laboratoires de contrôle de pollution ;
9. Décret N°99/821/PM du 09 novembre 1999 fixant
les conditions d'agrément des personnes physiques ou morales aux
inspections, contrôles et audits des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes ;
10. Décret N°99/822/PM du 09 novembre 1999 fixant
les conditions de désignation des inspecteurs et inspecteurs-adjoints
des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et
des appareils à pression de vapeur d'eau.
|
|
2000
|
11. Décret N° 2000/092/PM du 27 mars 2000
modifiant le Décret N° 95/436 /PM du 23 août 1995 Fixant
les modalités d'application du régime des forêts ;
12. Décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les
modalités d'application du code pétrolier.
|
|
2001
|
13. Décret N° 2001/546/PM du 3 juillet 2001
modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°
95/423/PM du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du
régime de la pêche ;
14. Décret de 2001 sur l'organisation et le
fonctionnement du Comité Nationale de l'Eau
15. Décret de 2001 sur les eaux de captage, de
traitement et de stockage des eaux potalisables
16. Décret de 2001 sur le prélèvement des
eaux de surface et des eaux souterraines à des fins industrielles ou
commerciales
17. Décret de 2001 précisant les
modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines
contre la pollution
18. Décret de 2001, portant création d'un Compte
d'Affectation Spéciale pour le Financement des Projets de
Développement en matière d'eau et d'assainissement
|
|
2002
|
19. Décret N° 2002/017 du 18 janvier 2002 portant
ratification du protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la
prévention des risques Biotechniques relatifs à la convention sur
la diversité biologique
20. Arrêté N°0222/A/MINEF du 25 mai 2002
portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de
contrôle de la mise en oeuvre des Plans d'Aménagement des
Forêts de production du domaine forestier permanent
|
|
2003
|
21. Arrêté N° 415/CAP/PR du 16 octobre 2003
portant désignation des membres de la commission (dont le SPE est
membre) créée par l'Accord du 08 février 1996, entre le
Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la
République du Tchad, relatif à la construction et à
l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline
|
|
2005
|
22. Décret N° 2005/0577/PM du 23 février
2005 fixant les modalités de réalisation des EIE
|
|
23. Arrêté N° 0070/MINEP du 08 mars 2005
fixant les différentes catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise à des études d'impacts et audits
environnementaux
|
|
24. Décret N° 2005/3089/PM du 29 août 2005
précisant les règles d'assiette, de recouvrement et de
contrôle de la taxe d'assainissement et de prélèvement des
eaux
|
|
2006
|
25. Instruction N° 1/MINEP/CAB du 19 avril 2006
prescrivant la lutte contre l'exploitation illégale des ressources
naturelles
|
|
2007
|
26. Arrêté N° 00001/MINEP du 03
février 2007 définissant le contenu général des
termes de référence des Etudes d'Impacts Environnementaux
(EIE)
27. Arrêté N° 00004/MINEP du 03 juillet 2007
fixant les conditions d'agrément des bureaux d'étude à la
réalisation des études d'impacts environnementaux
|
|
2008
|
28. Décision N° 00197/MINEP du 1er
juillet 2008 portant création du Comité National chargé de
la mise en oeuvre du programme de la décennie des nations unies pour
l'éducation en vue du développement durable
|
|
29. Arrêté N° 0315/MINEF fixant les
critères de présélection et les procédures de choix
des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
30. Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les
modalités d'attribution en priorité aux communautés
villageoises riveraines de toute forêts susceptible d'être
érigée en forêts communautaires
|
|
2011
|
31. Décret n° 2011/2583/PM du 23 Août
2011porte réglementation des nuisances sonores et olfactives
|
|
2012
|
32. Arrêté conjoint N°004/
Minepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Portant réglementation de la
fabrication, de l'importation et de la Commercialisation des emballages non
biodégradables
33. Arrêté conjoint N°
005/Minnepded/Mincommerce du 24 octobre 2012 Fixant les conditions
spécifiques de gestion des équipements électriques et
Électroniques ainsi que de l'élimination des déchets issus
de ses équipements
34. Décret N° 2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant
les modalités d'exercice de certaines compétences
transférées aux communes en matière d'environnement
|
|
2013
|
35. Décret N° 2013/0171/PM du 14 février
2013 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental et social
36. Décret N° 2012/0172/PM du 14 février
2013 fixant les modalités de l'audit environnemental et social
|
Somme toute, le dispositif juridique national tel
qu'élaboré par le gouvernement camerounais pour la gestion de son
environnement semble rendre compte de l'effectivité de la protection de
la nature, ce du moins d'un point de vu théorique. Mais Elisabeth
DOWDEWELL reste cependant convaincu que le DIE est l'instrument le plus
effectif de protection de l'environnement. A cet égard, il apparait
à juste titre que les différents textes nationaux sont
renforcés et complétés par la multitude de conventions
internationales relatives à la protection de l'environnement
ratifiées par l'Etat du Cameroun.
SECTION 2. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
La spécificité du droit de
l''environnement138(*) a
conduit les autorités publiques camerounais à adopter des
mécanismes particuliers pour la sauvegarde de leur environnement
naturel. Si on place la règlementation internationale dans le registre
de ces mécanismes développés par le droit
international139(*), on
ne peut en exclure les différentes Conventions internationales relatives
à l'environnement dont fait partie le Cameroun. D'ailleurs les
conventions internationales, nous le rappelle fort bien le Professeur KISS,sont
l'une des sources fondamentales du droit international de l'environnement.
Le Cameroun a adhéré à nombre
d'initiatives internationales, en l'occurrence à plus d'une centaine de
conventions multilatérales, régionales et sous-régionales
en matière de développement durable et de protection de
l'environnement notamment sur la biodiversité, les changements
climatiques, la désertification, la protection de la couche d'ozone, le
nucléaire, etc. Ces conventions contribuent au renforcement de la
coopération internationale, régionale et sous régionale.
Elles se rapportent soit à l'environnement vert, soit à
l'environnement gris ou aux changements climatiques. Sans prétendre
à une énumération exhaustive de toutes les conventions
auxquelles fait partie le Cameroun, dénombrons quelques-unes à
vocation universelle (paragraphe 1) d'une part et régionales (paragraphe
2) d'autre part.
Paragraphe 1.Les instruments internationaux à
vocation universelle
Le Cameroun a ratifié bon nombre de conventions
internationales à vocation universelle de protection de l'environnement.
Nous citerons en autres :
- Convention CITES140(*) ratifiée le 05 juin 1981 ;
- Commerce International des espèces de faune et flore
sauvages menaces d'extinction ratifiée le 07 septembre 1981 ;
- Convention de RAMSAR (relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement habitats des oiseaux
d'eau) ;
- Convention d'Abidjan et son protocole relatifs à la
coopération en matière de protection et mise en valeur du milieu
marin et ses zones côtières de la région d'Afrique de
l'Ouest et du Centre, ratifiée en août 1984 ;
- Convention de Vienne pour la Protection de la Couche
d'Ozone ratifiée le 30 août 1989 ;
- Protocole de Montréal à la Convention de
Vienne ratifié le 30 août 1989 ;
Convention cadre sur les
Changements Climatiques ratifiée le 14 juin 1982 ;
- Convention sur la lutte contre la Désertification
ratifiée le 29 mai 1997 ;
- Convention sur la Diversité Biologique
ratifiée le 19 octobre 1997 ;
- Convention de Bâle sur le Contrôle des
Mouvements Transfrontières - des Déchets dangereux et leur
élimination ratifiée le 11 février 2001 ;
- Convention de Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable à certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (PIC)
ratifiée le 20 mai 2002 ;
- Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet
1989 ;
- Le protocole de Carthagène sur la
Biosécurité ratifié le 20 février 2003 ;
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants ratifiée le 17 mai 2004 ;
- La convention Internationale portant création d'un
fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures du 12 décembre 1971 ainsi que ses deux protocoles
du 25 mai 1984 et du 27 novembre 1992
- La convention de Paris sur la désertification en
Afrique du 17 juin 1994
- La convention de Paris sur la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel du 23 novembre 1972
Paragraphe 2. Les instruments internationaux à
vocation régionale
Ces instruments se déploient tant au plan continental
au que sous-régional
Au plan continental on dénombre entre
autre :
- Convention Africaine d'Alger du 15/09/1968 sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, révisée
le 11 juillet 2003 à Maputo en Nairobi, et devenue Convention de Maputo
du 23 septembre 2003 ;
- Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre
1967 ;
- Protocole d'Abidjan 1981 relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution marine en cas
de situation critique ;
- Protocole d'Abidjan 1981 relatifs à la
coopération en matière de lutte contre la pollution marine en cas
de situation critique ;
- Convention de Bamako du 30/01/1991 sur l'interdiction
d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des
mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux
produits en Afrique ;
- Convention de Nairobi du 14/06/1992 sur les changements
climatiques
Au niveau sous-régional
- Traité relatif à la conservation et la gestion
durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale
- Accords de Libreville/Gabon du 16/04/1983 de
coopération et de concertation entre les Etats de l'Afrique Centrale sur
la conservation de la faune sauvage
- Accords d'ENUGU ; Nigéria du 03/12/1977 sur le
règlement conjoint relatif à la faune et à la flore dans
le bassin conventionnel du lac Tchad
- Accord de Yaoundé de 1973 portant sus la
création du fonds de développement de la commission du bassin du
Lac Tchad ;
Fondamentalement, l'évolution du cadre normatif interne
de protection de l'environnement au Cameroun est fortement tributaire
l'attachement des pouvoirs publics aux mécanismes juridiques
internationaux. Autrement dit, les textes nationaux sont renforcés et
complétés par les centaines de conventions internationales en
matière d'environnement auxquels fait partie le Cameroun. L'ensemble de
ces textes (les conventions, traités, protocoles, accords
internationaux, lois et règlements etc.) constituent le corpus des
textes juridiques environnementaux qui concourent à donner corps au
droit de l'environnement au Cameroun. Leur foisonnement traduit
incontestablement la volonté poussée des pouvoirs publics
camerounais à recourir à l'outil juridique pour résoudre
les questions environnementales. Toutefois, afin d'éviter que ces
instruments normatifs, pour impressionnants qu'ils paraissent, tombent dans le
vice de l'inapplication, le gouvernement de la République, suite aux
recommandations données lors des différents forums
internationaux, à imaginer et conçu des outils institutionnels
destinés à mettre en oeuvre l'outil juridique afin de
résoudre efficacement les problèmes liés à la
dégradation du milieu naturel.
Chapitre 2
Cadre institutionnel de protection de l'environnement
au Cameroun
Le passage de la théorie à la pratique dans le
processus de protection de l'environnement nécessite la création
et le fonctionnement d'institutions adéquates tant au niveau national
qu'international. Si depuis les années 70 les institutions
internationales de protection de l'environnement avait commencé à
prospérer, il faut noter que ce n'est que dans les années 90 que
le Cameroun tente de se doter d'institutions spécifiques
consacrées à la cause environnementale. En effet, à partir
de 1996, la situation institutionnelle au Cameroun a connu une évolution
mitigée. S'il est noté un accroissement notable des institutions
en matière de gestion de l'environnement, il est néanmoins
déploré une définition imprécise de leurs
compétences respectives. De manière globales, ces institutions
sont allées croissantes pour répondre aux exigences
découlant de l'Agenda 21, des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), du Nouveau Partenariat pour le Développement
de l'Afrique (NEPAD) et du Document de Stratégie de Réduction de
la Pauvreté (DSRP) au niveau national.
Le système camerounais de protection de l'environnement
repose à la fois sur un double cadrage institutionnel comprenant les
institutions internes (section 1), soutenues dans leurs actions par de
organisations à caractère internationales (section 2).
SECTION 1 : LES INSTITUTIONS INTERNES DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
En République du Cameroun,
L'environnement constitue un patrimoine commun de la
nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel. Sa
protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il offre à la vie
humaine sont d'intérêt général141(*).
A ce titre, « sa protection est un devoir pour
tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de
l'environnement »142(*). Avec les rénovations
institutionnelles143(*)
modernes opérées au lendemain de la Conférence Rio,
plusieurs acteurs se voient reconnaitre un rôle dans le cadre de la
protection de l'environnement144(*). Il s'agit en première place de l'Etat et de
ses institutions d'une part (paragraphe 1), et des acteurs privés
d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les institutions publiques de
gestion de l'environnement au Cameroun
A l'analyse des textes sur la protection de l'environnement au
Cameroun, notamment la Loi-cadre de 1996, et les textes sur la
décentralisation, il convient d'indiquer que l'Etat joue un rôle
pivot dans la gestion de l'environnement. Toutefois, si la conférence de
Stockholmconsidère sans équivoque
l'État comme acteur majeur de lutte pour la préservation de
l'environnement (A),la conférence de Rio et
son Agenda 21viendront quant à eux, tout en réitérant ce
rôle majeur de l'État,suggérer, introduire et favoriser de
manière explicite la reconnaissance de nouveaux acteurs. Parmi ces
acteurs dont les femmes et les jeunes, figurent en bonne place les
collectivités locales (B).
A. L'Etat, acteur majeur de protection de
l'environnement au Cameroun
La Constitution impose un devoir de protection. Ce devoir est
assuré à travers le ministère en charge de l'environnement
(1) et les établissements et agences spécialisés (2).
1) Le ministère en charge de
l'environnement
C'est avant tout le ministère de l'environnement qui
est investi des compétences en matière d'environnement. Il s'agit
d'une tendance somme toute naturelle, eu égard au caractère
récent des préoccupations environnementales. La création
d'un ministère chargé spécialement des questions
environnementales constitue ainsi une tentative de concrétisation
administrative de ces préoccupations toutes nouvelles. C'est là
l'une des conséquences institutionnelles de la Conférence de
Rio145(*).
En effet, la période post 2000 a été
marquée par de profondes mutations du paysage institutionnel. Ainsi, par
décret n°2012/431 du 01 Octobre 2012, le Président de la
République du Cameroun organise le nouveau département
ministériel créé par le décret du 09
décembre 2011 portant organisation du gouvernement. Ce nouveau
département ministériel est dénommé
Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du
Développement Durable ; il se substitue ainsi à
l'ex-Ministère de l'environnement et de la protection de la nature
(MINEP) ; ses missions ont été grandement élargies
pour répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que du
développement économique du Cameroun. L'objectif visé ici
étant la recherche de plus d'efficacité afin d'apporter des
réponses appropriées aux problèmes
environnementaux146(*).
Avant d'analyser le rôle ou la place qu'occupe le
ministère de l'environnement au Cameroun (b), il est important que
revisiter l'évolution de cette institution (a)
a) Evolution institutionnelle du ministère de
l'environnement au Cameroun
Depuis plus d'une vingtaine d'années, la protection de
l'environnement et le développement durable retiennent l'attention des
pouvoirs publics camerounais. En effet, la prise en compte réelle des
questions environnementales par le Gouvernement a pour référence
la CNUED de 1992147(*).
Elle constitue le point de départ d'une nouvelle dynamique dans la
politique nationale en matière environnementale. Dès lors,
environnement et développement durable vont faire partie
intégrante des politiques publiques au Cameroun.
En effet, le Cameroun a participé à de
nombreuses rencontres internationales (Conférence de Stockholm sur
l'environnement en 1972, Conférence mondiale de Mexico sur la population
en 1984) ; il a également mis sur pied des institutions
chargées de suivre l'évolution de l'environnement au Cameroun
(Comité permanent de l'Homme et de la Biosphère
(Comité MAB148(*)) créé en 1984, la Sous-Direction de
l'Environnement et des Etablissements Humains en 1984 au sein de la Direction
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du Ministère
du Plan et de l'Aménagement du Territoire (MINPAT)) , la
réalisation d'actions concrètes menées en vue d'assurer un
développement durable est difficilement perceptible149(*).
En préparation du Sommet de Rio, et afin de se
présenter audit sommet avec un certificat de bonne conduite
écologique150(*),
le Cameroun s'est doté d'un ministère en charge de
l'environnement. Le Ministère de l'environnement et des Forêts
(MINEF) est ainsi créé par le décret n°92/069 du 9
avril 1992. Soit deux mois avant la tenue du sommet. L'une de
réalisations majeures de ce ministère était l'adoption du
Plan National de Gestion de l'Environnement (PNGE) en 1996. Mais compte tenu
des imperfections de ce ministère, il a été
réorganisé par décret n°98/345 du 21 décembre
1998, modifié par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999.
La principale innovation de ce décret est la mise en place d'un
Secrétariat Permanent à l'Environnement en lieu et place de la
Direction de l'Environnement composé de deux Divisions : la Division
des Programmes et du développement Durable et la Division des Normes et
Inspections Environnementales, d'une part; et d'un Centre d'Information et de
Documentation sur l'Environnement d'autre part. D'ailleurs en 2000, le MINEF a
lancé le Programme Sectoriel Forêt et Environnement (PSFE) qui
s'orientait essentiellement vers le secteur forestier. Cette discrimination a
conduit le gouvernement à élaborer un Plan d'Action Forestier
National (PAFN) et la Stratégie et Plan d'Action Nationale de la
Biodiversité (SPANB)151(*).
Ces efforts n'ont pas permis au Cameroun d'atteindre les
objectifs qu'il s'était assignés. Cette défaillance a
conduit le pays à revoir sa politique en la matière. C'est ainsi
que le MINEF, créé en 1992 a été scindé en
2004 en deux Départements Ministériels à savoir, le
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP)
chargé de coordonner le développement et la mise en oeuvre de la
politique environnementale, et le Ministère des Forêts et de la
Faune (MINFOF) chargé du développement et de la mise en oeuvre
des politiques faunique et forestière.
En effet, par décret n°2004/320 du 8
décembre 2004, le chef de l'Etat crée un Ministère
spécifiquement chargé de l'Environnement. La création du
MINEP participait du souci d'apporter la contribution du Cameroun aux grandes
préoccupations mondiales, relatives à la lutte contre la
dégradation continue de l'Environnement et le déficit du
développement152(*), bref la préservation de la
biodiversité. Sa principale mission était l'élaboration,
la mise en oeuvre et le suivi de la politique nationale
d'environnement153(*). A
ce titre, il était en charge de la coordination et du suivi des
interventions des organismes de coopération régionale ou sous
régionale en matière d'environnement154(*). La mise en oeuvre de cette
mission impliquait préalablement la définition de mesures de
gestion rationnelle des ressources naturelles, la sensibilisation des
populations en vue de susciter leur participation à la gestion, à
la protection et à la restauration de l'environnement, la
négociation et le suivi de la mise en oeuvre des conventions et accords
internationaux relatifs à la gestion de l'environnement ainsi que la
lutte contre la pollution sous toutes ses formes.
Les différents programmes et stratégies
élaborés par ce ministère ainsi que ses missions155(*) dénotent à
tous égards le souci du Gouvernement d'honorer ses engagements
internationaux, d'assurer aux populations un cadre de vie sain, et d'anticiper
sur les besoins des générations futures en terme de ressources
naturelles. Mais comment concevoir une administration en charge de
l'environnement qui ne prend pas totalement en compte les enjeux du
développement durable ? C'est fort de ce constat que le
gouvernement camerounais a procédé à un
réaménagement de cette institution en 2011156(*). Elle change de
dénomination et devient le Ministère de l'Environnement, de
la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED).
Ainsi le MINEPDED est le point focal en matière d'environnement de
nos jours.
b) Le MINEPDED, nouvelle administration centrale en
charge de l'environnement au Cameroun.
Ce changement de dénomination de l'ex-MINEP en MINEPDED
n'a pas produit de profonds impacts sur les attributions. A priori, les
missions du MINEPDED sont sensiblement les mêmes que celles autrefois
confiées au MINEP.
D'ailleurs le MINEPDED est responsable de
l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement
en matière d'environnement et de protection de la nature dans une
perspective de développement durable ; de la
politique/stratégie de développement et du suivi de la
biodiversité ; de la coordination et du suivi des interventions en
matière de coopération régionale pour des questions
relatives à la biodiversité et ce en collaboration avec le
Ministère des Relations Extérieurs et d'autres administrations
concernées ; du suivi des grands projets afin de s'assurer qu'ils
sont en conformités avec les normes environnementales157(*). Ces missions visent
à répondre aux enjeux majeurs tant de protection de la nature que
du développement économique du Cameroun.
Dans l'exercice de ses missions, le MINEPDED dispose d'un
éventail d'institutions pour l'assister158(*). On aurait pu s'attendre
à voir mentionné dans ce texte une disposition relative à
la collaboration ou éventuellement au partenariat avec les
collectivités locales. La surprise n'est pas de moindre ; et il
faut procéder par interprétation ou par déduction à
partir du texte considéré pour voir comment les
collectivités collaborent avec le ministère de l'environnement
dans l'accomplissement des missions qui incombent à ce dernier. On peut
notamment penser que l'information du public et les incitations à
l'écocitoyenneté pour une meilleure gestion de l'environnement
par les populations serait facilement accueillies par celles-ci si les actions
étaient menées directement par les collectivités et non
par l'administration centrale. Cependant, une autre institution, le ministre de
l'habitat et du développement urbain (MINHDU), qui n'est pas le point
focal en matière de gestion de l'environnement au Cameroun semble rendre
compte de notre préoccupation de collaboration avec les entités
décentralisées159(*).
Ce que l'on pourrait qualifier de « vide
juridique » ici quant à l'absence d'une mention expresse
de la collaboration en matière d'environnement et du
développement durable entre l'administration centrale et
l'administration décentralisée ne doit pas faire penser à
une extrême centralisation des matières environnementales au
Cameroun. En effet, dans le cadre des responsabilités publiques et des
questions nécessitant une attention particulière telle que la
protection de l'environnement, l'autorité locale apparait comme la
structure la mieux indiquée. Le mode de gestion publique le plus
favorable à cette exigence dans la société contemporaine
s'avèreêtre la décentralisation dans
laquelle les collectivités se sont vues reconnaitre de larges
compétences160(*)
en matière d'environnement et de développement durable.
Mais avant que l'on arrive à l'analyse des missions des
collectivités locales, penchons-nous d'abord sur ces autres institutions
publiques et agences spécialisées qui assistent le MINEPDED.
2) Les autres administrations et agences
spécialisés
Le MINEPDED n'est pas la seule institution à s'occuper
des préoccupations environnementales. Il bénéficie de la
collaboration d'autres départements ministériels (a), et
s'appuie aussi sur différents organismes gouvernementaux
spécialisés de gestion de l'environnement (b).
a) Les autres départements
ministériels
Quelques ministères se sont vus reconnaitre certaines
attributions environnementales. Il s'agit entre autres :
- Du ministère de l'agriculture et du
développement rural, chargé entre autres de la protection de
l'espèce végétale, et de la participation à la
planification et au suivi de la réalisation des programmes
d'amélioration du cadre de vie en milieu rural161(*).
- du ministère de l'eau et de l'énergie,
chargé de l'amélioration quantitative et qualitative de la
production d'eau et d'énergie ; de la régulation de
l'utilisation de l'eau dans les activités agricoles ; du suivi de
la gestion des bassins d'eau162(*).
- du Ministère des Forets et de la Faune dont la
principale responsabilité est l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de
faune163(*).
- du ministère de l'habitat et du développement
urbain, chargé de de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un
plan d'amélioration de l'habitat, tant en milieu urbain qu'en milieu
rural ; du suivi du respect des normes en matière d'hygiène
et de salubrité, d'enlèvement et/ou de traitement des ordures
ménagères164(*).
b) Les organismes gouvernementaux
spécialisés.
Dans l'accomplissement de certaines de leurs missions, les
gouvernements font de manière générale recours à
des établissements ou agences publics165(*). Ces recours que l'on nomme improprement
« décentralisation technique » sont le plus
souvent dus à la technicité et la complexité des
problèmes, l'absence de rentabilité immédiate et
évidente de certains processus, et aussi une demande forte et les
besoins de financement166(*).
Dans le contexte spécifique du Cameroun, accordons
singulièrement notre attention sur trois de ces organismes :
· La Commission Nationale Consultative pour
l'environnement et le Développement Durable (CNCEDD).
Elle est une conséquence institutionnelle de la
Conférence de Rio. Au lendemain du Sommet de Rio de 1992, la plupart des
pays africains, parmi lesquels le Cameroun, se sont dotés d'une
Commission Nationale Consultative pour l'environnement, en tant que relais
national de la Commission du Développement Durable (CDD)167(*). Ainsi retrouve-t-on dans la
loi cadre de du 5 aout 1996 au titre II l'article 10 (2) qui institue
Une Commission Nationale Consultative de l'Environnement
et du Développement Durable dont la charge est celle d' assister le
gouvernement dans ses missions d'élaboration de coordination,
d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement.
Au Cameroun, la CNCEDD est créée par le
décret n°94/259/PM du 31 mai 1994 du Premier Ministre, et
modifiée successivement par les décrets n°99/634/PM du 09
juin 1999, et n°99/780/PM du 11 octobre 1999. Elle est une structure qui
permet au Gouvernement de mieux gérer l'environnement. Elle veille sur
la réalisation des activités découlant de l'Agenda
21 ; assure l'évaluation des progrès accomplis dans
l'exécution des engagements souscrits par le gouvernement dans le cadre
de l'Agenda 21 ; analyse les différents rapports établis
dans le cadre du suivi de l'application des différentes conventions
internationales relatives à l'environnement et au développement
durable ; prépare les contributions du Gouvernement
destinées à la Commission de Développement Durable et en
exploite les compte-rendu et recommandations.
· Le Comité Interministériel de
l'Environnement (CIE).
Institué par la Loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement168(*), le CIE assiste le Gouvernement dans ses missions
d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques nationales en matière d'environnement et de
développement durable169(*). Cette institution se veut une solution à
l'éparpillement institutionnel et surtout au chevauchement ou conflits
de compétences qui pourraient naitre entre ces institutions. Se voulant
une plate-forme de dialogue entre les différents ministères, il
est présidé par une personnalité nommée par le
MINEPDED et est composé de membres représentant dix-sept (17)
départements ministériels notamment170(*) :
- un
représentant du Ministère chargé de l'environnement ;
- un
représentant du Ministère chargé de l'administration
territoriale ;
- un
représentant du Ministère chargé de l'agriculture ;
- un
représentant du Ministère chargé des mines et de
l'industrie ;
- un
représentant du Ministère chargé des petites et moyennes
entreprises ;
- un
représentant du Ministère chargé de l'élevage, des
pêches et des industries animales ;
- un
représentant du Ministère chargé de l'aménagement
du territoire ;
- un
représentant du Ministère chargé de l'eau et de
l'énergie ;
- un
représentant du Ministère chargé de la recherche
scientifique ;
- un
représentant du Ministère chargé du tourisme ;
- un
représentant du Ministère chargé des travaux
publics ;
- un
représentant du Ministère chargé des transports ;
- un
représentant du Ministère chargé du développement
urbain et de l'habitat ;
- un
représentant du Ministère chargé des domaines et des
affaires foncières ;
- un
représentant du Ministère chargé de la santé
publique ;
- un
représentant du Ministère chargé de la
défense ;
- un
représentant du Ministère chargé des forêts.
· Le Fonds National pour l'Environnement et le
Développement Durable (FNEDD).
Aux termes de l'article 11 (1) de la loi n°96/12 du 05
août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement,
Il est institué un compte spécial
d'affectation du Trésor, dénommé FondsNational de
l'Environnement et du Développement Durable, ci-après
« Fonds » qui a pour objet, entre autres: de
contribuer au financement de l'audit environnemental ; d'appuyer les projets de
développement durable; d'appuyer la recherche et l'éducation
environnementale ; d'appuyer les programmes de promotion des technologies
propres ; d'encourager les initiatives locales en matière de protection
de l'environnement, et de développement durable ; d'appuyer les
associations agréées engagées dans la protection de
l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;
d'appuyer les actions des départements ministériels dans le
domaine de la gestion de l'environnement.
Le décret présidentiel n°2008/064 du 04
février 2008 fixe les modalités de gestion du Fonds crée
par la loi, n° 96/12 du 05 août 1996. Aux termes de l'article 4 (1)
de ce décret, les Ressources du Fonds sont destinées,
suivant les priorités arrêtés par le Gouvernement, à
appuyer les projets de développement durable, la recherche et
l'éducation environnementale, à contribuer à
l'amélioration des sites, aux Etudes d'Impact Environnemental (EIE),
à promouvoir les technologies propres, à encourager les
initiatives et associations de gestion durable de l'environnement entre
autres.
Si le rôle, mieux la place centrale de l'Etat à
travers ses institutions sur les questions environnementales n'est plus
à démontrer, précisons tout de même qu'à
l'échelon central l'Etat a des capacités d'orientation, de
fixation des nomes dont il s'assure du respect. Cependant de nouveaux acteurs
notamment les collectivités locales, discutent désormais ces
compétences.
B. La place des collectivités territoriales
en matière d'environnement au Cameroun.
La forte centralité en matière environnementale
Cameroun s'est estompée peu à peu avec le processus de
décentralisation. En effet, les Collectivités locales
camerounaises, en dépit des exigences issues de l'Agenda 21 du
Cameroun171(*) sur la
mise en place d'un cadre institutionnelle de protection de l'environnement
adéquat, trouvent le fondement de leurs compétences dans la loi
n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement. Si l'on admet avec le Préambule de la Constitution que
la protection de l'environnement est un devoir pour tous, et que l'État
veille à sa défense et sa promotion, c'est la loi du 05
Août 1996 qui définit les rôles en la matière en son
article 4 en ces termes : « Le Président de la
République définit la politique nationale de l'environnement. Sa
mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les
collectivités territoriales décentralisées... ».
S'agissant des déchets, cette loi précise en son article 46
(1) que « les collectivités territoriales
décentralisées assurent l'élimination des déchets
produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les
services compétents de l'Etat, conformément à la
réglementation en vigueur ». Voilà donc situé
approximativement le fondement législatif de la compétence des
collectivités territoriales en matière environnementale
où, peut-on dire, elles disposent de compétences propres
attribuées pas la loi.
En effet, l'article 26 de la Loi Constitutionnelle du 18
janvier 1996 énumère le domaine de la loi. Cet article donne
compétence au législateur pour l'organisation, le fonctionnement,
la détermination des compétences et des ressources des
collectivités territoriales décentralisées. En effet, les
lois sur les collectivités territoriales décentralisées
n'ont commencé à être promulguées qu'en 2004.
D'abord c'est la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant
« Loi d'orientation de la Décentralisation » qui
fixe les règles générales applicables en matière de
décentralisation territoriale ; ensuite la loi n°2004-018
fixant les règles applicables aux communes ; et enfin la loi
n° 2004-019 fixant les règles applicables aux Régions.
Compte tenu de l'ineffectivité des Régions au Cameroun à
l'heure actuelle, l'analyse sera axée essentiellement sur les communes
urbaines d'arrondissement (CUAD) et la Communauté Urbaine, notamment
celle de Douala. Elles permettent d'évaluer le degré de la
décentralisation172(*) de la gestion de l'environnement consentie par le
pouvoir central, de même que le partage des compétences entre la
communauté urbaine de Douala et les communes d'arrondissement.
1) La communauté urbaine de douala (CUD), un
acteur majeur de la protection de l'environnement
L'organisation de la ville de Douala privilégie la CUD
et les Communes d'Arrondissement173(*) en matière d'environnement, car depuis
presqu'une décennie, ce sont les communes urbaines qui sont
chargés de la gestion de l'environnement en milieu urbain174(*). A ce titre, la
commune175(*) est
compétente pour
L'alimentation en eau potable ; le nettoiement des
rues, chemins et espaces publics communaux ; le suivi et le contrôle
de gestion des déchets industriels ; les opérations de
reboisement et la création de bois communaux ; la lutte contre
l'insalubrité, les pollutions et les nuisances ; la protection des
ressources en eaux souterraines et superficielles ; l'élaboration
de plans communaux d'action pour l'environnement ; la création,
l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins
d'intérêt communal ; la gestion au niveau local des ordures
ménagères176(*).
Un décret du Premier Ministre fixant les
modalités d'exercice de certaines compétences
transférées aux communes177(*) récapitule ces compétences en deux
grands groupes. A cet effet la Commune est compétente pour
« l'élaboration des plans d'action pour
l'environnement ; et pour la lutte contre l'insalubrité ; les
pollutions et les nuisances »178(*). S'il parait ainsi aisé de
déterminer avec précision les compétences des CA,
l'analyse des compétences de la Communauté urbaine est
nécessaire pour mieux appréhender la répartition des
compétences entre la CUD et les CUAD.
La loi du 15 juillet 1987 renforcée par la loi du 22
juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes permet
d'identifier clairement les domaines de compétences de chacune de ces
entités. Ainsi, au sens de l'article 110 de la loi du 22 juillet 2004
sur les commune, la Communauté urbaine est compétente
pour :
- La création, l'entretien, la gestion des espaces
verts, parcs et jardins communautaires ;
- La gestion des lacs et rivières
d'intérêt communautaire ;
- Le suivi et le contrôle de la gestion des
déchets industriels ;
- Le nettoiement des voies et espaces publics
communautaires ;
- La collecte, l'enlèvement et le traitement des
ordures ménagères ;
- La création, l'aménagement, l'entretien,
l'exploitation et la gestion des équipements communautaires en
matière d'assainissement, eaux usées et pluviales ;
- L'élaboration des plans communautaires d'action pour
l'environnement, notamment en matière de lutte contre les nuisances et
les pollutions, de protection des espaces verts ;
- La création, l'entretien et la gestion des
cimetières publics ;
- La création et la gestion de toutes installations
à caractère sportif d'intérêt communautaire ;
- Les opérations d'aménagement
d'intérêt communautaire ;
- La constitution de réserves foncières
d'intérêt communautaire ;
- La création et la gestion de centres culturels
d'intérêt communautaire ;
- La participation à l'organisation et la gestion des
transports urbains de voyageurs ;
- L'élaboration et l'exécution de plans
communautaires d'investissement ;
- La planification urbaine, les plans et schémas
directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en
tenant lieu. A cet effet, la communauté urbaine donne son avis sur le
projet de schéma régional d'aménagement du territoire
avant son approbation.
La lecture combinée des articles 16 et 110 de la loi
sur les communes permet de constater que les communes et les Communautés
urbaines exercent de façon concurrente certaines compétences.
Afin d'éviter tout conflit de compétence, le législateur a
expressément mentionné dans la loi que les compétences de
la communauté priment sur celles des Communes d'arrondissement. C'est
dire combien cette entité est d'une importance particulière dans
le cadre du processus de développement local. Comme le relevait Francis
TIANI KEOU179(*),
La Communauté urbaine est l'institution locale
indiquée pour la mise en oeuvre et le suivi quotidien de la politique
environnementale de la Ville de Douala. Son budget tient largement compte de la
réalisation des projets environnementaux inscrits dans son plan de
campagne annuel (curage des caniveaux et drains, campagne de
dératisation et de désinsectisation, collecte et traitement des
ordures ménagères, création d'une nouvelle
décharge, entretien des parcs et jardins, désherbage des abords
de rue, etc.).
Pour des besoins opérationnels dans l'accomplissement
de ses missions, la Communauté urbaine a besoin d'un personnel de
qualité en nombre suffisant ainsi que des moyens financiers
adéquats. Bien plus, dans son organigramme, l'on constate que la Ville
de Douala s'est dotée d'une Direction de l'urbanisme, de la
construction et de l'environnement180(*) chargée entre autre de mettre en oeuvre une
politique environnementale et du cadre de vie ; de l'étude et de la
mise en oeuvre des actions de paysage ment de la ville ; de l'entretien
des espaces verts et des cimetières181(*). Plus spécifiquement, l'article 42 du
même texte nous renseigne sur un Département de
l'Environnement et du Cadre de Vie crée dans cette Direction. Ce
département est chargé de
mettre en oeuvre les instructions et directives du
Délégué dans le domaine environnemental et de
l'amélioration du cadre de vie ; d'identifier les nuisances urbaines et
les actions de prévention associées ; d'évaluer les
activités des prestataires chargés du ramassage, du transport et
du traitement des ordures ménagères et des autres déchets
; de veiller à l'application des mesures réglementaires relatives
à la promotion d'un environnement urbain sain, en relation avec les
services concernés ; de mettre en oeuvre des actions de sensibilisation
des populations.
L'on pourrait craindre que ce département ne dispose
pas de personnel répondant aux à certains critères
professionnels182(*).
Parvenu à ce niveau d'analyse, force est de constater
l'accent qui est mis sur le rôle des collectivités locales, leur
place dans l'entreprise de protection de l'environnement au Cameroun. En effet,
compte tenu de cette large gamme de compétences reconnues aux
Communautés urbaines, et celle Douala en l'occurrence, il parait
indéniable d'opiner, même si c'est à risque, que la
prise en compte183(*) des collectivités locales en matière
de gestion de l'environnement au Cameroun est bien plus considérable eu
égard à leur attributions législatives. Toutefois, ces
compétences légales des collectivités locales ne nous
renseignent assurément pas assez sur leur réelle participation
à la protection de l'environnement au Cameroun.
2) La répartition des compétences entre
la CUD et les CUAD
Dans le cadre d'une collectivité à deux
échelons184(*),
des dispositions spécifiques contenues dans la même loi
prévoient la répartition des compétences entre la Ville de
Douala et les six communes d'arrondissement qui la composent
actuellement185(*).
Concernant la CUD, on retiendra deux dispositions
spécifiques de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes, en l'occurrence :
· L'article 124 qui précise clairement :
« la création d'une communauté urbaine emporte le
transfert de compétences et de ressources à ladite
communauté urbaine par les communes d'arrondissement,
conformément aux dispositions de la présente
loi ».
· L'article 110 fixant les compétences des
Communautés urbaines.
On remarquera que cette disposition reprend presque totalement
le contenu de l'article 16 relatif aux compétences
transférées aux communes. En effet, force est de constater que
l'une des clefs de l'organisation des relations entre les Communautés
Urbaines (CU) et les CUAD et du partage entre-elles des compétences
transférées se trouve dans la définition de leurs
territoires et de leurs patrimoines respectifs186(*). Or, si la loi apporte une
définition des territoires, concernant le patrimoine et les
responsabilités, elle ne précise en rien les notions
d'intérêt communal d'une part et d'intérêt
communautaire187(*)
d'autre part. À titre d'exemple, il n'est pas aisé de distinguer
pour un espace vert, les critères qui le désignent comme
d'intérêt communal ou d'intérêt
communautaire188(*).
Pour que cette distinction soit opérante, il y a lieu d'en
préciser les critères. Il demeure alors que des clarifications
sont encore à apporter à la répartition effective des
compétences entre la CUD et les CUAD qui la composent189(*).
Paragraphe 2. Les acteurs privés de la
protection de l'environnement au Cameroun.
Afin de suppléer l'Etat dans cette action de protection
de l'environnement, de nombreux autres acteurs ont vu le jour. Les acteurs
non-étatiques, notamment les organisations non gouvernementales (ONG)
à caractère environnemental (A) et les entreprises privées
(B), y jouent un rôle de plus en plus croissant. Les uns et les autres
mènent des actions concrètes, visibles et plus ou moins durables
sur le terrain dans le domaine de la gestion de l'environnement. L'emprise de
leur action sur l'environnement est directe et perceptible, et l'impact de
leurs activités peut être évalué, suivi et
apprécié à différent niveaux. C'est pourquoi on les
considère comme des acteurs directs190(*)de la protection de l'environnement, pour les
distinguer des acteurs indirects191(*).
A. Le Rôle des ONG à caractère
environnemental
A l'instar des institutions publiques sus
évoquées, les ONG192(*) à caractère environnemental font
partie des institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de
l'environnement.
Pourtant, la reconnaissance de ces organismes comme acteurs de
la protection de l'environnement, n'est pas été toujours
allé de soi. En effet, plusieurs crises sociales ont favorisé
l'émergence et la consécration de tels organismes dans un
contexte international favorable à la prise en compte de tous les
acteurs sociaux de protection de l'environnement.
Pour mieux appréhender la dynamique des ONG
environnementales opérant au Cameroun, et plus particulièrement
dans la Ville de Douala (2), il serait de bon augure de faire un bref
détour sur le cadre normatif de leur consécration (1).
1) Cadre de normatif de consécration des
ONG
Si la place des ONG, en tant que partenaires
privilégiés des Etats et des organisations intergouvernementales
dans la mise en oeuvre des programmes environnementaux193(*) ne souffre aujourd'hui
d'aucune contestation, il faut noter qu'avant la CNUCED, la situation
était bien différente. En effet, c'était de façon
souvent directe et imprécise que l'on faisait allusion aux ONG dans les
textes internationaux194(*). Mais le sommet de RIO a été un lieu
de rassemblement inédit de divers acteurs du droit international de
l'environnement195(*). Mais peu avant la Conférence de Rio, on a
assisté à un véritable boom des ONG tant nationales
qu'internationales196(*), et la tendance s'est maintenue après le
sommet. Désormais, les ONG sont reconnues de la manière la plus
officielle et la plus solennelle comme acteurs du droit international de
l'environnement.
De fait, si le principe 10 de la Déclaration de Rio
requiert « la participation de tous les citoyens
concernés » pour optimiser la façon de traiter
l'environnement, il convient de relever que cette participation est plus
opérationnelle dans les associations et ONG. D'ailleurs, ce sont elles
qui répercutent le mieux les opinions des citoyens. Cette place assez
privilégiée des ONG se manifeste davantage lorsque l'Agenda 21
leur consacre tout un chapitre197(*). Plusieurs autres conventions tant
universelles198(*) que
régionales199(*)
adoptées après Rio contiennent des dispositions qui reconnaissent
l'importance des ONG et leur participation à la gestion durable de
l'environnement.
Sur le plan interne, la loi-cadre sur l'environnement ne
précise pas de façon expresse la place et le rôle des ONG
dans l'entreprise de protection de l'environnement. On en déduit de la
lettre de l'article 6. En effet, d'après les dispositions de l'article
6, alinéa 1 de la loi n° 96/12, toutes les institutions
privées sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de
sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux.
C'est ce que les ONG à caractère environnemental
s'évertuent à faire au quotidien pour contribuer à la
gestion convenable de l'environnement.
2) La dynamique des ONG environnementales dans la Ville
de Douala
Les ONG à caractère environnemental jouent un
rôle déterminant dans la protection de l'environnement au
Cameroun. Se situant au bas de l'échelle institutionnelle, elles sont
les institutions les plus proches des populations et les plus présentes
sur le terrain. Ainsi, elles interviennent dans l'animation, la formation, la
sensibilisation et l'organisation des populations autour des projets sociaux,
environnementaux ou économiques. De la sorte, elles sont souvent
utilisées comme des canaux d'informations et de sensibilisation sur la
conduite à tenir par les populations dans la gestion
écologiquement rationnelle des ressources naturelles.
Au Cameroun, plusieurs ONG participent à la gestion de
l'environnement. A titre d'exemple, nous pouvons citer : le Collectif des
Organismes de Participation au Développement du Cameroun (COPAD) ;
la Fédération des ONG de l'Environnement du Cameroun
(FONGEC) ; la Confédération des ONG d'Environnement et de
Développement de l'Afrique Centrale (CONGAC).
Plus spécifiquement dans la Ville de Douala, on
rencontre des ONG locales qui se sont données pour mission d'oeuvre afin
qu'inculquer aux populations la conscience écologique. Précisons
d'emblée que les grandes ONG internationales (IUCN, WWF) ne
s'intéressent pas encore spécifiquement à la Ville de
Douala200(*). Mais on
assiste à l'émergence d'un réseau d'ONG de l'environnement
(le ROAD).
En effet, ENVIRO-PROTECT201(*) est le chef de file des ONG se déployant dans
la Ville de Douala202(*). ENVIRO-PROTECT est en effet une organisation dont
les objectifs sont entre autres de sensibiliser les individus et les groupes
sociaux sur le rapport entre l'environnement et le développement,
d'aider les individus et les groupes sociaux à la résolution des
problèmes d'environnement et de développement, de coopérer
activement dans un double but d'échange d'expériences et
d'entraide avec les autres organisations nationales ou internationales
poursuivant les mêmes objectifs.
Certains projets réalisés par ENVIRO-PROTECT
sont des initiatives gouvernementales qui utilisent les organisations de la
société civile pour leur mise en oeuvre. C'est le cas par exemple
du Programme National de Développement Participatif (PNDP) dans
l'accompagnement des communes et communautés locales et les actions de
sensibilisation pour les routes rurales avec le Ministère des Travaux
Publics (MINTP). Par ailleurs, le gouvernement a eu souvent recours à
l'expertise d'ENVIRO-PROTECT (fruit de longues années
d'expérience acquise dans le domaine du développement durable et
autres). Ainsi, ENVIRO-PROTECT a participé à la
réalisation de la Stratégie et Plan National de Gestion de la
Biodiversité. Elle travaille en ce moment avec la CUD qui la d'ailleurs
sollicité pour l'élaboration de son Agenda 21.
En outre, la Fondation Camerounaise Terre
Vivante (FCTV) est une organisation de promotion et de protection
également très active dans la ville de Douala. C'est ainsi
qu'elle participe ou pilote un certain nombre de projets environnementaux.
Ainsi, en partenariat avec Living EarthFoundation, la FCTV assure la mise en
oeuvre du projet : « Amélioration des conditions de vie
dans les quartiers précaires - Gagner de l'argent par les
déchets » à Douala au Cameroun.
Par ailleurs, en étroite collaboration avec ses
partenaires, la FCTV a développé le projet « LOW
CARBON ENERGY » dont le but est la promotion d'un
marché de produits à faible émission de carbone,
l'amélioration de la santé des ménages, l'émergence
d'opportunités d'affaire et de travail. Sur le plan environnemental,
l'impact de ce projet permettra à la ville de Douala de réduire
l'émission des gaz à effet de serre (CO2 en
particulier) au travers de l'utilisation de produits à faible
émission de carbone203(*). Par exemple l'utilisation des systèmes de
cuissons améliorés réduit les émissions,
protège contre l'intoxication à la fumée, réduit la
déforestation et est moins couteux que la cuisine sur gaz naturel et au
bois classique. Le même exemple peut être pris avec les solutions
d'éclairage « solar light bulbproduct » qui
entraine une économie sur les factures d'électricités.
Une autre ONG, notamment le Centre International de Promotion
de la Récupération (CIPRE), spécialisée dans la
récupération des déchets plastiques déploie aussi
des activités impressionnantes dans la ville de Douala.
En effet, créée en 1996, le CIPRE a construit
son action autour de l'épineux problème des ordures
ménagères, et surtout des déchets plastiques.
« Cité Propre »204(*) est son projet phare,
soutenu par la Coopération française à travers le Fonds
Social pour le Développement (FSD). Il est basé sur la promotion
du recyclage des déchets plastiques et de la récupération
des emballages dans l'espace urbain. A travers ses actions, cette ONG a pu
créer toute une filière, allant de la pré-collecte
jusqu'au recyclage des déchets plastiques. Ainsi, tous les
déchets plastiques sont collectés à la base par la
population, et revendus au CIPRE.
B. Les entreprises privées.
1) Les entreprises privées polluantes à
Douala
La plupart des grandes entreprises de Douala sont des filiales
des multinationales205(*). De ce fait, elles sont obligées de prendre
en compte l'environnement dans leurs activités pour
l'intérêt de leurs maisons mères206(*). Récalcitrantes au
départ et souvent sanctionnées en vertu du principe du pollueur
payeur, ces entreprises traitent désormais certains de leurs
déchets ou les confient à des sociétés
spécialisées. Pour cette raison, elles ont des programmes de
développement durable. Certaines d'entre elles posent des actions dans
le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)207(*). La plupart de ces
entreprises ont dans leur organigramme un service hygiène,
santé, environnement et développement durable.
Quelques illustrations permettent de mieux appréhender
la situation.
Ø GUINESS Cameroun SA
Guinness Cameroun SA, sanctionnée par le passé,
a créé un service de gestion de l'environnement; de la
santé et des risques. Un centre d'information spécialisé
répond par ailleurs aux questions des membres du personnel et des
visiteurs. L'entreprise brassicole, qui, à l'heure actuelle, rejette
encore elle aussi ses eaux usées non-neutralisées dans la nature,
s'est dotée depuis quelques années déjà d'un
dispositif de montage d'une station d'épuration.
Nous avions acquis au départ un terrain au
voisinage de l'usine pour installer la station, mais nous sommes restés
bloqués par les difficultés d'obtention d'un titre de
propriété. Aujourd'hui, nous avons trouvé la solution de
l'installer sur un site aménagé dans notre usine,
explique-t-on au service environnemental qui assure que la
station est opérationnelle depuis 2008.
« Mettre en place une station d'épuration
coûte très cher. Les entreprises font déjà de gros
efforts. Il ne leur reste qu'à les construire et beaucoup sont sur la
voie », se félicite-t-on au ministère de
l'Environnement et de la protection de la nature. La bonne foi des industries
est désormais prise en compte et les rares sanctions ne sont plus
médiatisées comme auparavant, à la demande de ces
dernières.
Ø Société Anonyme des Brasseries
du Cameroun (SABC)
La SABC, dans son approche environnementale, s'engage à
assumer pleinement sa responsabilité sociale en faveur du
développement durable208(*). Cet engagement passe par :
· la préservation de l'écosystème
naturel
· l'utilisation rationnelle des ressources naturelles
· le respect de la réglementation en vigueur
· la gestion écologique des rejets
générés par son activité
· la sensibilisation et la formation du personnel sur la
protection de l'environnement
Concrètement, devant le bâtiment administratif de
l'usine de Koumassi, l'une des cinq que compte la SABC, trois bacs à
ordures en métal ont été installés. Le premier pour
les déchets en nylon, le second pour ceux en plastique et le
troisième pour les divers. Une zone poubelles a été
aménagée derrière l'entrepôt qui abrite la
chaîne de production. Les eaux usées de l'usine sont simplement
recueillies dans une cuve, où elles sont neutralisées par du gaz
carbonique, puis déversées dans l'un des deux caniveaux
aménagés.
Il faut noter qu'à la SABC, le service gestion de
l'environnement n'a vu le jour qu'en 2004, trois ans après que cette
entreprise et une douzaine d'autres aient été sanctionnées
par le ministère de l'Environnement et obligées à verser
des amendes allant de 2 à 5 millions de FCFA209(*).
Bien plus, dans le souci de préserver davantage
l'environnement contre les pollutions, notamment celles dues au plastique, les
SABC ont conclu un accord de partenariat avec la société HYSACAM
pour le ramassage et le traitement des bouteilles vides en plastique.
« Plastic-Récup » est nom de cet accord. Il
est une réponse à l'arrêté conjoint
n°004/MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012 portant
réglementation de la fabrication, de l'importation et de la
commercialisation des emballages non biodégradables. L'article 3 de cet
arrêté précise cependant que « tout
fabricant, importateur ou distributeur d'emballage non biodégradables
autorisés est responsable de la gestion de ses
déchets ». L'action des SABC à travers
« Plastic-Récup » procède de
l'application de Principe de Responsabilité cher au droit
international en général et au droit international de
l'environnement en particulier, et réaffirmé dans ce texte
réglementaire interne.
Ø Complexe Chimique Camerounais (CCC)
Le CCC est situé à Bassa, dans la zone
industrielle, à l'Est de la ville de Douala. Il s'emploie dans
l'agroindustriel que sont ses huileries, savonneries, détergenteries et
autres unités de glycérine. Dans un rapport210(*) faisant suite à une
étude menée en 2006, cet établissement industriel
déroule des aspects de la stratégie pour un développement
soutenu et responsable.
En clair, depuis bientôt une décennie et ce
dans la limite de ses moyens, le CCC a entrepris une politique
environnementale à terme en 4 volets et ce conformément
à la réglementation Camerounaise.
ü La mise sur pied au sein de l'entreprise d'un
comité de l'environnement qui de concert avec la direction doit
sensibiliser les travailleurs de veiller aux respects des normes
environnementales en vigueur.
ü Une information permanente avec la population
environnante pour trouver ensemble des solutions appropriées pour les
effluents.
ü Une politique de rénovation progressive de
l'outil de production désuet
ü Une politique du choix de nos fournisseurs
(stakeholders) conformément à ses objectifs en
matière environnementale.
2) Les entreprises privées
spécialisées dans la collecte et le recyclage
Pas toujours parfaitement équipées pour les
traiter, les entreprises confient aujourd'hui leurs déchets (huiles
usées, déchets d'hydrocarbures ou médicaux, batteries,
etc.) à des sociétés privées camerounaises (Bocam,
Bocom, Nettoycam, Red-Plast, Hysacam) spécialisées dans
l'enlèvement, l'incinération et le recyclage. Toutes ont
été créées après 2001. « Les
déchets aujourd'hui récupérés et traités par
ces sociétés étaient par le passé
déversés dans la nature », fait remarquer Jean
Jérôme OWONA, chef du bureau de l'information à la
délégation régionale du ministère de
l'Environnement pour la Région du Littoral, où sont
installées la majorité des industries.
En effet, quelques entreprises privées se positionnent
comme des partenaires quasi incontournables pour la gestion de certains
déchets dans la ville de Douala. Elles ont notamment
spécialisées dans la vidange de matières sanitaires, le
recyclage d'huiles de vidange et la collecte des boues industrielles. Leur
action est déterminante pour résoudre les problèmes de
pollution diffuse qu'auraient pu générer les eaux venues de
fosses septiques ou des latrines pleines211(*). Par leurs actions également, l'on assiste
à la maitrise par le recyclage des huiles vidangées des divers
moteurs et circuits hydrauliques, des polluants (métaux lourds,
phénols, cyamidées, PCB, etc.) qui se retrouveraient en grande
quantité sur les sites de production de ces boues.
· BOCOM RECYCLING
Gagner de l'argent en dépolluant. C'est le pari
lancé par le BocomRecycling, une société camerounaise
spécialisé dans la collecte et le recyclage des batteries
usées. Créée en 2004 dans le but de résoudre le
problème posé par la mauvaise gestion des batteries
usagées, BocomRecycling, entité du groupe BOCOM s'est depuis lors
imposé comme l'un des acteurs incontournable de ce secteur
d'activité dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun. En plus du
recyclage du plomb à partir des vieilles batteries, la structure a
diversifié son activité en y ajoutant le recyclage du plastique
permettant d'obtenir des matériaux utilisés dans le génie
civil tels que : les pavés (permettant un habillage des jardins, des
cours, des allés et bordures,...) et les tuiles pour les toitures. Ses
activités sont dès lors plus complètes, allant du
recyclage du plomb contenu dans les batteries, aux coques extérieures
des dites batteries. Permettant de ce fait de confirmer l'assertion selon
laquelle rien ne se perd dans la nature, tout se transforme212(*). Il convient aussi de
mentionner que les acides et le plomb que contiennent les batteries sont
très dangereux pour l'homme et les autres organismes vivants. Ce
métal peut causer des lésions cérébrales chez
l'individu, des maladies cardiovasculaires et de la reproduction. Selon les
experts, une seule batterie abandonnée dans la nature pollue 400 m²
de surface213(*).
· REDPLAST SARL
RED-PLAST est la première entreprise industrielle de
recyclage des déchets plastiques au Cameroun. Installée dans la
ville de Douala, et précisément à Ndokoti, sa vision se
décline en plusieurs points essentiels: développement durable et
protection de l'environnement. Par ses actions perceptibles sur le terrain,
elle contribue à la réduction des impacts environnementaux
liés à la production des déchets plastiques et aux
produits dérivés.
Cette entreprise verte génératrice de revenus et
d'emplois sur la base des déchets plastiques est chargée
d'exploiter ces déchets à travers leur récupération
et leur transformation en des produits semi-finis et finis. Elle offre les
services et produits suivants : La collecte des déchets plastiques, la
transformation et la vente des produits dérivés du plastique
à savoir les granulés utilisés comme matières
premières dans les industries de transformation du plastique ; les
tuiles pour les couvertures des maisons ; les pavés pour les
revêtements du sol.
· HYSACAM
Hysacam est la principale société privée
de traitement des déchets ménagers au Cameroun. Elle est
signataire de contrats de gestion avec 14 villes camerounaises. En
décembre 2009, réunis à Marrakech (Maroc), les maires
africains ont reconnu son efficacité en lui décernant le
1er prix « Africités de la gestion des
déchets en Afrique »214(*).
Hysacam signe des contrats d'objectifs avec les
communautés urbaines ; ces contrats encadrent très
précisément le contenu du service à rendre par ce dernier.
La communauté urbaine fixe par zone des objectifs précis de
circuits et de nettoiement. Le tonnage collecté est
contrôlé quotidiennement par la municipalité, qui
sanctionne par des pénalités conséquentes les
éventuels manquements aux objectifs.
· BOCAM SARL
BOCAM Sarl est une entité du GROUPE FOKOU qui s'occupe
de la collecte et de la gestion des déchets de toutes ses structures.
Agissant dans la métropole de Douala, elle se charge de la collecte des
huiles usées produits dans les différentes structures du Groupe
dont elle fait partie.
En effet, pour faire face aux exigences de la Banque Mondiale
en matière de management de l'environnement, BOCAM dispose de toute la
logistique nécessaire pour collecter systématiquement les huiles
usées et les déchets industriels dans tout le territoire
camerounais et les pays environnants215(*). Grâce à ses installations modernes
telles que la centrifugeuse qui est un séparateur très
performant, un laboratoire moderne et un personnel hautement qualifié,
BOCAM recycle les huiles usées afin d'incinérer les
déchets et les huiles ainsi recyclées sont utilisées dans
les chaudières industrielles des entreprises telles que CIMENCAM, LES
ACIERIES DU CAMEROUN, SCR MAYA, CAMLAIT etc...
En somme, la protection de l'environnement au Cameroun
mobilise plusieurs institutions nationales. L'intervention des acteurs
étatiques non étatiques esquisse ce que Maurice KAMTO appelle la
« démocratie participative » dans la gestion de
l'environnement.
SECTION 2. LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN
Le cadre global de la coopération en matière
d'environnement et de développement durable au Cameroun montre en effet
que celle-ci est strictement orientée sur la mise en oeuvre des
OMD216(*), à
travers le DSRP/DSCE. Ainsi, la mise en oeuvre du droit international de
l'environnement nécessite une coopération entre les
différents acteurs institutionnels, compte tenu de la complexité
même de cette mise en oeuvre que les Etats doivent assurer au plan
national217(*). La
coopération internationale est alors essentielle, étant
donné que les problèmes environnementaux ne s'arrêtent pas
aux frontières nationales. Les mesures d'envergure mondiale jouent un
rôle crucial pour fixer des objectifs, lever des fonds et faciliter le
partage des bonnes pratiques. Ainsi, l'encadrement institutionnel de la
protection de l'environnement permet de
Faciliter l'intégration de l'environnement et du
développement au niveau tant de l'élaboration et de la
planification de la gestion que de la mise en place d'un cadre juridique
approprié218(*).
A cet effet, compte tenu du caractère planétaire
des problèmes environnementaux, la coopération institutionnelle
internationale s'avère l'une de mesures appropriées
adoptées par la communauté des Etats pour faire face à la
dégradation sans cesse croissante de milieu naturel. C'est fort de cela
que l'Agenda 21 consacre un chapitre entier, notamment le chapitre 38 aux
« arrangements institutionnels internationaux ».
En outre, s'interrogeant sur le cadre institutionnel
international de protection de l'environnement au Cameroun, il n'est pas anodin
de se demander concrètement quelles sont les institutions
internationales qui oeuvrent pour la sauvegarde de l'environnement et du
développement du Cameroun ; on s'interroge aussi sur leur
rôle dans cette entreprise. En guise de réponse, l'Agenda 21
conclu que
L'objectif général [des
institutions] est d'assurer l'intégration des questions
d'environnement et de développement à l'échelle nationale,
sous régionale, régionale et internationale, y compris dans le
cadre des arrangements institutionnels du système des Nations
Unies219(*).
En effet, la conférence de Stockholm se trouve
être incontestablement le point de départ de l'émergence
au niveau international des mécanismes institutionnels
spécifiques dans le domaine de l'environnement220(*). Les institutions ici
considérées sont à la fois universelles, et
régionales ou sous régionales. Mais il y a une nouvelle tendance
qui fait bonne presse à l'aune de la mondialisation : la
coopération décentralisée. Envisagée le plus
souvent dans le cadre d'une coopération bilatérale, la
coopération décentralisée ne manque pas de faire ses
preuves depuis les années 1960 lorsque les pays du nord se
préoccupaient du développement des pays du sud.
La coopération institutionnelle dans le cadre la
protection de l'environnement s'étend du cadre multilatéral
(paragraphe 1) au cadre bilatéral (paragraphe 2).
Paragraphe 1. La coopération
multilatérale dans le cadre de la protection de l'environnement au
Cameroun
La coopération institutionnelle a été
renforcée ces cinquante dernières années en raison de la
nécessité de protéger par les moyens internationaux
l'environnement221(*).
En effet, la Conférence de Rio aura été, au bout du
compte, le point de départ d'une ère institutionnelle nouvelle et
d'une nouvelle approche de la coopération multilatérale pour la
protection de l'environnement. Mais, la Déclaration de Stockholm avait
déjà jeté les fondements d'une coopération
internationale pour la protection de l'environnement, contribuant ainsi
à l'émergence du nouveau droit international en la
matière. Ainsi, la coopération internationale pour la sauvegarde
et la préservation de l'environnement devient une nécessité222(*). De fait, la scène internationale s'est vue
enrichie d'un rôle accru joué par les organisations
internationales intergouvernementales. La collaboration multilatérale
est établie avec le Système des Nations Unies (Banque Mondiale,
FAO, PNUD, PNUE. ONUDI), l'Union Européenne, les institutions
régionales (NEPAD) et sous régionales africaines (COMIFAC,
CEFDHAC, etc.). La participation de la société internationale
touche les domaines variés, mais il convient de les regrouper sous deux
volets. D'une part, la collaboration avec le système des nations unies
(A) et d'autre part la collaboration avec les institutions régionales et
sous régionales (B).
A. La coopération avec le système
des nations unies.
Il est indéniable que plusieurs ou presque tous les
organes du système des nations unies participent au renforcement des
capacités tant institutionnelles que juridiques des pays dans leur
entreprise de protection de l'environnement. Fort de cela, il convient de
préciser le contenu de cette coopération (1) avant de voir le
rôle des institutions considérées (2).
1) Contenu de la coopération des institutions de
l'ONU
La coopération avec les institutions des nations unies
est à la fois normative (a) et technique (b).
a) Une coopération normative
La société internationale participe à
l'édification d'un corpus normatif propre à la gestion durable
des ressources naturelles et forestières223(*). En effet, le Système
des Nations Unies travaille de différentes façons afin de
promouvoir le développement économique et social en combinant les
activités normatives, analytiques et opérationnelles. Il aide
à formuler des politiques et fixe des normes et standards
internationaux. Il prépare des analyses, donne un certain soutient et
conseille les gouvernements. Concrètement, à travers le PNUE qui
est la plus haute autorité en matière environnementale dans le
système des nations Unies, l'ONU soutient les gouvernements dans
l'établissement, la mise en oeuvre et le renforcement des processus
normatifs nécessaires visant à atteindre le développement
durable au niveau national, régional et international, et à
l'intégration de l'environnement dans la planification du
développement.
b) Une coopération technique
Elle se manifeste à travers les conditionnalités
environnementales224(*),
la mobilisation internationale et aussi dans les programmes et projets de
gestion durable des ressources naturelles.
A travers les conditionnalités
environnementales, les institutions internationales
sont très impliquées dans l'amélioration des cadres
juridiques locaux de gestion des ressources naturelles. Dans ce sens, la Banque
Mondiale (BM) a été à la base de la réforme de la
Loi forestière du Cameroun qui a abouti sur la loi de 1994, de
même que les partenaires au développement ont imposé le
PSFE (Programme Sectoriel Forêt Environnement) comme programme de
référence en ce qui concerne la gestion de l'environnement au
Cameroun.
En outre, la coopération avec les institutions des
nations unies se matérialise par des actions concrètes sous forme
de programme et projets de gestion des ressources naturelles et de protection
de l'environnement menées à différents niveaux dans une
perspective de développement durable.Les programmes et activités
ayant pour objet un financement multilatéral aux fins de la
coopération dans le domaine du développement durable sont
multiples. Il s'agit du :
- programme de réduction de la pauvreté contenu
dans le DSRP ;
- programme d'appui à la formulation d'une politique
NTIC (Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication) pour le
développement de plans d'actions sectoriels;
- programme de promotion de l'éducation
environnementale en matière de gestion des ressources naturelles;
- programme de suivi de la mise en oeuvre des conventions de
Rio ;
- projet de renforcement du cadre de coopération et des
capacités de gestion du développement ;
- projet pilote micro-schème d'assistance aux
organisations d'appui et aux communautés à la base (appui aux
micro-activités urbaines et rurales, y compris le VIH/SIDA, renforcement
des capacités de gestion locales et écologiquement durables du
développement, promotion d'investissements privés par les femmes
et les jeunes à travers un mécanisme de microcrédit,
à financer sur les ressources PPTE, appui à la création
des réseaux utilisant les NTIC);
- programme d'appui à l'opérationnalisation du
PNGE;
- partenariats avec le FNUAP, l'UNICEF et l'UNIFEM /
partenariat renforcé avec les ONG;
- Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole
(PNVRA) ; etc.
2) Les institutions des nations unies et leur
rôle.
L'ONU dans son ensemble ne s'est intéressée aux
problèmes environnementaux qu'à partir de 1968 ; une
recommandation de conseil économique et social (ECOSOC),
entérinée par l'Assemblée Générale,
préconisait la convocation d'une conférence mondiale pour
discuter des problèmes environnementaux. C'est ainsi qu'a
été réunie la Conférence de Stockholm en 1972. A la
suite de cette conférence, en plus des 109 points que comportaient la
Déclaration et le Plan d'Action, des résolutions
financières et institutionnelles ont été adoptées.
C'est sur la base de ces résolutions qu'ont été mises en
place les premières institutions internationales
spécialisées en la matière. Il faut noter qu'entre
Stockholm et Rio, on a assisté à l'émergence de nouvelles
institutions visant à favoriser la mise en oeuvre des instruments
juridiques de protection de l'environnement. Il s'agit des institutions
financières (a) dont les interventions aident les Etats à mettre
en oeuvre leurs plans et programmes environnementaux conçus le plus
souvent avec l'appui des institutions techniques (b).
a) Les institutions financières.
Le lien évident entre l'environnement et le
développement impose un nouveau mode de financement du
développement des pays pauvres225(*). Ainsi par l'aide que les institutions
financières apportent aux projets de développement et par leurs
contributions accordées pour la création d'industrie ou la
réalisation de grands travaux, elles exercent une certaine influence sur
la gestion de l'environnement par les pays demandeurs, notamment en veillant
à en réduire les atteintes226(*). C'est du moins ce qui a conduit ces institutions
à n'accorder leur contribution financière qu'à des projets
de développement respectant les exigences du développement
durable. On parlera alors de conditionnalité environnementale,
concept ou exigence pas toujours appréciée par les pays demandeur
de l'aide.
Ø La Banque Mondiale
La Banque Mondiale (BM) a longtemps été
critiquée du fait de sa réticence vis-à-vis des
problèmes environnementaux. Depuis les années 80, à
travers les politiques environnementales227(*) qu'elle a développées pour guider ses
prêts, elle a commencé à manifester son
intérêt pour la cause environnementale en prenant en compte
l'aspect environnement et développement durable dans les projets qu'elle
soutient.Ces politiques ont été conçues
pour veiller au respect de certaines normes de protection environnementale dans
les projets de la BM, même lorsque ces mesures de protection n'existent
pas dans la législation nationale. Malgré l'importance de ces
politiques et leurs résultats, le cadre politique de la BM reste soumis
à une pression croissante depuis la fin des années 90. C'est
ainsi que de plus en plus fréquemment, elle est désignée
en tant que gestionnaire mandatée pour certains mécanismes de
financement international des projets environnementaux228(*). Entre 2006 et 2008, la
Banque a soutenu des projets environnementaux pour une valeur de 113,5 millions
de dollars229(*),
montrant l'engagement de l'institution financière et cherchant par
là même à faire améliorer son image d'entité
productiviste insoucieuse des conséquences de ses actions sur
l'environnement230(*).
La Banque Mondiale a apporté un appui technique et
financier dans le domaine de la planification et de la mise en oeuvre des
actions de conservation et d'utilisation rationnelle de la biodiversité
au Cameroun. Elle s'est fortement impliquée dans l'étude d'impact
environnemental du pipeline Tchad/Cameroun231(*). C'est également le cas du Projet Sectoriel
Forêt Environnement (PSFE) initié en 1999 par le Gouvernement
camerounais. D'une durée de dix ans, il couvrait l'ensemble du
territoire camerounais. Son domaine d'intervention englobait le secteur
forestier et l'environnement « vert ». L'objectif visé par le
PSFE était la mise en place d'un cadre cohérent pour toutes les
interventions qui concourent à la réalisation des objectifs de la
politique forestière et faunique du pays et le renforcement des
institutions nationales pour mettre en oeuvre la politique forestière de
gestion durable des ressources sur le triple plan écologique,
économique et social232(*).
Ø Le Fond monétaire internationale
(FMI)
Le FMI est une institution ayant pour but de stabiliser le
système monétaire et de réglementer les changes et de
gérer une masse monétaire importante pour venir en aide aux Etats
par des prêts. Créé à la conférence de
Brettons Wood en 1944, cette institution ne se souciait aucunement des
questions environnementales. Mais depuis 2000, lors du sommet du
millénaire organisé par l'ONU, huit objectifs (les OMD) ont
été sélectionnés par les Etats membres à
atteindre en 2015. Parmi ces objectifs figure celui d'assurer un environnement
durable. En effet, lutter contre la pauvreté, c'est déjà
prévenir les dommages à l'environnement. A partir de 2005, le FMI
a sélectionné trois domaines touchant directement à
l'environnement : les problèmes financiers, macroéconomiques
et budgétaires posés par les changements climatiques (financement
des mesures réduisant les émissions des gaz à effet de
serre) ; l'adoption d'une fiscalité environnementale
adaptée ; et l'introduction dans les prêts du financement du
recours aux énergies renouvelles, une sorte de conditionnalité
écologique.
Ø Le Fonds pour l'Environnement Mondial
(FEM)
Le FEM est une institution spécialement chargée
de financer des projets devant aider à la mise en oeuvre des conventions
environnementales. Créé en 1990, il est devenu en 1994 le
mécanisme financier principal et permanent et contribue à
l'application des conventions internationales par le financement de leur mise
en oeuvre à travers les partenariats de développement durable. Le
FEM est destiné à participer au financement des projets
sélectionnés destinés à la protection de
l'environnement dans les domaines prioritaires comme le changement climatique,
l'appauvrissement de la couche d'ozone, la protection de la
biodiversité, ou encore la protection de l'eau.
b) Les institutions techniques.
Il s'agit essentiellement du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) et de la Commission du Développement Durable
(CDD).
Ø Le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE)
Institué par Résolution 2997 (XXVII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, du 15
décembre 1972, le PNUE s'est vu attribuer le rôle de catalyseur de
l'action d'autres institutions233(*). L'Assemblée générale se
déclarait alors consciente de la
nécessité d'élaborer d'urgence, dans
le cadre des organisations des Nations unies, des arrangements institutionnels
permanents pour la protection et l'amélioration de
l'environnement234(*).
Autrement dit, le PNUE a été chargé de
centraliser l'action de la communauté internationale en matière
d'environnement et de réaliser la coordination dans ce domaine entre les
organismes des nations unies235(*). C'est d'ailleurs la seule institution
spécialisée des Nations Unies basée en Afrique.
Compte tenu de la déficience structurelle dont souffre
le PNUE depuis sa création, la conférence de Rio a
décidé de renforcer le système institutionnel, notamment
en sollicitant le concours du PNUD236(*) afin d'assurer l'assistance opérationnelle
pour la mise en oeuvre de l'Agenda 21.
Dans le contexte camerounais, le PNUD apporte une assistance
technique et financière à la planification environnementale, au
renforcement des capacités institutionnelles, à la promotion et
au développement des systèmes d'information environnementale. Il
a appuyé le Projet de Gestion de la Biodiversité avec un
financement spécial appelé « Facilité Global
pour l'environnement » plus connu sous l'appellation anglaise
« Global EnvironmentFacility » (GEF), le Programme
Régional de Gestion de l'Information Environnementale (PRGIE)237(*). Il a apporté son
assistance au SPE pour la mise en oeuvre du PNGE. Pour l'exercice 2003 - 2007,
il a soutenu le programme « d'appui à la protection et à
la régénération de l'environnement et des ressources
naturelles pour promouvoir le développement durable » pour un
montant de 3.500.000 dollars238(*).
Dans la ville de Douala, le PNUD a financé plusieurs
projets initiés par les ONG locales. Les associations telles
ADEC239(*),
ASHABO240(*),
FANG241(*) ont
récemment bénéficié d'une subvention du PNUD, pour
la conduite de leur projet de pré-collecte et de compostage dans
certains bassins versants de la ville de Douala. Par exemple, l'ONG ADEC et son
Projet de Pré-collecte et de Valorisation des Déchets Solides en
Compost (PPVC) dans le bassin du Mbanya inférieur à Douala a
bénéficié en mai 2008 d'une subvention du PNUD à
hauteur de 4 500 000 Francs CFA.
Ø La Commission du Développement Durable
(CDD)
La CDD242(*) est chargée de suivre l'état
d'avancement de l'application des engagements figurant dans l'Agenda 21,
d'évaluer la pertinence des financements et d'analyser la contribution
des organisations non gouvernementales ONG compétentes. A ce titre, Elle
a reçu pour mission de s'assurer du suivi efficace de la mise en oeuvre
de la CNUED, d'impulser la coopération internationale, de rationaliser
les capacités intergouvernementales en matière de prise de
décision et d'évaluer l'état d'avancement de l'application
de l'Action 21243(*).
Dans l'exercice de ses missions, la CDD examine les
informations obtenues de la part des gouvernements sous forme de communication
périodique ou de rapports nationaux concernant les activités
qu'ils entreprennent pour l'application de l'Agenda 21. Le relais national de
la CDD au Cameroun est la CNCEDD.
La prise de conscience des préoccupations
environnementales par les institutions d'aide et d'assistance au
développement se révèle bien manifeste au l'aune de la
mondialisation. S'il est vrai que les institutions à vocations
universelles font de l'environnement une question des plus essentielles, il
n'en demeure pas moins vrai qu'au niveau régional notamment en Afrique,
cette valeur reste partagée, ainsi qu'en témoigne la place qui
lui réservée au niveau institutionnel.
B. Les institutions africaines de protection de
l'environnement.
Plusieurs institutions africaines ont compétence en
matière environnementale. Tandis que les unes étendent leur
compétence sur l'ensemble du continent, d'autres se limitent à
une sphère sous régionale. On distinguera donc d'une part les
institutions régionales (1) et d'autre part les institutions sous
régionale (2).
1. Les institutions régionales de protection de
l'environnement en Afrique
Parmi les organisations régionales qui déploient
les activités dans le domaine de l'environnement, celles qui regroupent
les Etats africains jouent un rôle éminent, car c'est en Afrique
que l'on rencontre le plus les transgressions de l'environnement. A priori, ces
institutions jouent un rôle particulièrement actif dans le domaine
de la protection de l'environnement. On mentionnera l'Union Africaine (UA) et
le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).
a) L'Union Africaine
L'Afrique est l'un des premiers continents à prendre
conscience de la nécessité de protéger l'environnement.
L'Organisation pour l'Unité Africaine (OUA), créée en 1963
à Addis-Abeba, a progressivement défini une politique commune
pour les Etats africains en matière d'environnement à travers une
succession de Déclaration et de Plans d'Action244(*). D'ailleurs, c'est elle qui
a servi de cadre d'élaboration de la Convention africaine sur la
conservation de nature et de ressources naturelles, adoptée à
Alger le 15 septembre 1968. La Convention d'Alger est la première
convention internationale intégrant tous les aspects de la protection
internationale de l'environnement245(*). Bien plus, la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, adoptée en Nairobi en juin 1981, était la
première convention à reconnaitre à « tous
les peuples » le « droit à un environnement
satisfaisant et global, et propice à leur
développement »246(*). En outre, en réplique à la
Convention de Bâle de 1968 sur les mouvements transfrontières des
déchets dangereux, l'OUA a élaboré la Convention de Bamako
du 30 janvier 1991 interdisant d'importer en Afrique des déchets
dangereux et prévoyant le contrôle des mouvements
transfrontières247(*).
Dans le but de renforcer la capacité institutionnelle
à la mise en oeuvre de ces différents instruments juridiques de
protection internationale de l'environnement, il a été
signé à Lomé le 11 juillet 2000 l'Acte constitutif de
l'Union Africaine qui renforce la coopération entre les parties.
L'héritière de l'OUA intègre expressément dans les
attributions du conseil exécutif la protection de
l'environnement248(*).
Elle se dote d'un comité technique chargé des ressources
naturelles et de l'environnement249(*). Ainsi, par le message « pas
d'environnement sans développement », on comprend bien
que la position politique des Etats africains n'a pas changé depuis Rio.
Toujours dans sa quête d'efficacité, la nouvelle organisation
africaine va procéder à la révision de la Convention
d'Alger. C'est ainsi que trois ans seulement après sa création,
elle adopte la Convention africaine sur les ressources naturelles,
l'environnement et le développement à Maputo le 11 juillet
2003.
b) Le Groupe de la BAD
La BAD, créée à Khartoum le 4 Aout 1963,
le Fonds africain de développement (FAD), instituée à la
conférence annuelle de la BAD tenue à Lusaka en juillet 1973, et
le Fonds spécial pour le Nigéria créé en
février 1976 forment ce qu'il est convenu d'appeler le Groupe de la BAD.
L'Agenda 21, en son chapitre 33 reconnait un rôle aux
banques de développement régional et sous régional dans le
financement du développement durable. Ainsi,
Les banques et fonds de développement
régionaux et sous régionaux devraient jouer un rôle plus
important et plus efficace pour ce qui est de l'octroi, à titre
concessionnaire ou à d'autres condition de faveur, des ressources
nécessaires à l'exécution de l'Agenda 21250(*).
Si ce rôle des organismes financiers n'est reconnu, ou
tout au moins consigné dans un instrument juridique international, que
tout récemment, force est de constater que le Groupe de la BAD
manifestait déjà une réelle prise de conscience
environnementale depuis 1985. En 1987, il est créé en sons sein
une Division de l'environnement et de la politique sociale dont le
rôle est de coordonner tout le travail technique et les procédures
relatives à l'environnement dans les programmes de la banque ;
d'élaborer des directives et procédures pour l'évaluation
environnementale et les études d'impact des projets qui
bénéficient de son financement ; de donner des conseils
techniques au département par pays, à l'équipe
chargée de l'étude des programmes de membres de la région
sur les questions environnementales ; d'élaborer des programmes de
formation et d'accroitre l'expertise et matière d'étude des
projets sur ces questions.
De façon générale, la BAD se dit
disposée à fournir l'assistance technique et financière
nécessaire à tous les projets qui assurent la promotion d'un
développement respectueux de l'environnement.
2. La coopération sous
régionale en matière de protection de l'environnement en
Afrique
L'Afrique Centrale est caractérisée par une
diversité institutionnelle dans la gestion de l'environnement et des
ressources naturelles. L'existence de plusieurs institutions sous
régionales spécialisées dans le domaine, est perçue
comme un atout, en ce sens qu'elle permet de couvrir tous les aspects que
revêtent la préservation de l'environnement et la gestion durable
des ressources naturelles. Ainsi, existent entre autres, la Conférence
sur les Ecosystèmes Forestiers Denses et Humides d'Afrique Centrale
(CEFDHAC),l'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en Afrique
(OCFSA), l'Association pour le Développement de l'Information
Environnementale (ADIE), le Réseau des aires protégées
d'Afrique centrale (RAPAC), la Commission des Forêts d'Afrique Centrale
(COMIFAC), etc. Chacune de ces institutions étant
spécialisée sur des thématiques pertinentes pour la
région, elles ont toutes un rôle majeur à jouer dans la
préservation et la gestion durable des écosystèmes
naturels.
La COMIFAC est une initiative des Chefs d'Etat d'Afrique
Centrale visant l'harmonisation et la coordination des politiques et
stratégies sous régionales en matière de conservation et
de gestion durable des écosystèmes forestiers. Elle a mis en
place un plan de convergence et travaille de ce fait en collaboration avec
toutes les initiatives sous régionales telles que l'OCFSA, l'ADIE, le
RAPAC, la CEFDHAC, etc.
Le Plan de convergence de la COMIFAC est un
dénominateur commun sur lequel les différents Etats de la
sous-région conviennent pour engager des actions nationales et sous
régionales en faveur de la gestion durable des écosystèmes
forestiers. L'adoption dudit plan par les Chefs d'Etat au cours de leur
deuxième Sommet en février 2005 à Brazzaville, traduit la
ferme volonté politique de la sous-région à mettre en
oeuvre les actions communes et concertées. Ce plan de convergence est
d'autant plus important qu'il constitue pour la Communauté Economique
des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) la partie forestière de son plan
d'action de l'initiative environnementale du NEPAD, qui du reste, englobe
d'autres aspects tels que la lutte contre la dégradation des
terres251(*). Par
ailleurs, d'autres organisations ont également amorcé une
dynamique similaire sur des aspects tout aussi importants : c'est le cas
du Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC)
qui vise la promotion et la valorisation des aires protégées.
Face à toutes ces institutions, la CEEAC joue un
rôle de coordination et d'harmonisation des actions de chacune, au sein
de la région, de façon à garantir une cohérence
d'action aussi bien institutionnelle qu'opérationnelle sur le terrain,
et cela, en collaboration avec la CEMAC. Ce rôle se traduit par un
contrôle de cohérence, de légalité, de pertinence
des actions proposées et un suivi financier des ressources
affectées par les bailleurs de fonds au bénéfice de la
gestion de l'environnement et des ressources naturelles de l'Afrique
Centrale.
La CEEAC est ainsi vue par les partenaires extérieurs
comme l'institution fédératrice des actions environnementales et
de gestion des ressources naturelles. Elle a pour objectif politique global de
définir un cadre général de coopération en
matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles entre
les Etats membres de la communauté. Il s'agit de façon
spécifique, par le canal du Secrétariat
Général :
Ø d'harmoniser les politiques et stratégies de
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles au niveau de la
sous-région Afrique Centrale ;
Ø de favoriser la coopération avec les
organisations régionales et internationales sur l'environnement de la
sous-région Afrique Centrale, d'autres régions de l'Afrique
telles que l'Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Sud, et d'autres
sous-régions du monde, ainsi que les institutions du Système des
Nations Unies oeuvrant dans le même domaine ;
Ø de développer les capacités humaines et
institutionnelles des pays concernés pour la gestion de l'environnement
et des ressources naturelles avec l'établissement d'un centre ou
laboratoire d'excellence régional en matière
d'environnement ;
Ø d'adopter une approche concertée et
convergente des thèmes environnementaux majeurs dans la
sous-région, notamment : le cadre juridique et institutionnel, la
gestion des ressources naturelles, la gestion de l'environnement urbain et
industriel, la gestion des questions d'énergie et de transport, la
gestion des pollutions et nuisances, des déchets, des impacts
liés à l'exploitation des ressources minières, des risques
et catastrophes naturels, la gestion des conséquences et des impacts des
changements climatiques, etc. ;
Ø de suivre la mise en oeuvre des conventions
internationales.
Paragraphe 2. La coopération
bilatérale dans le cadre de la protection de l'environnement au
Cameroun
La coopération bilatérale en matière
d'environnement se réalise à travers les agences de
coopération qui forment la communauté des donateurs du secteur de
l'environnement252(*).
En effet, les agences de coopération apportent une assistance technique,
matérielle et financière pour l'élaboration, la mise en
oeuvre et le suivi des politiques et stratégies de gestion de
l'environnement253(*).
Outre ces agences de coopération (A) dont le rôle d'assistance
n'est pas de moindre dans la gestion de l'environnement au Cameroun, on
perçoit peu à peu l'émergence de la coopération
entre collectivités décentralisées et partenaires
internationaux (B).
A. Les agences de coopération en
matière d'environnement au Cameroun
Plusieurs partenaires254(*), assistent le Cameroun, à travers leurs
agences respectives, dans la conduite des programmes environnementaux.
Ainsi ;
Ø L'Agence Française de Développement
(AFD) appui techniquement les projets relevant de développement urbain
et des ressources naturelles. En effet, la coopération française
a mis en place un dispositif qui repose sur une approche intégrée
de la gestion de l'environnement avec les administrations, les populations et
les opérateurs économiques. Elle apporte un appui institutionnel
au ministère de l'environnement en matière d'élaboration
et de suivi des politiques environnementales. L'AFD a mis en place un fonds
pour aider les concessionnaires des forêts dans le processus de gestion
durable. Elle finance d'ailleurs les plans d'aménagement forestier de
certains exploitants français255(*). Dans le domaine de l'environnement urbain, compte
tenu de la complexité et de la croissance des problèmes
rencontrés, la France limite ses interventions à la fourniture
d'un conseiller technique auprès des Communautés Urbaines de
Yaoundé et Douala256(*).
Ø La GesellschaftTechnischeZusammenarbeit
(GTZ)257(*) focalise
son assistance sur l'éducation environnementale et de gestion des
ressources naturelles. Rappelons cependant que, comme partenaire
privilégié du Ministère de l'environnement camerounais,
elle l'assiste dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi des
politiques environnementales258(*). Il s'est fortement impliqué dans le suivi
de la table ronde sur la mobilisation des bailleurs de fonds dans le cadre de
la mise en oeuvre du PNGE par le SPE259(*). C'est d'ailleurs avec son concours que le GEF a
été réalisé avec les projets tels: le
PROFORNAT260(*), le
projet de cogestion des ressources naturelle du bassin du Congo, le projet
Korup, le projet « Conseiller GTZ auprès du MINEF »
etc. La coopération allemande contribue par ailleurs au renforcement des
capacités des acteurs de la société civile (associations
paysannes, ONG, etc...).
Ø L'Agence Canadienne de Coopération
Internationale (ACDI) est un partenaire qui appuie les mesures de planification
et de gestion durable des ressources naturelles à travers l'assistance
technique et financière aux projets de renforcement des
capacités261(*).
Elle a par exemple soutenu le projet d'Appui à la Protection de
l'Environnement au Cameroun, le Projet de gestion durable des forêts
Camerounaises262(*).
Ø La United State Agency for International
Development (USAID)263(*) pour sa part soutient les initiatives nationales de
renforcement des capacités techniques, institutionnelles et
financières en matière de gestion durable de l'environnement. Au
Cameroun, les initiatives mises en oeuvre dans ce cadre sont par exemple le
Programme Régional de l'Afrique Centrale pour l'Environnement qui vise
à réduire la déforestation et la perte de la
diversité dans le bassin du Congo.
Ø L'Union Européenne (UE) quant à elle
apporte un appui à la fois technique et financier à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de gestion
rationnelle et durable des ressources naturelles264(*). Son appui dans le secteur
de l'environnement au Cameroun depuis le début de la décennie
2000 s'estime à plusieurs millions d'euros dans le cadre de projets sous
différentes formes de financement ou d'une approche programme sous forme
d'appuis budgétaires et d'appuis institutionnels au
Gouvernement265(*).
Les financements ont porté sur les thèmes
suivants (et principaux projets concernés) :
- Conservation de la biodiversité et gestion des aires
protégées (Conservation du Parc National de Korup ; Programme
ECOFAC, appui au développement de l'écotourisme au Parc National
de BoubaNdjidah) ;
- Aménagement et gestion durable des forêts
(Projet Restauration et Conservation des Forêts dans le
département du Noun, Projet Réseau de partenariat) ;
- Développement local en zone forestière et
foresterie communautaire (Mesures d'accompagnement autour de la Réserve
du Dja ; Projet de mise en place des Forêts communautaires en
périphérie nord de la Réserve de Faune du Dja ;
- Education environnementale (Projet d'Education
Environnementale dans 5 Régions pilotes) ;
- Gestion de l'information environnementale (PRGIE) ;
- Etablissement d'un système de suivi des
éléphants (Projet MIKE) ;
- Diffusion de techniques d'élevage de la faune sauvage
comme alternative au braconnage (DABAC) ;
- Renforcement des capacités et appui institutionnel
(Appui à la mise en place de la fonction financière et
administrative et assistance technique à l'ex MINEF ; renforcement des
capacités du SPE ;
- Volets environnementaux des projets routiers (Appui
institutionnel à l'ex MINEF dans les Régions du Nord et de
l'Adamaoua pour la lutte anti-braconnage, l'installation et le suivi de
corridors écologiques, la sensibilisation, dans le cadre de la
construction de la route Ngaoundéré-Touboro-Moundou) ;
- Recherche en gestion des forêts et ressources
naturelles (Tropenbos, APFT, GPAC) ;
- Urbanisation (projet PACDDU).
La coopération entre le Cameroun et l'Union
Européenne dans le domaine de l'environnement s'est également
concrétisée par la création d'une Cellule Environnement et
Forêts rattachée à l'Ordonnateur National du Fonds
Européen pour le Développement (FED) chargée de l'appui
à l'identification, à la planification et à
l'élaboration des stratégies, au suivi de la politique
sectorielle et au suivi technique, administratif et financier des programmes et
projets financés par l'UE266(*).
Parvenus à ce niveau de l'analyse, force est de
constater que le Cameroun, conformément aux exigences de Rio,
intègre valablement la coopération internationale dans sa
politique nationale de gestion de l'environnement. Ladite coopération
est d'autant plus dynamique que son exercice s'étend aux
collectivités locales. En effet, la coopération
décentralisée telle qu'envisagé dans le contexte
camerounais résulte d'une convention par laquelle deux ou plusieurs
communes décident de mettre en commun leurs moyens en vue de
réaliser des objectifs communs267(*). Elle peut s'opérer entre des communes
camerounaises ou entre celles-ci et des communes étrangères, dans
les conditions fixées par la législation et la
réglementation en vigueur268(*). Nous considérerons ici la coopération
avec les communes étrangères.
B. La coopération
décentralisée dans le cadre de la protection de l'environnement
au Cameroun
Depuis plus de trois dernières décennies,
l'action publique internationale n'est plus l'exclusivité des Etats. De
nouveaux acteurs tels que les ONG, les associations professionnelles et surtout
les collectivités locales, jouent un rôle de plus en plus
important dans la coopération au développement. Le concept de
coopération décentralisée désigne ce
nouveau processus. Il se présente comme l'un des instruments les plus
appropriés pour dynamiser les initiatives de développement ;
il est un outil d'appui au développement local. La
référence à la décentralisation peut de ce fait
induire implicitement une reconnaissance de la coopération
décentralisée comme moyens d'actions des CTD à la mise en
oeuvre des stratégies269(*) de gestion rationnelle de l'environnement.
En effet, le concept de coopération
décentralisée est fort ancien dans sa signification.
Cécile CHOMBARD-GAUDI270(*) nous rapporte que longtemps avant que les
autorités politiques ne définissent les actions des communes
orientées vers l'extérieur271(*) en les qualifiant de coopération
décentralisée, celles-ci étaient engagées dans
plusieurs conventions de jumelage et divers types d'accord de
coopération avec des communes extérieures. Mais le concept
d'action extérieure n'a pas été retenu par le
législateur camerounais qui, lui, a préféré celui
de « coopération
décentralisée » pour désigner les actions
que les collectivités locales mènent à l'extérieur
des frontières nationales272(*). Cette coopération, introduite depuis 1990
dans l'administration camerounaise par la Convention-cadre relative à la
coopération franco-camerounaise est juridiquement encadrée par la
loi d'orientation de la décentralisation273(*). Ses modalités sont
fixées par un décret de 2011274(*). De ces textes, il ressort que la coopération
décentralisée s'applique strictement entre des acteurs de statut
infra étatique de droit public, ayant bénéficié de
transfert de pouvoirs de la part de l'Etat central275(*). Ainsi, la
coopération décentralisée se présente comme
« l'expression de l'affirmation d'une identité et d'une
personnalité locales distinctes de l'Etat, au-delà des
frontières nationales»276(*).
Dans le domaine de la protection de l'environnement, la
coopération décentralisée dénote cette nouvelle
forme de relation que les pays du sud entretiennent désormais avec ceux
du nord, ou encore entre eux277(*). La coopération internationale des
collectivités locales camerounaise s'intensifie. Mais la
coopération décentralisée entre la France et le Cameroun
reste la plus importante à l'heure actuelle278(*).
En effet, dès la fin des années 1960, le
Cameroun fut à l'initiative de l'introduction de comités
« coopération décentralisée » dans les
commissions mixtes entre la France et ses pays partenaires. Relativement
limité, la coopération décentralisée
franco-camerounaise a connu un nouvel essor suite au Sommet
Africités organisé à Yaoundé en 2003. A ce
jour, plus d'une trentaine de projets actifs sont recensés entre les
collectivités locales françaises et camerounaises pour un montant
de plus de 15 milliards de Francs CFA.
Quelques partenariats actifs :
- Coopération Communauté urbaine de Nantes /
Ministère de la Ville du Cameroun.
- Coopération commune d'Eybens
- Coopération de la région d'Alsace avec la
CUD
- La France intervient auprès des communautés
urbaines de Douala et Yaoundé dans le cadre du PADUDY (Programme d'Appui
au Développement Urbain des villes de Douala et Yaoundé.
- Dans l'appui au service de la voirie, on a la ville de
Mulhouse et la ville de Douala.
En dehors de la France, les collectivités locales
camerounaises coopères avec celles d'autres pays telles le Canada, les
Etats Unis, l'Italie, le Burkina Faso, le Gabon, etc.
Notre prétention ici n'est point de s'étendre
sur tous les contours de la coopération décentralisée au
Cameroun, notamment les actions de coopérations engagées par la
CUD. Nous y reviendrons dans les prochains développements notamment
dans la deuxième partie de ce travail.
Au demeurant, pour une meilleure protection de
l'environnement, le Cameroun au lendemain de la Conférence de Rio de
1992 s'est doté d'institutions spécifiques à la protection
de l'environnement et dont les compétences se sont
précisées au fur et à mesure. Bien plus, avec la
décentralisation perçue à notre ère comme nouvelle
et meilleure forme de gouvernance, l'essentiel des compétences en
matière environnemental ont été transférées
aux collectivités locales. Celles-ci sont aujourd'hui reconnues comme
des nouveaux acteurs de la scène internationale à travers cette
nouvelle forme de partenariat que l'on appelle la coopération
décentralisée pour le développement ou encore le
jumelage-coopération. Par la coopération
décentralisée, les collectivités locales des pays du nord
et du sud d'une part et celles des pays du sud entre eux s'échangent des
expériences afin de promouvoir le développement local dans leurs
pays respectifs. L'on ne doit pas perdre de vue qu'à un moment
donné de cette collaboration, les bailleurs de fonds interviennent
directement dans les collectivités locales pour fournir leur assistance
technique et financière ; ce qui permet de pallier la lourde
bureaucratie administrative.
CONCLUSION PARTIELLE
Il est indéniable au terme de cette première
analyse que le Cameroun a, depuis les années 90 opté une
meilleure prise en compte des préoccupations environnementales. En
témoigne le cadre légal et institutionnel dédié
à l'environnement.
En effet, le Cameroun a pris part à de nombreux fora
internationaux sur l'environnement dont les plus importantes sont les
Conférences de Stockholm en 1972 Rio en 1992. Bien plus, le Cameroun
est partie à la plupart des Conventions internationales sur
l'environnement. Au niveau interne, il a prit des dispositions
législatives et réglementaires pour assurer la
préservation de son environnement. Si la Loi Constitutionnelle du 18
Janvier 1996 énumère en son Préambule quelques principes
fondamentaux relatifs à l'environnement, c'est la Loi-Cadre du 04 Aout
1996 qui précise le cadre générale de protection de
l'environnement au Cameroun. Cette loi est complétée par les
différentes lois sectorielles, notamment la loi sur l'eau, les
forêts, la faune, les mines etc...
En outre, la dynamique internationale commande que des
institutions tant nationales internationales soient mises en place pour rendre
opérationnelle les efforts de protection de l'environnement. Au niveau
national, on assiste à la spécialisation de du domaine de
l'environnement à travers la mise sur pieds d'un Ministère
spécifique (le MINEPDED) accompagné par des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux. Au niveau international par ailleurs,
le Cameroun est rentré dans une ambiance de coopération pour
promouvoir et protéger son environnement. En effet, la mise en oeuvre du
droit international de l'environnement nécessite une coopération
entre les différents acteurs institutionnels, compte tenu de la
complexité même de cette mise en oeuvre que les Etats doivent
assurer au plan national.La coopération internationale est alors
essentielle, étant donné que les problèmes
environnementaux ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Les
mesures d'envergure mondiale jouent un rôle crucial pour fixer des
objectifs, lever des fonds et faciliter le partage des bonnes pratiques. Ainsi,
l'encadrement institutionnel de la protection de l'environnement permet de
« faciliter l'intégration de l'environnement et du
développement au niveau tant de l'élaboration et de la
planification de la gestion que de la mise en place d'un cadre juridique
approprié ».Les institutions ici
considérées sont à la fois universelles, et
régionales ou sous régionales.
Toutefois, la protection de l'environnement ne saurait
être efficace si elle se limitait au niveau national et international.
L'action locale doit être grandement considérée pour
permettre une implémentation efficace des stratégies prises au
niveau national et international. Ce qui donne sens à cette
formule : « Penser global, agir local »279(*). Certains auteurs parlent
aujourd'hui de glocalisation. La CUD est l'institution locale à
laquelle nous avons fait appel pour justifier cette action locale.
Partie II
LES STRATEGIES OPERATIONNELLES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LA VILLE DE DOUALA
Pour l'Afrique en général et le Cameroun en
particulier, les populations se trouvent au coeur de ses objectifs de
développement. Ainsi l'amélioration du bien-être humain et
la promotion de la prospérité constituent les principales
motivations de la politique et de l'action environnementales. Ainsi donc, la
corrélation entre les changements des sociétés humaines et
ceux de l'environnement s'avère étroite ; les changements de
l'une s'accompagnant des retombées de l'autre. Voilà donc
pourquoi les solutions politiques doivent tenir compte du fait que
Environnement et développement ne sont plus deux
défis distincts mais bien liés inexorablement. Le
développement ne peut être maintenu sur une base de ressources
environnementales qui se détériorent ; l'environnement ne peut
pas être protégé si la croissance ne tient pas compte des
coûts de la destruction environnementale280(*).
L'action politique se trouve donc confrontée à
ce nouveau défi du Droit international de l'environnement : la
nécessité de concilier l'environnement et le développement
économique et social281(*).Dans ce contexte, la question de
développement urbain durable est devenue primordiale pour la
municipalité, ce d'autant plus que la récurrence des
évènements dommageables a montré la fragilité du
système urbain. La Communauté Urbaine de Douala est le point
focal de la mise en place des stratégies visant l'intégration des
préoccupations environnementales et de développement durable dans
les axes stratégiques de développement urbain à
l'échelle local.
En effet, une analyse de ces stratégies permet
d'apprécier et de mettre en évidence les politiques locales de
protection de l'environnement de la ville de Douala (chapitre 1). L'enjeux de
l'analyse de ces politiques nous permettra de mettre au goût du jour les
facteurs potentiels de réussite ou d'échec des stratégies
mises en oeuvre, de déceler les insuffisances et de proposer des
améliorations (chapitre 2) pour une meilleure stratégie de
gestion de l'environnement au niveau local.
Chapitre 3
Les Politiques locales de protection de
l'environnement
S'il est vrai que les collectivités locales
camerounaises occupent une place de choix dans les affaires locales, l'on peut
relever qu'elles disposent d'énormes attributions législatives en
matière environnementale. De ce fait, si le législateur met
à leur actif des attributions en matière d'environnement, eu
égard à leur proximité avec les populations et à
leur place dans le développement local, il n'est pas aisé de
trouver dans les différentes législations sur la
décentralisation et la protection de l'environnement des dispositions
relatives aux différentes politiques environnementales
élaborées et mises en oeuvre dans les différentes
collectivités. A côté de la politique nationale de
protection de l'environnement, laquelle ne définit que les grands axes
en la matière, chaque collectivité développe des
stratégies qui lui sont propres afin d'atteindre les objectifs
fixés. Quelles sont donc ces stratégies de gestion de
l'environnement opérationnelles à Douala? La
Communauté Urbaine de Douala, compte de ténu de la densité
de sa population, de la qualité des entreprises qu'elle regorge (la
ville de Douala est une ville industrielle) et du niveau de dégradation
de l'environnement qui y est constaté, a élaboré un
certain de nombre de mesures282(*) tendant à améliorer la qualité
de l'environnement dans la Ville de Douala283(*). On comprend donc que c'est à bon droit que
la CUD s'est engagée à prendre des mesures hardies pour
réduire les atteintes à l'environnement naturel en mobilisant des
moyens adéquats. Cette politique concrétise une nouvelle vision
qui se veut pragmatique et incitative. L'engagement de la ville de Douala dans
les voies du développement durable (section 1), et l'approche
participative de protection de l'environnement (section 2) dans cette ville
pourront faire d'elle une véritable éco-ville.
SECTION I. L'ENGAGEMENT DE LA VILLE DE DOUALA
DANS UNE DEMARCHE DU DEVELOPPEMENT DURABLE284(*)
Les stratégies de réduction des atteintes
à l'environnement ou de réduction des risques environnementaux ne
sont pas une préoccupation récente dans la ville de Douala.
Elles revêtent un intérêt particulier pour les
autorités depuis près de trois décennies. Cet
intérêt s'est manifesté par la création au
début des années 80 du Service Technique Municipal ayant pour
mission de réduire la vulnérabilité aux inondations
à travers le curage des lits intérieurs des principaux cours
d'eau et la réhabilitation des caniveaux. Durant la période
1984-1987, les activités du Service Technique Municipal avec le
programme baptisé « Crash Programme » se sont
intensifiées avant de connaître un relâchement vers 1988
pour être relancées en 2000 sous la dénomination «
Programme de curage des drains » suite à la vague
d'inondations qui a frappé la ville. Ce programme a consisté non
seulement au curage, mais aussi en la démolition de tous les ouvrages et
habitations à même d'empêcher l'écoulement des eaux
pluviales et à la suppression de certains méandres afin
d'accroître la vitesse d'écoulement de ces eaux. En 2004, des
travaux de curage de drains ont été opérés dans les
arrondissements de Douala II et III par les Communes Urbaines d'Arrondissement
de Douala (CUAD) respectives, en collaboration avec la CUD dans le cadre du
« Pluie Project ». Ces travaux s'inscrivaient dans le sens
du déguerpissement des abords des cours d'eau, le débouchement
des dalots, des ouvrages de franchissement, le profilage (élargissement)
des chenaux d'écoulement et le raccordement de certains canaux en un
réseau pour l'évacuation efficace des eaux.
Par ailleurs, l'on observe que l'environnement de Douala se
dégrade de plus en plus du fait de la pollution ambiante et des
mauvaises pratiques du quotidien. «Douala étant la
première ville industrielle du Cameroun, l'impact des industries sur
l'environnement et sur la société est très
considérable. Les zones industrielles sont investies par les zones
d'habitat. Dans la zone industrielle de Bonabéri, la situation est
alarmante. Parce qu'il y a une densification des habitats dans cette zone
industrielle», explique Magloire OLINGA OLINGA, géographe
environnementaliste. Plusieurs autres raisons pourraient expliquer cette
aggravation de la pollution à Douala : le fait des eaux
usées et la démographie galopante qui entraine des drains
bouchés.Par conséquent, il y a des répercussions sur
l'environnement et même sur la santé. Notre observateur explique
une fois de plus que d'un point de vue des risques naturels, on a les
phénomènes d'inondations, des mouvements de masse,
l'érosion des sols qui sont liés à des
caractéristiques physiques de la ville, également à la
pression anthropique sur le milieu. Du point de vue de la biodiversité,
on se rend compte que la mangrove qui constitue une barrière naturelle
pour la ville de Douala est forcément détruite pour des besoins
humains285(*).
Ces dommages environnementaux que connait la ville de Douala
peuvent être atténués. Ainsi, des stratégies de
réduction desdits dommages en tant que mode de réponse aux
atteintes dont adoptées au niveau de la CUD. Pour donc s'en convaincre,
l'on remarque que la ville de Douala intègre de plus en plus les
préoccupations environnementales dans ses politiques de
développement (paragraphe 1). Bien plus, elle recourt de plus en plus
à la coopération décentralisée286(*) (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'intégration des
préoccupations environnementales dans la politique de
développement de la ville de Douala.
L'une des fonctions principales des collectivités
locales, outre les missions classiques comme l'état civil, est la
promotion du développement économique et social local287(*). Les collectivités
locales se sont vues confier d'énormes responsabilités dans ces
domaines. Si nous nous référons à la CNUED, qui a pour la
première fois placé les questions écologiques au centre
des débats d'un forum international et mondial, l'une de ses
recommandations importantes se retrouve dans le Principe 13 de la
Déclaration de Stockholm. Ce principe propose que, pour parvenir
à une gestion plus rationnelle des ressources et donc à
améliorer l'environnement, les États adoptent une approche
intégrée et coordonnée de leur planification du
développement. Les États doivent donc s'assurer que le
développement est compatible avec la nécessité de
protéger et d'améliorer l'environnement pour le
bénéfice de leur population. La Déclaration de Rio de
1992, dans son Principe 4, viendra réaffirmer cette conviction et cette
volonté internationale pour un développement tenant compte des
exigences environnementales.
Toutefois, les grandes déclarations d'intentions
faites au niveau mondial par la grande majorité des États, n'ont
pas pu efficacement gommer ou tout du moins freiner les mouvements ascendants
de dégradation de l'environnement et d'augmentation des écarts de
richesse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire et urgent d'agir au
niveau local, car bien des actions au niveau le plus proche du citoyen ont un
impact à plus ou moins long terme au niveau mondial. Voilà donc
pourquoi la ville de Douala, dans sa démarche pour le
développement durable (A) s'est inscrite dans une logique qui
intègre les préoccupations environnementales dans sa politique de
développement (B).
A. La démarche de la ville de Douala dans
les voix du développement durable
La ville de Douala est à plus d'un titre un espace
d'enjeux majeurs, du fait de son histoire, de son poids démographique
important estimé à près de 11% de la population du pays.
Capitale économique, la ville contribue à au moins 40 % de la
valeur ajoutée du secteur moderne non agricole du Cameroun. Par
ailleurs, la surenchère et la faiblesse relative de l'offre formelle en
parcelles destinées à l'habitat social, le chômage et la
pauvreté contribuent largement au développement de l'habitat
spontané, insalubre et des bidonvilles ; facteurs favorables
à la dégradation de l'environnement. Il n'est donc pas anodin que
les enjeux liés à la préservation de l'environnement et au
développement durable soient au coeur des préoccupations
planétaires depuis plus de deux décennies. Ainsi, afin de
s'arrimer à la donne internationale qui recommande l'élaboration
d'un Agenda 21 au niveau local, une structure de coordination du Plan d'action
y afférant a été mise en place (1). Cette structure
était composée de toutes les couches sociales concernées
dont la participation dans le processus d'élaboration de l'Agenda 21 de
la ville de Douala a été plus que remarquable (2).
1) La mise en place d'une structure de coordination et
du plan d'action
L'engagement de la ville dans les politiques visant un
développement urbain durable apparaît tel un impératif
préalable à l'entame et/ou la poursuite de la collaboration et
des négociations avec les partenaires internationaux pour l'octroi des
crédits de développement. C'est dans ce contexte que la
Communauté Urbaine de Douala, appuyée par le Gouvernement
Camerounais s'est engagée à conforter le développement de
la ville, dans le cadre d'une Stratégie de développement,
élaborée de manière participative, en impliquant notamment
dans chacune des phases de son élaboration les différents acteurs
urbains : Elus locaux (Maires des Communautés d'arrondissement),
administrations (Délégations régionales des
Ministères), Chambre de commerce, d'Industrie, des Mines et de
l'artisanat, ainsi que les acteurs du Groupement Inter patronal du Cameroun
(GICAM), représentant le secteur privé, les représentants
du Port Autonome de Douala (PAD), les représentants de la
société civile (ONG et associations), ainsi que les
médias. Cette Stratégie de Développement est
élaborée dans une perspective de gestion participative des
activités opérationnelles.
La stratégie ainsi définie marque une
volonté de planifier de manière participative et inclusive le
développement de la ville de Douala tout en intégrant les
préoccupations relatives à l'environnement et au
développement durable. Cette volonté s'est
matérialisée par la création de structures et de postes de
responsabilité spécifiques pour la mise sur pied d'un Plan
d'Action, notamment en Février 2005 de l'Atelier d'Urbanisme de Douala
(AUD) rattaché à la Direction de l'Urbanisme et de la
Construction, puis en Mai 2007 par la création de la Direction de
l'Atelier d'Urbanisme de Douala et enfin en Mai 2008 par la création de
la Direction des Études, de la Planification Urbaine et du
Développement Durable (DEPUDD).
L'Agenda 21 local de la ville de Douala288(*) constitue le volet
environnemental et social de la Stratégie de Développement de la
ville(CDS) de Douala et son aire métropolitaine à l'horizon
2025. Le CDS (City DevelopmentStrategy) constitue également un
ensemble de recommandation pour la mise en oeuvre de Plan d'Occupation du Sol
(POS), du Plan de Déplacement et de Transport Urbain (PDU) et
interviendra en complément au plan directeur d'urbanisme en cours
d'élaboration. Il s'agit d'une démarche multidimensionnelle
à une seule approche qui s'opère essentiellement par
anticipation/prévention à travers la mise en place d'une veille
prospective construite autour de projets divers, ainsi que l'action
immédiate.
Dans le cadre de ses missions, le Comité de pilotage
dispose d'une Cellule Technique qui a pour mission de définir, de suivre
et/ou de réaliser les études relatives à
l'élaboration de l'agenda 21, conformément aux axes
stratégiques adoptés par le Comité de pilotage. Ce
Comité est constitué d'un représentant de toutes les
Directions de la Communauté Urbaine, d'un expert de l'Université
de Douala et un représentant des Délégations
régionales du développement urbain et de l'habitat (MINDUH), de
la santé publique (MINSANTE), de l'environnement de la protection de la
nature et du développement durable (MINEPDED), des affaires sociales
(MINAS), de l'énergie et de l'eau, (MINEE), du transport (MINT), et
enfin de l'industrie, des mines et du développement technologique
(MINMIDT). Cette structure est assez agile, il existe une bonne
transversalité telle que tout responsable ou expert de toutes les
Directions de la Communauté Urbaine représenté dans le
Comité peut être sollicité en raison de ses
compétences dans le cadre de la réalisation de l'Agenda 21. Bien
mené, ceci pourrait constituer un facteur de réussite dans
l'élaboration dudit Agenda.
Mais il est regrettable de remarquer que les Maires des CUA,
élus locaux garants de l'amélioration du cadre de vie des
populations et supposés disposer d'une connaissance pragmatique des
réalités locales sont totalement exclus du Comité de
pilotage et ne sont que des simples membres de la Cellule technique, sans
réel pouvoir décisionnel. Ce constat nous conduit droit à
l'évaluation du degré de démocratie participative dans la
mise en place et le déploiement du plan d'action relatif à
l'élaboration de l'Agenda 21.
2) Evaluation du degré de participation des
différents acteurs dans l'élaboration de l'Agenda 21
Le Comité de Pilotage appréhende l'Agenda 21
local comme le développement et la mise en oeuvre de politiques et
stratégies, programmes et projets identifiés par les
autorités locales et la population de la Communauté dans
l'optique d'un développement urbain durable. Cette acception de l'Agenda
21 local suppose la participation, ou mieux la concertation avec les
différentes parties prenantes. De ce point de vue, dans un contexte
national de démocratie et de Décentralisation,
l'évaluation du degré de démocratie participative permet
de conclure de la démarche employée par les responsables de la
mise en oeuvre et de la coordination du plan d'action relatif à
l'élaboration de l'Agenda 21. Cette évaluation est fondamentale
dans la mesure où elle reflète d'une part le degré de
démocratie participative et le type de démarche employée,
d'autre part la pertinence des critères de choix des projets
prioritaires, de même que les secteurs d'intervention (Environnement,
salubrité, urbanisme, logements sociaux, hygiène et
assainissement, transport...), ainsi que les groupes sociaux cibles. Enfin,
elle pourrait en dernière analyse mettre en exergue les facteurs de
réussite et/ou les points de paralysie du plan d'action.
L'élaboration de l'Agenda 21 s'est tenue en six
phases. L'analyse du rôle et du statut des différents acteurs
locaux à ces diverses phases a guidée cette démarche.
Ø Le diagnostic de l'environnement
urbain
Cette phase constitue essentiellement la description et
l'analyse des problèmes urbains, afin de s'imprégner des
réalités actuelles, d'appréhender les
vulnérabilités territoriales, déceler les grandes
problématiques et d'entrevoir une vision des stratégies
adéquates. Elle a été réalisée par une
équipe pluridisciplinaire de consultants nationaux constituée
d'économistes environnementalistes, juristes, géographes,
urbanistes, d'ingénieurs de Conception (Technique et Génie
Civil), d'experts en politiques urbaines et d'écologistes forestiers,
assistée d'un Comité scientifique. Sous la coordination du Bureau
National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD), avec la
coopération technique de la GTZ-Yaoundé, et du Secrétariat
permanent à l'environnement (SPE).
Ø Les Journées de dialogue
Ces journées sont organisées dans l'optique
d'avoir le point de vue des populations et procéder à
l'identification concertée des divers problèmes qui les
préoccupent le plus, tout en leur permettant de préciser les
échéances au bout desquelles ils souhaiteraient les voire
résolus. Ces journées ont été organisées
ainsi qu'il suit :
- Les Journées de Dialogue Publiques
Décentralisées (JDPD) organisées par la Cellule Technique
dans les Mairies avec les élus locaux de chaque CUAD.
- Les Journées de Dialogue Publique (JDP) avec les
populations, scindées en catégories d'acteurs (Jeunes
élèves et étudiants, femmes, hommes, opérateurs
économiques, ONG et associations) et entretenus séparément
au cours de différentes JDP.
- Une journée de Dialogue Publique Locale (JDPL) pour
effectuer la synthèse des travaux des différentes Journées
de Dialogue
Ces Journées de Dialogue Publique et
Décentralisée (JDP et JDPD) se justifient par les enjeux d'un
développement urbain qui vise principalement une conscience par tous de
la nécessité pour la ville de faire face à des
défis sociaux et environnementaux de première urgence, une
volonté de répondre aux besoins locaux, la satisfaction des
aspirations profondes de la population et une volonté
d'élaboration des décisions au sein de la collectivité
afin d'en tirer des bénéfices directs et indirects. Cette phase
constitue la première étape de concertation et de
négociation avec les acteurs locaux, notamment les populations, les
opérateurs économiques, ONG, associations et les élus.
Ø L'atelier de planification
stratégique
Il s'agit de groupes de travail d'acteurs urbains
représentatifs qui analyseront les problèmes majeurs de la ville
et discuteront des stratégies à déployer pour atteindre
les objectifs fixés ; dans le but d'aboutir à
l'établissement d'un programme d'action pour la ville. C'est la Cellule
Technique qui veille au suivi et à la coordination de toutes ses
activités.
Ø La concertation et la négociation avec
les partenaires au développement
Afin de rompre avec les procédés de financement
classique au coup par coup sur des ressources budgétaires de la
Communauté Urbaine de Douala qui ont largement
révélé leur faiblesse et leur inefficacité
(réalisation partielle de projet, absence de suivi de
l'effectivité des politiques mise en oeuvre, parfois abandon total de
projet faute de financement), la table ronde avec les Partenaires de
Développement, tant du secteur public que les partenaires
étatiques et internationaux est organisée dans le cadre de la
mise en place d'instruments indispensables pour la mobilisation des
financements dédiés au plan d'action. Au niveau international,
les principaux Partenaires de Développement sont la Banque mondiale,
l'Agence française de Développement (AFD), la Coopération
française dans la perspective de l'Initiative PPTE bilatérale
française dite «Contrat de Désendettement -
Développement (D)», le PNUD l'Organisation internationale de
protection de la nature (WWF), l'Union Européenne (UE), la Banque
Africaine de Développement (BAD), la Coopération technique
Allemande (GTZ) et l'ONU.
Au niveau national, ces partenaires sont essentiellement du
Fond spécial d'Equipement Intercommunal (FEICOM), ainsi que toutes les
délégations régionales des Ministères
impliquées dans la gestion de l'environnement. Leur rôle se
résume à la collaboration, l'assistance dans la mise en oeuvre de
stratégies, projets et actions et surtout à l'octroi de
financement sous forme de crédits de développement.
Ø L'approbation du plan d'action
Il constitue la phase de synthèse des travaux de la
Cellule Technique, et d'approbation du plan d'action défini. Les
diverses phases de concertation et consultation des différentes parties
prenantes montrent clairement que le degré de démocratie
participative y est très mitigé car l'approbation et la
validation des travaux se font par le Comité de Pilotage en l'absence
des élus locaux (Maires). Cette incongruité pourrait constituer
une entorse à la mise en place du Plan d'action. Le risque que l'on
court est de tomber dans la difficulté de définition, et de choix
des domaines d'intervention des projets prioritaires. Cela constitue l'un des
facteurs possibles de paralysie du plan d'action. Ce qui renvoie à
s'interroger sur la pertinence du choix des projets prioritaires
approuvés. Des projets jugés prioritaires par les élus
locaux et leurs populations peuvent ne pas être considérés
comme tels par le Comité de Pilotage qui s'est fait une vision de
projets prioritaires parfois antérieurement à la concertation et
la consultation des populations et autres acteurs locaux. Ce risque est
d'autant plus probable qu'il n'existe aucun mécanisme
d'amélioration permanent mis en place pour pallier à une
éventuelle insuffisance d'un tel genre.
Compte tenu de la structure et du fonctionnement du
Comité de pilotage, de la Cellule Technique et du rôle des acteurs
locaux aux diverses phases du processus d'élaboration de l'Agenda 21
local, nous pouvons conclure qu'en dépit des possibles facteurs de
blocage tels que l'absence des élus locaux au plus haut niveau
décisionnel qui entache la pertinence du choix des projets prioritaires
dans l'approbation du plan d'action, il existe une coopération active et
structurée de la Communauté Urbaine de Douala avec les divers
services impliqués, les groupes sociaux cibles (Populations,
opérateurs économiques, ONG, Associations...), ainsi qu' avec les
Partenaires de Développement locaux et extérieurs dans
l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'action. La nature des
contributions et les intervenants dans la mise en oeuvre des projets
actuellement en cours à la Communauté Urbaine de Douala (CUD)
vient à juste titre corroborer ce constat. Ainsi, concomitamment
à l'élaboration de l'Agenda 21 local, un certain nombre de
projets sont en cours en matière de prévention et d'adaptation
aux risques environnementaux, conformément à l'approche par
anticipation/prévention. Le choix des projets en cours s'est
essentiellement effectué d'une part sur la base de leur importance
sociodémographique, dictée par le ressenti des populations.
Tableau des Projets en cours dans la ville de
Douala
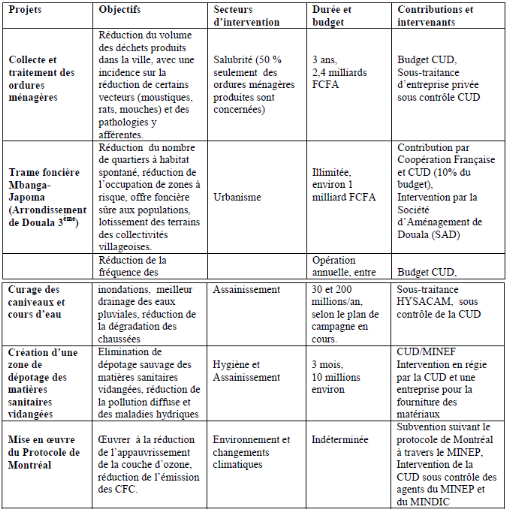
Source : Communauté Urbaine de Douala/DEPUDD (2010)
La démarche entreprise par la CUD dans le cadre d'un
développement urbain durable est fort significative pour
apprécier l'intégration des préoccupations
environnementales dans les politiques de développement de la ville.
Toutefois, l'engagement de la ville dans les voies du développement
durable est plus déterminant lorsque l'on se rend compte que plusieurs
raisons l'incitent à une telle démarche. Dans quelle logique
s'inscrit donc l'intégration des préoccupations environnementales
dans la politique de développement de la ville de Douala ?
B. La logique de l'intégration des
préoccupations environnementales dans la politique de
développement de la CUD
L'intégration des préoccupations
environnementales dans la politique de développement de la CUD
s'explique mieux à travers les diverses compétences
exercées par cette collectivité territoriale en matière de
développement durable (1), et à une volonté sans cesse
grandissante d'adapter les préoccupations et techniques internationales
de l'environnement au niveau local (2).
1) Les compétences de la Communauté en
matière de développement durable
Les collectivités locales disposent aujourd'hui, dans
la plupart des pays au monde, de plus en plus de compétences en
matière économique, de la planification et l'aménagement
du territoire. Toutes choses qui, dans la logique de la nouvelle gouvernance
prônée par la conférence de Rio de 1992 et basée sur
les politiques intégratrices et non sectorisées, peuvent
être une aubaine pour la protection de l'environnement. Les
collectivités locales ont donc là assurément un rôle
central et historique à assumer l'avenir de la planète
vis-à-vis à la fois de leur population d'aujourd'hui et de
demain. C'est par exemple diminuer les rejets polluants dans
l'atmosphère, protéger la biodiversité, les forêts
et les montagnes, promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et
de la santé, promouvoir les énergies renouvelables289(*). Il est donc clair que la
CUD est un acteur en matière économique, éducationnelle,
sanitaire et sociale290(*).
Ainsi, le partage des compétences est
rationalisé par une planification emboitée organisant les
pratiques territoriales de manière concertée291(*). Le principe de
planification est très largement en usage que ce soit en matière
d'usage des sols, de gestion de l'eau ou des déchets. Dans cette
mouvance, la ville de Douala dans le CDS se veut une ville attractive pour les
affaires et le tourisme à l'horizon 2025. Par ailleurs, en
matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la CUD est
responsable de la gestion des différents plans et permis en la
matière292(*).
Elle peut également prendre des plans communaux d'aménagement.
Elles délivrent les permis d'urbanisme et les permis de lotir ou de
construire293(*). Sur le
plan spécifique en matière environnementale, la Communauté
Urbaine a une mission très importante, celle de gérer le permis
d'environnement (permis d'exploiter les établissements qui peuvent
générer des pollutions).
Nous pouvons quand même remarquer sans
exagération que la CUD n'a pas une influence considérable sur
l'environnement par son poids économique relativement à ses
infrastructures et à ses modes de consommation. Mais d'un point de vue
sanitaire et social, la CUD a pour mission de répondre aux attentes
sociales et de construire un projet collectif pour le bien-être
individuel de ses habitants. C'est par exemple garantir l'accès à
la santé et à l'éducation, améliorer les conditions
de vie, lutter contre la pauvreté et la faim, renforcer les groupes
sociaux à travers les syndicats, les associations et les ONG
(populations locales, femmes, enfants, travailleurs,...).
En effet, les enjeux relatifs à l'urbanisation
croissante, à la santé, au logement, au transport, à
l'identité locale sont aujourd'hui primordiaux dans la mesure où
leur impact sur l'environnement est indéniable. Les localités
doivent être à la hauteur pour offrir à leur population un
cadre et des conditions de vie qui satisfassent aux exigences
environnementales. La Communauté y joue alors un rôle très
important surtout dans la protection du cadre de vie.
La collectivité territoriale
décentralisée est la structure de service public de base du
citoyen. C'est également le lieu où peuvent se retrouver
différentes associations, ONG, acteurs économiques pour
différentes démarches administratives. Les collectivités
locales sont le lieu d'initiatives locales, au plus proche des citoyens. Par
ailleurs, les autorités locales sont des instances publiques qui
justifient de plus de proximité avec les populations et
bénéficient auprès de ceux-ci d'une
légitimité qu'ils tirent des élections. En
général les populations locales font confiance en leurs
autorités locales. Mais il est regrettable de se rendre compte que dans
une ville comme Douala, les populations ne semblent pas être au courant
du rôle clé que doivent jouer leurs autorités locales en
termes de visions et d'actions pour le développement local294(*). Cela ne fait pas perdre de
vue cependant la vision de la ville en 2025 : l'attractivité de la
ville. Les multiples efforts opérés par la ville de Douala visent
à garantir à sa population de bonnes conditions de vie, en
aménageant le territoire, en garantissant le développement local
par l'investissement économique, en luttant contre la pauvreté et
les inégalités sociales. Tel est le nouveau défis de la
ville de Douala afin de rentre opérationnelles de nouvelles
expressions: « écotourisme », « tourisme
durable », « éco-quartier »,
« éco-ville », « ville
durable ».
Nous pouvons dès lors emprunter à Roger
GIBBINS, cette célèbre phrase :
Les villes sont devenues les principaux moteurs de la
prospérité économique et la qualité de la vie en
milieu urbain est désormais un des principaux éléments qui
déterminent la décision d'implantation des investisseurs et des
entreprises295(*).
Les collectivités se trouvent donc malgré elles
dans la position d'interlocuteur privilégié de ces
entreprises296(*). Le
développement durable tend donc à devenir « un
agent mobilisateur » pour les décideurs et acteurs
locaux297(*). Comment
donc la CUD traduit sur le plan local les principes du développement
durable bâtis et diffusés par la sphère
internationale ?
2) L'adaptation des préoccupations et techniques
internationales de l'environnement au niveau local
Précisons d'emblée que le Communauté
urbaine de Douala est dotés de compétences multiples qui lui
permettent d'agir sur les grands enjeux locaux ; mais aussi
représente une entité idéale de promotion et d'application
des principes du développement durable.
Nous osons revenir au niveau de cette analyse à la
question de savoir quelle place occupent les collectivités
territoriales décentralisées, et notamment la Communauté
Urbaine de Douala, dans les politiques globales de protection de
l'environnement au Cameroun. En guise de réponse, nous indiquons
qu'aujourd'hui la CUD s'impose comme plate-forme idéale d'application
des principes de développement durable.
La Déclaration de Rio prescrit clairement de mettre en
oeuvre le concept de développement durable dans un esprit de
partenariat. Ce partenariat sonne le début d'une nouvelle forme
d'approche managériale en termes de gouvernance. Cette nouvelle forme de
gouvernance tant souhaitée par beaucoup d'acteurs locaux ne manquera
pas, de créer, de bouleverser les habitudes et les idées
reçues. Les principes du développement durable sont ainsi
appelés à générer un état d'esprit de
développement où la première difficulté est de
réussir à enrichir l'esprit fonctionnel classique de
l'État, tellement enraciné298(*). Il est tout de même assez curieux de
constater que, dans les textes de base de la décentralisation au
Cameroun, il n'apparait pas de manière explicite, le concept de
développement durable, alors même que le contexte international
qui prévaut au moment de leur élaboration y est fortement
favorable et aurait permis aux autorités camerounaises d'anticiper sur
l'évolution des choses en intégrant, par le législateur,
des principes du développement durable. Plusieurs principes de la
Déclaration de Rio justifient le rôle déterminant des CTD.
Retenons pour le moment le principe d'équité inter et intra
générationnel.
En effet, le principe intra et
intergénérationnel résume l'expression d'une
solidarité trans-temporelle et trans-spatiale de la collectivité.
C'est-à-dire une solidarité dans le temps et une
solidarité dans l'espace. Il fait envisager le développement dans
l'optique d'un lien étroit entre celui-ci et les ressources naturelles
du territoire. Au demeurant la CUD dispose d'énormes compétences
en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles du territoire299(*), ressources qu'elles doivent
pouvoir gérer de manière durable.
En outre, les compétences diverses de la CUD lui
donnent des possibilités diverses de prendre en considération
différents pans des grands défis environnementaux comme le
changement climatique, la protection de la biodiversité et même la
gestion des risques environnementaux. Même si l'Etat gardera une main
mise considérable sur ces enjeux comme nous le précise Elisabeth
COLLANGE-POTRON,
Les collectivités territoriales auront à
jouer un rôle-clé sur certaines thématiques - notamment les
transports et le bâtiment - et sur d'autres, elles ne pourront que subir
l'impact des mesures prises par le Grenelle300(*).
Le changement climatique est devenu un enjeu nouveau pour la
CUD. En témoigne d'ailleurs les différentes rencontres nationales
et internationales organisées à Douala sur les questions de
changement climatique en milieu urbain. La dernière rencontre
internationale sur la thématique du changement climatique initiée
par la CUD s'est tenue en du 23 au 25 juin 2014 et regroupait les maires
francophones dans le cadre de l'AIMF (Association International des Maires
Francophones)301(*). Ces
initiatives sont prises afin de rompre avec une ancienne pratique
administrative : celle d'attribuer aux collectivités territoriales
décentralisées le simple rôle de partenaire et de les
reléguer à un rôle d'accompagnateur des politiques
nationales302(*). Ces
initiatives participent de la volonté de la CUD d'être plus
présente dans les grands projets structurant du pays303(*).
En effet, le rôle des collectivités locales face
au changement climatique commence à être reconnu par une
majorité de la classe internationale. La Commission environnement du
Parlement européen avait adopté le 19 octobre 2009 un amendement
à la résolution relative à la position de l'Union
Européenne à Copenhague mettant en exergue le rôle des
autorités locales et appelant l'Union à promouvoir
L'engagement des villes et des collectivités
locales et régionales dans le développement et la mise en oeuvre
de stratégies nationales sur le changement climatique, et notamment de
plans d'action d'atténuation et de programmes d'action
d'adaptation»304(*).
Bien qu'il incombe aux États de négocier
à l'échelon international sur la problématique liée
au changement climatique, la bataille ne sera pas gagnée sans une
intégration de tous les acteurs, à toutes les échelles. La
problématique de changement climatique semble être une
opportunité pour les collectivités territoriales et leurs actions
dans ce domaine peuvent leur offrir des atouts économiques non
négligeables. Isabelle ROUSSEL dira à ce
propos que:
Les collectivités ont investi dans des pôles
de compétitivité orientés autour des questions
énergétiques qui demandent un développement fort et urgent
de recherches et de technologies. Il s'agit de favoriser l'émergence de
projets innovants associant chercheurs, industriels et décideurs
locaux305(*).
Les collectivités sont aussi fortement
interpellées sur la question de la protection de la biodiversité
et leurs compétences en matière de protection de la nature leur
ouvrent cette voie. Au Cameroun, il est de la compétence des
Régions de connaitre des affaires concernant la gestion, la protection
des zones protégées d'intérêt régional
suivant un plan dûment approuvé par le représentant de
l'État ; de la gestion des parcs naturels régionaux, suivant un
plan soumis à l'approbation du représentant de l'État; de
l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi des plans ou
schémas régionaux d'action pour l'environnement306(*). Les compétences
environnementales des régions camerounaises sont directement
liées à la protection de la nature et sont des tremplins
nécessaires à la protection de la biodiversité. Toutefois,
compte tenu de l'inopérationnalité des Régions, ses
compétences sont partagées entre l'autorité
déconcentrée (le Préfet) et la municipalité. Dans
le cas d'espèce, la CUD assure avec l'assistance du Préfet les
compétences dévolues au Régions en matière
d'environnement. Ceci est d'autant plus vrai que dans la poursuite de ses
objectifs, la CUD concentre des efforts dans la lutte contre
l'insalubrité, les pollutions et nuisances, la protection des ressources
en eaux souterraines et superficielles, la création, l'entretien et la
gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt communal;
l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement. Ce qui
pourrait expliquer à certains égards la tendance aux actions de
coopération dans un but d'échange et de renforcement des
capacités.
Paragraphe 2.Les actions de coopération
de la CUD en faveur de la protection de l'environnement
De nombreuses actions de coopération sont
menées au sein de la CUD aboutissant pour certaines aux accords de
jumelage ou d'amitié, dans le cadre de la coopération
décentralisée (A), et pour d'autres au financement de plusieurs
projets, cas de coopération bi- et multilatérale (B).
A. La coopération
décentralisée
Le terme « coopération
décentralisée » peut revêtir des
significations différentes et englober de manière plus ou moins
extensive l'ensemble des acteurs de la coopération internationale.
D'ailleurs, le règlement du Conseil de l'Europe accorde la
qualité d'agent de coopération décentralisée
à tous les acteurs dits « infra
étatiques » ; c'est-à-dire toutes les
organisations et personnes morales qui ne relèvent pas directement du
gouvernement, qu'elles soient publiques ou privées. Il peut s'agir de la
sorte aussi bien de collectivités et autorités territoriales ou
locales que d'associations, d'ONGs et autres partenaires publics ou
privés. Par contre, selon les termes du droit français, la
qualité et le statut d'agent de coopération
décentralisée sont réservés uniquement aux
collectivités et autorités territoriales car on considère
qu'il s'agit des relations décentralisées au sens public de
l'expression307(*).
Pour Jean Louis VENARD, la Coopération
Décentralisée s'entend aujourd'hui dans un double sens :
d'une part, les institutions de coopération tendent de plus en plus
à favoriser la mobilisation des collectivités locales des pays
développés au service du développement urbain en Afrique
en apportant des compléments de financement aux accords directs
passés entre villes du Nord et du Sud désignés sous le nom
de « jumelage - coopération ». D'autre
part, selon le sens qui lui est donné parl'Union Européenne, la
coopération décentralisée a pour objet de mettre l'aide au
développement directement à la disposition des
collectivités locales du Sud en contournant les administrations
centrales des Etats308(*). Allant dans le même sens, Franck PETITEVILLE
définit la coopération décentralisée comme une
nouvelle forme de coopération internationale avec pour pendant
l'acheminement de l'aide publique au développement au Sud. Aussi
utilise-t-il avec insistance l'expression « coopération
décentralisée pour le développement », pour
catégoriser les relations Nord-Sud309(*).
Notons que, de prime abord, ces différentes approches
de la coopération décentralisée Nord-Sud sont
essentiellement réductionnistes et constituent un facteur de
minorisation de cette nouvelle forme de coopération internationale car,
occultant, mieux, faisant l'impasse sur les différentes interactions
et/ou légitimations réciproques qui sont à l'oeuvre dans
ce jeu. Laissons la législation camerounaisedéfinir pour nous la
coopération décentralisée. Au sens d'un
Décret du Premier Ministre, la coopération
décentralisée renvoie aux relations que les collectivités
territoriales nouent avec leurs homologues nationaux et étrangers en vue
de réaliser des objectifs communs310(*). Née dans un univers relationnel
essentiellement interdépendant, la coopération
décentralisée regroupe l'ensemble des actions de
coopération internationale menées entre une ou plusieurs
collectivités territoriales (régions, communes et leurs
groupements) et une ou plusieurs autorités locales
étrangères dans un intérêt commun fut-il relatif. Il
s'agit finalement d'un ensemble de relations de solidarité et/ou de
partenariat que développent les collectivités locales
camerounaises avec leurs homologues étrangers dans un
intérêt commun sinon égal du moins équitable.
Le Tableau ci-dessous présente l'état de la
coopération de la ville de Douala. Mais quelques unes seulement
retiendront notre attention.
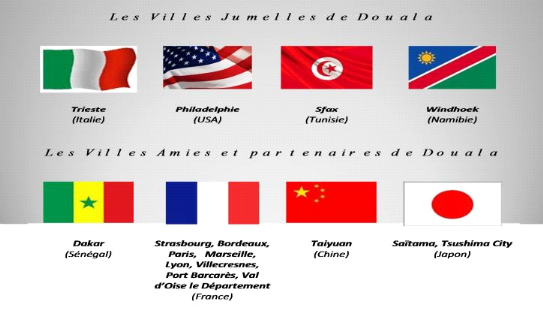
Ø Accord de coopération avec la ville de
Ouagadougou
L'Accord de Coopération entre la Ville de Douala et la
Ville de Ouagadougou au Burkina Faso est établi sur la base de la
signature d'un Protocole d'Amitié et de Coopération
décentralisée le 4 février 2012. Cet accord de
coopération a pour objet les échanges de connaissances et
d'expériences dans tous les domaines de la gestion urbaine et de la
Gouvernance locale pour le développement économique, social et
culturel des populations des Villes de Douala et Ouagadougou. Bien plus,
concernant les volets environnement et gestion durable des déchets, la
communauté urbaine de Douala s'est dite séduite par
l'expérience de Ouagadougou dans ce domaine.
En août 2013, le Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala a conduit,
dans le cadre d'une visite officielle à Ouagadougou, une grande
délégation composée d'un représentant du MINATD, de
plusieurs Directeurs de la Communauté Urbaine de Douala et du Directeur
de l'Agence HYSACAM de Douala. Au cours de cette visite, le projet ISDERA
(Innovative Service in DifficultEnvironment for Recycler Artisan) est
inclus dans le partenariat. En effet, lancé officiellement le 25 mars
2010, ce projet est financé à 90 % par l'Union Européenne
dans le cadre de son Programme « Acteurs non étatiques et les
Collectivités Locales dans le Développement ». La
Communauté Urbaine est le chef de file d'un groupe de partenaires
composé de : l'Université Ca'Foscari de Venise (Italie), la
Commune d'Arrondissement de Maroua 1er, l'Université de
Koudougou (Burkina Faso) et l'Association A.P.R.E.I.S. (France). L'objectif
général de ce projet est la réduction de la
pauvreté par la création d'une filière
professionnalisée de récupération et de recyclage
artisanal des déchets, en assurant la formation et l'appui des
récupérateurs artisanaux par des micro-projets adaptés.
Ø L'Accord cadre d'amitié Douala - Dakar
Un Accord-cadre d'Amitié et de Coopération a
été signé le 22 mars 1994 entre la ville de Douala et
celle de Dakar au Sénégal. Celui-ci a pour domaines
d'interventions : la gestion urbaine, les échanges au niveau de
l'enseignement supérieur, les échanges entre jeunes,
échanges entre opérateurs économiques et le
développement économique et culturel.
Ø L'Accord cadre d'amitié Douala -
Agadir
Des Maires et des opérateurs économiques de
plusieurs villes du Royaume Chérifien (Maroc) ont séjourné
au Cameroun du 29 juin au 5 juillet 2013. A cette occasion, cette
délégation a été reçue à Douala du 29
au 30 juin. Au cours de cette visite, un Protocole d'Accord-cadre
d'Amitié et de Coopération Décentralisée a
été signé entre le Délégué du
Gouvernement et le Maire de la ville d'Agadir. Dans ce Protocole d'Accord, les
deux parties sont convenues d'instaurer cette coopération
décentralisée en vue de procéder aux échanges de
connaissances et d'expériences dans tous les domaines de la gestion
urbaine et de la gouvernance locale pour le développement
économique, social et culturel de nos populations.
Toutefois, il serait peut-être aussi important de
préciser la coopération bi- et multilatérale menée
par la CUD en appui à la coopération
décentralisée.
B. La coopération
multilatérale
Nous analyserons ici la coopération avec certains
organismes internationaux (1), d'une part et les partenaires au
développement (2), d'autre part.
1) La coopération avec certains organismes
internationaux
Fidèle à sa politique d'ouverture vers
l'extérieur, la ville de Douala a toujours participé aux
différentes assises organisées par les grands regroupements
internationaux des villes et métropoles. Autrement dit, Douala est
très active dans les Associations de Villes, telles l'AIMF, METROPOLIS,
CGLU ou encore l'ICORD. Mais quel peut bien être l'apport dans ces
association pour l'amélioration du cadre de vie des populations Douala
et la réduction des risques environnementaux ?
Ø L'Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF)
L'AIMF a apporté un soutien efficace et important
à la Communauté Urbaine de Douala à travers :
- La fourniture et surtout l'adaptation à la
législation camerounaise du logiciel de la chaine financière
installé sur le réseau informatique cofinancé avec le
Projet PADUDY311(*);
- La réalisation de forages sur l'île de Manoka
dans la Commune d'Arrondissement de Douala 6ème;
- La réalisation de l'adressage en collaboration
financière avec l'Union Européenne ;
- L'inscription de la Ville de Douala dans plusieurs
programmes de renforcement des capacités notamment le Projet PARECC
(Projet d'Appui au renforcement des Collectivités Locales du Cameroun et
du Congo et de leurs Associations nationales)avec d'autres villes du Cameroun
et du Congo ou le Projet de Mobilisation des Recettes et de la Gestion
Financières des Villes de Bangui, Douala, et Pointe Noire, en
collaboration avec l'Union Européenne.
Tout récemment, cette association est venue en appui
à l'organisation par la CUD d'un séminaire sous régional
« Villes d'Afrique centrale et changement climatique», tenu
à Douala du 23 au 25 juin 2014. Ce séminaire s'inscrivait dans la
logique de l'objectif général de la Commission « Villes et
développement durable » de l'AIMF qui est celui de favoriser au
sein de cette Association l'échange d'expériences autour du
développement urbain durable. Spécifiquement, la Commission
cherche à encourager et à soutenir les villes qui s'engagent dans
une démarche de développementdurable. Ceci en facilitant la
circulation de l'information, en réunissant élus, techniciens et
experts autour de sujets de réflexion, de projets concrets sur le
terrainet en contribuant à pérenniser et à répandre
les bonnes pratiques en la matière.
Ø L'Institut Régional de
Coopération et de Développement(IRCOD)
Depuis 1997, l'IRCOD Alsace312(*) a redéployé ses partenariats au
Cameroun, en faisant de la relation et de la coopération entre
collectivités décentralisées alsaciennes et camerounaises
une de ses priorités. L'IRCOD Alsace estime en effet que c'est à
ce niveau que peut se développer une véritable dynamique de
développement local, dans le cadre d'approches participatives mobilisant
communes, acteurs de la société civile et structures
déconcentrées de l'Etat. Des démarches de ce type
constituent la base d'une véritable démocratie de
proximité.
Des relations particulières de coopération se
sont ainsi établies entre certaines collectivités
camerounaises dont Douala 1er, Douala 4ième, les
communes alsaciennes dont Strasbourg, Colmar, Sélestat, Lingolsheim,
Erstein et Thann. En effet, le développement des capacités de
maîtrise d'ouvrage des communes et l'appui aux initiatives de
développement local sont des axes majeurs de l'engagement de l'IRCOD
Alsace à travers la mise en oeuvre de projets concrets sur le
terrain. Ainsi, l'IRCOD Alsace et les communes alsaciennes partenaires se sont
engagés aux côtés de ces communes dont Douala
1er dans une action pilote d'aménagement et de
développement de quartiers spontanés. La première
étape de la démarche vise à organiser les habitants,
premiers concernés. Le travail d'animation réalisé par une
ONG locale partenaire a débouché sur la structuration des
habitants en un comité de développement représentatif de
la variété des couches socio-économiques. Il sera
l'interlocuteur privilégié de la commune pour identifier les
demandes des populations en terme d'amélioration à l'accès
aux services urbains de base et finalement pour aboutir à un programme
d'aménagement qui sera le fruit d'une démarche participative
associant la population et la commune (et aussi les chefferies traditionnelles,
la communauté urbaine et les services de l'Etat). L'expérience de
Douala 1er, plus avancée, montre aussi les
possibilités de contractualisation entre la commune et les habitants, au
travers du comité de développement, portant sur l'organisation du
fonctionnement et de la gestion des infrastructures réalisées
dans le cadre du programme (bornes fontaines). Un climat de confiance s'est
instauré progressivement entre la population et la commune qui se donne
les moyens de remplir ses missions de proximité.
Quid des partenaires au développement ?
2) La coopération avec les partenaires au
développement
Le financement de certains projets de la ville de Douala a
été soutenu par des partenaires au développement
dont :
Ø L'Agence Française de
Développement (AFD)
L'AFD est un partenaire privilégié de la ville
de Douala. Grâce à elle, plusieurs projets importants ont
été financés à travers le D313(*). D'autres projets sont soit
en cours de réalisation, soit seront mis en oeuvre à brève
échéance. Citons à cet effet les projets suivants :
l'aménagement des pénétrantes Est et Ouest de la ville de
Douala, ou encore le projet de drainage des eaux pluviales.
En outre, depuis septembre 2008, le Projet d'Appui
institutionnel PADUDY314(*) a commencé à être mis en oeuvre,
sous la supervision d'un Conseiller Technique français, suivant ses
trois composantes que sont :
- Appui à la Direction des Etudes, de la Planification
Urbaine et du Développement Durable, qui a permis d'équiper cette
direction et d'engager des études et la création d'un
Système d'informations Géographiques ;
- Appui à la Direction des Affaires Financières,
qui a permis d'informatiser la chaine financière depuis l'Ordonnateur
jusqu'au Comptable en passant par le Contrôle Financier
Spécialisé ;
- Appui au dialogue social entre les institutions municipales
et la population, qui a permis de mettre en place un partenariat entre la
Communauté Urbaine et les Communes d'Arrondissement de Douala pour
financer des projets d'amélioration du Cadre de vie portés par
des associations de quartiers.
Clôturé en septembre 2011, ce projet a
véritablement permis à la Communauté Urbaine de moderniser
ses structures315(*) et
ses capacités de gouvernance. En outre, d'autres projets sont
engagés dans le cadre de cette coopération, toujours en vue de
l'amélioration du visage de la ville de Douala. Il s'agit notamment du
projet de drainage pluvial316(*), réalisable dans la période de 2011
à 2016.
Ces projets s'inscrivent dans une perspective d'appui
à l'amélioration de l'assainissement, de la mobilité et du
système des transports urbains.
Ø La Banque Mondiale
Cette institution, à travers la
InternationalDevelopment Association (IDA), a financé pour 42
milliards de francs CFA le Projet d'Infrastructures de Douala (PID), à
travers lequel d'importantes infrastructures routières (23 km de voirie)
ont été réalisées ces dernières
années à Douala. Par ailleurs, la Banque Mondiale finance deux
autres projets à Douala : le Projet de Développement des secteurs
Urbains et de l'Eau (PDUE) en coursde réalisation et le Programme
d'Assainissement Liquide du Cameroun, en abrégé CAMSAN. Ces deux
projets contribueront à l'amélioration de manière durable
de l'assainissement des eaux usées dans la ville, ainsi que du drainage
des eaux pluviales.
Ø L'Union Européenne
Plusieurs projets ont reçu le financement de cette
institution de coopération multilatérale.
- Le projet ISDERA. Lancé officiellement le 25 mars
2010, le projet « Innovative Service in DifficultEnvironment for
Recycler Artisan » en abrégé ISDERA est financé
à 90 % par l'Union Européenne dans le cadre de son Programme
« Acteurs non étatiques et les Collectivités Locales dans le
Développement ». La Communauté Urbaine est le chef de file
d'un groupe de partenaires composé de : l'Université Ca'Foscari
de Venise (Italie), la Commune d'Arrondissement de Maroua 1er,
l'Université de Koudougou (Burkina Faso). L'objectif
général de ce projet est la réduction de la
pauvreté par la création d'une filière
professionnalisée de récupération et de recyclage
artisanal des déchets, en assurant la formation et l'appui des
récupérateurs artisanaux par des micro-projets adaptés.
- Leprojet OMD. Lancé en 2009, ce projet
intitulé : « Plans d'actions éducatives sur les
Objectifs du Millénaire pour le Développement, en
abrégé OMD, à travers les jumelages scolaires
Nord-Sud », financé par l'Union Européenne, associe des
partenaires de la France, de Bulgarie, du Burkina Faso et du Cameroun (CUD et
Commune d'Arrondissement de Maroua 1er), sous la conduite de
l'Université Ca'Foscari de Venise qui en est le Chef de file. Ce projet
poursuit les objectifs suivants :
· Sensibiliser les jeunes et leurs parents sur la
problématique du développement durable et son
applicabilité en Afrique Subsaharienne ;
· Soutenir le développement et
l'amélioration de la connaissance de la formation et des
compétences des dirigeants scolaires et des enseignants des pays
partenaires sur la thématique du développement durable et des
agendas 21 scolaires.
Au-delà de cet engagement dans les voies du
développement, l'autorité locale veille à promouvoir la
possibilité pour chacun de participer à la vie de la
société et de contribuer ainsi à la prise de
décision317(*)
aussi bien du domaine de l'environnement que dans d'autres domaines318(*).
SECTION 2 : L'APPROCHE PARTICIPATIVE DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA VILLE DE DOUALA
Dans le document stratégique de développement
(CDS) de la ville de Douala, la CUD projette d'en faire une ville cité
pilote en matière d'environnement tant au niveau national
qu'international en lui permettant et de se rendre visible dans tous les
domaines de l'environnement urbain et aussi de participer à de grands
programmes d'intérêt mondial319(*). Pour y parvenir, la CUD a engagé plusieurs
actions en faveur de l'environnement dont la mise en oeuvre tient largement
compte de tous les acteurs sociaux320(*). Il s'agit dans la stratégie de la
municipalité de mettre en évidence le « model
participatif »321(*)en matière de gestion de l'environnement et du
développement durable. LAZAREV fait remarquer que
Le développement ne peut être durable que
s'il est pris en charge par les populations qu'il concerne322(*).
Le recours à l'approche participative dans la gestion
de l'environnement est une conséquence de l'évolution
récente du contexte institutionnel international du
développement qui favorise la démocratisation à la base,
la libéralisation politique et la responsabilité
collective323(*).
L'approche participative exige donc l'implication de tous. Ce
système participatif contribue au renforcement de la gouvernance
locale324(*) et à
la consolidation d'une démocratie participative dans le domaine de
l'environnement. La gouvernance locale est donc promue comme mode idoine
de gestion des affaires dites locales (Paragraphe 1). C'est à travers
elle que se justifie de toute évidence l'implication ou la participation
légitime de tous dans les affaires environnementales (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La gouvernance locale, mode idoine de
gestion de l'environnement
L'enjeu ici est de savoir si les politiques locales ainsi
déployées sont de nature à conduire la ville vers la
réduction des atteintes à l'environnement et des risques
environnementaux. Il s'agit en fait de mener une analyse de l'appareil
politico-réglementaire qui englobe aussi bien les acteurs multiples que
les choix politiques de prévention et de gestion de l'environnement. Ce
qui nous permettra d'apprécier la portée de l'exécution
des plans relatifs à la protection de l'environnement et au
développement durable. Pour y parvenir, mettons d'abord en
lumière la structure et le fonctionnement de la gouvernance locale (A),
avant de voir par la suite son impact sur l'efficacité des
stratégies de protection de l'environnement dans la ville de Douala
(B).
A. Structure et fonctionnement de la gouvernance
locale à Douala
Le contexte politico-administratif de la Ville de Douala nous
montre que la gouvernance locale se situe ici entre concertation,
ambiguïté et chevauchement des compétences. Il s'agit d'une
libre administration prescrite par la Loi n°2004/017 du 22 juillet 2004
portant loi d'orientation de la décentralisation qui, en son article 2,
alinéa 1 dispose que la décentralisation
Consiste en un transfert par l'Etat aux
Collectivités Territoriales Décentralisées des
compétences particulières et de moyens
appropriés». Elle constitue «l'axe fondamental de la
promotion de la bonne gouvernance au niveau local325(*).
Les dispositions relatives à l'action
économique, à la planification, à l'aménagement du
territoire, à l'urbanisme donnent aux collectivités locales le
pouvoir d'améliorer la gestion de la ville326(*). D'après l'article 15
de la loi susmentionnée, la décentralisation transfère aux
communes les compétences en matière d'élaboration et
d'exécution des plans d'investissements communaux, d'élaboration
des documents d'urbanisme, d'aménagement urbain concerté et de
développement durable. Ce genre de rectitude suppose une organisation
répartissant sans ambiguïté les fonctions, le financement et
en responsabilisant les autorités locales. Si cette réforme a
acquis une valeur constitutionnelle327(*) se présentant comme l'axe fondamental de
développement de la démocratie et de la gouvernance au niveau
local328(*), sa
structure n'est pas aussi linéaire qu'elle le parait. Son fonctionnement
présente des particularités qu'il convient de souligner en tant
que soubassement quelque peu ignoré et inexploré des facteurs
institutionnels et politico-administratifs de la vulnérabilité de
la ville de Douala en matière environnementale.
Le poids de la tutelle sur les CUAD est souvent perçu
comme un obstacle majeur à l'efficacité de l'action de ces
collectivités locales. Cependant, au sens de la loi d'orientation de la
décentralisation qui attribue les missions de développement local
aux collectivités, l'objectif ici est la responsabilisation des
populations dans la gestion de leurs affaires à travers leurs
représentants élus. Un tel transfert de compétence est
indissociable de moyens réels d'exercice des pouvoirs
délégués. Ce qui visiblement n'est pas encore le cas pour
la ville de Douala. Les Maires ne disposent effectivement d'aucun pouvoir de
décision/action. Toutes les actions décidées au
préalable par leurs différents conseils de Communauté
et conseils municipaux doivent être approuvées et validées
par la tutelle avant leurs exécutions. Tel apparaît
l'épineux problème de l'effectivité des compétences
transférées329(*).
La rigidité du régime de tutelle constituerait
une infirmité à l'autonomie des collectivités
territoriales décentralisées et par conséquent pour
l'élaboration des plans de protection de l'environnement et du
développement durable. Il existe comme une logique de confiscation des
moyens légaux et réglementaires qui, mis à disposition des
collectivités territoriales décentralisées, auraient
contribué à améliorer l'efficacité de la protection
de l'environnement.
Il semble que la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 portant
création des Communautés Urbaines ne facilite pas les
interventions des divers acteurs de la gouvernance locale. Elle est à
l'origine des conflits. D'une part, cette loi a attribué des
compétences en matière de gestion de l'environnement tant
à la Communauté Urbaine de Douala qu'aux Communes Urbaines
d'Arrondissement sans spécifier les domaines d'intervention, ni les
échelles, encore moins les possibilités de relais de
compétence entre ces institutions. D'autre part, elle n'associe pas
équitablement le financement qui va avec les missions attribuées.
Evidemment les ressources humaines et financières à disposition
des Communes Urbaines d'Arrondissement les amènent à
démissionner ou à se faire exclure de la prise de
décision, et donc de la plupart de leurs compétences330(*). Par conséquent, la
Communauté Urbaine de Douala devient l'institution locale
compétente en matière de mise en oeuvre et de suivi de
la politique environnementale de la ville331(*).
De toute évidence, l'efficacité de la gestion
urbaine ne dépend pas exclusivement des Communes Urbaines
d'Arrondissement. Le problème est donc celui de tous les facteurs qui
influencent l'efficacité de la gouvernance locale. C'est dans cette
logique que Patrick Le GALES définit le concept de gouvernance urbaine
comme
La capacité à intégrer, à
donner forme aux intérêts locaux, aux organisations et aux groupes
sociaux en termes de capacité, à les représenter à
l'extérieur, à développer des stratégies plus
unifiées en relation avec le marché, l'Etat, les autres villes et
niveaux de gouvernement332(*).
En réalité, il s'agit d'opter pour des outils et
des stratégies susceptibles d'aider les collectivités locales
à améliorer leurs ressources humaines, leurs connaissances de
l'environnement urbain et à élaborer leur propre plan de
développement communal en concertation avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gouvernance locale.
La complexité de la structure et du fonctionnement de
la gouvernance locale de cette agglomération métropolitaine
laisse prévoir les impacts du fonctionnement de ce mode de gouvernance
en sur les stratégies de développement.
B. L'impact de la gouvernance locale sur
l'efficacité des stratégies de protection de l'environnement
à Douala
La Communauté Urbaine est l'institution locale
compétente en matière de mise en oeuvre et de suivi de la
politique environnementale de la ville. A cet effet, elle dispose en son sein
de la Direction des Etudes, de la Planification Urbaine et du
Développement Durable (DEPUDD). Essentiellement portée vers la
prospective, les responsabilités de cette Direction relatives à
la réduction des vulnérabilités et au développement
durable restent floues, tant dans l'élaboration des stratégies
que dans leur réalisation. Ceci tient lieu de la pluralité de ses
missions. La DEPUDD est simultanément impliquée dans une
nébuleuse de responsabilités relativesà :
- L'élaboration et le suivi des documents d'urbanisme
à court, à moyen et à long terme (PDU333(*), POS334(*), SDAU335(*)), nécessaires
à la planification urbaine et au contrôle de l'occupation du
sol.
- La réalisation des études de portée
générale ou sectorielle, relative aux projets structurants
(urbanisme, équipements à caractère économique ou
social, voiries, paysagement et habitat) et l'élaboration et le suivi
des études relatives aux transports et à la mobilité.
- L'élaboration et le suivi d'une stratégie de
développement économique de la ville.
- La communication sociale et l'ingénierie sociale des
projets.
- L'élaboration et le suivi de la politique
environnementale.
- L'élaboration et le suivi du plan d'adressage.
- La prise d'initiatives en vue de l'adoption d'une politique
de développement durable.
- La collecte, le traitement, la diffusion et la conservation
des données urbaines.
- L'établissement des relations avec les
administrations et les partenaires de développement relevant de ses
compétences.
Pour la réalisation de certaines de ses missions, la
DEPUDD dispose d'un département Environnement et développement
durable. Connu des autres départements de la Direction, ce service
dispose certes de charges clairement identifiées en ce sens où il
est en charge d'activités inhérentes aux préoccupations
liées au développement durable, mais comme la DEPPUD, ses actions
restent essentiellement prévisionnelles. Ses charges s'inscrivent dans
les axes contenant :
- La conception, la réalisation et le suivi
d'études et de projets dans les domaines de l'environnement, du
développement durable et d'atténuation de risques.
- La définition et la promotion des mesures de
protection de l'environnement et de protection contre les risques au sein de la
Communauté Urbaine de Douala en particulier, et pour l'ensemble des
acteurs de la ville en général.
- L'élaboration d'études d'impacts des projets
réalisés au sein de la Direction de la Planification Urbaine et
du Développement Durable.
- L'acquisition, le traitement et la diffusion d'informations
(initiatives, projets, études, réglementations et
procédures) en matière de protection d'environnement et de
risques naturels auprès des services concernés de la
Communauté Urbaine de Douala et des Communes Urbaines
d'Arrondissement.
- Le suivi, pour la Communauté Urbaine de Douala des
études et des projets en matière d'environnement, de
développement durable et d'atténuation de risques.
- L'alimentation de l'Observatoire Urbain en données
environnementales et sur les risques naturels et industriels
En outre, la Direction de l'Urbanisme de la Construction et de
l'Environnement (DUCE) est responsable du volet opérationnel des
stratégies, donc de l'élaboration et du suivi de la politique de
la Communauté Urbaine en matière de gestion des risques, du
développement durable. Laquelle politique implique résolument la
participation active du public336(*).
Paragraphe 2. La participation du public
à la protection de l'environnement dans la ville de Douala
Le modèle participatif de la gestion de l'environnement
urbain semble être, à l'aune de la mondialisation, l'un des enjeux
de la gouvernance locale. Dans un élan démocratique, le Droit de
l'environnement encourage la participation de tous les acteurs, donc leur
information préalable pour leur donner les moyens de participation
effective et efficace.
L'élan ainsi donné à la participation
des citoyens grâce à la politique de l'environnement est un apport
majeur à la démocratie et spécialement à la
démocratie directe337(*).
Avant de présenter le processus de participation du
public338(*) en
matière environnementale dans la Ville de Douala (B), il est
nécessaire de faire un bref détour sur le principe de
participation (A) tel que construit par le Droit international.
A. Le principe de participation en Droit
international de l'environnement
La participation du public est une notion relativement
récente en Droit de l'environnement339(*). D'ailleurs, la doctrine juridique ne nous offre pas
encore à ce jour une définition consensuelle. Toutefois, le
Lexique des termes juridiques340(*) réserve, pour le moins, la
première acception du terme participation à celle visée
ici.Il indique que la participation
Consiste à associer au processus de prise de
décision les intéressés (
citoyens,
administrés, salariés) ou leurs représentants.
Si le principe de participation n'est pas spécifique
à l'environnement341(*), la nature particulière du droit de
l'environnement a impliqué très tôt son
développement dans ce domaine. Il semble avoirtrouvé
là un terrain d'élection privilégié342(*). Face à une
exigence sociale accrue, conséquence de la sensibilité
croissante du public aux problèmes d'environnement, de nombreux
textes tels la Déclaration de Rio, la Convention d'Aarhus, sont
intervenus afin de reconnaître aux citoyens un droit
d'être associés aux décisions qui concernent leur
environnement343(*). La
revendication en faveur d'une plus grande démocratie
participative dans le domaine de l'environnement est en effet
directement à l'origine de l'extension du champ de la participation et
de l'affirmation du Principe de participation344(*).
Alors que le Droit international de l'environnement
est à peine naissant, la Déclaration de Stockholm du 16
juin 1972 insiste d'abord sur la nécessité de
former/informer le public345(*). En conséquence, la participation est
seulement ébauchée au principe 19 qui prévoit que
l'information et l'éducation du public lui permettront de
contribuer à la protection de l'environnement. La recommandation
97 du Plan d'Action adopté à l'issue de la
conférence, plus explicite, encourage lesEtats à faciliter
« la participation du public à la gestion et au
contrôle de l'environnement » et « à
prévoir les moyens de stimuler la participation active des citoyens
». Bien plus, le Plan d'Action de Vancouver de la
Conférence sur les établissements humains de 1976 consacre
les recommandations 49 à 53 à la participation, en
déclarant que « la participation populaire est un droit qui
doit appartenir à tous les secteurs de la population ».
La Charte mondiale de la nature, adoptée le 28
octobre 1982 affirmera à son tour ce principe de manière
à la fois plus nette et plus solennelle :
Toute personne aura la possibilité (...) de
participer, individuellement ou avec d'autres personnes à
l'élaboration des décisions qui concernent directement son
environnement.
Elle précise également que tous les
éléments nécessaires à la planification seront
portés à la connaissance du public pour qu'il puisse
effectivement être consulté et participer aux
décisions346(*).
Mais il faudra attendre la Déclaration de Rio de 1992 pour que le
principe de participation soit réellement consacré et
puissamment affirmé. En de termes très précis, le principe
10 de la Déclaration dispose en effet que
La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque
individu doit avoir dûment accès aux informations relatives
à l'environnement que détiennent les autorités
publiques, y compris des informations relatives aux substances
dangereuses dans la communauté, et avoir la possibilité de
participer au processus de prise de décisions. Les Etats doivent
faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du
public en mettant les informations à la disposition de
celui-ci.
Pour le Droit international, la participation est donc
tout en même temps accès à l'information et
participation à l'élaboration de la décision, depuis
l'élaboration de la loi à la décision
concrèteconcernant les communautés locales.
La prise en charge de leur destin par des
communautés locales aidées par les programmes internationaux
accrédite cette idée comme principe moteur de
l'application des programmes environnementaux347(*).
Le principe 10 de la Déclaration de Rio,
par sa grande précision terminologique, représente à
lui tout seul l'aboutissement d'une idée force qui recouvre les
divers aspects de la démocratisation environnementale :
participation, information et accès aux voies de
recours348(*).
Le lien est ainsi clairement établi entre la
protection de l'environnement et la participation, la participation et
l'accès à l'information et aux voies de recours. C'est donc
à bon droit que le Doyen PRIEUR affirmera que
Le développement durable n'a de sens au plan
politique que si les décisions sont prises par ceux qui en subiront les
effets ou du moins avec leur active participation349(*).
Pour ce qui est de la reconnaissance de ce principe au niveau
national, le cadre législatif nous renseigne efficacement depuis la
Constitution350(*)
jusqu'à la loi-cadre sur l'environnement351(*).
Fort de ces développements, la CUD reconnait au
public un rôle important dans la gestion de l'environnement. Quel est
donc le processus de prise en compte de ce public ?
B. La participation du public à la gestion
de l'environnement dans la ville de Douala
Pour mieux protéger l'environnement, le public doit
être impliqué de façon significative dans la gestion de
celui-ci. L'aspect subjectif de la participation du public (1) permet de mieux
appréhender la dynamique de cette participation (2).
1) L'aspect subjectif de la participation du public
dans la gestion de l'environnement à Douala
Nous envisageons d'une part ici le public comme personne
physique et d'autre part le public comme personne morale de droit
privé.
En effet, la notion de public désigne ici tous les
acteurs sociaux qui participent ou subissent de près ou de loin l'action
du politique en matière environnement. Au sens de ladite
Déclaration de Rio son Principe 10, il faut étendre à ce
public l'individu. Par ailleurs, la Convention d'Aarhus
distingue public de public concerné :Selon
l'article 2, paragraphe 4 de ladite Convention, le public
désigne
Une ou plusieurs personnes physiques ou morales et,
conformément à la législation ou à la coutume du
pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces
personnes.
Au vu de cette définition large, nous
considérons que le public au sens de la convention
équivaut aux populations. En outre, l'article 2, paragraphe 5
de la Convention définit le public concerné comme
Le public qui est touché ou qui risque d'être
touché par les décisions prises en matière d'environnement
ou qui a un intérêt à faire valoir à
l'égard du processus décisionnel.
Les ONG qui oeuvrent en faveur de la protection de
l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être
requises en droit interne sont présumées être
membres du public concerné.
Le public c'est donc les personnes physiques prises
individuellement, d'une part et collectivement d'autre part. Collectivement, il
s'agit des associations de défense de l'environnement.
La protection de l'environnement, si elle est devenue une
obligation de l'État, est avant tout un devoir des citoyens. Il est du
devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la
protection de l'environnement. Pour que ce devoir s'exerce en pratique, les
citoyens doivent, directement ou par l'intermédiaire d'associations,
être en mesure d'être informés et de participer aux
décisions pouvant exercer une influence sur leur environnement. Cette
participation est un apport majeur à la protection des droits de
l'homme352(*).
L'élan ainsi donné à la participation des citoyens
grâce à la politique de l'environnement est un apport majeur
à la démocratie et spécialement à la
démocratie directe353(*). Ainsi donc, le droit des associations de protection
de l'environnement se rattache directement au principe de participation.
Michel PRIEUR insiste sur le rôle de ces associations
(notamment celles qui bénéficient de l'agrément
administratif) en notant les formes diverses revêtues par leur
participation (relais d'
information en
direction du public, présence dans les organes de l'administration
consultative, organes de gestion de certains espaces naturels
protégés, lanceurs d'alerte et pour certaines rôle
d'expertise et surtout de contre-expertise), sans oublier leur intense
activité contentieuse354(*).L'administration locale utilise donc les
associations comme relais en vue de diffuser l'information en matière
d'environnement. C'est là une action essentielle pour mieux faire
connaître les enjeux et les orientations de la politique de
l'environnement. Des actions de sensibilisation (tracts, affiches,
conférences) et de formation accompagnent cette diffusion.
L'administration utilise aussi les associations pour faire remonter
l'information ; ces associations jouent le rôle d'informateurs du
fait de leur bonne connaissance du terrain.
Les associations telles ASHABO, FANG, ENVIRO-PROTECT, CIPCRE,
FCTV témoignent de leurs actions à Douala à travers bon
nombre de campagnes de sensibilisation organisées çà et
là355(*).
Les associations de défense de l'environnement
constituent donc un public concerné356(*) puisqu'elles n'ont pas
d'intérêt juridique ou de fait à démontrer
préalablement à leur intervention, pour autant que leur objet
social soit bien de nature environnementale.
2) La dynamique de la participation du public à
la gestion de l'environnement
La participation du public revêt un double
procédés : l'implication des populations dans le processus
d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la politique
environnementale de la CUD d'une part (a), qui inciteront davantage les
actions contributives de ces populations en faveur de l'environnement d'autre
part (b).
a) L'implication des populations locales dans
l'élaboration, le suivi et l'évaluation de la politique
environnementale de la CUD
L'information du citoyen de la ville de Douala est effective
à travers les campagnes médiatiques que la CUD entreprend. Par
ces campagnes, il s'agirait d'inculquer une véritable éducation
environnementale aux habitants. Concrètement l'on a très souvent
vu dans la cité des banderoles portant parfois les inscriptions
suivantes « ensemble pour une ville propre, un
environnement », « Gardons notre ville saines »,
« Jetez vos ordures dans la poubelle »,
« préservons notre environnement ».Ces slogans
à eux seul ne suffisent pas à inculquer une bonne
éducation environnementale qui permettra l'émergence d'une
culture citoyenne de respect de la loi environnementale. C'est pourquoi la CUD
en partenariat avec la Radio Balafon, dispose depuis près d'un an d'une
tranche d'antenne pour animer une émission tous les mardis matins sur
l'écocitoyenneté357(*). Elle sensibilise et informe les populations sur les
menaces croissantes qui pèsent sur l'environnement et la
nécessité de le protéger. Cette indispensable
éducation environnementale a pour objectif d'amener progressivement
l'individu à avoir un comportement respectueux de l'environnement.
On ne peut mieux protéger l'environnement que si l'on est
informé sur le niveau de sa dégradation, apprend-on.
D'un point de vue pratique, la CUD a initié dans son
programme d'action une journée communautaire baptisée
« Journée citoyenne de
propreté(JCP) »358(*)dont le but est de faire participer les
populations de façon active à la gestion de leur cadre de vie. Ce
concept se traduit par des activités d'investissement humain
(désherbage, curage de caniveaux, balayage, piquetage...)
couplées à des campagnes de sensibilisationaxées sur
l'hygiène et la salubrité. Ces opérations de
propreté, largement médiatisées, sont menées
mensuellement avec le concours des associations, des comités
d'hygiène de quartiers, des chefs de quartiers et autres
bénévoles. Le Délégué du Gouvernement, les
Maires et autres élus locaux participent personnellement et activement
à ces JCP. Ainsi, dans un souci de vulgarisation, le concept a
été décliné de plusieurs manières. L'une des
plus importantes déclinaisons aura été la création
de 2 concours primés :
- Le concours du quartier le plus propre et de la Commune
d'Arrondissement la plus citoyenne ;
- Le concours du marché le plus salubre (2
éditions ont été organisées par la CUD).
Ces concours ont pour but de susciter une adhésion
plus massive en créant une saine émulation entre les habitants
des différents quartiers de la ville (cas du concours du quartier le
plus propre) ou entre les commerçants des différents
marchés (cas du marché le plus salubre) ou encore entre les
différentes Communes Urbaines d'Arrondissement (cas de la CUAD la plus
citoyenne).
Tableau des différents lauréats au
concours de JCP entre 2008 et 2010
|
Classement
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
Quartier le plus propre
|
Cité sic bassa
|
Cité des enseignants
|
Cité des enseignants
|
|
CUAD la plus propre
|
CUAD Douala 4
|
CUAD Douala 3
|
CUAD Douala 1
|
|
Marché le plus propre
|
-
|
Marché de Bonassama
|
Marché New Deido
|
Cette initiative a reçu l'adhésion massive des
populations et des CUAD. On observe généralement au cours de la
JCP l'activisme des populations dans le curage des caniveaux, le
défrichage, le balayage, le revêtement de certaines
façades, etc. Cette politique trouve son relai dans les CUAD, notamment
la CUAD 3 qui a consacré tous les jeudis au nettoyage et à la
propreté (Journée de nettoyage et de propreté).
On parlera ici d'une véritable volonté de la CUD de
responsabiliser ses citoyens. Bien plus, Afin de faire pérenniser cette
initiative, l'on a procédé à la création des clubs
intitulés «Club JCP- Environnement» dans 16
établissements scolaires secondaires de la ville. Les membres de ces
Clubs ont suivi un séminaire d'imprégnation sur le concept JCP
pendant près d'une semaine à la CUD. Les activités de ces
clubs sont suivies et évaluées tout au long de l'année par
des responsables de la Communauté Urbaine de Douala. Leurs
activités diverses, telles que l'embellissement des façades,
l'instauration d'une journée de propreté, le tri des
déchets plastiques, le concours de la salle de classela plus propre, la
création d'une pépinière ou le compostage des ordures
ménagères biodégradables, contribuent à
l'éducation environnementale des élèves.
En outre, la participation des populations aux
décisions relatives à l'environnement peut être directe ou
indirecte. Directe, il peut s'agir des consultations, de la concertation ou des
enquêtes publiques. D'ailleurs la législation stipule que
La réalisation de l'étude d'impact
environnemental et social doit être faite avec la participation des
populations concernées à travers des consultations et audiences
publiques, afin de recueillir les avis des populations sur le projet359(*).
Plus précisément, la consultation publique
consiste en des réunions pendant l'étude, dans les
localités concernées par le projet ; tandis que l'audience
publique est destinée à faire la publicité de
l'étude, à enregistrer les oppositions éventuelles et
à permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de
l'étude. Il est aussi d'usage de procéder par voie d'affichage et
d'invitation, pour une audience publique dans une localité donnée
afin de recueillir des avis pour la construction d'infrastructures
routières, ou alors pour de grands travaux publics.
En effet, dans la ville de Douala, il a été
procédé à une consultation directe des populations avant
l'implantation de la Cimenterie Dangote sur les berges du Wouri. Ainsi, au
cours de la phase d'étude du projet, les populations se sont massivement
prononcées sur les effets néfastes tant environnementaux que
culturels que pourrait avoir ce projet. Tandis que certaines évoquaient
et déploraient l'augmentation du niveau de pollution que pourrait avoir
ledit projet, d'autres y voyaient une entrave aux événements
culturels de la communauté Sawa. Par ailleurs, en ce qui concerne le
second pont sur le Wouri, les populations concernées ont activement pris
part aux différentes réunions et consultations organisées
par les pouvoirs publics. Bien plus, durant toute la procédure
d'élaboration de l'Agenda 21 local de la ville de Douala en 2009, les
populations, à travers leurs représentants360(*) ont été
invitées aux travaux préparatoires.
Cette approche participative ou inclusive a renforcé,
à certains égards, la conscience environnementale des populations
de la ville de Douala. D'ailleurs, partant de l'idée que les populations
sont associées aux efforts de protection de l'environnement
déployés par les pouvoirs public, l'on doit reconnaitre avec
Michel PRIEUR que la protection de l'environnement est avant tout un devoir des
citoyens361(*). On
comprend donc l'agilité avec laquelle ceux-ci prennent des initiatives
dans leur différent milieu de vie.
b) Les initiatives des populations de Douala en faveur de
l'environnement
Dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, les
populations prennent des initiatives pour préserver leur cadre de vie,
et partant l'environnement. Dans un quartier comme Ndogpassi, situé
à la périphérique de la ville de Douala à la
pénétrante Est, plus précisément dans le secteur
appelé « Bonanjo », il est organisé
très souvent des weekends d'investissement humain.
En effet, dans ce quartier, les habitants organisent une fois
tous les deux mois une campagne de nettoyage. Lors de ces campagnes, on observe
comment les routes sont nettoyé, les caniveaux curés, les amas
d'ordure enlevés et reversés dans les bacs et les drains
vidés pour faciliter l'écoulement des eaux. Bien plus, on observe
de moins en moins l'entassement des ordures ménagers dans les carrefours
ou leurs déversement dans les cours d'eau. La société
HYSACAM ayant pris, en collaboration avec la mairie de Douala troisième
et le chef de ce quartier, l'initiative de procéder à une
collecte des ordures ménagères tous les dimanches à partir
de 15h.
Par ailleurs dans un quartier comme Bonapriso, les rues sont
de moins en moins encombrées par les ordures ménagères.
Avec l'initiative de la commune de Douala deuxième de mettre les bacs
à ordure dans toutes les rues, appuyée dans ses efforts par le
CUD, la conscience environnementale été éveillée et
l'on constate que de plus en plus, les ordures sont effectivement
déposées dans lesdits bacs.
Cette implication des habitants des différents
quartiers de la ville de Douala est un signe de la prise de conscience des
questions environnementales au niveau de nos quartiers, et par
conséquent marque le début de l'éco-citoyenneté qui
tendra vers l'avènement des éco-quartiers.
En somme, la Ville de Douala a élaboré depuis
plus d'une décennie des stratégies qui privilégient le
respect de l'environnement dans son processus de développement. Ses
efforts d'amélioration du cadre économique et infrastructurel
tel qu'il ressort de son CDS bénéficient de programmes d'action
qui mettent en exergue le respect des exigences de développement
durable. La politique ainsi adoptée par la Ville de Douala pour
affronter ses problèmes environnementaux urbains accorde une large place
à toutes les couches sociales concernées, notamment les
populations, les entreprises et les associations de protection et de promotion
de l'environnement. Cette approche participative renvoie à ce l'on
appelle la démocratie environnement et dont la Convention d'Aarhus
constitue le pilier.
Fort de ce qui précède, l'on peut dire que la
Communauté urbaine de Douala pourra atteindre les objectifs à
elle assignés dans le CDS : Faire de Douala une Ville Pilote en
matière d'environnement. Reste à apprécier la
capacité de la CUD à atteindre les objectifs définis tant
au niveau national qu'international à travers l'Agenda 21, les
Objectifs du Millénaire pour le Développement, le Nouveau
Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD),ou le Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté.
Chapitre 4
Evaluation des stratégies de protection de
l'environnement dans la ville de Douala
L'évaluation de l'action publique connait aujourd'hui
un regain croissant d'intensité. S'il est vrai que l'action publique
fait l'objet d'un programme pensé, élaboré et
étalé dans le temps, il est opportun de procéder à
un moment donné de sa réalisation à une évaluation.
Jean LECA écrit justement que l'évaluation est
L'activité d'analyse, d'interprétation de
l'information concernant la mise en oeuvre et l'impact des mesures visant
à assurer la préparation des mesures nouvelles362(*).
Par l'évaluation, il s'agit de vérifier
l'adéquation moyens/objectifs, et en cas d'insuffisance, de proposer des
mesures nouvelles. Ce qui fait dire à Jean Claude THOENIG que
l'évaluation « est une activité fondamentalement
normative »363(*) quand bien même elle permet une confrontation
des résultats aux attentes ou encore des objectifs aux moyens.
Compte tenu de ce qui précède, évaluer
l'action de la CUD en matière de protection de l'environnement commande
que l'on apprécie les moyens et les objectifs à son actif
(section 1) pour voir si cela justifie les résultats observables sur le
terrain. Concrètement, il s'agit pour nous de partir des moyens dont
dispose la CUD et des objectifs qu'elle s'est fixés pour proposer des
mesures nouvelles pouvant renforcer les capacités de la
Communauté Urbaine à atteindre ces objectifs tant au niveau
local, national, qu'international (section 2). Ceci dans la mesure où ce
travail d'évaluation devrait nous permettre de comprendre les
orientations des choix politiques et le niveau de participation des
différents acteurs.
SECTION 1 : EVALUATION DES POLITIQUES DE
LA CUD D'APRES LES MOYENS ET LES OBJECTIFS
Il convient de procéder d'abord à
l'évaluation d'après les moyens de la CUD en matière
environnementale (paragraphe 1), pour voir ensuite les objectifs que ces moyens
accompagnent (paragraphe 2).
Paragraphe 1. Evaluation des politiques
d'après les moyens mis en oeuvre par la CUD dans la cadre de la
protection de l'environnement
La préoccupation est ici de savoir dans quelle mesure
les moyens affectés à la politique de protection de
l'environnement par la CUD peuvent lui permettre d'arriver à cette fin.
En effet, l'accomplissement de sa mission de protection de l'environnement
nécessite la possession de moyens adaptés à la nature et
à l'ampleur de ladite mission. Ces moyens sont de plusieurs ordres, il
peut s'agir des financiers (A), des moyens humains et structurels (B). Il
serait cependant illusoire de prétendre ici à une analyse
exhaustive de toutes ces ressources.
A. Les Moyens financiers
La question des moyens financiers mis à la disposition
de la CUD en vue de l'accomplissement de ses objectifs pourrait conduire
à une variété de débats. En effet, il est tout
d'abord possible d'analyser les ressources finances financière de la
CUD, notamment son budget (1), afin d'en évaluer la quantité et
la qualité ; mais au-delà de tout cela, une analyse des
diverses sources de financement de ses actions nous semble pertinente (2).
1) Analyse du budget de la CUD
Le budget communal est l'instrument au travers duquel il est
possible d'obtenir une maîtrise de la nature des ressources de la
commune. Il se définit comme étant l'acte par lequel sont
prévues et autorisées les recettes et les dépenses des
organismes publics364(*).
En effet, depuis les années 2009, le budget de la
Communauté urbaine de Douala connait une augmentation relative. En 2012,
il a connu une augmentation en valeur réelle de 4,2 milliards F CFA,
soit 11% en valeur relative. Voté à 42,7 milliards FCFA, 25
milliards était consacrés à l'investissement, soit 60% du
budget, et 17 milliards pour le fonctionnement de l'institution, soit
40%365(*). En 2013, ce
budget était de 47 204 403 000 FCFA. En 2014, ce budget a
connu une augmentation de 2,47% par rapport au dernier exercice ; il est
passé à48,404 milliards de FCFA. Pour Fritz NTONE NTONE,
Délégué du Gouvernement auprès de la CUD, le budget
2014 représente le premier budget programme de la Communauté. Il
est consacré en majorité à l'investissement (31 milliards
de FCFA), basé sur quatre grands axes stratégiques
constitués de 17 programmes. Il s'agit d'abord de l'amélioration
des conditions de vie du plus grand nombre, à travers le renforcement du
système des marchés et des accès routiers entre autres.
Ensuite, l'amélioration de la compétitivité
économique. Puis, il s'agira de faire de Douala une ville pilote en
matière d'environnement, notamment à travers le perfectionnement
du réseau d'assainissement et la gestion des déchets. Enfin, il
est question d'améliorer la gouvernance366(*).
Ce volume budgétaire est-il à même de
financer toutes les initiatives environnementales entreprises dans la ville de
Douala ?
En 2011, la Direction de l'Urbanisme de la Construction et de
l'Environnement a soumis un Plan de Campagne à la session
consacrée à l'adoption du budget pour l'exercice 2012367(*). Nous notons que dans ce
plan de campagne, les opérations environnementales de salubrité
urbaine et de paysagement reçoivent une affectation budgétaire de
5,007 Milliards FCFA. Curieusement, l'on s'aperçoit que la part
consacrée à la collecte et le traitement des ordures
ménagères s'élève à 3 milliards FCFA. Or si
la collecte des ordures ménagères368(*) coûte environ 10
milliard à la CUD chaque année, qui supporte la contrepartie de
cette affectation ? Florent Mamert LOE369(*) faisait remarquer que les finances de la CUD sont
issues à 80% des subventions de l'Etat et des aides des
différents partenaires. Par déduction, on admet avec ce
fonctionnaire de la CUD qu'en matière de collecte des ordures, environ
10 milliards ont été affectés en 2013. Si comme en 2012, 3
milliards étaient issus des ressources de la collectivité, 7
milliard provenaient des subventions de l'Etat. Bien plus, le budget-programme
de la CUD pour l'exercice 2014 n'affecte que 4 989 350 452 FCFA
à la gestion de l'environnement. Le constat est le même que dans
les années précédentes. L'amélioration de la
gestion des déchets solides urbains absorbe plus de 3
milliards370(*).
Quelles sont donc les autres sources de financement de
l'action environnementale de la CUD ?
2) Les sources de financement de l'action de la CUD en
matière d'environnement
La fiscalité locale semble être le premier levier
financier des collectivités locales et en l'occurrence de la CUD. Il
s'agit ici, surtout de la fiscalité incitative, qui peut prévoir
des taxes élevées dans le but d'influencer ou de
décourager certaines habitudes de consommation des usagers ou des
entreprises. En effet, une bonne fiscalité environnementale amène
beaucoup d'avantages entre autres: une induction des changements de
comportements des producteurs et des consommateurs, un
rééquilibrage de la charge fiscale qui pèse sur les
différents facteurs de production (travail, capital et environnement) et
un encouragement permanent à l'amélioration des performances
environnementales et à la créativité.
L'approche fiscale environnementale est souvent
utilisée dans un but plus financier qu'incitatif371(*). La fiscalité
étant vue ici plus comme un moyen de financement de la protection de
l'environnement. Elle n'est dès lors perçue que comme une
redevance, qui ne modifie pas fondamentalement le comportement du pollueur,
mais que l'on affecte à la réparation des dégâts, en
espérant évidemment que les atteintes portées à
l'environnement soient réversibles. Comme partout ailleurs au Cameroun,
les taxes communales liées à l'environnement peuvent aussi
être qualifiées d'écotaxes. Elles rentrent d'une
part dans la catégorie de la taxe plus générale
dite « taxe de développement local ».
Cette taxe est perçue simplement en contrepartie des services de base et
des prestations rendus aux populations notamment, l'assainissement,
l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement de
ambulances, l'adduction d'eau, l'électrification. Par ailleurs, la
collectivité prend un « additionnel » sur un
impôt étatique préexistant372(*).
En 2013, les taxes communales contribuaient à hauteur
de 2,6 Mds FCFA aux recettes de la CUD. En 2014, les prévisions de
recette étaient de 3,739 Mds FCFA. Il va de soi que pour couvrir ne
serait-ce que les prévisions en matière environnementale, les
produits issus des taxes de la collectivité ne sont pas suffisants.
D'où la nécessité d'un appui financier externe373(*).
Si l'on peut se rendre compte de ce que la CUD
bénéficie de l'appui financier de ses partenaires374(*), l'autorité communale
a eu recours à l'emprunt communal pour le financement de ses
activités375(*).
Malgré ces efforts que ménage sans cesse
l'institution locale, la Ville de Douala demeure une métropole
très affectée par les problèmes environnementaux, en
raison des ressources toujours insuffisantes. Mais les ressources humaines et
structurelles pourront-elles relever le pan de la vulnérabilité
de l'environnement à Douala ?
B. Les moyens structurels et humains de la
CUD
Les responsabilités de plus en plus croissantes et
diversifiés de la CUD demandent certes la mobilisation d'énormes
masses financières. Mais que feraient-elles de tout cet argent une fois
mobilisé ? La réussite d'une politique locale de protection
de l'environnement passe inéluctablement par un appel à de moyens
organisationnels adéquats. La question force ici est de savoir si
l'organisation mise en place par la CUD peut lui permettre d'assurer avec
efficacité la protection de l'environnement, et par la même la
réparation des dommages causés à l'environnement. Comment
s'organise donc la ville de Douala pour faire face aux énormes
défis techniques et à l'expertise renforcée que
requièrent les problèmes environnementaux ? Tout ceci
nécessite une certaine professionnalisation de ses agents qui doivent
être à la hauteur non seulement des grands défis
environnementaux, mais également de leurs ambitions.
Nous voulons voir ici comment l'aménagement technique,
au mieux l'organisation de l'arsenal d'action dont dispose la CUD aux fins de
gestion de son environnement urbain permet de réponde avec
efficacité aux attentes de sa population.
Comme nous le rappelions au chapitre précédent,
la nouvelle stratégie de développement de la ville de Douala a
engendré la création de structures et de postes de
responsabilité spécifiques. Ce qui a conduit à la mise sur
pied, en février 2005 d'un Plan d'Action, et de l'Atelier d'Urbanisme de
Douala (AUD) rattaché à la Direction de l'Urbanisme et de la
Construction. En Mai 2007 on assiste à la création de la
Direction de l'Atelier d'Urbanisme de Douala, et en Mai 2008 à la
création de la Direction des Études, de la Planification Urbaine
et du Développement Durable (DEPUDD). Ces responsabilités ne sont
pas suffisantes cependant pour remplir le cahier de charge de la
Communauté urbaine en matière d'environnement. Il va donc de soi
que dans le but de plus d'efficacité, le CUD fait souvent recours
à des concessionnaires pour gérer des domaines ayant une
incidence notable sur l'environnement et dont la gestion nécessite une
très grande expertise.
Le partenariat entre la ville de Douala et la
société HYSACAM depuis 1969 en ce qui concerne la gestion des
déchets solides est très illustratif376(*). En outre, si l'on trouve
dans l'organisation technique un service « environnement »
notamment au Département « environnement et cadre de
vie », il est remarquable tout de même de constater que la
CUD ne dispose pas en son sein des personnes nanties d'une expertise en
matière environnementale. C'est compte tenu de cela qu'elle sollicite de
temps en temps l'appui technique de certains organismes partenaires. Notons
tout de même que le principal organisme d'appui technique aux
collectivités locales camerounaises reste sans doute le FEICOM à
côté duquel viennent la coopération française (par
l'AFD) et la coopération allemande (par la GTZ), pour ne citer que
celles-là. Ces deux partenaires apportent une coopération
technique dans le but de mettre en valeur et d'accroître les
potentialités de la Communauté urbaine par la transmission des
connaissances et du savoir-faire ou par l'amélioration des conditions
présidant à leur application377(*)
Ainsi, compte tenu des moyens très limités ou
insuffisantes de la CUD en matière d'environnement, l'on peut se rendre
à l'évidence de la difficulté pour la protection de
l'environnement à se réaliser efficacement. Cette
évaluation ex ante devrait être complétée
par la prise en compte des objectifs de la politique.
Paragraphe 2. Evaluation d'après les objectifs
de la CUD
Depuis 2010, la ville de Douala s'est dotée d'un plan
de développement contrôlé. En effet, l'élaboration
d'un Agenda 21 locale de la ville de Douala marque l'engagement formel du
gouvernement camerounais à déterminer et à mettre en
oeuvre des priorités en matière de développement durable
pour le XXIe siècle à chaque échelon
géographique.Ainsi, l'adoption d'une Stratégie de
développement de la Ville de Douala et de son aire métropolitain
s'inscrit dans cette démarche et ne voudrait en aucun cas être
Une liste de souhaits, de projets ou de plans sectoriels,
mais un projet de ville novateur adossé à un ensemble d'actions
poursuivies selon des moyens définis au préalable et
destinées à produire, dans une période donné, des
résultats mesurables sur une population, un secteur d'activités
ou un service urbain à l'aide d'indicateurs clés et de programmes
d'investissements prioritaires378(*).
Douala propose donc une amélioration de la ville et de
son aire métropolitaine à travers des objectifs
spécifiques. La CUD ambitionne donc faire de la Ville de Douala
Une ville pilote en matière d'environnement au
niveau national et international, pour lui permettre de participer à de
programme d'intérêt continental ou mondial et de se rendre visible
dans tous les domaines de l'environnement urbain379(*).
« Faire de Douala une ville pilote en
matière d'environnement » se présente dans le CDS
comme l'un des axes stratégiques de la politique de développement
de la ville380(*).
La ville de Douala fait face à de difficiles
problèmes environnementaux en raison des conditions climatiques et
géographiques particulières (fortes précipitations, relief
presque horizontal et comprenant des vastes zones inondables) en plus d'une
longue période d'inaction obligée à cause des faibles
revenus disponibles. Ce qui a entraîné une dégradation
générale des réseaux.
L'option prise de développer une politique pilote en
matière d'environnement, a amené les autorités locales
à inscrire plusieurs programmes au coeur de la poursuite de cet ultime
objectif. Mais avant d'arriver à ces programmes (B), évaluons
d'abord le niveau d'engagement de la CUD dans les préoccupations du
développement durable (A).
A. Evaluation du niveau d'engament de la
CUD
L'évaluation du niveau d'engagement de la CUD dans les
préoccupations de développement durable prend en compte au
niveau institutionnel la politique mise en place, le niveau d'organisation, le
degré de coopération et de démocratie participative, le
mode de financement et en fin le dispositif de résilience mis en
oeuvre.
La politique mise en place par la CUD connait peu à peu
un regain de faveur et tient globalement à un diagnostic dans le but
d'identifier et faire ressortir les actions et projet en vue de la promotion et
de la protection de l'environnement. D'un point de vue organisationnel,
l'engagement de la CUD dans les préoccupations de développement
urbain durable est récent et s'est principalement
matérialisé par la création de la Direction des
études de la planification urbaine et du Développement durable
(DEPPUD), muni d'un pôle Environnement et Développement durable.
Cette structure est l'organisme local en charge de l'environnement et du
développement durable, bien qu'il soit également en charge
d'autres missions détachées du cadre spécifique de
l'environnement et du développement durable. Le degré de
coopération et de démocratie participative y est très
mitigé. Hormis les Journées de Dialogue Publiques
organisées dans le cadre de l'élaboration de l'Agenda 21 locale,
les actions menées par la Communauté Urbaine pour informer tous
les acteurs urbains afin de favoriser leur participation sont dispersées
et sporadiques381(*). Le
mode de financement des projets est essentiellement basé sur les
financements classiques sur ressources budgétaires de la
Communauté. Cependant, la politique mise en place dans le cadre de
l'élaboration de l'Agenda 21 prévoit la mise en place
d'instruments de négociation avec les Partenaires de
développement pour la mobilisation des financements
spécifiquement dédiés à l'environnement et au
développement durable. En ce qui concerne la résilience, la Ville
de Douala a défini un ensemble d'actions et de projets, et a
procédé à l'élaboration de son Agenda 21 local,
composante de sa Stratégie de développement pour les 15
prochaines années, englobant ainsi l'élaboration d'autres
documents de planification à moyen et long terme à l'instar du
PDU (Plan Directeur Urbain), POS (Plan d'Occupation des Sols, et du SDAU
(Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme).
Le tableau ci-dessous présente l'échelle
d'engagement de la ville dans les préoccupations de développement
durable.
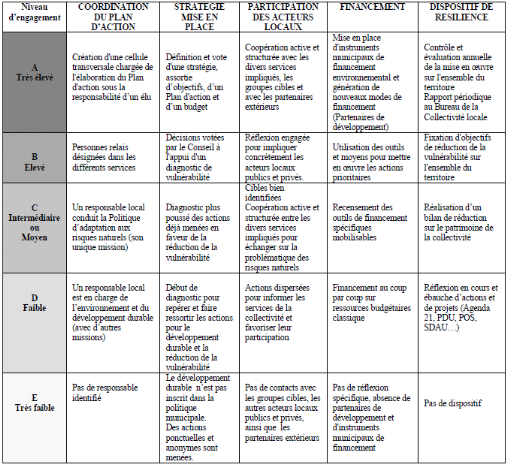
Tableau 1 : Echelle d'engagement de la CUD en
matière de développement durable.
Source : OLINGA OLINGA Joseph Magloire
En dépit de cette prise de conscience, que nous pouvons
qualifier d'avancée remarquable, l'engagement de la ville de Douala dans
les préoccupations environnementales correspond actuellement à un
niveau faible et au mode de réponse social qu'un auteur
définissait comme « l'acceptation de l'endommagement
». Car elle se produit lorsque le seuil de prise de conscience est
franchi et le mode de réponse se traduit par la recherche des palliatifs
parfois partiels aux dommages (opérations intempestives de curages,
profilage des lits des cours d'eau dans certains bassins versants...). Elle
s'exprime également par la mobilisation des communautés dans les
quartiers (Comité de quartiers, comité de développement,
comité d'hygiène et de salubrité...) pour la mise en place
des mesures de protection, parfois en collaboration avec les
Collectivité et d'autres organisations. Ce fût à titre
d'exemple le cas du projet « eau et assainissement » dans
quatre quartiers d'habitat sensible de la ville de Douala (Bepanda, Mabanda,
Nkololoun, Tractafric et Brazzaville), mené entre 2006 et 2009 par la
Communauté Urbaine de Douala en collaboration avec la GTZ et l'Union
Européenne avec les comités de développement des quartiers
concernés. L'on comprend le choix de la CUD porté sur des
programmes orientés et concertés.
B. Les programmes de développement durable
de la ville de Douala
Ces programmes viennent étayer les différents
projets déjà en cours dans la ville de Douala. Ils sont de divers
ordres :
Ø Renforcer les réseaux
d'assainissement.
A l'exception des réseaux d'assainissement construits
au début des années 80 à Douala-Nord et à la
Cité des Palmiers, la ville de Douala s'est développée
sans réseau d'assainissement des eaux usées appropriés. A
ce qui précède, s'ajoute une pluviométrie abondante qui,
faute d'ouvrages de drainage des eaux de pluies efficace contribue aux
fréquentes et récurrentes inondations observées dans la
ville, avec les conséquences hautement dommageables que l'on observe
notamment sur le patrimoine urbain. D'où la nécessité
d'entreprendre des projets en vue de remédier aux problèmes
rencontrés, notamment la réduction des inondations et la
réduction des maladies hydriques dans les quartiers d'habitat
précaires.
Des indicateurs permettent d'évaluer la
stratégie mise en place par la CUD pour assainir son réseau de
drainage. L'obstruction des caniveaux et de drains est la principale cause des
inondations. L'une des causes des inondations habituellement avancée
dans la ville de Douala est le sous dimensionnement des ouvrages de
franchissement et de drainage. Les enquêtes de terrain et les entretiens
avec le chef de service assainissement de la Communauté Urbaine de
Douala révèlent que les ouvrages aujourd'hui
considérés comme sous dimensionnés ne l'étaient pas
initialement, bien que certains présentent déjà des
sections insuffisantes382(*). Il va donc de soi que le curage du réseau
hydraulique de la ville de Douala, ou mieux leur redimensionnement serait un
meilleur moyen de diminuer les risques d'inondation. On pourrait se
réjouir du fait qu'en 2011, la CUD a lancé un avis appel d'offre
pour le curage et le calibrage de certains drains de la ville de
Douala383(*).
Malheureusement, pour des raisons budgétaires, le curage des drains et
des cours d'eau se fait à une fréquence très
irrégulière.
En outre, pour ce qui est de la réduction des maladies
hydriques, des efforts sont menées par la CUD pour la réduction
des risques potentiels d'épidémies par la mise en place des
latrines publiques, des fosses septiques et autres aménagement
d'assainissement dans les quartiers à fort risque de
promiscuité384(*). Ces efforts, étaientinitialement pour la
construction des latrines et fosses septiques respectant certaines normes. Mais
on note l'absence de ces fosses et latrines dans de nombreux quartiers de
Douala ; les populations se livrant à la construction
eux-mêmes des fosses et latrines en méconnaissance de certaines
règles. Ce qui aura un effet désastreux sur la santé,
notamment avec la pollution la nappe phréatique.
Quid de la gestion des déchets solides ?
Ø Améliorer la gestion des
déchets solides
En dépit des efforts entrepris pour gérer les
déchets solides de manière efficace, et rendre la ville plus
salubre, des progrès restent encore à faire dans ce domaine
sensible. Ces progrès sont indentifiables à partir de
l'état de la salubrité de la ville, et la diminution des risques
urbains.
En effet, afin de maintenir la ville de Douala à un
niveau de salubrité acceptable, la CUD s'est fortement engagée
dans la gestion des déchets solides et le nettoyage de la voirie. De
fait, la gestion des déchets est assurée dans la ville de Douala
par la société HYSACAM selon un contrat signé avec la
Communauté Urbaine de Douala385(*). Elle assure la collecte, le transport et la mise en
décharge. Selon HYSACAM, la production moyenne de déchets
ménagers est estimée à environ 600g/habitant/jour soit
plus 1300 tonnes/jour pour la ville de Douala. Mais ces déchets ne sont
pas collectés résolument. Car sur le volume produit, seulement
environ 500 tonnes sont collectées en raison du coût
élevé de cette activité386(*), de l'inaccessibilité de plusieurs quartiers,
et de l'absence du système de pré-collecte. La
pré-collecte consiste à collecter les déchets des
domiciles au lieu de dépôt agrée pour le transport final
vers les décharges. Elle est fonction de la distance domicile - point de
collecte. Plus cette distance est grande, moins les ménages y acheminent
leurs déchets. C'est ainsi que naissent des décharges sauvages.
Les causes sont nombreuses: l'insuffisance de moyens financiers de la CUD,
l'inaccessibilité de certains quartiers enclavés, l'incivisme, le
nombre limité camions collecte, l'absence de contrôle des
décharges et l'entreposage dans les rues avec dégagement
d'odeurs. Malgré l'amélioration de l'accessibilité qui a
contribué à renforcer la capacité de collecte des
déchets, celle-ci semble insuffisante. Et les facteurs
d'amélioration passent avant tout par une meilleure accessibilité
des quartiers.
Les ordures ménagères ne sont pas les seules
à poser problème : les déchets industriels (carcasses de
voiture, gravats de construction) représentent 250 tonnes de
déchets quotidiens produits à Douala (solides et boues)387(*). Ce type de déchet
peut être traité, pour les uns, si les établissements ont
une convention avec des sociétés de collecte de déchets
industriels. Pour les autres, on s'en débarrasse le long d'une ruelle,
loin des regards, ou pour les déchets industriels liquides, selon leur
valeur économique, on les recycle (hydrocarbures usagés qui
subissent un processus physiques ou chimiques en vue de leur recyclage en fuel)
ou on les déverse dans la nature (boues de peinture, d'acides). Pour les
déchets hospitaliers, ils ne sont pas traités à part.
Seuls les déchets produits par l'hôpital général
sont incinérés dans des appareils spéciaux.
Photo 01 : Dépôt sauvage d'ordures au
bord de la route au marché central à New-Bell.
Photo 02 : Dépôt sauvage d'ordures au
bord de la route à Nyalla Plateau

En outre, le manque de synergie d'action entre la CUD et les
CUAD dans l'identification et la gouvernance des projets urbains se
présente comme un obstacle à la gestion durable de la ville.
L'ambiguïté des relations entre ces acteurs contribue à
amenuiser l'efficacité de la gestion moderne des déchets, car les
communes d'arrondissement participent faiblement au suivi des actions d'HYSACAM
dans leurs territoires, en raison de la concentration des décisions en
la matière au niveau de la Communauté urbaine et de la faiblesse
des moyens à dispositions. D'où la montée de l'incivisme
écologique des populations caractérisée par le
déversement des déchets à même le sol, sur les
trottoirs, dans les drains et dans les caniveaux. Mais, est-ce vraiment de
l'incivisme ? Le dépôt d'ordures à même le sol,
sur les trottoirs, dans les drains et dans les caniveaux dans la ville de
Douala : un geste prémédité ou une simple pratique
imposée par la nécessité ?
Photo 03 : Dépôt sauvage d'ordures au
bord de la route à Bonamoussadi
Photo 04 : Dépôtd'ordures au bord de la
route à Deido

Il est clair que le dépôt des ordures en bordure
de la rue, les drains et dans les caniveaux quoiqu'en proportion
différenciée selon les types de « territoires de
salubrité urbaine », est assez
généralisé dans la ville de Douala388(*). Or, il est prévu
dans le cahier de charges des prestations accordées par la CUD à
HYSACAM, la sensibilisation des populations afin d'éviter les
dépôts d'ordures en bordure de rues. Car cette situation est
à l'origine de la dégradation de l'esthétique urbaine
comme en témoignent les photos ci-dessous.
Il est manifeste, à partir des photos ci-dessus, que le
dépôt d'ordures en bordure de la rue est une pratique
généralisé dans la ville de Douala. Malgré les
efforts qui sont déployé dans les quartiers comme Bonapriso ou
Bonamoussadi qui sont généralement pourvus de bacs à
ordures, mieux, qui bénéficient d'un traitement particulier en
termes de fréquence de collecte des ordures par le système de
porte à porte mis en place par HYSACAM389(*). Louis Bernard TCHOUIKOUA précisait en effet
qu'environ 9,49% de ménages déposent leurs ordures en bordure de
rues à Douala390(*). Ces geste n'est pour autant pas dénué
de toute signification. En effet, le choix volontaire de dépôt des
déchets en bordure de rues dans la quasi-totalité des quartiers
de Douala peut être perçu comme la traduction d'un
mécontentement ou d'une révolte sournoise des populations contre
certaines formes d'injustice socioéconomique391(*). Ce qui nous pousse à
penser que les pratiques de dépôts de déchets
ménagers en bordure de rues sont plus un acte
prémédité et conscient qu'une nécessité,
surtout dans les « territoires de salubrité
entretenue » (Bonapriso, Bonamoussadi, Deido ...) et dans certaines
zones des « territoires de salubrité
intermédiaire » (Bépanda, New Bell, Nyalla,
Oyack...).
En tout état de cause, les efforts de la
Communauté de Urbaine de Douala sont louables certes, cependant mais
beaucoup reste encore à faire pour faire de Douala une Ville dans
laquelle ne jonchent pas les déchets solides à tout coin de la
rue.
Qu'en est-il des espaces verts et loisirs ?
Ø Développer les espaces verts et
loisirs
La Ville de Douala s'est développée, dans un
contexte de minéralisation quasi généralisée de son
espace. Ainsi, le manque d'espaces de loisirs, de respiration et de
convivialité à la dimension de ses ambitions, constitue un
handicap majeur. Ces types d'espaces contribuant à la qualité de
vie, visent à améliorer l'attractivité de la ville et par
voie de conséquence, sa compétitivité. Ainsi, après
le nettoiement des rues, le curage des caniveaux et des drains, la collecte des
déchets, l'entretien des jardins publics et des espaces verts prend le
relais. En effet, les espaces verts qu'on croyait un tout petit peu à
l'abandon connaissent une attention particulière. En
témoignent : le rond-point IVème, « Feu
rouge Bessengue », la salle des fêtes d'Akwa, le marché
des fleurs, Bonassama et le jardin du cercle municipal. Avec cette
évolution, il n'est plus possible de penser Douala sans espaces de
loisir. Mais le seul problème qui se pose est le manque de personnel
pour l'entretien de ces espaces.
De tout ce qui précède, il ressort que plusieurs
facteurs sont à l'origine de la stagnation de l'action de la
Communauté Urbaine. Si nous avons pu relever le manque de personnels
pour l'entretien des espaces verts de la Communauté, l'on peut se
permettre de dire que cette question de personnel est cruciale à la CUD.
L'on constate un manque de personnel spécialisé dans le domaine
environnemental. Ainsi, bien que des bureaux spécialisés soient
créés au sein de cette institution, leurs occupants ne
comprennent pas toujours les attentes en matière d'environnement. Si en
2012, la CUD a procédé au renforcement de ses ressources humaines
en recrutant des jeunes diplômés camerounais, la question de la
spécialisation demeure, du moins en ce qui concerne la gestion de son
environnement.
En outre, l'absence de sanction pour dommage à
l'environnement, l'insuffisance des moyens contrôles,
l'inadéquation des politiques élaborées participent de la
fragilité de l'environnement urbain à Douala. Bien plus, la
pauvreté et ses conséquences, l'incivisme écologique, et
par tant l'ignorance du droit de l'environnement sont autant
d'éléments qui limitent l'action, mieux les résultats de
l'action de la CUD en matière d'environnement. Le constat parait donc
clair à ce niveau d'analyse : la faible effectivité du droit
de l'environnement à Douala. D'où la nécessité de
le promouvoir pour parvenir une meilleure protection.
SECTION 2. LES PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS
ENVISAGEABLES POUR UNE MEILLEURE ACTION DE LA CUD EN MATIERE
ENVIRONNEMENTALE
Les propositions d'améliorations que nous pouvons faire
dans le cadre de cette étude s'adressent d'une part au pouvoir central
(paragraphe 1) et d'autre part à la Communauté Urbaine de Douala
(paragraphe 2).
Paragraphe 1. Les recommandations à l'endroit du
pouvoir central
Compte tenu de la place qu'occupe l'administration centrale
dans l'élaboration des politiques nationales de protection de
l'environnement au Cameroun, et considérant le caractère
dispersé et non coordonné des instruments de protection de
l'environnement dans notre pays, nous lui recommandons de créer un cadre
institutionnel et fonctionnel favorable à la protection de
l'environnement par les Collectivités locales. Il s'agit ici tout
d'abord d'envisager la possibilité d'adapter les outils juridiques aux
nouvelles compétences des Collectivités locales au Cameroun (A).
Ensuite, il s'agit pour l'Etat de renforcer les outils financiers et
économiques des CTD (B).
A. L'adaptation des outils juridiques aux
nouvelles compétences des collectivités locales au Cameroun.
L'Etat devrait réaménager le cadre juridique
dans lequel se déploie les collectivités territoriales
décentralisées. Ainsi, l'ensemble des orientations
adoptées par une collectivité locale en matière de
protection de l'environnement devrait être intégré dans le
cadre d'un texte qui en fixe les objectifs. Il en est ainsi par exemple du code
des marchés publics, du code des investissements, qui doivent contenir
des exigences environnementales pour tout projet dans la
collectivité ; la seule Etude d'Impact n'étant plus
suffisante. Bien plus, l'État doit encourager l'introduction de
critères environnementaux dans le cahier de charges de la commande
publique et rendre obligatoire le critère de prise en compte des
exigences environnementales. La consolidation des outils financiers et
économiques n'étant pas en reste.
B. Le renforcement des outils financiers et
économiques des CTD au Cameroun.
Ce renforcement concerne surtout le pouvoir de tutelle. Le
pouvoir central doit créer des conditions financières et
économiques favorables à une meilleure protection de
l'environnement par les collectivités locales. La crise
financière de 2009 a considérablement limité la
capacité des collectivités locales à jouer un rôle
majeur dans le cadre de la protection de l'environnement et du
développement. Ainsi, nous recommandons au pouvoir central de faire
usage large du « Fonds National de l'Environnement et du
Développement Durable » qui a
pour objet d'encourager les initiatives locales en matière de protection
de l'environnement, et de développement durable et également de
soutenir et d'appuyer les projets de développement durable, la recherche
et l'éducation environnementale, les programmes de promotion des
technologies propres392(*). Les collectivités locales camerounaises
peuvent donc bien s'appuyer sur cette possibilité ouvertes par les
pouvoirs publics pour financer les projets liés à la protection
de l'environnement. Encore faudra-t-il dans l'interprétation de
l'article 4 du Décret fixant les modalités de gestion dudit
Fonds, qu'il soit possible d'attribuer « les projets de
développement durable » et les « initiatives
locales » aux collectivités locales ; afin de
permettre à celles-ci de surmonter leur besoin de financement.
Par ailleurs, nous lui recommandons de promouvoir l'emprunt
communal qui est un mode de financement, et qui reste l'une des réponses
appropriées à terme aux besoins d'investissement communaux
également sur le terrain de la protection de l'environnement.
Paragraphe 2. Les recommandations à l'endroit de
la CUD
Les recommandations que nous pouvons formuler à
l'endroit de la CUD concernent essentiellement le renforcement de ses outils
financiers et humains (A) d'une part, et le renforcement de l'éducation
et la démocratie environnementale (B) d'autre part.
A. Le renforcement des outils financiers et
humains de la collectivité
Pour que les objectifs de la CUD inscrits dans son CDS soient
atteints de façon optimale, il est opportun de revaloriser la dotation
budgétaire affectée à la protection de son environnement
et de développer une expertise locale.
Il est important pour la Ville de Douala, dans
l'élaboration de sa politique locale, de renforcer les dépenses
liées à l'environnement. La protection de l'environnement ne doit
pas être considérée comme un objectif subsidiaire, selon le
budget qui lui est affecté ; mais plutôt comme un objectif
essentiel compte tenu de son importance dans ce nouveau millénaire. Le
manque de moyens financier a très souvent justifié cet
état de chose.
Pour une meilleure efficacité, la CUD doit faire preuve
d'initiative. Elle doit envisager des activités
rémunératrices pour financer les dépenses relatives
à l'environnement. Ce sont des pratiques modernes393(*), conditionnées par le
dynamisme des élus locaux. La CUD peut par exemple, produire le compost,
le charbon organique etc..., et devenir dès lors un entrepreneur, et non
plus un simple gestionnaire.
En outre, les questions environnementales représentent
un enjeu majeur et stratégique qu'il est important de renforcer les
capacités des fonctionnaires municipaux responsables en la
matière, et de recruter des agents suffisamment outillés sur les
questions d'environnement et de développement durable. Ce qui limiterait
le recours à l'expertise extérieure qui coûte relativement
cher à la collectivité, et pourrait empiéter sur les
moyens mis en oeuvre pour l'éducation et la consolidation de la
démocratie environnementale.
B. Le renforcement de l'éducation et de la
démocratie environnementale
L'éducation et la sensibilisation à
l'environnement sont des facteurs clé de la prise de conscience des
enjeux planétaires (effet de serre, changement climatique, pollutions,
désertification, ...). Ils sont déterminants pour l'atteinte des
objectifs fixés par la Ville de Douala dans son CDS. Il est
nécessaire de renforcer cette éducation (1) qui favorise la
démocratie environnementale (2).
1) Le renforcement de l'éducation
environnementale
A titre de rappel, la Recommandation n° 96 de la
Déclaration de Stockholm de Juin 1972, précisait que
Les institutions des Nations Unies, notamment l'UNESCO, et
les institutions internationales concernées veilleront à prendre
les mesures nécessaires pour établir un programme englobant
plusieurs branches pratiques de l'éducation environnementale scolaire et
extrascolaire, et intéressant tous les niveaux d'enseignement et tous
les apprenants, dans le but de les informer des efforts qu'ils peuvent
entreprendre, dans les limites des moyens disponibles, en vue de la gestion des
questions de l'environnement et la préservation de celui-ci.
Après cette invite qui se voulait universelle,
plusieurs conférences ont été organisées ; les
plus importantes étant notamment la Conférence de Belgrade de
1975394(*) et la
Conférence de Tbilissi de 1977395(*). La conférence de Rio Janeiro de 1992
viendra réitérer l'intérêt de la
société internationale pour l'éducation environnementale.
L'article 36 de l'Agenda 21 met expressément l'accent sur le rôle
de l'éducation environnementale dans la sauvegarde de l'équilibre
écologique.
Il va de soi qu'au Cameroun, l'Etat maîtrise les aspects
législatifs relatifs à l'éducation à
l'environnement, propose des actions nationales, et fixe le cadre de la
formation. Son action est essentiellement pilotée par les
Ministères et leurs organes déconcentrés. Cependant,
cette action reste peu opérationnelle dans les collectivités
locales camerounaises, notamment dans la ville de Douala. Nous pensons que
l'exécutif communautaire pourrait, à son niveau, mettre un accent
sur cet aspect en mettant à disposition des établissements
scolaires primaires et secondaires des outils pédagogiques
nécessaires à l'éducation environnementale. S'il est vrai
que dans plusieurs établissements de la ville de Douala, on retrouve
déjà des « clubs environnement », il
est certain que ces clubs déplorent un manque criard d'outils essentiels
pour la réalisation de leurs objectifs.
En outre l'incivisme environnemental constaté dans la
ville de Douala se justifie assurément par la méconnaissance, ou
tout au mieux l'ignorance de la nécessité de garder un
environnement sain. Un effort supplémentaire est demandé à
la CUD pour renforcer les connaissances de ses populations sur les Principes de
Droit de l'environnement. La sensibilisation de proximité étant
le meilleur moyen.
En effet, s'il est à dessein pour la CUD de mettre
à la disposition des établissements scolaires des outils
pédagogiques (manuels, brochures et tous autres documents etc.) qui
permettraient aux élèves d'améliorer leurs connaissances
sur le Droit de l'environnement, et les enjeux environnementaux, le
procédé est tout à fait différent quand il s'agit
de la communication de masse.
Pour ce qui est du reste la population, nous proposons
à la communauté urbaine de renforcer ses outils de communication
sur les questions environnementales. Une sensibilisation efficace passe par une
bonne information. Ainsi pour une meilleure prise en compte des exigences
environnementales par les populations de la ville de Douala, la CUD a tout
intérêt à assurer une information continue pour garantir un
succès franc à leurs actions de sensibilisation. Plusieurs canaux
de communication devront donc être utilisés. A côté
des conférences de presse, des communiqués radios, des messages
sur banderoles et affichages, des bulletins d'information communaux qui n'ont
pas suffisamment fait leur preuve à ce jour, nous recommandons à
la CUD d'occuper davantage les tranches d'antennes dans les radios et
télés locales. Et que les horaires soient bien choisis pour
toucher un auditoire plus large. Par exemple, la CUD peut solliciter les
chaines de radios et télés qui ont le plus grand auditoire pour y
mener ses actions de sensibilisation. Nous pensons notamment à Canal
2 International, Equinox Télévision, LTM TV, Sweet FM, Radio
Balafon, RTM, Equinox Radio, Nostalgie FM. Des émissions peuvent
être menées entre 09h et 11h en matinée, et entre 19h et
21h en soirée. Nous proposons ces horaires parce que très
généralement c'est à ce moment que la grande partie de la
population écoute ou regarde la télévision.
En outre, en dehors de ces passages dans les radios et
télés que nous recommandons avec force à la
Communauté Urbaine, nous estimons également que, compte tenu de
la modernité des outils de publicité dans la ville de Douala, la
Communauté urbaine pourrait utiliser les écrans de
publicité disponibles dans les grands carrefours pour faire passer des
messages aux fins d'informer la population sur les enjeux majeurs de
l'environnement et la nécessité de le préserver, le but
étant d'éveiller les populations locales sur les questions
environnementales et de susciter en elles leur participation.
2) La consolidation de la démocratie
environnementale
Lorsque les populations sont assez
outillées sur les enjeux environnementaux, le processus pour leur
participation devient simplifié (réunions d'information, articles
dans le bulletin de la collectivité, expositions, mais aussi site
Internet, enquête ou « boîte à idées »). Un
processus d'appropriation apparaît, et les élus se sentent
confortés lorsqu'il leur faut parfois convaincre les quelques
administrés les moins respectueux de leur environnement.
Si une participation est présente dans la ville de
Douala sur les questions environnementales, il importe de la consolider en
créant ou en montrant l'intérêt qu'ont les populations
à s'intéresser à leur environnement. Par exemple, à
travers des messages d'information à la radio comme à la
télé, l'autorité communautaire peut susciter
l'adhésion. Si elle montre clairement l'intérêt qu'a la
population à prendre part aux consultations publiques lors d'une
étude d'impact, si elle montre l'intérêt qu'a un individu
ou un ménage de ne pas jeter les ordures dans la rue, si elle
éduque sur l'importance de la couche d'ozone etc..., il est clair que
les adhésions seront rapidement observées de la part de ces
populations. La démocratie participative se renforce de plus en plus.
Parvenu à ce niveau d'analyse, force est de constater
que la Communauté Urbaine de Douala a déployé des
stratégies assez ambitieuses pour la protection de environnement.
Cependant, les moyens dont elle dispose ne sont pas à la hauteur de ses
objectifs. Cette inadéquation moyens/objectifs peut se justifier
à travers l'insuffisance des ressources disponibles, d'une part et le
désintérêt de la population. C'est pourquoi nous estimons
que pour parvenir aux résultats escomptés, non seulement l'Etat
devrait réaménager les outils financiers et économiques
mis à la disposition de la collection, mais également, celle-ci
devrait faire preuve d'initiative entrepreneuriale en créant des
activités génératrices de revenus substantiels. Par
ailleurs, elle devrait mettre un accent particulier sur l'information et
l'éducation environnementale afin de s'assurer de la participation de
tous à la gestion de l'environnement.
CONCLUSION GENERALE
Parvenu au terme de cette étude, rappelons que notre
travail avait pour ambition de répondre à plusieurs
interrogations. D'abord, il voulait répondre à la question de la
place de la protection de l'environnement dans les attributions des
collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.
Ensuite, il voulait évaluer les politiques mises en oeuvre par les
collectivités locales pour assurer leurs missions environnementales.
En effet, s'agissant de la place accordée à la
protection de l'environnement dans les attributions des CTD au Cameroun, nos
développements nous ont permis de constater qu'elles occupent une place
essentielle sur les questions environnementales. A cet effet, dans le respect
de la réglementation elles élaborent librement des
stratégies qui lui permettent de remplir efficacement ses missions.C'est
pourquoi les collectivités territoriales décentralisées en
général et le Communauté Urbaine de Douala en particulier
assurent leur mission de protection de l'environnement au moyen de politiques
qu'elles élaborent et conformément aux normes en vigueur au
Cameroun.
Au terme de notre travail de vérification de cette
hypothèse, nous nous sommes rendu compte qu'effectivement, les
différentes lois sectorielles sur l'environnement n'évoquent pas
du tout, ou évoque assez limitativement les attributions des CTD. Au
niveau institutionnel, nous avons pu constater que bien que le pouvoir central
détient le monopole en matière d'élaboration des
politiques nationales de l'environnement, au niveau local, les
collectivités territoriales décentralisées sont plus que
des points focaux en ce qui concerne la protection de l'environnement.
Celles-ci sont aujourd'hui reconnues comme des nouveaux acteurs de la
scène internationale à travers cette nouvelle forme de
partenariat que l'on appelle la coopération décentralisée
pour le développement ou encore le jumelage-coopération.
L'on est fondé dès lors à croire que, de façon
informelle ou factuelle, les CTD au Cameroun disposent d'une place assez
déterminante dans la protection de l'environnement. Ce qui les pousse
à adopter des mesures à cette fin.
Par ailleurs, la Communauté Urbaine de Douala a
déployé des stratégies ambitieuses pour
l'amélioration de son environnement urbain. Les objectifs fixés
risquent de ne pas être atteints eu égard à de nombreuses
limitations constatées. A côté de l'insuffisance des moyens
économiques et humains s'ajoutent l'incivisme écologique des
citoyens. À notre avis, pour corriger ces limitations, il est important
pour la CUD et le pouvoir central de réaménager les outils
économiques et financiers de protection de l'environnement, et mettre un
accent particulier sur l'éducation environnementale.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
A. Ouvrages méthodologiques
1- BAUD (M.), L'art de la thèse, La
découverte, Paris, 2003.
2- BOURDIEU (P.), CHAMBEREDON (J. C.), PASSERON (J. C.),
Le métier de sociologue, Paris, Mouton, 2e
éd. 1973.
3- THOENIG (J. C.), Analyse des politiques publiques,
in (dir.) GRAWITZ (M.) et LECA (J.), Traité de Science
politique, Tome 4, PUF, Paris, 1985
4- TROGNON (A.), « Produire des données
» in BLANCHET (A.) et al.,Les Techniques d'enquête en
sciences sociales, Dunod, Paris, 1998.
B. Ouvrages collectifs et individuels
1- ABOYA ENDONG, (M.) « L'organisation des
grandes agglomérations camerounaises : Le cas de la ville de
Douala », in Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.),
La France Intercommunale - Regards sur la loi de réforme des
collectivités territoriales du 16 décembre 2010,
L'Harmattan, Paris, 2013.
2- AGLIN (S.), DUBRESSON (A.) (dir.), Pouvoirs et
cités d'Afrique Noire, décentralisations en questions,
Karthala, Paris, 1993.
3- AGULHON (M.) La république au village, les
populations de la révolution à la IIe
République. Paris, Seuil 1976, vol. 2.
4- BIAREZ (S.), Le pouvoir local, Paris,
Economia, 1990
5- CHAPUS (R.), Droit administratif
général, Montchrestien, Paris 1982
6- CORBIN (A.), Archaïsme et modernité en
Limousin au XIXe siècle, 1845-1880. Paris, Marcel
Rivière, 1975. Vol. 2.
7- FAVOUREU (L.), « Les bases constitutionnelles
du droit des collectivités locales », in MODERNE (F.)
(dir.), La nouvelle décentralisation, Paris, Sirey, 1983, pp.
24-26.
8- FIALAIRE (J.), Les stratégies du
développement durable, Paris, L'harmattan, 2008.
9- GENDREAU (F.), GUBRY (P.) et VERON (J.), « La
population et le défi de l'environnement durable », In
(sous la dir.) GENDREAU (F.), GUBRY (P.) et VERON (J.), Population et
Environnement dans les pays du sud, Ed Karthala, CEPED, 1996.
10- GONIDEC (P. F.), Les droits africains, Evolution et
sources, 2e éd., Paris, LGDJ, 1985.
11- GRANIER (L.), (coord), Aspect contemporains du droit
de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland Suisse
2008.
12- HOND (J. T.),« Etat des lieux de la
décentralisation territoriale au Cameroun » in Magloire ONDOA
(dir), L'administration publique camerounaise à l'heure des
réformes, L'Harmattan, Paris, 2010.
13- KAMTO (M.), « La mise en oeuvre et le suivi
du Droit International de l'Environnement », Rapport
introductif, in PRIEUR (M.) (dir.) La mise en oeuvre national du droit
international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des
troisièmes journées scientifiques du Réseau
« Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin
2001.
14- KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique,
Edicef/AUPELF, Paris, 1996.
15- KAMTO (M.), Pouvoir et droit en Afrique noire. Essai
sur les fondements du constitutionalisme dans les Etats d'Afrique noire
francophone, Paris, LGDJ, 1987.
16- KEOU TIANI (F.), Douala - Etat de l'environnement et
développement durable,L'Harmattan Cameroun, 2013.
17- KISS (A. C.), BEURRIER (J. P.), Droit international de
l'environnement, 4ème éd. Pédone, Paris
2010.
18- KOM TCHUENTE (B.), Développement communal et
gestion urbaine au Cameroun, les enjeux de la gestion municipale dans un
système décentralisé, Ed CLE, Yaoundé 1996.
19- LAMARQUE (J.), Droitde la protection de la nature et
de l'environnement, Paris, LGDJ, 1973.
20- LAVEILLE (J. M.), Le droit international de
l'environnement, Ellipses, Paris, 2001.
21- LAZAREV (G.), Vers un écodéveloppement
participatif, L'Harmattan/PNUD/FENU, Paris, 1993.
22- MILIBEAU (A.), Le système local en France,
Paris, Montchrestien, coll « clefs », 1992.
23- MINKOA SHE (A.), Droits de l'homme et droit
pénal au Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du
Droit en Afrique », 1999.
24- MONÉDIAIRE (G.), « Droit de
l'environnement et
participation », in SALLES (D.) (dir.)
et alii, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013.
25- MONJAL (P. Y.) et AUBELLE (V.) (dir.), La France
Intercommunale - Regards sur la loi de réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010, L'Harmattan, Paris, 2013.
26- MORAND-DEVILLER (J.), Le droit de
l'environnement, Paris, 2e éd, PUF, 2010.
27- MOUTONDO (E.M.), « Les lois cadres dans les
pays francophones d'Afrique», in GRANIER(L.), (coord), Aspect
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et
Centrale, UICN, Gland Suisse 2008.
28- MULLER (P.), Les Politiques Publiques, Paris,
2e Ed. Que-sais-je, 1994.
29- NGOH YOM (R.) et alii, Le Cameroun Municipal
2002-2007, Yaoundé, FEICOM, 2002.
30- NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit
International Public, LGDJ, 5e éd, Paris, 1994.
31- OTTO PFESMANN, FAVOREU (L.) (dir.), Droit des
libertés fondamentales, Dalloz, 4e éd. Paris
2007.
32- PETITEVILLE (F.), La coopération
décentralisée. Les collectivités locales dans la
coopération Nord-Sud, l'Harmattan, Paris 1995.
33- PRIEUR (M.) (sous la dir.), La mise en oeuvre du droit
international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des
troisièmes journées scientifiques du réseau
« Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, 2001.
34- PRIEUR (M.), Droit de l'environnement, Dalloz,
Paris, 2004.
35- SANDS (Ph.), Principles of international environmental
law. Manchester University Press, Manchester, New York, vol. 1, Framework,
standards and implementation, 1995.
36- SIME (R. N.), « L'intégration et
l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le
droit africain », in GRANIER (L.), (coord), Aspect
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et
Centrale, UICN, Gland Suisse 2008.
37- TIANI KEOU (F.), Douala : Etat de l'environnement
et du Développement Durable, L'Harmattan, Paris, 2013.
38- ZAKANE (V.) « Problématique de
l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du
Burkina-Faso » In Laurent GRANIER (coord.), Aspects
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et
centrale, UICN, Gland, Suisse 2008.
II. Dictionnaires et Lexiques
1- CORNU (G.), Dictionnaire Juridique, Paris, PUF,
8e éd. Fév. 2000.
2- Dictionnaire Larousse, encyclopédie 2000, Paris,
1999.
3- GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.) (dir.), Lexique des
termes juridiques, 13e éd, Dalloz, Paris, 2001.
4- Petit Larousse, Grand format, 1989.
5- REY-DEBOVE (J.) & REY (A.), Le petit dictionnaire
de la langue française, 2006.
III. Thèses et Mémoires
A. Thèses
1- CHIKHAOUI (L.), Le financement de la protection de
l'environnement, Thèse, Université de Paris I, 1996.
2- KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), Recherche sur l'autonomie
des collectivités territoriales décentralisées au
Cameroun, Thèse, FSJP-Université de Douala, Douala, 2013.
3- MVELLE MINFENDA (G.), Aide au développement et
coopération décentralisée. Esquisse de
désétatisation de l'aide française : Le cas du
Cameroun, du Congo et Gabon - RDC - Rwanda, Thèse de Doctorat en
Science politique, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2005.
4- NGO EKOUMOU (A. M.), Une nouvelle forme de relation
Nord/Sud : la coopération entre les collectivités locales
françaises et les collectivités locales africaines (la
coopération décentralisée), 1982-1990, Thèse
de doctorat 3ème cycle en Relations internationales, IRIC,
1994.
5- NGO TONG (C. M.), Intercommunalité,
coopération décentralisée et stratégies de lutte
contre la pauvreté au Cameroun.Etude spécifique des
villes de limbe et Kribi et de la communede Dschang. Thèse de
doctorat, Université de Nantes, Nantes, juin 2012.
6- TCHUIKOUA (L.B.), Gestion des déchets solides
ménagers à Douala au Cameroun : opportunité ou menace pour
l'environnement et la population ? Thèse de Doctorat,
Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3, Bordeaux, 2010.
7- VANDERVORST (A.), La conditionnalité
écologique dans les organisations financières internationales,
Thèse de Doctorat, Rouen, 1999.
B. Mémoires
1- AOUSTIN (T.), La participation du public aux plans et
programmes relatifs à l'environnement, Mémoire de DEA,
Université de Limoges, Limoges, 2004.
2- BASSAMAGNE MOUGNOK (C.), La coopération
décentralisée entre la France et le Cameroun : un
véritable partenariat ? Mémoire de Master II en Science
Politique, Université de Yaoundé II-SOA, Yaoundé,
2006.
3- BLANC (S.), La coopération
décentralisée : un acteur émergent dans l'aide publique au
développement des pays du Sud, Exemples de collectivités locales
Françaises et Sénégalaises, Région de Midi
Pyrénées/ région de Thiès ; Département de
la Dordogne / commune de Sokone ; Commune de Bon encontre / île de
Karabane, Mémoire de Master I en Géographie et
Aménagement du Territoire, Université de Toulouse Le Miral, Juin
2008.
4- EDOUA BILONGO (B.), La répartition des
compétences entre l'Etat et les communes, Mémoire de DEA de
Droit Public, FSJP/UY II Soa, Yaoundé, Année académique
2006-2007.
5- KOUAM TEAM (G.L.), La participation des
collectivités territoriales décentralisées à
la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France,
Mémoire deMaster Droit International et Compare de l'environnement,
Université de Limoges, Limoges, Aout 2010.
6- KUIATE BOBNGWI (C.), Les Enjeux de l'émission
obligataire par les collectivités territoriales
décentralisée : le cas de la Communauté Urbaine de
Douala, DESS, IRIC/UY2, 2006.
7- LESART (S.), Les réseaux de coopération
décentralisée et la mobilisation des acteurs : l'exemple
alsacien, Mémoire de 4e année d'IEP, Strasbourg,
Juin 2008.
8- LUBAC (J. C.), Recherche sur les problèmes
juridiques de la coopération internationale des collectivités
territoriales, Thèse de Doctorat en droit public, Université
de Toulouse 1 et de Sciences sociales, Toulouse, 2005.
9- MATCHIUM KOUAGNE (C.F.), La protection Juridique de
l'environnement au Cameroun et en France : le cas des nuisances
sonores, Mémoire de Master 2, Université de Limoges,
Septembre 2009.
10- NGAMALIEU NJIADEU (A.), La protection de
l'environnement marin au Cameroun: contribution à l'étude
de la mise en oeuvre des conventions internationales,
Mémoire deDEA Droit public, FSJP-Université de Douala,
Douala, 2005.
11- NGWANZA OWONO(J.),La mise en oeuvre de la
convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques au Cameroun:
cas du mécanisme pour un développement propre,
Mémoire de Master Droits de l'homme et action humanitaire,
Université catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, 2008
12- PEGUI (Y. F.), Gouvernance locale et
attractivité territoriale des entreprises : cas de la Ville de Douala,
Mémoire de Master II recherche en Sciences économiques, option
économie du territoire, de l'environnement et de la
décentralisation, Université de Yaoundé II - Soa,
Yaoundé 2012.
13- PONGUI (B. S.), Les défis du Droit
international de l'environnement, Mémoire de Master II,
Université de Limoges, Limoges, 2007.
IV. Actes de Colloques
1- BOMBA (C. M.), « Environnement et
développement urbain au Cameroun » in PRIEUR (M.),
Vers un droit de l'environnement Urbain : Actes de la
2e journée scientifique du « Réseau Droit
de l'environnement » de l'AUPELF-UREFà l'Université
Cheikh AntaDiop, Sénégal Dakar, octobre 1996.
2- DASSE (P.), « Cameroun : La mise en
oeuvre du droit international de l'environnement dans le secteur marin et
littoral » Rapports nationaux,, in Michel PRIEUR
(dir.), La mise en oeuvre national du droit international de
l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes
journées scientifiques du Réseau « Droit de
l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001.
3- DE BEIR (J.), DESCHANET (E.), FODH (M.), La politique
environnementale française : une analyse économique de la
répartition de ses instruments du niveau global au niveau local. 25
et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes Journées d'Etudes du Pôle
Européen Jean MONNET. Disponible sur
http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf
4- KAMTO (M.), « La mise en oeuvre et le suivi
du Droit International de l'Environnement », Rapport introductif
, in PRIEUR (M.) (dir.) La mise en oeuvre national du droit international
de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes
journées scientifiques du Réseau « Droit de
l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001.
5- KAMTO (M.), « Le droit camerounais de
l'environnement, entre l'être et le non être »
Rapport introductif au colloque international organisé du 29 au 30 avril
1992 à Yaoundé par le CERDIE sur le thème
« Droit et politique de l'environnement au
Cameroun ». Disponible sur
http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm
6- KISS (A. C.), La mise en oeuvre du droit à
l'environnement, problématique et moyens, 2e
conférence européenne « Environnement et droits de
l'homme », Salzbourg, 3 déc. 1980 (Institut pour une
politique européenne de l'environnement).
7- NICOLAS (St.) « Belgique »
Bilan et évolution des droits nationaux, in PRIEUR (M.)
(préf.) Vers un nouveau droit de l'environnement ?,
Réunion mondiale des juristes et associations de droit de
l'environnement, Université de Limoges.
8- PRIEUR (M.) (Sous la dir.), La mise en oeuvre du droit
international de l'environnement dans les pays francophones, Acte des
troisièmes journées scientifiques du réseau
« Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, 2001.
9- PRIEUR (M.), Réunion constitutive du
Comité de l'environnement de l'AHJUCAF, « Rapport
introductif », Actes du Colloque de Porto-Novo, Benin, Juin 2008.
V. Rapports d'études
1- ANNAN (K.) : « Pour un véritable
partenariat mondial », Rapport annuel sur l'activité de
l'organisation (ONU), 1998.
2- Comité directeur des autorités locales (CDLR)
et recommandation du Comité des Ministres,
« L'environnement et les collectivités locales et
régionales », Communes et Régions d'Europe,
n°60, Editions Conseil de l'Europe.
3- CUD, Stratégie de développement de la
ville Douala et de son aire métropolitaine, Rapport final,
Décembre 2009.
4- Division statistique de l'ONU, « Rapport
Final », Atelier sur les statistiques de l'environnement,
Yaoundé, Décembre 2011.
5- FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.) : « Les
acteurs environnementaux au Cameroun : états des lieux »,
Yaoundé, GTZ/MINEF, octobre 2000.
6- Global Contact/Global Reporting Initiative, Communication
on Progress, « La responsabilité corporative du CCC sur
les conditions de travail, la protection de l'environnement, la transparence
et la lutte anti-corruption », décembre 2006.
7- MINEP/PNUD, Révision/opérationnalisation
du PNGE vers un programme environnement (PE) : Diagnostic de la situation
de l'environnement au Cameroun, Volume I, février 2009
8- Rapport n°01/MMGC/RP/DIVCOM/2014,
Séminaire régional sur le thème :
«Villes d'Afrique centrale et changement climatique »
Organisé par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) Avec l'appui
de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Juin 2014).
9- République du Cameroun / MINATD 2008
« Etude diagnostic des communautés urbaines de Douala et
Yaoundé », Rapport final, Cameroun, Mai - Juin 2007.
10- République du Cameroun/Commission
européenne, Profil environnemental du Cameroun, Rapport
Provisoire, Mars 2004.
11- République du Cameroun/Communauté Urbaine de
Douala, Stratégie de développement de la ville de Douala et
de son aire métropolitain, Décembre 2009.
12- SANTUS (A.S.) (dir), « Coopération
décentralisée et intercommunalités ».
Ministères des Affaires Etrangères / Commission Nationale de la
coopération décentralisée, 2003
13- Stratégie et Plan d'Action National pour la
Biodiversité. République du Cameroun 2012, Stratégie
et Plan d'Action National pour la Biodiversité - Version II 2012 -
MINEPDED
VI. Revues
1- AFFONSE LEME (M. P.), « L'environnement dans
la Constitution brésilienne », Les Cahiers du Conseil
Constitutionnel n° 15, 2003
2- BOISSON de CHAZOURNES (L.), « La mise
en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de
l'environnement : enjeux et défis », RGDIP,
99/1995/1, p. 60
3- BOUDINE (J.), « La distinction entre
collectivité locale et collectivité territoriale (variations
sémantique ou juridique ?) », RDP/LGDJ, 1992, pp.
171-199
4- CAPITANI (A.), « La charte de
l'environnement : une leurre constitutionnelle », RFDC
n°63, 2005, pp. 494-516.
5- CARTON (O.), « De l'inutilité d'une
constitutionnalisation du droit de l'environnement », LPA 2,
Septembre 2005
6- CHERON (M.), « Les collectivités
territoriales se sont donné rendez-vous à
Copenhague », 11 décembre 2009. Disponible sur
http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf
7- CHOMBARD-GAUDIN (C.), « Pour une histoire des
villes et communes jumelées », in Revue d'histoire n° 35,
XXe siècle, juillet-septembre 1992, pp. 60-66
8- COLLANGE-POTRON (E.), « Grenelle de
l'Environnement : quels rôles pour les
collectivités ? » Disponible sur
http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html
9- DEMAZIÈRE (Ch.)
« L'action économique locale et l'environnement. Les
collectivités locales prennent-elles en compte les contraintes et
opportunités qu'offrent les ressources naturelles pour l'économie
d'un territoire ? », Développement durable et
territoires. Disponible sur
http://developpementdurable.revues.org/894
10- DOUBE BILLE (St.) Les moyens de mise en oeuvre du
droit de l'environnement, in « Evolution des institutions de
mise en oeuvre du droit de l'environnement et du
développement » RJE 1993
11- DOUMBE BILLE (S.), « L'Agenda 21 et le cadre
institutionnel »,RJE, 1994.
12- DOUMBE BILLE (St.), « Evolution des
institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit international de
l'environnement et du développement », RJE, 1993/1
13- DOUME MBILLE (St.), « Constitution et Droit
de l'environnement », AIDC, vol 9, 1999.
14- DUPUY (P.M.), « Où en est le droit
international de l'environnement à la fin du
siècle ? » RGDIP, T. 101, 1997.
15- GIBBINS (R.), « La gouvernance locale dans
les systèmes politiques fédéraux », Revue
Internationale des Sciences Sociales, 2001/01 n° 107.
16- HUGLO (Ch.) « Environnement et Droit de
l'environnement »,Jurisclasseur Environnement,1992, Fascicule.
101.
17- KREMLIS (G.) : « La communauté
Européenne : partenaire international de la protection de
l'environnement », REDE, 1997/1.
18- LE LOUARN (P.), « Le principe de
participation et le droit de l'environnement», Revue Droit de
l'environnement, n°90juillet/août 2001.
19- LE GALES (P.), « Du gouvernement des villes
à la gouvernance urbaine », RFSP n° 1, 1995.
20- MALJEAN DUBOIS (S.), « La mise en oeuvre du
droit international de l'environnement », notes de l'IDDRI,
n° 4, 2003.
21- MBARA GUERANDI (G.),
« Décentralisation participative et gouvernance
spatiolocale au Cameroun » CJDHR vol.2 N° 2,
Décembre 2008.
22- MENGANG MEWONDO (J.), « La conservation des
écosystèmes et la biodiversité au Cameroun »,
Moabi n° 8, juin 1999.
23- MORAND-DEVILLER (J.), « Les réformes
apportées au droit des associations et de la participation
publique », RFDA, 1996-2.
24- MOUANGUE KOBILA (J.), « Le préambule
du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : De l'enseigne
décorative à l'étalage
utilitaire »,LexLata, n° 23-24, févr.-mars 1996.
25- N'DOMBI (C.) : « Le rôle des ONG
dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du
Sud », RJPIC n°2, 1994.
26- NGAMBA TCHAPDA (H.),
« Décentralisation et renforcement de la gestion
urbaine au Cameroun: collecte différenciée des ordures
ménagères à douala ». PDF disponible sur
http://www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.doc
27- NGUINGUIRI (J. C.), « Les approches
participatives dans la gestion des écosystèmes forestiers
d'Afrique centrale », CIFOR, OccasionalPaper n° 23, Juillet
1999
28- ORLIANGE (Ph.), « La Commission du
développement durable ». AFDI, vol. 39, 1993.
29- Pascal METZGER, « Contribution à une
problématique de l'environnement urbain », Cahier de
Sciences Humaines, 30 (4) 1994.
30- PRIEUR (M.), « La Convention d'Aarhus,
instrument universel de la démocratie environnementale »,
RJE., n° spécial, 1999.
31- PRIEUR (M.), « Démocratie et Droit de
l'Environnement et du Développement », RJE, 1993.
32- PRIEUR (M.), « L'environnement est
entré dans la Constitution », RJE, n° spécial
2005.
33- PRIEUR (M.), « Le droit à
l'environnement et les citoyens : la participation », RJE,
1988-4.
34- ROUSSEL (I.), « Les collectivités
locales et le changement climatique » 2007. Disponible sur
http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repertoire/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Roussel.pdf
35- SIOUTIS GLYKENIA, « Le droit de l'homme
à l'environnement en Grèce », RJE n°4,
1994.
36- VANDERVORST(A.), « Contenu et porté
du concept de conditionnalité environnementale : Vers un nouvel
instrument au service du droit de la protection de l'environnement en
Afrique ? », Revue d'étude et de recherche sur le
droit et l'administration dans les pays d'Afrique,
Université Montesquieu - Bordeaux,
septembre 2001, disponible sur
http://afrilex.u-bordeaux4.fr/contenu-et-portee-du-concept-de.html
37- YMELE (J. M.) « Les voies
camerounaises vers une meilleure gestion des déchets », Revue
SPD (Secteur Privé & Développement), n°15.
VII. Textes de Loi
1- Arrêté N°01/CUD/2010 du 22 janvier 2010,
portant organisation des services de la Communauté Urbaine de Douala.
2- Constitution de la Finlande, du 11 juin 1999 entrée
en vigueur le 01er mars 2000
3- Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001
portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel
de l'environnement
4- Décret n° 2004/320 du 8 décembre
2004portant organisation du gouvernement et repris à l'article
5- Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation MINEP.
6- Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006
modifiant et complétant certaines dispositions
7- Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant
les modalités de la coopération décentralisée
8- Décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant
les modalités de la coopération décentralisée.
9- Décret n° 2013/0171/PM du 14 février
2013 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental et social.
10- Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004
portant organisation du gouvernement.
11- Décret n°2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature
12- Décret n°2011/408 du 09 décembre 2011
portant organisation du gouvernement
13- Décret n°2012/431 du 01er octobre
2012 portant organisation du MINEPDED
14- Décret no 87/1366, du 24 septembre
1987 portant création de la
commune urbaine de Douala
15- Décret n°2008/064/PM, du 4 février 2008,
fixant les modalités de gestion de Fonds national pour l'Environnement
et le Développement Durable
16- La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement
17- Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 qui
régit les organisations non gouvernementales au Cameroun
18- Loi n° 99/014 du 22 décembre 1999
régissant les organisations non gouvernementales au Cameroun
19- Loi n°2004/017 du 04 juillet 2004 portant Loi
d'orientation de la décentralisation au Cameroun.
20- Loi n°2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les
règles applicables aux communes
21- Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972
22- Loi n°96/12 du 05 Août 1996 portant Loi-cadre
Relative à la gestion de l'environnement
VIII. Textes internationaux
1- Charte mondiale de la nature, du 28 octobre 1982
2- Charte mondiale de la nature, du le 28 octobre
1982
3- Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, juin
1981
4- Convention africaine sur les réserves naturelles,
l'environnement et le développement, du 11 juillet 2003
5- Convention américaine relative aux droits de l'homme
traitant des droits économiques et culturels adopté à San
Francisco, du 17 novembre 1988
6- Convention d'Aarhus
7- Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontaliers et la question des déchets dangereux produits en
Afrique, 30 Janvier 1991
8- Convention de Rio sur la diversité biologique, juin
1992
9- Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la
désertification du 17 juin 1994
10- Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972
11- Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, du 26 août 1789
12- Déclaration de Brazzaville du 30 mai 1996
13- Déclaration de Rio de 1992
14- Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999
15- Déclaration des Droits de l'Homme et des Peuples,
du 10 décembre 1948
16- Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, du 27 juin 1984
17- Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, du 27 juin 1984
18- Plan d'Action 21
19- Plan d'Action de Vancouver de 1976
IX. Jurisprudence
1- CC n° 85-196 DC, Rec 63 ; RJC i-238, Evolution de
la Nouvelle-Calédonie, 8 et 23 Août 1985.
2- CC n° 91-290 DC, Rec 50 ; RJI i-438, Statut de la
Corse, 9 mai 1991.
3- CIJ, affaire de licéité de la menace ou
l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, Recueil 1996.
4- CIJ, Affaire GabcikovoNagymaros. du 25 septembre
1997.
5- Directives de l'Union Européenne
n°s2003/4/CE et 2003/35/CE, respectivement du 28 janvier et du 26
mai 2003.
6- Résolution 2997 (XXVII), Dispositions
institutionnelles et financières concernant la coopération
internationale dans le domaine de l'environnement.
X. Cours et séminaires
1- ABOYA ENDONG (M.) « Séminaire
demondialisation et communautarismes internationaux », Master II
Recherche Science politique, option Etudes internationales,
FSJP-Université de Douala, année académique 2012/2013,
Inédit.
2- DONFACK SOKENG (L.),
« L'intercommunalité et coopération
décentralisée », Séminaire de formation
à l'attention des Préfets, Kribi, juillet 2010,
Inédit.
3- KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Doit de la coopération
décentralisée, Cours de mater II Doit public,
FSJP-Université de Dschang, Année académique 2009-2010,
Inédit.
4- ONDOA (M.), Séminaire de méthodologie de
la recherche, DEA de Droit Public Fondamental, FSJP/UYII-Soa, Année
académique 2009/2010, Inédit.
5- OWONA (J.), Séminaire sur la
décentralisation camerounaise : les collectivités
territoriales décentralisées, DEA Droit public, FSJP-UY II
Soa, Année académique 2009-2010, Inédit.
6- PRIEUR (M.), Les principes généraux du
droit de l'environnement. Cours de Droit international et comparé
de l'environnement, Université de Limoges. Disponible sur
http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246
7- TCHALA ABIMA (F.), Participation des différentes
parties prenantes dans la gestion des ressources naturelles au Cameroun,
Séminaire sur la gestion communautaire des ressources naturelle
organisé par l'IUNC, Aout 2012.
XI. Sites internet
http://afrilex.u-bordeaux4.fr/contenu-et-portee-du-concept-de.html
http://bocam.populus.org/
http://developpementdurable.revues.org/894
http://ecovilles.fr/wp/2011/08/la-ville-durable-quelles-definitions
http://fr.wikipedia.org/wiki
http://gaston.lema.arch.ulg.ac.be/urba/cours/durabilite/02-enjeux/Metzger.pdf
http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf
http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repertoire/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Roussel.pdf
http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf
http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html
http://www.cairn.info
http://www.cameroon-tribune.cm/
http://www.cidce.org/publications/sommaire%20rio.htm
http://www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.doc
http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm,
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ville_durable_CRDD_01-2011.pdf
http://www.dicopart.fr/fr/dico/droit-de-lenvironnement-et-participation
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Intercommunalites.pdf
http://www.douala-city.org
http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246.
http://www.fctvcameroun.org/profiles/blogs/quartier-precaires-de-la-ville-de-douala
http://www.google.cm/
http://www.institut-gouvernance.org/docs/note1-irg.pdf
http://www.lesbrasseriesducameroun.com/?q=environnement,
http://www.memoireonline.com
http://www.minep.gov.cm
http://www.proparco.fr
http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4067,
http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml,
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/
http://www-wds.worldbank.org
* 1 KISS (A. C.), BEURRIER
(J. P.), Droit international de l'environnement,
4ème éd. Pedone, Paris 2010, p. 18
* 2Ibid. p.19
* 3 KAMTO (M.), Droit de
l'environnement en Afrique, Paris, Edicef/AUPELF, 1996, p.15
* 4 Voir sur la
« glocalisation »des enjeux planétaires les
développements du Professeur ABOYA ENDONG (M.) «
Séminaire demondialisation et communautarismes
internationaux», Master II Recherche Science politique, option Etudes
internationales, FSJP-Université de Douala, année
académique 2012/2013, Inédit
* 5 Arrêt C.I.J du 25
septembre 1997, § 57, Affaire GabcikovoNagymaros.
* 6 V. Principe 23 de la
Déclaration des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 1992
* 7 KAMTO (M), op. cit.
p. 17
* 8 Le droit à
l'environnement apparait pour la première fois au plan international
avec la Déclaration de Stockholm de 1972 dont le principe 1'affirme que
« L'homme a un droit fondamental à la liberté,
à l'égalité et à des conditions de vie
satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de
vivre dans la dignité et le bien-être (...) ».
* 9 La première
formulation expresse du droit à l'environnement est de la Charte
Africaine des Droits de l'homme et des peuples de 1981. Son article 24 proclame
que « Tous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant global et propice à leur développement ».
Même si le protocole additionnel à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits
économiques et culturels adopté à San Francisco le 17
novembre 1988 apporte des précisions complémentaires, inspirant
par la même le constituant camerounais de 1996, la Convention africaine
sur les réserves naturelles, l'environnement et le développement
signée le 11 juillet 2003 à Maputo est l'instrument international
le plus complet à ce point de vue. Elle promet en effet
« le droit de tous les peuples à un environnement
satisfaisant qui favorise leur développement ».
* 10 KISS (A. C.), BEURRIER
(J. P.), op. cit. p. 19
* 11 MORAND-DEVILLER (J.),
Le droit de l'environnement, Paris, 2e éd, PUF,
2010, p. 14
* 12C'est de la
Conférence de Rio qu'est issu le concept
d'écodéveloppement, concept éclipsé depuis
par celui de développement durable, ancré dans le
Rapport « Our Common future » de la Commission des
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de 1987,
présidée par Gro Harlem Brundtland. Selon ce Rapport,
« le développement durable (...) c'est un
développement qui satisfait les besoins du présent sans risquer
que les besoins des générations futures ne puissent plus
être satisfaits ».
* 13 MORAND-DEVILLER (J.),
op. cit. p. 4. Au sens du Principe 4 de la Déclaration de Rio,
« pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être considérée
isolément ».
* 14 Ce concept a
été forgé dans le cadre des Nations Unies pour tenter de
réconcilier les points de vue divergents des pays industrialisés
et des pays en développant l'importance à accorder à la
préoccupation environnementale dans leurs politiques économiques
respectives. Non sans équivoques, il désigne en premier lieu une
vision intégrée des exigences de protection environnementale et
de développement économique, telle qu'elle est
énoncé au Principe 4 de la Déclaration de Rio (Voir note
13). Selon le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement intitulé « Our Common
future » (1987), il vise également à rendre
compatible la satisfaction des besoins du présent,
particulièrement dans les pays pauvres, avec celles des
intérêts des générations futures (Voir principe 3
Déclaration de Rio). Il implique à terme une adaptation des
méthodes, sinon, en bien des cas, de l'idéologie sous-jacente
à la gestion rationnelle d'un Etat moderne, respectant en particulier
l'expression des préoccupations et des choix des populations
concernés par les politiques économiques et environnementales de
chaque Etat et l'utilisation équitable des ressources naturelles
partagées, qui retrouve ici une signification encore élargie. Il
est exact que les mérites diplomatiques comme les faiblesses techniques
de cette notion tiennent précisément à son extrême
généralité comme aux frontières imprécises
sensées l'embrasser sans trop la définir. Il faut donc la prendre
non comme un principe à la signification univoque, mais comme une
matrice conceptuelle définissant la perspective générale
dans laquelle les principes déjà établis de la bonne
gestion de l'environnement doivent être restitués. Voir DUPUY
(P.M.), « Où en est le droit international de
l'environnement à la fin du siècle ? » RGDIP,
T. 101, 1997, p.886
* 15 V. Préambule de
la Constitution du 18 janvier 1996. Voir aussi Art 2, de la Loi n°1996/12
du 05 Aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 16 V. article 2(2) de la
Loi n°2004/017 du 04 juillet 2004 portant Loi d'orientation de la
décentralisation au Cameroun.
* 17 V. article 4(1) de la
loi n°2004/017 précité.
* 18 Le sénat n'est
mis en place au Cameroun que depuis Juin 2013
* 19 V. Principe 1 de la
déclaration de Stockholm.
* 20 BOURDIEU (P.),
CHAMBEREDON (J. C.), PASSERON (J. C.), Le métier de sociologue,
Paris, Mouton, 2e éd. 1973, p. 54
* 21 SINDJOUN (L.),
L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case vide ; cité par
KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), Recherche sur l'autonomie des
collectivités territoriales décentralisées au
Cameroun, Thèse, FSJP-Université de Douala, Douala, 2013, p.
24
* 22 MORAND-DEVILLER (J),
op. cit. p. 6
* 23 HUGLO (CH.)
« Environnement et Droit de
l'environnement »,Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule.
101, p.2.
* 24 GENDREAU (F.), GUBRY
(P.) et VERON (J.), « La population et le défi de
l'environnement durable », In (sous la dir.) GENDREAU (F.),
GUBRY (P.) et VERON (J.), Population et Environnement dans les pays du sud,
Ed Karthala, CEPED, 1996, p.19
* 25 La nature est un
concept vague qui signifie de façon générale tout ce qui
est né ou tout ce qui donne naissance. (HUGLO (CH.)
« Environnement et Droit de
l'environnement »,Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule.
101, p.2). La protection de la nature vise donc en réalité
à conserver le milieu naturel en son état primitif.
* 26 En ce qui concerne, le
concept de la qualité de la vie, Jean LAMARQUE considère dans une
tentative de définition que « la qualité de la vie
ne peut constituer que le vague fondement moral de la protection de
l'environnement, elle ne peut être objet de droit ».
(LAMARQUE (J.), Droitde la protection de la nature et de
l'environnement, Paris, LGDJ, 1973). En outre le concept de
qualité de vie est en lui-même difficilement traduisible
en droit positif ; il est l'origine d'un vaste mouvement d'idée
ayant conduit les pouvoirs publics à prendre de plus en plus en
considération les finalités qualitatives dans
l'aménagement de l'espace tant rural qu'urbain. (MORAND-DEVILLER (J),
Op. cit. p. 67).
* 27 La notion
d'écologie est beaucoup plus précise. Le terme écologie
vient de deux vocables grecs signifiant l'un la maison l'autre la science, il
semble avoir été utilisé pour la première fois par
le biologiste allemand Ernest Haeckel en 1866 « l'écologie
c'est la connaissance de l'économie de la nature, l'investigation de
toute les relations d'un animal à la fois avec son milieu
inorganique et organique incluant par-dessus tout ses relations amicales et
antagonistes avec ceux des animaux et des plantes avec lesquels, il entre
directement en contact ». (Ernest HAECKEL, cité par HUGLO
(CH.) « Environnement et Droit de l'environnement »,
p. 2)
* 28 KISS (A. C.), BEURRIER
(J. P.), Droit international de l'environnement,
4ème éd. Pedone, Paris 2010, pp. 18-19
* 29 REY-DEBOVE (J.) &
REY (A.), Le petit dictionnaire de la langue française, 2006, p.
914
* 30 CORNU
(G.), op cit p. 342
* 31 V. article 4(k), Loi
n°96/12 du 05 Aout 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 32 V. Principe 2 de la
Déclaration de Stockholm.
* 33 V. affaire de
licéité de la menace ou l'emploi d'armes nucléaires,
Avis consultatif, CIJ, Recueil 1996 pp. 241-242 paragraphe 29
* 34 KAMTO (M.), op
cit, p. 16
* 35Ibid.
* 36 Dictionnaire Larousse,
encyclopédie 2000, Paris, 1999, p.1278
* 37 CORNU (G.),
Dictionnaire Juridique, Paris, PUF, 8e éd.
Fév. 2000, p. 628
* 38 MENGANG MEWONDO
(J.) : « La conservation des écosystèmes et la
biodiversité au Cameroun », Moabi n° 8, juin 1999,
p.29.
* 39 Petit Larousse, Grand
format, 1989 pp.790-791
* 40 CHIKHAOUI (L.), Le
financement de la protection de l'environnement, Thèse,
Université de Paris I, 1996, p.15
* 41 V. Principe 4,
Déclaration de Rio
* 42 V. Préambule de
la Déclaration de Stockholm
* 43 FAVOUREU (L.),
«Les bases constitutionnelles du droit des collectivités
locales», in MODERNE (F.) (dir.), La nouvelle
décentralisation, Paris, Sirey, 1983, pp. 24-26. Lire aussi
à ce sujet BOUDINE (J.), «La distinction entre
collectivité locale et collectivité territoriale (variations
sémantique ou juridique ?), RDP/LGDJ, 1992, pp. 171-199
* 44 CHAPUS (R.), Droit
administratif général, Montchrestien, Paris 1982, p 244.
* 45 CC n° 91-290 DC,
Rec 50 ; RJI i-438, Statut de la Corse, 9 mai 1991.
* 46 CC n° 85-196 DC,
Rec 63 ; RJC i-238, Evolution de la Nouvelle-Calédonie, 8 et 23
Août 1985.
* 47 GUILLIEN (R.) et
VINCENT (J.) (dir.), Lexique des termes juridiques, 13e
éd, Dalloz, Paris, 2001, pp 108-109
* 48 OWONA (J.),
Séminaire sur la décentralisation camerounaise : les
collectivités territoriales décentralisées, DEA Droit
public, FSJP-UY II Soa, Année académique 2009-2010,
Inédit.
* 49 Article 2, Loi n°
2004/017 précitée
* 50 C'est une personne
morale de droit public jouissant de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière. En effet la Constitution du Cameroun crée
deux types de collectivités locales : la Commune et la
Région. Toute autre collectivité pouvant être
créée par la loi. Il ressort de cette disposition qu'une
distinction doit être faite entre « les collectivités
territoriales décentralisées créées directement par
la constitution et celles dont la création est du domaine de la
loi» (Cf Jean Tobie HOND, « Etat des lieux de la
décentralisation territoriale au Cameroun » in Magloire ONDOA
(dir), L'administration publique camerounaise à l'heure des
réformes, L'Harmattan, Paris, 2010, pp. 93-114, cité par NGO
TONG (M. C.), thèse précité, p. 217). Le statut juridique
de la Communauté Urbaine au Cameroun reste flou. Créée par
la loi en 1987, la communauté urbaine a un statut juridique
différent de celui de la commune instituée par la constitution
Elle fonctionne selon les critères d'un établissement public
administratif. Mais contre toute attente, elle se présente dans le
décor communal comme une super structure décentralisée. A
bon droit la considère-t-on même assez maladroitement une
collectivité communale par le simple fait que les règles
déterminant son régime se retrouvent consignées dans la
loi qui détermine les régimes de communes, notamment la loi
n°2004/018 du 4 juillet 2004 portant règles applicable aux
communes.
* 51 KAMTO (M.), Droit
de l'environnement en Afrique, Edicef/AUPELF, Paris, 1996
* 52 DOUMBE BILLE (St.),
« Evolution des institutions et des moyens de mise en
oeuvre du droit international de l'environnement et du
développement », RJE n° 1993- 31
* 53 BOMBA (C. M.),
« Environnement et développement urbain au
Cameroun » in PRIEUR (M.), Vers un droit de l'environnement
Urbain : actes des 2e journées scientifiques du
« Réseau Droit de l'environnement » de l'AUPELF-UREF
à l'Université Cheikh AntaDiop, Sénégal Dakar,
octobre 1996
* 54 KOM TCHUENTE (B.),
Développement communal et gestion urbaine au Cameroun, les enjeux de
la gestion municipale dans un système décentralisé,
Ed CLE, Yaoundé 1996
* 55 KAMTO (M.),
« La mise en oeuvre et le suivi du droit international de
l'environnement » Rapport introductif général, in
Michel PRIEUR (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de
l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes
journées scientifiques du Réseau « Droit de
l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001
* 56DASSE (P.),
«Rapports nationaux, Cameroun : La mise en oeuvre du DIE dans le
secteur marin et littoral», in Michel PRIEUR (dir.), La mise
en oeuvre national du DIE dans les pays francophones, Acte des
troisièmes journées scientifiques du Réseau
« Droit de l'environnement », AUF, Yaoundé, juin
2001
* 57 TCHUIKOUA (L.B.),
Gestion des déchets solides ménagers à Douala au
Cameroun : opportunité ou menace pour l'environnement et la population
? Thèse de Doctorat, Université Michel de Montaigne de
Bordeaux 3, Bordeaux, 2010
* 58 NGO TONG (C. M.),
Intercommunalité, coopération décentralisée et
stratégies de lutte contre la pauvreté au Cameroun.Etude
spécifique des villes de limbe et Kribi et de la communede Dschang.
Thèse de doctorat, Université de Nantes, Nantes, juin
2012
* 59 LUBAC (J. C.),
Recherche sur les problèmes juridiques de la coopération
internationale des collectivités territoriales, Thèse de
Doctorat en droit public, Université de Toulouse 1 et de Sciences
sociales, Toulouse, 2005
* 60 MVELLE MINFENDA (G.),
Aide au développement et coopération
décentralisée. Esquisse de désétatisation de l'aide
française : Le cas du Cameroun, du Congo et Gabon - RDC -
Rwanda, Thèse de Doctorat en Science politique, Université
Jean Moulin, Lyon 3, 2005
* 61 Lire au ce propos
DONFACK SOKENG (L.), «L'intercommunalité et coopération
décentralisée», Séminaire de formation à
l'attention des Préfets, Kribi, juillet 2010. KEUTCHA TCHAPNGA (C.),
Doit de la coopération décentralisée, Cours de
mater II Doit public, FSJP-Université de Dschang, Année
académique 2009-2010, Inédit.
* 62NGAMALIEU NJIADEU (A.),
La protection de l'environnement marin au Cameroun: contribution
à l'étude de la mise en oeuvre des conventions
internationales, Mémoire deDEA Droit public,
FSJP-Université de Douala, Douala, 2005
* 63 EDOUA BILONGO (B.),
La répartition des compétences entre l'Etat et les communes,
Mémoire de DEA de Droit Public, FSJP/UY II Soa, Yaoundé,
Année académique 2006-2007
* 64 MATCHIUM KOUAGNE
(C.F.), La protection Juridique de l'environnement au Cameroun et en
France : le cas des nuisances sonores, Mémoire de Master 2,
Université de Limoges, Septembre 2009
* 65 Il s'agit de la Loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement (loi ENE).
* 66 Voir GRANIER (L.),
« Introduction », in GRANIER (L.), (coord),
Aspect contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et
Centrale, UICN, Gland Suisse 2008, p. xiii
* 67 KAMTO (M.),
« Le droit camerounais de l'environnement, entre l'être et
le non être » Rapport introductif au colloque
international organisé du 29 au 30 avril 1992 à Yaoundé
par le CERDIE sur le thème « Droit et politique de
l'environnement au Cameroun ». Disponible sur
http://www.cipcre.org/ecovox/eco03/dossier1.htm,
consulté le 30/04/2013
* 68 La
décentralisation est un système permettant à une
collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à
un service (décentralisation technique) de s'administrer elle-même
en fonction des lois du marché (décentralisation
économique et financière) sous le contrôle de l'Etat. Dans
ce contexte, l'Etat dote ces agences d'une personnalité juridique,
d'autorités propres et de ressources suivant certains principes
scientifiques. La décentralisation territoriale permet la
création en marge de l'Etat des collectivités dotés d'une
personnalité juridique, habilitées à s'administrer
elles-mêmes dans des conditions de relative autonomie par rapport aux
gouvernants et aux organes centraux (Voir MBARA GUERANDI (G.),
« Décentralisation participative et gouvernance
spatiolocale au Cameroun »CJDHR vol.2 N° 2, Décembre
2008 p.57). Au Cameroun, la décentralisation est prévue par la
loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution
du 02 juin 1972. L'article 1, alinéa 2, et le titre X -art 16, 17, 55 et
61- traitent des collectivités territoriales
décentralisées faisant du pays un «Etat unitaire
décentralisé» Dans ce cas, la décentralisation
consiste en un transfert par l'Etat, aux Collectivités territoriales
décentralisées, ci-après désignées« les
Collectivités territoriales », de compétences
particulières et de moyens appropriés. (Art. 2 de la loi
n°2004/017 du 22 juillet 2004 Portant loi d'Orientation de la
décentralisation)
* 69 La
décentralisation des collectivités territoriales tend vers la
réalisation de l'idéal démocratique, c'est-à-dire
le gouvernement du peuple par le peule et pour le peuple, pour reprendre
Abraham Lincoln. L'objectif de la décentralisation est de permettre un
partage des responsabilités verticales et horizontales dans la
scène étatique. A cet effet, elle exprime la responsabilisation
des collectivités territoriales et constitue un moyen de la dynamisation
de l'activité et de la vie nationale. Cette structure favorisera
l'identification par la population des problèmes locaux, nationaux et
internationaux, et permettra par la même la participation et la
contribution de chaque citoyen au développement tant sur le plan local,
national qu'international. (Voir MBARA GUERANDI (G), Op. cit. pp.
47-49)
* 70 V. principe 23,
Déclaration de Rio
* 71 NGAMBA TCHAPDA (H.)
« Décentralisation et renforcement de la gestion urbaine
au Cameroun : Collecte différenciée des ordures
ménagers à Douala » in CIDEGEF.
Disponible sur :
www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.docý
(consulté le 13 novembre 2013)
* 72 Le débat sur la
ville durable bénéficie d'un renouveau sans
précédent. Les instruments d'urbanisme et de gestion de la ville
évoluent et offrent aux aménageurs un cadre renouvelé
d'invention et aux élus d'investissement ou de réorientation de
leurs actions. Ce débat tend à élargir l'espace pertinent
de la planification urbaine bien au-delà de la frontière du
bâti continu. La ville durable se doit donc de faire corps avec sa proche
campagne pour former une région urbaine dont la planification d'ensemble
serait le préalable d'une pensée globale d'aménagement.
Au-delà de la dimension spatiale, la ville durable doit également
être appréhendée comme un système dont les
différentes composantes interagissent entre elles. (Sources :
Dossier du CRDD, La ville Durable, Janvier 2011). Disponible sur
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ville_durable_CRDD_01-2011.pdf(consulté
le 11 janvier 2014)
Définir la ville durable est un exercice
complexe. Le concept de ville durable n'est pas
précisément défini, et ne dispose pas, à ce jour,
de principes, indicateurs et critères clairement mesurables. Il fait
l'objet d'une pluralité de définitions, les unes sont
tournées tantôt vers l'urbanisme écologique, tantôt
vers la qualité de vie. Toutefois, dans son acception première,
la ville durable désigne une ville ou une unité urbaine
respectant les principes de développement durable, et de l'urbanisme
écologique, qui cherche à prendre en compte conjointement les
enjeux économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme,
suivant l'approche de démocratie participative édictée par
l'Agenda 21 de la Conférence de Rio. La ville durable pose alors la
question de la gouvernance où les différents acteurs, dont les
habitants, se retrouvent autour d'un projet. Les urbanistes seuls ne pourront
pas fabriquer la ville durable.
http://ecovilles.fr/wp/2011/08/la-ville-durable-quelles-definitions/(consulté
le 11 janvier 2014)
* 73 Agenda 21 est le titre
d'un document publié par les Nations Unies lors du Sommet de la Terre
(Conférence de Rio) en 1992, décrivant les priorités de
l'ONU en matière de développement durable pour le XXIe
siècle, et incitant les pouvoirs publics à définir, pour
chaque échelon géographique (pays, région, ville) leur
propre Agenda 21, à travers un dialogue avec les habitants.
Source : Document cadre de l'élaboration de l'agenda 21 de la ville
de Douala», Janvier 2009
* 74 La ville de Douala a
procédé à l'élaboration d'un Agenda 21 local dans
les années 2000-2001. Ainsi, dans un contexte marqué par la
volonté de planifier de manière inclusive le développement
de la ville, il est devenu indispensable de doter la Communauté Urbaine
de Douala (ci-après CUD) et les autres acteurs urbains d'outils
de programmes et de projets concrets de matérialisation de la
Stratégie de Développement Durable de la ville Douala à
l'horizon 2035. L'Agenda 21 local de la ville de Douala doit alors être
entendu ici comme « le développement et la mise en oeuvre
de politiques et stratégies, de programmes et de projets
identifiés par les autorités locales et les populations de la
Communauté Urbaine, dans l'optique d'un développement
durable » In Document cadre de l'élaboration de l'agenda
21 de la ville de Douala, Janvier 2009
* 75 MULLER (P.), Les
Politiques Publiques, Paris, 2e éd. Que-sais-je, 1994, p.
100. Voir aussi à ce sujet BIAREZ (S.), Le pouvoir local,
Paris, Economia, 1990 ; MILIBEAU (A.), Le système local
en France, Paris, Montchrestien, coll « clefs »,
1992
* 76 MULLER (P.), Op
cit. p. 100
* 77 AGULHON (M.) La
république au village, les populations de la révolution à
la IIe République. Paris, Seuil 1976, vol. 2
* 78 CORBIN (A.)
Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle,
1845-1880. Paris, Marcel Rivière
* 79 ONDOA (M.),
Séminaire de méthodologie de la recherche, DEA de Droit
Public Fondamental, FSJP/UYII-Soa, Année académique 2009/2010,
Inédit.
* 80 La CUD est une
collectivité publique décentralisée qui gère sous
la tutelle de l'État camerounais, les affaires locales en vue d'assurer
le développement économique social et culturel des populations de
la ville de Douala. Elle est créée le 24 septembre
1987 par le décret
no 87/1366, succédant ainsi à la commune urbaine
de Douala créée elle en
1974 , à la suite de la commune de
plein exercice qui a vu le jour en
1967 . Il faut noter que la loi
no 87/015 du 15 juillet 1987 qui en fixe les compétences
futures est abrogée par une nouvelle loi no 2004 du 22
juillet
2004 fixant les règles applicables
aux communes. Par ailleurs, la spécificité de la ville de Douala
relève du rôle prépondérant que revêt cette
agglomération sur le plan national (principal foyer industriel du
Cameroun) et au niveau de la sous-région CEMAC. La ville de Douala est
également la capitale de la région du littoral. Cette ville qui
doit son nom à un peuple Bantou les
« Dualas », a vu le jour suite à
l'installation de ces derniers sur l'estuaire du fleuve Wouri. La
présence dudit fleuve, d'une part, et celle de la mangrove d'autre part,
influencent l'essor de la ville qui connaît un étalement radial de
part et d'autre des deux berges.
* 81 Les années 1990
correspondent un moment particulier de l'histoire de l'Afrique et du Cameroun
en particulier. Si l'on doit considérer à bien des égards
cette période comme celle marquée par le souffle de la
démocratie en Afrique, il faut la considérer aussi comme
l'année écologique ; car la conscience écologique est
plus manifeste au sein de tout Etat. De fait, après la participation du
Cameroun à la Conférence de Rio, plusieurs instruments -
normatifs et institutionnels - de protection de l'environnement sont
élaborés. D'ailleurs, la révision constitutionnelle de
1996 marque un véritable point de départ dans le processus de
protection de l'environnement au Cameroun avec la création des
collectivités locales et leur participation dans la gestion des affaires
dites «locales».
* 82 KAMTO (M.), Pouvoir
et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du constitutionalisme dans
les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 41
* 83 La dogmatique est une
méthode juridique fondée sur l'étude et
l'interprétation des textes. Elle postule la détermination et la
restitution du droit en vigueur à travers les seuls textes
juridiques.
* 84 La casuistique est
quant à elle une démarche juridique positive sur l'étude
des décisions de justice.
* 85 Les politiques
publiques désignent à la fois une science, une méthode et
un objet. Bien que la deuxième permette d'expliquer la première
nous insisterons sur celle-ci. Nous partirions tout d'abord de
l'économie de la définition de cette notion.
Les politiques publiques renvoient en effet à plusieurs
acceptions. Elles désignent l'intervention d'une autorité
publique ; ou des ensembles structurés réputés
cohérents d'intentions, de décisions et de réalisations
imputables à une autorité publique local, nationale ou
supranationale dans un cadre sectoriel. Dans ce sens, la notion de
« politique publique », à travers l'action
publique, implique une coalition d'intervenants permanents ou
éphémères, sectoriels ou globaux, épisodiques ou
institutionnalisés. Ces derniers jouent un rôle de
médiateur, et concourent à une solidarité, non pas pour
mettre à défi la puissance publique, mais pour collaborer afin
d'établir l'ordre et l'équilibre social. A ce niveau, on se
trouve dans la logique d'une « politique publique
négociée ». La notion de politique publique incite
dès lors à penser les décisions non plus isolément,
mais intégrées dans une continuité minimal
conditionnée par un amont et conditionnant un aval. Elaborer une
politique publique suppose donc une marge de validité sur laquelle on
peut intervenir. Dans ce sens les politiques publiques apparaissent comme des
grandes lignes d'action, des directives formulées par une
décision administrative ou législative. Ainsi pourrait-on parler
de politique sanitaire, de politique éducative, de politique
environnementale etc., celle-ci étant le résultat des
interactions entre les différents acteurs du système politique.
Autrement dit, une politique publique se présente sous forme de
programme d'action propre à une ou plusieurs autorités politiques
gouvernementales. Elle désigne un travail de régulation des
pouvoirs publics au confluent de plusieurs jeux et interactions sociales aussi
diverses que variées. C'est ainsi que la
« politique » de protection exercée par les
CTD au Cameroun est, dans le contexte de notre étude, intimement
liée à la politique de l'environnement.
* 86 Il s'agit ici la
politique environnementale de la communauté urbaine de Douala
* 87 Il est question
d'évaluer cette politique.
* 88 Voir à ce sujet
les développements de THOENIG (T.H.), « L'analyse des
politiques publiques », In GRAWITZ (M.) et LECA (J.),
Traité de science politique, Tome 4, PUF, Paris, 1985, pp.
45-46
* 89 BAUD (M.), L'art de la
thèse, La découverte, Paris, 2003, p. 52.
* 90 TROGNON (A.),
« Produire des données » in BLANCHET (A.) et
al.,Les Techniques d'enquête en sciences sociales, Dunod, Paris,
1998, p. 3-4.
* 91 Sur les techniques
documentaires et ses composantes, voir Madeleine GRAWITZ, op. cit.,pp.
647 et 648, 653 et 655.
* 92 BRAUD (P.), Op.
cit, p 544
* 93 LAGROYE (J.), op.
cit, pp. 440-446 (Selon l'auteur, tous les acteurs gouvernementaux ont
chacun un agenda institutionnel, alors qu'il n'y a qu'un seul agenda pour les
politiques conjoncturelles du gouvernement).
* 94Voir les
développements de Maurice KAMTO sur les sources du droit de
l'environnement en Afrique. In, Droit de l'environnement en Afrique,
op cit, p. 66
* 95 Il faut dire ici que le
Cameroun a ratifié la plupart des conventions internationales
(universelles et régionales) sur l'environnement. Ce qui l'engage
à donner une application effective au plan national desdites
conventions. A cet égard, le droit camerounais de l'environnement
constitue une dynamique marquée par la vitalité et la
diversité de règles qui le composent.
* 96 Lire à ce sujet
les développements de Stéphane NDOUBE BILLE sur Les moyens de
mise en oeuvre du droit de l'environnement, in « Evolution des
institutions de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du
développement» RJE 1993, p. 5-10
* 97ZAKANE (V.)
«Problématique de l'effectivité du droit de
l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina-Faso» In
Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement
en Afrique de l'ouest et centrale, UICN, Gland, Suisse 2008, pp 13-34
(Spéc. p.15)
* 98 KAMTO (M.),op.
cit., p. 361
* 99Le Principe 25 de la
Déclaration de Stockholm se trouve en effet formulé en ces
termes : « Les États doivent veiller à ce que les
organisations internationales jouent un rôle coordonné, efficace
et dynamique dans la préservation et l'amélioration de
l'environnement». Il va s'en dire que la Conférence de
Stockholm a jeté les fondations conceptuelles et institutionnelles de la
coopération internationale pour la protection de l'environnement. Cette
exigence de coopération est davantage renforcée dans le chapitre
38 de l'Agenda 21 qui recommande fortement une coopération
institutionnelle internationale.
* 100ZAKANE (V.)
«Problématique de l'effectivité du droit de
l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina-Faso» In
Laurent GRANIER (Coord.),op cit, p. 14
* 101Au sujet de
l'internationalisation du droit de l'environnement,lire Michel PRIEUR,
«Rapport introductif», Réunion constitutive du
Comité de l'environnement de l'AHJUCAF, Actes du Colloque de
Porto-Novo, Benin, Juin 2008.
* 102 SIME (R.
N.),«L'intégration et l'harmonisation des normes de droit
international de l'environnement dans le droit africain»In Laurent
GRANIER (Coord.),op cit,p. 168
* 103En droit
international, le terme «ratification» désigne la
procédure par laquelle un Traité international, signé par
le Chef d'État, le Premier ministre ou le Ministre des affaires
étrangères (seules personnes habilitées à signer),
est soumis au Parlement pour approbation. En règle
générale, le Traité ne peut entrer en vigueur
qu'après sa ratification. Voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_ratification
, consulté le 13 Novembre 2013.
* 104La Constitution est
dans tout Etat, selon l'expression du Doyen Vedel «la base de tout
système juridique».
* 105 LAVEILLE (J. M.),
Le droit international de l'environnement, Ellipses, Paris, p.7
* 106 KAMTO (M.), op.
cit., p. 68
* 107 PRIEUR (M.),
«L'environnement est entré dans la Constitution»,
RJE, n° spécial 2005.
* 108
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/constitutionnalisation/18485
* 109 Un abaissement dans
la hiérarchie des normes n'est pas impossible lorsqu'on envisage une
constitutionnalisation dans les pays affirmant la suprématie du droit
international sur le droit constitutionnel, et qui constitutionnalise par la
même le droit international.
* 110La
constitutionnalisation du droit est le processus qui, par le moyen du
principe
de constitutionnalité, concourt à assurer l'unité du
droit ou de l'ordre juridique en donnant un socle commun à l'ensemble
des branches du droit. Ainsi, le fait que la
Constitution soit
envisagée comme une norme juridique suprême dans un ordre
juridique donné a pour conséquence que les sources
constitutionnelles irriguent l'ensemble de l'ordre juridique. On distingue deux
formes de constitutionnalisation : directe et indirecte. 1) La
constitutionnalisation directe est une constitutionnalisation des sources du
droit. C'est un phénomène qui correspond à une
élévation de la valeur juridique de certaines
règles de
droit qui paraissent plus importantes que d'autres, mais qui n'ont pas
reçu de consécration constitutionnelle implicite. La
jurisprudence française a notamment dégagée parmi ces
règles le droit à un recours juridictionnel, le droit à
saisir un tribunal pour défendre sa cause. 2) D'autre part, on parle de
constitutionnalisation indirecte, de constitutionnalisation du fond du droit,
lorsque l'interprétation de la Constitution retenue par le juge
constitutionnel va avoir un effet sur l'ordre juridique et surtout sur les
interprétations retenues par les juridictions ordinaires.
Sources :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitutionnalisation_du_droit
* 111 (Sous la dir.)
Matthieu (B) et VERPAUX (M.), Economia, Presses universitaires d'Aix de
Marseille, 1998, p. 181
* 112 PRIEUR (M.), op.
cit, p. 59, cité par DOUME MBILLE (S.), «Constitution et
Droit de l'environnement», AIDC, vol 9, 1999, p. 244
* 113KISS (A. C.),
Droit international de l'environnement, op. cit, p. 19. Selon cet
auteur, le principe éthique de protection de l'environnement
préconise la reconnaissance de la responsabilité de l'homme pour
la sauvegarde de l'ensemble de la biosphère : l'homme n'est pas le
propriétaire mais seulement le gestionnaire. A côté de
cette conception, l'auteur formule une conception éco-centrique de cette
protection qui postule que l'homme fait partie de son milieu qui doit
être sauvegardé dans son ensemble, comprenant toutes formes de
vie, sans tenir compte de leur utilité éventuellement.
L'environnement est donc protéger pour l'environnement et pour
l'homme.
* 114Au sens de cet
article, «tous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant et global propice à leur
développement».
* 115La lettre de l'article
65 du texte constitutionnel de 1996 intègre expressément le
préambule au sein de la Constitution. Cette déclaration explicite
implique de facto que l'ensemble des dispositions contenues dans le
préambule font partie intégrante de la loi fondamentale. Toutes
ces dispositions se trouvent ce faisant alignées sur l'ensemble du
régime des autres dispositions constitutionnelles
(V. MINKOA SHE (A.), Droits de l'homme et droit pénal au
Cameroun, Paris, Economia, Coll. « La Vie du Droit en
Afrique », 1999 p. 26). Ainsi, l'affirmation de la valeur juridique
du préambule de la constitution n'a pas épuisé la
problématique de la force contraignante des normes qui y sont
édictées. Toutefois, il convient, du reste dans le texte,
d'identifier les normes dont la violation peut donner matière à
un contrôle de constitutionnalité et dont la violation peut
être sanctionnée par le juge, et celles qui ne répondent
pas aux critères d'identification des normes juridiques. En effet, la force juridique de chacune des normes
inscrites dans le préambule est détachable de la valeur juridique
globale du texte du préambule. Bien plus, le droit requérant la
précision et la certitude, et étant exclusif des principes
faiblement déterminés, il convient de séparer dans le
préambule les normes certaines, des normes incertaines (V. MOUANGUE
KOBILA (J.), «Le préambule du texte constitutionnel du 18
janvier 1996 : De l'enseigne décorative à l'étalage
utilitaire»,LexLata, n° 23-24, févr.-mars 1996, p.
36).
* 116SIOUTIS GLYKENIA,
«Le droit de l'homme à l'environnement en
Grèce», RJE n°4, 1994, pp. 329-334.
* 117AFFONSE LEME (M. P.),
«L'environnement dans la Constitution brésilienne»,
Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 15, 2003
* 118 Article 26 paragraphe
d (5) de la Constitution du 18 janvier 1996
* 119Article 26 paragraphec
(3) de la Constitution du 18 janvier 1996
* 120Le caractère
Self-executing d'une Convention Internationale est souvent difficile
à déterminer et peut faire l'objet d'appréciations
divergentes. Est Self-executing une disposition qui n'exige pas une
mesure complémentaire pour son application. Voir à ce sujet
NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER (P.) et PELLET (A.), Droit International Public,
LGDJ, 5e éd, Paris, 1994, p. 230
* 121Celui-ci veille au
respect de la protection de l'environnement par le biais des
députés élus par lui.
* 122Article 26
alinéa 5 de la Constitution du 18 janvier 1996.
* 123 Il s'agit
principalement de l'OMD n°7 qui concerne la préservation de
l'environnement. D'ailleurs selon les termes liminaires de cette OMD, La
protection et la promotion d'un environnement sain et durable reste un souci
majeur pour le Gouvernement camerounais.
* 124 CARTON (O.),
«De l'inutilité d'une constitutionnalisation du droit de
l'environnement», LPA 2, Septembre 2005, pp. 3-10.
* 125 CAPITANI (A.),
«La charte de l'environnement : une leurre
constitutionnelle», RFDC n°63, 2005, pp. 494-516.
* 126 En effet, le droit
international de l'environnement présente une infirmité
consubstantielle à son mode d'élaboration et d'entrée en
vigueur. Pour être effectif, celui-ci doit être accepté par
les Etats. Or, le droit de l'environnement n'a pas de frontière et son
inapplication par un Etat peut compromettre son efficacité (c'est le cas
par exemple du Protocole de Kyoto). En outre, le droit international de
l'environnement est constitué d'une multitude d'actes dont la
portée normative est parfois nulle ; ce qui constitue une limite
certaine à l'effectivité de la protection de l'environnement au
niveau mondial. Ainsi, les diverses déclarations (par exemple, la
Déclaration de Rio), Recommandations et Programmes (exemple Agenda 21)
sont des projets politiques davantage que des instruments juridiques.
Dès lors, les principes du droit de l'environnement sont certes parfois
consacrés mais dépourvus de portée juridique. Par exemple,
s'agissant du développement durable, la Déclaration de Rio n'a
pas de portée normative impérative. Il en est de même des
principes de prévention, de précaution que consacre la
Déclaration.
* 127 GONIDEC (P. F.),
Les droits africains, Evolution et sources, 2e éd.,
Paris, LGDJ, 1985, p. 102
* 128 Article 26 de la Loi
Constitutionnelle du 18 Janvier 1996. Cette disposition constitutionnelle
autorise donc de façon expresse le législateur à prendre
des lois qui permettent de mettre en oeuvre la protection juridique de
l'environnement. Ainsi, une loi relative à la protection de
l'environnement est, dans la plupart des cas au Cameroun, adoptée par le
Parlement, à l'initiative du gouvernement ; en particulier
là où les questions qui y sont relatives sont
constitutionnellement définies comme étant du domaine
législatif.
* 129V. infra
* 130 OTTO PFESMANN,
FAVOREU (L.) (dir.), Droit des libertés fondamentales, Dalloz,
4e éd. Paris 2007, p.85
* 131KAMTO (M.), op.
cit, p. 66-67.Pour l'auteur, certes depuis Stockholm et quelque fois
avant, [le Cameroun] a édicté des normes relatives à la
protection des espaces et des espèces fauniques. Mais c'est seulement,
depuis le début des années 1990 qu'apparait dans le [droit
camerounais] des normes spécifiques à la protection de
l'environnement. Plus couramment, la question était abordée
indirectement à travers certaines branches du droit telles le droit des
espaces, le droit de l'urbanisme et de la construction, le droit minier, le
droit forestier.
* 132 KAMTO (M.) op.
cit., p. 67
* 133 MOUTONDO (E.M.),
«Les lois-cadres dans les pays francophones d'Afrique», in
GRANIER (L.), op. cit. p. 58. L'auteur mentionne qu'au moins 37 pays
africains ont inclus des dispositions en matière d'environnement dans
leurs Constitutions.
* 134Ibidem
* 135Afin d'éviter tout plagiat, nous
reprendrons pour l'essentiel dans cette rubrique les développements de
Janvier NGWANZA OWONO, in «La mise en oeuvre de la convention-cadre des
nations unies sur les changements climatiques au Cameroun: cas du
mécanisme pour un développement propre», Mémoire de
Master Droits de l'homme et action humanitaire, Université catholique
d'Afrique centrale,Yaoundé, 2008
* 136 Article 1 de la
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996.
* 137 Voir l'article 3 de
la loi n°96/12 du 05 aout 1996 portant loi cadre relative à
l'environnement
* 138Le droit de
l'environnement a pour objet l'étude de l'ensemble de normes juridiques
relatives à la protection de l'environnement sous ses diverses formes
terrestres, naturelles, culturelles, spatiales etc.C'est un droit transversal,
technique et complexe. Ses champs tendent à se diversifier au fur et
à mesure des avancées scientifiques et techniques.A juste titre,
Michel Prieur dit : "Chacun sait que l'environnement n'a pas de
frontière ; c'est pour cette raison que les Etats ont
été obligés d'élaborer de nouvelles règles
de droit international pour lutter contre les pollutions, pour protéger
la faune et la flore.
* 139 Ces mécanismes
ne sont pas propres au droit international. Pour la plupart, ils ont
émergé dans les droits nationaux. Voir KISS (A.C.), BEURIER (P.)
op. cit, p. 177
* 140International Trade in
Endangered Speces of Wild Fauna and Flora
* 141Article 2 de loi
n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement
* 142 Préambule de
la Constitution de la République du Cameroun
* 143 DOUMBE BILLE (St.),
« Evolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du
droit international de l'environnement et du développement »,
RJE, 1993/1
* 144 Article 3 de la loi
précitée.
* 145 KAMTO (M.),
« La mise en oeuvre et le suivi du Droit International de
l'Environnement », Rapport introductif général, in
PRIEUR (M.) (dir.) La mise en oeuvre national du droit international de
l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes
journées scientifiques du Réseau « Droit de
l'environnement », AUF, Yaoundé, juin 2001, p. 18
* 146 Marie Antoinette
(T.F.), In Atelier sur les statistiques de l'environnement,
« Rapport Final », Division statistique de l'ONU,
Yaoundé, Décembre 2011. Maurice KAMTO affirmait
déjà qu'une solution adéquate au du problème
institutionnel semble conditionner largement l'efficacité de la gestion
de l'environnement dans une perspective de développement durable.
KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris,
Edicef/AUPELF, 1996, p.105
* 147
http://www.minep.gov.cm/index2.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1&pop=1&page=0,
Consulté le 13 mars 2014.
* 148Man And
Biosphère
* 149
http://www.minep.gov.cm/index2.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=1&pop=1&page=0,
Consulté le 13 mars 2014.
* 150 KAMTO (M.), Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 107
* 151 Lire à ce
propos la version révisée de la Stratégie et Plan d'Action
National pour la Biodiversité. République du Cameroun 2012,
Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité -
Version II 2012 - MINEPDED. Disponible sur
http://www.minep.gov.cm
* 152 Ce que Jean Marc
LAVEILLE qualifie de débâcle écologique. LAVEILLE
(J. M.), Droit international de l'environnement, Paris, Ellipses,
1998, p. 9
* 153 Article 4,
alinéa 19 du décret n°2004/320 du 8 décembre 2004
portant organisation du gouvernement. Voir aussi l'article 01er
alinéa 2 du Décret n°2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature
* 154 Alinéa 19, art
4, du décret précité
* 155 Ces missions
découlent du statut que lui confère son décret de
création. Ces missions précisées à l'article 5
alinéa 19 du décret n° 2004/320 du 8 décembre
2004portant organisation du gouvernement et repris à l'article 1er
du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation
MINEP.
* 156 Le décret
n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement
remplace l'ex-MINEP par le MINEPDED. Ceci est d'autant plus vrai que le MINEP
n'est plus mentionné à l'article 4 dénommant les
différents départements ministériels. Mais on trouve
plutôt mentionnée le Ministère de l'environnement de la
protection de la nature et du développement Durable.
* 157Article 8
alinéa 19 du décret n°2011/408 du 09 décembre 2011
portant organisation du gouvernement. Voir aussi l'article 01er
alinéa 2 du décret n°2012/431 du 01er octobre
2012 portant organisation du MINEPDED
* 158 Voir article 2 du
décret de 2012 précité.
* 159 En effet,
l'alinéa 23 de l'article 8 du décret du 09 décembre 2011,
précisant les attributions du ministre de l'habitat et du
développement urbain (MINHDU), dispose que ce dernier « en
matière de développement urbain est chargé de
l'élaboration et de la mise en oeuvre des stratégies
d'amélioration de la circulation dans les grands centres urbains avec
les Départements Ministériels et les Collectivités
Territoriales Décentralisées concernés ; de
l'embellissement des centres urbains en liaison avec les Départements
Ministériels et les Collectivités Territoriales
Décentralisées intéressés ; de la planification et
du contrôle du développement des villes ; du suivi de
l'élaboration des plans directeurs des projets d'urbanisation en liaison
avec les Collectivités Territoriales
Décentralisées». C'est fort de cela que ledit
décret affirme avec force que le MINDHU travaille en étroite
collaboration avec les Collectivité territoriales
décentralisées.
* 160 Nous reviendrons sur
ces compétences dans nos développements.
* 161 Article 8,
alinéa 7 du décret du 09 décembre 2011
précité.
* 162 Article 8,
alinéa 12 du décret du 09 décembre 2011
précité.
* 163 Article 8,
alinéa 22 du décret du 09 décembre 2011
précité.
* 164 Article 8,
alinéa 23 du décret du 09 décembre 2011
précité
* 165 Rapport du
Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation
du Comité des Ministres, « L'environnement et les
collectivités locales et régionales », Communes et
Régions d'Europe, n°60, Editions don Conseil de l'Europe, p. 10
* 166Ibid.
* 167 La Commission des
Nations Unies pour le développement durable (CDD) a été
créée par l'Assemblée générale des Nations
Unies en décembre 1992 pour assurer un suivi efficace de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED), également connue comme le Sommet de la
Terre. Elle est chargée d'examiner les progrès accomplis dans la
mise en oeuvre d'
Action
21 et la
Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement, ainsi que de
fournir des orientations pour assurer le suivi du
Plan
d'application de Johannesburg aux niveaux local, national,
régional et international.
(
http://www.un.org/fr/conf/csd/about.shtml,
consulté le 13 mars 2014).
* 168 L'article 10 (2) de
la Loi-cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant gestion de
l'environnement dispose que le Gouvernement est assisté dans ses
missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de
contrôle des politiques de l'environnement par un Comité
Interministériel de l'Environnement.
* 169 Article 2 (1) du
Décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et
fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement
* 170 Article 3 (nouveau)
du Décret n° 2006/1577/PM du 11 septembre 2006 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret n° 2001/718/PM
du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité
interministériel de l'environnement
* 171
http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/cameroon/inst.html
(consulté le 18 Avril 2014)
* 172 ABOYA ENDONG (M.),
« L'organisation des grandes agglomérations
camerounaises : Le cas de la ville de Douala », in
Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.), La France Intercommunale -
Regards sur la loi de réforme des collectivités territoriales du
16 décembre 2010, L'Harmattan, Paris, 2013, p. 376
* 173Ibid
* 174 Lire à ce
propos Pascal METZGER, « Contribution à une
problématique de l'environnement urbain », Cahier de
Sciences Humaines, 30 (4) 1994, pp. 595-619.
Disponible sur
http://gaston.lema.arch.ulg.ac.be/urba/cours/durabilite/02-enjeux/Metzger.pdf
(consulté le 19 avril 2014) ; Lire aussi
« L'environnement en milieu urbain » Naturopa
n°94, 2000-Français.
Disponible sur
http://128.121.10.98/coe/pdfopener?smd=1&md=1&did=594430
(consulté le 25 juin 2013)
* 175 Aux termes de
l'article 3(1) de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux communes, « La commune a une
mission générale de développement local et
d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses
habitants ».
* 176 Article 16 de loi
n°2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables aux
communes.
* 177 Il s'agit du
Décret n°2012/0882/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités
d'exercice de certaines compétences transférées aux
communes en matière d'environnement.
* 178 Article
1er du décret précité.
* 179 TIANI KEOU (F.),
Douala : Etat de l'environnement et du Développement
Durable, L'Harmattan, Paris, 2013, p. 106
* 180 Dans
l'arrêté N° 01/CUD/2010 du 22 janvier 2010, portant
organisation des services de la Communauté Urbaine de Douala, le
chapitre 4 est intitulé « Direction de l'urbanisme, de la
construction et de l'environnement »
* 181 Article 39 de
l'arrêté précité.
* 182 TIANI KEOU (F.),
op. cit, p. 106
* 183 Le Professeur ABOYA
ENDONG préfère le terme « implication »
à celui de prise en compte. Il s'agit là d'un simple choix
sémantique qui n'impacte pas pour autant la volonté des acteurs
institutionnels. ABOYA ENDONG (M.), « L'organisation des grandes
agglomérations camerounaises : Le cas de la ville de
Douala », in Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.),
op. cit. p. 376
* 184 Echelon communal et
échelon intercommunal.
* 185 Les communes de
Douala 1er, 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et 6ème.
* 186 République du
Cameroun / MINATD 2008 « Etude diagnostic des communautés
urbaines de Douala et Yaoundé », Rapport final, Cameroun,
Mai - Juin 2007, p. 33
* 187Ibid.
* 188Ibid.
* 189 ABOYA ENDONG (M.),
« L'organisation des grandes agglomérations
camerounaises : Le cas de la Ville de Douala », in
Pierre-Yves MONJAL et Vincent AUBELLE (dir.), op. cit. p. 379
* 190 FOUDA (Y.) et BIGOMBE
LOGO (P.) : « Les acteurs environnementaux au
Cameroun : états des lieux », Yaoundé, GTZ/MINEF,
octobre 2000, p.13.
* 191 Les acteurs indirects
interviennent dans la gestion de l'environnement par l'intermédiaire des
autres acteurs pour la réalisation de leurs objectifs dans ce domaine.
Il s'agit essentiellement des agences de coopération et des bailleurs de
fonds. FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.), op. cit, p.14.
* 192 On entend par ONG
tout regroupement, association ou mouvement constitué de façon
durable (sur la base d'un acte juridique généralement
appelé statut) par des individus ou des personnes morales appartenant
à un même Etat ou à des Etats différents, en vue de
la poursuite de buts non lucratifs. (KAMTO (M.), Droit de l'environnement
en Afrique, op. cit, p. 381). Par ailleurs, la loi n° 99/014 du 22
décembre 1999 qui régit les organisations non gouvernementales au
Cameroun définit une ONG en son article 29 alinéa 1 comme une
association déclarée ou une association étrangère
autorisée conformément à la législation en vigueur,
et agréée par l'administration en vue de participer à
l'exécution des missions d'intérêt
général.
* 193 BOISSON de CHAZOURNES
(L.), « La mise en oeuvre du droit international dans le
domaine de la protection de l'environnement : enjeux et
défis », RGDIP, 99/1995/1, p. 60 ; N'DOMBI
(C.) : « Le rôle des ONG dans la coopération
Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2,
1994, p.148. Lire également ANNAN (K.) : « Pour un
véritable partenariat mondial », Rapport annuel sur
l'activité de l'organisation (ONU), 1998, pp. 22-63 ; KREMLIS
(G.) : « La communauté Européenne :
partenaire international de la protection de l'environnement »,
REDE, 1997/1, pp. 9-15.
* 194 En effet, selon le
point 7 de la Déclaration de Stockholm « les hommes de
toutes conditions et les organisations les plus diverses peuvent, par les
valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer
l'environnement de demain ». Voir aussi l'article IX
alinéa 2 de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage.
* 195 LAVIEILLE (J.-M.),
op. cit., p.35
* 196 KAMTO (M.), Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit, p.381.
* 197 La troisième
partie de l'Agenda 21 intitulée «Renforcement du rôle des
principaux groupes » recouvre le Chapitre 27 portant
sur le renforcement du phénomène ONG.
* 198 Le point 14 du
Préambule de la Convention sur la diversité biologique du 05 juin
1992 souligne la nécessité de « favoriser la
coopération entre les Etats et le secteur non gouvernemental aux fins de
conservation de la diversité biologique ». Voir aussi
l'article 4, alinéa 1(i) de la Convention-Cadre sur les changements
climatiques du 09 juin 1992. Le point 22 du Préambule de la Convention
des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 1994
insiste sur « le rôle spécial joué par les
organisations non gouvernementales ». Voir aussi l'art. 10 al. 2
(f) de la même Convention.
* 199 La Déclaration
de Brazzaville du 30 mai 1996 évoque « la
nécessité d'impliquer d'avantage les populations autochtones, les
collectivités locales, les organisations non gouvernementales... dans la
conservation et la gestion des écosystèmes ».
Paragraphe 9, Déclaration issue de la CEFDHAC. Aussi de la
Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999,
qui fait suite au sommet des chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la
conservation et la gestion durable des forêts tropicales, précise
la volonté des Etats d'Afrique Centrale de renforcer les actions visant
à accroître la participation rapide des populations et des autres
acteurs dans le processus de gestion durable et de conservation des
écosystèmes forestiers.
* 200 TIANI KEOU (F.),
op cit, p. 109
* 201 ENVIRO-PROTECT
(Organisation internationale pour la protection de l'environnement en Afrique
centrale) est une ONG de droit camerounais spécialisée dans le
domaine de la protection de l'environnement, créée en 1991. Elle
compte jusqu'à présent quatre antennes : antenne de Maroua,
antenne siège à Yaoundé, antenne de Douala, antenne de
Bafang. Dans le cadre de cette recherche, nous avons
bénéficié de l'appui documentaire de l'agence de Douala.
* 202 Lorsque la Ville de
Douala préparait son agenda local, l'ONG Environnementale ENVIRO-PROTECT
avait été désignée à la tête du groupe
devant rédiger la composante environnementale.
* 203
http://www.fctvcameroun.org/profiles/blogs/quartier-precaires-de-la-ville-de-douala
(consulté le 18 avril 2014)
* 204Le projet
« Cité Propre » de CIPRE a remporté
en l'an 2000 le « Grand prix de la coopération
internationale » organisé par le Haut Conseil de la
Coopération Internationale en France
* 205 TIANI KEOU (F.),
op. cit. p. 109
* 206Ibid.
* 207Ibid.
* 208
http://www.lesbrasseriesducameroun.com/?q=environnement,
consulté le 24 mars 2014
* 209
http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4715
, (Consulté le 24 mars 2014)
* 210 Global Contact/Global
Reporting Initiative, Communication on Progress, « La
responsabilité corporative du CCC sur les conditions de travail, la
protection de l'environnement, la transparence et la lutte
anti-corruption », décembre 2006
* 211 Ibid.
* 212
https://www.facebook.com/BocomIndustriel/posts/422877851153184,
(consulté le 24 mars 2014).
* 213
http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4067,
(consulté le 24 mars 2014).
* 214 YMELE (J. M.)
« Les voies camerounaises vers une meilleure gestion des
déchets », Revue SPD (Secteur Privé &
Développement), n°15. Disponible sur
http://www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/Publications-Proparco/secteur-prive-et-developpement/Authors/Issue-15-authors/jean-pierre-ymele-hysacam
(consulté le 21 avril 2014)
* 215
http://bocam.populus.org/rub/1,
consulté le 24 mars 2014.
* 216 MINEP/PNUD,
Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme
environnement (PE) : Diagnostic de la situation de l'environnement au
Cameroun, Volume I, février 2009, p. 100. Par ailleurs, le Forum de
haut niveau sur la coopération pour le développement,
convoqué à Bamako en Mai 2012 par l'ECOSOC, remarquait que compte
tenu des lenteurs observées des progrès vers les OMD, il
était opportun d'orienter la coopération pour le
développement vers ces OMD.
* 217 Lire à ce
propos PRIEUR (M.) (sous la dir.), La mise en oeuvre du droit international
de l'environnement dans les pays francophones, Acte des troisièmes
journées scientifiques du réseau « Droit de
l'environnement », AUF, Yaoundé, 2001.
* 218 DOUMBE BILLE (S.),
« L'Agenda 21 et le cadre institutionnel »,RJE,
1994.
* 219 Voir paragraphe 7 du
chapitre 38 de l'Agenda 21.
* 220 KAMTO (M.), Droit
de l'environnement en Afrique, op .cit, p. 372
* 221 KISS (A. C.),
BEURRIER (J.P.), Droit international de l'environnement,op cit, p.
79
* 222 PELLET (A) et
DAILLIER (P), Droit international public, L.G.D.J, 7e
Edition, Paris, 2002 p. 1310
* 223 MINEP/PNUD,
Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme
environnement (PE) ... op. cit. , p. 103
* 224 Le terme conditionnalité est
généralement assimilé aux conditions fixées par
certaines organisations financières internationales dans la poursuite de
leurs objectifs. La conditionnalité reste donc un instrument
économique au service des organisations financières, ses liens
avec le droit et la protection de l'environnement sont peu évidentes,
dans la mesure même où le terme même de
conditionnalité environnementale reste flou dans sa définition.
Toutefois, il s'agirait d'un instrument susceptible de mettre au service de la
protection de l'environnement, notamment africain, les milliards
générés chaque année par les organisations
financières internationales, tout simplement en conditionnant le
déboursement de ces sommes au respect du droit de l'environnement. La
conditionnalité environnementale, selon Alain VANDERVORST, serait le
fait pour une organisation financière internationale de
considérer une ou plusieurs mesures liées à la protection
de l'environnement comme nécessaires ou souhaitables au
déclenchement ou au maintien d'une ou plusieurs opérations. La
conditionnalité environnementale serait une des parades trouvée
par les institutions de Breton-Wood pour mettre les africains au pas en ce qui
concerne la protection de l'environnement. VANDERVORST (A.),
« Contenu et porté du concept de conditionnalité
environnementale : Vers un nouvel instrument au service du droit de la
protection de l'environnement en Afrique ? », disponible sur
www.afrilex.u-bordeau4.fr,
consulté le 05 avril 2014. Lire aussi VANDERVORST (A.), La
conditionnalité écologique dans les organisations
financières internationales, Thèse de Doctorat, Rouen, 1999.
* 225 KAMTO (M.), Droit
de l'environnement en Afrique, op .cit, p. 375
* 226 KISS (A. C.),
BEURRIER (J.P.), op. cit., p. 99. L'exigence du contrôle des
normes environnementales est ici vérifiée lors d'une demande de
financement d'un projet de développement qui se veut respectueux de
l'environnement.
* 227 Ces politiques
environnementales sont autrement dites des « politiques de
sauvegarde ». Elles renvoient aux conditionnalités
environnementales. Cf. n. 84.En effet, en permettant l'évaluation
environnementale des projets, la consultation des communautés
affectées, la publication de l'information, les compensations des
impacts et la remise en état du milieu de vie, la protection de la
biodiversité, pour ne citer que ces exemples, les politiques de
sauvegarde contribuent à réduire les impacts négatifs des
projets de développements ; elles favorisent des résultats
positifs.
* 228 KAMTO (M.), op.
cit., p. 377
* 229 KISS (A. C.),
BEURRIER (J.P.), op. cit., p. 100
* 230Ibid.
* 231 République du
Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du
Cameroun, Rapport Provisoire, Mars 2004, p. 36
* 232Idem.
* 233 SANDS (Ph.),
Principles of international environmental law. Manchester University
Press, Manchester, New York, vol. 1, Framework, standards and implementation,
1995. pp. 72-73. Cité par MALJEAN DUBOIS (S.), « La mise
en oeuvre du droit international de l'environnement », notes de
l'IDDRI, n° 4, 2003, p. 16
* 234 Résolution
2997 (XXVII), Dispositions institutionnelles et financières concernant
la coopération internationale dans le domaine de l'environnement.
* 235 KAMTO (M.), op.
cit., p. 373
* 236 Le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) est un organisme autonome des
Nations Unies créé en 1965 par l'Assemblée
Générale. Il travaille en étroite collaboration avec
environ 150 gouvernements et 30 agences intergouvernementales pour fournir
l'assistance technique permettant d'améliorer les niveaux de vie et la
croissance économique des pays en voie de développement. Les
projets du PNUD visent à augmenter le taux d'alphabétisation et
à assurer des formations professionnelles, à encourager les
investissements de capitaux et à développer les capacités
technologiques. Le PNUD assure le rôle de chef de file pour ce qui est
des initiatives prises par les organismes des Nations Unies en matière
de renforcement des capacités à l'échelle locale,
nationale et régionale. Voir chapitre 38, paragraphe 25 (a) de
l'Agenda 21).
* 237 République du
Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du
Cameroun, op. cit. p. 36
* 238Idem.
* 239 L'ONG
dénommée Appui pour le Développement Communautaire du
Cameroun (ADEC) a été créée en 1992, et elle est
l'une des plus anciennes de Bépanda. Ses membres s'activent depuis lors
à apporter des solutions aux multiples problèmes
environnementaux, sociaux, économiques et d'emploi que rencontrent les
habitants de Bonewonda dans le bassin du Mbanya inférieur.
* 240 ASHABO (Association
des Habitants de Bonamoukouri)
* 241 FANG
(Fédération des Associations de New-Deido et Gentil)
* 242Cf. n. 26
* 243 ORLIANGE (Ph.),
La Commission du développement durable. Annuaire
français de droit international, vol. 39, 1993. pp. 820-832. Cité
par MALJEAN DUBOIS (S.), op cit, P. 16
* 244 KISS (A. C.),
BEURRIER (J.P.), Droit International de l'environnement, op
cit, p. 115
* 245Ibid.
* 246 Article 24 de la
Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples.
* 247 Voir chapitre IX de
la Convention de Bamako du 30 Janvier 1991.
* 248 Article 13
alinéa 1 (e) de l'Acte constitutif de l'UA
* 249 Article 14
alinéa 1 (d) de l'Acte constitutif de l'UA
* 250 Voir chapitre 33
paragraphe 14 alinéa A, iii de l'Agenda 21.
* 251MINEP/PNUD,
Révision/opérationnalisation du PNGE vers un programme
environnement (PE) ... op. cit p. 108
* 252 FOUDA (Y.) et BIGOMBE
LOGO (P.), « Les acteurs environnementaux au Cameroun : vue
d'ensemble », Yaoundé, GTZ/MINEF, octobre 2000, p.11
* 253Ibid.
* 254 Le Canada,
l'Allemagne, les Pays Bas, la Grande Bretagne, la Belgique, les Etats Unies, le
Japon, la France et l'Union Européenne.
* 255 République du
Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du
Cameroun, op cit, p. 39
* 256Idem.
* 257 En français
entendu comme Agence allemande de coopération technique.
* 258 République du
Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du
Cameroun, op cit, p. 37
* 259, Idem.
* 260 Projet de Gestion des
Forêts Naturelles au Sud-Est du Cameroun
* 261 FOUDA (Y.) et BIGOMBE
LOGO (P.), ibid. Idem
* 262Idem.
* 263En français
entendu comme Agence américaine pour le développement
international.
* 264 FOUDA (Y.) et BIGOMBE
LOGO (P.), op. cit.,
* 265 République du
Cameroun/Commission européenne, Profil environnemental du
Cameroun, op cit, p. 35
* 266Ibid.
* 267 Article 131
alinéa 1 de la Loi n°2004/18 du 22 juillet 2004.
* 268 Article 131
alinéa 2 de la loi précitée
* 269 NGO TONG (M. C.),
Intercommunalité, coopération décentralisée et
stratégies de lutte contre la pauvreté au Cameroun. Etude
spécifique des villes de limbe et Kribi et de la commune de
Dschang, Thèse de Doctorat, Nantes, 2012, p. 16
* 270 CHOMBARD-GAUDIN (C.),
« Pour une histoire des villes et communes jumelées
», in Revue d'histoire n° 35, XXe siècle,
juillet-septembre 1992, pp. 60-66
* 271 Pour Samuel LESART,
la coopération décentralisée est le fruit d'un processus
historique d'internationalisation des collectivités et des affaires
dites « locales ». LESART (S.), Les réseaux de
coopération décentralisée et la mobilisation des
acteurs : l'exemple alsacien, Mémoire de 4e
année d'IEP, Strasbourg, Juin 2008, p. 7
* 272 NGO TONG (M. C.),
Thèse précitée, p. 24
* 273 La loi n°
2004/017 d'orientation de la décentralisation au Cameroun dispose en son
article 85 : « Les Collectivités territoriales peuvent
coopérer avec des Collectivités territoriales de pays
étrangers, sur approbation du Ministre chargé des
Collectivités territoriales, suivant les modalités prévues
par un décret d'application de la présente loi»
* 274 Décret n°
2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la
coopération décentralisée.
* 275 BLANC (S.), La
coopération décentralisée : un acteur émergent dans
l'aide publique au développement des pays du Sud, Exemples de
collectivités locales Françaises et Sénégalaises,
Région de Midi Pyrénées/ région de Thiès ;
Département de la Dordogne / commune de Sokone ; Commune de Bon encontre
/ île de Karabane, Mémoire de Master I en Géographie
et Aménagement du Territoire, Université de Toulouse Le Miral,
Juin 2008, p. 10. Citée par NGO TONG (M. C.), Thèse
précitée, p. 25
* 276 NTYE NTYE (D.),
« Coopération décentralisée et
développement local », in NGOH YOM (R.) et alii, Le
Cameroun Municipal 2002-2007, Yaoundé, FEICOM, 2002, p. 24.
Citée par NGO TONG (M. C.), Ibid.
* 277 Lire à ce
propos EKOUMOU (A. M.), Une nouvelle forme de relation Nord/Sud : la
coopération entre les collectivités locales françaises et
les collectivités locales africaines (la coopération
décentralisée), 1982-1990, Thèse de doctorat
3ème cycle en Relations internationales, IRIC, 1994, p.44
s
* 278 BASSAMAGNE MOUGNOK,
à la suite de Charles NACH MBACH (NACH MBACK (C.), La
coopération décentralisée pour le développement
entre la France et le Cameroun, ...), voit dans la coopération
décentralisée entre la France et le Cameroun, un véritable
partenariat gagnant-gagnant et présentant des grands enjeux et
défis tant pour le Cameroun que pour la France. Il dépasse la
conception lacunaire de cette coopération selon laquelle les
collectivités camerounaises seraient des quémandeurs de l'aide
auprès des communautés française pour fonder son
argumentaire sur un partenariat équilibré entre les
communautés locales des deux pays où chacune apporterait une
plus-value à l'autre. BASSAMAGNE MOUGNOK (C.), La coopération
décentralisée entre la France et le Cameroun : un
véritable partenariat ?, Mémoire de Master II,
Université de Yaoundé II - SOA, Yaoundé, 2006.
* 279 Cette formule,
employée par René DUBOS lors du premier Sommet sur
l'environnement résume l'esprit du développement durable qui
prévoit que dans la stratégie nationale de développement
durable soient prévus des pôles régionaux et locaux pour
diffuser les concepts et pratiques du développement durable sur leur
territoire.
* 280 Commission Mondiale
de l'Environnement et du Développement, 1987
* 281 Lire à ce
propos BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « La mise en oeuvre du droit
international dans le domaine de l'environnement: enjeux et
défis » RGDIP, 99/1995/1, pp.41-48 ; Lire aussi
PONGUI (B. S.), Les défis du Droit international de
l'environnement, Mémoire de Master II, Université de
Limoges, Limoges, 2007
* 282 Le recours à
ces mesures élaborées au niveau local participe de ce que Pierre
MULLER appelle le retour au local. (MULLER (P.), Les Politiques
Publiques, Paris, 2e Ed. Que-sais-je, 1994, p. 100). Un retour
destiné à favoriser l'élaboration des politiques dites
locales et l'inscription de ces politiques dans l'agenda structurel et
conjoncturel du pays.
* 283 Ces mesures doivent
être efficaces afin de permettre l'atteinte des objectifs du
développement durable. En effet, le principe d'efficacité est
ici indéniablement reconnu. Selon ce dernier, les mesures prises
par les autorités publiques « doivent être
efficaces et intervenir à un bon moment ; elles doivent produire
les résultats requis, à partir d'objectifs clairs et
d'une évaluation de leur impact futur et de l'expérience
antérieure ». Or, il n'est pas hasardeux d'affirmer
dès à présent que, par essence, les plans et
programmes prétendent occuper une place privilégiée au
sein des instruments propres à satisfaire l'exigence d'efficacité
ainsi définie. (AOUSTIN (T.), La participation du public aux plans
et programmes relatifs à l'environnement, Mémoire de DEA,
Université de Limoges, Limoges, 2004, p. 6)
* 284 Le
développement durable fait partie intégrante des OMD, qui ont
été fixés par l'ensemble des États membres de
l'ONU. A cet effet, un scénario a été proposé et
repose sur trois principaux éléments : l'efficacité
(utilisation des techniques les plus performantes) ; la sobriété
(techniques utilisées avec parcimonie) ; et l'utilisation de ressources
renouvelables à l'instar de l'énergie solaire ou les
éoliennes, au travers de projets d'électrification rurale.
* 285 Le cas de la mangrove
de Youpwé en est une illustration parfaite aujourd'hui. Jadis
conservée, non pas seulement pour prévenir les érosions et
les inondations, tant que la chute des avions, parce que proche de la zone
aéroportuaire, cette mangrove représentait un espace vital pour
le développement de la faune aquatique, notamment pour des
espèces qui se multiplient dans les eaux douces. La mangrove de
Youpwé est aujourd'hui prise d'assaut par des constructions
industrielles. Ce qui ne favorise pas toujours la préservation des
espèces d'eau douce contre les rejets produits par ces entreprises.
* 286 En
référence au jumelage (Cf. CHOMBARD-GAUDIN (C.),
«Pour une histoire des villes et communes jumelées »,
in Revue d'histoire n° 35, XXe Siècle, juillet-septembre
1992, pp. 60-66. Longtemps avant que les autorités politiques ne
définissent les actions des communes orientées vers
l'extérieur en les qualifiant de coopération
décentralisée, celles-ci étaient engagées dans
plusieurs conventions de jumelage et divers types d'accord de
coopération avec des communes extérieures. Les jumelages
émergent en Europe après la deuxième guerre mondiale.
* 287 KOUAM TEAM (G. L),
La participation des collectivités territoriales
décentralisées à la protection de l'environnement au
Cameroun, en France et en Belgique, Mémoire de Master en Droit
international et de comparé de l'environnement, Université de
Limoges, Limoges, Aout 2010, p 28.
* 288Pourquoi un Agenda 21
local? A l'initiative des Nations Unies, le document intitulé Agenda 21
constitue un outil de concertation pour planifier le développement
durable à différentes échelles géographiques. En
d'autres termes, le rôle de cet Agenda 21 est de définir les
priorités en matière de développement durable pour le
21ème siècle. Il s'agit avant tout d'un document
élaboré dans le but de faciliter la prise de décision
concertée et de permettre au minima l'appropriation, au maxima
l'adhésion par les habitants des projets urbains respectueux des
exigences environnementales. La gestion et la planification urbaines
s'organisent autour de nombreux outils (CDS, PDU, POS, PDU,...), sachant que
chacun de ces outils abordent des thèmes précis quelquefois de
manière sectorielle. L'Agenda 21 local de Douala comprend donc une
série de projets importants qui touchent tous les domaines ; le
développement durable a en effet des enjeux de portée
globale.(Aymar METEKE, « Un Agenda pour la Ville de
Douala », L'Afrique durable : La pratique du
développement durable en Afrique, n°1, juin 2012, p. 5
* 289 KOUAM TEAM (G. L),
op. cit. p. 28
* 290 V. article 110 de la
loi n°2004/018 du 22 juillet 2004, fixant les règles applicables
aux communes.
* 291Rapport du
Comité directeur des autorités locales (CDLR) et recommandation
du Comité des Ministres, « L'environnement et les
collectivités locales et régionales », Communes et
Régions d'Europe, n°60, Editions Conseil de l'Europe, p. 13
* 292 V. article 10 de la
loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 précitée
* 293 V. article 10 de la
loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 précitée
* 294 Constat recueilli
suite à plusieurs échanges avec des habitants de la ville de
Douala
* 295 GIBBINS (R.),
« La gouvernance locale dans les systèmes politiques
fédéraux », Revue Internationale des Sciences
Sociales, 2001/01 n° 107 p.183 ; Disponible sur
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=RISS&ID_NUMPUBLIE=RISS_167&ID_ARTICLE=RISS_167_0177
(consulté le 18 juillet 2014)
* 296 Lire à ce
propos DEMAZIÈRE (Ch.) « L'action
économique locale et l'environnement.Les collectivités locales
prennent-elles en compte les contraintes et opportunités qu'offrent les
ressources naturelles pour l'économie d'un
territoire ? »,Développement durable et
territoires [En ligne], Dossier 1 | 2002, mis en ligne le
01 septembre 2002,URL :
http://developpementdurable.revues.org/894,(consulté
le 11 août 2014)
* 297 FIALAIRE (J.),
Les stratégies du développement durable, Paris,
L'harmattan, 2008, p.17
* 298 NICOLAS (St.)
« Belgique » Bilan et évolution des droits
nationaux, in PRIEUR (M.) (préf.) Vers un nouveau droit de
l'environnement ?, Réunion mondiale des juristes et associations de
droit de l'environnement,Université de Limoges. CRIDEAU. Centre de
recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de
l'aménagement et de l'urbanisme, France, 2003/05 p. 268.Le Rapport de
recherche et étude est disponible sur
http://www.cidce.org/publications/sommaire%20rio.htm
(consulté le 14 aout 2014)
* 299Cf. loi sur
les communes et plus particulièrement son article 110
précité.
* 300 COLLANGE-POTRON (E.),
« Grenelle de l'Environnement : quels rôles pour les
collectivités ? »
http://www.auvergnepro.com/Grenelle-de-l-Environnement-quels.html
(consulté le 15 juin 2014)
* 301 Ce séminaire
sous régional intitulé « villes d'Afrique centrale
et changement climatique » avait pour objectif essentiel
«d'amener les villes francophones à élaborer un plaidoyer
argumenté à exposer et à défendre sur la
scène internationale », en animant des
réflexions autour de ces questions, en mobilisant des élus, les
administrations centrales et locales, des acteurs de la société
civile, des universitaires, des professionnels des villes d'Afrique centrale et
des partenaires au développement autour de l'analyse des défis et
des leviers d'action permettant d'adresser efficacement les enjeux du
changement climatique et de la durabilité pour les villes des pays en
développement. (Rapport n°01/MMGC/RP/DIVCOM/2014,
Séminaire régional sur le thème :
«Villes d'Afrique centrale et changement climatique »
Organisé par la Communauté Urbaine de Douala (CUD) Avec l'appui
de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), Juin 2014)
* 302 La France est bien
plus audacieuse et la volonté de donner un rôle central aux
collectivités en la matière se fait ressentir, principalement par
les projets de lois Grenelle 1 et 2. En effet, le constat d'échec de la
France dans la mise en oeuvre des plans climats de 2000 et de 2004 et le
constat de la grande part de responsabilité des collectivités
locales dans les émissions de gaz à effet de serre explique la
volonté de mettre en oeuvre les plans climats territoriaux. Le projet
grenelle 1 qui n'a pas abouti prévoyait des « schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ».
L'échec du projet de loi Grenelle 1 n'aura pas tempéré les
ardeurs de la France dans son objectif de renforcer le rôle des
collectivités territoriales. C'est ainsi que le projet Grenelle 2 va
prévoir un bilan des émissions de gaz à effets de serre et
dans son article 26, préciser les autorités qui sont dans
l'obligation de le faire. C'est ainsi que les collectivités
territorialesen plus d'établir un bilan, auront
aux termes du projet de loi et du futur article L.229-26 du code de
l'environnement l'obligation d'établir un « Plan climat
énergie territorial ».
* 303 Lire la Note
Conceptuelle du Séminaire sous régionale sur le thème :
« Villes d'Afrique centrale et changement climatique »
Organisé par la CUD avec l'appui de l'AIMF. Juin 2014.
* 304 CHERON (M.),
« Les collectivités territoriales se sont donné
rendez-vous à Copenhague », 11 décembre 2009.
http://www.association4d.org/IMG/pdf_Article_collectivites.pdf
(consulté le 20 juin2014)
* 305 ROUSSEL (I.),
« Les collectivités locales et le changement
climatique » 2007, p. 50
http://www.appa.asso.fr/_adminsite/Repertoire/7/fckeditor/file/Revues/AirPur/Airpur_72_Roussel.pdf
(consulté le 20 juin 2014)
* 306 V. Article 19 de la
loi n°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
régions.
* 307 SANTUS (A.S.) (dir),
« Coopération décentralisée et
intercommunalités ». Ministères des Affaires
Etrangères / Commission Nationale de la coopération
décentralisée, 2003, p. 8, PDF disponible sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Intercommunalites.pdf
(consulté le 18 Aout 2014)
* 308J AGLIN (S.),
DUBRESSON (A.) (dir.), Pouvoirs et cités d'Afrique Noire,
décentralisations en questions, Karthala,Paris, 1993, p. 24.
Cité par BASSAMAGNE MOUGNOK (C.), La coopération
décentralisée entre la France et le Cameroun : un
véritable partenariat ? Mémoire de Master II en Science
Politique,Université de Yaoundé II-SOA, Yaoundé,
2006 p.12
* 309 PETITEVILLE
(F.), La coopération décentralisée. Les
collectivités locales dans la coopération Nord-Sud,
l'Harmattan, Paris 1995, p. 7
* 310 Décret n°
2011/1116/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la
coopération décentralisée
* 311 Programme d'Appui au
Développement Urbain des villes de Douala et Yaoundé
* 312 L'IRCOD d'Alsace est
né en 1986 de la volonté de la Région Alsace de promouvoir
une politique de coopération régionale entre l'ensemble des
acteurs alsaciens (collectivités locales, institutions diverses et
structures représentant la société civile alsacienne),
créant ainsi les conditions d'une véritable coopération de
territoire à territoires
* 313 Contrat de
Désendettement et de Développement
* 314Projet d'Appui au
Développement Urbain de Douala et Yaoundé - Composante Douala
* 315 Il s'agit
essentiellement ici de la l'élaboration des documents de planification
urbaine tels : La stratégie de développement de la ville de
Douala et de son aire métropolitain à l'horizon 2025 (CDS) ;
Le Plan Directeur d'Urbanisme (PDU) ; et la Plan d'Occupation des Sols
(POS).
* 316 Intervention dans les
quartiers (Voies d'accès, Eau potable, éclairage public, bloc
sanitaire etc. ...) ; construction des drains primaires.
* 317 V. Article 11
alinéa 3 de la Constitution de la Finlande.
* 318 V. Article 14 de la
Constitution de la Finlande.
* 319 République du
Cameroun/Communauté Urbaine de Douala, Stratégie de
développement de la ville de Douala et de son aire
métropolitain, Décembre 2009, p. 19.
* 320 Rappelons que cette
prise en compte de tous les acteurs sociaux participent de la mise en oeuvre du
chapitre 40 de l'Agenda 21 qui insiste sur la nécessité
d'associer l'ensemble des groupes sociaux afin de afin de permettre la
réalisationd'un développement durable et d'une protection
intégrée de l'environnement.
* 321 A propos du model
participatif, lire TCHALA ABIMA (F.), Participation des
différentes parties prenantes dans la gestion des ressources naturelles
au Cameroun, Séminaire sur la gestion communautaire des ressources
naturelle organisé par l'IUNC, Aout 2012. Lire également
NGUINGUIRI (J. C.), « Les approches participatives dans la
gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique
centrale », CIFOR, OccasionalPaper n° 23, Juillet 1999.
* 322 LAZAREV (G.), Vers un
écodéveloppement participatif, L'Harmattan/PNUD/FENU, Paris,
1993, p. 19
* 323 NGUINGUIRI (J.)
op. cit, p. 2
* 324 La notion de
gouvernance a été utilisée et fortement popularisée
par la Banque mondiale à la fin des années 1980. Le concept a
ensuite été affiné par la communauté des
chercheurs, des consultants et des cadres des institutions internationales.
Mais en fait, la thématique de la gouvernance a aussi été
abordée dans d'autres domaines que celui du développement :
- Etude du fonctionnement des organisations collectives ou des
entreprises privées (corporategovernance) ;
- Etude des politiques publiques municipales, du gouvernement
local et de la question de la
subsidiarité (multi-levelgovernance) ;
- Gestion des biens publics mondiaux ou de la
régulation des flux de la mondialisation(gouvernance globale ou
mondiale), etc.
Toutefois, la gouvernance demeure un concept flou, mouvant et
« attrape-tout ». (PEGUI Y. F.) Gouvernance locale et
attractivité territoriale des entreprises : cas de la Ville de Douala,
Mémoire de Master II recherche en Sciences économiques, option
économie du territoire, de l'environnement et de la
décentralisation, Université de Yaoundé II - Soa,
Yaoundé 2012, p. 33). En outre, le PNUD propose une approche globale,
une vue d'ensemble de la gouvernance. Ici, la gouvernance est
considérée comme l'exercice de l'autorité politique,
économique et administrative dans le cadre de la gestion des affaires
d'un pays à tous les niveaux. Voir Conception de la Gouvernance
« Vers l'harmonisation des conceptions de la gouvernance
?» Regards croisés de la Banque mondiale, de la
Commission européenne et du PNUD. PDF disponible sur
http://www.institut-gouvernance.org/docs/note1-irg.pdf
(consulté le 20 juillet 2014). Autrement dit, et ce dans sa conception
normative, la gouvernance désigne l'ensemble des interactions entre une
diversité d'acteurs publics et privés dans l'élaboration
et l'exécution des politiques publiques afin d'atteindre des objectifs
communs de satisfaction de l'intérêt général. On
distingue très souvent la gouvernance globale (où
interviendraient au côté et par dessus les Etats, les grandes
institutions et les acteurs privés transnationaux), et la gouvernance
locale (où le rôle de la société civile et les
entreprises locales serait mis en avant au côté des instances
décentralisées et déconcentrées de l'Etat). Pour
Jean LECA, la gouvernance locale rend compte de la recherche de nouveaux modes
d'organisation territoriale et d'une conception moderne du management local,
transcendant les politiques sectorielles. Empruntée des sciences
politiques (discipline dans laquelle la gouvernance vise les nouvelles formes
de gouvernement), cette expression souligne le caractère composite du
système d'action présidant à l'élaboration des
politiques d'aménagement du territoire et de développement
économique. La gouvernance locale ne se décrète pas, elle
est un construit dans lequel les institutions sont largement imbriquées
jouant ainsi un rôle d'intermédiation.
* 325 V. article 2
alinéa 2 de loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant loi
d'orientation de la décentralisation
* 326La gestion de la ville
désigne l'ensemble des fonctions de coordination des services
techniques, de régulation des espaces et des groupes et qui y
évoluent.
* 327 V. Préambule
de la Constitution de la République du Cameroun. V aussi le Titre X de
la Constitution de la République du Cameroun qui traite des
Collectivités territoriales décentralisées.
* 328 V. article 2
alinéa 2 de la loi n°2004/017 précitée
* 329Cette situation tient
à l'imprécision des textes quant aux mécanismes de
transfert des compétences, car aucun texte officiel ne le
précise. Les collectivités locales restent ainsi soumises
à une tutelle rigide. Une illustration remarquable de cette
rigidité de la tutelle dans la gouvernance locale de la métropole
de Douala est l'hégémonie des responsables locaux nommées
par décret présidentiel (Gouverneur de la Région,
Préfet du département et Délégué du
Gouvernement après de la Communauté Urbaine de Douala) sur les
élus locaux issus du suffrage universel (Maires). On relève par
exemple des situations où des actions menées par les
autorités de tutelle sont entreprises pour le compte des
collectivités locales sans que les organes compétents de ces
dernières (Conseils de Communauté et conseils Municipaux) n'aient
eu à en débattre.
* 330En effet, la loi
n°87/015 du 15 juillet 1987 prévoit la possibilité de
rétrocéder certaines compétences des Communes Urbaines
d'arrondissement à la Communauté Urbaine de Douala.
* 331 On peut noter ici une
structure et un fonctionnement monolithique faiblement implantée en ce
qui concerne la gestion de l'environnement et l'adoption des
préoccupations de développement durable. Car focalisée
seule sur la CUD.
* 332 LE GALES (P.),
« Du gouvernement des ville à la gouvernance
urbaine », RFSP n° 1, 1995, p. 90. Cité par
François RANGEON, « Le gouvernement local ».
PDF disponible
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/francois_rangeon.pdf_4a082d9809a71/francois_rangeon.pdf
* 333 Plan Directeur
d'Urbanisme
* 334 Plan d'Occupation des
Sols
* 335 Schéma
Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme
* 336 Nous entendons par
public ici les personnes physiques prises individuellement
(populations) ou collectivement (association, organisation, communauté
etc...)
* 337 PRIEUR (M.), Les
principes généraux du droit de l'environnement. Cours de
Droit international et comparé de l'environnement, Université de
Limoges. Disponible sur
http://www.droitsfondamentaux.prd.fr/envidroit/modules/dossiers/dossier.php?idElem=249173246.
(Consulté le 08 avril 2013).
* 338Il faut entendre par
public ici tous les acteurs sociaux qui participent ou subissent de près
ou de loin l'action du politique en matière environnement. La notion de
public énoncée dans le principe 10 de la
Déclaration de Rio reste encore floue, voire controversée. Au
sens de ladite Déclaration, il faut étendre à ce
public l'individu. Par ailleurs, la Convention d'Aarhus
distingue public de public concerné :
- En vertu de l'article 2, §4 de la Convention,
le public désigne « une ou plusieurs
personnes physiques ou morales et, conformément à la
législation ou à la coutume du pays, les associations,
organisations ou groupes constitués par ces personnes ».
Au vu de cette définition large, nous considérons que le
public au sens de la convention équivaut aux
populations.
- L'article 2, §5 de la Convention définit le
public concernécomme « le public qui est
touché ou qui risque d'être touché par les décisions
prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt
à faire valoir à l'égard du processus
décisionnel ». Les ONG qui oeuvrent en faveur de
la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions
pouvant être requises en droit interne sont
présumées être membres du public
concerné.
* 339 Lire à ce
propos PRIEUR (M.), « Le droit à l'environnement et les
citoyens : la participation », RJE, 1988-4, p. 397;
MORAND-DEVILLER (J.), « Les réformes apportées au
droit des associations et de la participation publique », RFDA,
1996-2, p. 218. Voir aussi, dans le même sens, les Directives de l'Union
Européenne n°s2003/4/CE et 2003/35/CE, respectivement du 28
janvier et du 26 mai 2003, sur le droit à l'information et à la
participation publique aux décisions environnementales ainsi que le
droit d'accès à la justice dans la même matière.
* 340GUILLIEN (R.), VINCENT
(J.), et al. Lexique des termes juridiques, Dalloz,
Paris, 2001, p. 404
* 341 La participation
entre dans toutes politiques publiques dans un Etat de droit. Ainsi, on
retrouve ce principe dans divers instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme. Notamment :
Selon l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi
est l'expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leur
représentants, à sa formation (...) ».
Selon l'article 21 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme : « Toute personne a le droit de
prendre part à la direction des affaires publiques de son pays
(...). Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
»
Selon l'article 25 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques : « Tout citoyen a le droit et la
possibilité (...) de prendre part à la direction des
affaires publiques (...) ; d'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux fonctions publiques de
son pays »
Selon l'article 13 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels : « Les Etats
parties (...) reconnaissent le droit de toute personne à
l'éducation (...). Ils conviennent (...) que l'éducation doit
mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une
société libre (...) ».
* 342AOUSTIN(T.), La
participation du public aux plans et programmes relatifs à
l'environnement, Mémoire de DEA, Université de Limoges,
Limoges, 2004, p. 7
* 343 Fondée sur
l'idée que la protection de la biosphère est
l'intérêt commun de l'humanité, la protection de
l'environnement y est revendiquée comme un droit. Source de
droit pour les individus, impliquant une intervention positive des
Etats, le droit à l'environnement est aussi source de devoirs
pour eux et leur impose l'obligation de participer à la
protection de l'environnement. Conçu comme une composante d'un
droit à l'environnement, le principe de participation a
été consacré par de très nombreux instruments
internationaux. AOUSTIN(T.),Ibid.
* 344Ibid.
* 345Elle réclame,
en son Principe 19, une information éducative sur la
nécessité de protéger et d'améliorer
l'environnement.
* 346 Le principe de
l'information, corolaire du principe de participation est ainsi posé.
Pour que chacun puisse effectivement veiller à la sauvegarde de
l'environnement, il est indispensable qu'il dispose d'informations concernant
à la fois l'état de l'environnement et les projets qui risquent
d'y porter atteinte. Ces informations pourront être soit
spontanément données par les autorités publiques, soit
sollicitées au titre de la communication des documents administratifs.
L'information fournie, quelle qu'en soit son origine, permettra alors une
participation en connaissance de cause.
* 347LE LOUARN (P.),
« Le principe de participation et le droit de l'environnement
», Revue Droit de l'environnement, n°90juillet/août
2001, p. 128.
* 348 PRIEUR (M.),
« La Convention d'Aarhus, instrument universel de la
démocratie environnementale », RJE., n°
spécial, 1999, p.17 ; Lire aussi PRIEUR (M.), « Le
droit à l'environnement et les citoyens : la
participation », RJE, 1988-4, p. 397 ; MORAND-DEVILLER (J.),
« Les réformes apportées au droit des associations
et de la participation publique », RFDA, 1996-2, p. 218.
* 349 PRIEUR (M.),
« Démocratie et Droit de l'Environnement et du
Développement », RJE, 1993, pp. 13-17 ;
* 350 Le préambule
de la Constitution du 18 janvier 1996 consacre la participation du public sous
cette formule : «Toute personne a droit à un environnement
sain. La protection de l'environnement est un devoir pour
tous... ».
* 351 Cette
consécration est beaucoup plus précise dans l'article 9 (e) de
la Loi cadre de 1996 en ces termes : « chaque
citoyen doit avoir accès aux informations relatives à
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses ; chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de
l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ; les
personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs
activités, se conformer aux mêmes exigences ; les
décisions concernant l'environnement doivent être prises
après concertation avec les secteurs d'activité ou les
groupes concernés, ou après débat public lorsqu'elles
ont une portée générale ».
* 352KISS (A. C.), La
mise en oeuvre du droit à l'environnement, problématique et
moyens, 2e conférence européenne
«Environnement et droits de l'homme», Salzbourg, 3
déc. 1980 (Institut pour une politique européenne de
l'environnement). Cité par PRIEUR (M.), Les principes
généraux du droit de l'environnement. Op cit. p.
59. Pour l'auteur, par son double aspect qui apporte à la fois droits et
devoirs aux individus, le droit de l'environnement transforme tout ce domaine
en sortant les citoyens d'un statut passif de bénéficiaires et
leur fait partager des responsabilités dans la gestion des
intérêts de la collectivité toute entière.
* 353PRIEUR (M.), Les
principes généraux du droit de l'environnement. Op cit,
p. 59
* 354 PRIEUR (M.),
Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, 2011, p. 93
* 355 Nous ne reviendrons
pas sur les développements au sujet des actions de ces associations,
étant donné que nous leur avons déjà accordé
une attention particulière. Cf. Chapitre 2, section 1,
paragraphe 2.
* 356L'article 2,
paragraphe 5 de la Convention d'Aarhus
* 357 Il s'agit de
l'émission « la minute de
l'environnement ».
* 358 Les Journées
Citoyennes de Propreté (JCP) ont été lancées en
2006, dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie des populations de la
Ville de Douala tout en impliquant chaque citoyen dans l'aménagement de
la Ville. Il s'agit de fédérer les populations autour de
l'hygiène et la salubrité pour le bien-être de tous.
* 359 V. article 20
alinéa 1 du Décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013
fixant les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental et social.
* 360 Ces
représentants sont le plus souvent les associations de défense de
l'environnement, les ONG.
* 361 PRIEUR (M.),
Droit de l'environnement, Dalloz, Paris, 2004, p. 112
* 362 Cité par
MULLER (P.), Les politiques publiques, PUF, Paris, 1990, p. 117
* 363 THOENIG (J. C.),
Analyse des politiques publiques, in (dir.) GRAWITZ (M.) et LECA (J.),
Traité de Science politique, Tome 4, PUF, Paris, 1985, p. 34
* 364 CATHELINEAU (J.),
« Les finances locales » in BENOIT (F. P.)
dirCollectivités locales, Paris 1998, cité par KUIATE
BOBNGWI (C.), Les Enjeux de l'émission obligataire par les
collectivités territoriales décentralisée : le cas de
la Communauté Urbaine de Douala, DESS, IRIC/UY2, 2006. Disponible sur
http://www.memoireonline.com
* 365 Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_urbaine_de_Douala(consulté
le 18 Aout 2014)
* 366 Source : Steve
LIBAM
https://www.cameroon-tribune.cm/
(consulté le 06 juillet 2014)
* 367 Ledit plan de
campagne est joint en annexe de ce travail.
* 368 La gestion des
déchets urbains est l'une des questions environnementales les plus
préoccupantes et les plus budgétivores pour les pays en
développement. V. NGAMBA TCHAPDA (H.),
« Décentralisation et renforcement de la gestion
urbaine au Cameroun: collecte différenciée des ordures
ménagères à douala ». PDF disponible sur
http://www.cidegef.refer.org/douala/Ngamba_Tchapda_H.doc.
(Consulté le 13 juin 2013)
* 369 Florent Mamert LOE
est le Conseiller Technique n°4 du Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, il est
aussi enseignant associé à la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Douala.
* 370 Pour être exact
dans le chiffre, le budget 2014 de la ville de Douala affecte
3 242 182 353 FCFA à l'amélioration de la gestion
des déchets solides dans la Ville de Douala. Source :
http://www.douala-city.org/downloads/157.pdf
(page consulté le 29 Aout 2014).
* 371DE BEIR (J.),
DESCHANET (E.), FODH (M.), La politique environnementale française :
une analyse économique de la répartition de ses instruments du
niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes
Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET. Disponible
sur
http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf
(Consulté le 05 juillet 2014)
* 372 Ce que l'on appelle
autrement les Centimes additionnels communaux. Les prélèvements
des centimes additionnels communaux sont estimés à 30 Mds FCFA
dans le budget-programme de la CUD pour 2014
* 373 On pense ici
nécessairement à l'appui de l'Etat et des partenaires
financiers.
* 374 Nous ne reviendrons
pas sur cette assistance, car ayant déjà fait l'objet de
développement.
* 375 En 2005, la CUD a
émis un emprunt un emprunt obligataire auprès des marchés
financiers camerounais d'une valeur faciale de 16 Mds FCFA. Cette
émission est de nature à permettre à la CUD
d'acquérir de nouvelles ressources devant lui permettre de
réaliser des travaux d'investissement.
* 376Malgré une
ambition affichée des autorités locales, via la CUD et son
partenariat avec HYSACAM, Douala ne parvient pas une gestion efficace du
traitement des déchets. Le manque de moyens, de mutualisation des
connaissances, de sensibilisation met à mal, semble-t-il, cette bonne
gestion de ce secteur très sensible dans les métropoles
urbaines.
* 377KOUAM TEAM (G.L.),
La participation des collectivités territoriales
décentralisées à la protection de l'environnement au
Cameroun, en Belgique et en France, Mémoire deMaster Droit
International et Compare de l'environnement, Université de Limoges,
Limoges, Aout 2010, p. 62
* 378 Voir CUD,
Stratégie de développement de la ville Douala et de son aire
métropolitaine, Rapport final, Décembre 2009, p. 9
* 379Ibid, p.
16
* 380 Pour information, le
CDS présente plusieurs axes stratégiques d'actions prioritaires
pour l'émergence de la ville de Douala à l'horizon 2025 :
- Axe stratégique CDS n° 1: Améliorer les
conditions de vie du plus grand nombre pour atténuer les effets de la
pauvreté
- Axe stratégique CDS n°2: Améliorer la
compétitivité économique dans l'aire métropolitaine
pour relancer les activités formelles
- Axe stratégique CDS n°3: Faire de Douala une
ville pilote en matière d'environnement
- Axe stratégique CDS n°4: Améliorer et
moderniser la conduite des actions publiques.
* 381De manière
générale, le droit de la participation du public en
matière environnementale en tant qu'instrument procédural
souffre, comme le droit matériel de l'environnement, d'un fort
déficit d'effectivité. Or, faute d'effectivité juridique
plénière, il est très malaisé d'en apprécier
l'efficacité. La configuration juridique du droit à la
participation exprime et entérine, à sa manière, diverses
réticences à l'égard de la
démocratie
participative. (Gérard MONÉDIAIRE, « Droit
de l'environnement et
participation », in SALLES (D.) (dir.)
et alii, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013,
disponible sur :
http://www.dicopart.fr/fr/dico/droit-de-lenvironnement-et-participation
(consulté le 18 avril 2013).
* 382 En effet, les
ouvrages construits il y a plus de 20 ans pour certains se trouvent
obsolètes aujourd'hui car le fort taux d'urbanisation a conduit à
l'augmentation de la proportion des espaces imperméabilisés
(habitations, chaussées...), en réduisant du même fait
l'infiltration et en accentuant le ruissellement des eaux pluviales. Bien plus,
le rejet de déchets dans les cours d'eau entraîne leur
obstruction, empêchant l'écoulement libre dans les drains en amont
et provoquant d'importantes inondations. Les dalots et les buses prévus
pour l'écoulement des eaux se trouvent donc généralement
obstrués par les alluvions et les ordures ménagères
charriées par la rivière. D'où l'impossibilité pour
ces ouvrages de permettre un bon écoulement des eaux.
* 383Il s'agit de l'Avis
d'appel d'offre n° 010/AONO/CUD/CPM/2011 du 25/01/2011 en vue
d'exécuter des Travaux de Curage et de Calibrage de Certains Drains de
la ville de Douala et Hydro-curage des réseaux enterrés du
Plateau JOSS. Disponible sur
http://douala-city.org/downloads/67.pdf
* 384 V. Cadre de
politique de réinitialisation du Projet d'assainissement liquide au
Cameroun, Rapport final, Mai 2011, p. 17. Disponible sur
http://www-wds.worldbank.org
* 385 Pour assurer une
collecte optimale des déchets dans la ville, il est
procédé à son découpage en « territoire de
salubrité urbaine » suivant des considérations
morphologiques, liées aux voies d'accès et au type d'habitat. On
a ainsi :
- Des « territoires de salubrité
entretenue » ; il s'agit des quartiers propices à
l'urbanisation (Bonapriso, Bonamoussadi, Deido, Zone de recasement de
recasement de Ndogpassi), disposant d'un réseaux de desserte interne
bien structuré, entretenu et facilitant la circulation des camions de
collecte. Ces quartiers sont tous inscrit dans le cahier de charge de
HYSACAM.
- Des « territoires de salubrité
intermédiaire » ou quartiers de type New-Bell, Bépanda,
Nyalla. Ces quartiers sont à cheval entre les plateaux et les bas-fonds
impropres à l'habitat. Ils présentent d'une part des zones
desservies pas des voies carrossables, et d'autre part des zones
enclavées difficilement accessibles aux véhicules de collecte.
Ces quartiers sont pour certains inscrits dans le cahier de charge des
prestations de HYSACAM.
Des « territoires insalubres » ou
quartiers de type Mambanda, MaképéMissoke, Newtown
Aéroport. Ce sont des quartiers essentiellement constitués des
bas-fonds inhabitables, et inaccessibles. Par conséquent, ne sont pas
inscrits dans le cahier de charge des prestations de HYSACAM.
Cette sectorisation de la collecte des ordures dans la ville
de Douala pourrait expliquer à certains égards l'état
salubre ou non de certains quartiers. Il va donc de soi que la CUD devrait
prendre toutes dispositions nécessaires non seulement pour
désenclaver les quartiers précaires, mais également
prendre des mesures adaptées pour améliorer l'état de leur
environnement.
* 386 Plus de 3 Mds FCFA
sont dépensés chaque année pour la gestion des
déchets. A titre d'illustration, le budget 2014 de la ville de Douala
affecte 3 242 182 353 FCFA à l'amélioration de la
gestion des déchets solides dans la Ville de Douala. Source :
http://www.douala-city.org/downloads/157.pdf
(page consulté le 29 Aout 2014).
* 387KEOU TIANI (F.),
Douala - Etat de l'environnement et développement
durable,L'Harmattan Cameroun, 2013, p. 180
* 388 V. TCHUIKOUA (L.
B.), Gestion des déchets solides ménagers à Douala au
Cameroun : opportunité ou menace pour l'environnement et la
population ?, Thèse précitée, pp. 188-190.
* 389Il ressort de ces
observations que la ville de Douala éprouve d'énormes
difficultés dans la gestion de ses ordures ménagères. La
Communauté Urbaine de Douala, principal acteur local en charge de ce
secteur, use des moyens disponibles pour résoudre le problème de
l'évacuation des déchets ménagers, à travers son
partenaire HYSACAM. Mais, elle semble ne pas être au bout de ses peines.
V. TCHUIKOUA (L. B.), Thèse précitée, p.
178
* 390Op. cit. pp.
191-192
* 391Ibid.
* 392 Voir Article 4 de par
Décret n°2008/064/PM, du 4 février 2008, fixant les
modalités de gestion de Fonds national pour l'Environnement et le
Développement Durable
* 393 Les
collectivités sont désormais investisseuses, puisque rien ne les
empêche d'entreprendre des investissements, car elles connaissent mieux
les réalités et les besoins qui lui sont propres.
* 394Il s'agit de la
Conférence internationale des experts en matière
d'éducation environnementale, tenue en 1975 à Belgrade
(ex-Yougoslavie).
* 395Il s'agit de la
Conférence gouvernementale sur l'éducation environnementale,
tenue en 1977 à Tbilissi.
| 


