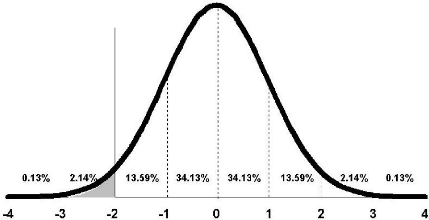|
Les facteurs associés à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée( Télécharger le fichier original )par Lansana CAMARA Institut de formation et de recherche démographiques de Yaoundé - En vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en démographie 2005 |
IV-2-4 : Variation de la malnutrition des enfants selon les variables les variables intermédiaires en
LISTE DES TABLEAUXTableau 1 : Nombre moyen d?habitants par type de personnels de santé et par région. . - 11 - Tableau 2 : Principales maladies traitées dans les centres de santé et en consultations externes des hôpitaux - 12 - Tableau 3 : Récapitulation des concepts, variables et indicateurs de l?étude. .. - 41 - Tableau 4 : Examen des taux de réponse de quelques variables de l?étude. .. - 49 - Tableau 5 : Tableau récapitulatif des valeurs des indices de Whipple et de Myers selon le sexe et pour l?ensemble de la population. - 54 - Tableau 6 : Variables anthropométriques - 55 - Tableau 7: Prévalence de la malnutrition des enfants en fonction des variables indépendantes - 69 - Tableau 8 : taux de malnutrition des enfants selon les variables intermédiaires en Guinée - 70 - Tableau 9 : Dictionnaire des variables de l?AFCM. .. - 80 - Tableau 10 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs environnementaux - 83 - Tableau 11 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs socio-économiques - 84 - Tableau 12 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs culturels - 85 - Tableau 13 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des variables intermédiaires - 86 - Tableau 14 : Récapitulatif des contributions (en %) des groupes de facteurs à l?occurrence de la malnutrition chez l?enfant. .. - 87 - Tableau 15 : Mécanisme d?action de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans. - 90 - Tableau 16 : Récapitulatif des déterminants de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée - 91 - LISTE DES GRAPHIQUES ET FIGURESI-4-4 : Carte géographique de la République de Guinée - 15 - Schéma conceptuel - 34 - b- Schéma d?analyse . - 41 - Graphique 1 : Courbe des effectifs par âge et par sexe - 50 - Graphique 2 : Courbe représentative des effectifs des femmes en Ige de procréer en groupe d?~ges quinquennaux - 51 - Graphique 3 : Courbe de rapport de masculinité - 51 - Graphique 4 : Pyramide des âges de la population - 52 - Graphique 5: La répartition des enfants selon le poids - 56 - Graphique 6: La répartition des enfants selon la taille - 56 - Graphique 7 : Répartition des enfants selon l?Lge. .. - 57 - Graphique 8: L?évolution par 1ge du rapport poids-pour-taille des enfants de moins de 60 mois selon le premier décile (D1) et les quartiles (Q1, Q2, Q3). - 60 - Graphique 9 : Niveau de vie des ménages - 62 - Graphique 10 : Répartition des enfants de moins de cinq ans selon leur état nutritionnel - 67 - Graphique 11: Taux de malnutrition des enfants selon la région de région de résidence - 71 - Graphique 12 : Taux de malnutrition selon le milieu de résidence - 72 - Graphique 13 : Taux de malnutrition des enfants selon le niveau d?instruction de la mqre. .. - 72 - Graphique 14: Taux de la malnutrition selon l?activité de la m~re . - 73 - Graphique 15 : Taux des la malnutrition des enfants selon le niveau de vie des ménages - 73 - Graphique 16 : Taux de malnutrition des enfants selon l?ethnie de la mgre . - 74 - Graphique 17 : Taux de malnutrition des enfants selon la religion de la mère - 75 - Graphique 18 : L?évolution de la malnutrition des enfants par ige. .. - 76 - Graphique 19 : caractéristiques individuelles et contextuelles des enfants par rapport à leur état nutritionnel en Guinée - 80 - LISTE DES ACCRONYMES ET ABREVIATIONSACP : Analyse en Composantes Principales ADDAD : Association pour le Développement et la Diffusion de l?Analyse des Données. AFCM : Analyse Factorielle Correspondances Multiples AGBEF : Association Guinéenne pour le Bien-être Familial ASFEGUI : Association des Sages Femmes de Guinée ASFLCM : Association des Sages Femmes pour la lutte contre les MST/SIDA ASSJFG : Association des Sages Femmes pour la Santé de la Jeune Fille en Guinée AGRETO : Association Guinéenne pour la Réinsertion des toxicomanes CEA : Communauté Economique Africaine CERREGUI : Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Guinée CLCPTNSF : Comité de lutte Contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes à la Santé de la Fille DAAF : Direction des Affaires Administratives et Financières EDS : Enquête Démographique et de Santé. EDSG : Enquête Démographique et de Santé de Guinée FAO : Food and Agriculture Organisation (Oganisation des Nations Unies pour l?Agriculture et l?alimentation). FMI : Fonds Monétaire International MST : Maladies Sexuellement Transmissibles OMS : Organisation Mondiale de la Santé ONG : Organisation Non Gouvernemetale. OPF : Option Planification Familiale OPF : Option Planification Familiale. OUA : Organisation de l?Unité Africaine. P.F : Planification Familiale PAS : Programme d?Ajustement Structurel PEV/SSP/ME : Programme Elargi de Vaccination intégré aux Soins de Santé Primaires avec fourniture des Médicaments Essentiels PREF : Programme de Réforme Economique et Financière PREF : Programme de réformes économiques et financières RGPH : Recensement Général de la Population et de l?Habitation. SIDA : Syndrome Immunitaire Déficience Acquis. SOGGO : Société Guinéenne de Gynécologie et d?obstétrique TDCI : Troubles Dus à la Carence en Iode UNFPA : United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population). UNICEF: United Nations International Children?s Emergency Fund (Fond des Nations Unies Pour l?Enfance). WHO: World Health Organization (OMS: Organisation Mondiale de la santé). RESUME DU MEMOIRELes données anthropométriques des enfants de moins de 5 ans de l?EDSG-1999 montrent qu?il existe en Guinée de réels problèmes nutritionnels. En effet, la malnutrition est distribuée de façon inégale à travers le pays, touchant particulièrement la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Le niveau de la malnutrition dans le pays est largement supérieur au seuil du 10% fixé par l?Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au dessus duquel les enfants sont considérés comme «gravement touchés » par la malnutrition aiguë. Parmi les autres facteurs, il y a la faible couverture vaccinale, notamment en milieu rural. Elle correspond en fait à un accès limité aux soins de santé primaires que la forte mortalité infantile confirme bien. Certaines mères, fortement influencées par la culture traditionnelle, ne voient pas la nécessité des vaccins. Par ailleurs les enfants sevrés après l?kge de six mois présentent un meilleur état nutritionnel par rapport à leurs congénères sevrés avant six mois. De même, les enfants allaités au sein présentent un état nutritionnel satisfaisant par rapport à ceux qui sont allaités au biberon et qui consomment des aliments solides. La malnutrition intervient moins fréquemment chez les premiers et les derniers nés. Des résultats semblables ont été obtenus dans d?autres travaux de recherche en Afrique (FAO, 1999 ; OMS, 2003 ;~). Par ailleurs, ces résultats paraissent évidents pour un spécialiste de santé, mais ils demeurent essentiels pour un planificateur en vue du renforcement des stratégies mises en oeuvre pour lutter contre la mortalité infantile due à la malnutrition en Guinée. Eu égard à ces résultats, formulons à l?intention des pouvoirs publics guinéens quelques recommandations susceptibles de réduire substantiellement la malnutrition infantile: Toute intervention visant à améliorer l?état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans doit cibler en priorité la Moyenne Guinée puis la Haute Guinée. Initier un programme de sensibilisation pour encourager les mères à vacciner leurs enfants contre les maladies infantiles. 2s. Promouvoir l?enseignement des soins santé et nutrition aux mères à travers les médias et les campagnes de Communication pour le Changement de Comportement (CCC) qui inclut également la promotion de l?allaitement maternel pendant les six premiers mois de la vie de d?un enfant. INTRODUCTIONDans les pays en voie de développement, la malnutrition sévit surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Elle est étroitement associée aux infections, expliquant le rôle important lui est attribué dans plus de 50% des 12 millions de décès d'enfants par an (OMS, 2003). Fort de cela, le contrôle d'un problème si grave est indispensable et l'amélioration de la nutrition des populations est devenue une préoccupation centrale et un objectif majeur. En effet, depuis la conférence internationale sur les soins de santé primaires d?Alma Alta (1978) dont la préoccupation majeure a été de protéger et de promouvoir la santé de tous les peuples du monde à l?horizon 2000, beaucoup d?efforts ont été consentis par les gouvernements du monde dans la lutte contre la mort ; notamment la baisse de la mortalité infanto-juvenile découlant des efforts consentis pour éliminer les principales causes de décès, à travers les programmes de la vaccination, l?amélioration des conditions de vie des populations, de la nutrition et l?hygiqne. Malgré ces multiples efforts, on observe encore d?importantes disparités dans certains pays et entre différents pays (OUA /UNICEF, 2000). Face à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans encore élevée dans la plupart des pays africains en général et en Guinée en particulier, une attention particuli~re mérite d?être accordée aux causes de ce phénomène qui ne cesse de prendre de l?ampleur et qui est pourtant évitable ou peut tout au moins être amoindri. Outre les souffrances qui en résultent, la perte du potentiel humain entraîne des coûts économiques et sociaux qu'aucun pays ne peut supporter. C?est pourquoi, dans le souci de ressortir les pistes de contrôle de ce problème de santé, il serait intéressant d?identifier les facteurs contribuant à sa persistance dans ces pays. Ainsi, elle a suscité l?intérêt chez bon nombre de chercheurs de plusieurs disciplines scientifiques (agriculture, santé, environnement, éducation, démographie, médecine, économie, etc.). Ceux-ci ont apporté un éclairage appréciable dans la connaissance des déterminants, des niveaux et des tendances du phénomène (Rwenge, 1993). Les études économiques, épidémiologiques, démographiques, géographiques, etc. ont montré que l'état nutritionnel d'une population est à la fois facteur et conséquence du développement. Ces études estiment que son contrôle est possible si l'on maîtrise les facteurs qui le déterminent. En Afrique Subsaharienne, il existe de fortes disparités géographiques, économiques et socioculturelles en matière de nutrition. La Guinée n?échappe pas à cette situation qui conduit jà une variation de la malnutrition des enfants. En effet, selon l?Enquête Démographique et de santé réalisée dans ce pays en 1999, 9,1% des enfants de moins de cinq ans sont atteints de malnutrition aiguë. Par ailleurs la FAO1, estime que le taux d?émaciation est supérieur à 10% au niveau national en 1999. En outre, les taux d?émaciation sont supérieurs à 12% dans toutes les régions, excepté en Guinée Foresti~re, ce qui montre qu?il existe en Guinée de réels problèmes nutritionnels car l?OMS fixe à 10% le seuil au-delà duquel une population est gravement touchée par la malnutrition aiguë. Il nous semble important d?étudier particulièrement les facteurs explicatifs de la malnutrition en vue de proposer aux pouvoirs publics guinéens des recommandations susceptibles de renforcer les stratégies de lutte contre la mortalité et la morbidité des enfants dues à la malnutrition. La malnutrition est un des principaux problèmes de santé publique et de bien #177;être qui affectent les enfants de moins de cinq ans en Guinée. Elle résulte tout autant d?une alimentation inadéquate que de certaines maladies infectieuses (rougeole, parasitoses, gastro-entérite,~). Une alimentation inadéquate est le résultat d?une insuffisance de la nourriture disponible au niveau du ménage et de pratiques alimentaires inadaptées. Celles-ci font référence non seulement à la qualité et à la quantité des aliments donnés aux enfants qui, à leur, tour affectent l?état nutritionnel de ceux-ci, mais aussi aux étapes de leur introduction. Les mauvaises conditions d?hygi~ne alimentaire et environnementale augmentent le risque de contracter notamment des maladies diarrhéiques, qui détériorent l?état nutritionnel des enfants. La santé est une condition essentielle du bien-être des individus et un objectif fondamental du développement social et économique (Banque mondiale, 1994). Il ne suffit pas de recenser avec précision les individus souffrant de malnutrition pour élaborer une politique de réduction de la malnutrition. Mais il faut également identifier les facteurs qui sont à l?origine de cette situation alarmante sur le plan sanitaire. A premiqre vue, on pourrait croire que l?explication est simple : l?individu est mal nourri parce que le ménage n?a pas les moyens de lui procurer assez de nourriture de bonne qualité. C?est la th~se cél~bre défendue par A. Sen (1998). La malnutrition ne résulte pas seulement d?une offre insuffisante de produits alimentaires mais aussi d?une demande inadéquate, les ménages pauvres ne pouvant pas acheter des produits qui sont disponibles même dans les pays à faible PIB/habitant. Il ressort de la littérature que la diversité géographiques, climatiques et ethniques en Guinée rendent intéressante et nécessaire l?analyse de la malnutrition des enfants de moins de 1 FAO (1999) : Aperçus Nutritionnels par Pays - GUINEE 4 février 1999. Les données présentées dans cette étude sont obtenues des pays eux-mêmes et des banques de données internationales (FAO, OMS...). cinq ans (Tolno, RGPH, 1996). Par ailleurs, Ngwe et collaborateur (1993) pensent que l?inégalité du statut nutritionnel est énormément influencée par les facteurs économiques et socioculturels. Ils notent que les facteurs climatiques ne sont pas forcément les plus déterminants dans l?explication du statut nutritionnel. Les facteurs socio-économiques et culturels via le comportement des individus sont importants, surtout dans un contexte de crise économique persistante comme cela est le cas pour la Guinée. Partant de ces constats, la présente étude se propose de répondre à la question suivante : Quels sont les facteurs associés à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée ? Plus spécifiquement l?étude s?emploie à apporter réponses aux questions ci-dessous : Q1 : Quel est le profil des enfants malnutris ? Q2: Qu?est ce qui explique les inégalités observées au niveau de l?état nutritionnel des enfants ? Q3 : Quelle est l?influence respective des comportements des parents en mati4re d?alimentation et de santé et des autres facteurs sur l?état nutritionnel des enfants ? L?objectif général de cette étude est de contribuer à l?amélioration des connaissances sur les déterminants de la malnutrition des enfants en Guinée. Les résultats de l?étude pourront aider les acteurs dans le secteur de santé et les décideurs politiques guinéens à améliorer les stratégies actuelles de santé infantile et aussi à réduire le nombre élevé des décès infantiles attribuables à la malnutrition. Plus spécifiquement, l?étude cherche à : > Evaluer le niveau de la malnutrition et ses variations spatiales et en fonction de certaines caractéristiques de la population. > Caractériser les enfants par rapport à leur état nutritionnel. > Identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d?expliquer la malnutrition des enfants. > Déterminer le rôle des comportements des mères en matière de soins et d?alimentation dans le schéma explicatif de l?état nutritionnel des enfants. L?étude s?articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre porte sur le contexte national. Le deuxième chapitre dresse un état des lieux de la recherche sur les déterminants de la malnutrition des enfants en Afrique. A partir des éléments de cette revue de la littérature, nous dégageons le cadre conceptuel de l?étude, énonçons les hypoth~ses de recherche et construisons notre modqle d?analyse. Le troisi~me chapitre présente la méthodologie adoptée pour mener cette étude et présente les données utilisées. Le quatrième et le cinquième chapitres sont consacrés jà l?analyse des données. CHAPITRE I CM 17 (; 7 ( ' ( L'(7 8 ' (L?étude des phénomqnes démographiques n?a de sens que si elle est menée par rapport au contexte géographique, politique, économique et socioculturel dans lequel les phénomènes abordés se manifestent et se développent ; ce chapitre porte ces différents aspects. I-1 : MILIEU PHYSIQUELa Guinée est située à l?Ouest du continent africain et limitée à l?Ouest par la Guinée Bissau et l?Océan Atlantique, au Nord par le Sénégal et le Mali, à l?Est par la Côte d?Ivoire et au Sud par la Sierra Léone et le Libéria. Avec une superficie de 245.857 Km2, ce pays présente une grande diversité du milieu naturel : les effets combinés du climat, de la végétation et du relief engendrent quatre régions naturelles distinctes. La Basse Guinée est une vaste plaine côtière de 50 à 90 Km de large, avec un climat chaud et humide. Elle est marquée par une pluviométrie particulièrement abondante (3.137mm par an), notamment sur la côte où souffle la mousson. L?abondance des pluies et la végétation luxuriante expliquent en partie la fréquence de certaines maladies comme le paludisme et les diarrhées dans cette région. L?arrivée massive des réfugiés Sierra-léonais et libériens dans cette région a accru la pression sur les ressources alimentaires disponibles, entraînant ainsi une aggravation des problèmes alimentaires et nutritionnels. Or, selon les statistiques disponibles au Ministère de la santé, la sous-alimentation et la malnutrition sont parmi les principales causes de morbidité et de mortalité au niveau national. La Moyenne Guinée est une région essentiellement montagneuse au climat foutanien, marqué par des températures relativement basses de novembre à mai. La pluviométrie y atteint 1.823 mm par an. L?environnement est menacé par la dégradation des sols, liée au surp1turage et à l?agriculture extensive sur br~lis. Cela a un impact négatif sur la production agricole et entraîne ainsi des probl~mes d?alimentation pour la population en général et les enfants en particulier. La haute Guinée est une région
de savane, caractérisée par le climat sud-soudanien chaud
et faible (1.558 mm). Certains cours d?eau sont infectés et favorisent la prolifération des maladies telles que l?onchocercose et la bilharziose. La pratique fréquente des feux de brousse par les populations constitue un des principaux problèmes environnementaux que connaît cette région. Cette pratique contribue à l?appauvrissement des sols et, par conséquent, à la baisse de la production alimentaire. La Guinée forestière est caractérisée par une forêt dense humide liée à une pluviométrie relativement abondante (2.249 mm). La chaleur humide favorise la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme qui constitue l?une des principales causes de morbidité et de mortalité du pays, en particulier dans cette région. Comme la Basse Guinée, la Guinée forestière a connu un flux massif des réfugiés Sierra-léonais et Libériens. Ce phénomène a également accru la pression démographique sur les ressources alimentaires. Conakry étant une zone spéciale des régions, elle est particulièrement marquée par des probl~mes d?habitat liés à la pression de la demande sur l?offre insuffisante de logements et à la précarité des habitations. A cela s?ajoute l?insalubrité caractérisée par des syst~mes d?évacuation des eaux usées et des ordures ménagères inappropriés. Pour terminer, il convient de noter que les besoins de la population en eau potable sont considérables et ne sont pas couverts par les infrastructures existantes. En 1992, environ 37% des ménages disposaient de l?eau courante à domicile ; 39% des ménages utilisaient l?eau des puits ordinaires ou des cours d?eau (EDS, 1992). La situation est encore pire en milieu rural où jà peine 10% disposent de l?eau courante, contre plus de 61% en milieu urbain. Ce déficit en eau potable est un facteur déterminant de la prévalence de maladies infectieuses et parasitaires. 1-2 : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUESD?apr~s les résultats du dernier recensement, la population guinéenne était évaluée à 7.156.406 habitants en 1996. Le taux d?accroissement annuel moyen est de 3,1% pour la période intercensitaire (1983-1996). Cette population qui est majoritairement constituée de femmes (51%), est très inégalement répartie sur le territoire national. En effet, il existe de grandes disparités de peuplement, d?une part, entre les unités administratives (Régions administratives, Préfectures et Sous-préfectures) et, d?autre part, entre les régions naturelles et à l?intérieur de celles-ci. La densité moyenne du pays est de 29 habitants au km2. Au niveau des préfectures, elle varie de 10,7 habitants au km2 à Kouroussa (Haute Guinée) à 112,3 habitants au km2 à Labé (Moyenne Guinée). Les préfectures les moins peuplées se trouvent en haute Guinée, qui a une densité moyenne de 14,2 habitants contre plus de 30 habitants dans les autres régions. Conakry a une densité moyenne nettement plus forte (2.429 habitants au km2). La population guinéenne vit essentiellement en milieu rural (70%) mais plus de sa moitié (51%) réside dans la capitale. Le rythme d?accroissement de la population urbaine, plus accéléré (4,1%), est à l?image de la plupart des pays de la Sous-région. En dehors de Conakry qui abrite plus d?un million d?habitants, les deux autres grands centres urbains sont N?zérékoré et Kankan, avec chacun plus de 100.000 habitants. Le poids des personnes 1gées de moins de 15 ans (46%) traduit l?extrême jeunesse de la population guinéenne, qui se confirme par la faiblesse de ses âges moyens (23 ans) et médian (14,9 ans). C?est la conséquence d?une fécondité élevée, caractérisée par sa précocité et sa stabilité, en dépit de tous les efforts de sensibilisation menés par les programmes de planification familiale et de santé de la reproduction. Le taux brut de natalité est estimé à 39,7%0. Quant à la mortalité, son niveau reste encore plus élevé (taux brut de mortalité estimé à 14,2%0), même si sa tendance est incontestablement à la baisse. L?espérance de vie à la naissance est de 54 ans, avec une différence à l?avantage des femmes (55,4 ans contre et 52,7 ans chez les hommes). La mortalité infantile, quant elle, s?él~ve à 121 déc4s d?enfants de moins d?un an pour 1.000 naissances vivantes. Par ailleurs, sur 1.000 enfants ayant survécu à 1 an, 92 enfants décqdent avant l?kge de 5 ans. Au total, sur 1.000 enfants qui naissent, environ 200 meurent avant l?~ge de 5 ans. A l?instar des indicateurs de la mortalité générale, ceux de la mortalité infantile et juvénile sont un peu plus élevés chez les garçons que chez les filles quel que soit le milieu de résidence. La mortalité maternelle est assez élevée et tourne autour de 600 décès maternels pour 100.000 naissances. La population guinéenne est aussi affectée par d?intenses mouvements migratoires internes qui font de la Moyenne Guinée et de la Haute Guinée des régions d?émigration à destination de la Guinée forestière et de la Basse Guinée. Quant à la migration internationale, elle reste encore tr~s peu importante, malgré l?ouverture du pays à l?extérieur depuis 1984. Toutefois, la Guinée a enregistré l?afflux de plus d?un demi-million de réfugiés libériens, Sierra Léonais et Bissau Guinéens, à la suite des conflits armés qui ont éclaté dans ces pays frontaliers au courant des années. 1-3 : SITUATION SANITAIRE1.3.1 : Politique et programmes de santéLa politique sanitaire repose sur la stratégie des soins de santé primaires. Cette stratégie consiste à rendre accessibles géographiquement, culturellement et financièrement les soins de santé à l?ensemble de la population guinéenne. Elle s?appuie sur les composantes suivantes : - l?intégration harmonieuse des soins curatifs, préventifs et promotionnels ; - la promotion de la santé individuelle, familiale et communautaire ; - la participation des bénéficiqres à la conception, à l?exécution et à l?évaluation des programmes de santé. Le but de la politique sanitaire du gouvernement est d?améliorer la santé de l?ensemble de la population par la réduction de la morbidité et de la mortalité, notamment celles des groupes les plus vulnérables que sont les mères et les enfants. Les principaux objectifs de cette politique sont : - assurer la disponibilité des services de santé de qualité et à un coût abordable à tous les niveaux; - mettre à la disposition des populations des services de santé géographiquement accessibles et culturellement acceptables ; - assurer la viabilité et la pérennité du système sanitaire. Les premiers programmes ont été élaborés et exécutés à partir de 1988. Parmi les plus importants, on peut citer : - les programmes de lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës et les maladies nutritionnelles chez l?enfant ; - les endémies telles que la lpre, la tuberculose, l?onchocercose, les troubles dus à la carence en iode (TDCI) ; - les MST et le SIDA ; - le PEV/SSP/ME; - les programmes de promotion de la santé de la reproduction et de l?allaitement maternel ; - la lutte contre les carences en micronutriments, eau et assainissement et santé mentale. La mise en oeuvre de ces programmes a contribué à l?amélioration de l?état de santé des populations entre 1988 et 1992. En effet, la mortalité infantile est passée de 149%0 en 1983 à 136%0 pour la période de 1988 et 1992 (EDS 1992). De même, l?espérance de vie à la naissance estimée à 45 ans en 1983 serait passée à 50 ans en 1991. 1-3-2 : Infrastructures sanitaires et médicamentsLe pays compte 898 formations sanitaires réparties comme suit : 330 centres de santé, 240 postes de santé, 28 hôpitaux préfectoraux (y compris les deux hôpitaux d?entreprises de Fria et Kamsar), 7 hôpitaux régionaux, deux hôpitaux nationaux (Donka et Ignace Deen), deux centres médico-communaux, 104 cabinets privés et 213 pharmacies. Cependant, la plupart de ces formations sanitaires rencontrent d?énormes difficultés pour leur fonctionnement, en raison de leur sous-équipement. Les médicaments occupent une place primordiale dans le système de santé en GUINEE. D?importantes mesures ont été prises pour assurer leur disponibilité et leur utilisation. La distribution des médicaments est assurée aussi bien par le secteur formel public et privé que par le secteur informel. Soumis à aucun contrôle, celui-ci met en danger la santé et la vie de la population. A cela s?ajoute la pratique de l?automédication répandue dans le pays. En ce qui concerne le secteur privé en particulier, le développement des structures sanitaires est récent. Celles-ci sont inégalement réparties dans le pays. Plusieurs ONG interviennent également dans le domaine de la santé. On peut citer, entre autres : l?Association Guinéenne pour le Bien-être Familial (AGBEF), le Plan International Guinée, l?Option Planification Familiale (OPF), l?Association des Sages Femmes de Guinée (ASFEGUI), le Comité de lutte Contre les Pratiques Traditionnelles Néfastes à la Santé de la Filles (CLCPTNSF), l?Association des Sages-Femmes pour la lutte contre les MST/SIDA (ASFLCM), la Société Guinéenne de Gynécologie et d?obstétrique (SOGO), Cellule de Recherche en Santé de la Reproduction de Guinée (CERREGUI) , SIDALERTE Guinée ; l?Association des Sages Femmes pour la Santé de la Jeune Fille en Guinée (ASSJFG) et l?Association Guinéenne pour la Réinsertion des toxicomanes (AGRETO). 1-3-3 : Personnel médicalLe nombre d?habitants par médecin est de 8.048. Ce ratio est meilleur que ceux enregistrés dans les pays voisins en 2000. Cependant, on note une insuffisance du personnel qualifié (médecins spécialistes, dentistes, sages-femmes, infirmiers spécialisés), des gestionnaires et des administrateurs sanitaires. Le nombre d?habitants par sage femme, Aide de santé et Agent technique de santé est respectivement de 21.310, 5.261 et 2.975. Ce personnel de santé est inégalement réparti entre le milieu rural et les centres urbains, ainsi qu?entre les régions et à l?intérieur de celles-ci. Conakry est nettement plus favorisé que le reste du pays (Tableau 1). Tableau1 : Nombre moyen d'habitants par type de personnels de santé et par région.
Source : Fichier du personnel de la direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF) du Ministère de la santé, 1996. Pour atténuer ces inégalités, le Gouvernement a élaboré, en 1990, un plan de redéploiement du personnel médico-sanitaire. Cependant, sur le terrain, son application se heurte à de nombreuses difficultés liées, entre autres, à l?enclavement de certaines zones en milieu rural. Par ailleurs, la productivité du personnel, sa motivation et son niveau de formation sont dans l?ensemble faibles. 1-3-4 : Profil épidémiologiqueMalgré les progrès accomplis au cours de la période 1985-1991, la situation sanitaire de la population guinéenne demeure préoccupante. Les niveaux de morbidité et de mortalité sont élevés. Les maladies infectieuses et parasitaires telles que le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques sont prédominantes. En outre, on assiste à la résurgence de certaines maladies autrefois en voie d?éradication (la trypanosomiase humaine et la tuberculose). L?onchocercose et la lZpre sont en déclin ; l?incidence de la méningite et du choléra reste préoccupante. A ces principales maladies s?ajoute le SIDA dont l?impact démographique est pour le moment difficile à évaluer à cause de l?incertitude des statistiques disponibles sur cette pathologie. Le paludisme, les infections respiratoires et les helminthiases sont les premières pathologies traitées dans les structures sanitaires en 1996 (tableau 2). Toutefois, ce classement YECI1-Ls1-IRnLl1-sLINKF,K1-sLAId1-s. Lik,K1-z Ll1-AL1-AJECIsLE1-LP RInsLdVnLIn, Ll1- LSM1i3P 1-, Ll1-sLinJ1-FtiRnsL respiratoires aiguës et la diarrhée prédominent. La malnutrition des enfants est parmi les causes de décès infantile en Guinée. Tableau 2 : Principales maladies traitées dans les centres de santé et en consultations externes des hôpitaux en 1996
Source : Annuaire des statistiques sanitaires, Guinée, 1996. Le paludisme, les infections respiratoires et les helminthiases
sont les premières pathologies les tranches d?~ges. Chez les enfants de moins d?un an, le paludisme occupe de loin la premiqre place avec 46% des cas suivi des maladies diarrhéiques avec 26% des cas et des helminthiases (6%). Chez les enfants de 1 à 4 ans, le paludisme est prépondérant avec 36% des cas suivi des infections respiratoires aiguës (23%) et des helminthiases (16%). 1-3-5 : Couverture vaccinaleEn 1992, environ 3 enfants de moins de 5 ans sur 10 étaient vaccinés contre les maladies l?enfance en Guinée (EDS, 1992). Plus de 60% d?enfants l?ont été au moins une fois, par contre 36,4% des enfants n?ont jamais été vaccinés. Le taux de vaccination le plus élevé est observé à Conakry, ville au sein de laquelle, un peu plus d?un enfant sur deux a été vacciné contre toutes les 6 maladies du PEV/ SSP/ ME. La haute Guinée demeure, quant à elle, la région qui a enregistré le plus faible taux avec un peu plus d?un enfant vacciné sur 5. Aussi, si en milieu urbain près de la moitié des enfants sont vaccinés, dans les zones rurales, sur 5, un peu plus d?un enfant l?est. En dehors de quelques exceptions, ces taux sont fortement corrélés avec les niveaux de mortalité infantile et juvénile. 1-4 : CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 1-4-1 : Revenu des populations Selon les résultats de l?Enquête Intégrale sur les Conditions de vie des ménages avec module Budget Consommation réalisée en 1994, environ 40% des guinéens vivent en dessous du seuil de pauvreté (revenu inférieur à 293.714FG, soit 300$ US). Environ 15% de populations vivent dans une situation d?extrême pauvreté (revenu inférieur à 172.284 FG, soit 180$ US). Cette situation exclut la majorité de la population du système de soins de santé. 1-4-2 : Effet du Programme de Réformes Economiques et Financières (PREF) sur la santé de la population.A partir de 1985, le gouvernement, en collaboration avec les bailleurs de fonds (IDA, FMI), a entrepris un ambitieux programme de réformes économiques et financières (PREF), qui a bénéficié d?un appui financier des bailleurs de fonds (IDA, FMI)., Ce programme visait les objectifs suivants : - réduire le poids de l?Etat dans la conduite des activités économiques ; - réduire et renforcer son rôle dans l?orientation de la politique économique ; - promouvoir le secteur privé. Si l?application du PREF a permis d?enregistrer des résultats encourageants dans maints domaines, au plan social, la dévaluation de la monnaie nationale a par contre provoqué des tensions inflationnistes affectant les marchés des biens et services de base, en particulier en milieu urbain. A titre d?illustration, les prix des produits alimentaires ont plus que triplé entre 1986 et 1991, ces mêmes prix ont quadruplé entre 2003 et 2004 à Conakry. Ceux des médicaments importés par le secteur privé formel et les services de santé ont été multipliés par 3,25 en 1991 et 4,50 en 2004. Au même moment, l?augmentation du taux de chômage a contribué jà la réduction du revenu par tête. Par ailleurs, l?accroissement des besoins sanitaires d?une part et la réduction des ressources financiqres de l?Etat, d?autre part, ont eu pour corollaire la dégradation du système national de santé. 1.4.3. Alphabétisation des femmesSelon la définition retenue par le recensement de la population de 1996, une personne est dite alphabétisée lorsqu?elle sait à la fois lire et écrire dans une langue quelconque, nationale ou étrangère. La conséquence de la faible scolarisation et de la faible instruction des femmes se traduit par leur analphabétisme élevé. Environs 8 femmes sur 10 sont illettrées. Seul un quart de femmes est alphabétisé, avec le taux le plus faible en Haute-Guinée et le plus élevé à Conakry. Parmi celles qui sont alphabétisées, le français constitue la langue d?alphabétisation la plus courante ; moins d?une femme sur 100 est alphabétisée en arabe ou en langue nationale. I-4-4 : Carte géographique de la République de Guinée
Source : www.ortcoop.free.fr/guinee/guinea2
II-1 : SYNTHESE DE LA LITTERATURE SUR LES DETERMINANTS DE LA MALNUTRITIONIl ressort de la littérature sur les facteurs affectant la malnutrition des enfants de moins de cinq ans plusieurs études empiriques, nous nous intéressons aux approches suivantes : l?approche environnementale, socio-économiques et culturelle. II-1-1 : Les facteurs environnementauxDans le cadre de cette étude, l?environnement est appréhendé à travers la région de résidence, le milieu de résidence et les conditions climatiques, qui sont des facteurs variant selon la région naturelle de résidence des enfants. Ainsi, le climat peut influencer différemment l?état nutritionnel de ces derniers en fonction de leur région. II-1-1-a : La région naturelleUn regard sur les indicateurs produits par des travaux descriptifs et des analyses de l?EDS-Guinée sur l?état nutritionnel des enfants, permet de constater que la prévalence de la malnutrition varie selon la région naturelle. En effet, 26% des enfants de moins de cinq ans accusent un retard de croissance en Basse Guinée, 24% en Moyenne Guinée, 27% en Haute Guinée, 331% en Guinée Forestière et 16% à Conakry (EDS-Guinée, 1999). Toutefois, il est difficile de déterminer les facteurs qui peuvent être à l?origine de cette variation, compte tenu des spécificités des quatre régions, observables notamment au niveau des caractéristiques suivantes: le climat, la culture, le développement économique et les ressources naturelles. Ces caractéristiques ont une incidence sur le régime alimentaire des populations résidentes qui, à son tour, est susceptible d?expliquer les disparités régionales de la malnutrition des enfants (Agbessi et al, 1987). Au Cameroun par exemple, Ngo Nsoa (2001) a montré qu?il existe des inégalités régionales de la malnutrition et que ce phénomène ne frappe pas avec la même acuité les enfants dans les différentes régions de ce pays. L?auteur explique cette situation par l?inégale répartition de la disponibilité alimentaire, des ressources en eau potable et des centres de santé maternelle et infantile. En ce qui concerne particulièrement la disponibilité des aliments sur le marché, il convient de souligner l?importance du niveau de vie des ménages qui conditionne l?accqs à ces aliments. II-1-1-b : Le climatEn Guinée, les régions sont des unités administratives qui représentent des entités différentes entre elles sur plusieurs plans. Les spécificités de ces entités peuvent influencer différemment l?état nutritionnel des enfants, comme cela a été montré par Akoto & al, (1989). Le climat intervient considérablement dans la chaîne causale de la santé des enfants en Afrique subsaharienne pour l?amélioration ou la dégradation de l?environnement. Le climat a trois composantes principales qui varient selon la région naturelle la température, l?humidité de l?air et les précipitations. Il existe deux saisons en Guinée qui s?étendent chacune sur une période de 6 mois : la saison sèche et la saison pluvieuse. Cette situation des pluies renvoie à la saisonnalité de la malnutrition due à la variation des trois composantes climatiques. Celles-ci conditionnent la disponibilité en eau, dans les zones sans adduction d?eau, lorsqu?on sait la consommation directe de l?eau de mauvaise qualité ou son usage pour la préparation des aliments, surtout pour les aliments de sevrage du nourrisson, expose à la morbidité (Ngo Nsoa, 2001). Nombre d?auteurs ont identifié le climat comme déterminant de la malnutrition, de la morbidité et de la mortalité des jeunes enfants (Leton, 1979 ; Gaigbe ,1986 ; Akoto & Hill, 1988; Dackam & al, 1993 ; Cantrelle, 1996). Leurs études ont montré que le climat peut influencer directement en favorisant la régulation thermique ou indirectement,dans certaines régions que d?autres, en dégradant l?environnement par la pollution de l?eau et des ressources en alimentation. Cela favorise l?apparition de certaines maladies infectieuses qui affectent à leur tour l?état nutritionnel des enfants. Les fluctuations locales des conditions climatiques qui exercent une influence sur la qualité des sols peuvent induire des variations dans la production agricole. Cette dernière est susceptible d?affecter de façon inégale l?état nutritionnel des enfants, car à chaque climat 1 correspond un type de végétation et des ressources végétales et animales spécifiques. Les individus se nourrissent différemment selon les ressources alimentaires disponibles dans leurs régions de résidence. Le climat détermine donc en partie la façon dont les populations se nourrissent (Agbessi & al, 1987). II-1-1-c : Le milieu de résidence :En matière de nutrition, il existe des disparités spatiales selon le milieu de résidence car les enfants ruraux et urbains ne sont pas exposés aux mêmes risques de malnutrition. En effet, OE vIUIIEMEvEQtEgI EIKESRAIlin?XQIPErlpytTEI ISIR(Xits EliP IQtEirII referment les vitamines sXERI IP EIFK0 731XQIISIRSRLIERQ iP SRLIEQtI des personnes instruites et quantité élevée des structures et des équipements sanitaires. Les causes de la malnutrition ne sont pas identifiées avec précision, la pauvreté semblant toutefois jouer un rôle important, mais uniquement dans le AIQA031XQI 11IlEAINI SIRtIFIRQIdIs FlEAAIAIII SlXs riFKIs (IQ dIssRXs dIsqXIllIs lE sitXEtiRQ paraît uniformément mauvaise). Il en est de même pour les foiP EIIRQsIEQitEILIN IFIIIt CEQs lIs vilOIsTIQ gpQtIEl II dans la capitale en particulier que se concentrent les hôpitaux de référence (Ntsame, 1999). IL découle de ce qui précède que le milieu de résidence exerce une influence sur les pratiques alimentaires des parents. En milieu rural et en économie de subsistance, les dépenses d'énergie peuvent varier considérablement d'une période de l'année à l'autre, suivant le calendrier des activités agricoles. C'est souvent au P RP IQt ESSIlrSpriRdI dI sRXdXrI»I TXe les disponibilités alimentaires sont au plus bas: les greniers à céréales sont vides et les gens commencent alors à puiser dans leurs réserves internes pour maintenir une activité normale. Ils maigrissent et, si aucune solution n'est envisagée, ils pénètrent dans le cercle infernal et vicieux de la malnutrition que nous analyserons dans le chapitre sur les déséquilibres alimentaires. En ce qui concerne les enfants, il faut considérer que leurs besoins énergétiques sont étroitement liés à la vitesse de croissance: plus grande est la vitesse de croissance, plus l'enfant a besoin d'énergie pour bâtir ses nouveaux tissus. Or la vitesse de croissance est très élevée chez les plus petits (un enfant double son poids à environ 5 mois et le triple à 10 mois). La vitesse de croissance diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit. II-1-2 : Les facteurs socio-économiques/RrsqX?XQI fEP IOIIIIt SEXvrI, EFI TARQNIA P IP ErIA lIsISlXMIXQIA 1Xi FRXrIQt lINSlXs grands risques : leurs droits à la survie, à la croissance et au développement sont menacés. Or sXIELEIIQfEQts qXI QEBAIQt EXjRXrd?KXi dEQs lI IP RQoIlIQ d0I1RSSIP IQt, qXEtIIINLYIRQt dEEK une pauvreté extrême (OUA/UNICEF, 1990). Cette pauvreté détermine toutes les conditions de l?IxBtIQTI, Ey EFRP SrAME P ElQXtIEiRQ, UI P EQIXIId?IEXCsElXErI, Il?EEsIQFI 243TXiSIP IQtN AEQitEEIl Eq3qXEWItIP rP IllEKXrOIRdI111I1 1C?Ist lE SIiQFISElIIFEXAI ARXs-jacente de millions de décqs évitables et la raison pour laquelle les enfants sont mal nourris, ne vont pas à l?école, subissent de mauvais traitements et sont exploités (UNICEF, 1998). On en déduit que la pauvreté est au coeur des violations constantes des droits des enfants. II-1-2-a : L'activité économique de la mqreLorsque la mqre est instruite et que c?est elle qui se charge de la préparation de la nourriture de son bébé, il n?existe pas de probl~me de malnutrition manifeste, les aliments de complément étant riches sur le plan nutritionnel : le lait en poudre (Guigoz, Nido, Klim, Céréal, lait concentré, , Cr~me de riz, Phosphatine, ). Tous ces produits importés sont de bonne qualité et, en raison d?un pouvoir d?achat suffisant, les mqres peuvent se les procurer aisément. Mais la préparation de ces aliments, et surtout du lait en poudre, peut être défectueuse ; en particulier, lorsque les mères travaillent hors de la maison familiale, la préparation de ce lait est assurée par les filles ou les grandes mères qui assurent la garde des enfants mais ne possèdent généralement pas de notion d?hygiqne ; d?où l?apparition des gastro-entérites chez l?enfant. Dans ce groupe des femmes instruites, le lait et ses dérivés constituent l?aliment de base. Elles pratiquent beaucoup plus l?alimentation artificielle pour l?enfant, la fréquence de l?allaitement maternel est diminuée. L?enfant est sevré assez tôt en raison du travail de la m~re hors du foyer, le congé de maternité étant t très court environ deux mois. Le sevrage définitif est ici conditionné par une nouvelle grossesse dans certains cas. Dans le groupe des femmes pauvres, les mères copient le comportement nutritionnel de celles qui sont instruites pour oublier l?allaitement traditionnel (ONAPO-Rwanda, 1982). Malheureusement leur pouvoir d?achat ne permet pas un tel changement. La plupart de ces mères abandonnent rapidement l?allaitement maternel au profit du biberon, conduisant ainsi l?enfant à de nombreuses formes de malnutrition (Kwashiorkor, marasme, anémie, ) si les quantités de lait dilué sont faibles voire à la gastro-entérite si la stérilisation du biberon n?a pas été assurée. Ainsi, l?activité économique permet à la femme d?avoir un pouvoir d?achat élevé pour subvenir aux besoins alimentaires de l?enfant. Il s?en suit un meilleur choix d?aliments à donner à l?enfant (Ntsame, 1999). II-1-2-b : L'instruction de la mèreL?instruction joue un rôle particuli4rement important lorsqu?il s?agit de savoir comment les ressources seront utilisées pour assurer aux enfants nourriture, soins et santé. Il importe cependant d?insister sur l?interaction entre nutrition des enfants et éducation des parents (Rakotondrabe, 2004). Des parents plus instruits, surtout les mères, sauront mieux nourrir leur enfant tandis q?un enfant mieux nourri se montrera plus attentif et apprendra mieux qu?un enfant mal nourri (OUA /UNICEF, 2000). Ces dernières années sont marquées par les difficultés économiques en Afrique au sud du Sahara. La Guinée a connu une grave détérioration de son syst~me d?enseignement. Or, l?éducation des mcres est particuli~rement importante pour la nutrition du jeune enfant. Les taux très faibles d?analphabétisme observés parmi les femmes en Guinée prédisposent donc une bonne partie des enfants au problème de malnutrition. L?instruction des mqres améliore les connaissances et les pratiques en matière d?hygi~ne alimentaire, ce qui leur confère plus de chance de préparer des aliments de sevrage plus nutritifs et sains, et de prendre de bonnes décisions en cas de maladie des enfants (Berhrman, 1988, cité par Ntsame, 1999). La littérature abonde à ce sujet et la plupart des chercheurs mettent en évidence l?importance de cette variable dans la détermination de la mortalité des enfants (Akoto et Tabutin, 1989 ; Caldwell John, 1981 ; Dackam, 1990,). Dans une étude portant sur 56 pays en développement, Flegg (1982) a souligné qu?il est plus important d?améliorer l?instruction maternelle que d?augmenter l?effectif du personnel médical pour qu?il y ait une baisse de la mortalité des enfants dans ces, bien que la pénurie de personnel de santé y soit parmi les principaux problèmes à résoudre pour améliorer la santé des enfants. II-1-2-c : LH\VSHOKIi\I\Le type d?habitat est ici le site et la qualité du logement de l?enfant, le type d?aisance et la nature des matériaux de construction ainsi que quelques biens d?équipement modernes possédés par ses parents. Il y a lieu de penser à une variation significative des taux de prévalence des maladies infectieuses (diarrhée et infection respiratoire aiguë ~) selon le type d?habitat. Vu l?existence d?une synergie entre la diarrhée et la malnutrition, le type d?habitat a donc un impact sur la malnutrition des enfants. En Ethiopie, Kirkos (cité par Zo Harilala, 2002) a mis en évidence l?influence du type de sol sur l?incidence de la diarrhée. Trois indicateurs de la qualité d?habitat (le type de sol, la source d?approvisionnement en eau et le nombre de personnes par pièce) sont déjà apparus dans plusieurs enquêtes (Enquête Démographique et de Santé (EDS) et Enquête à indicateurs multiples (MICS),~) comme étant en relation avec la prévalence de la diarrhée. Le milieu urbain africain est caractérisé par un mélange des quartiers privilégiés ou planifiés (logements haut standing) et des quartirs défavorisés ou spontanés (bidonvilles). En milieu urbain africain, le type d?habitat s?apparente au type de quartier, les conditions de vie dans ce dernier sont plus précaires que celles des populations rurales (Akoto & Hill, 1987). Le cas de Conakry est illustratif en ce sens que cette ville est particulièrement marquée par de graves probl~mes d?habitation liés à la pression de la demande sur l?offre insuffisante de logements et à la précarité des habitations. A cela s?ajoute l?insalubrité caractérisée par des systZmes d?évacuation des eaux usées et des ordures ménagqres inappropriés. Les alentours des quartiers situés dans les bas-fonds font l?objet d?accumulation des eaux stagnantes favorables à la prolifération des bactéries et des vecteurs d?agents pathogqnes du paludisme et de la diarrhée surtout pendant la saison des pluies. Il convient de noter que les besoins de la population en eau potable sont considérables mais ne sont pas couverts par les infrastructures existantes. En 1992, environ 37% des ménages guinéens disposaient de l?eau courante à domicile, 39% des ménages utilisaient l?eau des puits ordinaires ou des cours d?eau (EDS-Guinée, 1992). La situation était encore pire en milieu rural où à peine 10% disposait de l?eau courante, contre plus de 61% en milieu urbain. Ce déficit en eau potable est un facteur déterminant de la prévalence de maladies infectieuses et parasitaires dont le lien avec l?état nutritionnel des individus n?est plus à démontrer II-1-3 : Les facteurs culturelsIl existe un grand nombre de croyances et coutumes qui exacerbent les carences nutritionnelles des enfants liées à une insécurité alimentaire chronique et/ou saisonnière (Baker & al, 1996). Pendant l?allaitement par exemple un enfant connaît des demandes nutritionnelles plus grandes mais un grand nombre d?enfants ne les compensent pas en mangeant davantage, en mangeant des aliments d?une meilleure qualité nutritionnelle. Le fait de ne pas améliorer le régime alimentaire pourrait être dû à un manque de connaissances sur la vulnérabilité nutritionnelle et les besoins nutritionnels accrus par les mères (Baker & al, 1996). Ces préoccupations ainsi que les tabous alimentaires souvent pendant l?allaitement privent les enfants de nutriments et d?aliments nécessaires, du reste favorables à leur croissance. II-1-3-a : La religionLa religion a une influence sur les comportements des individus en matière de d?alimentation. Toutefois, il est difficile, en Afrique noire, de dissocier le christianisme de la colonisation et du mode de vie occidental. La plupart des missionnaires chrétiens venus évangéliser les africains avaient, entre autres objectifs, celui de remplacer les cultures locales par la culture occidentale, convaincus que tout ce qu?ils pouvaient apprendre aupr~s des africains était mauvais voire démoniaque (Akoto, 1990 ; Ntsame, 1999). Pour ce faire, et dans le cadre des pratiques d?alimentation des enfants, ces missionnaires ont, durant la période coloniale, crée, par le canal des foyers sociaux, des écoles ménagères oil les élèves apprenaient les pratiques occidentales en mati~re d?alimentation. On distingue trois grands groupes de religion en Guinée: l?Islam, le Christianisme et la religion traditionnelle. Dans ce pays, l?Islam est pratiqué simultanément avec les valeurs culturelles tr~s proches des us et coutumes ancestrales. Cette religion n?a donc pas affecté les habitudes alimentaires des musulmans depuis les temps anciens jusqu?à nos jours, et les tabous alimentaires sont encore vivaces chez ses pratiquants. Ce-ci a un impact négatif sur l?état nutritionnel des enfants et sur celui des filles en particulier; car il s?est avéré que dans certains pays musulmans tels que le Bangladesh, l?Egypte, la Turquie, la Tunisie, la Syrie, les individus ont une préférence pour le sexe masculin pour des raisons culturelles qui existent dans la plupart des pays musulmans (Gbenyon & Locoh, 1989). Considéré comme dépositaire et héritier de la famille, le garçon s?y voit ainsi investi de pouvoirs et valeurs conséquents que lui confèrent la famille et la société. Il en est donc le membre par excellence à perpétuer les us, les coutumes et les valeurs traditionnelles ancestrales. Le christianisme prône l?adoption de nouveaux comportements vis-à-vis de l?enfant, la perception de celui-ci, les pratiques alimentaires à lui soumettre et l?attitude face au syst~me de soins de santé infantile, tout cela selon le mode de vie occidental. Quant à la religion traditionnelle, elle véhicule les valeurs traditionnelles ancestrales (Ngo Nsoa, 2001). Les chrétiennes ont ainsi tendance à pratiquer une bonne alimentation des enfants, ce qui a des effets positifs sur la scolarisation de ces derniers. Des études on montré l?impact positif de la religion chrétienne des mqres sur l?état nutritionnel de leurs enfants (Akoto, 1990 ; Ntsame, 1999). En Guinée, l?état nutritionnel des enfants des chrétiens est meilleur que les enfants issus des parents musulmans (EDS-Guinée, 1999). Cet avantage des chrétiens sur les musulmans, proviendrait de leur niveau d?instruction élevé (Noumbissi, 1996). L?instruction permet aux femmes de s?adapter au monde moderne, de rompre avec certaines pratiques traditionnelles néfastes à la nutrition des enfants, et d?être sensibilisées au probl~me d?hygi~ne alimentaire (Akoto, 1993). Par ailleurs, gr~ce à l?instruction, les chrétiennes, auraient plus tendance à ne pas faire de discrimination entre les enfants considérés comme des dons de Dieu. Elles accorderaient les mêmes soins aux enfants des deux sexes contrairement aux femmes musulmanes qui ont tendance à favoriser les garçons par rapport aux filles (Akoto, 1993). II-1-3-b : iLlitmniiticitilaip ~Les populations de l?Afrique au sud du Sahara s?acharnent sur des croyances dans leurs manières de vivre en mati~re d?alimentation. Ces croyances sont particulièrement importantes à certaines périodes comme : pendant la grossesse, la parturition et avant les cinq premières années de la vie (Rwenge, 1993). Dans toute société, chaque femme est nécessairement imprégnée des us et coutumes de son environnement socio-culturel et surtout de son groupe ethnique (Rwenge, 1993). Sachant que l?ethnie est le lieu par excellence de reproduction des us et coutumes (Ngo Nsoa, 2001). Il s?av~re crucial de prendre en compte de l?appartenance ethnique dans l?analyse explicative de la variation de la malnutrition des enfants africains (Akoto, 1993). On sait à cet effet que le rôle de l?appartenance ethnique est plus important que celui des facteurs socio-économiques et environnementaux, dans l?explication de la malnutrition (Akoto, 1993 ; Wenlock, 1979 cité par Akoto, 1993). Etant donné que les tabous alimentaires varient d?un groupe ethnique à une autre, les comportements des individus en mati4re d?alimentation peuvent considérablement varier selon l?appartenance ethnique et affecter ainsi l?état nutritionnel et la santé des mqres et des enfants (Rwenge, 1993). Ainsi l?absence de certains types de viandes, de poissons et des oeufs dans l?alimentation des enfants peut dégrader ou altérer leur état nutritionnel. Il en est de même pour certaines femmes, à l?instar de celles du Nord Cameroun, qui se privent des aliments riches en matières nutritives, de peur de donner naissance à un gros bébé (Dackam, 1981). Leur comportement peut affecter négativement l?état nutritionnel de la mqre et conduire à une insuffisance pondérale chez l?enfant à naître (UNICEF, 1996). Dans ce cas de figure, les carences nutritionnelles commencent ds l?enfance et se prolongent au moment de l?adolescence puis à l?age adulte. Il en découle que « des petites mères donnent naissance à des petits bébés qui deviendront de petites mères » (Chatterjee, 1989 cité par Becker & al, 1996). Comme on peut le constater ces tabous et interdits alimentaires appliquées dans les sociétes africaines n?ont aucun fondement scientifique. Bien au contraire, ils sont susceptibles d?entraîner, pour l?enfant comme pour la mqre, des conséquences néfastes au plan sanitaire (infections diverses, avitaminose et autres carences). II-1-3-c : Milieu de socialisationLe milieu dans lequel la femme a grandi (au moins une douzaine d?années depuis sa naissance) exerce une influence sur son comportement vis-à-vis de la santé des enfants. On suppose que dans ce milieu, la femme intériorise les normes et les valeurs de sa société. La mère est donc censée adopter des comportements en mati4re d?alimentation et de soins en fonction de ces normes et valeurs. La socialisation rend compte de la culture et marque l?appartenance de la mre à un groupe quelconque, elle isole trois catégories de femmes : les femmes modernes socialisées dans les grandes villes, les femmes intermédiaires socialisées dans les petites villes et les femmes rurales socialisées en milieu rural. Elle oppose cependant le premier groupe et le dernier. Ces deux groupes ont des comportements différents en matière d?alimentation et de soins de l?enfant. Ainsi, en milieu rural, les mqres sont plus attachées à leur origine culturelle, les comportements qu?elles manifestent à l?~ge adulte ne sont que le reflet des coutumes et traditions acquises pendant l?adolescence. II-1-4 : Les variables intermédiairesDe ce qui précède, on a va constater que les facteurs socio-économiques et culturels agissent sur la malnutrition des enfants via les comportements des mères (appelés variables intermédiaires). Entre autres comportements, on peut citer : le mode d?allaitement, la durée de l?allaitement au sein, l?kge de l?enfant au sevrage et à l?introduction des aliments de complément, les pratiques des soins préventifs et curatifs, l?~ge de la mqre à l?accouchement et l?intervalle inter génésique. II-1-4-a- Le mode et la durée de l'allaitementLes habitudes alimentaires constituent l?un des facteurs déterminants de l?état nutritionnel des enfants, qui affecte, à son tour, la morbidité et la mortalité des enfants (Diallo, 1999). Le lait maternel est le premier élément d?alimentation et constitue à bien des égards un aliment irremplaçable pour le nouveau né. Toutefois, dans bien des ethnies, l?enfant est nourri au lait de vache pendant les trois premiers jours de vie. En effet, le ?premier lait?? (colostrum) est considéré comme sale, impur (sans doute à cause de sa couleur jaunâtre). On attend donc la montée de lait du troisième jour pour mettre l?enfant au sein. L?enfant est ensuite nourri au sein jusqu?à environ 22-23 mois (Diallo, 1999). Les mères donnent parfois du lait de vache ou de chgvre en complément lorsqu?elles n?ont pas assez de lait. Le lait maternel a des propriétés particulières puisqu?il est stérile et parce qu?il transmet les anticorps de la mqre et tous les éléments nutritifs nécessaires à l?enfant pendant les premiers mois d?existence (Diallo, 1999). Il permet également d?éviter les déficiences nutritionnelles et de limiter la prévalence de la diarrhée et d?autres maladies. Par ailleurs, l?allaitement maternel, par son intensité et par sa fréquence, influe sur l?état de santé des enfants. En effet, l?allaitement prolonge l?infécondité post-partum, qui à son tour affecte l?intervalle inter-génésique qui influe à son tour sur l?état nutritionnel des enfants via le niveau de fécondité. Le lait maternel est le seul aliment réellement adapté aux besoins du nouveau-né et du nourrisson pendant les premiers mois de la vie. Il apporte sous une forme appropriée, des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux et la plupart des vitamines nécessaires au développement du bébé. De la naissance jusqu' à l'âge de 6 mois, le lait maternel suffit largement pour nourrir l'enfant. Le lait maternel ne nécessite aucune préparation et il est sain. La composition du lait maternel évolue avec le temps, en fonction de l'évolution des besoins de l?enfant. A partir de 6 mois, le lait maternel ne suffit plus à couvrir les besoins de l?enfant. Contrairement à l?allaitement au sein, l?allaitement au biberon n?est pas à la portée de toutes les couches sociales. Le biberon n?est pas recommandé par l?OMS2 (1994) parce que des conditions d?hygicne inadéquates au cours de son utilisation font courir à l?enfant un risque de contamination par des agents pathogènes. De plus, les préparations artificielles pour bébé (qui nécessitent souvent de l?eau) et les autres laits n?ont pas la même valeur nutritionnelle que le lait maternel pour les enfants de moins de 6 mois. Pour ces raisons, l?alimentation au biberon accroît les risques de maladies infectieuses et de malnutrition chez les enfants. L?Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que, de la naissance jusqu?à l?lge de 6 mois environ, tous les enfants soient exclusivement allaités au sein. Cette recommandation est loin d?être suivie par les femmes guinéennes car les résultats de l?EDS1999 rév~lent que l?introduction des liquides tels que l?eau, l?eau sucrée, les jus, ainsi que celle de préparations artificielles pour bébé et d?aliments solides intervient tôt. Il en ressort en effet seulement 12% des enfants de moins 6 mois sont exclusivement allaités au sein et 31% des enfants de moins de 6 mois reçoivent déjà des liquides et aliments solides de complément 2 Organisation Mondiale de la Santé, 47è Assemblée Mondiale de la Santé (AMS 47.5), 9 mai 1994. autres que l?eau. Cette pratique a un effet négatif sur l?état nutritionnel des enfants, cela pour des raisons suivantes :
II-1-4-b- / 14T11DP OWEDTe
II-1-4-c- Caractéristiques démographiques de la mère et de l'enfant
Ces mères adolescentes qui ont contracté la grossesse par le mariage précoce, par un accident ou par une volonté manifeste, n?ont pas de moyens voire la capacité nécessaire pour s?occuper et subvenir aux besoins nutritionnels de leurs enfants. Ceci les expose particulièrement au risque de la synergie infection-malnutrition. II-1-4-c-2 : / I BsIxIBItBlNGTIBIIBlNIULIt Les pratiques discriminatoires envers les petites filles sont documentées notamment dans le sous-continent indien. Elles touchent aussi bien le domaine alimentaire que le domaine sanitaire. Dans certains pays de l?Asie du Sud comme le Bangladesh, on accorde une préférence aux enfants de sexe masculin pour l?allaitement et les soins (Venkatacharya, 1986 cité par Rakotondrabe, 2004). Si des discriminations sexuelles en matière de nutrition existent également en Afrique subsaharienne, elles sont cependant faibles en milieu urbain en général. C?est ce qui se confirme dans l?étude de Banza-Nsunzu (2004) à yaoundé. Le fait d?observer une surmortalité féminine entre 1 mois et 5 ans à Bamako (Fargues 1988 ; Mbacké & LeGrand 1992 cités par Desgrees, 1996) laisserait penser à un état nutritionnel différentiel selon le sexe, influencée probablement par une forme de discrimination entre garçons et filles. Toutefois, cette relation a été rarement statistiquement vérifiée (différence non significative). Les différences porteraient plutôt sur l?accqs aux services payants et la perception sociale des enfants. L?attention des parents tourne plus vers les garçons qui seront plus tard les premiers responsables de la sécurité du bien-être familial et les garants des vieux jours des parents, contrairement aux filles qui, à l?Lge adulte, ne contribuent généralement au revenu du ménage que faiblement (Caldwell 1988, cité par Rakotondrabe, 2004). L?kge de l?enfant est susceptible d?expliquer les variations de la malnutrition par le fait qu?à moins de six mois, les enfants bénéficient de la protection des anticorps de leur mqre. Souvent, ils ne sont pas encore en contact avec les agressions extérieurs car sont nourris au lait maternel. Mais au-delà de 6 mois, le sevrage les expose aux agents pathogènes et favorise l?exposition à la malnutrition. En Afrique il existe une relation négative entre l?kge des enfants et leur malnutrition. Au Gabon par exemple, un grand nombre de décès surviennent entre 1 et 3 ans des suites de rougeole et de malnutrition, qui frappent rapidement après le sevrage de l?enfant (Bakenda, 2004). c-3 : Le rang de naissance Les grossesses précoces peuvent entraîner une carence ou une déficience physiologique de la mère et par conséquent une insuffisance pondérale à la naissance difficile à récupérer ou une prématurité des enfants qui est une des principales causes de la malnutrition (Akoto et Hill, 1988 ; UNICEF, 1986). Par ailleurs, le rang de naissance est une variable discriminante en matière de morbidité et de mortalité des enfants en Afrique (Rakotondrabe, 1996 ; Sene, 2004). En effet, le manque d?expérience des mgres adolescentes et le phénomqne des mariages précoces qui touche la plus grande partie des adolescentes en Afrique subsaharienne font que les enfants de moins de cinq ans de rang un sont exposés au risque de maladies infectieuses, qui affectent à leur tour l?état nutritionnel de ces enfants. Contrairement aux premiers nés, les enfants de rang élevé bénéficient généralement de soins de moindre qualité, l?attention accordée par la mqre diminuant considérablement au fur et à mesure que le rang de l?enfant augmente. Cette diminution provient du surcroît de la charge occasionnée par une famille relativement nombreuse (Masuy Stroobant, 1986 citée par Rakotondrabe, 2004). Un nombre d?enfants élevé provoque une compétition entre fr4res et soeurs qui se manifeste non seulement sur le temps disponible à la mqre pour s?occuper de chacun de ses enfants, mais également sur la qualité des aliments attribués à chacun d?eux, surtout dans les familles où il n?y a pas suffisamment de ressources économiques. On pourrait ainsi observer une carence nutritionnelle chez les enfants derniers-nés (Rakotondrabe, 2004). II-1-4-d- Interaction entre malnutrition et infectionUne étude de la FAO (2000) montre que chez un sujet soufrant de la malnutrition, certains mécanismes de défense naturelle de l?organisme sont altérés et ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, un enfant soufrant de la malnutrition protéique a une réaction immunitaire défectueuse lorsqu?on lui inocule le vaccin contre la fiqvre jaune. Cette étude constate que les enfants souffrant de la malnutrition sont moins aptes à se défendre contre les infections. L?infection affecte de différentes façons l?état nutritionnel des enfants. La plus importante est sans doute l?infection bactérienne et les autres infections qui entraînent une perte accrue en azote de l?organisme (Latham, 2001). L?effet de la diarrhée sur la malnutrition a été particulièrement étudié par certains auteurs (Garenne et al,, 2000 ; Banza-Nsunzu, 2004). En effet, il ressort dans l?étude de Banza-Nsunzu qu?à Yaoundé, le risque diarrhéique est presque deux fois plus élevé chez les enfants malnutris que chez ceux qui ne présentent aucun indice de carence nutritionnelle ; la part du risque attribuable à la malnutrition est de 47%. La diarrhée peut avoir une issue fatale, car elle entraîne habituellement une déshydratation sévère. On peut considérer la diarrhée et la déshydratation qui peut l?accompagner comme une forme de malnutrition. D?autres études soutiennent que certaines maladies comme la rougeole et le paludisme ont des impacts négatifs sur la croissance et le développement des enfants. Selon l?UNICEF (1998), le tiers des cas de malnutrition est dE au paludisme dans les régions d?Afrique. La rougeole provoque l?irritation prononcée du tube intestinal susceptible d?affecter le processus de digestion et d?absorption. La diarrhée se présente souvent comme une complication de la rougeole renforçant ainsi le cercle vicieux malnutrition-infections, notamment chez les enfants dans les pays en développement ( Ngo Nsoa, 2001).. II-1-4-e- / DITIIKANKIE1101111QLe rôle de la vaccination est de lutter non seulement contre les maladies à travers la stimulation de la production des anticorps mais aussi de protéger l?enfant, si possible contre l?infection en augmentant ses capacités de défense préventive contre les germes (HAROUNA, 1998). Le nombre et la dose des vaccins combinés aux facteurs de prévention tels que le suivi régulier de la grossesse, l?accouchement dans des centres de santé et des visites post-natales permettent de maîtriser, sinon de diminuer, l?importance de la part de la malnutrition chez les enfants (UNICEF, 1998). Grenier et Gold (1986) soulignent qu?à la naissance, le taux d?anticorps de l?enfant est égal à celui de la mère. Cependant, l?étude de Letonturier (1996) a montré que l?effet protecteur de l?allaitement maternel diminue rapidement à partir du quatri4me mois de la naissance. L?organisme de l?enfant doit sécréter lui-même ses anticorps pour assurer son immunité (Letonturier, 1996). Pour assurer ce processus au niveau de l?enfant, l?OMS recommande de lui administrer les vaccins nécessaires à sa protection contre les principales maladies qui sévissent dans le milieu environnant. II-2 : HYPOTHESES ET CADRE COCEPTUEL Rappelons que cette étude vise à :
L?atteinte de ces objectifs s?effectuera par le test des hypoth~ses ci-après : II-2-1 : Hypothèses Hypothèse principale Pour atteindre les objectifs, nous supposons que la malnutrition des enfants est déterminée par les comportements des mères en matière de nutrition et de soins et par les caractéristiques démographiques des mères et celles des enfants eux-mêmes subissant l?effet des facteurs socioéconomiques, socio-culturels et environnementaux. Hypothèses secondaires De l?hypoth~se principale découlent les hypoth~ses secondaires suivantes : H1 : Parmi les facteurs les facteurs socio-économiques, le niveau de vie des ménages est la variable qui influence beaucoup plus sur la malnutrition des enfants. H2 : La région naturelle discrimine fortement les enfants en matière de nutrition. H3: L?appartenance ethnique influence sur la malnutrition des enfants. II-2-2 : Le cadre conceptuelUn cadre conceptuel est une représentation graphique qui résume une série de propositions concernant les déterminants d?un phénom~ne donné et leurs mécanismes causaux (Palloni, 1987). Dans une perspective de la recherche d?explication de la santé des enfants, un cadre conceptuel a été proposé par Mosley et Chen (1984). Bien d?autres, cadres conceptuels ont été élaborés, parmi lesquels on peut citer ceux de Meegama (1980), d?Akoto (1985) Le cadre de Mosley et Chen est le plus connu. Leur modèle repose sur un postulat de base : « La survie de l'enfant est essentiellement déterminée par les ressources sociales et économiques de la famille » (Mosley et Chen, 1984 ; Akoto, 1985). Leur modèle revêt un intérêt à plusieurs titres. D?abord, ils distinguent les déterminants socio-économiques seulement et les déterminants proches, ces derniers jouant de rôle intermédiaire de l?influence des premiers sur la survie des enfants, cette distinction n?étant pas évidente dans les autres études. Ensuite, leur schéma intègre à la fois l?approche bio-médicale et l?approche sociale dans l?explication de l?impact des facteurs économiques sur la santé des enfants, en mettant en exergue le rôle de la synergie malnutrition/infection. La croissance des enfants est ainsi considérée comme une des variables à expliquer, la situation des enfants décédés étant assignée dans la catégorie de malnutrition extrême. De plus, la synergie sociale nous semble être à la base de l?explication de ce phénomqne sur la santé des enfants : Ce cadre peut donc nous servir de base pour établir un cadre propice à la recherche des facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants. Cadre conceptuel
Facteurs Comportements des mères en Etat nutritionnel des enfants Facteurs Caractéristiques démographiques Facteurs Cadre conceptuel construit à partir de celui de Mosley et Chen (1984) Les comportements des mqres en mati4re d?alimentation et de soins et les caractéristiques démographiques des enfants et des mères médiatisent les effets des facteurs socio-économiques, environnementaux et culturels sur la malnutrition des enfants. II-2-3 : Définition des concepts de base Etat Nutritionnel des enfants L?état nutritionnel des enfants résulte, à la fois, de l?histoire nutritionnelle (ancienne et récente) de l?enfant et des maladies ou infections qu?il a pu avoir. Par ailleurs, l?état nutritionnel influe, à son tour, sur la probabilité qu?un enfant de contracter des maladies : un enfant atteint de malnutrition aiguë est en situation de faiblesse physique qui favorise les infections. L?état nutritionnel est évalué au moyen de trois indices anthropométriques. A suivant la taille par rapport à l?1ge (taille-pour-âge), le poids par rapport à la taille (poids-pourtaille) et le poids par rapport à l?Lge (poids-pour-âge). Malnutrition D?apr4s le Dictionnaire universel (1988), la malnutrition est le déséquilibre entre les constituants de la ration alimentaire (protéines, glucides, eau, sels minéraux et vitamines). Selon la FAO (1992), la malnutrition est un déséquilibre nutritionnel. Ce déséquilibre peut être un excès ou un déficit des éléments nutritifs. Selon l?UNICEF (1998), la malnutrition est le fruit de l?association d?une alimentation inadéquate (en qualité et en quantité) et des infections. Chez les jeunes enfants, elle entraîne des troubles de croissance. Les enfants malnutris sont plus petits et plus légers (par rapport à leurs poids et à leurs tailles attendus) que les enfants de leur âge bien nourris. Le concept de malnutrition prête à confusion et de la multiplicité des définitions qu?on lui donne. Dans le cadre de notre étude, la malnutrition est due au déficit nutritionnel. Indices de l'état nutritionnel des enfants Quelque soit l?indice considéré, la malnutrition est défini comme un déficit nutritionnel. Ce déficit est évalué par rapport aux normes internationales en la matière. Ainsi, l?OMS recommande que l?état nutritionnel des enfants enquêtés soit comparé à celui de la population de référence internationale3. Dans une population en bonne santé et bien nourrie, on s?attend à ce que seulement 2,3% des enfants se situent à moins de deux écarts-type (malnutrition modérée), dont 0,1% à moins trois écarts-type (malnutrition sévère), en dessous de la médiane pour chacun des trois indices de nutrition. Indice taille-pour-âge L?indice taille-pour-âge permet de mesurer la malnutrition chronique qui se traduit par une taille trop petite pour un âge donné (retard de croissance). Autrement dit, cet indice est une mesure des effets à long terme. Il ne varie que très peu en fonction de la saison de la 3 La référence a été établie par NCHS/CDC/WHO à partir de l?observation d?enfants américains de moins de cinq ans en bonne santé. Cette référence internationale est applicable pour tous les enfants de cet âge dans la mesure oil, quel que soit le groupe de population, ils suivent un modèle de croissance similaire. Les données de la population de référence internationale ont été normalisées pour suivre une distribution normale et la moyenne sont identiques. Pour les différents indices étudiés, la comparaison de la situation lors d?une enquête donnée avec le standard international est effectuée en mesurant la proportion d?enfants observés qui se situent à moins de deux et à moins de trois écarts-types en dessous de la médiane de la population de référence. collecte des données. En effet, un enfant qui a reçu une alimentation inadéquate et/ou a été malade pendant une longue période ou encore de façon répétée peut accuser un retard de croissance staturale. Cependant, son poids peut rester en correspondance avec sa taille réelle, donnant ainsi un indice poids-pour-taille normal. La malnutrition chronique n?est pas toujours visible dans une population car un enfant de trois ans présentant cette forme de malnutrition peut ressembler à un enfant de deux ans bien nourri. Les enfants pour lesquels la taille-pourâge se situe à moins de deux écarts-type en dessous de la médiane taille-pour-âge de la population de référence sont considérés comme petits pour leur âge et donc atteints de retard de croissance ; ceux pour lesquels la taille-pour-âge se situe à moins de trois écarts-type en dessous de la médiane taille-pour-âge de la population de référence sont considérés comme atteints de retard de croissance sévère. Indice poids-pour-taille La malnutrition aiguë (émaciation) est un déficit nutritionnel en calories et/ou en protéines, conséquence d?une alimentation insuffisante durant la période ayant précédée l?enquête ou une perte de poids consécutive à une maladie. Elle permet de mesurer la situation nutritionnelle actuelle des enfants, mais cet indice est fortement influencé par la saison de collecte pendant laquelle s?est effectuée l?enquête. Les enfants dont le poids-pour-taille se situe à moins de deux écarts-type en dessous de la médiane poids-pour-taille de la population de référence sont considérés comme souffrant d?émaciation, ceux se situant à moins trois écarts-type souffrant d?émaciation sév~re. L?indice poids-pour-taille reflète, en effet, la situation nutritionnelle actuelle (au moment de l?enquête). Cette forme de malnutrition est la conséquence d?une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé l?observation ou peut-être le résultat de maladies provoquant une perte de poids (diarrhée sévère, par exemple) : un enfant souffrant de cette forme de malnutrition est maigre ou émacié. L?indice poids-pour-taille refl~te donc une situation actuelle qui n?est pas nécessairement une situation de longue durée. Cette forme de malnutrition aiguë peut être influencée par la saison pendant laquelle s?est effectuée la collecte des données, étant donné que la plupart des facteurs susceptibles de causer un déséquilibre entre le poids et la taille de l?enfant (épidémie, sécheresse, période de soudure, etc.) sont très sensibles à la saison. Indice poids-pour-âge Le troisième indice, poids-pour-âge, est la combinaison des deux indices ci-dessus taille-pour-âge et poids-pour-taille. Il mesure l?insuffisance pondérale chez l?enfant. Les enfants dont le poids-pour-âge se situe à moins de deux écarts-type en dessous de la médiane poids-pour-lge de la population de référence sont considérés comme souffrant d?insuffisance pondérale, ceux se situant à moins de trois écarts-type souffrent d?insuffisance pondérale sévère. Facteurs socio-économiques Ils sont perçus comme l?ensemble des acquis matériels, financiers, niveau de vie et intellectuels susceptibles de conférer à un ménage un certain bien-être ou d?en disposer. En outre, ces facteurs couvrent la satisfaction des besoins essentiels du ménage. De ce fait, ils déterminent la capacité des ménages à mobiliser les ressources en vue d?assurer un meilleur état nutritionnel des enfants. Facteurs environnementaux Selon le dictionnaire Le Robert (2003), l?environnement est l?ensemble des éléments qui conditionnent le cadre de vie d?un individu. Le concept environnement a plusieurs dimensions, les plus utilisées sont socioéconomique et culturelle. Facteurs culturels Ce sont des normes, des croyances et des valeurs véhiculées au sein d?un groupe d?individus donnés. Nous les appréhendons à partir de l?ethnie, du milieu de socialisation et de la religion. Caractéristiques démographiques Il s?agit des caractéristiques liées à la mère et à l?enfant, qui sont susceptibles d?affecter l?état nutritionnel de ce dernier. Nous avons ainsi retenu : l?~ge de la mqre, l?kge de l?enfant, le sexe de celui-ci et son rang de naissance. Les comportements de la mère Le comportement de la mère désigne ses condites face à l?alimentation et aux soins des enfants. Il est appréhendé à partir de la vaccination, le mode d?allaitement et l?~ge au sevrage de l?enfant. II-2-4: Construction du mod~le d?analyse :a- Variables et Indicateurs Nous présentons dans la suite les indicateurs et variables utilisés pour rendre compte des différents concepts précédemment définis. * Variable dépendante La variable dépendante de l?étude est la malnutrition des enfants. Elle permet de rendre compte de la croissance de l?enfant. Il résulte, d?une part, de la qualité et de la quantité de l?alimentation reçue par l?enfant dans le passé et, d?autre part, des maladies qu?il a pu contracter au cours de sa vie (Rakotondrabe, 2004). A partir des mesures anthropométriques recueillies au cours de l?enquête, on pourra évaluer l?état nutritionnel de l?enfant concerner. * Variables indépendantes
C?est le niveau d?études atteint par la mère dans un système éducatif formel. Cette variable peut être appréhendée à partir la dernière classe atteinte, du diplôme obtenu le plus élevé, ou du nombre d?années passées dans le syst~me éducatif formel. Dans le cadre de ce travail, l?instruction de la m~re sera mesurée en distinguant les modalités suivantes : sans niveau, niveau primaire, niveau secondaire et plus. L'activité économique de la mère L?activité économique de la mqre sera appréhendée à partir de l?occupation. Cette variable comprend les modalités suivantes: Inactive, cadre et employée de service, commerçante, agricultrice, ouvrière qualifiée et ouvrière non qualifiée. Le milieu de résidence Il est mesuré par le secteur d?habitat de l?enquêtée. Il comprend deux modalités : le milieu rural et le milieu urbain. La religion Elle est mesurée par la religion d?appartenance de la mqre. Trois modalités sont retenues en tenant compte des spécificités des confessions religieuses prédominantes en Guinée : chrétienne, musulmane et sans religion. L'ethnie de la mère A cause de la diversité ethnique en Guinée, nous répartissons les mères dans quatre groupes ethniques culturellement homogènes en leur sein et différents entre eux: Malinké, Soussou, Peulh et Forestier. Le niveau de vie D?aprIs la littérature, le niveau de vie du ménage est un concept difficile à appréhender vu son caractère complexe. Nous l?appréhendons à partir de certaines caractéristiques du suivantes : type de toilettes, type d?habitat, nature du sol, mode d?approvisionnement en eau potable, biens de valeurs économique possédés par le ménage (télévision, radio, bicyclette, moto, voiture). La région de résidence La région de résidence de la mère (qui est également celle du ménage) a une influence sur l?état nutritionnel de l?enfant. Chaque région a sa particularité physique, culturelle et économique. Les individus d?une région donnée ont probablement quelques caractéristiques qui les différencient de ceux d?une autre région. A cela, il faut ajouter la répartition inégale des ressources naturelles (surtout les potentialités agricoles), économiques (eau potable, aliments) et des structures sanitaires. Les sept provinces de la Guinée ont été regroupées en quatre régions naturelles. Compte tenu de leurs spécificités bioclimatiques et culturelles, ces régions sont : la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière. A ces régions naturelles s?ajoute la ville de Conakry. *Variables intermédiaires Le mode d'allaitement de l'enfant Le mode d?allaitement est appréciée à travers les modalités suivantes : les enfants qui ont été allaités au sein, ceux qui ont été allaités au biberon et ceux qui ont eu l?allaitement mixte. L'âge de l'enfant au sevrage Selon l?OMS, le sevrage ou l?introduction des aliments solides dans l?alimentation de l?enfant doit commencer à partir de 6 mois environ. Cela nous a permis d?avoir une variable à deux modalités : aliments solides introduits à partir de 6 mois environ ou avant cet âge. La vaccination de l'enfant Le nombre et le type de vaccins reçus par l?enfant permettent de saisir le comportement de sa mère en matière de santé. Les vaccins retenus à cet effet sont : le BCG, le DTPcoq, la poliomyélite et le vaccin contre la rougeole. La construction de cette variable se fait sur la base du calendrier vaccinal établi par l?OMS. La variable a deux modalités: si l?enfant a reçu tous les vaccins nécessaires pour son âge (oui), si l?enfant n?a pas reçu un vaccin (non). Le sexe de l'enfant Le sexe désigne l?ensemble des caract~res qui permettent de distinguer chez la population des titres vivants le genre male et le genre femelle (le Petit Larousse, 1998). Il comporte deux modalités : masculin et féminin. L'âge de l'enfant L?kge de l?enfant est mesuré en mois ou en années. L'âge de la mère Nous considérons pour cette variable les groupes d?kges suivants: moins de 20 ans, 20 à 34 ans, 35 ans et +. Les enfants qui appartiennent aux mères des groupes de moins de 20 ans et celles de 35 ans et + sont exposés à un haut risque de malnutrition (Tolno, 1999). Le rang de naissance Le rang de naissance se présente en quatre groupes de modalités, compte tenu des expériences variées des mères à prendre soins de leurs enfants : rang1, rang2, rang3 et rang4 (1, 2-3,4-5, 6 et+). b- Schéma d'aXaX\\e
Région Milieu de Résidence Vaccination, eau Instruction Malnutrition des enfants Mode d?allaitement Niveau de vie Age de Ethnie Religion Rang de naissance Tableau3 : Récapitulation des concepts, variables et indicateurs de l'étude.
Conclusion partielle Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques travaux portant sur les facteurs explicatifs de la santé des enfants, dans le but de mettre en relief le poids des variables qui rendent compte des caractéristiques de la femme par rapport aux autres variables explicatives. En particulier, cette revue de la littérature nous a permis d?examiner quelques approches de la malnutrition ainsi que le rôle particulier joué par certaines variables socio-économiques, culturelles et environnementales dans l?explication de la malnutrition des enfants. En définitive, nous avons retenu que les comportements des femmes africaines sont tributaires des facteurs socio-économiques, des facteurs culturels et des facteurs environnementaux. Compte tenu de la complexité du phénomène étudié et de la diversité d?approches, nous avons opté pour une approche globale et multidimensionnelle, afin de comprendre les variations intervenant dans les comportements des populations africaines et guinéennes en particulier, en mati4re d?alimentation et de santé. L?objectif final de cette démarche était de situer nos hypothqses de recherche par rapport au schéma causal de la malnutrition des enfants, à la lumiqre d?un cadre théorique plus global (relatif à la santé des enfants). Ceci nous a permis de dégager notre cadre d?analyse mettant en évidence les relations et les mécanismes par lesquels les facteurs explicatifs potentiels influencent la malnutrition des enfants. Dans le chapitre suivant, nous présentons les sources des données utilisées. Après l?évaluation de la qualité de celles-ci, nous présentons les techniques statistiques retenues pour vérifier nos hypothèses de recherche. CHAPITRE III : SOURCES DES DONNEES ET METHODOLOGIECe chapitre présente les données utilisées dans le cadre de cette étude. L?évaluation de ces données permet de mieux préciser les variables opérationnelles et les méthodes d?analyse retenues III-1 : Présentation des donnéesLes données de base de cette étude proviennent de la deuxième enquête démographique et de santé de la Guinée (EDSG-II) réalisée par la Direction Nationale de la Statistique (Minist~re du Plan et de la Coopération), avec l?assistance technique de Macro International Inc en 1999. L?Enquête Démographique et de Santé de Guinée (EDSG-II, 1999) est une enquête nationale réalisée par sondage. L?EDSG-II fournit des informations détaillées notamment sur la fécondité, la planification familiale, la mortalité des enfants de moins de cinq ans, la santé des mères et des enfants (soins prénatals, assistance à l?accouchement, vaccination des enfants, maladies infantiles) ainsi que l?allaitement et l?alimentation des enfants, l?iodation du sel, la prévalence de l?anémie et l?état nutritionnel des enfants et des mqres. Les résultats de l?EDSG- II concernent également les infections sexuellement transmissibles et le sida, l?excision et, enfin, la disponibilité des services communautaires économiques et sanitaires. Ces informations sont représentatives au niveau national, au niveau du milieu de résidence (urbain et rural) ainsi qu?au niveau des régions naturelles. Pendant l?enquête, on a identifié 5.216 ménages et 5.090 enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 98%. En outre, 7.117 femmes ont été identifiées comme éligibles et 6.753 ont été enquêtées avec succès, soit un taux de réponse de 95%. Parmi les 2.196 hommes éligibles, 1.980 ont été enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 90%. Les données de l?EDSG-II, ont été collectées à partir de quatre questionnaires:
.Ces questionnaires rendent compte des caractéristiques socio-économiques, culturelles et démographiques des femmes, de leurs conjoints et de leurs enfants. En particulier, ils fournissent, pour chaque enfant, les informations relatives à la malnutrition. Les données utilisées dans le cadre de cette étude se rapportent au questionnaire individuel femme. Parmi les treize sections de ce questionnaire, seul la section1 (Caractéristiques socio-démographiques de l?enquêtée), la section 4A (Grossesses et Allaitement) et la section 4B (Vaccination et Santé) nous ont intéressés. III- 2 : Justification du choix de l'indicateur de l'état nutritionnel des enfantsPlusieurs variables anthropométriques peuvent être utilisées pour mesurer l?état nutritionnel. On peut citer, entre autres, la taille, le poids, le périmètre brachial (le tour de bras), le périmètre crânien, le périmètre thoracique, le pli cutané, etc. Le choix des meilleurs indicateurs parmi ces variables ne fait pas l?unanimité des chercheurs. A titre d?exemple, Van Loon et Vlientinck (1989), à l?aide d?une analyse des composantes principales, ont identifié la taille, le périmètre brachial et le pli cutané comme les trois mesures anthropométriques à prendre en compte pour évaluer l?état nutritionnel de l?enfant. Briend (1998), quant à lui, a identifié le tour de bras comme l?indice anthropométrique le plus utile pour estimer le risque de déc~s. D?autres études effectuées en milieu hospitalier au Bangladesh, par contre, ont suggéré de combiner plusieurs indices. En pratique, les indices nutritionnels les plus utilisés sont le poids et la taille. Ils permettent de calculer des indicateurs de la malnutrition protéino-énergétique (MPE) qui est la forme de malnutrition la plus répandue. Le périmqtre brachial n?est proposé comme un crit~re de référence que dans le cas où il serait difficile de mesurer le poids avec précision (Briend, 1998). Connaissant le poids, la taille et l?~ge de l?enfant, on peut quantifier son état nutritionnel au moyen de trois indices : - l?indice poids-âge (P/A), qui compare le poids de l?enfant au poids de référence pour son âge, c?est-à-dire au poids d?un enfant en bon état nutritionnel ayant le même âge que lui. Il permet d?apprécier le degré d?insuffisance ou d?excqs pondéral ; - l?indice poids-taille (P/T), qui compare le poids de l?enfant au poids de référence pour sa taille, permet d?apprécier le degré de maigreur [ou d?obésité]. Les enfants maigres en comparaison avec leur taille souffrent d?une malnutrition aiguë ; - l?indice taille-âge (T/A), qui compare la taille de l?enfant à la taille de référence pour son ~ge. Cet indice permet d?identifier les retards [ou les avances] de croissance en taille. Les enfants petits pour leur ~ge souffrent d?une malnutrition chronique. Sur la base de ces indices anthropométriques, on peut se servir de la classification de Waterlow pour situer un enfant par rapport à son état nutritionnel : on utilise soit le pourcentage par rapport à la médiane, soit le Z-score (Hennart.P., inédit). Si l?on admet que 80% de la médiane de référence du poids pour taille et 90% de la médiane de référence de la taille pour âge correspondent pratiquement à moins deux écarts types en dessous de ces médianes, on peut utiliser le Z-score qui exprime, en « déviations standards », l?écart (du poids ou de la taille) d?un enfant par rapport à la médiane des enfants de référence (de sa taille ou de son âge). On considère ainsi que : - si l?indice P/T de l?enfant se situe en dessous de 12ET de la médiane de la référence, celui-ci présente une émaciation ; - si l?indice T/A de l?enfant se situe en dessous de 12ET de la médiane de la référence, celui-ci présente un retard de croissance. - si l?indice P/A de l?enfant se situe en dessous de ~2ET de la médiane de la référence, celui-ci présente une insuffisance pondérale. - Malnutrition aiguë sévère ou malnutrition chronique sévère ou insuffisance pondérale sévère quand respectivement, les indices poids-pour-taille, taille-pour-âge et poidspour-âge sont inférieurs à -3ET de la médiane de référence. L?utilisation de ces indices anthropométriques repose sur l?hypoth~se que tout écart entre une mesure anthropométrique observée et la norme de référence est attribuable à la malnutrition. Chaque indice est déterminé par les deux autres, deux d?entre eux pourront à la limite suffire pour rapporter les résultats de l?enquête et il est fréquent de ne retenir que P/T et T/A pour la présentation des caractéristiques anthropométriques de la population (Briend, 1998). A cet effet, une diminution brutale de la ration alimentaire s?accompagne d?une perte de poids rapide et se répercute sur l?indice P/T (elle implique une baisse rapide de cet indice). En revanche, la taille ne diminue pas en cas de malnutrition, le ralentissement de la croissance devra se poursuivre pendant plusieurs mois pour que l?indice T/A commence à fléchir. Ainsi, la baisse de l?indice P/T traduit une malnutrition aiguë et celle de T/A une malnutrition chronique (Briend, 1998). Compte tenu de l?intérêt de chaque indice, l?évaluation de la qualité des données sur l?kge nous permettra de choisir un indice. III- 3 : Evaluation de la qualité des donnéesL?utilisation d?une source de données requiert avant tout l?évaluation de sa qualité car elle peut être entachée d?erreurs. L?évaluation de la qualité des données permet d?apprécier la cohérence interne des données et même leur cohérence externe, ce qui détermine le degré de fiabilité des résultats d?analyses. Pour être acceptables, les données à utiliser doivent avoir un taux de non-réponse inférieur à 10 %. Pour évaluer la qualité des données de cette étude, nous examinerons dans un premier temps les taux de réponse des différentes variables et dans un second temps nous évaluerons la qualité des données sur l?~ge. Tableau 4 : Examen des taux de réponse de quelques variables de l'étude.
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999 Les variables contenues dans le tableau 4 ont été bien couvertes. Les données sur ces variables peuvent donc être utilisées dans cette étude. III-3-2 : Evaluation de la qualité des données sur l'ge.L?évaluation de la qualité des données sur l?~ge peut se faire par deux méthodes : la méthode graphique et la méthode statistique. III-3-2-a : Méthode graphique.Cette méthode consiste à apprécier l?allure de la pyramide des âges des membres des ménages enquêtés, selon que cette pyramide est régulière ou non. Mais avant de construire la pyramide des âges, on peut examiner la courbe des effectifs par âge et par sexe (graphique 1). Graphique 1 : Courbe des effectifs des membres du ménage par âge et par sexe
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999. Le graphique ci-dessus montre de fortes irrégularités dans la déclaration de l?ige, surtout au niveau des âges ronds, comme en témoignent les pics plus élevés au niveau des âges terminés par 0 ou 5. Ce graphique montre par ailleurs qu?entre 15 et 45 ans, les pics sont plus élevés chez les individus de sexe féminin, ce qui pourrait traduire une mauvaise déclaration des âges des mères. En regroupant l?1ge des femmes en classes d?~ges quinquennaux (15-49 ans), on réduit le biais de déclaration de l?~ge. Cette procédure conduit à la construction de la courbe des effectifs (graphique 2) et de la pyramide des âges (graphique 3). Graphique 2 : Courbe représentative des effectifs des femmes en âge de procréer en JUDSHOI~JH qDiQqDeQQaDx
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999. En ce qui concerne la courbe relative à la répartition des femmes en âge de procréer par groupe d?~ges, elle fait disparaître les distorsions liées au probl~me de déclaration de l?~ge. De plus l?allure la courbe présente une évolution normale des effectifs, en ce sens que ces derniers décroissent régulicrement avec l?cge. Graphique 3 : Courbe de rapport de masculinité
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999. Graphique 4 : Pyramide des âges de la population
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999. Il ressort de ce graphique 4 que la pyramide des âges de la population guinéenne présente peu d?irrégularités au niveau de chaque sexe. Elle a la forme triangulaire (base large et sommet rétréci), caractéristique des pays à forte fécondité et mortalité élevée. Toutefois, on note un gonflement des effectifs à 5-9 ans, au détriment du groupe d?ages plus jeune. Il s?agit certainement d?une anomalie, pouvant être attribuée à une mauvaise déclaration d?~ge par les enquêtés. En effet, nombre de ces enquêtés auraient tendance à transférer certains individus du groupe d?~ges 0-4 ans vers le groupe d?~ges 5-9 ans Ce déficit des enfants de moins de cinq ans pourrait être dû à des omissions (voire à des refus) de ceux de moins d?un an, cela pour des raisons culturelles. Une autre hypothqse repose sur l?effet de sélection qui se traduirait par une sous représentation des jeunes générations des individus dans l?échantillon des ménages. Cette pyramide traduit également la jeunesse de la population Guinéenne et le surnombre des effectifs féminins par rapport aux masculins que la courbe du rapport de masculinité illustre bien (figure 3) jà partir du groupe d?cges 15-19 ans jusqu?au groupe d?lges 50-54 ans . III-3-2-2 : Les méthodes statistiques.Ces méthodes font recours à certains indices pour évaluer l?attraction ou la répulsion P oEV-WpsRdaW3agibclaratioQU ceLIains URVINTg it noW ment de11i1ndices de Whip931 11 ] 62 Myers, de Bachi et de l?indice combiQCO des Nations Unies. Dans le cadre de cette étude, seuls les indices de Whipple et de Myers sont utilisés. L?indice de Whipple (Iw) permet de mettre en évidence les distorsions dans la déclaration de l?1ge. Il s?agit de l?attraction des ~ges se terminant par 0 et 5 au sein du groupe d?~ge 23-62 ans qui traduit la préférence des enquêtés pour ces âges. Ainsi, on peut calculer : , où Pi désigne l?effectif des de la population âgée de i ans.
L?application de cette formule offre les cas de figure suivants : Si Iw=0, il y a répulsion totale des chiffres 0 et 5 ; Si Iw<1, il y a répulsion pour le 0 et pour le 5 ; Si Iw1, il n?y a aucune préférence ; Si 1<Iw<5, il y a attraction et cette attraction est d?autant plus forte que Iw est voisin de 5 ; Si Iw=5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5 (Roger G. et collaborateurs, 1981). L?indice de Myers (Im), mesure l?attraction ou la répulsion des âges se terminant par les chiffres allant de 0 à 9. (Ibid.). L?indice de Myers (Im) varie entre 0 et 180 et conduit à la règle de décision suivante : Si Im0, il n?y a aucune distorsion sur les âges ; Si Im=180, cela signifie que tous les individus ont un âge terminé par le même chiffre. (Idem) Les résultats du calcul de ces deux indices (effectué à l?aide de la procédure SINGAGE du logiciel PAS) sont consignés dans le tableau suivant. Tableau 5 : Tableau récapitulatif des valeurs des indices de Whipple et de Myers selon le sexe et pour l'ensemble de la population.
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999. Nous constatons que quel que soit le sexe, l?indice de Whipple est compris entre 1 et 5 (il est de 1,61 pour les hommes, 1,75 pour les femmes et 1,69 pour l?ensemble). Il y a donc attraction des chiffres 0 et 5, plus forte chez les femmes que chez les hommes. Néanmoins cette attraction est très faible (valeurs proches de 1) ; ce qui dénote une qualité des données relativement bonne. Ainsi, les enquêtés ont déclaré leur âge de façon objective. Cette conclusion confortée par les valeurs faibles de l?indice de Myers (plus proches de 0 que de 180 quel que soit le sexe). Par ailleurs, l?indice de Myers fait ressortir une répulsion des âges terminés par les chiffres 1 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 et 9. Mais cela ne remet pas en cause la qualité des données dans leur ensemble. III-3-2-3 : L'évaluation de la qualité
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variables |
Modalités |
Effectifs |
Pourcentages de réponse |
|
0 |
1098 |
||
|
1 |
921 |
||
|
Age des enfants |
2 |
985 |
86,4 |
|
3 |
1008 |
||
|
4 |
1028 |
||
|
0-8,1g |
1239 |
||
|
8,2-10,8 kg |
1150 |
||
|
Poids des enfants |
10,9-13,6 kg |
1169 |
80,6 |
|
13,7 kg et + |
1142 |
||
|
36-713cm |
1192 |
||
|
Taille des enfants |
714-821cm |
1157 |
|
|
822-925cm |
1176 |
80,3 |
|
|
926cm et + |
1158 |
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999.
Au regard des résultats sur le tableau des taux de non-réponses relatives aux variables anthropométriques chez les enfants de moins de cinq ans (taux de non-réponse supérieur à 10%), on est enclin à valider l?hypothqse d?omission ou de non-déclaration des âges des enfants par les enquêtés. Toutefois, il n?est pas exclu que certaines observations déconsidérées jà l?issue du test informatique de cohérence portant sur ces trois variables (apurement des fichiers des données). Dans un cas (omission ou refus) comme dans l?autre (données observantes), le taux élevé de non-réponse confirme l?irrégularité de la pyramide des 1ges dans sa partie la plus inférieure (enfants de moins de cinq ans). En conséquence, l?interprétation des résultats d?analyse des données anthropométriques doit se faire avec prudence.
Graphique 5: La répartition des enfants selon le poids
|
60 40 to 1 30 W 20 |
|||||||||||||||
|
0 1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 Poids |
|||||||||||||||
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999.
Graphique 6: La répartition des enfants selon la taille
|
45 40 35 30 |
||||||||||||||||||||||||
|
; 25 |
||||||||||||||||||||||||
|
I |
||||||||||||||||||||||||
|
20 w |
||||||||||||||||||||||||
|
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 42 83 |
124 |
165 |
206 247 288 329 370 411 452 493 534 575 616 |
657 |
698 |
|||||||||||||||||||
|
Taille |
||||||||||||||||||||||||
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999.
Ces graphiques : 5&6 présentent des irrégularités par rapport à la courbe relative à la population de référence, qui suit une loi normale. Cela laisse penser qu?il existe une proportion non négligeable des enfants présentant des carences nutritionnelles. Mais dans l?ensemble, l?allure générale de ces deux courbes sous forme de cloche s?apparente à celle de la loi normale. Ce qui permet d?accepter la qualité des données sur les variables anthropométriques.
Graphique 7 : Répartition GI4 II:faI:74 41BI: lIMI.
|
1150 1050 in |
|||||
|
:I= 1000 |
|||||
|
I" |
|||||
|
"4= 950 w |
|||||
|
900 |
|||||
|
850 |
|||||
|
800 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Ages |
|||||
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999.
Le graphique 7 montre que l?Lge des enfants de moins de cinq ans est mal déclaré car l?effectif des enfants devrait décroître jusqu?à 5 ans. Or constate une baisse réguli4re de 0 à 2 ans et une croissance de la courbe des effectifs jusqu?à 4 ans révolus. Cette mauvaise qualité de l?kge des enfants peut être due à plusieurs causes (une famine dévastatrice, épidémie, sélection de l?échantillon,..).
Au cours de cette enquête, tous les enfants de moins de cinq ans des femmes de 15-49 ans interviewées devaient être pesés et mesurés. Les données devraient donc porter sur cette population cible, c?est-à-dire les 5046 enfants répondant à ces critères. Or parmi ceux-ci, 2104 enfants (soit 42%) ont été exclus de l?échantillon d?analyse pour les raisons suivantes :
- enfants dont la taille ou le poids ne sont pas connus (7%). Il s?agit des enfants absents
pendant l?enquête, des enfants malades ou présentant des infirmités ou de cas de refus ;
- enfants dont la taille ou le poids sont improbables c?est-à-dire présentant des mensurations erronées par rapport aux critères de référence internationale (7%). Il pourrait s?agir d?erreurs de report ou de mesures assez délicates chez les jeunes enfants ;
- enfants dont l?~ge manque ou est incomplet (28%). L?kge est une variable essentielle au niveau de l?analyse des données nutritionnelles.
L?échantillon d?analyse ne porte donc que sur 2939 enfants kgés de moins de cinq ans soit 58% des enfants éligibles. Les taux d?erreurs observés semblent tr~s élevés.
Il est généralement admis que l'anthropométrie est l'outil le plus commode d'évaluation de l'état nutritionnel des enfants, bien que les variations des courbes de croissance tiennent à diverses raisons (maladies par exemple) et non pas seulement à la nutrition. Toutefois, on peut remarquer que les propositions sur l'utilisation des données relatives au poids et à la taille des enfants sont largement acceptées. Ce point de vue a été appuyé dans un rapport conjoint de la FAO, de l'OMS et des Nations-Unies (WHO, 1985). Nous retenons que l?indice poids-pourtaille (P/T) qui ne dépend pas de l?~ge des enfants a l?avantage de tenir compte des conditions du moment, il peut refléter la situation nutritionnelle actuelle des enfants. Toutefois, cet indice peut ne pas s?adapter à une population donnée à cause de la diversité des tailles et de climats notamment dans les pays du Sahel. Mais compte tenu de l?appartenance de la Guinée à la zone équatoriale (caractéristique de la forêt et de la savane), on peut supposer que cet indice s?adapte mieux aux situations nutritionnelles des enfants guinéens.
Selon la recommandation de l?OMS, l?état nutritionnel observé des enfants de moins de cinq ans sera comparé à celui des enfants américains de moins de cinq ans, considérés comme étant bien nourris, connu sous le nom de standard NCHS/CDC/OMS (Centre National des statistiques Sanitaires des Etats-Unis/ Centre des Contrôles de Maladies des Etats-Unis/ Organisation Mondiale de la Santé). Son application doit cependant s?effectuer avec prudence car elle peut introduire un biais potentiel surtout pendant les premiers mois de la vie. En Afrique sub-saharienne, les habitudes alimentaires diff~rent d?un pays à un autre et à l?intérieur
de ceux-ci. Les courbes de référence ont été établies sur la base des données provenant d?enfants américains nourris artificiellement dont la croissance diffère de celle des enfants nourris au sein. Compte tenu de la différence morphologique entre les enfants américains et guinées (ces derniers sont minces et de faible poids), la référence aux enfants américains comme standard peut conduire à des résultats biaisés. De même, la différence de mode d?alimentation des enfants (mode d?allaitement, diversification des types d?aliments introduits après le sevrage) creuse d?avantage l?écart entre les deux groupes, du point de vue nutritionnel. Nous risquons de classer des enfants n?ayant pas de probl~me nutritionnel parmi ceux qui l?ont. Il convient de rappeler que la référence aux enfants américains s?apprête mieux à la comparaison de l?état nutritionnel des enfants de deux ou plusieurs pays sous développés. Elle permet par ailleurs de comparer l?état nutritionnel de deux sous populations d?enfants d?un même pays. Les débats se sont poursuivis ces dernières années pour savoir s'il est nécessaire et adéquat d'utiliser une norme internationale pour évaluer l'état nutritionnel des enfants. Toutefois, l?objectif n?est pas de comparer l?état nutritionnel de deux sous population ou tout au moins d?évaluer l?état nutritionnel des enfants guinéens, mais de comprendre les facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants.
Au regard de ce qui précède, nous nous sommes proposés de construire un standard d?état nutritionnel à partir des données de l?EDS-1999 de Guinée, car il nous semble que cette norme internationale est trop élevée pour un pays comme la Guinée oil les habitudes alimentaires sont variées. Ce standard a été déjà utilisé notamment par NTSAME ONDO (1999) proposé par AKOTO pour mesurer l?impact de la fécondité sur la qualité des enfants en Côte d?Ivoire. Précisons rapidement la démarche de la construction de l?indicateur de l?état nutritionnel.
La première étape consiste à calculer le premier décile (D1) et les quartiles Q1, Q2 et Q3 du rapport du poids sur la taille des enfants nés au cours de cinq années précédant l?enquête, c?est-à-dire des enfants âgés de 1 à 60 mois révolus. Rappelons que D1 est une valeur de la variable étudiée telle que 10 % des enfants aient un rapport poids-pour-taille inférieur ou égal à cette valeur (D1). Quant aux quartiles, ils divisent la série en quatre parties égales comptant chacune 25% des observations. Ainsi, 25%, 50% et 75% d?enfants ont une valeur de poids-pour-taille inférieure respectivement à Q1, Q2 et Q3.
Ensuite, comme l?EDS a exclu de l?échantillon d?analyse des enfants dont l?~ge manque, une représentation graphique de l?indicateur poids-pour-taille en fonction de l?~ge des enfants a été effectuée (graphique 8).
La troisième étape consiste à lisser les courbes ainsi obtenues. L?aspect du nuage de points obtenu nous permet de retenir la fonction puissance pour le lissage des courbes, la fonction puissance a été retenue. Elle est de la forme : Y = AXb
En vue de déterminer les valeurs de paramètres « A » et « b », cette fonction a été linéarisée par l?application du logarithme népérien : ln Y = ln A + b ln X
En posant ln Y = y, ln X = x, ln A = a et b = b, on obtient : y = a + bx
a et b sont déterminés par la méthode des moindres carrés, qui minimise la somme des carrés des erreurs ( E ei2)4. Où ei est l?écart
Graphique 817 R 101MINKIRSETR~gIRduRTEpport poids-pour-taille des enfants de moins de 60 mois selon le premier décile (D1) et les quartiles (Q1, Q2, Q3).
|
180 160 140 120 100 80 60 40 20 |
|||
|
Valeurs D1 observe Valeurs D1 esti me Valeurs Q1 observe Valeurs Q1 estimé Valeurs Q2 observe Valeurs Q2 esti me Valeurs Q3 observe Valeurs Q3 esti me |
|||
|
0 |
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
||
Source : rapports calculés à partir des données de l?EDSG 1999
La démarche présentée ci-dessus a permis d?obtenir une séri de quatre équations qui Vales Q estimépermettent d?estimer, pour un enfant d?un ~ge donné, les valeurs respectives de D1, Q1, Q2 etQ3
Valeurs Q2 observé - pour D1 : ln yi = -2,653 + 0,163* ln xi Yi= e(ln yi)
- pour Q1 : ln yj = -2,565 + 0,154 * ln xj ? Yj = e(ln
yj)V
4 a et b sont calculés selon les formules suivantes : a = y #177; bx où y est la moyenne du rapport poids-pour-taille des enfants et x leur âge moyen ; b = covariance (x,y)/ variance (x) = [ (1/n) (Exi yi) f x y] / [ (1/n) (Exi2 - (x)2]
- pour Q2 : ln yk = -2,445 + 0,148 * ln xk 4 Yk = e(ln yk) - pour Q3 : ln yl = -2,353 + 0,143 ln xl4 Yl = e(ln yl)
Cinq modalités catégorielles ont été retenues pour l?indicateur de l?état nutritionnel des enfants : Très mauvais, Mauvais, Moins bon, Bon, Très bon.
Interprétation des résultats :
Les enfants dont le rapport poids/taille est strictement inférieur à D1 ont un état nutritionnel très mauvais. Ceux dont le rapport poids/taille est supérieur ou égal à D1 et inférieur à Q1 ont un état nutritionnel mauvais. Lorsque le rapport poids/taille est supérieur ou égal à Q1 et inférieur à Q2 on a un état nutritionnel moyen. Si le rapport poids/taille est supérieur ou égal à Q2 et inférieur à Q3 cela correspond à un état nutritionnel bon. Et enfin, quand le rapport poids/taille est supérieur à Q3 ce-ci traduit un état nutritionnel très bon. Remarquons que le rapport poids-pour-taille de 0 mois a été éliminé de la procédure d?ajustement puissance car le logarithme népérien de 0 vaut l?infini. Nous avons supposé que la plupart d?enfants ayant moins d?un mois ne connaissent pas un probl~me sérieux de nutrition. Ils ont ainsi été assimilés aux enfants ayant un état nutritionnel moyen.
En outre, la malnutrition relative au rapport poids-pour-taille (malutrition aiguë ou émaciation) est un phénomène à la fois complexe et rare au sein d?une population qui ne frappe qu?à une période donnée. Pour ce fait, nous nous intéressons aux enfants dont l?état nutritionnel est préoccupant. Il s?agit des enfants se trouvant en dessous du premier décile. En d?autres termes, on s?intéresse aux enfants dont 10 % aient un rapport poids-pour-taille inférieur ou égal à D1. Pour cela, nous avons transformé l?état nutritionnel des enfants en une variable binaire (mauvais et bon).
/ iiQtiliSIONFQ 1211 110X0IMIIMIaIcomme suit :
L?indice P/T considère l'état nutritionnel d'une population des enfants comme : . Satisfaisant, si la proportion d'enfants malnutris est inférieure à 5%;
. Précaire, si cette proportion est comprise entre 5% et 10%;
. Sévère, si elle est comprise entre 10% et 15%;
. Très sévère à partir de 15%.
Le niveau de vie est un élément de différentiation des individus selon le revenu ou le type de biens possédés par le ménage. A ce titre, il permet d?expliquer bon nombre de comportements et d?attitudes des individus. Le revenu d?un ménage reste incontestablement le meilleur indicateur de son niveau de vie. Ainsi, l?approche monétaire du niveau de vie des ménages repose sur le classement de ces derniers en fonction des tranches de revenus. Cependant, la collecte des informations sur le revenu des ménages n?est pas aisée en Afrique oil le revenu est souvent considéré comme un sujet tabou même au sein du couple. La difficulté de pouvoir disposer d?une telle variable dans les pays en développement amène souvent à utiliser les caractéristiques des logements et la disponibilité de certains biens de valeur économique dans le ménage (approche non monétaire), sur lesquels les informations sont faciles à collecter.
Nous avons opté pour l?approche non monétaire. Les variables retenues à cet effet sont les suivantes : la nature du sol, le type de toilettes et la source d?approvisionnement en eau. A ces caractéristiques de l?habitat s?ajoutent quelques biens domestiques de valeur économique réfrigérateur, bicyclette, mode d?éclairage, radio, voiture, moto et poste téléviseur. Ces variables ont été utilisées dans la procédure ACP du logiciel SPSS. Le niveau de vie ainsi construit est une variable à cinq modalités. La procédure classification par nuées dynamiques du logiciel SPSS appliquée sur les cinq modalités du niveau de vie et à l?aide des variables qui ont permis de l?obtenir permet de regrouper ces modalités en trois : Faible, Moyen et élevé. C?est l?une des méthodes les plus utilisées dans la littérature anglo-saxonne (Beninguisse et Kobiané, 2005).
Graphique 9 : Niveau de vie des ménages
|
Niveau de vie |
||||||||||
|
40 35 30 25 20 15 10 5 0 |
||||||||||
|
Faible Moyen Elevé |
||||||||||
Source : Exploitation des données de l?EDSG-1999.
L?analyse de la malnutrition des enfants n?est effectuée à l?aide de deux types de méthodes :
- Les méthodes descriptives ;
- La méthode explicative.
Ces méthodes d?analyse présentent le niveau de la malnutrition des enfants et fait ressortir ses aspects différentiels selon les caractérisques contextuelles des mères et des enfants. A l?aide de tableaux croisés et des statistiques du khi-deux rattachées à chaque tableau, les méthodes descriptives mettent en évidence les associations des variables deux à deux, tout en indiquant les variables qui sont significativement associés à l?état nutritionnel des enfants. Cela permet aussi de déceler au préalable le problème de la multi colinéarité entre les variables, s?il existe. La construction d?indicateurs composites est la solution proposée pour ce problème.
Afin de mieux caractériser les mqres et les enfants selon l?état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, nous utiliserons l?analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). L?AFCM est une méthode qui permet de décrire la structure latente d?un ensemble de variables qualitatives. Elle repose sur la notion de profil et d?inertie entre des modalités des variables étudiées. Si ces distances sont faibles, il y a association entre les variables. Cette méthode va nous permettre de catégoriser les mqres et les enfants selon l?état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans. En effet, l?AFCM permet de mettre en évidence les interrelations entre plusieurs variables et les facteurs déterminants la malnutrition des enfants. Les plans factoriels et les contributions relatives de chaque modalité des variables à l?inertie expliquée par chaque axe permettent de mieux caractériser les femmes. Les différents paramètres de cette méthode sont fournis par des programmes informatiques. Le programme « ANCOR.PAR » du logiciel ADDAD nous permet de sortir les nuages de points et des tableaux de contributions et de valeurs propres. Nous allons nous y atteler à travers les résultats sur la base de la matrice de configuration et des graphiques.
/ ?REjeFtif nGe nFette nptuGe nptaQt nla nP ise neQ npYiGeQFe nGes nfaFteurs nexSliFatifs nGe nla n malnutrition des enfants, et compte tenu de la nature dichotomique de notre variable dépendante (bon état nutritionnel et mauvais état nutritionnel), la régression logistique binaire IMnlanP pllRGenI1FhQi1,11nG1aQalyNnlanP HA{ n1QGEIupe.
Principes de la méthode.
/ HnSRiQFISIsnGenEINnGenl?NIlEsation de cette méthode de régression sont les suivants:


La variable dépendante doit être une variable qualitative et dichotomique (ayant deux modalités : 0 et 1). La modalité valide (1) de cette variable doit concerner le groupe le plus minoritaire au plan VECENEnGRQtnl?e111FWnQenGpS1WnSIsn2EE 5.
Les variables indépendantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais toutes les modalités de ces variables doivent être dichotomisées avant leur introduction dans le modèle de régression. La modalité de référence de chaque variable ne doit pas être iQtIRGuitenGEQsnlenP RG~leg n61nP nTMNNSURE[Hak9nSRWDM3YPC1P I tudié (mauvais état nutritionnel des enfants) se réalise, 1-P est la probabilité pour que cet événement ne réalise pas (bon état nutritionnel des enfants).
- Le modèle de régression logistique se présente comme suit:
. Où Z est la variable à expliquée ou la variable dépendante.
· La forme linéaire de Z se présente comme suit Z = )5'0 +,131X1 +,132X2 + .
Avec X1, X2,~, nXn sont des variables indépendantes (ou des variables explicatives) Hnâ1, nâ2,~, ân sont des coefficients de régression.
· Quant à la forme multiplicative, nellenestnGRQQpenSarnltiSIFIAiRQ dont
l1pTXMRQnest :
La statistique = Odds ratio ou « rapport de chances ».
La régression logistique fournit, entre autres, le
nombre d'observations, la probabilité du
Khi2
associée au modèle, le pouvoir
prédictif du modèle (pseudo R2), les rapports de
chances (Odds
5 841AtnEIQUnqNRQnFRQsIGJInlInrpgUMIRQnlRgWENnEiQ11InFRP P tnaGaStpeniux npYpQeP IQtsnIEIIsnTIVRFTNIr,n 1996).
ratios) ou les paramètres de régression associés aux différentes variables explicatives et/ou à leurs modalités respectives, et enfin l'intervalle de confiance des paramètres pour chacune des modalités et/ou des variables introduites dans le modèle avec les probabilités correspondantes (P> | Z |). Ces différents paramètres facilitent l'interprétation des résultats.
Aides à l'interprétation
La probabilité du Khi2 associée au modèle permet de se prononcer sur l?adéquation du modèle utilisé. Le modèle sera jugé adéquat lorsque la probabilité associée au Khi2 sera inférieure à 5% voire 10%. Le pseudo R2 détermine le pouvoir prédictif du mod~le, c?est-à-dire la capacité du modèle à expliquer la malnutrition des enfants rien qu?avec les variables explicatives qu?il contient. Par ailleurs, en ce qui concerne le risque de malnutrition, le modèle de régression logistique fournit pour chaque variable introduite dans l?équation une probabilité (P > | Z |) pour que le comportement représenté par cette variable ne soit pas différent de celui du groupe de référence, par rapport au phénomène étudié au (x) seuil (s) fixé (s) (1%, 5%, 10%), on dira que cette probabilité est faible pour qu?il y ait pas de différence entre les groupes mis en comparaison. Ainsi, on en conclut à un comportement différentiel de ces groupes face au phénomène étudié. Dans ce cas s?agissant de la malnutrition des enfants en particulier, le comportement différentiel se mesure en termes d?écart du groupe présenté dans le modèle par rapport à celui de référence. Cet écart étant exprimé par un rapport de risque (odd ratio) ou risque relatif risque correspondant calculé par un algorithme approprié, cette valeur est fournie par le logiciel STATA. Lorsque ce rapport est inférieur à 1, on dira que les enfants qui s?identifient au groupe mis dans le modèle de régression en courent ((1-OR)*100) % moins de risque d?être malnutris que ceux qui s?identifient par rapport au groupe de référence. Dans le cas contraire (OR>1), on parlera plutôt d?un risque plus élevé chez les premières catégories des enfants que chez la catégorie correspondant au groupe de référence.
Conclusion partielle
Ce chapitre nous a permis de préciser la source des données utilisées dans cette étude (EDSG-1999). Aussi de définir les variables opérationnelles. La variable milieu de socialisation ne sera pas prise en compte, car elle n?a pas été saisie au moment de l?enquête.
L?évaluation de la qualité des données nous a permis de juger que dans l?ensemble, les données sont relativement de bonnes qualité et peuvent être utilisées pour des fins d?analyses. Par ailleurs, il nous a permis aussi de construire notre variable dépendante aux moyens des techniques statistiques.
Le prochain chapitre présente les niveaux et les facteurs associés à la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée dans une approche descriptive.
Ce chapitre examine quelques caractéristiques essentielles liées à la malnutrition des enfants. Le niveau et les aspects différentiels de la malnutrition des enfants y sont analysés à partir d?une approche descriptive qui met en relation les variables indépendantes avec l?état nutritionnel des enfants. Cela se fait au moyen de la méthode d?analyse bivariée (tableaux croisés). Enfin une AFCM est utilisée pour dégager les profils des enfants par rapport au phénomène étudié.
Rappelons que l?indice poids-pour-taille reflète la masse corporelle par rapport à la taille. Même si l?cge n?intervient pas dans ce indicateur de l?état nutritionnel, nous l?utilisons néanmoins pour son importance dans l?analyse des phénomqnes démographiques. En particulier l?kge est le meilleur descripteur de l?état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans. L?indice poids-pour-taille est sensible à certains facteurs fréquents pendant la saison des pluies tels que les maladies diarrhéiques et les déficits alimentaires (période coïncident avec la période de soudure). La malnutrition aiguë ou l?émaciation est donc la conséquence d?une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé l?enquête et/ou d?une perte de poids consécutive à une maladie. La figure suivante donne le niveau de malnutrition en Guinée en 1999.
Graphique 10 : Répartition des enfants de moins de cinq ans selon leur état nutritionnel
|
100,0 |
||||||||
|
80,0 |
||||||||
|
60,0 |
||||||||
|
40,0 |
||||||||
|
20,0 |
||||||||
|
0,0 bon |
mauvais |
|||||||
|
Niveau de 89,3 malnutrion des enfants |
10,7 |
|||||||
Source : AnalyV- dINKIRQW-s dIT?EDSG 1999
A une certaine taille correspond un certain poids, et tout déficit du poids par rapport à la taille correspond une malnutrition appelée émaciation. Le graphique 10, rend compte du niveau de l?état nutrition des enfants en Guinée. On note que le taux de prévalence de l?émaciation des enfants vaut 10,7%. Ce résultat réconforte celui de la FAO, qui estime qu?en 1999, le niveau de malnutrition aiguë est supérieur à 10% au niveau national. Ceci montre qu?il existe en Guinée de réels problImes nutritionnels. L?OMS ayant fixé à 10% le seuil au delà duquel une population est « gravement touchée » par l?émaciation, cette situation est préoccupante d?autant qu?elle risque de s?amplifier au fil des années à venir. Les causes de ce taux élevé de malnutrition sont multiples et complexes. L?étape suivante va nous aider à mettre en évidence les associations entre les facteurs prédisposant les enfants à la malnutrition en Guinée.
- Variations de la malnutrition des enfants selon les principales variables indépendantes
L?analyse bivariée ci-apr~s entre les variables indépendantes et l?état nutritionnel des enfants permettra de faire une typologie des enfants touchés par la malnutrition.
Tableau 7: Prévalence de la malnutrition des enfants en fonction des variables indépendantes
|
VARIABLES INDEPENDANTES |
Prévalence de malnutrition |
||
|
Effectifs total des enfants |
Malnutrition |
||
|
Nombre de cas |
Taux de prévalence (%) |
||
|
Milieu de résidence |
ns |
||
|
Urbain |
884 |
90 |
10,2 |
|
Rural |
2056 |
225 |
10,9 |
|
1 IMIX DiQANEX+NZQ |
ns |
||
|
Sans niveau |
2425 |
226 |
11,0 |
|
Primaire |
283 |
29 |
10,2 |
|
Secondaire ou plus |
232 |
19 |
8,2 |
|
Région naturelle |
*** |
||
|
Basse Guinée |
658 |
65 |
9,9 |
|
Moyenne Guinée |
518 |
75 |
14,5 |
|
Haute Guinée |
481 |
58 |
12,1 |
|
Guinée Forestière |
825 |
64 |
7,8 |
|
Conakry |
459 |
53 |
11,5 |
|
Ethnie |
*** |
||
|
Soussou |
650 |
57 |
8,8 |
|
Peulh |
916 |
132 |
14,4 |
|
Malinké |
856 |
89 |
10,4 |
|
Forestière |
478 |
34 |
7,1 |
|
61+N1Xr d'a+NWINé de la mère |
ns |
||
|
Inoccupée |
506 |
55 |
10,9 |
|
Secteur moderne |
909 |
90 |
9,9 |
|
Secteur traditionnel |
1499 |
166 |
11,1 |
|
Religion de la mère |
** |
||
|
Islam |
2473 |
279 |
11,3 |
|
Christianisme |
278 |
22 |
7,9 |
|
Sans religion |
182 |
12 |
6,6 |
|
Niveau de vie des ménages |
* |
||
|
Faible |
1165 |
139 |
11,9 |
|
Moyen |
848 |
77 |
9,1 |
|
Elevé |
819 |
81 |
9,9 |
|
Ensemble Guinée |
2939 |
314 |
10,7 |
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; Seuil de référence : prob =0,05
Tableau 8 : taux de malnutrition des enfants selon les variables intermédiaires en Guinée
|
VARIABLES INTERMEDIAIRES |
Prévalence de malnutrition |
||
|
Effectifs total des enfants |
Malnutrition |
||
|
Nombre de cas |
Taux de prévalence (%) |
||
|
Age de l'enfant en mois |
*** |
||
|
<6 |
487 |
37 |
7,8 |
|
6-11 |
375 |
66 |
17,6 |
|
12-23 |
639 |
134 |
21,0 |
|
24-35 |
566 |
51 |
9,0 |
|
36-47 |
453 |
16 |
3,5 |
|
48-59 |
421 |
11 |
2,6 |
|
Sexe de l'enfant |
ns |
||
|
Masculin |
1529 |
163 |
10,7 |
|
Féminin |
1411 |
151 |
10,7 |
|
Rang de naissance |
* |
||
|
1 |
557 |
50 |
9,0 |
|
2-3 |
914 |
88 |
9,6 |
|
4-5 |
728 |
94 |
12,9 |
|
6 ou plus |
742 |
83 |
11,2 |
|
Age de la mère |
ns |
||
|
15-24 |
295 |
26 |
8,8 |
|
25-34 |
1962 |
221 |
11,3 |
|
35 ou plus |
684 |
68 |
9,9 |
|
Mode d'allaitement |
*** |
||
|
Au sein |
576 |
29 |
5,0 |
|
Biberon |
126 |
126 |
13,1 |
|
Solide/semi solde |
1225 |
151 |
12,1 |
|
Vaccination |
** |
||
|
Non |
622 |
80 |
12,9 |
|
Oui |
1801 |
181 |
10,0 |
|
Age au sevrage |
*** |
||
|
Avant 6 mois |
2552 |
302 |
11,8 |
|
Après 6 mois |
318 |
7 |
2,2 |
|
Qualité de l'eau de boisson |
* |
||
|
Eau potable |
1999 |
200 |
10,0 |
|
Eau non potable |
940 |
114 |
12,1 |
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; Seuil de référence : prob =0,05
La région de résidence est une variable de différentiation de la malnutrition des enfants en Guinée (relation significative au seuil de 1%). Le niveau le plus élevé de malnutrition des enfants est enregistré en Moyenne Guinée (14%) le niveau le plus faible est observé en Guinée Forestière (8%). A Conakry la capitale plus d?un enfant sur dix souffrent de la malnutrition (12%). Cette différence entre les régions peut s?expliquer par les spécificités culturelles, socioéconomiques et environnementales de ces entités géographiques. La Guinée forestière par exemple, est une région de forêts comme son nom l?indique et surtout une région à prédominance chrétienne, ce qui prédispose les habitants à peu d?interdits alimentaires. Ainsi on suppose que les femmes de cette région ont plus de chances d?avoir une gamme variée d?aliments et donc de ne pas se priver des aliments referment des micronutriments.
Graphique 11: Taux de malnutrition des enfants selon la région de région de résidence
|
15 10 5 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Basse |
Moyenne |
Haute |
Fotastieta |
Conakry |
||||||||||||||||||||
|
Region naturelle |
9,9 |
14,5 |
12,1 |
7,8 |
11,5 |
|||||||||||||||||||
Source : Analyse des données de l?EDSG IV-2-1-b : Le milieu de résidence
Les résultats selon le milieu de résidence ne font
pas apparaître des écarts statistiquement CEicINfs eIN les milieux
urHIQUirgal eQFmati4re 4A3maciatioQUs IKfants. Toutefois H re
Co
les enfants du milieu rural sont relativement plus nombreux à
être malnutris (11%) que
n nturelle 99 145 121 78 115
ceux du milieu urbain (10%).
Graphique 12 : Taux de malnutrition selon le milieu de résidence
|
11 |
|||||||||||||
|
10 9 |
|||||||||||||
|
Urbain |
Rural |
||||||||||||
|
Milieu de residence |
10,2 |
10,9 |
|||||||||||
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999
IV-2-2-a Le niveau d'instruction de la mre 11
Il ressort de l?EDSG-1999 que la prévalence de malnutrition baisse à mesure que le 10niveau d?instruction de la mre augmente, les enfants des mres les plus instruites étant les moins nombreux à connaître des problèmes nutritionnels (8% contre 11% chez les mères non
Urbain Ruralinstruites). Toutefois, cette relation serait due au hasard car elle n?a pas de signification
Milieu de résidence 102 109
statistique.
Graphique 13 : Taux de malnutrition des enfants selon le niveau d'instruction de la mqre.
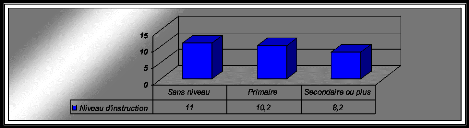
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999 IV-2-2-b : Secteur d'activité de la mère.
On constate que la prévalence de malnutrition varieTAWpeu HTfonction de l?activi49 3-11a E mqre, surtout lorsqu?on compare la situation des enfants des mères inactives (10%) à celle des enfants dont les mères travaillent dans le secteur moderne.
Graphique 14: Taux de la malnutrition selon l'activité de la mqre
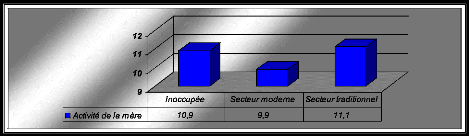
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999 IV-2-2-c : Niveau de vie des ménages
Le niveau de vie des ménages est un facteur de différentiation de la malnutrition des enfants au seuil de 10%. En effet, environ 12% des enfants issus des ménages de niveau de vie faible souffrent de malnutrition, 9% des enfants de moins de cinq ans en souffre dans les ménages de niveau de vie moyen et 10% des dans les ménages de niveau de vie élevé. Par ailleurs on note que l?état nutritionnel des enfants des ménages de niveau de vie élevé est sévrre alors que celui des enfants des ménages de niveau de vie moyen est précaire. Cette situation peut s?expliquer par l?occupation des mqres des ménages de niveau de vie élevé. En effet, une mqre tr~s occupée n?a pas beaucoup de temps à consacrer aux soins de son enfant, cependant la garde de l?enfant est assurée par un membre de la famille ou une femme de ménage dont la majorité ne connaît pas les r4gles d?hygiqnes. Ceci a pour conséquence le mauvais entretien de l?enfant et une
9
mauvaise préparation de sa nourriture qui le plonge ainsi dans des épisodes de maladies 11 infectieuses qui le conduisent dans un état de malnutrition aiguë.
Graphique 15 : Taux des la malnutrition des enfants selon le niveau de vie des ménages
|
15 |
||||||||||||||
|
10 5 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Faible |
Moyen |
Beve |
||||||||||||
|
Niveau de we des ménages 11,9 |
9,1 |
9,9 |
||||||||||||
Source : AnalyV-KIeNERQe10de l3K ' 6G
Comme la région de résidence, l?ethnie de la mqre est facteur de différentiation de la en matière de nutrition des enfants (seuil de signification de 1%). Les résultats mettent en évidence une proportion des enfants malnutris particulièrement élevée chez les peulhs (14%). A l?opposé, c?est dans l?ethnie foresti4re où la plus faible (7%). Chez les enfants soussous ainsi que les malinkés, on note une situation intermédiaire. Il existe donc des inégalités de malnutrition selon l?appartenance ethnique de la mre. Ces résultats rejoignent la th~se selon laquelle l?ethnie serait une composante culturelle fondamentale dont l?influence sur la malnutrition dérive des habitudes et coutumes propres à chaque groupe ethnique, l?hypoth~se qui sera testée dans l?analyse explicative. Ces résultats laissent présager qu?il existe dans chacun des groupes ethniques guinéennes, des comportements des parents en matière de pratiques alimentaires et de soins accordés aux enfants susceptibles d?expliquer les différences de malnutrition observées.
Graphique 16 : Taux de malnutrition des enfants selon l'ethnie de la mre
|
15 |
||||||||||||||||||
|
10 |
||||||||||||||||||
|
5 |
||||||||||||||||||
|
Soussou |
Peulh |
Malinke |
Forestière |
|||||||||||||||
|
Ethnie de la mere 8,8 |
14,4 |
10,4 |
7,1 |
|||||||||||||||
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999
On observe également une différence nette (seuil de 5%) entre les enfants malnutris, selon que
Ma e
leuM' qreIVAoQVd?IobpdieITe isGEmique (11% HI8%)7 ou4)ratiquantes
de la religion traditionnelle (7%).
Graphique 17 : Taux de malnutrition des enfants selon la religion de la mère
|
15 |
||||||||||||||
|
10 5 |
||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||
|
Islam |
Christianisme |
Animisme |
||||||||||||
|
Religion de la mere 11,3 |
7,9 |
6,6 |
||||||||||||
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999
,Il n?existe pas de lien significatif, au plan statistique, entre l?~ge de la mqre et l?état nutritionnel de l?enfant, même si l?on note moins d?enfants malnutris (9%) chez les jeunes mamans (15-24) que chez les vieilles générations.
L?âge des enfants les discrimine de façon significative au plan nutritionnel. Cette discrimination se traduit par une relation sous forme de « U » renversé qui attribue aux tout jeunes enfants (moins de 6 mois) et aux plus âgés (2-4 ans) des faibles taux de prévalence de malnutrition (moins de 10%), opposant ainsi ces deux groupes aux enfants âgés de 6 à 23 mois (taux supérieurs à 15%). En ce qui concerne les enfants de moins de 6 mois, leur situation nutritionnelle acceptable tiendrait au fait que la plupart d?entre eux sont exclusivement nourris au sein naturel. Les quelques cas d?inadéquation du poids/taille dans ce groupe pourraient être assimilés aux enfants nés prématurés. Quant aux enfants de 2-4 ans, il se pourrait qu?ils se soient adaptés au changement intervenu dans leur alimentation en fonction de l?kge. Cela ne semble pas être le cas des enfants âgés de 6 à 23 moins, dont les plus jeunes connaissent l?introduction précoce de l?allaitement mixte et les plus lgés viennent à peine d?être sevrés. Cela est d?autant plausible que les résultats de l?EDSG-1999 situent l?~ge moyen au sevrage à 22,4 mois.
Graphique 18 : L'évolution de la malnutrition des enfants par âge.
|
25 20 15 10 5 0 -5 |
||||||||
|
Emaciation |
||||||||
|
'I 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
||||||||
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999
Sur ce graphique, on observe des fluctuations importantes de la prévalence de malnutrition des enfants selon l?kge de ces derniers. La proportion des enfants émaciés augmente régulièrement de 3 à 14 mois, ~ge auquel elle atteint 21%. Elle diminue pour atteindre 0 à l?Lge de 44 mois avant d?augmenter légèrement puis se stabiliser jusqu?à 59 mois. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces fluctuations importantes notamment les précédents alimentaires de l?enfant au cours d?une période de soudure ou/ et les maladies diarrhéiques qu?il a eu à contracter avant la date de l?enquête. On retiendra de ce graphique que l?Lge vulnérable à la malnutrition de l?enfant se situe entre 2 et 19 mois.
Compte tenu de la pertinence de l?kge dans l?étude de l?évaluation de l?état nutritionnel des enfants, nous l?utiliserons dans les modèles multivariés (cf. chapitre V) comme variable de contrôle.
7 10 13 16 19 22 25 28 31 3
Le croisement entre le sexe de l?enfant et son état nutritionnel indique l?absence d?une association significative entre les deux variables. Ainsi, la malnutrition touche autant de garçons que de filles (10,7%).
Il existe une relation entre le rang de naissance de l?enfant
et son état nutritionnel ; mais cette
relation n?est que de faible
poids statistique (10%). Il en découle que la malnutrition intervient
moins fréquemment chez les premiers-nés et les derniers-nés que chez les enfants de rangs intermédiaires.
On constate une forte association (seuil de 1%) entre le mode d?allaitement et l?état nutrition des enfants. Il en ressort que le probl~me de malnutrition se manifeste en cas d?allaitement mixte (13%) et des aliments solides (12%) qu?en l?absence d?aliments supplémentaires dans l?allaitement maternel. Cependant, l?effet du mode d?allaitement demande d?être interprété avec souplesses étant donné que cette variable dépend de l?1ge des enfants : les plus âgés (2-4 ans) sont moins concernés par l?allaitement maternel exclusif que les tout petits.
L?EDS-II montre l?importance de la vaccination, traduit par son rôle protecteur contre certaines maladies susceptibles d?entraîner la malnutrition chez les enfants. En effet, les enfants immunisés sont moins nombreux (10%) à souffrir de malnutrition que les non vaccinés (13%).
Le respect du calendrier de sevrage par les mères préserve un nombre élevé d?enfants de la malnutrition car celle-ci ne touche que 2% des enfants sevrés après 6 mois. Ce taux de prévalence de malnutrition représente le cinquième de celui observé chez les enfants sevrés précocement (10%).
Bien qu?ayant une faible signification statistique (seuil de 10%), l?association entre, d?une part la qualité de l?eau consommée par le ménage et d?autre part, la malnutrition des enfants mérite toute l?attention requise. Point n?est en effet besoin de le rappeler la consommation d?une eau non potable entraîne la diarrhée, sachant que cette pathologie est intimement liée à la malnutrition.
L?analyse bivariée a fournit des infirmations intéressantes sur les associations entre la variable dépendante et les variables indépendantes et intermédiaires. Toutefois, elle ne permet pas de relever l?ensemble des caractéristiques des enfants avec l?état nutritionnel. Ceci nous
conduit à effectuer une analyse descriptive multivariée afin d?identifier les groupes de facteurs associés à la malnutrition des enfants.
- Profil des enfants selon leur état nutritionnel.
Pour réaliser le second objectif de notre étude, nous avons eu recours à l?Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). Contrairement à l?analyse bivariée qui ne repose que sur la relation entre deux variables, l?analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) met en évidence les interrelations entre plusieurs variables, à partir desquelles, on peut apercevoir des regroupements de variables par « affinité » ou proximité statistique et la position des variables (ou groupes de variables) par rapport à d?autres. L?AFCM a l?avantage de résumer une masse d?informations contenues dans plusieurs variables6. Cette technique permet ainsi d?obtenir un nombre réduit de variables résumées (facteurs)7 qui, dans le cadre de cette étude, dégagent les profils des mères dont les enfants souffrent de malnutrition.
La lecture du Graphique 19 (plan factoriel), et de la matrice des contributions des variables de ce graphique à la variance expliquée par chaque axe factoriel nous a permis de relever les variables fortement liées au phénomène étudié. Le critère de sélection d?une variable est que la valeur de sa contribution doit être supérieure ou égale à la contribution moyenne de l?ensemble des variables. Dans cette étude, il convient de noter qu?une variable va contribuer fortement à la définition d?un axe si sa contribution relative est supérieure ou égale à 1000/40, ce qui correspond à CTR=25. L?examen critique du plan factoriel va consister à la caractérisation des axes factoriels.
Les variables ayant contribué fortement au positionnement de l?axe1 (l?axe horizontal) sont: RES1, RES2, ETN1, REG5, NIV1, NIV3, NIM3, ACT2, ACT3, soit une contribution relative totale de 74 ,2%. Ces variables correspondent aux modalités initiales suivantes: milieu urbain, milieu rural, Soussou, Conakry, Niveau de vie faible, Niveau de vie élevé, Niveau d?instruction secondaire ou plus, Secteur moderne, Secteur traditionnel. L'axe1 est donc caractérisé par les facteurs socio-économiques. Cet axe oppose deux groupes
6 Il s?agit des variables dichotomiques, correspondant aux modalités des variables qualitatives initiales.
7 Graphiquement, ces facteurs sont représentés par des axes appelés axes factoriels. Ainsi, un plan factoriel est constitué par deux axes factoriels perpendiculaires.
d?enfants dont les caractéristiques sur le graphique se positionnent aux parties supérieures (pôle positif) et inférieur (pôle négatif) de l?axe2.
> Le premier groupe est constitué par des enfants présentant un mauvais état nutritionnel (pôle positif). En général, il s?agit des enfants de sexe masculin âgés moins de six mois, et dont le rang de naissance est supérieur à 3, leurs mères ne sont pas instruites et résident en basse guinée, en moyenne guinée et en haute guinée ; celles-ci appartiennent à la vieille génération (35 ans ou plus) et aux ménages modestes. Ces mères résident en milieu rural. Elles sont musulmanes, sont soit inoccupées, soit occupées dans le secteur traditionnel.
> Le deuxième groupe est constitué par des enfants présentant un bon état nutritionnel. Ce sont en majorité des filles aînées dont l?lge est compris entre 12-23 mois et 48-59 mois. Ces enfants appartiennent aux ménages économiquement aisés. Leurs mères ont été scolarisées au niveau primaire au moins et exercent dans le secteur moderne. Il s?agit des mères typiquement urbaines résidant à Conakry (capitale) ou en Guinée forestière dont la plupart y sont ressortissante. Ces mères sont chrétiennes ou animistes.
Les variables ayant le plus contribué ( à hauteur de 82,7%) jà l?axe2 (axe vertical) sont: ETN2, ETN4, REG2, REG3, REG4, NIM2, REL1, REL2, REL3. Ces variables correspondent aux libellés suivants: Peulh, Forestière, Moyenne guinée, Haute guinée, Guinée forestière, Niveau de vie moyen, Islam, Christianisme, Animisme. L'axe2 s'identifie donc au
x

rs
ltur els et environnementau
Cependant, le fait que les modalités de la variable dépendante (état nutritionnel bon et état nutritionnel mauvais) soient toutes d?abscisse nulle ne permet pas de caractériser les enfants par rapport au phénomène étudié. En dépit de cette difficulté, la position de la variable dépendante par rapport à l?axe2 d?une part et l?identification de ce dernier aux facteurs culturels et environnementaux d?autre part témoignent d?une forte association entre ces facteurs et la malnutrition. Ce résultat étant produit par l?analyse descriptive, le chapitre suivant pourra éclairer sur la nature des relations entre variables soupçonnées à cette phase.
Graphique 19 : caractéristiques individuelles et contextuelles des enfants par rapport à Op\I\ nu\Ii\iINTIQGuinée
|
1AXE HORIZONTAL (1) --AXE VERTICAL (2) --TITRE:ESSAI NOMBRE DE POINTS : 40 ==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .177 1 LIGNE = .074 |
ANCORR SUR COUL35 (89) |
||||
|
+ |
REG2----+ |
+ 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
REG3! ETN2 |
! 0 |
01 |
||
|
! |
REG1 |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
NIV1 MAUVREL1 |
! 0 |
01 |
||
|
! |
RES2RAN4 ! |
ETN1 |
! 0 |
01 |
|
|
! |
ACT3 AGE3ETN3 |
! 3 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
+ |
AGE2 |
+ 3 |
01 |
||
|
! |
NIV2 BON RAN2 |
ACT1 |
! 4 |
01 |
|
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
ACT2 |
! 0 |
01 |
|
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
AGE1 |
NIV3 ! 0 |
01 |
||
|
! |
! RAN1 |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
RES1 REG5! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
NIM3 ! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
NIM2 |
! 0 |
01 |
|
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
REG4 ! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
REL3 |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
ETN4 ! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
||
|
! |
REL2 ! |
! 0 |
01 |
||
|
+ |
+ |
+ 0 |
01 |
||
|
NOMBRE |
DE POINTS SUPERPOSES: 10 |
||||
NIM1(AGE3) RAN3(ETN3) AGM1(AGE3) SEX1(AGE2) AGM3(AGE2) AGM5(AGE2) SEX2(BON ) AGM2(BON ) AGM4(BON ) AGM6(BON )
1FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCORR
PLACE MEMOIRE DEMANDEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 1840
1
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999
Tableau 9 : Dictionnaire des variables de l'AFCM
|
Variables et modalités |
Libellés des modalités |
|
Milieu de résidence. |
|
|
RES1 |
Urbain |
|
RES2 |
Rural |
|
Ethnie |
|
|
ETN1 |
Soussou |
|
ETN2 |
Peulh |
|
ETN3 |
Malinké |
|
ETN4 |
Forestière |
|
Région naturelle |
|
|
REG1 |
Basse guinée |
|
REG2 |
Moyenne guinée |
|
REG3 |
Haute guinée |
|
REG4 |
Guinée forestière |
|
REG5 |
Conakry |
|
Malnutrition des enfants |
|
|
BON |
Non |
|
MAUV |
Oui |
|
Niveau de vie |
|
|
NIV1 |
faible |
|
NIV2 |
moyen |
|
NIV3 |
élevé |
|
Age |
|
|
AGE1 |
15-24 ans |
|
AGE2 |
25-34 ans |
|
AGE3 |
35 ans + |
|
Niveau d'instruction de la mqre |
|
|
NIM1 |
sans niveau |
|
NIM2 |
primaire |
|
NIM3 |
secondaire ou plus |
|
Religion de mère |
|
|
REL1 |
Islam |
|
REL2 |
Christianisme |
|
REL3 |
Animisme |
|
Activité de la mère |
|
|
ACT1 |
Inoccupée |
|
ACT2 |
Secteur moderne |
|
ACT3 |
Secteur traditionnel |
|
Sexe de l'enfant |
|
|
SEX1 |
Masculin |
|
SEX2 |
Féminin |
|
Rang de naissance |
|
|
RAN1 |
1 |
|
RAN2 |
2-3 |
|
RAN3 |
4-5 |
|
RAN4 |
6 ou plus |
|
Age de l'enfant en mois |
|
|
AGM1 |
<6 |
|
AGM2 |
6-11 |
|
AGM3 |
12-23 |
|
AGM4 |
24-35 |
|
AGM5 |
36-47 |
|
AGM6 |
48-59 |
Source : Analyse des données de l?EDSG 1999
Le chapitre précédent a mis en évidence des associations entre certaines variables explicatives et la malnutrition des enfants. L?objet de ce chapitre est de confirmer ou non ces relations, cela dans une perspective explicative permettant d?identifier les déterminants de ce phénomène.
Compte tenu de la nature dichotomique de la variable dépendante (1=malnutrition ; 0= sinon) et du faible poids de la modalité valide (10,7%), la régression logistique apparaît comme la technique d?analyse la plus indiquée. L?application de cette technique se fait selon les étapes suivantes :
- constitution des modèles de régression pour chacun des trois groupes de facteurs explicatifs présentés dans le modèle conceptuel. Pour chaque modèle de régression, analyse des effets bruts et nets des variables du groupe considéré ;
- Constitution d?un mod~le intégrant les variables
intermédiaires. Comme à
l?étape
précédente, analyse des effets bruts et nets de chacune des
variables ;
- Constitution d?un mod~le global intégrant tour à tour les trois groupes de facteurs explicatifs et les variables intermédiaires, appréciation du comportement des variables explicatives en l?absence puis en présence des variables intermédiaires.
Pour sélectionner et hiérarchiser les facteurs de risque de la malnutrition des enfants, nous avons utilisé la procédure lroc du logiciel STATA. Celle-ci permet d?évaluer la contribution de chaque facteur à la prédiction totale (Modèle final) et à dégager ainsi une structure hiérarchique des prédicteurs (Boquier, 1996)8. Le lancement de cette procédure sur STATA en particulier se fait à la suite de la commande « logistic ». On obtient à la suite un tracé de la courbe ROC9. Plus le tracé est courbe vers le coin en haut à gauche du graphique, meilleure est la prédiction. Un modèle sans pouvoir de prédiction aurait une courbe tracée à 45°
8 L?ANALYSE DES ENQUETES BIOGRAPHIQUES à l?aide du logiciel STATA.
9 Recever Operating Characteristic : le terme, qui provient de la théorie de détection des signaux, est utilisé par convention.
qui se confondrait alors avec la diagonale sur le graphique. La surface au-dessous de la courbe serait de 0,50. Un modèle avec un pouvoir total de prédiction (PPT) aurait pour courbe ROC une droite verticale le long de l?axe de sensibilité. La surface au dessous de la courbe serait de 100%. Mais comme cette procédure fournit plutôt le pouvoir prédictif total (PPT), le pouvoir
prédictif réel (PPR) s?en déduit à l?aide de la formule suivante :
On désigne par ÄPPR, l?apport d?un facteur ou un groupe de facteurs dans le mod~le de régression suivant, il se calculera comme suit : ÄPPRPPRi-PPRi-1 où i est le nombre de modèles de régression logistique (i1, 2, 3, n).
Les résultats du modèle de régression constitué par les facteurs environnementaux sont cosignés dans le tableau 10.
Tableau 10 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs environnementaux
|
VARIABLES |
Odds ratio « rapport de côtes » |
|||||
|
Modèle 0 (effets bruts) |
Modèle1 |
Modèle2 |
||||
|
Région |
||||||
|
- Basse Guinée |
1,32 ns |
1,32 ns |
1,31 ns |
|||
|
- Moyenne Guinée |
1,98*** |
1,98*** |
1,94*** |
|||
|
- Haute Guinée |
1,63*** |
1,63*** |
1,61** |
|||
|
- Guinée Forestière |
r |
r |
r |
|||
|
- Conakry |
1,63** |
1,63** |
1,76** |
|||
|
PPR=26,46% |
||||||
|
Milieu de résidence |
||||||
|
- Urbain |
0,98 ns |
0,90 ns |
||||
|
- Rural |
r |
r |
||||
|
PPR=22,86% |
||||||
|
Signification |
*** |
*** |
*** |
|||
|
PPR (%) |
26,46 |
26,48 |
||||
|
ÄPPR (%) |
0,02 |
|||||
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; r désigne la modalité de référence.
Parmi les deux variables sélectionnées pour rendre compte des facteurs environnementaux, seule la région de résidence influence significativement (effets brut et net) la malnutrition des enfants. Quant au milieu de résidence, il n?agit pas sur ce
phénomène. La non-pertinence de cette variable s?aperçoit au niveau de sa contribution quasi nulle (0,02%) au pouvoir prédictif du modèle qui la contient avec la région. Notons toutefois que la prise en compte du milieu de résidence dans l?analyse (Mod~le2) modifie l?effet de la région naturelle. A Conakry par exemple, la considération du milieu de résidence augmente le risque de malnutrition de 12 points, sachant que la valeur initiale de ce risque (effet brut) est de 63% plus élevé Guinée foresti~re. Bien que qu?invariable en haute Guinée, le risque de malnutrition y perd une partie de sa signification statistique (passant du seuil de 1% à celui de 5%) sous l?effet du milieu de résidence. Dans l?ensemble, les résultats d?analyse montrent que le risque pour un enfant d?être malnutri est relativement plus faible en Guinée forestière que dans les autres régions naturelles. Mais ce risque ne varie pas significativement lorsqu?on compare la situation nutritionnelle des enfants de cette région à celle des résidents de la basse Guinée.
Le modqle de régression logistique relatif à l?influence des facteurs socio-économiques sur la malnutrition des enfants a permis de dresser le tableau 11.
Tableau 11 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs socioéconomiques
|
VARIABLES |
Odds ratio « rapport de côtes » |
|||
|
Modèle 0(effets bruts) |
Modèle 1 |
Modèle 2 |
Modèle 3 |
|
|
Niveau de vie - Bas - Moyen - Elevé PPR=24,30% |
r 0,76* 0,88 ns |
r 0,76* 0,88 ns |
r 0,77* 0,94 ns |
r 0,77 ns |
|
Niveau d'instruction -Aucun -Primaire -Secondaire ou plus PPR=23,42% |
r 0,95 ns |
r 0,96 ns |
r 0,95 ns |
|
|
Secteur d'activité -Sans occupation -Moderne -Traditionnel PPR=23,76% |
0,98 ns 0,95 ns R |
0,95 ns 0,94 ns R |
||
|
Signification |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
PPR (%) |
24,30 |
24,74 |
25,72 |
|
|
ÄPPR (%) |
0,44 |
0,98 |
||
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; r désigne la modalité de référence.
L?analyse montre qu?aucun facteur socio-économique n?influe sur la malnutrition des enfants. On en déduit qu?en mati4re de nutrition, ni le niveau de vie du ménage, ni le niveau d?instruction de la mqre, ni le secteur d?activité de celle-ci ne discrimine les enfants. Ainsi, la variation du phénomène étudié en fonction de ces facteurs peut être attribuée au hasard. Une analyse intégrant les trois groupes de facteurs retenus dans le cadre conceptuel nous édifiera à ce sujet.
Le tableau12 contient les résultats de la régression logistique du risque de malnutrition des enfants en fonction des facteurs culturels.
Tableau 12 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des facteurs culturels
|
VARIABLES |
Odds ratio « rapport de côtes » |
|||||
|
Modèle 0 (effets bruts) |
Modèle 1 |
Modèle 2 |
||||
|
Groupe ethnique |
||||||
|
-Soussou |
0,86 ns |
0,86 ns |
0,86 ns |
|||
|
-Peulh |
1,49** |
1,49** |
1,48** |
|||
|
-Malinké |
r |
r |
r |
|||
|
-Forestière |
0,68* |
0,68* |
0,72 ns |
|||
|
PPR=27,20% |
||||||
|
Religion |
||||||
|
-Islam |
r |
r |
||||
|
-Christianisme |
0,71 ns |
1,02 ns |
||||
|
-Animisme |
0,54** |
0,84 ns |
||||
|
PPR=12,24% |
||||||
|
Signification |
*** |
*** |
*** |
|||
|
PPR (%) |
27,20 |
27,22 |
||||
|
ÄPPR (%) |
0,02 |
|||||
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; r désigne la modalité de référence
Il en ressort que l?influence de ces facteurs ne se manifeste qu?à travers l?effet partiel de l?ethnie. A cet effet, seuls les enfants peulh se distinguent des malinké (groupe de référence), les premiers présentant un risque de malnutrition de 48% plus élevé que les derniers. Quant aux enfants appartenant aux autres groupes ethniques, leur situation nutritionnelle n?est pas tr~s différente de celle des malinkés. Avec une contribution infime (0,02 %) au pouvoir prédictif au
modqle de régression, l?appartenance religieuse des parents n?est pas un facteur culturel pertinent dans l?explication de la malnutrition des enfants en Guinée.
Le tableau 13 comprend les résultats de la régression logistique du risque de malnutrition des enfants sous l?influence des variables intermédiaires.
Tableau 13 : Risque de malnutrition chez les enfants en fonction des variables intermédiaires
|
VARIABLES |
Odds ratio « rapport de côtes » |
|||||
|
Effets bruts |
Modèle1 |
Modèle2 |
Modèle3 |
Modèle4 |
Modèle5 |
|
|
Vaccination |
||||||
|
-Non |
1,52*** |
1,52*** |
1,49*** |
1,54*** |
1,54*** |
1,55*** |
|
-Oui |
r |
r |
r |
r |
r |
r |
|
PPR=26,28 |
||||||
|
Eau de boisson |
||||||
|
- Potable |
0,84 ns |
0,90 ns |
0,91 ns |
0,94 ns |
0,91 ns |
|
|
- Non potable |
r |
r |
r |
r |
r |
|
|
PPR=23,64% |
||||||
|
0 RGRG'DGDENIP HN |
||||||
|
-Allaitement au sein |
r |
r |
r |
r |
||
|
-Biberon |
1,67** |
1,86** |
1,86** |
1,77** |
||
|
-Solide/semi-solide |
2,16*** |
2,22*** |
2,23*** |
2,01*** |
||
|
PPR=18,92% |
||||||
|
Rang de naissance |
||||||
|
-1er |
r |
r |
r |
|||
|
- de 2 à 3ème |
1,13 ns |
1,14 ns |
1,11 ns |
|||
|
- de 4 à 5ème |
1,56** |
1,63** |
1,64** |
|||
|
- de 6ème au plus |
1,34 ns |
1,46* |
1,49* |
|||
|
PPR=24,98% |
||||||
|
Age au sevrage |
||||||
|
- Avant 6 mois |
3,61*** |
2,99** |
||||
|
- Après 6 mois |
r |
r |
||||
|
PPR=22,76% |
||||||
|
Signification |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
|
PPR (%) |
26,28 |
26,86 |
24,48 |
27,26 |
28,26 |
|
|
1:335 111:11 ) |
0,58 |
-2,38 |
2,78 |
1,00 |
||
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; r désigne la modalité de référence.
Dans cette catégorie de variables, la qualité de l?eau consommée par le ménage est la seule qui n?agit pas significativement sur la malnutrition des enfants. L?action des variables
intermédiaires restantes est variée. On constate notamment que le fait de ne pas respecter les
doses des vaccins essentiels augmente de 55% le risque de malnutrition chez l?enfant. Mais l?apport des autres variables intermédiaires dans l?augmentation de ce risque est tr~s modeste (3%), comparativement à l?effet brut du statut vaccinal de l?enfant. Par ailleurs, le risque de malnutrition passe du simple au double avec l?introduction des aliments solides dans l?allaitement de l?enfant puis au triple en cas de sevrage précoce de celui-ci (moins de 6 mois). Cette situation traduirait le comportement des mères. Certaines mères, fortement influencées par la culture traditionnelle, ne voient pas la nécessité des vaccins.
On note enfin un risque de malnutrition plus faible chez les premiers-nés que les enfants de rang supérieur, même si ce risque s?atténue quelque peu chez les cadets (rang 6 et plus) que chez les enfants de rangs 4 et 5.
Les pouvoirs prédictifs des variables et groupes de facteurs, calculés conformément au cadre conceptuel sont présentés dans le tableau 14.
Tableau 14 : Récapitulatif des contributions (en %) des groupes de facteurs à l'occurrence de la malnutrition chez l'enfant.
|
GROUPES DE FACTEURS |
CONTRIBUTIONS |
CLASSEMENT |
CONTRIBUTIONS |
|
Facteurs environnementaux |
26,48 |
2,84 |
|
|
-Région de naturelle |
26,46 |
2 |
2,82 2 |
|
-Milieu de résidence |
22,86 |
-0,02 |
|
|
Facteurs socio-économiques |
25,72 |
1,56 |
|
|
-Niveau de vie du ménage |
24,30 |
1,22 |
|
|
-Niveau d?iINructioQUe la mère |
23,42 |
3 |
0,40 3 |
|
-Secteur d?activité |
23,76 |
0,04 |
|
|
Facteurs culturels |
27,22 |
1,38 |
|
|
-Groupe ethnique |
27,20 |
1,30 5 |
|
|
-Religion de la mère |
12,24 |
1 |
0,12 |
|
VARIABLES INTERMEDIAIRES 28,26 5,82 |
|||
|
Comportement de la mère |
24,48 |
3,40 |
|
|
-Vaccination |
26,28 |
3,78 |
|
|
-Eau de boisson |
23,64 |
5 |
0,82 1 |
|
-Mode d?allaitement |
18,92 |
-1,12 |
|
|
Caractéristiques démographiques de l'enfant |
25,38 |
2,72 |
|
|
-Rang de naissance |
24,98 |
1,34 4 |
|
|
-Age au sevrage |
22,70 |
4 |
1,18 |
Les résultats des contributions brutes montrent que la culture occupe la première place dans la structure hiérarchique des facteurs de risque de malnutrition des enfants en Guinée (27,22%). Elle est suivie par le contexte représenté par les facteurs environnementaux (26,48%). Viennent ensuite les facteurs économiques (25,72%) puis les caractéristiques démographiques de l?enfant (25,38%) et les comportements de la mgre en matiire de soins et d?alimentation (24,48%). Toutefois, lorsqu?on met les variables intermédiaires ensemble (comportements de la mqre et caractéristiques de l?enfant), l?on se rend compte que la contribution de ce groupe (28,26) dépasse celle de la culture. De ce fait, les variables intermédiaires deviennent les déterminants cruciaux de la malnutrition des enfants. Les deuxième et troisième places dans ce nouveau classement reviennent ainsi aux facteurs socioculturels et aux facteurs environnementaux respectivement. Etant donné qu?aucun facteur économique n?influe sur le risque de malnutrition des enfants, nous présumons que l?ensemble de ce groupe n?influence donc pas ce phénomgne, en attendant les résultats de l?analyse globale (section V-6).
Lorsqu?on s?intéresse aux sous-groupes des groupes de facteurs, les trois premières places reviennent successivement à l?ethnie (27,20%), à la région naturelle (26,46%) et à la vaccination (26,28%), en ne considérant que les contributions individuelles des variables (au brut) supérieures à 25%. Ces variables peuvent être considérées comme les déterminants cruciaux de la malnutrition chez les enfants en Guinée.
S?agissant des résultats des contributions nettes on constate une permutation de rang entre les facteurs culturels et les comportements de la mère. Ce qui laisse présager que ces derniers médiatisent l?influence des facteurs culturels sur la malnutrition que nous allons vérifier à la section V-6. Dans la structure hiérarchique des facteurs de risques de malnutrition ; les comportements de la mère (3,40%) et les facteurs environnementaux (2,84%) se classent aux premiers rangs. Ce qui réconforte les résultats des contributions brutes étant donnés que la vaccination et le mode d?allaitement sont fortement influencés par la culture de la mère notamment le groupe ethnique.
A l?intérieur des sous-groupes des groupes de facteurs de risque de malnutrition, les variables qui se rév~lent déterminants à l?explication de la malnutrition des enfants sont les suivantes : la vaccination (3,78%), la région naturelle (2,82%) et le rang de naissance (1,34%).
Ces deux résultats (contributions brutes et nettes) n?ont nullement de contradiction entre elles, les résultats de des unes confirment ceux des autres. Par ailleurs, les variables se classent par même ordre d?importance dans chaque résultat. Evaluons à présent la contribution de chaque groupe de facteurs explicatifs au pouvoir prédictif du modèle global de régression.
En mettant ensemble les groupes de facteurs on pourrait observer des changements au niveau de la significativité de chaque variable ou bien au niveau des risques relatifs qu?elles présentent. En effet, ces interactions entre les différentes variables pourraient confirmer ou infirmer nos hypothèses en précisant les facteurs les plus déterminants. Les résultats de la régression logistique appliquée à cet effet sont consignés dans le tableau 16. En effet, il en ressort que l?avant dernier mod~le contient un peu moins du tiers (30,36%) des informations initiales. Il indique également que les facteurs environnementaux contribuent moins (1,06%) à l?acquisition de ce pouvoir prédiction.
Tableau 15 : Mécanisme d'action de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans.
|
VARIABLES |
Odds ratio « rapport de côtes » |
|||
|
Modèle1 |
Modèle2 |
Modèle3 |
Modèle4 |
|
|
Groupe ethnique |
||||
|
-Soussou |
0,86 ns |
0,79 ns |
0,88 ns |
0,78 ns |
|
-Peulh |
1,48** |
1,35 ns |
1,44* |
1,25 ns |
|
-Malinké |
r |
r |
r |
r |
|
-Forestière |
0,72 ns |
0,81 ns |
0,63 ns |
0,77 ns |
|
Religion |
||||
|
-Islam |
r |
r |
r |
r |
|
-Christianisme |
1,02 ns |
1,07 ns |
1,59 ns |
1,34 ns |
|
-Animisme |
0,84 ns |
0,89 ns |
1,25 ns |
1,26 ns |
|
Région |
||||
|
- Basse Guinée |
1,24 ns |
1,28 ns |
1,77* |
|
|
- Moyenne Guinée |
1,30 ns |
1,27 ns |
1,49 ns |
|
|
- Haute Guinée |
1,35 ns |
1,50* |
1,85** |
|
|
- Guinée Forestière |
r |
r |
r |
|
|
- Conakry |
1,62 ns |
1,60 ns |
2,01* |
|
|
Milieu de résidence |
||||
|
- Urbain |
0,87 ns |
1,18 ns |
1,12 ns |
|
|
- Rural |
r |
r |
r |
|
|
Niveau de vie |
||||
|
- Bas |
r |
r |
||
|
- Moyen |
0,85 ns |
0,96 ns |
||
|
- Elevé |
0,85 ns |
0,95 ns |
||
|
Niveau d'instruction |
||||
|
-Aucun |
r |
r |
||
|
-Primaire |
1,00 ns |
1,06 ns |
||
|
-Secondaire ou plus |
0,73 ns |
0,77 ns |
||
|
Secteur d'occupation |
||||
|
-Sans occupation |
0,77 ns |
0,91 ns |
||
|
-Moderne |
0,84 ns |
0,96 ns |
||
|
-Traditionnel |
r |
r |
||
|
Vaccination |
||||
|
- Non |
1,53** |
|||
|
- Oui |
r |
|||
|
Eau de boisson |
||||
|
- Potable |
0,79 ns |
|||
|
- Non potable |
r |
|||
|
Mode d'allaitement |
||||
|
-Allaitement au sein |
r |
|||
|
-Biberon |
1,89** |
|||
|
-Solide/semi-solide |
2,18*** |
|||
|
Rang de naissance |
||||
|
-1er |
r |
|||
|
- de 2 à 3ème |
1,16 ns |
|||
|
- de 4 à 5ème |
1,59** |
|||
|
- de 6ème au plus |
1,53* |
|||
|
Age au sevrage |
||||
|
- Avant six mois |
3,15** |
|||
|
- Après six mois |
r |
|||
|
Khi2 |
59,35*** |
62,99*** |
67,80*** |
86,68*** |
|
PPR (%) |
27,22 |
28,28 |
30,36 |
36,18 |
|
ÄPPR(%) |
1,06 |
2,08 |
5,82 |
|
(*) prob =0,10; (**) prob =0,05; (***) prob =0,01; (ns) non significatif ; r désigne la modalité de référence.
Les résultats de l?analyse montrent que l?introduction des facteurs environnementaux dans le modqle de régression (Mod:le 2), d?une part, annule l?effet de l?ethnie de la mqre sur le risque de malnutrition chez l?enfant et, d?autre part, n?améliore pas le pouvoir prédictif du modèle. En effet, aucune des composantes de ce groupe de facteurs n?agit significativement sur le phénomqne étudié et ces facteurs ne contribuent que de 1% à l?amélioration du pouvoir prédictif du mod~le. L?effet de l?ethnie n?est que timidement réhabilité par la présence des facteurs économiques (mod:le 3), dont l?impact suscite également l?influence (du reste faible et tr~s limitée) de la région naturelle. Par contre, l?influence des facteurs économiques reste nulle, en dépit de leur contribution au pouvoir prédictif du modèle de régression qui représente le double de celle des facteurs environnementaux. On peut ainsi dire qu?en l?absence des variables intermédiaires, l?ethnie de la mqre et, dans une moindre mesure, la région naturelle sont les facteurs qui influencent la malnutrition des enfants. Le contrôle de l?effet conjugué de l?ensemble des variables indépendantes par celui des variables intermédiaires (mod~le 4) entraîne l?annulation de l?effet du groupe ethnique mais amplifie par contre celui de la région naturelle. On en retient que le risque de malnutrition chez les enfants est plus élevé en basse Guinée, en haute Guinée et Conakry (respectivement 77%, 85% et 2 fois supérieur) qu?en Guinée forestière. En confrontant ce résultat avec celui relatif au classement des facteurs de risque, on se rend compte qu?en définitive, la région naturelle, la vaccination de l?enfant, le mode d?allaitement de l?enfant, le rang de naissance de l?enfant et l?~ge au sevrage de l?enfant influencent beaucoup plus la malnutrition des enfants en Guinée.
Tableau 16 : Récapitulatif des déterminants de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée
|
Variable étudiée |
Déterminants cruciaux |
|
Malnutrition des enfants |
Région naturelle |
|
Vaccination de l?enfant |
|
|
Rang de naissance de l?enfant |
|
|
Age au sevrage de l?enfant |
|
|
Mode d?allaitement de l?enfant |
Conclusion partielle
Dans l?ensemble, la plupart des relations observées au chapitre précédent viennent d?être confirmées par les résultats de l?analyse explicative. Ainsi, les effets des variables explicatives sur la malnutrition sont en partie médiatisés par les comportements de la mère et les caractéristiques démographiques de l?enfant.
L?analyse des résultats nous a permis de classer les facteurs culturels et environnementaux aux premiers rangs dans l?explication de la malnutrition des enfants parmi les trois groupes de facteurs retenus dans cette étude. Dans le premier groupe de facteurs, l?ethnie revêt une importance capitale dans la variation de la malnutrition des enfants ; mais son influence est médiatisée par le mode d?allaitement, le rang de naissance de l?enfant et l?~ge au sevrage de l?enfant. Dqs lors, ces différentes variables deviennent des déterminants cruciaux de la malnutrition des enfants. Dans le deuxième groupe de facteurs, la région naturelle est un facteur de différenciation de la malnutrition des enfants. L?effet de cette variable se renforce en présence des variables intermédiaires. Ainsi, s?ajoutent également la région naturelle et le statut vaccinal de l?enfant sur la liste des déterminants cruciaux de la malnutrition des enfants en Guinée. Les facteurs socio-économiques n?influencent pas la malnutrition des enfants.
L?étude que nous avons menée avait pour objectif général de contribuer à l?amélioration des connaissances sur les facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants en Guinée. Pour cela, nous avons assigné à l?étude les objectifs spécifiques suivants: (1) dégager les différences de l?état nutritionnel des enfants, (2) caractériser les enfants par rapport à leur état nutritionnel, (3) identifier et hiérarchiser les facteurs susceptibles d?expliquer la malnutrition des enfants découlant des différences observées, (4) déterminer le rôle des comportements des mères en mati4re de soins et d?alimentation dans le schéma explicatif de l?état nutritionnel des enfants.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé les données de l?Enquête Démographique et de Santé de Guinée de 1999. L?évaluation de la qualité des données nous a permis de relever quelques insuffisances relatives à la déclaration de l?~ge de la mqre, ainsi que celui de l?enfant. Cette carence méthodologique a été comblée par le regroupement des ~ges des mqres en groupes d?~ge quinquennaux. Aussi avons-nous construit un standard à partir de ces données, car nous avons jugé que la référence internationale couramment utilisée pour l?évaluation de l?état nutritionnel des enfants semble être élevée pour les enfants guinéens.
Pour tester notre cadre théorique de référence, nous avons eu recours à deux méthodes d?analyse : dans un premier temps, nous avons effectué une analyse descriptive, suivie d?une analyse explicative.
L?analyse descriptive des données anthropométriques des enfants de moins de 5 ans de l?EDSG-1999 montre qu?il existe en Guinée de réels probl~mes nutritionnels. En effet, la malnutrition est distribuée de façon hétérogène à travers le pays, touchant particulièrement la Moyenne Guinée et la Haute Guinée. Ces taux sont largement supérieurs au seuil du 10% fixé par l?Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au dessus duquel les enfants sont considérés comme «gravement touchés » par la malnutrition aiguë. L?analyse explicative a permis d?identifier un certain nombre de facteurs de risque de malnutrition des enfants, d?où la vérification de nos hypothèses de travail. Par ailleurs, les facteurs culturels et environnementaux se placent aux premiers rangs dans la structure hiérarchique des déterminants de la malnutrition des enfants en Guinée. Ainsi, parmi les facteurs culturels, l?appartenance ethnie revêt une importance capitale dans la variation de la malnutrition des
enfants ; mais son influence est médiatisée par le mode d?allaitement, le rang de naissance de l?enfant et l?~ge au sevrage de l?enfant. Dqs lors, ces différentes variables deviennent des déterminants cruciaux de la malnutrition des enfants. S?agissant des facteurs environnementaux, la région naturelle est un facteur important de différenciation de la malnutrition des enfants. Son effet est particulièrement renforcé par celui du statut vaccinal des enfants, avec lequel cette variable s?ajoute aux déterminants cités ci-dessus. Les facteurs socioéconomiques n?influencent pas la malnutrition des enfants. En particulier, les résultats mettent en évidence l?importance du rôle que doit jouer la m~re pour l?amélioration de l?état nutritionnel de l?enfant.
Des résultats semblables ont été obtenus dans d?autres travaux de recherche en Afrique (FAO, 1999 ; OMS, 2003 ;~). Par ailleurs, ces résultats paraissent évidents pour un spécialiste de santé, mais ils demeurent essentiels pour un planificateur en vue du renforcement des stratégies mises en oeuvre pour lutter contre la mortalité infantile due à la malnutrition en Guinée. Eu égard à ces résultats, nous tenons à adresser à l?intention des pouvoirs publics guinéens quelques suggestions susceptibles de réduire substantiellement la malnutrition infantile:
Toute intervention visant à améliorer l?état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans doit cibler en priorité la Moyenne Guinée puis la Haute Guinée.
Initier un programme de sensibilisation pour encourager les mères à vacciner leurs enfants contre les maladies infantiles.
2s. Promouvoir l?enseignement des soins de santé et nutritionnels aux mqres à travers les médias et les campagnes de Communication pour le Changement de Comportement (CCC) qui incluent également la promotion de l?importance du lait maternel pendant les six premiers mois de la vie de d?un enfant.
Les résultats de cette étude ouvrent d?autres pistes de recherches auxquelles les chercheurs sont invités à s?investir. Etant donné que les facteurs culturels ont une part assez importante dans l?explication de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans en Guinée, il serait intéressant d?étudier en profondeur la relation entre le statut de la mqre et la malnutrition des enfants, en y associant une enquête qualitative pour mieux définir les moyens d?action à mener en vue d?une maîtrise de ce phénomène.
AGBESSI-DOS-SANTOS H. & al, (1987) : Manuel de nutrition Africaine. Eléments de bases appliqués, Karthala, Paris, 331p.
AKOTO E. M. (1993) : Déterminants socio-culturels de la mortalité des enfants en Afrique Noire. Hypothèses et recherche d'explication. Louvain- La- Neuve, Académia, 1993, 269p.
AKOTO E. M. (1990) « Christianisme et inégalités en matière de mortalité des enfants en Afrique noire ». Population, Vol n°6, 1990, pp971-992.
AKOTO E. M. & TABUTIN D. (1989): « les inégalités socioéconomiques et socioculturelles devant la mort » in Mortalité et société en Afrique au sud du Sahara. Ed par Pison G., Van de Walle et Sala-Diakanda. Paris, INED, PUF, pp35-64 (Travaux et documents, cahier n°124).
AKOTO E. M. & HILL A. (1988): « Morbidité, Malnutrition et Mortalité des enfants » in Population et société en Afrique au sud du Sahara, l?harmattan, Paris, pp309-334.
BAKENDA J. L., (2004) : Les déterminants de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon, Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 97p.
BAKER J. ; MARTIN L. ; & PIWOZ E. : (1996) : Nutrition de la femme et ses conséquences pour la survie de l?enfant et la santé reproductive en Afrique, 42 p.
BANQUE MONDIAL (1994) : Pour une meilleure santé en Afrique, les leçons de l?expérience, Washington DC., 283 p.
BANZA-NSUNGU A. B. (2004) : Environnement urbain et santé : La morbidité diarrhéique des enfants de moins de cinq ans à Yaoundé (Cameroun), Thèse de doctorat en géographie de la santé, novembre 2004, université Paris X- Nanterre, 374 p.
BARRY, A.O. (1981) : Essai d'appréciation de l'état nutritionnel des populations vulnérables du CGR de Labé. Thèse de Doctorat en Médecine, Université de Conakry.
BENINGUISSE .G, KOBIANÉ J-F (2005) : « ANALYSE FACTORIELLE »; Objectifs, fondments, diversité des méthodes et application à la construction d?un proxy de niveau de vie in Ateliers de formation à l?analyse comparative des données d?enquêtes démographiques et de santé (EDS) sur le thème : la discontinuité des soins obstétricaux en Afrique centrale et de l'ouest, 30p. Juin 2005.
BHUIYA A. & STREATFIELD K. (1991), « Mother?s Education and Survival of
BOURNE K. L. & WALKER G. M. (1991), « The Differential Effect of Female Children in a Rural Area of Bangladesh », Population Studies, 45, p. 253-264.
BRET B. : (1995), Le tiers-monde : Croissance, Développement, Inégalité, Marketing. 187 p.
BRIEND A. (1998) : La malnutrition de l?enfant. Des bases physiopathologiques à la prise en charge sur le terrain, Monographie Chaire Danone, 163p.
CALDWELL J. (1981) « InGiffDARC PIternelle et mortalité infantile ». Dans Frorum mondial de la santé, vol 2, n°1, OMS, Genève, pp91-93.
CANTRELLE P. (1996) : « Mortalité et environnement » in Population et environnement dans las pays du sud. Karthala CEPED, Paris, pp217-228.
CHERIF F. (1980) : Anémies nutritionnelles en Guinée. Thèse de Doctorat en Médecine, Université de Conakry.
DACKAM N. R. ; GUBRY P. ; NGWE E. (1993) : « Les inégalités géographiques et la mortalité au Cameroun » in Social and medecine, vol 36, n°10, New-York, pp1285-1290.
DACKAM N. R. : (1988) : Niveau d?instruction de mqre et mortalité ; une évaluation critique, les anales de l?IFORD, vol 12, n°1, 101p.
DACKAM N. R. : (1990) : L?éducation de la mqre et la mortalité des enfants, cahier de l?IFORD, n°2, Yaoundé, 160 p.
DACKAM N. R. : (1981) : Mortalite juvenile en Afrique tropicale, Memoire de DEA en Demographie, 139p.
DESGREES DU LOU A. (1996) : Sauver les enfants : le rôle des vaccinations. CEPED, n°12, Paris, 261p.
DIALLO L. & KEITA M. (2000) : « la femme guinéenne en 1996» in Rapport du Recensement Général de la Population et de l?Habitat (RGPH), Rep. Guinée, DNS, 54p.
DIALLO O. : (1999) : « Allaitement et Etat nutritionnel des enfants en Guinée »in Enquête Demographique et de Sante Guinee, Macro International Inc. Pp135-152.
Direction Nationale de la statistique (1996), Rapport du recensement General de la Population et de l?Habitat, Rep. Guinee, 40 p.
EDSC, 1991 : Nutrition en Afrique ; Nutrition et sante des jeunes enfants au Cameroun, 75p.
EDSC, 1992 : Rapport de l?enquête démographique et de santé de Guinée, 275p.
EL MAKRINI (2001) : Le genre et la sante des enfants : Possibilité d?analyse à partir de l?EDS?95 de l?Egypte, Centre d?Estudis Demographics, 30p.
FAO (1999) : Bulletin de l?Organisation des Nations Unies pour l?Alimentation et l?Agriculture. Aperçu nutritionnel par pays, 30p.
FAO (1996) : Sixième enqu6te mondiale sur l'alimentation. Organisation des Nations Unies pour l?Alimentation et l?Agriculture. FAO, Rome.
FLEGG A. T. (1982). « Inequality of inconme, illiteraey and medical care as determinant of Infant mortality in underdeloped countries ». In Population studies, vol 36, pp441-458.
GAIGBE TOGBE V. (1986) : Mortalite infantile à Yaounde : une etude de saisonnalite, Memoire de DEA en demographie, IDP, Paris, 179p.
GARENNE & al., (2000) : Risques de décès associés à différents états nutritionnels chez l?enfant d?~ge préscolaire : étude réalisée à Niakhar (Sénégal), 1983-1986, CEPED n°17, Paris, 201p.
GBENYON K. & LOCOH T. (1989). « Les différences de Mortalité entre filles et garçons » in Mortalité et Société en Afrique au sud du Sahara, ed. INED/UIESP/IFORD/MNIN/, paris, pp221-244.
GRENIER B. & GOLD F. (1986) : Développement et maladies de l?enfant, Masson, Paris, 634p.
HAROUNA S. (1998) : Incidence du comportement des mères en matière de soins préventifs sur la mortalité des enfants au NIGER, les cahiers de l?IFORD, n°22, 123p.
JOSHI Arhun R. (1994): « Maternal schooling and child health: preliminary analysis of the intervening mechanisms in rural Nepal ». Dans Health transition review, vol4, n°1, pp1-28.
LACHAUD J. : (2003) : La dynamique de l?inégalité de la malnutrition des enfants en Afrique. Une analyse comparative fondée sur une décomposition de régression, document de travail, université Montesquieu-Bordeaux IV, 23p.
LATHAM M. C., (2001) : La malnutrition dans les pays en développement, Organisation des Nations Unies pour l?Alimentation et L?Agriculture (FAO), Rome/Italie, 515p.
LETON C. (1979) : « Variation saisonnière des décès infantiles dans l'ouest du Zaïre » in la mortalité des enfants dans le tiers monde, Chaire quetelet département de démographie ULC, pp173-183
LETONTURIER P. (1996) : Immunologie générale, Masson, Paris, 160p.
LESSONNDE Louise (1996) : Les défis de la Démographie, Paris XIIIè, 224p.
Macro International Inc. (1992) : Enquête Démographique et de santé de GUINEE (EDSG-I)
Macro International Inc. (1999) : Enquête Démographique et de santé de GUINEE (EDSG-II), 370p.
Macro International Inc. (1999) : Nutrition des jeunes enfants et des mères en Guinée. Nutrition en Afrique : graphiques commentés, 41p.
MAEF (Minist~re de l?Agriculture de l?Élevage et des Forêts). (1997) : Programme d?appui à la sécurité alimentaire (PASAL). Bulletins trimestriels de suivi des importations.
MAEF (MinistEre de l?Agriculture de l?Élevage et des Forêts) (1997) : Programme d?appui à la sécurité alimentaire (PASAL). Stratégies sous-sectorielles et thématiques.
MASON, Karen Oppenheim (1993), «The impact of Women?s Position on Demographic Mother?s Education on Mortality of Boys and Girls in India », Population Studies, 45, p.
MEFP (MinistIre de l?Economie, des Finances et du Plan, Direction Nationale de la Statistique). (1996) : Enquête à Indicateurs Multiples (EIM) 1996.
MOSLEY H. & CHEN L. (1984) : « Schéma explicatif de la mortalité des enfants » in Déterminants de la mortalité. Dir., J. VALLIN & al., INED, Paris, pp432-433.
MPC (Ministère du Plan et de la Coopération). (1994-1995a) : Projet d?appui au développement socio-économique (PADSE). Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages avec module budget et consommation (EIBC). Rapport final.
MPC (Ministère du Plan et de la Coopération). (1994-1995b) : Projet d?appui au développement socio-économique (PADSE). Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages avec module budget et consommation (EIBC). Un profil de pauvreté en Guinée.
MPF (Ministère du Plan et des Finances). (1991) : Projet d?appui au développement socioéconomique (PADSE). Enquête sur les informations prioritaires (ESIP). Rapport final.
MS (Ministère de la Santé, Division Alimentation Nutrition). (1994) : Politique nationale et plan d?action pour la nutrition en Guinée.
MS (Ministère de la Santé, Division Alimentation Nutrition). (1994) : Troubles dus à la carence en iode en Guinée. Rapport final.
MSPP (Ministère de la Santé Publique et de la Population). (1991) : Rapport préliminaire des résultats de l?enquête sur l?alimentation et la nutrition en Moyenne Guinée (ENAMOG).
MSPP (Ministère de la Santé Publique et de la Population). (1991) : Etat de bien-être des ménages à Conakry : analyse préliminaire (ENCOMEC).
NGO NSOA P. (2001) : Les différences régionale de la malnutrition infanto-juvenile au Cameroun : Recherche des facteurs explicatifs. Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 94p.
NOUMBISSI A., (1996) : Methodologie d?analyse de la mortalité des enfants au Cameroun, ULC, Academia, 305p.
NTSAME ONDO Nicole (1999) : Impact de la fécondité sur la qualité des enfants. Recherche des mécanismes d?action, Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 119p.
OMS (1981) : Elaboration d?indicateurs pour la survie continue des progr~s réalisés dans la voie de la santé pour tous d?ici l?an 2000, Genve, 102p.
OMS (1996) : Maternité sans risque, n°21 (2), Genève, 16p.
OMS (2001) : Bulletin de l?organisation Mondiale de la santé. Recueil d?articles n°4.
ONAPO-Rwanda (1982) : Actes du colloque « Famille, Population et Développement », édit, Kigali, du 27 septembre au 1er octobre 1982.
OUA/UNICEF (2000) : L?avenir de l?Afrique : ses enfants. Etudes sectorielles, n°92-806- 2030-4, 223p.
RAKOTONDRABE F. P. (2004) : Statut de la femme, prise de décision et santé de l?enfant à Madagascar, thèse de doctorat, IFORD, Yaoundé, 353p.
RAKOTONDRABE F.P. (1996): Les facteurs de la mortalité des enfants à Madagascar, les cahier de l?IFORD n°10, Yaoundé, 123p.
ZO HARILALA R. : (2002) : Déterminants de la diarrhée des enfants de moins de cinq ans à Yaoundé, Mémoire de DESSD, IFORD, 103p.
Rapport du recensement Général de la Population et de l?Habitat (RGPH), Rep. De GUINEE, 2000, DSN, 40p.
RWENGE M. (1993) : « Quelques aspects du contexte socioculturel de la morbidité des enfants en Afrique au Sud du Sahara » in mortalité infantile et juvénile en Afrique : Bilan des recherches et politiques de santé, IFORD, 15 p.
SEN A. 1998. « Mortality as an Indicator of Success or Failure », in Economic Journal, 108, pp 1-25.
SENE P. I. S. (2004) : Les déterminants sociaux et environnementaux de la morbidité diarrhéique des enfants au Sénégal, Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 122p.
TOLNO D. (1999) : « Mortalité des enfants » in EDS-Guinée,1999, Macro International Inc, USA, 2000, pp153-160.
TOLNO D. (2000): « Mortalité » in Rapport du Recensement Général de la Population et de l?Habitat (RGPH), Rep. Guinée, DNS, 40p.
UNICEF (1986) : La situation des enfants dans le monde. Aubier Montaigne Paris, 184p.
UNICEF (1990) : Les enfants et l?environnement, la situation des enfant dans le Monde. New York, 73p.
UNICEF (1998) : La situation des enfant dans le Monde. New York, NY 10017, 141p.
VALLIN J. (2002) : « Mortalité, sexe et genre » in Déterminants de la mortalité, INED, Paris, France, pp319-350.
VALLIN Jacques (1982): Sex patterns of mortaliy: a comparative study of model life tables and actual situations with special reference to the cases of Ageria and France. In: Lopez A. & al., op.cit,
VAN DER POL H., (1988) : « L'influence du type d'allaitement : le cas de Yaoundé »in Population et Société en Afrique au sud du Sahara, l?Harmattan, Paris, pp325-339.
VAN LOON & VLIETINCK R.F. (1989) «Evaluation de
l?état nutritionnel d?un enfant et d?une communauté» in
Les carences nutritionnelles dans les pays en développement,
3è journées du
GERM, Etudes réunies par D. Lemmonier et
Y. Ingenbleek, Karthala-ACCT, Paris, pp 20-29.
WAGSTAFF A. 2000. « Socio-economic Inequalities in
Child Mortality: Comparaisons across
nine Developing Countries »,
Bulletin of the World Health Organisation, vol. 78, n/1, pp.19-29.
Webographie
http://www.basics.org/programs/basics2/DR%20Congo%20Pict%20Hist/EPI/epi_pdf/Macropl an%202002.PDF.
http://www.canada.gc.ca/main_f.html http://www.ceped.ined.fr/activite/publi/integral/html/dossier/pdf/dossiers_cpd_48.pdf. http://www.unicef.org/french/ffl/09/index.html
http://www-aidelf.ined.fr/colloques/seance6/t_mabika.pdf
www.fao.org/french/newsroom/news/2003 www.fao.org/docrep/008/w0078f
www.wordbank.org/afr/findings/french www.un.org/new/fe-presse/docs
Caractérisation des enfants selon leur état nutritionnel en Guinée
1
******************************************
* *
* B I B L I O T H E Q U E A D D A D *
* *
* MICRO (VERSION 89.1) *
* *
* 17/09/89 *
* 05-10-05 19:32:58 *
******************************************
A D D A D - 89 -
ANALYSE DES CORRESPONDANCES (ANCORR) D'APRES : YAGOLNITZER ET TABET
INS. 1 - TITRE :
TITRE ESSAI ANCORR SUR COUL35 (89);
INS. 2 - PARAM (PARAMETRES GENERAUX) : NI, NJ, NF, NI2, NJ2, LECIJ, STFI, STFJ PARAM NI=2939 NI2=0 NJ=40 NJ2=0 NF=2 LECIJ=1 STFI=0 STFJ=1;
INS. 3 - OPTIONS : IOUT, IMPVP, IMPFI, IMPFJ, NGR
OPTIONS IOUT=0 IMPVP=1 IMPFI=0 IMPFJ=1 NGR=1;
INS. 5 - GRAPHE (NGR DEMANDES DE GRAPHIQUES) : X, Y, GI, GJ, NCHAR, OPT, NPAGE,
CADRE
GRAPHE X=1 Y=2 GI=0 GJ=1;
INS. 6 - LISTE (LECTURE DU TABLEAU DES DONNEES - A, F) :
LISTE IDEN (1,3) RES1L(5,1) RES2(7,1)
ETN1(9,1) ETN2(11,1) ETN3(13,1) ETN4(15,1) REG1(17,1)
|
REG2(19,1) |
REG3(21,1) REG4(23,1) NIV2(33,1) NIV3(35,1) |
REG5(25,1) AGE1(37,1) |
BON(27,1) AGE2(39,1) |
MAUV(29,1) |
NIM2(45,1) NIM3(47,1)
REL1(49,1) REL2(51,1) REL3(53,1) ACT1(55,1) ACT2(57,1)
ACT3(59,1)
SEX1(61,1) SEX2(63,1) RAN1(65,1) RAN2(67,1) RAN3(69,1)
RAN4(71,1)
AGM1(73,1) AGM2(75,1) AGM3(77,1) AGM4(79,1/) AGM5(1,1)
AGM6(3,1);
LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2
NOMJ(J)! RES1 RES2 ETN1 ETN2 ETN3 ETN4 REG1 REG2 REG3 REG4 REG5
PJ(J) ! 9 20 7 8 9 5 7 4 5 9 5 351
LES POIDS DES LIGNES ET DES
COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2
NOMJ(J)! BON MAUV NIV1 NIV2 NIV3 AGE1 AGE2 AGE3 NIM1 NIM2 NIM3
PJ(J) ! 26 3 11 8 8 3 20 7 24 3 2 351
LES POIDS DES LIGNES ET
DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2
NOMJ(J)! REL1 REL2 REL3 ACT1 ACT2 ACT3 SEX1 SEX2 RAN1 RAN2 RAN3
PJ(J) ! 25 3 2 5 9 15 15 14 6 9 7 351

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR NOMJ(J)! RAN4 AGM1 AGM2 AGM3 AGM4 AGM5 AGM6
|
10 |
** -2 |
||||||||||||||
|
PJ(J) ! 7 5 4 |
6 6 4 4 351 |
||||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
TABLEAU DES VALEURS PROPRES |
ET DES VECTEURS PROPRES |
||||||||||||||
|
NUMERO ! VAL PROPRE 1 ! VAL |
PROPRE 2 ! VAL PROPRE 3 |
||||||||||||||
|
! 1.00000 ! |
.28169 ! .20023 |
||||||||||||||
|
OBJET 1! -.16289 ! |
.36268 ! -.17307 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 2! -.23923 ! |
-.24642 ! .11722 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 3! -.13726 ! |
.15682 ! .07248 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 4! -.15546 ! |
.04058 ! .23540 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 5! -.15989 ! |
.00752 ! .05951 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 6! -.11842 ! |
-.24917 ! -.46177 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 7! -.13694 ! |
.01524 ! .18840 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 8! -.10993 ! |
-.06618 ! .24884 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 9! -.12197 ! |
-.05178 ! .17856 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 10! -.15610 ! |
-.20648 ! -.38568 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 11! -.11696 ! |
.37503 ! -.12719 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 12! -.27368 ! |
-.00134 ! -.02572 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 13! -.09415 ! |
.00526 ! .07317 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 14! -.18018 ! |
-.23198 ! .13336 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 15! -.15510 ! |
-.09660 ! -.03070 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 16! -.15537 ! |
.36424 ! -.13022 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 17! -.09262 ! |
.01119 ! -.07221 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 18! -.23623 ! |
.01970 ! -.00310 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 19! -.13922 ! |
-.03996 ! .05223 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 20! -.26187 ! |
-.11767 ! .08831 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 21! -.09169 ! |
.14242 ! -.15742 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 22! -.08236 ! |
.21713 ! -.10732 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 23! -.26479 ! |
.10851 ! .20293 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 24! -.09013 ! |
-.15160 ! -.37461 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 25! -.07320 ! |
-.20349 ! -.27426 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 26! -.12186 ! |
.11640 ! -.01217 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 27! -.16228 ! |
.26415 ! -.07394 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 28! -.20455 ! |
-.28156 ! .07023 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 29! -.20964 ! |
.00462 ! .00897 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 30! -.19954 ! |
-.00421 ! -.01016 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 31! -.12690 ! |
.04780 ! -.11014 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 32! -.16140 ! |
.03574 ! -.02353 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 33! -.14404 ! |
-.01342 ! .04617 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 34! -.14444 ! |
-.06767 ! .07599 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 35! -.11806 ! |
-.04187 ! .04455 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 36! -.10311 ! |
.00070 ! -.01373 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 37! -.13527 ! |
.01997 ! .00189 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 38! -.12667 ! |
.00825 ! -.01878 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 39! -.11312 ! |
.01420 ! .00058 ! |
||||||||||||||
|
OBJET 40! -.10980 ! |
-.00322 ! -.01761 ! |
||||||||||||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
LES VALEURS PROPRES |
VAL(1)= 1.00000 |
||||||||||||||
|
!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! |
CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME |
DES |
VALEURS |
PROPRES |
|||||||||||
|
2 |
! |
.28169 |
! |
11.979! |
11.979!*******!*!***************!***************! |
||||||||||
|
3 |
! |
.20023 |
! |
8.515! |
20.494! |
3.464!*!***************!****** |
|||||||||
|
4 |
! |
.15073 |
! |
6.410! |
26.904! |
2.105!*!***************!* |
|||||||||
|
5 |
! |
.13328 |
! |
5.668! |
32.572! |
.742!*!************** |
|||||||||
|
6 |
! |
.13203 |
! |
5.615! |
38.186! |
.053!*!************** |
|||||||||
|
7 |
! |
.11918 |
! |
5.068! |
43.255! |
.546!*!************* |
|||||||||
|
8 |
! |
.10166 |
! |
4.323! |
47.578! |
.745!*!*********** |
|||||||||
|
9 |
! |
.09047 |
! |
3.847! |
51.425! |
.476!*!********** |
|||||||||
|
10 |
! |
.08907 |
! |
3.788! |
55.213! |
.060!*!********* |
|||||||||
|
11 |
! |
.08701 |
! |
3.700! |
58.913! |
.087!*!********* |
|||||||||

! 12
|
! |
.08569 |
! |
3.644! 62.557! |
.056!*!********* |
|
|
! 13 |
! |
.08310 |
! |
3.534! 66.091! |
.110!*!********* |
|
! 14 |
! |
.08299 |
! |
3.529! 69.620! |
.005!*!********* |
|
! 15 |
! |
.08205 |
! |
3.489! 73.109! |
.040!*!********* |
|
! 16 |
! |
.07994 |
! |
3.400! 76.509! |
.090!*!********* |
|
! 17 |
! |
.07783 |
! |
3.310! 79.818! |
.090!*!******** |
|
! 18 |
! |
.07464 |
! |
3.174! 82.992! |
.136!*!******** |
|
! 19 |
! |
.06401 |
! |
2.722! 85.714! |
.452!*!******* |
|
! 20 |
! |
.05817 |
! |
2.474! 88.188! |
.248!*!****** |
|
! 21 |
! |
.04856 |
! |
2.065! 90.253! |
.409!*!***** |
|
! 22 |
! |
.04684 |
! |
1.992! 92.245! |
.073!*!***** |
|
! 23 |
! |
.04439 |
! |
1.888! 94.133! |
.104!*!***** |
|
! 24 |
! |
.03676 |
! |
1.563! 95.696! |
.325!*!**** |
|
! 25 |
! |
.02821 |
! |
1.199! 96.895! |
.364!*!*** |
|
! 26 |
! |
.02517 |
! |
1.070! 97.966! |
.129!*!*** |
|
! 27 |
! |
.02072 |
! |
.881! 98.847! |
.189!*!** |
|
! 28 |
! |
.01591 |
! |
.677! 99.523! |
.204!*!** |
|
! 29 |
! |
.00615 |
! |
.262! 99.785! |
.415!*!* |
|
! 30 |
! |
.00307 |
! |
.131! 99.916! |
.131!*! |
|
! 31 |
! |
.00112 |
! |
.047! 99.963! |
.083!*! |
|
! 32 |
! |
.00070 |
! |
.030! 99.993! |
.018!*! |
|
! 33 |
! |
.00017 |
! |
.007!100.000! |
.023!*! |
|
! 34 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.007!*! |
|
! 35 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.000!*! |
|
! 36 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.000!*! |
|
! 37 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.000!*! |
|
! 38 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.000!*! |
|
! 39 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.000!*! |
|
! 40 |
! |
.00000 |
! |
.000!100.000! |
.000!*! |
1
! J1 ! QLT POID INR! 1#F COR CTR! 2#F COR CTR!
|
1!RES1! |
750 |
27 |
24! |
1182 |
646 |
132! |
-475 |
105 |
30! |
|||||
|
2!RES2! |
749 |
57 |
11! |
-547 |
645 |
61! |
219 |
104 |
14! |
|||||
|
3!ETN1! |
123 |
19 |
28! |
606 |
107 |
25! |
236 |
16 |
5! |
|||||
|
4!ETN2! |
194 |
24 |
25! |
139 |
8 |
2! |
678 |
186 |
55! |
|||||
|
5!ETN3! |
13 |
26 |
25! |
25 |
0 |
0! |
167 |
12 |
4! |
|||||
|
6!ETN4! |
864 |
14 |
30!-1117 |
251 |
62!-1745 |
613 |
213! |
|||||||
|
7!REG1! |
110 |
19 |
28! |
59 |
1 |
0! |
616 |
109 |
35! |
|||||
|
8!REG2! |
190 |
12 |
30! |
-320 |
17 |
4! |
1013 |
173 |
62! |
|||||
|
9!REG3! |
104 |
15 |
29! |
-225 |
11 |
3! |
655 |
93 |
32! |
|||||
|
10!REG4! |
702 |
24 |
25! |
-702 |
202 |
43!-1106 |
501 |
149! |
||||||
|
11!REG5! |
610 |
14 |
30! |
1702 |
564 |
141! |
-487 |
46 |
16! |
|||||
|
12!BON ! |
15 |
75 |
4! |
-3 |
0 |
0! |
-42 |
15 |
1! |
|||||
|
13!MAUV! |
14 |
9 |
32! |
30 |
0 |
0! |
348 |
14 |
5! |
|||||
|
14!NIV1! |
367 |
32 |
22! |
-683 |
297 |
54! |
331 |
70 |
18! |
|||||
|
15!NIV2! |
47 |
24 |
25! |
-331 |
44 |
9! |
-89 |
3 |
1! |
|||||
|
16!NIV3! |
685 |
24 |
25! |
1244 |
628 |
133! |
-375 |
57 |
17! |
|||||
|
17!AGE1! |
14 |
9 |
32! |
64 |
0 |
0! |
-349 |
14 |
5! |
|||||
|
18!AGE2! |
4 |
56 |
12! |
44 |
4 |
0! |
-6 |
0 |
0! |
|||||
|
19!AGE3! |
15 |
19 |
27! |
-152 |
7 |
2! |
168 |
8 |
3! |
|||||
|
20!NIM1! |
360 |
69 |
6! |
-238 |
257 |
14! |
151 |
103 |
8! |
|||||
|
21!NIM2! |
141 |
8 |
32! |
824 |
76 |
20! |
-768 |
66 |
25! |
|||||
|
22!NIM3! |
201 |
7 |
33! |
1399 |
171 |
47! |
-583 |
30 |
12! |
|||||
|
23!REL1! |
847 |
70 |
6! |
218 |
243 |
12! |
343 |
604 |
41! |
|||||
|
24!REL2! |
456 |
8 |
32! |
-893 |
85 |
23!-1860 |
370 |
140! |
||||||
|
25!REL3! |
341 |
5 |
33!-1475 |
149 |
41!-1677 |
192 |
75! |
|||||||
|
26!ACT1! |
56 |
15 |
29! |
507 |
55 |
14! |
-45 |
0 |
0! |
|||||
|
27!ACT2! |
361 |
26 |
24! |
864 |
342 |
70! |
-204 |
19 |
5! |
|||||
|
28!ACT3! |
557 |
42 |
18! |
-731 |
533 |
79! |
154 |
24 |
5! |
|||||
|
29!SEX1! |
1 |
44 |
17! |
12 |
0 |
0! |
19 |
0 |
0! |
|||||
|
30!SEX2! |
1 |
40 |
19! |
-11 |
0 |
0! |
-23 |
0 |
0! |
|||||
|
31!RAN1! |
45 |
16 |
29! |
200 |
10 |
2! |
-388 |
36 |
12! |
|||||
|
32!RAN2! |
8 |
26 |
25! |
118 |
6 |
1! |
-65 |
2 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
34!RAN4! |
39 |
21 |
27! |
-249 |
20 |
5! |
235 |
18 |
6! |
|||||
|
35!AGM1! |
13 |
14 |
30! |
-188 |
7 |
2! |
169 |
6 |
2! |
|||||
|
36!AGM2! |
1 |
11 |
31! |
4 |
0 |
0! |
-60 |
1 |
0! |
|||||
|
37!AGM3! |
2 18 28! 78 2 0! 6 0 0! |
|||||||||||||
|
38!AGM4! |
1 16 29! 35 0 0! -66 1 0! |
|||||||||||||
|
39!AGM5! |
1 13 30! 67 1 0! 2 0 0! |
|||||||||||||
|
40!AGM6! |
1 12 31! -16 0 0! -72 1 0! |
|||||||||||||
|
! ! |
1000! 1000! 1000! |
|||||||||||||
|
1AXE HORIZONTAL (1) --AXE VERTICAL (2) --TITRE:ESSAI ANCORR |
SUR COUL35 (89) |
|||||||||||||
|
NOMBRE DE POINTS : 40 |
||||||||||||||
|
==ECHELLE : |
4 CARACTERE(S) = .177 1 LIGNE = .074 |
|||||||||||||
|
+ |
REG2----+ |
+ 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
REG3! ETN2 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
REG1 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
NIV1 MAUVREL1 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
RES2RAN4 ! ETN1 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
ACT3 AGE3ETN3 |
! 3 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
+ |
AGE2 |
+ 3 |
01 |
|||||||||||
|
! |
NIV2 BON RAN2 ACT1 |
! 4 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! ACT2 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
AGE1 |
NIV3 ! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! RAN1 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
RES1 REG5! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
NIM3 ! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! NIM2 |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
REG4 ! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
REL3 |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! ETN4 |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! |
! |
! 0 |
01 |
|||||||||||
|
! REL2 ! |
! 0 |
01 |
||||||||||||
|
+ + |
+ 0 |
01 |
||||||||||||
|
NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 10 |
||||||||||||||
NIM1(AGE3) RAN3(ETN3) AGM1(AGE3) SEX1(AGE2) AGM3(AGE2) AGM5(AGE2) SEX2(BON ) AGM2(BON ) AGM4(BON ) AGM6(BON )
1FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCORR
PLACE MEMOIRE DEMANDEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 1840
Population de Référence Internationale OMS/CDC/NCHS Distribution Normale