Troisième partie
L'agriculture périurbaine au risque de la ville ? Le cas
de Diamniadio (Dakar, Sénégal)

Conflits et mutations d'une agriculture sous tutelle
urbaine
La confirmation a été apportée que les
relations entre urbanisation et agriculture ne relèvent pas
d'une coupure simple entre « citadins » et « ruraux
», et entre « ville » et
« campagne ». Cette analyse, trop
réductrice, ne rendrait pas compte de
l'hétérogénéité des intérêts,
et de la capacité des acteurs à jouer sur
différents plans. Le territoire d'étude est
révélateur de césures qui apparaissent lorsque l'on
tente de le décrire. Celles-ci sont dynamiques et autant
révélatrices de contradictions qui se régulent
entre entreprises, collectivités locales, pouvoirs coutumiers et
agriculteurs, grâce à de nouvelles règles du jeu
qui ont pour arrière plan la marchandisation des
ressources. Car même si elle se mondialise et
se libéralise, l'économie ne peut
être indifférente aux ancrages locaux et doit
forcément s'appuyer sur eux pour s'implanter. La problématique de
l'eau, la pression foncière et la quête d'un emploi seront les
entrées d'une grille d'analyse révélatrice de
compétitions et de coopérations entre acteurs d'un même
endroit et nouveaux venus, tout en étant porteuse d'une nouvelle
urbanité.
1 Accès à l'eau : une
compétition exacerbée face à un épuisement de la
ressource
L'un des champs majeurs de confrontation entre l'urbanisation
et son environnement rural est celui de l'usage de l'eau. L'agriculture
irriguée consomme la majeure partie de l'eau disponible, grâce
à des forages profonds dans la nappe souterraine, mais la croissance de
la population dakaroise s'accompagne également d'une augmentation de la
demande par tête. La nappe phréatique est donc
surexploitée alors même que la région a connu des
années de sécheresse successives. Dans les communes de
Diamniadio et Sébikhotane, « tout le monde » veut faire du
maraîchage et planter des manguiers, mais la baisse de la nappe exclut
les petits exploitants dont les puits sont asséchés. Ceux
qui n'abandonnent pas leur exploitation recourent à des quotas d'eau
auprès de la Sénégalaise Des Eaux (SDE), car c'est
désormais le
système marchand qui joue le rôle d'arbitre entre
usages concurrents de la ressource.
A) Des problèmes de compétition pour une
ressource de plus en plus rare
La succession d'années sèches que le pays a
connu au cours de la période écoulée a
entraîné un abaissement progressif de la nappe
phréatique. Cet abaissement est lié non seulement à
la faible recharge, mais aussi à la surexploitation des nappes qui
subissent des prélèvements intensifs pour satisfaire la
forte demande en eau de la ville de Dakar. Actuellement, les
prélèvements effectués dépassent la capacité
de la nappe du paléocène de Sébikotane. En effet, celle-ci
s'est abaissée de 15 mètres depuis la fin des années 70.
Une telle situation entraîne des risques importants de tarissement. La
Sénégalaise des eaux dispose de
5 forages dans la commune et d'un équipement de
pressurisation qui prend part dans l'approvisionnement de la ville de Dakar
et contribuent à l'assèchement de la ressource.
S'agissant des techniques d'exhaure et d'irrigation, il faut
noter que l'exploitation des puis traditionnels n'est plus possible sur la
commune de Sébikhotane, suite à l'abaissement de
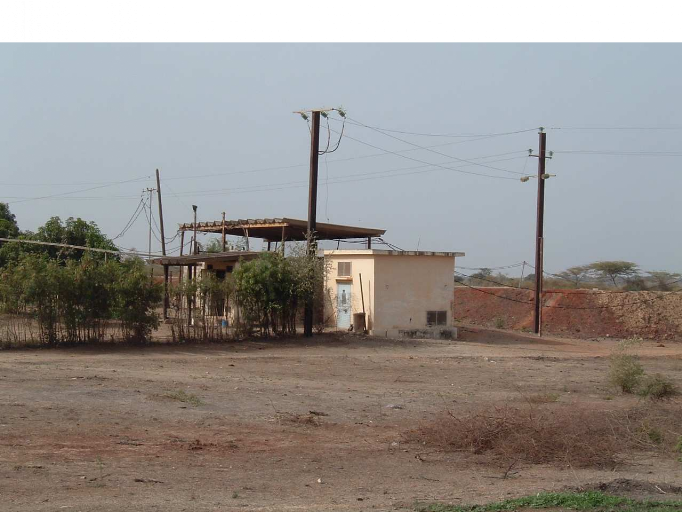
la nappe phréatique ces dernières années.

Photo 11-Forage privé d'une entreprise
agricole Photo 12-Un puit traditionnel rendu
inutilisable par la course à la profondeur : le
propriétaire de la parcelle a abandonné
l'arboriculture par manque d'eau.
Celle-ci est attribuée aux 10 forages, dont 5
privés qui permettent une exhaure de l'eau
en profondeur et rendent inutiles les puits traditionnels. Au
niveau de l'arboriculture, la zone était très productive
auparavant avec les mangues, les papayes, les mandarines, les
pamplemousses. Mais la baisse de la nappe phréatique durant ces deux
dernières décennies à causé la perte de plus des
2/3 des manguiers et 3 /4 des mandariniers, surtout chez les petits
producteurs. Le lac de barrage de Séby-Ponty constitue une
réserve d'eau intéressante pour les
exploitations familiales alentours, mais le manque de pompes rend
l'irrigation difficile.


Photo13-Départ pour la borne
fontaine
payante le long de la N1: des quartiers de
Diamniadio ne sont pas encore équipés
Photo 14-Une retenue colinéaire peu
mise
en valeur. Le manque de pompe a été
invoqué par les enquêtés
| 


