Le conseil de sécurité et les questions
africaines de 1990 à nos jours
NOURDINE MED MOEVA
B.P: 1826 MORONI - COMORES
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES
- MEKNES
(MAROC)
Travail effectué sous l'encadrement de Monsieur le
professeur Younes BERRADA.
ANNEE UNIVERSITAIRE 2003/2004
Liste des Abréviations
Res.............................
Résolution
Pel.............................. Personnel
Civ...................... ....... Civile
P................................. Page
VOL........................... Volume
U.N.I.S.A..................... Initiative
Spéciale du Système des Nations Unies pour
le développent de l'Afrique
P.U.F............. ............. Presse Universitaire
Française O.U.A..........................
Organisations de l'Unité Africaine
U.A..................... ...... Union Africaine
E.C.O.M.O.G................ Ecowas Monitoring
Group (Groupe d'Observateurs Militaire de
la CEDEAO)
C.E.D.E.A.O................. Communauté
Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest
A.P.D.......................... Aide Publique
au Développement
B.E.R.D....................... Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement
B.M........................... Banque
Mondiale
C.N.U.C.E.D ... ............ Conférence
des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement
S.D.N.......................... Société des
Nations O.M.P......................... Opérations de
Maintien de la Paix O.N.U.................. .......
Organisation des Nations Unies
N.E.P.A.D..................... Nouveau
Partenariat pour la Paix et le développement de l'Afrique
F.U.N.U....................... Force d'Urgence
des Nations Unies F.P.I............................ Front
Populaire Ivoirien P.D.C.I........................ Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire
P.I.T........................... Parti Ivoirien des
Travailleurs
R.D.R ......................... Rassemblement
Des Républicains
M.P.C.I ....................... Mouvement
Patriotique de la Côte d'Ivoire
M.P.I.G.O.................... Mouvement Populaire Ivoirien
du Grand Ouest C.E.I...........................
Communauté des Etats Indépendants
O.T.A.N...................... Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord C.A.E.M...................... Conseil
d'Aide Economique Mutuelle U.N.I.T.A.....................
Union Nationale pour l'Indépendance Totale en
Angola
O.N.U.C.I......................
Opérations des Nations Unies en Côte d'Ivoire
M.P.L.A ...................... Mouvement
Populaire de Libération de l'Angola
G.A.T.T.......................
Général Agrément on Tarif and Traid. (Accord
Général sur les
Tarifs Douanières et le Commerce.)
O.M.C........................ Organisation Mondiale du
Commerce P.A.M......................... Programme
Alimentaire Mondial
TABLE DES MATIERES :
INTRODUCTION GENERALE..................................
4
CHAPITRE PRELIMINAIRE : CADRE CONCEPTUEL DU SUJET......... 9
Section I : L'OSSATURE DU SYSTEME
ONUSIEN......................... 11
Section II : LE CONTENU DU MAINTIEN DE LA
PAIX..................... 16
CHAPITRE I : CHAMP D'ACTION DU CONSEIL DE
SECURITE
|
EN
AFRIQUE..................................................
|
23
|
|
Section I :
|
CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX EN
AFRIQUE.............
|
25
|
|
A :
|
Particularités des conflits africains dans les
années 90..
|
26
|
|
B :
|
Le conseil de sécurité face aux conflits
africains........
|
30
|
Section II : LES COROLLAIRES DU MAINTIEN DE LA
PAIX EN AFRIQUE 34
|
A :
|
Le cadre sécuritaire et le plan
humanitaire................
|
35
|
|
B :
|
Le développement socioéconomique dans les pays
|
|
|
victimes des
conflits..........................................
|
39
|
CHAPITRE II:LE CONSEIL DE SECURITE ENTRE SAISINE ET
AUTO-SAISINE
DES QUESTIONS AFRICAINES...............................
44
Section I : CONTEXTE ET SCENARIO GENERAL DES
CONFLITS
|
AFRICAINS.....................................................
|
45
|
|
A :
|
Dilemme du conseil et issue des conflits
................
|
49
|
|
B :
|
Le conseil et le système complémentaire
...............
|
54
|
Section II: LES MISSIONS ONUSIENNES EN
AFRIQUE.................. 60
|
A :
|
Les missions dans le cadre du maintien de la
paix......
|
63
|
|
B :
|
Le développement africain dans la
déclaration du
|
|
millénaire, vu du Conseil de
sécurité..................... 79
CONCLUSION...................................................................
87
BIBLIOGRAPHIE
...................................................................
90
WEBOGRAPHIE......................................................................
93
LOGICIELS
REFERENTIELS...............................................................
94
(Lors de la mise en forme de ce texte pour la publication, la
pagination n'a pas été respecté : Veuillez faire attention
aux revois vers d'autres pages.)
Introduction générale
Selon la grille de lecture de l'analyse systémique, «
l'Afrique pourrait être considérée
comme un sous système du système
international»1; or depuis la fin des années
80, la communauté internationale a vu naître et s'enliser sur
cette partie du monde, un éventail de problèmes dont leur
vaste majorité tournent autour des conflits armés.
Cependant, l'importance de ces problèmes africains à partir
des années 90, ne se résume pas à
l'existence des conflits seulement, car bien avant
l'Afrique a connu un bon nombre de conflits.
En effet, dans les années post 1990, à l'instar
du conflit congolais des années 60 et du conflit angolais des
années 70 et 80,2 l'Afrique n'était pas
épargnée de ce fléau. Mais contrairement aux
conflits africains contemporains, la majeur partie de ces derniers
étaient
des conflits qui mettaient en opposition deux sinon plusieurs
Etats. Cependant, tout au long
des années 80 qui ont d'ailleurs été
qualifiées de décennie perdue pour le développement de
l'Afrique, la situation s'est aggravée. C'est ce qui a conduit au
relance du dialogue et des négociations entre pays
développés et ces pays en développement au milieu de ces
années. D'autant plus que les formidables changements qui se sont
produits dans le monde à la fin de
ces années 80, ont obligé à
réévaluer la coopération et le traitement
multilatéral des problèmes3. Ceci dit, certes, la fin
de ces années est marquée essentiellement sur le plan de
la politique internationale par la recomposition du
système international suite à la fin de la guerre froide, mais
plus consistants sont les répercutions qu'a eu ces
événements sur les Etats africains.
Dés lors longtemps convoités par les deux
superpuissances, la fin de la guerre froide a laissé
déboussolés nombre d'Etats africains4, qui
jusqu'à là n'existaient sur la scène internationale,
que sous le parrainage respectif de l'un de ces derniers sinon par la voie du
mouvement de non-alignement qui de nos jours n'a qu'un intérêt
purement historique5.
C'est dans ce contexte que dés le début
des années 90, l'on se trouve partout à quelques variantes
près, dans une situation où l'Etat africain est désormais
dans l'incapacité d'effectuer les arbitrages nécessaires et de
définir les compromis sociaux indispensables non seulement à tout
passage à l'économie de marché, mais aussi à la
production même de l'ordre public6. De cela s'ajoute le
fait que comme l'a souligné KODJO EDEMEDEM, et qui
1 Zartman, Africa as a subordinate state system in
international relation, in international organization, 1967, p 545-564.
2 Voir aussi à ce propos: GRESH ALAIN,
l'Afrique australe, une "sphère de conflits", Le monde diplomatique,
Février 1988
3 CNUCED, Au service de la croissance et du
développement, 30 ans et au-delà (1964-1994), P 6,
UNCTAD/EDM/ERCP/8, Nations Unies 1994
4 Dans ces plans de développement
économique et social pour 1986-1990 et jusqu'à l'an 2000,
l'union soviétique avait
ouvertement notifié une vaste programme prometteur pour
l'Afrique ainsi que l'ensemble des pays en développements.
5 Igor Oussatchev, Du décret sur la paix, Vers
un monde sans guerres et sans armes, P 43 et 44, Editions de l'agence de presse
Novosti, Moscou 1987.
6Voir Achile Mbmbe, Déconfiture de l'Etat et
risques de la "transition démocratique", Le Monde diplomatique, mai
1993. Voir aussi du même auteur, Afrique indocile, Karthala, Paris
1988.
justifie aisément ce cas présent, « le
continent africain, après deux décennies d'indépendance,
et malgré les différentes stratégies de
développement élaborées pour la décennie qui
vient de s'achever, n'a pas encore réussi son décollage
économique et industriel malgré les progrès
accomplis, il demeure par excellence le continent du sous-
développement» 7.
C'est dans ce sens aussi qu'une étude intitulée
Ecology and Politics: Environmental
stress and security in Africa, a établie que
«l'appauvrissement des ressources naturelles est étroitement
lié à l'insécurité des personnes, des groupes ou
des Etats8». A partir de là, on peut se poser la
question suivante: Quelle est la part de la communauté internationale
face à
cet amer constat en Afrique ? . Autrement dit, sur le plan
institutionnel international, quel est
le rôle de l'organisation des Nations Unies face
cela ? . Cependant, la réponse ne fut pas longue à
attendre car l'organisation des Nations Unies lança «le nouvel
ordre du jour pour le développement de l'Afrique», tout au
début des années 19909. Ceci dit, comme l'a
souligné Bertrand Schneider, «La communauté
internationale tout entière est concernée par le
progrès de l'Afrique car le monde a besoin de l'Afrique comme
l'Afrique a besoin du monde10».
Ainsi, pour donner suite à cette initiative, un
plan d'Action révisé à l'échelon du
système des Nations Unies pour le redressement économique de
l'Afrique a été adopté par
les Nations Unies en 1994. Ceci comportait des mesures
adéquates en vue de coordonner les programmes d'activité, et
d'éviter les chevauchements en créant les synergies souhaitables
pour ce continent. Par la suite, ce plan d'action a été
remplacé en 1996 par l'Initiative Spéciale des Nations
Unies pour l'Afrique11. Bien plus, et parallèlement
à cela on retrouve d'autres initiatives tel le Nouveau Partenariat
pour la Paix et le développement (NEPAD)12, dont
l'accent est mis sur le concept de la «bonne gouvernance»
pour les pays africains13.
Cependant, toutes ces initiatives qui sont mises en oeuvre selon
des rythmes et dans
des conditions très variables selon les pays ou
groupes de pays et selon les programmes considérés, ont
toujours fait l'objet d'efforts importants de la part du système des
Nations Unies en vue d'en assurer une coordination satisfaisante. D'autant plus
qu'au niveau global
et faisant suite à la résolution 1998/46 du Conseil
Economique et Social, la première réunion
annuelle de coordination régionale du système des
Nations Unies en Afrique qui s'est tenue
à Nairobi en mars 1999 sous la Présidence
de la Secrétaire générale adjointe des Nations
Unies14, a décidé que l'Initiative
spéciale des Nations Unies en Afrique constituait un cadre
7KODJO EDEMEDEM (Ancien secrétaire
général de l'O.U.A), Le retard de l'Afrique peut être
rattrapé, Le Monde diplomatique, Février 1980.
8ROBERT-ALIROBERT-ALI BRAC DE LA PERRIÈRE,
(oeuvre(s): COLLECTIF), Scandinavian Instituta of African Studios,
1989.
9 Adopté par l'Assemblée
générale le 18 décembre 1991 : Voir à ce propos :
Documents officiels de l'Assemblée générale,
47éme
session, Supplément n 6 (A/47/6/Rev.1), vol. I, programme
45, Distr. GENERALE A/RES/49/142 le 01 février 1995. de même que
le Rapport de B.B Ghali, Pour la paix et le développement, DPI/1537,
Nations Unies, octobre 1994 :
www.un.org
10Bertrand Schneider, l'Afrique face à ses
priorités, P 10, économica, 1987.
11U.N.S.I.A
12Le texte du NEPAD est publié dans son
intégralité sur le site Web :
http://www.gov.za/issues/nepad.htm>.
13Voir à ce propos: Ecofinance N ° 37,
novembre 2003 : ou aussi l'Extrait de la transcription de la conférence
de presse du secrétaire d'État adjoint (Américain M.
Kansteiner) aux affaires africaines :
http://usinfo.state.gov/francais
, 19 septembre 2002
14 Document Coordination and Collaboration among UN
agencies at the regional and subregional levels in Africa
adéquat pour la coordination des activités du
système des Nations Unies en Afrique et qu'il convenait de simplifier
les procédures de coordination actuelles. De même lors de sa
session
en date de juillet 1999 (Genève), le conseil a
procédé à l'examen des suites données aux
recommandations contenues dans le Rapport du Secrétaire
général des Nations Unies sur
«les causes des conflits et la promotion d'une
paix et d'un développement durable en
Afrique15». A cet égard l'importance
accordée à la question de la coordination a
été particulièrement soulignée puisque le
rapport qui a été discuté comportait ces deux
initiatives qu'on vient de mentionner concernant l'Afrique"16.
Par conséquent force est de reconnaître
qu'à l'époque contemporaine il n'y a guère de
problème qui n'ait pas d'une façon ou d'une autre une dimension
internationale. Cependant, il est apparu que dans ce «continent soumis
à de multiples menaces [...], seule la paix interne et externe peuvent
permettre d'affronter le redoutable défi que constitue [...],
l'épanouissement des populations chaque jour plus nombreux et le retard
qui s'accroît par rapport au reste du monde 17».
Mais la paix en Afrique en particulier depuis les années 90,
est devenu un problème assez épineux et ceux
à cause du caractère interne que revêt la
majorité des conflits sur ce continent.
Ceci dit l'abandon du continent de la moindre valeur
stratégique après la fin de la guerre froide a
coûté très cher en vies humaines africaines et en
«sécurité globale», car s'il
est vrai que le terrorisme fleurit dans le chaos plus encore que
sur la pauvreté, les conflits africains dits
déstructurés, n'échappent pas à ce constat. Parlant
d'elle mêmes, ces derniers
ont en effet coûté la vie à plus de 3
millions de civils au Congo-Kinshasa, à plus de 300 000 personnes au
Burundi, 200 000 en Sierra Leone, et autant au Liberia, sans
négliger la situation actuelle en Côte d'Ivoire, de la Casamance,
du Nord de l'Ouganda, de la Somalie,
ou aussi de la longue guerre civile en Angola qui comptabilise au
moins 500 000 morts,
n'en parlons plus du conflit qui perdure entre le nord et le sud
du Soudan où l'on parle à nos jours de pas moins de 2 millions de
morts18.
En tant qu'organe principal chargé du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales, le conseil de sécurité des nations unie
ne peut s'y déroger. Cependant sa tâche parait un peu plus
délicat qu'auparavant et ceux pour deux raisons:
D'une part, face à ces conflits qui en grande partie
sont des conflits internes, le champ d'action du conseil de
sécurité tel qu'il est déterminé par la
charte, ne lui permet pas d'intervenir dans ces derniers tant qu'ils ne
présentent pas des signes expansionnistes sinon catastrophiques de
manière à menacer la paix et la sécurité
internationales.
D'autre par, il est apparut que même s'il intervient,
aussi efficace que soit son action, face aux catastrophes humanitaires qui sont
devenus monnaie courante dans ces conflits, le constat historique de nos jours,
nous renvoi à l'anecdote du médecin après la mort .
15 Rapport du S G de l'O.N.U, Causes des conflits en
Afrique, Section de la technologie de l'information du
Département de l'information Nations Unies 1998.
www.onu.fr : voir aussi : Basic Facts
About the United Nations, P 68, DPI/2155, United nations, April 2001.
16 Voir à ces propos : Coordination de
l'action du système des Nations Unies en Afrique, sur le site web des
Nations Unies :
www.unsia.org
17 Ibid. Bertrand Schneider, l'Afrique face à
ses priorités, P 11.
18 Stephen Smith, La seconde "pacification" de
l'Afrique, Le Monde 24juin 2003.
http://www.lemonde.fr
Toutefois, ceci n'est toujours pas aussi caduc qu'on pourrait le
croire car dans bien des
cas les résultats ont été assez
remarquables, comme nous le verrons un peu plus loin. Mais, étant
donné que le mandat du conseil de sécurité se limite
principalement au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, notre travail ne peut que porter sur les conflits
armés africains qui pourraient d'une façon ou d'une
autre menacer la paix et la sécurité internationales.
Cependant, on ne peut prétendre ainsi, avoir fait le tour du sujet et
ceux aussi
pour deux raisons.
Primo, comme l'a fait remarquer Boutros. B Ghali : «
dans ce nouveau contexte international, la paix et la
sécurité implique bien d'avantage que des questions de
territoires
et d'armements, mais aussi des questions d'ordre
économique et sociale sont à prendre en compte à plus
fortes raisons19». De plus ce caractère
interne que revêt la majorité des conflits africains pose
le problème du fondement des interventions du conseil de
sécurité dans ce genre de conflits. D'où la
nécessité de déterminer de prime abord : Quel est
le fondement et l'étendue de la compétence du conseil de
sécurité dans ce cas précis des questions africaines
?. Autrement dit, c'est le problème du champ d'action du
conseil de sécurité en Afrique que nous allons essayer de
traiter dans un premier chapitre.
Secondo: continuant dans ce même ordre d'idées,
il est à prendre en considération la réalité de
ces conflits déstructurés et à reprendre d'une
façon récapitulative les actions sinon les réactions du
conseil de sécurité et les issues respectives de ces conflits.
C'est ainsi qu'une question s'impose portant sur la relation entre l'action
sinon la réaction du conseil de sécurité et l'issue d'un
conflit ? C'est ce qui ferra l'objet de notre deuxième chapitre sous
l'intitulé du conseil de sécurité entre saisine et
auto-saisine des questions africaines.
Ce faisant, cette approche laisse subsister quelques zones
d'ombres émanant des termes mêmes qui constituent
l'intitulé de ce travail; ce qui ne peut être compréhensif
que
par l'éclaircissement au préalable des ces
derniers. C'est pourquoi, il s'impose de nous poser
ces quelques questions: Que ce que le conseil de
sécurité ? Quelle est sa place sinon sa consistance au
sein du système onusien? En quoi est il concerné par les
questions africaines ? .
Cette première série de questions vise surtout par
leurs réponses, à nous permettre de dégager en premier
lieu l'importance sinon la consistance que porte tel ou tel problème
une
fois saisi par le conseil de
sécurité, mais aussi à mettre en avant le
rôle et la compétence de
cet organe au sein du système onusien, qui se
résume grosso modo au maintien de la paix et
à la sécurité internationales.
C'est de là que vient notre deuxième série
de questions qui s'articule autour de cette compétence du conseil de
sécurité et portant sur le sens du maintien de la paix ainsi que
son contenu tout particulièrement
en Afrique à partir de cette dernière
décennie. Aussi, convient-il d'introduire par un chapitre
préliminaire tendant à jeter la lumière sur le cadre
conceptuel lié au sujet.
19 Rapport de l'ex-secrétaire
général de l'O.N.U, Boutros.B. Ghali, pour la paix et le
développement DPI/1537, Nations Unies, septembre 1994.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CADRE CONCEPTUEL DU SUJET
Guy Lagelée et Gilles Manceron écrivaient
qu'«il aura fallu les horreurs du nazisme
et des autres régimes fascistes et dictatoriaux dans
les années 1941-1945, pour que naisse la conviction que les droits de
l'homme doivent être sauvegardés sur le plan international
pour
que le monde ne soit pas menacé d'un nouveau
conflit»20. Toutefois, il convient de souligner
que la communauté internationale ou le système
international peut être appréhendé comme étant
l'ensemble des acteurs qui ont un certain rôle sur la scène
internationale21. Ce faisant, l'étude de ce système
nous indique que parmi ces acteurs qui sont d'ailleurs assez
diversifiés, l'organisation des Nations Unies occupe une place
incontournable due à son universalité mais surtout à
sa vocation globale qui l'ont érigé au rang de
«système des Nations Unies»22.
Mise sur pied en 1945 par la Conférence de San
Francisco à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l'Organisation
s'est fixée pour objectif de maintenir la paix et la
sécurité internationales, cultiver l'amitié entre les
nations, encourager le progrès social, favoriser
l'élévation du niveau de vie et les droits de l'homme.
Tout au long des décennies depuis sa création, le
système onusien a su aider à mettre
fin à de nombreux conflits de même qu'à
surmonter moult crises internationales notamment
par le biais de son organe phare qui est le conseil
de sécurité, dont sa tâche principale s'articule
autour du maintien de la paix et la sécurité
internationales. Dés lors face à la menace de guerre
nucléaire et des conflits régionaux apparemment
interminables, le maintien de la paix est devenu l'une des principales
préoccupations de l'organisation. Cependant, l'organisation est
beaucoup plus qu'un mécanisme de maintien de la paix et une instance de
règlement des conflits. D'autant plus qu'on retrouve au même titre
qu'elle, des institutions qui lui sont reliées menant à bien des
tâches extrêmement diverses qui touchent tous les aspects de la
vie quotidienne dans le monde entier et tout particulièrement
en
Afrique23.
Mais, étant donné que nous avons pu
apercevoir en introduction générale ainsi qu'au tout
début ce chapitre le pourquoi des ces questions africaines à
partir des années 90, il reste du moins quelques interrogations qui
s'imposent et qui peuvent s'articuler ainsi:
20Guy Lagelée et Gilles Manceron,
Conquête mondiale des droits de l'homme, éditions cherche midi
et
UNESCO, 1998
21 Professeur Younes Berrada, théorie des
organisations internationales ( Cours polycopié pour
la section R.I - UF4, P 1, faculté des sciences
juridiques économiques et sociales de Meknés, année
universitaire 2003-2004
22Jean François Muracciole, L'O.N.U depuis
1945, Ellipses.
23Voir à ces propos: VIRALLY, Michel,
L'O.N.U. d'hier à demain, Paris, Edition du Seuil,1961; GERBET, Pierre,
GHEBALI, Victor-Yves, et MOUTON, Marie-Renée, Société des
Nations et Organisation des Nations Unies, Paris, Edition Richelieu, 1973:
L'équipe de AJC, O.N.U. carrefour des Nations, Lévis,
Secrétariat du collège de Lévis, 1972 : G.KATZIN, Alfred,
L'O.N.U. pour tous, France, Nations Unies, 1960: COMPTON'S NEWMEDIA,
INC. , Compton's interactive encyclopedia, Cambridge, Compton's home
library, 1997 : LIRIS INTERACTIVE, Larousse Multimédia
Encyclopédique, Paris, Larousse, 1996.
Qu'est ce que le conseil de sécurité ? Quelle
consistance peut avoir une question pour qu'elle se retrouve soumise
à ce dernier ? , Ou encore quel est son domaine de
compétence?
Ainsi, il s'impose donc de jeter les éclairages sur
l'organisation de Nations Unies, afin
de mettre en évidence l'importance de ce conseil de
sécurité [SECTION I], mais aussi cette démarche
nous amènera nécessairement à voir la notion et le contenu
du maintien de la paix
et de la sécurité internationales [SECTION
II], qui constituent la principale tâche de ce
dernier.
SECTION I : L'OSSATURE DU SYSTEME ONUSIEN
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'Afrique
n'existait pas en tant qu'entité signifiante sur la scène
politique et économique mondiales, et les nouvelles institutions
qui venaient d'être crées O.N.U, B.M, FMI, ne se
préoccupaient guère de l'environnement international pour la
paix et le développement socio-économique de ce continent.
Mais la reconnaissance croissante de l'interdépendance économique
des Etats et l'intensification du débat sur la paix et le
développement socio-économique, et à mesure que
les pays d'Afrique accédaient à
l'indépendance dans les années 50 et 60, ont conduit au
lancement de la décennie des Nations Unies pour la paix et le
développement24.
Crée en 1945 pour pendre la relève de la
SDN installée à Genève depuis 1919, l'organisation
de Nations Unies qui a une vocation universelle et globale
est une conséquence directe de la deuxième guerre
mondiale25. Enumérant les buts de l'organisation, l'article
premier de la charte des Nations Unies évoque la
réalisation de la coopération internationale en relevant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel, et humanitaire; le développement des relations
amicales entre les nations, et surtout le maintien de la paix et de la
sécurité internationales26. Son article 2 indique que
les principes de l'organisation dans la poursuite des buts qu'elle s'est
fixée sont entre autres : le principe de l'égalité
souveraine de tous les membres de l'organisation et le
règlement pacifique des différends27.
Cependant à coté de ces buts et principes
énoncés par le chapitre premier de cette charte, l'ossature
politico-juridique du système onusien apparaît essentiellement au
chapitre
III de la charte. En effet, l'article 7 dispose qui'«il
est crée comme organes principaux de
l'organisation des Nations Unies: une assemblée
générale, un conseil de sécurité, un conseil
économique et social, un conseil de tutelle, une cour
internationale de justice et un secrétariat. Les organes
subsidiaires qui se relèveraient nécessaires pourront
être crées conformément à la présente
charte28». Autrement dit l'ensemble de ce
système onusien repose sur l'action de ces six organes dits principaux,
ainsi que sur cette possibilité de créer
24 Ibid. CNUCED, 30 ans et au-delà
(1964-1994), P 4.
25 Le statut de la cour internationale de
justice25, fait partie intégrante de la charte des Nations
Unies.
26 paragraphe1, 2 et 3, article 1 de la Charte des
Nations Unies et statut de la cour internationale de justice, p 5, DPI/511,
Nations
Unies-New York réimpression de juin 1998.
27 Charte des Nations Unies et statut de la cour
internationale de justice, p 6 et 7, DPI/511, Réimpression de juin
1998
28 Ibid. p 10
aux besoins des organes subsidiaires. Et cette
possibilité se matérialise, en premier lieu à
l'article 22 qui dispose que «l'assemblée
générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle
juge nécessaire à l'exercice de ses
fonctions29». Et par la suite l'article 29 dispose
que «le conseil de sécurité peut
créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire
à l'exercice de ses fonctions»30.
Voir schéma ci-après :
29 L'assemblée générale
comptabilise à nos jours plus de 150 organes subsidiaires
crées. Quant au conseil de sécurité, il comptabilise
pas moins de sept organes subsidiaires et dans l'ensemble on peut
relever que depuis sa création à nos jours, l'O.N.U a
crée environ 250 organes subsidiaires tous organes confondus : Voir
à ce propos : Mme Wafae Makoudi, cours de relation internationale, p
106, faculté des sciences juridiques économiques et sociales de
Meknés, 1999-2000
30 Ibid. charte des Nations Unies, p 23.
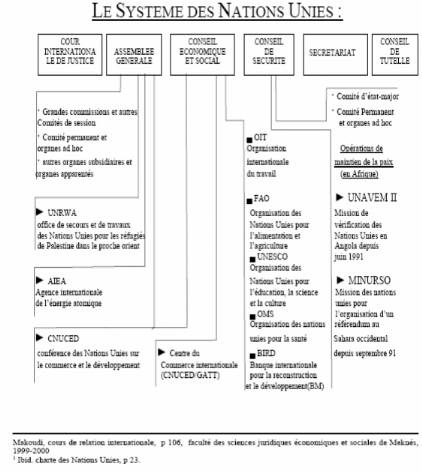
|
? NUEH
Centre des Nations
Unies pour les établissements humains
(Habitat)
? FISE
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
? FNUAP
Fonds des Nations Unies pour la
Population
? HCR
Haut Commissariat pour les
réfugiés
? INSTRAW
Institut international de recherche et de
Formation pour le promotion de la Femme
? PNUCID
programme des Nations Unies pour
contrôle international des drogues
? PNUD
programme des Nations Unies pour
développement
? PNUE
programme des Nations Unies pour
l'environnement
? UNITAR
Institut des Nations Unies pour la
Formation et la recherche
? UNU
Université des Nations Unies
? WFC
Conseil Mondial de l'Alimentation
? UNIFEM
fonds de développement
des nations unies pour la femme
|
? PAM
Programme alimentaire mondial
· COMMISSIONS
TECHNIQUES
- Commission de la condition de la femme
- Commission
de la population
- Commission de la science et de la technique
au service du développement
-Commission de
Statistiques
-Commission des droits de l'homme
-Commission des stupéfiants
-Commission du développement durable
-Commission du développement sociale
-Commission pour
la prévention du crime et de la
justice
. Commissions régionales
-Commission économique
Pour l'Afrique (CEA)
-Commission économique pour l'Amérique
latine et les caraïbes (CEPALC)
-Commission économique
Pour l'Europe (CEE)
-Commission économique et
Sociale pour l'Asie et
Le pacifique (CESPA)
-Commission économique et Sociale pour l'Asie
occidentale (CESAO)
. COMITES DES SESSION ET
COMITES PERMANENTS
· ORGANES D'EXPERTS,
ORGANES AD HOC ET
ORGANES APPARENTES
|
_ IDA
Association
Internationale
De développement
_ SFI
Société financière
Internationale
_ AMGI Agence
Multilatérale des investissements
_ FMI
Fonds monétaire internationale
_ UPU
Union postale universelle
_ UIT Union
internationale des
télécommunications
_ OMM Organisation maritime
internationale
_ OMPI organisation mondiale de la
propriété intellectuelle
_ FIDA Fonds
internationales de développement
agricoles
_ ONUDI
Organisation des nation unies pour le
développement industrielle
_ GATT Accords général sur les tarifs
douaniers et le commerce.
|
? ONUSOM
Opération des
Nations Unies
en Somalie (Avril
1991)
? ONUMOZ Opération des nations unies
au
Mozambique
Depuis décembre
1992
? MONUOR
Mission d'observation des nations unies Ouganda- Rwanda
depuis juin 1993
? MONUL
Mission d'observation des Nations unies au Liberia depuis
septembre 1993
|
|
|
|
|
Légendes :
? Programmes et Organisations des Nations
Unies
(liste indicative)
_ Institutions spécialisées et autres
organisations
autonomes faisant partie du système
· Autres commissions, comités et organes
ad
|
Ainsi, Il s'impose de mettre l'accent sur l'organe qui est le
conseil de sécurité dans la
mesure où il constitue l'un des clefs de ce sujet, mais
surtout étant donné qu'il constitue le cadre principal
d'affermissement de la paix et la sécurité
internationales31. D'autant plus qu'il apparaît une
importance toute particulière de cet organe tant par sa composition que
sur
ses compétences.
31 voir à ce propos l'article 12 et 24 de la
charte des Nations Unies
Concernant sa composition, en dehors de la cour
internationale de justice qui ne connaît qu'une participation de
«juge ad hoc», à l'instar de l'assemblée
générale qui est un organe plénier, en dépit
des cinquante membres qui composent le conseil économique et
social, se passant du conseil de tutelle qui de nos jours n'existe que dans la
charte et non par
son utilité32, ou aussi du
secrétariat général de l'organisation qui n'a en
principe qu'une
fonction purement administrative sinon de coordination;
fort de ces quinze membres, le conseil de sécurité incarne
la clef de voûte de l'organisation des Nations Unies. A ce propos
il est significatif de noter que l'article 23 de la charte
dispose dans son premier paragraphe
que «Le Conseil de sécurité se
compose de quinze Membres de l'Organisation », dont la
République de Chine, la France, l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique, constituent les
«membres permanents de ce dernier33». Les
«Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à
titre de membres non permanents, par l'Assemblée générale
qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des
Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la
sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation,
mais aussi d'une répartition géographique
équitable34».
Ceci dit, d'un coté la désignation explicite de ces
cinq membres qui ne sont autres que
les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale,
et de l'autre les mesures restrictives qui s'accompagnent de la
désignation en tant que membres non permanents, et qui s'articulent
aussi, d'un coté autour des buts principaux qui est le
maintien de la paix et la sécurité internationales et aux
autres fins de l'Organisation; et de l'autre sur la
considération
«équitable» d'ordre géographique
quant à l'élection de ces derniers au conseil de
sécurité, traduisent l'importance de cet organe.
En ce qui est de sa compétence, ce même
paragraphe nous interpelle quant à faire la liaison avec les
dispositions de l'article 24 de la charte qui dispose expressément
qu'«Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses
Membres confèrent au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales
et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui
impose cette responsabilité, le Conseil
de sécurité agit en leur
nom35». De surcroît, l'article 25 vient corroborer
cela en disposant explicitement que: «Les Membres de
l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer
les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte».
Ce faisant, la genèse de cette importance ne peut
s'apprécier dans son vaste étendue qu'à la lumière
du contenu tant juridique que pratique de ce concept qui est le maintien de la
paix et la sécurité internationales.
32 Avec l'indépendance des Palaos, dernier
territoire sous tutelle des Nations Unies, le Conseil de tutelle a
officiellement suspendu
ses activités le 1er novembre 1994. Il a
depuis modifié son règlement intérieur et ainsi mit fin
à l'obligation qui lui était faite de se
réunir annuellement: Source: La composition des
organes principaux de l'organisation en 2003, Nations
Unies, New York, janvier 2003,
http://www.droitshumains.org
33 Notons que ces cinq membres permanents sont les
seuls à bénéficier du droit de veto.
34 Ibid. charte des Nations Unies, p 19
35 Ibid. article 24 paragraphe 1, p 20
SECTION II : LE CONTENU DU MAINTIEN DE LA PAIX.
Le concept de maintien de la paix relève
essentiellement de la problématique de la sécurité
collective. C'est à dire d'un régime visant à
garantir multilatéralement, par un dispositif juridique
l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de
chacun des Etats de
la communauté internationale, Impliquant un sens à
la fois dynamique et statique. En ce sens donc, on peut soutenir que le
maintien de la paix englobe l'idée de restauration aussi
bien
que de préservation, et par conséquent
peut exiger le recours à des moyens coercitifs autant que
préventifs.
Ceci dit, à première vue le règlement
pacifique des différends tel qu'il est mentionné dans la charte,
semble ne devoir être qu'une simple modalité préventive du
maintien de la paix. Cependant la réalité est plus complexe et ce
pour deux raisons:
D'une part, la pratique des organisations internationales
de sécurité collective, la
S.D.N.,(1919-1939) , et depuis 1945 l'O.N.U,
révèle que les procédures de règlement
pacifique sont souvent utilisées postérieurement au recours
à la force. Or souvent y'a des
situations qui ne demandent que la mise en oeuvre de ces
procédures de règlement pacifiques
plutôt que le recours à la force qui pourrait les
freiner dans leurs élans de destructions.
D'autre part, il apparaît que le règlement
pacifique des différends a une finalité en principe
curative, alors que celle du maintien de la paix est normalement
conservatoire.
Delà, le maintien de la paix constitue l'objectif
naturel de tout régime de sécurité collective. Mais
en tant que concept abstrait, la sécurité collective a
des origines très anciennes: elle a fait l'objet d'innombrables
projets avancés par des hommes d'Etat, des intellectuels de
renom ou de simples utopistes (Sully, Jeremy Bentham, Emmanuel
Kant, William Penn, Emeric Crucé, l'abbé de
Saint-Pierre...), depuis le XIVe siècle
jusqu'à la première guerre mondiale. Elle n'a trouvé son
expression juridique qu'en 1919 avec le pacte
de la S.D.N. Celui-ci garantissait en effet,
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique
des pays membres contre toute agression extérieure, et
proclamait le principe de l'indivisibilité de la paix36, tout
en affirmant la solidarité automatique de la communauté des Etats
membres en cas d'agression37. Cela dit, son dispositif
reposait sur le triptyque désarmement-règlement pacifique des
différends-sanctions économiques. Mais l'expérience
de la S.D.N. en matière de sécurité
collective a été considérée comme celle de la
faillite de la paix. Ainsi, compte tenu des leçons de l'entre
deux guerres, le régime de la sécurité collective de
l'O.N.U. fut conçue à partir de l'idée selon laquelle
le fardeau du maintien de
la paix devait obligatoirement incomber aux cinq grandes
puissances victorieuses.
Dés lors la nouvelle organisation mondiale a pu disposer
de pouvoirs plus importants
que ceux de la S.D.N., pour la simple raison que ces
pouvoirs revenaient en réalité aux membres permanents du
conseil de sécurité. Cela explique que dans la
problématique initiale
de l'O.N.U., le désarmement et même le
règlement pacifique des différends occupent une
36 Le pacte de la SDN stipule que : « toute
guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non 'un des membres
de la
Société, intéresse la Société
tout entière »
37 Ibid. « Si un membre de la
Société recourt à la guerre [...], il est ipso facto
considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les
autres membres de la Société. »
place assez secondaire par rapport aux sanctions militaires et
non militaires que le conseil de sécurité a toute latitude de
décréter par décisions juridiquement obligatoires en
vertu du chapitre VII de la Charte. Celle-ci fut en tout cas
élaborée dans la perspective d'un monde placé sous
l'égide d'un directoire de pays au-dessus de tout
soupçon, puisque dotés d'un droit de veto conférant
d'avance à chacun d'eux une totale immunité politique, et
entre lesquels était censée régner une harmonie politique
durable.
Toutefois, les débuts de la guerre froide en 1947,
rendirent aussitôt caducs les postulats sur la base desquels reposait
la Charte à savoir ceux de la responsabilité naturelle,
de la probité morale et de l'entente continue
des grandes puissances. La création de l'O.T.A.N., en 1949,
puis la conclusion du pacte de Varsovie en 1955,
confirmèrent que la sécurité collective
n'était comme à l'époque de la S.D.N., qu'un mirage dans
les relations internationales. Ainsi, le conseil de sécurité
sous la pression des circonstances renonça
tacitement à l'objectif de la sécurité
collective au profit de celui de la gestion limitée des crises.
Dés lors les opérations dites de maintien de la paix, entreprises
sur une base ad hoc et
à l'aide de contingents nationaux pourvus de casques
bleus portant le logo de l'O.N.U., aller traduire une mutation qui de nos jours
reste le moyen le plus adéquat pour le maintien de la paix
38.
En effet, dans une période fortement
imprégnée du spectre de la guerre, à l'heure où
le monde se trouve scinder en deux portions idéologiques
antagonistes; bref dans un climat
de tension cadencé par un fragile
équilibre des forces nucléaires, dans sa formulation, le
maintien de la paix et de la sécurité internationales ne pouvait
pas ignorer ce contexte. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre le maintien
de la paix comme moyen de préserver tout d'abord la paix dans cette
période que l'on appelle communément guerre froide, avant de le
prendre dans le sens de préserver les générations futures
du fléau de la guerre.
Ce faisant à cette époque les
opérations en questions n'allaient avoir qu'un but modeste qui se
résume à la stabilisation de certaines situations conflictuelles.
Dés lors forces neutres et non combattantes, les Casques bleus
qui constituent l'élément moteur des opérations de
maintien de la paix n'entrent en scène qu'avec l'aval des
parties et ne stationnent sur le territoire de l'une d'elles qu'avec l'accord
exprès du pays hôte39; et ils ne
sont autorisés à utiliser la force qu'en cas de
légitime défense.
Ainsi, les Casques bleus peuvent être
considérés comme des soldats sans ennemis: ils n'interviennent
pas comme dans un régime de sécurité collective
à titre de gendarmes chargés de châtier un agresseur,
mais comme de simples «pompiers» dont la seule tâche est
de maîtriser un sinistre dont l'origine ou les
responsabilités ne les concernent pas40.
Toutefois, Au terme du paragraphe premier de l'article
24, la disposition indiquant qu'«en s'acquittant des devoirs
que lui impose cette responsabilité le conseil de
sécurité
38 Voir à Ces propos : paix et maintien de la
paix, Encyclopaedia universalis 8. (Sur Cd Room ): 2002 Encyclopaedia
Universalis
France S.A.
39 Exception faite de l'expérience congolaise
(1960-1964)
40 Casques bleus déployés en Afrique
jusqu'en 1990: Opérations des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.)
1960-1964 ; Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de
transition en Namibie (G.A.N.U.P.T.) 1989-1990.
agit» au nom de l'organisation, laissent entrevoir
un probable appréciation discrétionnaire ainsi qu'une
légitimité d'avance du conseil de sécurité quant
aux méthodes de mise en oeuvre
du maintien de la paix. Mais le paragraphe 2 de ce même
article vient délimiter de jure cette dernière en
précisant que «Dans l'accomplissement de ces devoirs, le
Conseil de sécurité agit conformément aux buts et
principes des Nations Unies». De plus le même paragraphe ajoute
que les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de
sécurité pour lui permettre
d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux
Chapitres VI, VII, VIII et XII. Il apparaît donc clairement que
cette notion de maintien de la paix et de la sécurité
internationales n'est pas totalement laisser à un pouvoir
discrétionnaire du conseil de sécurité, comme l'a
démontré magistralement Mohammed Bedjaoui : «un organe
crée par un traité est d'évidence soumis
à celui-ci dans son existence, sa mission et ses
pouvoirs. Le conseil de sécurité doit obéir
aux dispositions de la charte dans sa mission au
service de l'organisation des Nations
Unies41».
L'idée véhiculée par cette notion qui
tende à préserver la paix et la sécurité
internationales se retrouve donc soumise au même titre que les autres
fins de l'organisation,
au même régime juridique que les autres fins des
Nations Unies. D'autant plus que, compte- tenu des implications à la
fois politiques, économiques voir sociologiques qu'engendre le
maintien de la paix, il est tout à fait louable qu'elle soit liée
au besoin, aux autres fins de
l'organisation. A ce titre, il est significatif d'évoquer
l'article 65 de la charte qui dispose
que «Le Conseil économique et social peut fournir
des informations au Conseil de sécurité
et l'assister si celui-ci le
demande42». C'est ainsi que dans son rapport
l'ex-secrétaire général de l'O.N.U, disait que
«Dans ce nouveau contexte international, nous
nous
somme engagés résolument et de
concert sur le chemin qui conduit à la paix et à la
sécurité, au progrès économique et
l'équité sociale, à la démocratie et au respect des
droits
de l'homme. [...]. A l'heure actuelle, nous
saisissons mieux l'origine des problèmes que la
sécurité implique bien d'avantage
que des questions de territoires et d'armements. Nous comprenons que les
lacunes du développement économique, social et politique
sont les causes des conflits43».
Cependant, pour mieux apprécier le contenu de cette notion
de maintien de la paix et
de la sécurité en Afrique, il nous faut revenir
tout au début des années 90. Plus précisément
le 31 janvier 1992, pour la première fois dans son
histoire le conseil de sécurité s'est réuni au niveau des
chefs d'Etats ou de gouvernement et a adopté une importante
déclarations. Dans celle-ci les quinze invitaient le secrétaire
général de l'organisation B.B Ghali, à élaborer une
étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la
capacité de l'organisation dans
les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et
du rétablissement de la paix et sur
la façon d'accroître son efficacité dans le
cadre des dispositions de la charte. Le 23 juin de la même année,
B.B Ghali a remis ses propositions sous forme d'un petit rapport
d'une
soixantaine de pages, intitulé « AGENDA POUR
LA PAIX ». Depuis cette date, la technique des
«AGENDAs», est devenue aux Nations Unies une pratique
courante. Sont
41 Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et
contrôle de la légalité des actes du conseil de
sécurité, p 24, Bruylant
Bruxelles, 1994
42 Ibid. charte des Nations Unies, p 43.
43Rapport de l'ex-secrétaire
général de l'O.N.U, Boutros. B. Ghali, septembre 1994.
Voir aussi : Daniel Colard, la société internationale
après la guerre froide, P 8, édition Armand Colin, 1996.
venus ainsi s'ajouter «un agenda sur l'environnement
», adopté au Sommet de RIO en juin
1992, un «agenda de vie » en date de 1993,
et un «agenda pour le développement », appelé
aussi action 21 en date de mai 1994. Ces quatre rapports se
complètent et souligne les nouvelles préoccupations dignes
d'intérêt et débouche sur une nouvelle stratégie
internationale de la paix et la sécurité.
Le plus significatif et le plus connu est l'agenda pour la
paix, dans lequel on trouve d'une façon très
détaillée le contenu de cette notion de maintien de la paix et de
la sécurité internationales, et dont l'essentielle concerne
quatre grands problèmes qui sont: Le développement de la
diplomatie préventive, Le rétablissement de la paix, Le maintien
de la paix, la consolidation de la paix et la coopération avec
les accords et les organismes régionaux. Ces techniques dites de
«prévention de la paix » sont singulièrement
définies de
la façon suivante :
- La diplomatie préventive a pour objet d'éviter
que des différends ne surgissent entre
les parties, d'empêcher qu'un différend existant ne
se transforme en conflit ouvert, et si un conflit éclate, de faire en
sorte qu'il s'étende le moins possible.
- Le rétablissement de la paix vise à rapprocher
des parties hostiles, essentiellement
par des moyens pacifiques tels que ceux prévus au
chapitre VI de la charte des Nations
Unies.
- Le maintien de la paix consiste à
établir une présence des Nations Unies sur le terrain; ce
qui n'a jusqu'à présent été fait qu'avec
l'assentiment de toutes les parties concernées, et s'est normalement
traduit par un déploiement d'effectifs militaires et/ou de police des
Nations Unies, aussi dans bien des cas de personnel civil. Cette technique
élargit
les responsabilités de préventions des conflits
aussi bien que de rétablissement de la paix.
- La consolidation de la paix après les conflits qui est
un concept entièrement nouveau, traduit une action menée en vue
de définir et d'étayer les structures propres à raffermir
la
paix afin d'éviter une reprise des hostilités.
En somme, on peut dire que la diplomatie préventive vise
à régler les conflits avant
que la violence n'éclate. Le rétablissement et le
maintien de la paix ont pour objet de mettre
fin aux conflits et de préserver la paix une fois qu'elle
a été instaurée. En cas de succès, l'un
et l'autre débouchent sur la consolidation de la paix
après les conflits, contribuant ainsi à empêcher que les
actes de violence ne reprennent entre les nations et les peuples.
Quant aux techniques utilisées pour l'application de ces
divers procédés du maintien
de la paix et de la sécurité
internationales, en ce qui concerne le recours à la diplomatie
préventive, il recommande : l'utilisation de mesures visant
à renforcer la confiance; le recours aux procédés
d'établissement des faits; la mise sur pied d'un réseau
de système
d'alerte rapide; le déploiement préventif
dans quatre zones en crises d'une présence onusienne et la
création de zones démilitarisées des deux
coté ou d'un seul coté d'une frontière. Pour le
rétablissement de la paix44, il implique la saisine de la
cour internationale
de justice ainsi que l'organisation d'une action internationale
pour améliorer la situation qui
a donnée naissance au différend ou au conflit sous
la forme d'une assistance aux personnes
44 Chapitre VI de la charte des Nations Unies.
ou mobilisation des ressources ce qui fait recours si
nécessaire aux sanctions économiques45 . Enfin en
cas d'échec au chapitre VI de la charte, la
sécurité collective autorise le passage au chapitre VII
pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales en cas de «menace contre la paix, rupture de la
paix ou d'acte d'agression46».
Pour ce qui est des sanctions coercitives, la plus
grave est prévue par l'article 42 à savoir : l'action
militaire, c'est à dire le recours à la force armée
ou tout simplement à la violence47 . Plus
intéressant aussi est la technique du maintien de la paix
à la quelle on retrouve des missions d'observations ou
d'interposition inventée par l'O.N.U à l'occasion
de la crise de Suez en date de 1956, plus connue
sous l'appellation «d'opération de maintien de la paix
» (OMPs). Notons à ce propos qu'on a compté treize OMPs
pendant la guerre froide, et plus d'une vingtaine depuis le bouleversement
survenu après 1989. De nos
jours la demande d'intervention ne cesse de
s'accroître comme en témoigne la situation actuelle au
Côte d'Ivoire, bien que les OMPs récents doivent satisfaire
de nouveaux besoins; d'où la diversification des missions qui par
conséquent occasionnent des coûts de plus en plus
élevés quant au niveau des moyens à
rassembler48.
Enfin, la consolidation de la paix ou la construction
de la paix se pose après les conflits. Elle vise à
instaurer un environnement favorable, par une série de mesures
politiques, économiques et sociales pour éviter qu'ils
n'éclatent à nouveau. Et dans l'ensemble on peut dire donc
que cette conception du maintien de la paix et de la sécurité
internationales est très novatrice et donne un contenu
très large à la notion de sécurité collective
dont l'O.N.U a la charge, et par-là même l'importance du
conseil de sécurité. C'est dans ce sens que l'Afrique
où souvent la conjoncture politique et socio-économique
laisse à désirer, et où les questions s'articulent
en grande partie autour des conflits, a contribué de façon
évidente à ces innovations de la sécurité
collective notamment à partir
des années 90.
Cependant, une question assez pertinente s'impose :
Quel est le contenu juridique, politique et surtout
sécuritaire de la compétence du conseil de sécurité
en Afrique ? C'est ce que nous allons voir dans notre premier chapitre
ci-après sous
l'intitulé : Champ d'action du conseil de
sécurité en afrique.
45Article 41 de la charte des Nations Unies.
46 CHAPITRE VII / Action en cas de menace contre
la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.
Article 39 « Le Conseil de sécurité
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la
paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou
décide quelles mesures seront prises conformément aux
Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales »
47Exemple : le feu vert donné par le
conseil de sécurité sur la base du chapitre VII
précité à la coalition contre l'Irak le 25
novembre 1990.
48 Moyens Logistique, personnel, matériel,
sécurité du personnel, transport, ...
Notes :
.Certains des passages de ce
deuxième point sur le maintien de la paix et la sécurité
internationales, notamment à partir de l'«AGENDA POUR LA
PAIX », sont tirés presque
intégralement dans l'ouvrage précité de
Daniel Colard, « La société Internationale après la
guerre froide », P 8 et P31.
. La notion ou aussi le concept de maintien de la paix serra
utilisée tout au long de ce travail comme terme générique
englobant nécessairement :La diplomatie préventive ; le
rétablissement de la paix ainsi que la consolidation de la paix.
CHAPITRE I
CHAMP D'ACTION DU CONSEIL DE SECURITE EN AFRIQUE
Selon la charte, l'organisation des Nations Unies
à été crée entre autres pour préserver
les générations futures du fléau de la guerre. Et comme en
témoigne l'article 42, le maintien de la paix repose essentiellement
sur le conseil de sécurité49. Cependant, il s'est
avéré que dans le contexte de la guerre froide, le conseil de
sécurité s'est trouvé confronté au problème
du veto de ses membres permanents, et par conséquent son action
principalement dans le domaine du maintien de la paix fut
paralysée50 . Pour pallier à ce problème
la résolution 337 du 3 novembre 1950 «UNION POUR LE
MAINTIEN DE LA PAIX», dite aussi résolution DEAN ACHERSON, a
mis en avant le rôle moteur de l'Assemblée Générale
en
cas de paralysie du conseil de sécurité.
Et ceci était nécessaire particulièrement pour
l'Afrique puisque durant cette période, des régimes non
démocratiques étaient soutenus et alimentés par les
superpuissances au nom de leurs objectifs stratégiques. Mais lorsque
cette drôle de guerre a prit fin, l'Afrique a tout à coup
été laissé à elle-même, et un nombre de plus
en plus grandissant d'Etats africains se trouvent prises par des conflits et
des troubles violents.51 D'ailleurs, parlant de cette situation
dans son rapport sur les causes des conflits
en Afrique, Kofi Annan disait que «depuis 1970
à nos jours, il y a eu sur le continent africain plus de
trente guerres qui dans leur majorité ont pour origines des
conflits internes52».
Ceci dit, étant donné que l'organisation a
comme but premier de régler les guerres inter-Etats, ces conflits
ne peuvent que compromettre ou sinon rendent difficiles les efforts
menés par cette dernière pour instaurer la paix et la
prospérité de même que le bon respect
des droits de l'homme dans cette parie du globe.
C'est ainsi qu'à partir des années 90
l'Afrique s'est trouvait au centre de l'action onusienne. C'est dans ce
sens aussi que l'Assemblée Générale a lancé une
série d'initiatives ambitieuses sur ce continent sous le slogan de
«Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour
le développement de l'Afrique». Toutefois
force est de souligner que l'essentielle du contenu
de ces initiatives réside nécessairement
dans une optique plus socio-économique que politique53.
D'autant plus que ce nouvel ordre du jour tient aussi son importance
dans le domaine politique ou plus précisément dans le champ
d'action du conseil de sécurité qui se résume au maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
49 Ibid. préambule de la charte, p 3 et
article 42, p 28.
50 Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et
contrôle de la légalité des actes du conseil de
sécurité, p 12, Bruylant Bruxelles,
1994.
51 Voir à ce propos : Selon la Charte de
l'O.N.U. : Article paru sur le site web : http
:www.hippiesylvain.free.fr. Url
complet: http
:www.hippiesylvain.free.fr
/HTML/selon_la_charte_de_l.htm
52 Rapport du S G de l'O.N.U, Causes des
conflits en Afrique, Section de la technologie de l'information du
Département de l'information Nations Unies 1998.
www.onu.fr : voir aussi : Basic Facts About the
United Nations, P68, DPI/2155, United nations, April 2001.
53Ibid. Documents officiels de l'Assemblée
générale, 94e séance plénière, 23
décembre 1994.
Résumant cette situation dans son rapport
précité, suite à la réunion tenue par le
conseil de sécurité le 25 septembre 1997 pour
examiner la nécessité d'une action internationale
concertée en vue de promouvoir la paix et la
sécurité internationales en Afrique, Kofi Annan disait que le
conseil lui a prié de présenter un rapport sur les sources
des conflits en Afrique, les moyens de prévenir ces
conflits et d'y mettre fin et la manière de poser par la suite les
fondements d'une paix et d'une croissance économique durable. Mais
considérant que la question dépasse son
domaine de compétence, il «soumets le présent
rapport également à l'assemblée générale et
aux organes du système des Nations Unies dont
les responsabilités englobent l'Afrique y
compris les institutions de Bretton Woods54».
Autrement dit, le secrétaire général comme l'a
demandé le conseil de sécurité, a mit en
évidence par ce rapport le lien de causalité directe et
étroit qui existe entre le socio- économique, la paix et
la sécurité en Afrique, mais aussi la
nécessité d'une coordination effective entre les organes du
système onusien ainsi que la B.M, F.M.,...
Delà, force est de constater que le conseil de
sécurité, l'Assemblée générale, le
secrétariat général ainsi que des organismes autonomes, en
bref la majorité des organes du système onusien, jouent de
concert des rôles complémentaire majeurs, certes dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales,
mais aussi dans le domaine socio- économique en Afrique. D'ailleurs
les moyens et les techniques de maintien de la paix et de
la sécurité internationales tels qu'ils sont
définis dans l'agenda pour la paix et tels que nous
les avons exposés dans le cadre du chapitre
préliminaire de ce travail, en sont assez démonstratifs.
Ainsi, il se déduit par conséquent que les
questions africaines s'inscrivent d'une part dans la problématique
centrale du conseil de sécurité et ce par les
caractéristiques spécifiques des conflits africaines; autrement
c'est le problème du CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX EN AFRIQUE
[Section I ]. D'autre part elles s'apprécient
également sous l'angle de l'action préventive et humanitaire
du conseil de sécurité, dans la mesure que ces
derniers
aspects sont avec le développement
socio-économique, les COROLLAIRES directs des conflits
et donc DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE tout
particulièrement sur ce continent
[Section II ].
SECTION I :
CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN
AFRIQUE
.
L'expérience de ces dernières années a
poussé les Nations Unies à se focaliser sur la
construction de la paix et de la sécurité en
Afrique55. Cependant les menaces de paix sur ce continent par leurs
caractéristiques, font que le maintien de la paix dans le sens
d'éviter le conflit militaire n'est pas suffisant pour
l'établissement de la sécurité et de la paix durable. Mais
une telle sécurité ne peut se réaliser que par
un relèvement socio-économique et l'épanouissement des
peuples africains. Ainsi, sachant que les activités du conseil de
sécurité
couvrent principalement les domaines de prévention
de la Paix56, et vu que ces types d'engagements doivent pour
être efficaces, prendre place simultanément ou se chevaucher,
il
54 Le rapport relève qu'en 1996 seulement, 14
des 53 pays d'Afrique ont connu des conflits armés, Rapport de Kofi
Annan, 25
septembre 1997.
55 Voir l'introduction de ce chapitre I.
56 Maintien de la paix: peace making;
Rétablissement de la paix: peace keeping ; Renforcement de la
paix : renforcement et
Construction de la paix: peace bulding
est tout à fait souhaitable que les trois organes
centraux du système onusien57, oeuvrent par synergie afin de
pouvoir faire face à un tel problème58. Aussi il n'est
pas à négliger non plus, l'intervention des autres organes en
particuliers le conseil économique et social et la cour internationale
de justice, étant donnée qu'ils sont eux aussi et souvent
sollicités par le conseil
de sécurité dans le cadre du maintien de la paix
sur ce continent.
De ce fait, ce cadre du maintien de la paix et de
la sécurité en Afrique s'apprécie d'une part sur la
définition même des conflits africains, et d'autre part sur le
regard qu'a le conseil de sécurité sur ces derniers. C'est pour
cela qu'il convient de voir les particularités
des conflits africains des années 90 [A], avant de
s'intéresser à l'attitude du conseil de
sécurité face à ces conflits [B].
A : PARTICULARITES DES CONFLITS AFRICAINS DES ANNEES 90.
Dés le début des années 90, pour causes
de fin de guerre froide, la communauté internationale a cessé
de s'intéresser à un continent africain en grande
difficulté59. Cependant, il apparaît qu'au centre de
ces dernières figurent les conflits qui ne cessent de s'amplifier de
part et d'autre sur l'étendue du continent. La particularité
première commune
à ces conflits, réside dans le fait que
pas moins de 90% d'entre eux prennent place à l'intérieur
plutôt qu'entre des Etats souverains60. Toutefois, ce
caractère interne est souvent sujet à discussion et ceux à
cause du fait que l'une des parties peut considérée le
différend comme étant interne tandis que l'autre l'assimile
comme un différend d'ordre externe; c'est
à dire qui oppose deux entités qui en principes
devraient être souverains61. Plus regrettable encore est le
cas des conflits dits sécessionnistes, qui prenant prétexte
de l'absence de démocratie ou de tout autre motif pseudo-
juridique, menacent l'unité nationale voir l'existence même
d'un Etat62. Dans ce sens relevons un premier cas aujourd'hui
théoriquement réglé, qui est celui de l'Erythrée,
et qui grâce à une lutte armée de vingt ans a finalement
réussi à se détacher de l'Ethiopie et devenir un Etat
indépendant.
A ce propos, dans son ouvrage intitulé RELATIONS
INTERNATIONALES AFRICAINS, Pierre François Gonidec traitant
sur ce problème, distingue les conflits liés
à la décolonisation et ceux non liés
à cette dernière. Et par conflit de
décolonisation, l'auteur entend les conflits «qui n'opposent
pas des africains entre eux, mais la puissance coloniale
et des mouvements de
libération63». Toutefois, depuis fort longtemps ce
genre de conflits ne
représentent qu'un intérêt historique. Et
lorsque la décolonisation s'est effectuée dans des
57 Conseil de sécurité,
Assemblée générale et Secrétariat
général
58 Ibid. Basic facts about the United Nations, P
67.
59 Voir Ecofinance N° 37, rubrique
éclairage, novembre 2003,
60 Ibid. basic Facts about the united nations P 67,
: voir aussi Pierre François Gonidec, relations Internationales
Africains, Tome
5, P 6, Bibliothèque africaine et Malgache
61 Ibid. Pierre François Gonidec, relations
Internationales Africains, P 147-148 et 149.
62Tel est le cas du Conflit qui a abouti
à l'indépendance de l'Erythrée le 24 mai 1993, de
celui de l'ex république Fédérale islamique des
Comores qui suite à un mouvement sécessionniste qui
débuta le 14 juillet 1997 a fini par la transformation du
régime fédérale en union des îles
Comores au mois de décembre 2001( voir jeune Afrique l'intelligent, N
° 2251, du 29 février
au 6 mars 2004) ; Ou aussi celui qui perdure sous le nom du
Conflit du Sahara occidental qui depuis le 6 septembre 1991 un cessez-le feu
est entrée en vigueur, mettant ainsi fin à 16 années de
conflit armée. Source: (respectivement) prises de vue
générale
et actualité politique de 1990 à 2001,
Encyclopaedia Universalis 8 ( Sur Cd Room ).
63 Ibid., Pierre François Gonidec , relations
Internationales Africains, P 148.
conditions telles qu'elle conduit une partie de la population
à contester la solution retenue
par l'Etat colonial ou par une instance internationale, Tran
Van Minh quant à lui, qualifie ce genre de conflit de conflit de
décolonisation de type nouveau64. Selon lui, la
caractéristique essentielle de ces conflits, est qu'ils opposent
non pas un Etat colonial non africain à un mouvement de
libération dont l'objectif est l'indépendance, mais un peuple
face à un Etat africain dont l'existence est parfois ancienne.
C'est tout particulièrement le cas de l'Erythrée qu'on vient
de mentionner ou aussi le cas du soudan qui depuis le 23 avril 1990,
après avoir déjoué un putsch organisé par de jeunes
militaires et des officiers à la retraite, le général
Omar Hassan El - Béchir a exécuté pas moins de 28
officiers qui contribua aux motifs du soulèvement sur la
capitale65.
Et dans un tout autre registre, on retrouve les
internationalistes qui parlent, quant à eux
de conflits juridiques et de conflits politiques.
Entendant par conflit juridique, le conflit relatif à
l'application ou à l'interprétation d'un droit existant. Et
par opposition, le conflit politique veut dire tout conflit qui n'est pas
juridique66.
Dans cette étude consacrée aux conflits,
Tran Van Minh souligne aussi que «la pratique africaine de
règlement de conflits n'a pas reprit cette distinction de
litiges juridiques et de litiges politiques67». En fait,
cette pratique a montré une certaine préférence
à recourir à l'intervention devenue de plus en
plus systématique, des anciennes puissances coloniales en cas de
règlement de conflit. Cela dit, de nos jours les conflits africains dans
leur vaste majorité sont liés d'une façon ou d'une autre
à la décolonisation. Ainsi force est
de reconnaître l'influence néfaste de la non
prise en compte, ni des diverses origines ethniques, ni des origines
historico-géographiques voir culturels des peuples africains, lors
de la délimitation des frontières de ces
Etats africains68. A titre d'exemple, citons le génocide
perpétré au Rwanda en 1994 ; Ou aussi le conflit du
Sahara occidentale, qui
d'ailleurs la cour internationale de justice a reconnu
par avis consultatif, l'appartenance historique du Sahara à
l'ensemble du Grand Royaume du Maroc, et ce bien avant
l'indépendance69. Cependant en l'espèce le conflit
Rwandais, comme l'a qualifié Pierre François Gonidec, est
«Un conflit Typiquement lié à la question
ethnique70». Autrement dit, c'est un conflit issu en
quelque sorte d'un manque de politique d'intérêt
général commun et effectif. Cela dit, comme
particularité, il n'est pas non plu à
négliger le caractère individualiste de facto qui
s'attache à la grande majorité des Etats africains, quant
au détenteur de la souveraineté. En d'autre terme, face à
des gouvernants soucieux en priorité
de se maintenir au pouvoir, souvent au grand dam de
l'intérêt général et par conséquent de la
64 Tran Van Minh, Encyclopédie juridique de
l'Afrique, P 103 à 105,. Volume I -1979.
65 Le 30 juin de la même année,
plusieurs centaines de milliers de manifestants qui réclamaient la mise
en application immédiate
de la charia, ont fait qu'à partir du 25 juillet 1993,
les combats s'intensifient entre les troupes gouvernementales et les forces
rebelles de l'Armée populaire de libération du Soudan
(A.P.L.S), provoquant l'évacuation de plus de 100 000 civils,
et ce jusqu'à
la mise à l'écart d'Hassan El - Tourabi, en 2000
(Après avoir nommé Omar Hassan El - Béchir à la
haute magistrature du pays,
El - Tourabi revient pour incarner l'homme fort du régime
le 1er avril 1999) : Source : Actualité politique du soudan
depuis 1990
à 2001,
Encyclopaedia Universalis 8 ( Sur Cd Room ) 2002.
66 Ibid. Relations internationales africains.
67 Ibid Tran Van Minh, P 103 .
68 Rapport de Affolabi Moussa Okanla, Afrique,
Désarmement et sécurité, P 12, Alger 24-25 mars
1990, UNIDIR 90/109, Nations Unies 1991.
69 Ibid. Relations Internationales africains, P 149
à 150.
70 Ibid.
masse populaire, il est systématiquement question
de conflit soit pour l'accession au pouvoir, soit de rébellion
revendiquant des droits de participations aux affaires étatiques, ou
aussi de sécession voir d'irrédentisme71.
Et d'un point de vue socio-économique, la
singularité des conflits africains peut aussi s'illustrer d'une part,
par la lutte pour la défense ou contre l'appropriation des
ressources naturelles d'un Etat par une minorité; et d'autre
part, par un grand refus contre la marginalisation
socio-économique d'une minorité du peuple ou de la masse
populaire dans
sa globalité. C'est en tout cas dans ce sens que dans son
rapport en date du 02 septembre
2003, le secrétaire général de l'O.N.U,
s'exprimait en disant que «Toutefois, la pénurie de certaines
ressources naturelles, leurs mauvaises gestions ou leur épuisement et
l'inégalité d'accès à ces ressources, doivent aussi
être considérées comme des causes potentielles de
conflits72 ».
Ainsi, de revendication sectorielle sous le bouclier
juridique du fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
à la lutte contre l'oppression et le favoritisme, tous rendent compte du
caractère intra-étatique des la plupart des conflits africains.
Cela étant aussi qu'à coté de ces conflits ils subsistent
des questions qui rentrent à juste titre dans le domaine de
compétence du conseil de sécurité. Autrement dit, des
litiges qui mettent en opposition des Etats indépendants et
souverains.
Tel est le cas de ce même conflit du Sahara qui
«par interposition», oppose également
le Maroc et l'Algérie73. Mais compte tenu de
leur caractère plus diplomatique que militaire, sinon de leur
rareté notamment à partir dans ces dernières
décennies, force est de souligner
que dans l'ensemble, qu'ils soient internes ou entre Etats
souverains, les conflits africains dans la plupart des cas accentuent
l'instabilité politique des ces derniers, voir de toute la
région concernée; d'où le problème de
plus en plus fréquent des personnes dites déplacés
et
des réfugiés.
D'ailleurs, en plus du cas extrême de
Génocide ou tout simplement de crime contre
l'humanité comme ce fut le cas au Rwanda et au Burundi,
ce phénomène des personnes déplacés et de
réfugiés constitue l'un des facteurs qui a mit le conseil de
sécurité sur le qui- vive face à ces questions africaines
depuis 1990.
C'est pourquoi il importe de voir quelle est la position sinon
l'attitude du conseil de sécurité face à ses conflits
africaines.
B : LE CONSEIL DE SECURITE FACE AUX CONFLITS AFRICAINS
Depuis la création de l'O.U.A74,
la doctrine de l'O.N.U a été d'abandonner aux africains le
soin de régler eux même leurs problèmes. Et ceci a prit
naissance solennellement
du coté africain depuis 1964 à propos du conflit
Somalo-Ethiopien. En effet, à cette date le
71 Ibid.
72 Rapport de Kofi Annan faisant suite à
l'application de la déclaration du millénaire (06 au 8 septembre
2000); A/58/323, 58éme session de l'A G, Nations Unies, 02 septembre
2003.
73 Ibid. relations internationales africains, P
148.
74 Depuis 2001, on parle plutôt de Union
africaine. Voir à ce propos : Union africaine: Encore Un Virage ou
Mirage par Najib Mouhtadi, article paru sur Libération
(Casablanca) 24 juillet 2001; également disponible sur le
site web : http// :Www. Perspectives-africaines.com ; ou aussi jeune
Afrique l'intelligent, N ° 2251, 29 février au 6 mars 2004.
conseil des ministres de l'O.U.A, vota une résolution
dans laquelle il dispose que «l'unité de l'Afrique exige que
le règlement de tous les conflits qui peuvent subvenir entre
les Etats membres soit recherché dans le cadre de
l'O.U.A75». Cette disposition traduit donc la
préoccupation des africains de vouloir régler eux-mêmes
leurs conflits, soit dans le cadre des organisations régionales ou
sous régionales, soit aussi dans celui de la relation plus
informelle entre dirigeants d'Etats africains.
Cependant, l'existence de ces préférences
africaines dans le règlement des conflits, bien qu'ils
écartent si fréquemment ou plutôt retardent
grièvement l'intervention onusienne, n'exclut pas l'action du
conseil de sécurité à qui incombe la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Toutefois, force est de souligner
qu'à bien des occasions cette intervention du conseil fut sujet à
controverse particulièrement dans
le cas où les actions de ce dernier
n'interviennent qu'après que le pire se soit produit ou
aussi du fait qu'il recourt par manque de moyens logistiques et
techniques, à un Etat étranger
à un conflit afin de s'acquitter de sa tache comme lui
autorise l'article 43 de la charte des
Nations Unies76.
Ce double constat bien qu'il soit systématique valable
pour l'ensemble des interventions du conseil de sécurité en
Afrique, fut le cas surtout lors du conflit somalien dans lequel
après que 22 casques blues pakistanais et 18 marines américains
furent tués en octobre 1993 au cours d'attaques armées, sur la
base de la résolution 837, les Américains
ont par la suite donné l'impression que c'est
plutôt un conflit «Americano-Aïdidienne» qu'une
opération de maintien de la paix et ce du fait que leur
principal mission fut de capturer sinon de mettre hors d'état de
nuire le Général Aïdid au détriment des populations
civiles77.
C'est ainsi que ces préférences africaines
arrivent à s`expliquer de nos jours, par des telles dérives qui
font que comme l'a souligné Kofi Annan, Faute d'avoir
prévenu ces épouvantables tragédies en Somalie et au
Rwanda certes, les dirigeants des pays africains
ont manqué à leurs responsabilités
à l'égard de leurs peuples, mais surtout l'Organisation des
Nations Unies a manqué à ses devoirs78.
Cela dit, l'O.N.U a perdu une grande part de sa
crédibilité en Afrique.
Toutefois sur le plan juridique, le conseil de
sécurité conformément à l'article 24 de la charte,
conserve son droit ainsi que son devoir d'intervenir ailleurs comme en Afrique
afin
d'y trouver une solution et ce dans le souci d'éviter
qu'un conflit interne ou non ne s'ébranle
75 Ibid. Relations Internationales Africains, P
168.
76 L'Article 43 dispose que «Tous les Membres
des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la
sécurité internationale, s'engagent à mettre à la
disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial
ou à des accords spéciaux, les forces
armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de
passage, nécessaires au maintien de
la paix et de la sécurité internationale. 2.
L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de
ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement
général, ainsi que la nature des facilités et de
l'assistance à fournir. 3. L'accord ou les accords seront
négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil
de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de
sécurité
et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de
sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront
être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles
constitutionnelles respectives».
77 Ibid. Nouvel ordre mondial et contrôle de la
légalité des actes du conseil de sécurité, P 64 et
65. ; voir aussi Anatole AYISSI, PAIX GENERALE ET SECURITE FRAGMENTEE,
L'Afrique dans/et le nouvel ordre sécuritaire mondial, UNIDIR, 18
mars
2000
78 Rapport de Kofi Annan, Les conflits, une
réalité à laquelle il faut faire face, 25 septembre
1997.
au point d'atteindre des dimensions
internationales79. De même que comme prévue dans le
cadre du chapitre VIII, l'organisation des Nations Unies sous l'égide du
conseil de sécurité, peut coopérer avec les
organisations régionales et sous régionales dans leur tache
du maintien de la paix et la sécurité.
A ce titre, rentrant dans le cadre des innovations
dans les interventions face aux conflits en Afrique introduites par le
secrétaire général dans la gestion stratégique
de l'O.N.U, des nominations en 1997 comme celle d'un envoyé
spécial de l'O.N.U et de l'O.U.A. pour la région des grands
lacs, et la nomination la même année d'un représentant
spécial de l'O.N.U pour les enfants dans les conflits armés,
constituent des initiatives assez significatives dans ce domaine. De même
que le déploiement commun des forces régionales
et sous-régionales avec celles de l'O.N.U (forces
multinationales), sont eux aussi évocatrices. Mais plus concret
restent les déploiements complémentaires de forces
d'observateurs comme la force d'observateurs militaires des
Nations Unies (sans armes) qui
a été déployée parallèlement
à l'ECOMOG, avec pour mandat de travailler avec les forces de l'Afrique
occidentale afin d'appliquer l'accord de paix au
Libéria80.
Force est de reconnaître donc que bien des initiatives
du conseil de sécurité face aux conflits africains restent
à saluer. D'autant plus que le conseil adopta diverses
résolutions allant par diversifications dans le sens du maintien
de la paix et de la sécurité sur ce continent. A titre de
référence on pourrait citer: La résolution 658
relative à la situation au Sahara occidental en date du 27 juin
1990 ; La résolution 696 relative au conflit en Angola
en date du 30 mai 1991; La résolution 797
en date du 16 décembre 1992 relative à la situation
au Mozambique; La résolution 872 du 5 octobre 1993 qui
créait la mission des Nations Unies au Rwanda; La
résolution 866 du 22 septembre et qui prévoyait entre
autres
la création d'une mission d'observateurs internationaux
chargée de superviser
l'acheminement de l'aide humanitaire et le bon déroulement
des élections fixées à février- mars 1994 au
Liberia et celle de 1995 (résolution 985) créant le
comité des sanctions contre
ce pays sur la base d'une violation des accords de cessez le
feu; La résolution 1044 du 31 janvier 1996 condamnant la
tentative d'assassinat dont le président égyptien a
été l'objet; de même la Mission d'Observation des
Nations-Unies en Angola qui est le fruit de la résolution
1118 du conseil de sécurité en date du 30
juin 1997; La résolution 1192 du 27 septembre
1998 conditionnant la levée des sanctions sur la
Libye à propos de l'extradition des deux libyens responsables
présumés du détournement de la Pan-Am qui doivent
comparaître devant le tribunal écossais basé à
Amsterdam (Pays bas); La résolution 1258, relative à la
grave situation humanitaire que connaît la république du Congo;
Et pour l'année 1999, la Résolution 1271 adoptée
par le Conseil de sécurité sur la situation en
République centrafricaine; La Résolution 1320
concerne quant à elle la situation entre l'Erythrée
et l'Ethiopie en date de l'année 2000; La Résolution 1375
adoptée par le Conseil de sécurité en
2001, relative à la situation humanitaire au
Burundi; Egalement on retrouve pour l'année
2002 des résolutions comme la Résolution 1399
relative encore à la situation en République
79 Voir à ce propos : articles 24, 36 et 37 de
la charte des Nations Unies.
80 Ibid. Kofi Annan, Les conflits, une
réalité à laquelle il faut faire face : voir aussi
les résumés de ce rapport intitulés respectivement :
Les innovations dans les interventions face aux conflits en Afrique ;
Les principales recommandations du Secrétaire général
Préparé pour Internet par la Section de la technologie
de l'information du Département de l'information (c) Nations Unies
1998 :
www.un.org
démocratique du Congo et avec le conflit qui vient de
s'intensifier en Côte d'Ivoire, on peut noter pour l'année
2003 la Résolution 1514. Et enfin pour cette
année, il convient de mentionner les deux Résolution
concernant encore cette situation en Côte d'Ivoire à savoir
la Résolution 1528 ainsi que la
Résolution 1527 portant création de l'ONUCI81.
De tout ceci, il convient de retenir que :
Tout d'abord il est à savoir que pour un conflit
donné voire une question donnée parmi ceux et celles qu'on
vient de mentionner ou les autres qui n'apparaissent pas ici, le
plus souvent on retrouve pas moins de deux à trois résolutions
ou plus qui sont adoptées dans la même année pour le
même conflit sinon pour la même question. Ensuite, entre toutes
ces résolutions concernant le cas par cas des questions africaines, il
existe d'autres qui par leur formulation concernent l'Afrique sinon les
questions africaines sans qu'elles s'adressent particulièrement
à un cas précis. Tel est par exemple le contenu de la
résolution 1196
Adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 3927éme séance du 16 septembre 1998
portant sur l'obligation des tous les Etats membres de l'O.U.A d'appliquer
les décisions relatives aux embargos sur les armes
décrétés contre les pays et les zones africains en
situation de conflit82.
Ainsi, par de telles résolutions qui sont
d'ailleurs assez nombreuses, il apparaît que l'action du conseil de
sécurité face à ces questions africaines ne se
borne pas aux seules situations armées, mais qu'à coté
il existe aussi des retombés sinon des causes souvent plus
menaçantes faisant figure par conséquent de corollaires directs
du maintien de la paix et de
la sécurité en Afrique.
SECTION II :
LES COROLLAIRES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE EN AFRIQUE
L'un des buts que l'O.N.U. se propose de réaliser
au même titre que la paix, est la sécurité et le
développement socio-économique des nations83. Et dans
le sillage des questions africaines depuis la fin des années 80, le
conseil de sécurité, interprétant dans un sens très
libéral le chapitre premier de la charte, n'hésite plus à
renforcer son action notamment par la création et l'intervention des
organes subsidiaires afin de mieux s'acquitter de sa
tâche84.
En effet, l'expérience de ces dernières
années a montré que le maintien de la paix en particulier en
Afrique, s'il se limite à la prévention des conflits ne suffit
pas à instaurer une paix solide et durable; mais qu'une telle
sécurité peut seulement être réaliser en aidant les
pays à promouvoir le développement économique, la justice
sociale, la protection des droits
de l'homme, la bonne gouvernance et le processus de
démocratique.85. De ce fait, il est clair
81 Pour les résolutions mentionnées
ici et qui s'inscrivent dans la période 90 à 92, voir
Karel C. Wellens, Résolutions et déclarations du conseil
de sécurité (1946-1992), P 70; Pour ceux d'après
92, voir sur le site des Nations Unies :
http://www.un.org/french/ ; Chronologie
des résolutions du conseil de sécurité jusqu'à nos
jours (Mars 2004).
82 Référence onusienne de cette
résolution : S/RES/1196 (1998), 19980916,le 16 septembre 1998.
83 Ibid. charte des Nations Unies, article 1 et 55,
respectivement page 5 et 37.
84Jean François Muracciole, L'O.N.U depuis
1945, P 44 et 45, Ellipses.
85 Bilan des missions des Nations Unies pour la paix,
Centre d'informations des Nations Unies, janvier 2003. Site web:
wwww.un.org
que le maintien de la paix ne se résume pas à la
seule action qui tend à freiner les conflits
une fois éclatés, mais que c'est tout un
mécanisme qui en principe devrait à la lumière des moyens
et des techniques que nous venons de souligner
précédemment dans le chapitre préliminaire,
éviter l'embrasement sinon diminuer l'intensité voire supporter
les méfaits des conflits avant même que les hostilités
armés n'éclatent et/ou après que ces derniers se sont
tues.
Cela dit, comme corollaires du maintien de la paix et de la
sécurité en Afrique, force
est de nous intéresser au cadre sécuritaire
et humanitaire [A], avant de nous pencher nécessairement sur la
question du développement socio-économique [B].
A : LE CADRE SECURITAIRE ET LE PLAN HUMANITAIRE EN
AFRIQUE
Dans son rapport en date du 02 septembre 2003, le
secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, estime qu' «un grand nombre des conflits récents
du continent africain, ont été caractérisé par des
actes d'extrêmes violences perpétrées contre
des civils, notamment des actes brutaux de
torture, des viols, des mutilations, des harcèlements et des
exécutions86». Ceci dit, il ne serait pas
illégitime que le maintien de la paix implique nécessairement
d'un coté l'arrêt des combats, mais de l'autre la protection
des civils qui dans la plupart des cas sont des innocentes
victimes de ces conflits87.
C'est dans ce sens que le conseil de sécurité
adopta diverses résolutions dans ce cadre
du maintien de la paix et de la sécurité en
Afrique, tendant à faire appliquer des accords de cessez-le feu, sinon
à faire échec d'une manière ou d'une autre aux
affrontements armés avant leurs déclenchements ou aussi
leur reprises. Il est significatif dans ce contexte de mentionner des
résolutions comme la résolution 1474 relative à la
situation en somalie, la résolution 1493 relative au conflit qui perdure
en république démocratique du Congo; ...etc.,
étant donné qu'elles portent embargos sur les
armes en destination des pays d'Afrique en situation de
conflit88. Il est également, de la résolution 1467
dite «Mobilisation concernant le trafic d'armes
légères», portant sur une mobilisation devant
l'ampleur du trafic illicite d'armes légères en Afrique de
l'Ouest et le phénomène de mercenariat. Plus
évocatrice encore est la résolution 1459 dite
«système de certification du processus de Kimberley
», portant son soutien au système de certification des
diamants bruts du processus de Kimberley; appelés aussi
«Diamants de la guerre », étant
donné qu'ils alimentent considérablement les conflits
armés en afrique.89 A ce titre rappelons que ce processus a
été établi à l'instigation des pays de l'Afrique
australe producteurs de diamants pour mettre fin
au commerce illicite des diamants bruts.
Dans l'optique du bon respect des accords conclu de part et
d'autres en Afrique, entre partis à un conflit notamment afin d'aboutir
à un cessez-le feu, force est de relever le cas de
la Namibie qui en 1989-1990 le conseil de sécurité
avait mis en place un groupe d'assistance
86 Application de la déclaration du
millénaire, point 61 de l'ordre du jour du 58éme assemblée
générale des Nations Unies, 02
septembre 2003, A58/323.
87 Voir à ce propos : Afrique,
désarmement et sécurité ( Alger 24 - 25 mars 1990),
UNIDIR, Nations Unies 1991.
88 Ibid. Centre d'information des Nations Unies,
résumé des Résolutions du conseil de
sécurité, octobre 2003
89 Ibid.
des Nations Unies pour la période de transition dans ce
pays afin de compléter le respect du cessez-le feu et d'assister le
déroulement d'élections démocratiques antérieur au
conflit armé
qui opposé ce pays et l'Afrique du sud90.
De même, c'est sur le rapport du secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies, relatif au déploiement préliminaire des
Nations Unies en République Démocratique
du Congo daté du 15 juillet 1999, et sur l'accord de
cessez-le feu signé à Lusaka le 10 juillet
1999, et celui du premier août 1999 signé par le
mouvement de libération du Congo, que le conseil de
sécurité s'est basé pour adopter lors de sa
403éme session le 06 août de la même
année, la résolution 1258 relative à la grave situation
humanitaire que connaissait ce pays notamment en ce qui concerne le retour au
foyer des réfugiés et des personnes déplacées en
particuliers les enfants91.
Notons aussi que dans le cadre de sa compétence
de créer les organes subsidiaires dans l'accomplissement de sa
tache en vertu de l'article 29 de la charte des Nations Unies, le conseil de
sécurité a mit sur pied chronologiquement dans ce sillage des
conflits en Afrique
à partir des années 1990, six commissions de
sanctions entre 1992 à 1997 dont : Le Comité
des sanctions contre la Libye: résolution 748
(1992 ; Comité des sanctions contre la
Somalie: résolution 751 (1992); Comité
des sanctions contre l'Angola: résolution 864 (1993);
Comité des sanctions contre le Rwanda: résolution 918
(1994; Comité des sanctions
contre le Libéria: résolution 985 (1995),
et enfin le Comité des sanctions contre la Sierra
Leone institué par résolution 1132
(1997)92.
Soulignons cependant que la création de ces commissions
intervenait soit suite à un
non-respect des embargos prises par le conseil de
sécurité, ou à un non-respect des accords
de cessez-le feu signé entre belligérants sous les
auspices de l'O.N.U ou non, voire à une violation de toutes autres
mesures du conseil de sécurité prise dans le sens du maintien de
la
paix et de la sécurité en Afrique.
Sur le plan humanitaire, la résolution du conseil de
sécurité dite «les enfants et les conflits
armés93» est assez signifiante. D'autant
plus qu'au même titre que la condamnation
du terrorisme décrétée par le conseil de
sécurité, l'assistance humanitaire est devenue elle aussi un
élément central des opérations du maintien de la paix et
de la sécurité en Afrique94.
La résolution 688 du conseil de sécurité
vient corroborer cela dans le sens qu'elle opéra le
lien entre la violation des droits de l'homme et la menace
pour la paix, bien que dans un autre sens elle ouvre la voie à la
définition «d'un droit
d'ingérence95». Et dans ce sens aussi, bien
qu'elle fut l'oeuvre de l'assemblée générale, la
résolution 43 -131 portant assistance
90 Ibid. L'O.N.U depuis 1945, P 45 et 46.
91 Groupe de recherche et d'informations sur
la paix et la sécurité (GRIP):
www.Grip.org Réf : GRIP DATA :
G1699, 04
novembre 1999.
92 Ibid. les organes subsidiaires du conseil de
sécurité de l'O.N.U, centre d'informations des Nations Unies,
MAE/NU07, 25
juillet 1998.
www.un.org
93 Résolution 1460 du 30 janvier 2003
portant sur la mise en place de mesures appropriées contre le
recrutement et l'utilisation d'enfants soldats
94 Ibid. l'O.N.U depuis 1945, P 46
95 Cette résolution qui condamne le
terrorisme à par sa formulation opéré un lien entre la
violation des droits de l'homme et la menace conter la paix, mais comme l'a
confirmé tout récemment les évènements qui ont
précédé la chute du régime irakien, elle
représente aussi une source « légale»
d'ingérence à la limite de le grossièreté.
humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et
aux situations d'urgences, est elle aussi significative. De plus cette
dernière allait être complétée par une autre en date
du 14 décembre 1990, sur la mise en place de corridor humanitaire dans
les zones en situation de conflit96.
Professant à ce propos, le président F
Mitterrand disait qu'«Il existe dans notre droit pénal
un délit grave, celui du non-assistance à personne en
danger. en droit international, la non-assistance aux peuples en danger n'est
pas encore un délit, mais c'est
une faute morale et politique qui a déjà
coûté trop de mort et trop de douleurs à trop de peuples
abandonnés pour que nous acceptions à notre tour de la
commettre97». Dés lors les atrocités
commises de part et d'autre sur le continent africain ne peuvent que
poussé le conseil de sécurité à instituer
des Tribunaux pénales chargés de juger les auteurs de
ces «crimes contre l'humanité». A ce
titre on retrouve donc, le tribunal pénal international
pour le Rwanda institué par la
résolution 955 en date du 08 novembre 1994, siégeant
à Arusha (Tanzanie). Ce tribunal a commencé
à fonctionner au siége à compter du 27 novembre
1995. Ses objectifs sont de juger les personnes présumées
responsables d'actes de génocides ou d'autres violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les
citoyens Rwandais présumés responsables de tels actes ou
violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le premier
et le 31 décembre
199498. De même, il convient
aussi de mentionner la Cour Pénale Internationale qui est
appelée à juger les crimes conter l'humanité, les crimes
de guerre et les actes de génocide, dont de nos jours on
évoque déjà le chiffre de quelque 200 plaintes
s'accumulant sur le bureau du procureur. Notons à ce propos que 143
Etats ont déjà signé le traité de Rome en
1998, instituant cette dernière. Et parmi eux, 89
l'ont ratifié dont 22 pour le continent africain, et sont donc
considérés comme
«Etats-parties99».
Toutefois, malgré cet effort conjugué
essentiellement sous les auspices du conseil de sécurité en
collaboration avec les diverses institutions onusiennes et autonomes, comme
l'a
fait remarquer le Pape Paul VI, «le développement
est le nouveau nom de la paix, et la paix
est une condition nécessaire au développement
durable humain100». C'est aussi le point de
vue de l'ex-secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies qui en parlait par ces termes:
«Nous savons maintenant que la sécurité implique
bien d'avantage que des
questions de territoires et d'armements, [...], que les
lacunes du développement économique, social et politique sont les
causes des conflits101». Dans ce sens aussi, force est
de mentionner l'intervention de Jacqueline Oble, lors
de la conférence de l'institut des Nations Unies pour la
recherche sur le désarmement en date du 24 et 25 mars 1990
qui estime qu'«à cela, il faut ajouter des
préoccupations beaucoup plus récents et qui par leur
généralisation menacent la sécurité de nos
pays[...], je veux parler de la sécurité sur le plan
économique. Il est évident qu'un Etat digne de ce nom doit
assurer à ses concitoyens la
96 Source :Communauté internationale et les
droits de la personne humaine, travaux dédiés à la
mémoire de DRISS SLAOUI, Journée d'étude
organisée le 07 février 2002, Fondation Roi Abul-Aziz Al
Saoud pour les études islamiques et sciences
humaines, Edition 2001.
97F Mitterrand, Discours prononcé à
Mexico en 1981 à la veille de la conférence de CANCH. Ibid.
Daniel Colard, P 25.
98 Source : Centre d'informations de Nations Unies,
25 juillet 1998.
99 Anna Borrel , 18 juges, une CPI, Source :
www.Afrik.com, 12 mars 2003.
100 Discours du pape Paul VI à l'O.N.U en
1965, voir Ibid. Daniel Colard, P 31
101 Ibid. B.B Ghali, pour la paix et le
développement, DPI/1537, Nations Unies
sécurité alimentaire, or l'observation
de la réalité africaine montre que cette
sécurité alimentaire fait souvent défaut à cause
bien entendu des calamités naturelles, mais aussi et surtout à
causes des guerres102».
C'est delà que vient la dimension socio-économique
du maintien de la paix et de la sécurité dans les pays africains
victimes des conflits.
B : LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DANS LES PAYS
AFRICAINS VICTIMES DES CONFLITS
Fixant les objectifs de l'organisation, le
préambule de la charte des Nations Unies proclame la paix et la
sécurité, et le développement en vue de
résoudre les problèmes de caractère économique,
social et humain103. Dans son ouvrage LE REGAIN
DEMOCRATIQUE, Jean François Revel, écrit ceci : «il
est plus facile de sauver un Etat chancelant, que des citoyens
persécutés104». Et l'actuel
secrétaire général de l'organisation des Nations
Unies quant à lui écrivit dans son rapport relatif à la
situation en Afrique, en date du 16 avril 1998
que «les efforts de l'Afrique doivent
bénéficier d'un appui international mieux affirmé dans
l'arène tant politique qu'économique; les mesures
d'allégement de la dette doivent aller plus loin et les produits
africains doivent avoir plus facilement accès aux marchés
d'exploitation,
si l'on veut accroître le niveau de la vie et partout,
promouvoir la stabilité 105».
Et parlant des spécificités des nouveaux conflits
africains, Daniel Colard fait observer
que «l'effondrement ou la désintégration
des structures de l'Etat, notamment de la police et
de la justice [...] », fait que
«l'organisation des Nations Unies est donc obligée de
dépasser
les simples taches militaires, humanitaires
(opérations de maintien de la paix de première
génération), et d'interposition (opération d maintien de
la paix de seconde génération), pour restaure l'autorité
du pouvoir politique, favoriser la réconciliation entre les
clans ou les factions rivales qui veulent imposer leur loi au
pays106». Sous cet aspect, des exemples comme celui
de la Namibie, Angola, Mozambique, paraissent donc assez illustratifs. Ainsi
donc, cette multiplicité des fonctions démontre que le conseil de
sécurité et l'ensemble des autres organes du système
onusien et/ou autonomes doivent jouer de concert un rôle
très utile voire crucial avant et/ou après l'adoption d'un
règlement ou d'un accord de paix..
De ce fait, il n'est pas étonnant que l'organisation
dans son ensemble soit appelée à exercer des taches comme
de regroupement et démobilisation des forces autrefois
belligérantes107, opérations de déminage,
réinsertion des combattants dans la vie civile, rapatriement des
réfugiés et des personnes déplacées, fournitures
d'une assistance sanitaire, alimentaire, surveillance du respect des droits de
l'homme et des opérations électorales, et surtout des mises en
place de nouvelles structures administratives et policières, routier,
allant
102 Ibid. UNIDIR, P 38.
103 Ibid. préambule de la charte de Nations
Unies, P 3 et 4
104 Voir à ce propos : Veynes et Viljoen, la
protection des droits de l'homme en Afrique, P 10 et 11, RMEI N° 3/
1999
105 Ibid. Rapport de Kofi Annan, « les conflits
une réalité a laquelle il faut faire face », 25 septembre
1997.
106 Ibid. Daniel Colard, P 38.
107 C'est fut le cas en Centrafrique
jusqu'à la restauration et au redressement
économique d'un pays tout entier108. C'est d'ailleurs
à ce propos que monsieur B.B Ghali, parlait à bon escient de
«consolidation de la paix après les conflits», et
d'«opération de maintien de la paix de troisième
génération109».
Il appartient donc à l'O.N.U. toute entière, dans
cette optique du maintien de la paix
qui échoit inévitablement de droit au conseil
de sécurité, de prendre un maximum de mesure110
dans des domaines différents et pendant une longue durée,
de façon à supprimer
les causes des conflits et à construire ainsi la
paix sur des fondations solides et durables.
Cela dit, on touche nécessairement ici à
l'armature des institutions de l'Etat, à son fonctionnement,
à la question des droits de l'homme; en somme aux
problèmes du développement économique et social et
à la démocratisation sous toutes ses formes.
Quant au domaine politique, notons que l'O.N.U. en conjuguant
ses efforts à ceux des organisations régionales en
l'occurrence O.U.A et certains mouvements de libérations
nationales, a contribué puissamment à la fois à
mettre fin à la domination coloniale et au système de
l'apartheid111.
Cela dit, le maintien de la paix, jadis appel au
même titre que la diplomatie, l'intervention de forces ou aussi
l'assistance humanitaire, une aide technique et économique notamment
après que les hostilités armées se sont tues. De
ce fait, étant toujours dans ce cadre de maintien de la paix,
le conseil de sécurité certes y est impliqué mais
aussi l'assemblée générale, le secrétariat
général, ou en un mot, l'ensemble des organes du
système onusien ainsi que les organisations autonomes, peuvent
contribuer à ce vaste chantier. A ce titre aussi l'existence et la
création des organismes spécialisés qui couvrent tous les
domaines et qui ont vocation globale à agir pour le bien de
l'humanité, et particulièrement pour la plupart des pays
africains victimes des conflits, ne peut que renforcer ce noble
chantier112.
Force est donc de mentionner à ce propos
certains programmes onusiens à l'instar U.N.I.S.A113,
lancée le 15 mars 1996 par le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, le président de l'ex-Organisation
de l'Unité Africaine, le président de la banque mondiale,
les présidents du Ghana et du Sénégal, le
vice-président du Kenya et les chefs des agences de l'organisation des
Nations Unies. Cette dernière est en effet un programme de
dix ans composé d'actions concrètes
destinées à accélérer le développement
dans des domaines prioritaires désignés préalablement par
les pays africains. Cette initiative constitue
le mécanisme de mise en oeuvre du nouvel ordre du
jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les
années 90.
108 STÉPHANE HESSEL, Vers un conseil de
sécurité économique et social, LE MONDE DIPLOMATIQUE,
jUILLET 2003. Url:
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/07/HESSEL/10235
.
109 Ibid. Agenda pour la paix. Ibid. Daniel
Colard.
110 Ou d'encourager les Etats ou les institutions
internationales compétentes, à coordonner des programmes,
111 La domination coloniale se réfère
ici à l'indépendance de la Namibie intervenue en 1991 au
gré du conseil de sécurité face à la
république sud africaine. ; L'étape finale de l'abolition de
l'apartheid fut observée en Afrique du sud officiellement en 1994.
Voir
à ces propos : Ibid. Relations Internationales africains,
P 58
112 Ibid. Vers un conseil de sécurité
économique et social, STÉPHANE HESSEL, Le Monde diplomatique,
juillet 2003.
113 Terminologies Anglaise: United Nations For
African Development
A ses origines, l'initiative compte de nombreux
domaines prioritaires. Et par ses objectifs, il vise à permettre aux
africains de prendre en main leur propre développement,
d'améliorer la coordination des donateurs et d'accroître
l'efficacité de l'aide fournie. Cependant, une proposition faite
récemment tendait à accorder une attention particulière
aux cinq objectifs suivant : Elargir l'éducation de base et les
soins de santé essentielles; Promouvoir la bonne gouvernance;
Maîtriser la technologie de l'information et Intégrer les
préoccupations démographiques à tous les niveaux du
développement, avec un accent particulier sur la pleine
participation des femmes. Et Il incombe à cet effet, à
une ou plusieurs agences de l'organisation des Nations Unies, la
responsabilité de mobiliser les ressources et de coordonner la mise
en oeuvre de chaque action prévue dans le programme. Sont inclus dans
les autres domaines prioritaires de cette initiative: la mobilisation
des ressources; l'allégement de la dette; l'accès des produits
africains aux marchés internationales; la coopération sud-sud;
l'édification de la paix et le règlement des conflits;
le développement des ressources en eau et la
sécurité alimentaire; la lutte contre la dégradation
des sols et la désertification ainsi que la réduction de la
pauvreté et la garantie
des moyens d'existence durables.
En ce qui est des institutions participantes à cette
initiative qui incarne par excellence
le nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le
développement de l'Afrique, on retrouve:
la B.M; la Commission Economique pour l'Afrique; la
C.N.U.C.E.D; le département des affaires économiques et
sociales des Nations Unies; le fond de développement des Nations Unies
pour la femme; le fonds des Nations Unies pour l'enfance; le fond
international de développement agricole; le F.M.I; le haut
commissaire aux droits de l'homme; le haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés; l'organisations des Nations Unies
pour l'éducation la science et la culture; l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture; l'organisation internationale du
travail ; l'organisation météorologique mondiale; l'organisation
mondiale de la santé; l'O.M.C; Le P.A.M; le programme des
Nations Unies pour le développement; le programme des Nations Unies
pour l'environnement; l'union internationale des
télécommunications et enfin l'union postale
universelle 114.
S'exprimant à ce sujet, Kofi Annan disait que ce
«programme devait être jugé en partie sur la
capacité qu'il confère à l'organisation des Nations
Unies de répondre aux besoins des plus pauvres en Afrique et
ailleurs», avant d'ajouter que «les efforts de
l'Afrique
on fait que 11 pays du continent ont atteint en 1997 des taux
de croissance économique de
6% et plus. Ce taux de croissance atteint ou
dépasse l'objectif fixé en 1991 par l'Assemblée
générale dans le cadre du nouvel ordre du jour des Nations Unies
pour le développement de l'Afrique dans les années 90, dont
l'initiative spéciale est désormais le véhicule de mise en
oeuvre au titre d'une résolution de l'assemblée
générale en date de décembre 1997». De
même il souligne en outre que «ce qui est
particulièrement encouragent dans ces taux de croissances, c'est
qu'ils ont été enregistrés à une
période ou l'aide publique au développement est en
déclin, et où la croissance rapide des flux d'investissements
étrangers directs à destination des pays en
développement, a largement ignoré l'Afrique et où
ne
114 voir à ce propos : Que ce que
l'initiative spéciale du système des Nations Unies ? :
Afrique relance, département de l'information des Nations Unies,
Bureau S-931, Nations Unies, New York 10017 :
www.un.org.
l'oublions pas, certains partis du continent sont encore en
proie à des conflits et des luttes internes115». Et
dans ses dernières phrases de ce message, le secrétaire
général, indiquait que
«le conseil de sécurité a
récemment tenu sa toute première réunion au niveau
ministériel, consacrée à l'Afrique, gage d'un
renouveau d'intérêt pour les perspectives de
l'Afrique». Puis il clôtura son discours en indiquant, qu'il
soumettra «bientôt au conseil de sécurité un
rapport recommandant des façons de renforcer le soutien que
l'organisation apporte aux
efforts de l'Afrique, d'aborder les problèmes de
conflits et de poser les fondations d'une paix et d'un
développement durable116».
Autre programme allant dans ce sens du
développement socio-économique de l'Afrique est celui connu
sous le nom du N.E.P.A.D117, qui se traduit par un Partenariat sur
divers niveaux entre l'Afrique et presque tous les organismes du système
onusien voir aussi
un grands nombres d'Etats faisant figure de puissance
économique. De même, notons que
par sa déclaration du 06 avril 1994, la
quatrième conférence des ministres du comité
consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de
sécurité en Afrique centrale qui s'est tenue à
Yaoundé, a recommandé la création d'un centre sous
régional pour les droit de l'homme et de la démocratie sous
l'égide du haut commissariat des droits de l'homme aux Nations
Unies118.
En bref, quelle que soit l'opération envisager ou
l'organe voir l'organisation mise à contribution, en matière de
maintien de la paix et de la sécurité voire aussi du
développent socio-économique en Afrique, on peut dire sans
crainte que cette dernière à les faveurs du conseil de
sécurité étant donné le cause à effet qui
anime ces deux dimensions qui intègrent forcement et
nécessairement le champ d'action du conseil de sécurité en
Afrique, et par là même les efforts et les opérations du
maintien de la paix sur ce continent.
Et comme le souligne d'ailleurs B.B Ghali, «les
opérations de maintien de la paix, on
fait preuve de leur importance; elles peuvent surveiller le
respect des modalités d'un accord
de paix, elles peuvent offrir aux combattants du
temps et une incitation à rechercher une paix durable, elles
peuvent fournir une aide humanitaire, et dans le cadre des nouvelles
formes des conflits, elles peuvent aider à reconstruire des
sociétés entières119».
Cependant, il s'est avéré que souvent ce
temps offert aux combattants par ses opérations et par
conséquent par le conseil de sécurité, permet d'accentuer
et d'alourdir le bilan de ces conflits africains. De même
qu'à l'instar de «restore Hope» ainsi que
l' «opération turquoise», il
apparaît que le conseil de sécurité, sinon ces
opérations de maintien de la paix par leur source, dérivent au
point que l'on vient à se demander. Quel est
le sens de ces O.M.Ps en Afrique ?; Où se situe la
légalité et où réside l'irrégularité
? Mais
115Ibid., Afrique relance, Message du
secrétaire général de L'O.N.U en date de 1999, sur
l'initiative spéciale pour la mise en oeuvre du nouvel ordre du jour
pour l'afrique.
(www.afrik.com ou
www.un.org)
116Le rapport en question est celui que nous avons
mentionné précédemment sous l`intitulé « les
conflits une réalité à laquelle il
faut faire face » qui date du 25 septembre 1997.
117Nouveau Partenariat Pour le Développement de
l'Afrique
118 UNHCHR, Central Africa, 2002
119 Ibid. Rapport de B.B Ghali, Pour la paix et le
développement : voir aussi Ibid. Société internationale
après la guerre froide, P
38
aussi, quel bilan pour la décennie 90, et quelles sont les
perspectives d'avenir pour l'Afrique notamment au regard du conseil de
sécurité ?.
C'est ce qui ferra l'objet de notre dernier chapitre sous
l'intitulé du Conseil de sécurité entre saisine et
auto-saisine des questions africaines.
CHAPITRE II
LE CONSEIL DE SECURITE ENTRE SAISINE ET AUTO-SAISINE
DES QUESTIONS
AFRICAINES
Le préambule de la charte des Nations Unies
dispose qu'afin de «préserver les générations
futures du fléau de la guerre [...], les Nations Unies unissent leurs
forces pour maintenir la paix et la sécurité
internationales120». A cette fin, elles
confèrent à titre principal cette responsabilité au
conseil de sécurité et précise qu'en
«s'acquittant des devoirs
qui incombe cette responsabilité», ce
dernier agit en leur nom121. Cependant, tout en
évinçant le spectre d'une guerre mondiale,
l'immédiat de l'après guerre froide a renfloué
l'idée d'un nouvel ordre mondial plus juste, plus
équitable et surtout plus sensible aux problèmes des plus
démunis. Dés lors en Afrique dont la conjoncture
socioéconomique est surtout marquée par une augmentation des
points de tensions et de violence, le conseil de sécurité
désormais libéré de l'emprise de l'antagonisme des
blocs, s'est vu multiplier les opérations de maintien de la
paix. C'est donc dans ce «new thinking»
généralisé que le
«conseil de sécurité quarante ans
débilité par les rivalités et la paralysie, focalise tous
les espoirs que l'on veut bien placer dans l'avènement de ce
nouvel ordre mondial122». Néanmoins à la
lecture des événements et des issues des conflits
africaines, une question s'impose:
Quel est l'impact de l'action du conseil de
sécurité sur l'Afrique ?
Ou en plus claire, Comment ce fait-il que jusqu'à
nos jours les conflits africains restent toujours presque sur le
même statu quo ?
Or pour répondre à cette interrogation, force est
de voir au préalable, LE CONTEXTE ET
LE SCENARIO GENERAL DES CONFLITS SUR CE CONTINENT
[SECTION I]; avant d'étaler le contenu des LES MISSIONS ONUSIENNES
EN AFRIQUE. [SECTION II ].
SECTION I :
CONTEXTE ET SCENARIO GENERAL DES CONFLITS
AFRICAINS.
A l'heure où le monde occidental célébrait
la chute du rideau de fer, et au moment où
la menace d'une guerre totale fait place aux espoirs d'une
communauté internationale plus
120120 Nous, peuples des Nations Unies,
résolus à préserver les générations futures
du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a
infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer
à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites, à créer les conditions
nécessaires au maintien de la justice et du
respect des obligations nées des traités et autres
sources du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et, à
ces fins,
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix
l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la
sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des méthodes
garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans
l'intérêt commun, à recourir aux institutions
internationales pour favoriser le progrès économique et social de
tous les peuples, avons décidé d'associer nos efforts pour
réaliser ces desseins. En
conséquence, nos gouvernements respectifs, par
l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville
de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
ont adopté la présente Charte des Nations Unies et
établissent par les présentes une organisation internationale qui
prendra le nom de Nations
Unies.
121 Ibid. Charte des Nations Unies, article 24, P
20.
122 Ibid. Nouvel ordre mondial et contrôle de
la légalité des actes du conseil de sécurité, P 12
et 13.
pacifiste et plus humanitaire, sinon plus
épanouie dans son corps composant, comme l'a souligné Kofi
Annan «la paix demeure cependant précaire dans de nombreuses
régions du monde. De plus, les processus de paix de diverses
régions [...], ont tendance à se dénouer
de façons douloureuses 123».
En effet, la disparition de la Guerre froide a lieu durant
les années 1989-1991 avec l'effondrement des régimes
communistes de l'Europe de l'est et l'implosion de l'URSS. Durant la
deuxième moitié de 1989 une série de révolutions
non violentes124 mettent fin aux régimes communistes des
démocraties populaires. Le 9 novembre 1989 le mur de Berlin
devenu sans objet s'est écroulé sous la liesse des retrouvailles
du peuple allemand. Plus rien
dès lors ne s'oppose à la réunification de
l'Allemagne qui a lieu le 3 octobre 1990. Pendant
que l'URSS se délite, Gorbatchev accepte le retrait des
soldats soviétiques125 et l'entrée de l'Allemagne
réunifiée à l'OTAN. Partout les communistes sont
évincés du pouvoir126, seul le
régime de Ceausescu semble résister en
Roumanie bien qu'une révolution violente s'y déroule
s'achevant par l'exécution du dictateur communiste le 25
décembre après une parodie de procès.
Dés 1990 des élections libres sont
organisées dans tous les pays d'Europe de l'Est. Finalement en
juin et juillet 1991 le CAEM127 et le Pacte de Varsovie sont
dissous précédant cette même année l'effondrement de
l'URSS le 25 décembre, laissant la place à la CEI128.
Et
de leur part, les occidentaux mettent en place en avril 1991 la
BERD129 afin de venir en aide
aux nouvelles démocraties.
De tout cela, Il résulte que les USA émerge
comme le seul gendarme capable du monde et le seul véritable
arbitre du nouvel ordre international.
Dans ce contexte, le tiers monde qui en majorité est
constitué par les pays africains, ne
pouvait échappé aux conséquences de tels
évènements. D'autant plus qu'avec l'O.N.U. qui
se trouve désormais libérée d'un droit de
veto abusif130, les brûlots de la Guerre froide vont
par conséquent trouver une solution forcement politique et
théoriquement pacifique.
Cela dit, la chute du mur de Berlin et l'éclatement de
l'Union soviétique ouvrirent soudain le champ à ce qui semblait
jusqu'alors d'impossibles règlements. Ce qui fait aussi
que des négociations pour la résolution
des conflits d'après-guerre froide en Afrique, se mirent en branle
à Luanda et à Maputo sous le patronage actif des Nations Unies,
bien que le régime communisant du colonel Mengistu à Addis-Abeba
ployait sous l'offensive conjointe
des fronts de libération du Tigre et
d'Erythrée. D'ailleurs ce dernier allait obtenir son
indépendance réclamée par les armes depuis plus de
vingt ans. D'autant plus qu'ailleurs l'union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola131 et la
Résistance Nationale du
123 Kofi Annan, Partnership For global community,
Nations Unies 1998.
124Sauf les évènements tragiques de
Roumanie un peu plus tard et l'éclatement de la Yougoslavie.
125 Qui prendra effet en1994.
126 Novembre 1989 en Bulgarie, puis
"Révolution de velours" en chécoslovaquie avec Vaclav Havel.
127 Conseil d'aide économique mutuelle Ou
Comecon, crée le 25 janvier 1949 entre l'URSS et les démocraties
populaires.
128 Communauté des Etats
indépendants
129 Banque européenne pour la reconstruction
et le développement
130 l'O.N.U. recevra d'ailleurs en 1988 le Prix Nobel
de la Paix
131 UNITA
Mozambique132, qui contestaient les
démocraties populaires mises en place par les mouvements de
libération de tendance marxiste avec le soutien de l'ex-URSS
et de l'ensemble de la mouvance tiers-mondiste, étaient devenus
en 1991 et 1992 des partis légalement reconnus133.
Dés lors l'Amérique démocrate soucieuse de
faire oublier les compromissions passées,
se pose en «parrain» des nouveaux
régimes d'Afrique australe et de la Corne, conduits par d'anciens
marxistes conquis à l'économie de marché. Ainsi une vague
de démocratisations secoua le continent de part en part avec
force. Conférences nationales, constitutions pluripartites,
élections,... tant de signaux fort paraissaient ouvrir pour
cette autre Afrique
une ère de renaissance avec le sentiment d'avoir enfin
soldé une génération après la vague des
indépendances des années 60.
Cependant on allait assister à des sommets d'horreur tout
long des événements futurs,
à l'instar de l'année 1994 avec le
génocide des Tutsis du Rwanda, et les affrontements au Burundi entre
Hutus et Tutsis, ainsi que les dernières affres
surréalistes du régime de Mobutu au Zaïre qui allait
bientôt être emporté par l'onde de choc de la
tragédie rwandaise dont les répliques se font encore sentir
jusqu'à nos jours dans toute l'Afrique centrale.
En somme on peut constater que le spectacle donné par
cette partie du continent fait balancer entre incrédulité et
désespérance comme en témoigne les cas suivants :
Mozambique: Moscou annonce en 1989 le retrait
des conseillers militaires soviétiques. Et dans la Corne de l'Afrique,
il exerce des pressions sur l'Ethiopie134 pour
qu'il cesse la guerre d'Erythrée qui fut une province rattachée
à l'Ethiopie et qui oppose depuis trente ans Addis Abeba au
F.P.LE135. un cessez-le feu sera signé en 1991
après le renversement de Mengistu.
Afrique du Sud: la libération de M.
Nelson Mandela considéré comme le «plus vieux prisonnier
du monde», la fin de l'apartheid et l'accession au pouvoir de la
majorité noire, signaient la fin d'une époque.
Angola: une «guerre de cent
ans» s'est de nouveau rallumée, signant un des
échecs
les plus retentissants de l'O.N.U. et de la communauté
internationale, dans un pays qui avait
été le théâtre sanglant d'un des
grands affrontements Est-Ouest des années 70 et 80, et où un
«siècle de paix» serait
nécessaire pour venir à bout du déminage136.
D'autant plus que le chef de guerre de l'UNITA, M. Jonas Savimbi qui avait
repris les combats pour le contrôle
des gisements de pétrole et de diamants après
avoir refusé d'admettre son échec à l'élection
présidentielle de septembre 1992, avait dû se
résoudre sous la pression internationale à souscrire en
1994 aux «accords de Lusaka» qui prévoyaient
la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et pour lui-même
un «statut spécial ».
132 RENAMO. ( un mouvements armés à
recrutement ethnique)
133 Ils ont pu de ce fait, conclure des accords de
paix qui prévoyaient des élections pluripartites sous
l'égide de l'Organisation des
Nations Unies.
134 le gouvernement Mengistu, s'était
rallié en 1982 au camp socialiste
135 Front de libération de
l'Erythrée
136 En août 1988, sous l'arbitrage des U.S.A,
est signé à Genève, entre l'Afrique du Sud, Cuba et
l'Angola et la Namibie un accord prévoyant un retrait des troupes
cubaines et sud-africaines de l'Angola et de la Namibie136. A propos
de la Namibie, les U.S.A et l'U.R.S.S conviennent, en mai 1988, d'appliquer la
résolution 435 du Conseil de sécurité de l'O.N.U . source
: LE MONDE DIPLOMATIQUE,AVRIL 1999 , P 16 et 17
url
:http://www.monde-diplomatique.fr/1999/04/LEYMARIE/11906
Congo: En proie à la vindicte des milices
à Brazzaville, le régime a fait nettoyer des quartiers à
l'arme lourde .
Somalie: le pays demeure fragmenté sans
Etat comme «hors du monde», malgré une dizaine de
tentatives de réconciliation en cinq ans.
Centrafrique et
Guinée-Bissau: des mutineries à
répétition ont surgi en dépit de tous
les cessez-le-feu mis en oeuvre.
Sierra Leone: des rebelles se vengent en coupant
les bras et les mains des civils alors
que dans une capitale en feu, des gouvernementaux interdisent
l'accès des salles d'opérations aux french doctors.
Océan indien: Iles sans cesse
batailleuses, l'archipel des Comores est secouée par des mouvements
sécessionnistes, tandis que dans une île Maurice couverte
d'éloges137, la colère
de la minorité créole laissée pour compte
éclate d'une façon sans précédente dans ce pays.
Algérie: l'horreur du terrorisme
islamiste s'est banalisée comme en témoigne le charnier
découvert le samedi 27 décembre 2003 dans l'ouest de ce
pays à Relizane, ville
située à 350 km à l'ouest d'Alger. Ce
charnier comportait des squelettes entiers de plusieurs
personnes dont la tête porte des gros orifices
creusés par des balles avec lesquelles ils ont été
exécutés dans les années 1995138.
Cependant et malheureusement, tous ces conflits
malgré l'euphorie d'espoirs que faisait naître cette fin de
la guerre froide, sont loin d'avoir disparu. Mais plus
inquiétant
encore reste le fait que certains s'éternisent et d'autres
sont apparus à la faveur de la détente entre les
grands139.
Force est donc de constater que dans l'ensemble un
scénario pareil ne pouvait et/ou
ne peut que contribuer à ancrer les problèmes
de paix et de la sécurité de ce continent au centre de
l'activité onusienne par là même au coeur de
l'action du conseil de sécurité140. D'autant plus
qu'à l'époque contemporaine, il n'y a guère de
problème qui n'aient pas une dimension internationale, d'où la
fortune du concept controversé de droit, voire de devoir
d'ingérence. Ceci n'est en fait qu'une des conséquences du
caractère interne de la majorité
des conflits africains comme nous l'avons évoqué
dans le chapitre précédent. Il paraît donc aisé de
comprendre la compétence du conseil de sécurité pour ce
genre de questions dont par nature, sont des questions internes, mais ayant un
impact sur la sécurité et la paix régionales voire
internationales. Ainsi, force est donc de se demander à quel moment un
conflit interne
en vienne à être considéré comme
une menace à la paix et à la sécurité
internationales ?. Ou aussi quel est le fondement de ce droit sinon de ce
devoir d'ingérence ? Et enfin, quelle est l'issue de ces conflits
africains dits internes face à l'action du conseil de
sécurité ?
Ainsi fait, il s'impose de voir tout d'abord: LE DILEMME DU
CONSEIL ET L'ISSUE DES CONFLITS AFRICAINS [A]; et ensuite: LE CONSEIL DE
SECURITE ET LE SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE L'O.N.U.[B].
137 Destination privilégiée du tourisme
international
138 Source : Conférence de presse de Hadj
Smain, représentant local de la Ligue Algérienne de
Défense des Droits de l'Homme
(LADDH), ALGER (AP), samedi 27 décembre 2003, 23h06
.
139 Source :
http://www.rabac.com, Relinter :
Éléments de mise en place du Monde Contemporain depuis la
moitié du XXème
siècle : Les nouveaux rapports internationaux dans le
Monde après la fin de la Guerre froide dans les années 90
140 Ibid. Basic facts, about the united nations, P
67.
A : LE DILEMME DU CONSEIL DE SECURITE ET ISSUE DES CONFLITS
AFRICAINS
Dans le chapitre précédent, il a
été souligné que depuis la création de
l'organisation de l'unité africaine141, la doctrine de
l'organisation des Nations Unies fut d'abandonner aux africains le soin
de régler eux-même leurs propres problèmes.
Cependant dans ce monde d'aujourd'hui marqué par
l'interdépendance croissante, il n'y a guère de problèmes
qui n'est
pas une dimension internationale. De plus, en
dépit de l'existence de ces préférences africaines
dans le règlement des conflits, bien qu'ils écartent si
fréquemment ou plutôt retardent grièvement
l'intervention onusienne, ces préférences africaines
n'excluent pas l'action du conseil de sécurité à qui
incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. D'autant plus que comme l'a fait
remarqué John Foster Dulles, «le conseil de
sécurité n'est pas un organe qui simplement applique le droit
convenu,
il est par lui-même un droit 142».
Ceci dit, en dépit de ces préférences africaines, en plus
de
sa compétence reconnue dans la charte des Nations Unies,
le conseil de sécurité s'est par sa pratique, reconnu une
compétence dont selon Mohammed Bedjaoui, est une compétence
qui
se base sur une interprétation de la
charte143.
Dans le cadre de sa compétence reconnue par la charte,
l'article 34 dispose que «le conseil de sécurité peut
enquêter sur tout différent ou toute situation qui pourrait
entraîner
un désaccord entre nations ou engendrer un
différent, afin de déterminer si la prolongation
de ce différend ou de cette situation semble devoir
menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales144». Dans ce sens, il parait
soutenable que le conseil de sécurité dispose d'un pouvoir
discrétionnaire pour déterminer cas par cas les situations qui
semblent devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Toutefois, appliquée aux cas africains depuis
1990, en dépit de l'incapacité de l'organisation de
l'unité africaine contrairement à certaines organisations
régionales occidentales145, il s'est avéré que
des réticences sont exprimés du moins tacitement par le
conseil quant à intervenir sur ces questions africaines.
Déplorablement, cette attitude de réticence a causé
et ne cesse d'engendrer de nombreuses victimes et dommages. Cela dit
aussi, qu'au terme de l'article 34 précité et à la lecture
des articles 37 et 39, force est de constater que bien qu'il ait recouvert le
plein exercice des ses compétences après la chute du communisme,
l'issue de ces conflits africains sinon le déroulement de l'action du
conseil de
sécurité face à ces derniers, laisse
apparaître un dilemme largement mesurable. Fâcheusement ce
dilemme est justifiable sur les termes mêmes employés par
ces articles dont en particulier l'article 34 qui parle de
«désaccord entre nations», contrairement aux
conflits africaines de cette dernière décennie qui comme nous
l'avons souligné ne sont dans leur vaste majorité que des
conflits internes.
141 De nos jours l'O.U.A a cédé la
place à l'U.A ( union Africaine)
142 John Foster Dulles, War or Peace, The Mac Milan
company, New York, 1950
143 Ibid. Nouvel ordre mondial et Contrôle de
la légalité des actes du conseil de sécurité.
144 Ibid. Charte des Nations Unies, article 34, P
24.
145 En l'exemple de l'OTAN qui a su s'imposer voir
évincer l'O.N.U. dans des conflits européens comme celui du
Kosovo en
1998.
Aussi, il est à noter que bien que divers
articles de la charte donnent pouvoir à l'Assemblée
générale et au secrétaire général de
faire des études et des recommandations concernant le maintien
de la paix146, l'article 36 indique clairement que
«le conseil de sécurité peut à tout moment de
l'évolution d'un différend de la nature mentionnée
à l'article
33 ou d'une situation analogue, recommander les
procédures ou méthodes d'ajustement
appropriés». Delà, il convient de faire deux
remarques:
Primo: l'article 33 par sa formulation relève
que le point de départ pour qu'un différend soit de
nature à menacer la paix et la sécurité
internationale, réside sur la prolongation de ce dernier. Cependant
plutôt que de renfermer nécessairement et préventivement
l'appréciation de cette prolongation dans un délai sinon
dans des signes distinctifs pour le conseil de sécurité,
cette prolongation reste de jure comme de facto à
l'appréciation discrétionnaire des parties concernées et
aussi du conseil de sécurité147. C'est
qui bien évidemment est un superflu quant on sait que la
fin envisager distinctivement par
les protagonistes, conditionne à elle seule tout en
outrepassant le droit conventionnel, l'arrêt sinon la continuité
d'un conflit. Dés lors on peut par conséquent comprendre
que sans interposition à défaut d'un compromis, un conflit
comme celui du Rwanda arrive à atteindre
de tels sommets de violence.
Secondo: Il est aussi à signaler que cet article 33
énonce certes un certains nombres
de mesures et de moyens à suivre pour parvenir aussi
efficacement que possible à un issue pacifique d'un conflit, mais il
apparaît que le facteur temps n'est pas pris en compte par ce dernier.
Pourtant l'expérience a montrée certes les mérites de ces
moyens pacifiques, mais également ses limites sinon ses risques
notamment face à un conflit qui se trouve déjà en phase
de «négociation par les armes».
De ce fait et à la lumière de ces articles, on
peut soutenir donc que certes la charte fidèle à ses
principes et a son attachement indéfectible à la
paix et à la sécurité internationales
privilégie fidèlement les moyens pacifiques et consensuels, mais
ces moyens
par leurs procédures qui sont assez longs par nature
laissent souvent persister périlleusement une situation qui n'a de
révérence que l'arrêt à temps des hostilités
armées.
Dans son paragraphe 2 le même article 33 dispose que
«le conseil de sécurité devra prendre en
considération toutes procédures déjà
adoptées par les parties pour ce différend». C'est fut
le cas notamment en 1991 dont suite à l'accord conclu entre M.P.L.A et
l'UNITA,
qui prévoyait entre autre l'appel à des
forces de l'O.N.U. pour garantir la régularité des
élections, l'O.N.U. a conduit son action de maintien de la paix en
Angola conformément à ce dernier148.
146 l'article 35 dispose dans ses paragraphes 1 et 2
que «tout membres de l'organisation peut attirer l'attention du
conseil de sécurité [...], sur un différend ou une
situation de la nature visée dans l'article 34»; de même
qu'«un Etat qui n'est pas membre
de l'organisation peut attirer l'attention du conseil de
sécurité [...], sur tout différend auquel il est partie
».
147 «Les parties à tout différend
dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationales doivent en rechercher le solution, avant
tout, par négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix».
148 Ibid. relations internationales africaines, P
97.
Toutefois par assortiment, les faits ainsi que les
dénouements de ces conflits africains appellent à une
réflexion quant au danger et aux conséquences du prolongement
d'un conflit sans que l'action du conseil de sécurité ne se
trouve mise en application. C'est dans ce sens
que lors de sa déclaration à la réunion
du conseil de sécurité en date du 24 janvier 2000, le ministre
des affaires étrangers canadien, l'honorable LLOYD AXWORTHY, s'exprimant
à propos de la commission d'enquête indépendante
chargée d'enquêter sur le comportement
de l'O.N.U. pendant le génocide commis au Rwanda
en 1994, soulignait que «l'enquête renforce l'importance
des questions africaines dans les activités du conseil de
sécurité et la crédibilité de celui-ci. Elle
explique comment le conseil néglige le continent à ses risques et
périls et décrit le prix épouvantable que les africains
paient en conséquence; elle expose tout cela clairement,
méthodiquement et de manière indélébile, à
tel point qu'il est difficile voire impossible au conseil de
sécurité de se dérober à son obligation de soutenir
la paix et la sécurité en Afrique ou de
l'ignorer149».
Cette déclaration assez réaliste s'appuie sur le
fait que comme l'a affirmé Jean Pierre
Lafon150 à propos de ce même conflit,
«les Nations Unies n'ont pas été sérieusement
saisies
du conflit au Rwanda qu'à partir du début de
l'année 1993». En fait, la première fois que le
Conseil de Sécurité exprimait son opinion sur la question du
Rwanda, Il invitait le Secrétaire général avec un luxe de
précautions qui allait beaucoup plus loin que ce qui était
souhaité, à
étudier en consultation avec l'organisation de
l'unité africaine la contribution que les Nations
Unies pourraient apporter en appui aux efforts de l'organisation
de l'unité africaine. Ceci dit
les Nations Unies n'étaient pas mises sur le
devant de la scène, mais que le conseil de
sécurité étudiait plutôt la possibilité
d'établir une force internationale sous les auspices conjoints de
l'O.U.A. et de l'O.N.U., chargée de l'assistance humanitaire, de la
protection des populations civiles. En outre Il était aussi
proposé que le Secrétaire général étudie la
création d'une force permettant le déploiement d'observateurs le
long de la frontière entre le Rwanda
et l'Ouganda. C'est ce qui arriva avec la
résolution 812, qui traduit en effet la première
implication des Nations Unies dans le conflit du Rwanda bien que c'est fut
à l'initiative de la France.151
A ce propos aussi, M Lafon tout en distinguant la
période précédent la signature des accords d'Arusha
intervenus le 04 août 1993 et la période d'entrée
en application de ces derniers jusqu'à l'assassinat le 06 avril 1994
du président rwandais ainsi que la période à compter du
07 avril 1994 qui a abouti au génocide, a déclaré que la
France avait entreprise la première à New York tout au
début du mois de mars 1993, les démarches nécessaires pour
impliquer l'organisation des Nations Unies dans la recherche d'un
règlement du conflit qu'était causé depuis un
certain nombre d'années par l'affrontement du front patriotique
rwandais et des forces gouvernementales rwandais. Il ajoute en outre que les
partenaires de
la France ont été saisies en négociations
informelles en mars 1993 et des instructions de la direction des Nations Unies
ont été envoyés à leurs ambassadeurs à
l'O.N.U à cet effet. Puis
149 Déclaration faite à la
réunion du conseil de sécurité des Nations Unies sur la
république du Congo, New York , 24 janvier 200. Source :
ministère des affaires étrangère et du commerce
internationale canadien
150 directeur du service des Nations Unies et des
relations internationales au ministère des affaires
étrangères française : (Il fut à ce poste de mai 89
à avril 1994).
151 Commission d'enquête parlementaire
française sur les opérations militaires au Rwanda entre 1990 et
1994 -Audition de
M. Jean-Pierre LAFON, directeur des Nations Unies et des
Relations internationales au ministère des Affaires
étrangères (mai
1989-avril 1994), source :
http://www.reseauvoltaire.net/
il a fait remarquer que c'est cette initiative française
qui fut à l'origine de cette résolution
812 du conseil de sécurité dans laquelle pour la
première fois jadis, le conseil de sécurité se montrait
gravement préoccupé par le conflit notamment par les
conséquences qu'ils pourrait avoir pour la paix et la
sécurité dans cette région ainsi que sur tout le
continent voire à l'échelle internationale152.
Plus délicat encore, M. Jean-Pierre Lafon a
indiqué que des réticences que pourra confirmer
l'ambassadeur auprès des Nations Unies avaient été
ressenties tant du côté du Secrétaire
général adjoint parce qu'il y avait des conflits interafricains
dont il avait minimisé
la gravité, que de la part de leurs partenaires
occidentaux à propos d'une implication des Nations Unies. Il
souligne enfin que la France avait été
étonnée de cette attitude du Secrétaire
général adjoint, dans la mesure où elle ne correspondait
pas à la prise de position
de M. Boutros Boutros-Ghali qui était très
conscient des dangers de la situation rwandaise.
Enfin, selon M. Jean-Pierre Lafon, l'ambassadeur français
aux Nations Unies avait rapporté
que «le représentant de la Grande-Bretagne
s'était interrogé sur l'opportunité qu'il y avait pour
l'Organisation des Nations Unies à agir au Rwanda et
estimait que la seule organisation concernée était
l'OUA. Les représentants du Japon, de l'Espagne et des Etats-
Unis s'étaient aligné en partie sur l'ambassadeur de
Grande-Bretagne». Pourtant, quelques jours plus tard, M. Boutros
Boutros-Ghali devait souligner comme il l'a toujours fait
d'ailleurs, que l'OUA n'avait aucune efficacité et aucune
crédibilité sur le terrain153.
Ainsi et comme pour tant d'autres questions similaires en Afrique
à partir de 1990, à l'instar de la question somalienne qui fut
largement soumise à l'appréciation
«discrétionnaire» de la puissance
américaine par la voie légitime du conseil de
sécurité, les conflits africaines que ce soit par le
déroulement de l'action du conseil de sécurité ou
de leurs issues, traduisent largement dans cette vue un dilemme du conseil de
sécurité.
Ce faisant en dépit de ce dilemme, il existe tout un
mécanisme qui concoure sinon qui pâlie à ce
défaillance. Tel le «système de
complémentarité » entre le conseil de
sécurité et
les autres organes du système onusien.
B : LE CONSEIL DE SECURITE ET LE SYSTEME COMPLEMENTAIRE
Fort de ses quinze membres, monopolisé par les
cinq permanents, le conseil de sécurité a comme principale et
unique tâche, de veiller au maintien de la paix et la
sécurité internationales. Ce faisant ce lourd tribut ne lui
revient pas à lui seul puisque par la simple lecture de la charte, il
apparaît que bien d'autres organes interviennent nécessairement et
aux besoins dans son champ d' action.
152 Ibid. Commission d'enquête parlementaire
française sur les opérations militaires au Rwanda entre 1990 et
1994 -Audition de
M. Jean-Pierre LAFON, directeur des Nations Unies et des
Relations internationales au ministère des Affaires
étrangères (mai
1989-avril 1994), source :
http://www.reseauvoltaire.net/
153 Ibid. Commission d'enquête parlementaire
française sur les opérations militaires au Rwanda entre 1990 et
1994 -Audition de
M. Jean-Pierre LAFON, directeur des Nations Unies et des
Relations internationales au ministère des Affaires
étrangères (mai
1989-avril 1994), source :
http://www.reseauvoltaire.net/
En effet, l'article 10 de la charte des Nations Unies dispose
que «l'Assemblée générale peut discuter toute
question ou affaire rentrant dans le cadre de la présente charte ou
se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes
prévus dans la présente charte154».
Cependant force est de constater que formulé ainsi, cet article assoit
une compétence générale à l'Assemblée
générale. Dès lors il n'est pas surprenant que
cette dernière s'immisce dans le champ d'action du conseil de
sécurité. Toute fois le même article ajoute que cette
dernière ne peut agir ainsi que «sous resserve des dispositions
de l'article
12». Or ce fameux article 12 dispose explicitement
dans son paragraphe premier que «Tant
que le Conseil de sécurité remplit à
l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les
fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte,
l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation
sur ce différend ou cette situation, à moins que le
Conseil de sécurité ne le lui
demande155». Ceci-dit, malgré sa
compétence générale, l'Assemblée
générale des Nations Unies ne peut s'occuper d'une
affaire rentrant dans le cadre du maintient de la paix et de la
sécurité internationales, tant que ce dernier ne se soit
pas dessaisi implicitement ou explicitement.
De plus, soulignons aussi que comme l'a précisé
d'une façon générale l'article 10 de
la charte, la compétence de l'Assemblée
générale dans ce cas précis se borne à
«formuler sur
ces questions ou affaires, des recommandations [...], au
conseil de sécurité». Et ici encore, force est de
remarquer que par la pratique cette compétence de l'Assemblée
générale dans ce domaine du maintien de la paix et de la
sécurité internationales se manifeste surtout en cas
d'impossibilité du conseil de s'acquitter de son devoir. Tel fut le cas
du temps de la guerre froide dont le conseil s'est trouvé
confronté systématiquement au problème du veto; par
conséquent son action en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationale s'est
vue paralysé d'où la résolution DEAN
ACHERSON qui a mit en avant ce rôle de
l'Assemblée générale en cas de paralysie du
conseil de sécurité.
Mais cette compétence qui d'ailleurs parait être
plus palliative que complémentaire à celle du conseil de
sécurité, n'est pas la seule à soutenir le conseil de
sécurité dans sa tache principale. Mais également on
retrouve celle du secrétaire général.
En effet dans un cadre plus administratif que politique qui
lui revient de son statut de secrétaire général de presque
tous les organes principaux de l'organisation excepté la cour
internationale de justice156, ce dernier intervient dans le domaine
du maintien de la paix et de
la sécurité internationales, faisant office
de secrétaire général du conseil de
sécurité et de l'Assemblée
générale157. A ce titre l'article 99 dispose
que «Le Secrétaire général peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui,
à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la
sécurité internationales158». Toutefois il
convient de souligner que cette possibilité ne lui ait pas
exclusive, car dans les mêmes terme l'Assemblée
générale peut elle aussi l'exercé. Mais
l'originalité de l'intervention du
154 Ibid. Charte des Nations Unies, P 11.
155 Ibid. charte des Nations Unies, P 13
156 l'article 98 de la charte dispose que « Le
Secrétaire général agit en cette qualité à
toutes les réunions de l'Assemblée générale,
du Conseil de sécurité, du Conseil
économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres
fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente
à l'Assemblée générale un rapport annuel sur
l'activité de l'Organisation ».
157 Ibid.
158 Ibid. P 61
secrétaire général dans ce cadre,
réside dans la pratique. En effet aussi, se basant sur de
l'article 98 de la charte, ce dernier a fait sien depuis le premier titulaire
de ce poste à celui d'aujourd'hui de focaliser pertinemment son action
dans le domaine du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Cet
état des choses se constate surtout à la lecture des divers
rapports annuels qu'ils présentent en l'exemple de celui de
Boutros B Ghali, intitulé symboliquement AGENDA POUR LA PAIX, Ou
celui qui porte comme titre: POUR LA PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT; de même que celui de l'actuel
secrétaire général qui s'intitule symboliquement: LES
CONFLITS, UNE REALITE A LAQUELLE IL FAUT FAIRE FACE159.
Mais plus consistant encore est le fait que les missions
de maintien de la paix bien qu'ils soient établies par le conseil de
sécurité, ils sont placés sous la coordination sinon le
contrôle du secrétaire général. Dés lors bien
que dans le cadre de cette section ça n'a qu'un intérêt
historique, il est significatif de rappeler que lors du conflit
congolais de 1960, le secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies trouva la mort dans le cadre de
l'exercice de ces fonctions160.
Notons enfin qu'en ce qui concerne le conseil
économique et social, l'article 65 de la charte dispose que ce
dernier «peut fournier des informations au conseil de
sécurité et l'assister si celui-ci le demande ».
Ceci est d'autant plus crucial dans ce cadre précis des
questions africaines à partir des années 90, étant
donné que la dimension socio-économique
et humanitaire sont surtout les plus critiques de tous
les conséquences de ces conflits africaines. C'est dans ce sens
qu'on retrouve de nos jours des organes subsidiaires voir des institutions
spécialisés qui interviennent eux aussi dans ce champ d'action du
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Parmi eux,
notons pertinemment et à titre indicatif le cas de
la C.N.U.C.E.D, qui depuis sa huitième session qui
s'est tenu à Carthagène en Colombie, sous le thème entre
autres du consensus sur le développement pour les années 90, a
mit en oeuvre un mécanisme de «conversion des capacités
militaires à des fins civils», qui sous tend
un réel volonté «d`analyser les
coûts et les avantages [...], devant permettre d'assurer la transition
en matière de désarmement161». Et
aussi, bien qu'elle s'inscrit dans le cadre purement
socio-économique, soulignons néanmoins que lors de cette session,
la Conférence
a consacré l'un de ses thèmes sur le
redressement économique et le développement de l'Afrique en
guise de «contribution à la mise en oeuvre du nouvel ordre du
jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans
les années 90162». C'est ainsi qu'
«un
159 Depuis, l'agenda pour la paix, de nos jours on
retrouve les rapports du secrétaire général sous cette
forme, tel l'agenda pour l'environnement, pour le développement, ...
(Pour les références voir la bibliographie.)
160 Lors de la crise du Congo en 1960, suite la
sécession Katanga, qui brisa l'unité afro-asiatique, et rend par
là même le
Secrétaire général Hammarskjöld
vulnérable aux attaques de l'U.R.S.S., qui l'accuse de « collusion
avec les puissances impérialistes » tout en réclamant
remplacement par « un organe exécutif collectif, composé de
trois personnes dont chacune représenterait un groupe
déterminé d'Etats » (Khrouchtchev à
l'Assemblée générale du 23 septembre 1961).
Hammarskjöld n'acceptant pas l'échec et cet état des choses
succomba à une crise cardiaque dans l'avion qui le conduit sur les lieux
d'une nouvelle négociation avec Tschombé. Par la suite, son
successeur U Thant a déclaré qu'il en était «
arrivé à se confondre avec
les buts et principes mêmes de la Charte des Nations Unies
» reçut le prix Nobel à titre posthume en 1961 : source :
Encyclopaedia universalis, (Biographie de Hammarskjöld
161 La Huitième session s'est tenue en 1992
à Carthagène (en Colombie) : Guide de la CNUCED, 30 ans au
delà, P 25, UNCTAD
1964-1994, Nations Unies 1994.
162 Ibid. P 37.
service de la C.N.U.C.E.D est spécialement
chargé d'étudier les questions intéressant
particulièrement les pays africains163.
Cependant le plus significatif de tous les organes
subsidiaires faisant partie du système complémentaire du
maintien de la paix et de la sécurité internationales en
Afrique est le comité d'état major, organe subsidiaire du
conseil de sécurité prévu explicitement par
l'article 47 de la charte164.
ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL DE SECURITE QUI PRENNENT PAR
AUX
QUESTIONS AFRICAINES AU 25 juillet
1998165:
1.COMITE POUR L'ADMISSION DE NOUVEAUX
MEMBRES
Historique : Ce Comité,
après s'être prononcé sur la plupart des demandes
d'admission aux
Nations Unies présentées entre mai 1946 et juillet
1947, n'a plus été appelé à intervenir dans
la procédure d'admission des nouveaux membres jusqu'en
février 1971 où il a repris son rôle
à l'occasion de la demande d'admission du Bhoutan. C'est
ainsi qu'il prit part également aux questions africaines au conseil de
sécurité à partir des années 90 lors de l'admission
la
Namibie le 23 avril 1990 et de l'Erythrée le 28 mai
1993.
Objectifs : Chargé d'examiner les
demandes d'admission à l'Organisation des Nations Unies
(article 59 du règlement intérieur provisoire du
Conseil de sécurité).
Composition: Les représentants de
tous les Etats membres du Conseil de sécurité.
Réunions selon les besoins.
2. COMITES DES SANCTIONS
Historique: Depuis 1946, le Conseil de
sécurité a créé plusieurs Comités
chargés de suivre
l'application de sanctions décidées à
l'encontre de pays membres : les 15 pays membres du Conseil de
sécurité y participent et élisent chaque année un
nouveau bureau qui se réunit en séances privées.
La présidence des Comités
est exercée, à titre personnel, par l'Ambassadeur d'un membre non
permanent du Conseil de sécurité.
Les vice-présidences sont
attribuées à des délégations et ne revêtent
aucun caractère
personnel.
A ).Comité créé par la
résolution 748 (1992) - Libye
Président: M. Türk
(Slovénie)
Vice-présidents : Portugal et
Gabon
163 Soulignons que dans ce sens, les nouvelles
orientations définies par la conférence à cette occasion,
portent notamment sur l'étude du développement durable, les
ressources financières et humaines pour le développement, le
commerce, les produits de base et la diversification des exportations des pays
africaine (Ibid.)
164 l'article 47 dispose « Il est
établi un Comité d'état-major chargé de conseiller
et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce
qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au
Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la
réglementation des armements et le désarmement éventuel.
»
165 Nb : le comité
d'état major, en vertu de l'article 47 de la charte, participe
systématiquement au maintien de la paix et
de la sécurité internationales une fois que
ce dernier comporte un volet militaire ou paramilitaire.
B ).Comité créé par la
résolution 751 (1992) - Somalie
Président: M. Buallay
(Bahreïn)
Vice-présidents : Costa Rica et
Gambie
C ).Comité créé par la
résolution 864 (1993) -Angola
Président: M. Mahugu (Kenya)
Vice-présidents : Costa Rica et
Japon.
D ).Comité créé par la
résolution 918 (1994) - Rwanda
Président:M. Hisashi Owada
(Japon)
Vice-présidents : Bahreïn et
Suède.
E ).Comité créé par la
résolution 985 (1995) - Liberia
Président: M. Fernando Berrocal
Soto (Costa Rica)
Vice-présidents : Japon et
Suède.
F ).COMITE CREE PAR LA RESOLUTION 1132 (1997) - SIERRA
LEONE
Président: M. Hans Dahlgren
(Suède)
Vice-présidents : Costa Rica et
Kenya
3. TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Historique : Institué le 8/11/94
par la résolution 955 du Conseil de sécurité agissant en
vertu
du chapitre VII de la Charte, en application des recommandations
du rapport rendu par la
Commission d'experts pour le
Rwanda166.
Objectifs : - Juger les personnes
présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les
citoyens rwandais présumés responsables de tels
actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er
janvier et le 31 décembre 1994.
Siège: Arusha (Tanzanie)
Bureau du Procureur : Kigali (Rwanda)
Fonctionnement : Composition :
définie conformément au statut adopté en annexe de
la résolution 955. Il s'agit d'une juridiction
indépendante, mais liée au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie : le procureur et les
chambres d'appel des deux tribunaux sont les mêmes.
1 - Le Procureur est le Procureur du
Tribunal pénal international pour l'ex- Yougoslavie : Mme Louise
Arbour (Canada) depuis le 1/10/96 ; elle a succédé à M.
Richard Goldstone (Afrique du Sud)167.
2 - Les deux Chambres de première instance, sont
composées de trois juges chacune.
Les juges : au nombre de 6, ont été
élus par l'Assemblée générale, les 24 et
25 mai 1995, pour un mandat de 4 ans sur une liste
présentée par le Conseil de sécurité : ils doivent
être
des personnes de haute moralité, possédant
les qualifications requises dans leur pays
respectif pour être nommés aux plus hautes fonctions
judiciaires ; il a été tenu compte de leur expérience en
matière de droit pénal et de droit international,
notamment de droit
166 Le Tribunal a commencé à
fonctionner au Siège à compter du 27/11/95.
167 Le Procureur-adjoint,
chargé, notamment, de la supervision du Bureau de Kigali, est
M.Muna (Cameroun).
international humanitaire et des droits de l'homme.168
(Bangladesh), Yakov A. Ostrovsky
(Russie) , Navanethem Pillay (Afrique du Sud) et enfin William H.
Sekule (Tanzanie)169.
En somme, on peut sans crainte soutenir que ce système
complémentaire comme le démontre l'histoire de ces diverse
institutions qu'on viennent de mentionner ci-dessous, est loin d'avoir
épuisé ses ressources et ceux pour deux raisons :
Primo : Les liens étroites et de plus en plus croissants
que tissent le maintien de la paix
et de la sécurité internationales ne cessent de
s'élargir touchant même des domaines dont il
n'y a pas longtemps on ne pouvait les concevoir que sous
l'optique du «domaine réservé de l'Etat» et
non du droit conventionnel. Tel par exemple les droits de l'homme et
les conditions désastreuses des après conflit.
Secondo: et comme conséquence de ce premier constat, les
organes composantes du
système onusien, que ce soit ceux dits
principaux, subsidiaires ou spécialisés voire aussi
autonomes, par la pratique ils tendent de plus en plus à instituer un
fonctionnement interne propre qui tend à prendre en considération
presque tous les secteurs des autres organes du système onusien,
comme en témoigne la préoccupation de la
C.N.U.C.E.D, organe subsidiaire de l'assemblée
générale des Nations Unies, qui a vocation principalement
économique et commerciale, à prendre en
considération et à contribuer aux problèmes du maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
Ceci dit, cette complémentarité tend en
quelque sorte vers une fusion et non une confusion, comme le laisse
entendre certains auteurs qui de nos jours avancent l'idée d'un conseil
de sécurité, économique et social à la place d'un
conseil de sécurité170.
Mais pour une bonne compréhension à cela, il
importe donc de s'intéresser aux situations sur le terrain, autrement
dit LES MISSIONS ONUSIENNES EN AFRIQUE.
SECTION II :
LES MISSIONS ONUSIENNES EN AFRIQUE.
Dans son article 42, la charte des Nations Unies
dispose que «le Conseil peut entreprendre toute action qu'il juge
nécessaire au maintien ou au rétablissement de la
paix». Toutefois et comme nous l'avons souligné plus
haut, durant le contexte particulier de la guerre froide le Conseil de
sécurité s'est trouvé confronté au problème
du veto et son action
en matière de maintien de la paix s'est vue
paralysée. Cependant la résolution 377 du 3
novembre 1950 de l'Assemblée Générale
"Union pour le maintien de la paix" dite résolution
168 Le Greffier est nommé par
le Secrétaire général pour un mandat de quatre
ans168.
169 La Chambre d'appel est
composée des cinq juges qui siègent également à la
Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
170 « La responsabilité de la gestion,
à l'échelle mondiale, du développement économique
et social, ainsi que des menaces qui
pèsent sur la paix et la sécurité
internationales, doit être partagée entre toutes les nations du
monde et devrait être exercée dans un cadre multilatéral.
Étant l'organisation la plus universelle et la plus
représentative qui existe dans le monde, l'O.N.U. a un rôle
central à jouer à cet égard. Pour traduire
ces valeurs communes en actes, nous avons défini des objectifs auxquels
nous attachons
une importance particulière » :Source :
STÉPHANE HESSEL,LE MONDE DIPLOMATIQUE | JUILLET 2003 , vers un
conseil
de sécurité économique et social, URL :
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/07/HESSEL/10235.
Dean Acheson, est venue pallier à ce problème en
cas de paralysie du Conseil de Sécurité171. Cette
dernière opère en effet un transfert de la
responsabilité du maintien de la paix à l'Assemblée
générale. Ce qui fait que dans cette hypothèse, à
défaut du conseil de sécurité, l'Assemblée
générale peut décider l'envoi d'une opération de
maintien de la paix sur tel ou
tel conflit172. C'est tout spécialement
à base de cette résolution, que l'Assemblée
Générale a décidé l'envoi d'une force de maintien
de la paix à la suite de la crise de Suez en créant la
F.U.N.U. dans cette période. Et cette force avait pour
mission de vérifier le retrait effectif des troupes et de pacifier la
région173.
Ce faisant à cette époque, les
opérations en question n'allaient avoir qu'un but modeste qui se
résume à la stabilisation de certaines situations conflictuelles.
Mais selon le
cas aussi, ils ont eu pour objectifs de superviser un
cessez-le-feu, de servir de tampon pour prévenir toute escalade, ou de
faciliter le retour à la normale. Dans tous les cas, leur
rôle
essentiel a été de geler momentanément un
conflit donné ou d'en contenir la violence dans certaines limites,
sans pour autant régler le problème ni même en
modifier les données fondamentales174. Mais si ces
opérations de maintien de la paix traduisent la remarquable
faculté d'adaptation de l'O.N.U175, elles n'en
reflètent pas moins les limites du rôle politique
de l'Organisation dans ce monde unipolaire176.
En effet dans le contexte de son renouveau politique
favorisé par la nouvelle politique multilatérale pratiquée
par l'U.R.S.S. depuis 1987, l'O.N.U. a connu une double évolution
positive marquée par un retour à l'idéal de la
sécurité collective et par une mutation dans les fonctions
exercées jusque là par les Casques bleus. D'autant plus
qu'à la suite de l'invasion
du Koweït par l'Irak en août 1990, l'O.N.U. est
parvenue à mettre en oeuvre les dispositions
du chapitre VII de la Charte que l'on croyait inapplicables.
Ainsi d'août à novembre 1990, le
Conseil de sécurité a agi pour la
première fois dans son histoire, comme un véritable
directoire et assumé pleinement ses responsabilités statutaires.
Dès l'invasion du Koweït et
conformément au grand rite de la sécurité
collective, il a condamné sans appel l'agresseur et
conféré à la victime la légitimation
morale ainsi que le soutien politique de la communauté
internationale177.
C'est de ce retour espéré et durable que
les missions des casques bleus se sont développées dans
une direction qualitativement nouvelle. Ainsi depuis 1990 diverses
opérations ont combiné des fonctions de maintien de
la paix et des fonctions de
171 la saisine de l'Assemblée se fait soit par
l'Assemblée elle-même par un vote à la majorité de
ses membres , soit à la demande
du Conseil de Sécurité par un vote affirmatif de
neuf quelconques de ses membres. Voir l'Article 18 de la charte des Nations
Unies.
172 Soulignons tout de même qu'en principe,
les opérations de maintien de la paix sont établies par le
conseil de sécurité et sont dirigés par le
secrétaire général ou souvent ses représentants
spéciaux. Les aspects militaires sont quant à eux sous le
contrôle du
comité d'état major.
173 la crise de Suez a eu lieu en 1956.
174 En 1967, le départ des troupes
onusiennes stationnées à la frontière
Egypto-israélienne depuis 1956 (retrait effectué à
la demande de l'Egypte) entraîna aussitôt le déclenchement
de la guerre dite de Six Jours .
175 Problème soulevé au Section deux du
chapitre préliminaire
176 C'est néanmoins pour rendre hommage
à leur contribution spécifique que le prix Nobel de la paix a
été décerné en 1988 aux
Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix.
177 Faisant preuve d'une cohésion sans
précédent, il a adopté - à l'unanimité ou
à la quasi-unanimité , un ensemble de douze décisions
décrétant des sanctions économiques (résolution
661), un blocus naval (résolution 666) ainsi qu'un blocus
aérien (résolution 670) et, par ailleurs, fixé un
délai de quarante-sept jours avant l'application de sanctions militaires
(résolution 678).
rétablissement de la paix sous l'appellation commune
de missions de maintien et de rétablissement de la paix ou plus
générique encore, de missions de maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Dans cette
foulée, certains pays membres de l'O.N.U. en sont venus
à proposer de confier aux casques bleus de nouvelles
fonctions allant de la surveillance d'élections libres à
l'administration provisoire d'un Etat souverain178, en passant
par la lutte contre le terrorisme ou l'aide aux pays victimes de
catastrophes naturelles.
Dés lors les opérations de maintien de la paix ont
ainsi connu une évolution, passant
des opérations de maintien de la paix au sens strict
comme ce fut le cas pour les opérations basées sur le chapitre
VI de la Charte et qui respectaient les trois principes à
savoir: le consentement, l'impartialité et l'interdiction de
faire usage de la force sauf en cas d'autodéfense, à
des opérations de soutien, d'assistance et avec l'apparition de
l'ingérence humanitaire des opérations «
militaro-humanitaires». De là on retrouve une extension
du
rôle de ces opérations qui doivent désormais
consolider la paix en favorisant la démocratie et
la tenue d'élections libres, en désarmant les
factions rivales, en protégeant les droits de l'homme, et en
acheminant de l'aide humanitaire. De plus, désormais ils peuvent
être mises
en place en dépit de la volonté de l'Etat sur le
territoire duquel se déroule l'opération. Tel fut
le cas par exemple en Somalie et au Rwanda au tout début
et au milieu des années 90.
Mais dans l'ensemble, force est de constater que les missions
onusiennes en Afrique
ne dérogent pas au cadre générale de la
sécurité collective. Cependant les spécificités
des conflits africains de cet après guerre froide, invitent à
distinguer ces missions de ceux qui se déroulent un peu partout
ailleurs179. De plus, étant donnée le contexte
particulier des conflits africains qui se caractérise surtout par la
précarité des conditions de vie sinon la faiblesse de l'Etat
africain ou plus généralement du sous développement, il
va de soit que le maintien de
la paix sur cette partie du monde comporte une touche toute
particulière.
C'est en ce sens que des initiatives comme l'UNISA ou
le NEPAD qui se sont construites parallèlement et qui se
déroulent conjointement avec ces missions de maintien de
la paix et de la sécurité en Afrique [A], rendent
comptes des spécificités de ces derniers. Il
en est de même de la déclarations du
millénaire dans laquelle on trouve un volet spéciale pour
l'Afrique sous l'intitulé: Répondre aux besoins spéciaux
de l'Afrique. [B].
A : LES MISSIONS ONUSIENNES EN AFRIQUE DANS LE CADRE DU
MAINTIEN DE LA PAIX
Le bilan de cette dernière décennie en
matière de maintien de la paix en Afrique a incité les
Nations Unies à se consacrer plus que jamais à la consolidation
de la paix, l'action visant à soutenir les structures qui renforceront
et consolideront la paix. En effet depuis 1990
178 C'est fut le cas pour le Cambodge
179 On peut distinguer deux types de conflits en
Afrique qui s'attache à cet après guerre froide : les conflits
«régionaux» qui sont incarnés en Afrique par la
question du Sahara occidental; Et les conflits «Purement
Internes» qui s'attachent surtout à des questions de
Rébellion, d'appartenance ethnique voir aussi sur fond de
problèmes socio-économiques tel qu'ils sont misent en avant dans
le cadre de la déclarations du Millénaire et qui sont
représentés par le cas extrême du Rwanda et de nos
jours la situation en Côte d'Ivoire.
à nos jours l'expérience a montré que le
maintien de la paix, s'il se limite à la prévention de conflits
ne suffit pas à instaurer une paix solide et durable180.
Voir le tableau suivant :
Données générales des missions
onusiennes en Afrique, de 1990 à 2000.
|
Pays ou région
|
Nom abrégé de la mission
|
Durée
|
Effectif global
|
Effectif max.
|
Nom de l'opération et mandat
|
|
Angola
|
UNAVEM I
Rés
626 (1988)
|
1989
1991
|
70
|
?
|
Mission de vérification des Nations Unies en
Angola. Vérifier le retrait des troupes cubaines
|
|
Namibie
|
GANUPT
Rés
435 (1978)
|
1989
1990
|
4 500
1 500 pol civ
|
301
100 pol civ
|
Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de
transition en Namibie. Aider à la transition vers
l'indépendance
|
|
Angola
|
UNAVEM II Rés
696 (1991)
|
1991-
1994
|
350
|
15
|
Mission de vérification des Nations Unies en
Angola. Surveiller le cessez-le-feu
|
|
Sahara occidental
|
MINURSO Rés
690 (1991)
|
1991-
|
375
64 pol civ
|
34
6 pol civ
|
Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara occidental. Surveiller le cessez-le-feu
|
|
Afrique du
Sud
|
UNOMSA
|
1992
|
60
|
?
|
Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud.
Observer la période préélectorale.
Personnel de l'O.N.U. seulement
|
|
Mozambique
|
ONUMOZ
|
1992-
1995
|
7 500
|
15
|
Opération des Nations Unies au Mozambique. Assurer la
sécurité, surveiller le déminage et les cessez-le-feu
|
|
Somalie
|
UNITAF
|
1992-
1993
|
37 000
|
1 410
|
Force multinationale. Distribuer des secours
|
|
Somalie
|
UNUSOM I Rés 751 (1992)
|
1982
1993
|
937
|
12
|
Opération des Nations Unies en Somalie. Détacher du
personnel au quartier général
|
|
Libéria
|
UNOMIL
|
1993-
|
303
|
0
|
Mission d'observation des Nations Unies au Libéria.
Surveiller la mise en oeuvre de l'Accord de paix
|
|
Rwanda, Ouganda
|
Rés
846 juin 1994
|
1993-
1994
|
100
|
3
|
Mission d'observation des Nations Unies en Ouganda et au Rwanda.
Vérifier que l'on ne fait pas passer d'approvisionnements militaires au
Rwanda.
|
|
Rwanda
|
MINUAR
|
1993-
1996
|
5 900
90 pol civ
|
430
1 pol civ
|
Mission d'assistance des Nations Unies au Rwanda. Aider le
gouvernement en transition en vue des élections. Aider le commission
d'enquête sur le trafic d'armes
|
|
Somalie
|
UNOSOM II
|
1993-
1995
|
28 000
|
9
|
Opération des Nations Unies en Somalie. Distribuer des
secours
|
|
Afrique du
Sud
|
Mission du
Commonwealth
|
1994
|
?
|
2 pol civ
|
Aider le mission du Commonwealth
|
|
Tchad
|
GONUBA Rés
915 mai 1994
|
1994
|
9
|
0
|
Groupe d'observateurs des Nations Unies dans la bande d'Aouzou.
Surveiller le retrait de l'administration libyenne
|
|
|
|
|
|
Force multinationale pour le Zaïre orientale.
|
180 Question déjà étudiée
au chapitre précédent : ( Section II du Chapitre I, les
corollaires du maintien de la paix en Afrique)
|
Zaïre
|
FMN
|
1996
|
452
|
452
|
Faciliter le retour des agences humanitaires, le livraison de
l'assistance, et le rapatriement des réfugiés
|
|
Ethiopie, Erythrée
|
MINUEE
|
2000-
2002
|
12,000
|
450
|
Force multinationale et observateurs
|
Notes : Pel Civ = Personnel civil.
? = donnée non définie.
Des conflits sur le terrain et d'une analyse
croisée avec ce tableau on constate donc que dans la foulée de
son processus de paix en Afrique, que ce soit face aux conflits ou aux
impératifs humanitaires voir à la mise en place des structures
étatiques après
que les hostilités se sont tues, le conseil de
sécurité depuis la fin de la guerre froide jusqu'à
nos jours n'a jamais cessé de se consacrer aux
questions africaines. Cependant étant donné qu'une
présentation exhaustive du cas par cas de ses questions
africaines aux conseil de sécurité dépasserais le
cadre temporel de ce travail, néanmoins il convient de faire
une précision sur quelques unes de ses missions et opérations du
conseil de sécurité en Afrique dans cette dernière
décennie.
Tenant compte de la prolongation ainsi que de son
déroulement effectif tout au long
des années 90 et au-delà, sélectivement la
situation du Sahara occidental nous parait assez illustratif et ceux aussi
à cause de son caractère interne pour certains des acteurs
à ce conflit,
et externe pour les autres voir aussi du fait du risque
supposable de déboucher sur un
embrasement de la région mettant du même
coup en cause la paix régional voir internationale.
Et étant donné que dans le chapitre et les
sections précédents nous avons pu apercevoir le contenu et
le déroulement du conflit rwandais qui soulignons le incarne
le
point culminant des catastrophes humanitaires, des violences
ethniques ainsi que du manque d'effectivité pour ces missions des
Nations Unies en Afrique à partir des années 90, par
conséquence et par similitude ainsi que pour rester dans
l'actualité, le conflit qui perdure de
nos jours en côte d'ivoire ne peut que s'imposer.
SAHARA OCCIDENTAL 181:
Le Sahara occidental est un territoire qui se situe sur la
côte Nord-Ouest de l'Afrique, limitrophe du Maroc, de la Mauritanie et de
l'Algérie. Il était sous administration espagnole jusqu'en 1976.
par la suite, le Maroc et la Mauritanie l'ont tous deux
revendiqué; revendication à laquelle s'oppose le Front populaire
pour la libération de la Saguía-el-Hamra
et du Río de Oro, dit Front POLISARIO.
Les Nations Unies ont cherché un règlement
de la question du Sahara occidental depuis que l'Espagne s'est
retirée du territoire en 1976 d'autant plus que suite à cela, des
combats ont éclaté entre le Maroc qui a décidé
de "réintégrer" le Sahara occidental à son territoire,
et le Front POLISARIO, soutenu par l'Algérie.
La Mauritanie a quant à elle renoncé à toute
prétention sur le Sahara occidental en 1979182.
181 voir aussi l'avis consultatif de la CIJ en date
de 1975 ,
Url :
http://www.lawschool.cornell.edu/library/cijwww/cijwww/cdecisions/csummaries/csasommaire751016.htm
182 L'Organisation de l'unité africaine (OUA)
est également intervenue en 1979 pour trouver un règlement
pacifique au conflit.
En 1985, le Secrétaire général des Nations
Unies a entrepris, en coopération avec l'Organisation de l'unité
africaine, une mission
Le 27 juin 1990 le Conseil de sécurité a
approuvé le rapport du Secrétaire général en date
du 18 juin 1990 contenant le texte intégral des Propositions de
règlement ainsi qu'un Plan de règlement mis au point par ce
dernier. Le 29 avril 1991, dans sa résolution 690, le Conseil de
sécurité a décidé de créer la Mission des
Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental conformément aux indications données dans le rapport
du Secrétaire général du 19 avril dans lequel le Plan de
règlement était présenté en détail.
Le Plan de règlement également appelé Plan
de mise en oeuvre, ménageait une période
de transition pendant laquelle le représentant
spécial du Secrétaire général, agissant sous
l'autorité de celui-ci, serait seul responsable de toutes les questions
relatives au référendum
par la voie duquel le peuple sahraoui choisirait entre
l'indépendance et l'intégration au
Maroc. Son contenu est le suivant :
- Surveiller le cessez-le-feu.
- Vérifier la réduction des troupes marocaines sur
le territoire.
- Surveiller la consignation des troupes marocaines et du
Front
POLISARIO dans des emplacements convenus.
- Veiller à la libération de tous les prisonniers
et détenus politiques sahraouis;
- Superviser l'échange des prisonniers de guerre
(Comité international de la
Croix-Rouge).
- Exécuter le programme de retour des
réfugiés (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés).
- Identifier et inscrire les électeurs habilités
à voter.
- Organiser un référendum libre et équitable
et en proclamer les résultats.
Le représentant spécial serait assisté
dans sa tâche par un adjoint et par un Groupe intégré
composé de civils, de militaires et de policiers civils de l'O.N.U., qui
constituerait la M.I.N.U.R.S.O. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés a été chargé du programme de
rapatriement pour les Sahraouis dont la qualité d'électeurs avait
été établie et
qui souhaitaient retourner dans le territoire. La
période de transition devait commencer au moment de l'entrée
en vigueur du cessez-le-feu et se terminer avec la proclamation des
résultats du référendum.
Il était prévu que la MINURSO devrait compter de
800 à 1000 agents civils selon les besoins des différentes
phases de la période de transition, environ 1 700 soldats et
observateurs militaires, et 300 fonctionnaires de police. D'après
le Plan de règlement, le référendum au Sahara
occidental aurait dû avoir lieu en janvier 1992. Il n'a toutefois pas
été possible de respecter le calendrier initialement
prévu. Le 24 mai 1991, le Secrétaire général
mettant son Plan à exécution a proposé un cessez-le-feu
commençant le 6 septembre. Les deux parties ont accepté. Les
trois mois suivants ont cependant fait apparaître qu'il serait
impossible de terminer avant le 6 septembre un certain nombre de travaux qui
devaient être achevés au moment du cessez-le-feu. Il est
également devenu évident qu'en dépit de l'acceptation
des parties des divergences de vues persistaient entre elles sur un
certain nombre de points importants. L'une des parties a de ce fait
refusé que la période de
de bons offices qui a abouti aux Propositions de règlement
acceptées en principe par le Maroc et le Front POLISARIO le 30
août
1988.
transition commence le 6 septembre 1991183.
Entre-temps les hostilités avaient éclaté dans
le territoire et avaient mis un terme à un armistice de
fait qui durait depuis plus de deux ans. Dans ces circonstances, le
Secrétaire général a décidé que le
cessez-le-feu officiel entrerait
en vigueur le 6 septembre comme convenu, étant
entendu que la période de transition commencerait sitôt
achevées les tâches en suspens. Le Conseil de
sécurité a retenu la proposition du Secrétaire
général consistant à déployer d'ici là 100
observateurs militaires
sur le territoire afin de vérifier le cessez-le-feu et
la cessation des hostilités dans certaines zones. L'effectif des
observateurs militaires a ensuite été porté à
228 hommes et du personnel de soutien logistique et administratif a
également été envoyé sur place. La MINURSO
avait pour mission principale de vérifier le cessez-le-feu et
la cessation des hostilités. Le quartier général de
la MINURSO a été installé à Laayoune et des
postes de commandements régionaux dans les secteurs Nord et Sud du
territoire. Un bureau de liaison
a également été établi à
Tindouf, qui permettait de rester en relation avec les
autorités
algériennes et le Front POLISARIO. Ainsi depuis
le déploiement de cette mission en septembre 1991, le
cessez-le-feu a été en règle générale
respecté mais la période de transition n'a pas encore
commencé jusqu'à nos jours, étant donné que les
parties ont des vues divergentes sur certaines dispositions centrales des
Propositions de règlement, dont en particulier les critères
de définition des électeurs pouvant participer au
référendum. Toutefois et malgré ces difficultés,
les parties continue à se dire engagées à mettre en
oeuvre
le Plan de règlement. Et la MINURSO quant à
elle, rempli le mandat qui lui avait été confié dans la
mesure où la situation le lui permettait. De son
côté le Secrétaire général et ses
représentants spéciaux ont poursuivi leurs efforts afin de
trouver une solution acceptable par
les deux parties. Ce processus a conduit à des
révisions successives du Plan de règlement et
du calendrier initialement prévu.
La Commission d'identification de la M.I.N.U.R.S.O a
été établie en mai 1993. En août 1994,
après avoir terminé le travail de préparation -
notamment s'être assuré de la coopération des
parties, la M.I.N.U.R.S.O a commencé le processus
d'identification et d'inscription des électeurs. Du fait des
difficultés procédurales et opérationnelles
rencontrées, l'identification des électeurs a
procédé lentement et les efforts entrepris pour
résoudre le différend entre les parties n'ont pu aboutir. En
l'absence de tout progrès du Plan
de règlement, le Secrétaire général a
recommandé en mai 1996 de suspendre le processus d'identification, ce
qui a entraîné le retrait du personnel civil de la MINURSO, et
notamment
de la composante police civile chargée d'assurer la
sécurité et d'aider la Commission d'identification. La
composante militaire est restée déployée sur le terrain
afin de surveiller
et de contrôler le cessez-le-feu, conformément
à son mandat.
Au début de 1997 le Secrétaire
général a intensifié les efforts entrepris pour
régler de manière satisfaisante les principaux points litigieux.
Ainsi une série de pourparlers directs entre les parties a pu être
organisée, sous les auspices de l'Envoyé personnel du
Secrétaire général. A l'issue favorable des derniers
pourparlers, le Secrétaire général a pu constater
dès
le mois de septembre l'entrée en vigueur des accords
conclus au cours des pourparlers. C'est d'ailleurs sur sa recommandation, que
ce processus d'identification a repris en décembre
1997. Malgré un certain nombre de
difficultés, l'identification des individus habilités
à
183 La partie en question est la Maroc.
participer au référendum à l'exception
des requérants appartenant à trois groupements tribaux,
s'est achevé le 3 septembre 1998. Cela dit, les parties n'ont
pas été capables d'arriver à un consensus sur la
façon de procéder pour les requérants membres des
trois groupements tribaux souhaitant se présenter individuellement.
Afin de faire avancer le processus, le Secrétaire
général a présenté en octobre 1998 un ensemble de
mesures aux parties, parmi lesquelles figuraient un protocole sur
l'identification
de ceux des requérants membres des groupements
tribaux qui souhaiteraient se présenter individuellement et un
protocole sur les procédures de recours. Le Front POLISARIO a
accepté l'ensemble des mesures proposées le mois suivant tandis
que le Gouvernement du Maroc ne l'a accepté en principe qu'en mars 1999
après avoir demandé des clarifications.
L'identification de ceux des requérants membres
des trois groupements tribaux a repris le 15 juin 1999. En ce qui
concerne les individus identifiés en 1994, 1995 et de
décembre 1997 à septembre 1998, les procédures de recours
ont débuté le 15 juillet lors de la publication de la
première partie de la liste provisoire des électeurs. Cette liste
incluait 84
251 noms d'individus habilités à voter sur
147 249 requérants identifiés. Durant les six semaines
correspondant à la période de recours pour le groupe 94-95/97-98,
la Commission d'identification a reçu 79 000 recours.
L'identification des requérants membres des trois
groupements tribaux s'est achevée fin
décembre 1999. Sur 51 220 requérants qui se sont
présentés, 2 130 ont été habilités
à voter. La période de recours pour les individus de la
seconde partie de la liste provisoire a commencé le 15 janvier et s'est
poursuivie pendant six
semaines.
Bien que le processus d'identification ait pu être
mené à bien, les parties continuent à avoir des vues
extrêmement divergentes en ce qui concerne les procédures
de recours, le rapatriement des réfugiés et plusieurs
autres points fondamentaux du Plan. Le Secrétaire
général a demandé à son Représentant
spécial de poursuivre les consultations qu' il avait
engagées avec les parties en vue de tenter de concilier leurs positions
divergentes.
|
MINURSO en chiffre.184
|
|
Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un
référendum au Sahara Occidental
Depuis avril 1991
|
|
Importance:
|
|
|
militaires;
|
208
|
|
policiers civils;
|
25
|
|
Civils internationaux;
|
166
|
|
civils locaux
|
123
|
|
Nombre total de pertes en vies humaines:
|
10
|
|
Crédits autorisés entre juillet 2002 à juin
20/03
|
$US 43.4 millions de dollars (montant brut)
|
184 Source :Département de l'information,
DPI/2286--02-61111--décembre 2002--10M , (c) 2002-2003 Les Nations
Unies
Cependant dans un entretien publié en décembre
2001, par le quotidien algérien
''Al Khabar'', M. Messahel, ministre
délégué algérien chargé des questions
africaines, a soutenu que ''l'Algérie a milité depuis un
quart de siècle pour que le peuple sahraoui puisse exercer son droit
à l'autodétermination et à l'indépendance''
; mais que ''les efforts de la communauté internationale qui
ont abouti aux accords d'Houston'' , à l'heure actuelle
l'application de ces accords ''se heurte à des obstacles
dressés par le Maroc''. ''C'est partant
de ces convictions que l'Algérie s'est
opposée et continue à s'opposer au contenu de
l'accord-cadre qui ne vise autrement que l'intégration du Sahara
Occidental à l' occupant Marocain, sans tenir compte de la
légalité internationale et violant aussi les droit
légitimes
du peuple sahraoui'', a-t-il martelé. En
revanche, a ajouté le ministre, et dans le but de surmonter
les obstacles dressés devant le règlement juste et
définitif du conflit du Sahara Occidental, ''l'Algérie a
soutenu les efforts du l'Envoyé Personnel du Secrétaire
général de l'O.N.U. en vue de mettre en ouvre les accords de
Houston''185. C'est dans ce sens que ce conflit revêt un
caractère typiquement juridique.
En ce qui concerne la position du conseil de
sécurité, il convient de la récapituler par ces quelques
résolutions:
Bien que deux résolutions concernant cette situation
ont été prisent respectivement dont la résolution
658 en date du 27 juin 1990 ainsi que résolution 725 du 31
décembre
1991, c'est avec la résolution
référencée S/RES/690 (1991), du 29 avril 1991 que le
Conseil
de sécurité a établi la M.I.N.U.R.S.O et
a demandé aux deux parties de coopérer pleinement avec le
Secrétaire général à la mise en oeuvre de
son plan de règlement186 par la suite, divers
résolutions on été adoptés par le conseil, allant
de la prolongation au renforcement du mandat de cette mission. Tel fut le cas
par exemple de la résolution 690 adoptée en 1995 amis aussi et
surtout la résolution 1033 adoptée par le Conseil de
sécurité sur le référendum pour
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et le processus
d'identification. La résolution 1056 elle, s'inscrit dans
l'année 1996. Pour l'année 1997, notons la
résolution
1133, la résolution 1131 et la résolution
1108. En 1998, la résolution 1215, la résolution
1204, la résolution 1198, la résolution 1185 , la
résolution 1163 et en fin la résolution 1148, sont assez
démonstratives. Quant à l'année 1999, la
résolution S/RES/1224 du 28 janvier
1999, aux termes de laquelle le Conseil de sécurité
a entre autre, prolongé le mandat de la
MINURSO jusqu'au 11 février 1999 est assez
représentative. Puis vient la résolution : S/RES/1228
(1999), 11 février 1999 aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a entre autre, prorogé le mandat de la MINURSO
afin que puissent se tenir des consultations dans l'espoir et dans l'attente
d'un accord sur les protocoles relatifs aux activités
d'identification,
de recours et de planification du rapatriement, ainsi que
sur la question essentielle du calendrier de mise en oeuvre. Par la suite
viendra, la résolution S/RES/1232 (1999), 30 mars
1999 aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a entre autre, prorogé le mandat de la
MINURSO pour permettre de parvenir à un accord entre tous
les intéressés sur des modalités détaillées
d'application des protocoles relatifs à l'identification et à la
procédure de recours ;
la résolution S/RES/1235 (1999), 30 avril 1999 aux termes
de laquelle le Conseil de sécurité
a prorogé le mandat de la MINURSO et a demandé au
Secrétaire général de le tenir informé
185 Source :Sahara Press Service, SPS 001,
RASD/ALGERIE, Messahel: Nous rejetons la 3ème voie'' , le 12
décembre 2001.
186 Section du Site Internet des Nations
Unies et la Section de la paix et de la sécurité du
Département de l'information en coopération avec le
Département des opérations de maintien de la paix. (c) Nations
Unies 2003
de tout fait nouveau important concernant l'application du Plan
de règlement et de la viabilité
du mandat de la MINURSO. La résolution S/RES/1238
(1999), 14 mai 1999 aux termes de laquelle le Conseil de sécurité
a entre autre, prorogé le mandat de la M.I.N.U.R.S.O afin de relancer
l'opération. Et enfin, la résolution S/RES/1263 (1999), 13
septembre 1999 aux termes de laquelle le Conseil de sécurité a
décidé de proroger le mandat de la M.I.N.U.R.S.O
et a entre autre, prié le Secrétaire
général de continuer à régulièrement rendre
compte des
faits nouveaux d'importance concernant l'application du Plan
de règlement d'identification, ainsi que la résolution
S/RES/1282 (1999), 14 décembre 1999 aux termes de laquelle le
Conseil de sécurité a décidé de proroger le
mandat de la M.I.N.U.R.S.O et a entre autre, approuvé la
poursuite de consultations engagées avec les parties en vue de tenter de
concilier leurs positions divergentes mérite aussi d'être
mentionner.
Pour cette nouvelle décennie, tout commence avec la
résolution S/RES/1292 (2000),
29 février 2000 aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a décidé de proroger le mandat
de la M.I.N.U.R.S.O jusqu'au 31 mai 2000 et a
appuyé l'intention manifestée par le Secrétaire
général de demander à son Envoyé personnel
de prendre l'avis des parties et d'étudier les moyens de parvenir
à un règlement rapide, durable et concerté de leur
différend. Puis viendra la S/RES/1301 (2000), 31 mai 2000 aux
termes de laquelle le Conseil de sécurité a
décidé de proroger le mandat de la M.I.N.U.R.S.O jusqu'au
31 juillet 2000, en
comptant que les parties présenteront à
l'Envoyé personnel du Secrétaire général des
propositions précises et concrètes sur lesquelles elles
pourraient s'entendre afin de régler
les multiples problèmes auxquels se
heurte l'application du Plan de règlement. La
S/RES/1309 (2000), 25 juillet 2000 aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a décidé de proroger le mandat de la
MINURSO jusqu'au 31 octobre 2000, en comptant que les parties
se rencontreront pour des pourparlers directs sous les
auspices de l'Envoyé personnel du
Secrétaire général pour tenter de
résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte
l'application du Plan de règlement. La S/RES/1324 (2000), 30
octobre 2000 aux termes de
laquelle le Conseil de sécurité a
décidé de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 28
février 2001 en comptant que "les parties
continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes
auxquels se heurte l'application du Plan de règlement et d'essayer de se
mettre d'accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de
leur différend".
Pur l'année 2001 on notera : La résolution
S/RES/1342 (2001), du 27 février 2001
aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a décidé de proroger le mandat de
la MINURSO jusqu'au 30 avril 2001 en comptant que "les parties continueront
de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte
l'application du Plan de règlement et d'essayer de se mettre d'accord
sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur
différend au sujet du Sahara occidental". La S/RES/1349 (2001), 27
avril 2001 aux termes
de laquelle le Conseil de sécurité a
décidé de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au
30 juin 2001 "en comptant que, sous les auspices
de l'Envoyé personnel du Secrétaire général,
les parties continueront de tenter de résoudre les multiples
problèmes auxquels se heurte l'application du Plan de
règlement et d'essayer de se mettre d'accord sur un
règlement politique mutuellement acceptable de leur
différend au sujet du Sahara occidental". La S/RES/1359
(2001), 29 juin 2001 aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a décidé de proroger le mandat de
la MINURSO jusqu'au 30 novembre 2001 et, entre autres, "appuie
pleinement les efforts que fait le Secrétaire général pour
inviter toutes
les parties à se rencontrer face à face ou dans
des pourparlers indirects, sous les auspices
de son Envoyé personnel" et la
S/RES/1380 (2001), 27 novembre 2001 aux termes de laquelle le Conseil de
sécurité a décidé de proroger le mandat de la
MINURSO jusqu'au 28 février 2002 et prie le Secrétaire
général de le tenir informé de tout fait nouveau important
dans un rapport intérimaire présenté au plus tard
le 15 janvier 2002, et de faire à son intention le point de la
situation au plus tard le 18 février 2002.
En 2002 :
S/RES/1394 (2002), 27 février 2002 aux termes de laquelle
le Conseil de sécurité a décidé de proroger le
mandat de la MINURSO jusqu'au 30 avril 2002.
S/RES/1406 (2002), 30 avril 2002 aux termes de
laquelle le Conseil a décidé de proroger le mandat de la
MINURSO jusqu'au 31 juillet 2002 afin d'examiner plus avant le rapport du
Secrétaire général en date du 19 février 2002.
Et enfin, S/RES/1429 (2002), 30 juillet 2002 aux
termes de laquelle le Conseil a décidé de proroger le
mandat de la MINURSO jusqu'au 31 janvier 2003 et entre autres
déclare qu'il "Continue d'appuyer énergiquement les
efforts déployés par le Secrétaire
général et son Envoyé personnel pour trouver une solution
politique à ce différend de longue date, invite l'Envoyé
personnel à poursuivre ces efforts " .
Durant l'année dernier, on a pu comptabilisé quatre
résolutions :
S/RES/1463 (2003), 30 janvier 2003 aux termes de
laquelle le Conseil a décidé de proroger le mandat de la
MINURSO jusqu'au 31 mars 2003 afin de donner aux parties le temps d'examiner la
proposition qui leur est présentée par l'Envoyé personnel
du Secrétaire général.
S/RES/1469 (2003), 25 mars 2003 aux termes de laquelle
le Conseil a décidé de proroger le mandat de la MINURSO
jusqu'au 31 mai 2003 et prie le Secrétaire général de
présenter un rapport sur la situation avant le
19 mai 2003, comme le Secrétaire général l'avait
proposé dans sa lettre datée du 19 mars 2003,
adressée au Président du Conseil de sécurité.
S/RES/1485 (2003), 30 mai 2003 aux termes de laquelle
le Conseil a décidé de proroger le mandat de la MINURSO
jusqu'au 31 juillet 2003 pour pouvoir examiner de plus près le rapport
du Secrétaire général en date du 23 mai du même
année
Et la S/RES/1495 (2003), 30 juillet 2003 aux termes de
laquelle le Conseil a entre autres, décidé de proroger le
mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2003 et demande
aux parties de travailler avec l'O.N.U., l'une avec
l'autre en vue de l'acceptation et de l'application du Plan de paix.
Et pour cette année en cours, bine que d'autres n'y
manquerons de venir par la suite, notons à ce jours la
Résolution 1523 adoptée dernièrement concernant cette
regrettable situation qui perdure au Sahara occidental.
CÔTE D'IVOIRE :
Le 3 mai 1990, le président Félix
Houphouët-Boigny au pouvoir depuis
l'indépendance en 1960, accepte le multipartisme: 9
partis politiques d'opposition sont légalisés le 31. Le 28
octobre, le président Houphouët-Boigny qui est pour la
première fois
confronté à un adversaire lors d'une
élection présidentielle, obtient son septième mandat
avec 81,68 p.100 des suffrages. Le candidat de l'opposition Laurent Gbagbo,
chef du Front populaire ivoirien (F.P.I.), recueille 18,32 p. 100 des voix. Le
taux d'abstention est de 30,84 p.100. Le 25 novembre, les
premières élections législatives depuis
l'instauration du multipartisme donnent la majorité au Parti
démocratique de Côte d'Ivoire (P.D.C.I., ancien parti unique),
avec 163 sièges sur 175. Le F.P.I. obtient 9 sièges et
le Parti ivoirien des travailleurs (P.I.T.), 1. Les 2 autres sièges
reviennent à des candidats indépendants. Le taux d'abstention
s'élève à près de 60 p. 100.
Le 13 février 1992, à Abidjan une centaine de
membres de la Fédération estudiantine
et scolaire de Côte d'Ivoire et son secrétaire
général Martial Ahipeaud, sont interpellés par la police.
Ils manifestaient contre l'impunité des responsables des violences
commises en mai
1991 dans la cité universitaire de Yopougon. Le rapport de
la commission d'enquête relative
à ces violences rendu public le 29 janvier, mettait en
cause le général Gueï chef d'état-major
de l'armée. Le 18 de ce mois, une manifestation
organisée dans la capitale par le F.P.I. pour réclamer la
démission du général Gueï
dégénère en émeute; 300 personnes sont
arrêtées dont Laurent Gbagbo et René
Dégny-Ségui, président de la Ligue ivoirienne des
droits de l'homme. Ils sont condamnés le 6 mars à 2 ans
de prison ferme. Martial Ahipeaud a été condamné en
février à 3 ans de prison ferme.
Le 24 juillet du même année, le président
Houphouët-Boigny annonce l'amnistie des prisonniers politiques. La loi
d'amnistie votée le 29 concerne 75 opposants politiques, dont Laurent
Gbagbo et René Dégny-Ségui, mais bénéficie
aussi aux militaires responsables des violences perpétrées
à l'université de Yopougon. Le 7 décembre 1993,
c'est le décès du président Félix
Houphouët-Boigny.
Et en application de la Constitution Ivoirienne, le
président de l'Assemblée nationale Henri Konan
Bédié se proclame président. Il doit assumer ses fonctions
jusqu'au terme du mandat en cours en septembre 1995. Le 9, le Premier
ministre Alassane Ouattara, qui conteste la légitimité du
nouveau président, démissionne. Le 11, le président Henri
Konan Bédié nomme un technicien, Daniel Kablan Duncan, à
la tête du gouvernement. Le 15, celui-
ci forme un cabinet auquel les 2 principaux partis d'opposition,
le F.P.I. et le P.I.T., refusent
de participer.
Le 20 septembre 1995 le gouvernement interdit toute
manifestation en raison des violences qui se multiplient à
l'approche des élections présidentielle et législatives.
Le 22 octobre le président Henri Konan Bédié, candidat du
P.D.C.I., est élu à la tête de l'Etat avec
96,44 p.100 des suffrages. Les 2 grands partis d'opposition, le
F.P.I. de Laurent Gbagbo et le
Rassemblement des républicains (R.D.R.) de Djény
Kobina, avaient appelé au «boycottage actif»
du scrutin afin de protester contre la modification du code
électoral qui empêchait
l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, candidat
du R.D.R. et principal rival du
président sortant, de se
présente187r. Le taux de participation n'est que de
56,03 p. 100. Le
26 novembre, le P.D.C.I. remporte 148 des 172
sièges attribués lors des élections
187 C'est sur fond de cette attitude
érigé en concept « D'ivoirité » que va
s'articule l'escalade des violences qui jusqu'à nos jours sont entrains
de détruire ce pays.
législatives. Le R.D.R. en obtient 13 et le F.P.I., 11.
L'opposition avait accepté de participer
au scrutin en contrepartie de la révision des
listes électorales. Toutefois, la loi électorale interdisait
à Djény Kobina et à Alassane Ouattara de se
présenter et l'élection dans la circonscription où
Laurent Gbagbo était candidat est reportée.
er
Le 1
Le 29 décembre, Laurent Gbagbo est élu
député lors d'élections partielles.
janvier 1997 le secrétaire général du
F.P.I., Abou Drahamane Sangaré, emprisonné
depuis un an, est libéré. Le 23 décembre
1999 des soldats qui exigent l'amélioration de leurs conditions de vie
descendent dans la rue à Abidjan et occupent divers lieux
stratégiques. Le
24, les mutins appellent le général Robert
Gueï ancien chef d'état-major à participer aux
négociations avec le pouvoir. Ils exigent la libération des
dirigeants du Rassemblement des républicains, le parti de l'ancien
Premier ministre Alassane Ouattara, auquel le pouvoir conteste le droit
de se présenter à l'élection présidentielle
prévue en octobre 2000 et qui vit
en exil. Constatant l'échec des négociations.
Par la suite, le général Gueï annonce la destitution
du président Bédié, la dissolution des institutions
et la création d'un Conseil
national de salut public. Le 26, le président
Bédié est évacué vers Lomé dans un
hélicoptère militaire français. Le 27, le
général Gueï propose aux partis politiques de lui
fournir des hommes susceptibles de participer au futur gouvernement. Ils
répondront tous favorablement. Le 29, Alassane Ouattara regagne son
pays.
Les 4 et 5 juillet 2000, des unités de l'armée
se mutinent à Abidjan et en province, exigeant le versement du
«butin de guerre» que leur aurait promis le
général Gueï pour leur participation au coup d'Etat de
décembre 1999. Après le retour au calme, moyennant
promesse du versement d'une prime, le général Gueï
accuse «certains politiques» d'avoir préparé
un «coup d'Etat». Le 23, le projet de Constitution
élaboré par la junte, en vue du retour des civils au pouvoir
est approuvé par référendum. Le 22 octobre, le
scrutin présidentiel auquel ni Alassane Ouattara ni aucun candidat du
P.D.C.I. n'a été autorisé à se présenter,
se déroule en l'absence d'observateurs internationaux. Le taux
de participation serait d'environ 40 p.100. Le 24, Robert Gueï se
proclame élu après que la junte a dissous la commission
électorale qui annonçait la victoire de Laurent Gbagbo,
avec 51 p.100 des suffrages.
Le 25, des dizaines de milliers de manifestants hostiles
à la junte investissent le palais présidentiel. Les forces
armées se rallient à Laurent Gbagbo. Ce dernier fait proclamer
les résultats par la commission électorale. Toutefois les
partisans d'Alassane Ouattara exigent
un nouveau scrutin. Le 26, alors que Laurent Gbagbo est investi
président de la République,
des affrontements entre militants du F.P.I., originaires de
l'Ouest chrétien et du
R.D.R. originaires du Nord musulman, font plusieurs dizaines de
morts.
Le 1er décembre, la Cour suprême
rejette la candidature aux élections législatives d'Alassane
Ouattara. Le R.D.R. annonce qu'il ne participera pas aux législatives.
Il appelle
ses partisans à une «marche nationale de
protestation», le 4, en direction d'Abidjan, marche
qui est interdite par les autorités. Les 4 et 5, des
dizaines de milliers de partisans d'Alassane
Ouattara affrontent les forces de l'ordre à Abidjan. Le
bilan officiel des violences s'élève à
une vingtaine de morts. Le 10, le F.P.I. remporte 96
sièges sur 225 lors des élections législatives; le
P.D.C.I., 77. Le taux de participation est de 33 p.100 seulement. Le 8
janvier
2001, les forces loyalistes mettent fin à la
sixième tentative de coup d'Etat militaire depuis
les 13 derniers mois. Le 25 mars, les élections
municipales se déroulent dans le calme. Le
R.D.R., qui avait boycotté les précédents
scrutins, l'emporte dans 64 municipalités sur 195.
Le P.D.C.I. s'octroie 58 municipalités. Le F.P.I. n'en
obtient que 34. Le taux de participation n'est que de 41 p.100. Le 1er
décembre, Alassane Ouattara en exil en France depuis un an,
rentre dans son pays. Le 13, les autorités lui
reconnaissent finalement son «ivoirité », qui
doit lui permettre de se présenter aux scrutins électifs.
Le 10 août 2000, mandatés par leurs pairs
de l'O.U.A., les présidents béninois et togolais effectuent
une mission de bons offices à Yamoussoukro pour tenter
d'apaiser la situation intérieure. la fin du mois de septembre,
à l'approche de l'élection présidentielle, 10 chefs d'Etat
de pays voisins se rendent à Abidjan pour une ultime
médiation188.
En bref, soulignons que comme pour le Rwanda et tant d'autres
cas africain, malgré cette détérioration
systématique et la situation critique marquée par ces
lots de morts épisodique, l'O.N.U, sinon le conseil de
sécurité n'a commencé à se préoccuper
effectivement de la Côte d'Ivoire qu'a partir de l'année 2003. et
pourtant, selon d'Amnesty International qui est vivement
préoccupée par la recrudescence d'atteintes majeures aux
droits humains, aux exécutions sommaires, aux enlèvements,
"disparitions" et aux tortures et mauvais traitements qui se pratiquent, depuis
le 19 septembre 2002, ce pays fait face à une
des plus graves crises de son histoire.
Seuls les forces militaires françaises et
l'opération Licorne ont assumé le rôle d'une
force d'interposition puis de surveillance du respect du cessez-le-feu
accepté le 17 octobre
par les deux parties au conflit; forces se réclamant du
groupe d'opposition armée MPCI189 et
les forces armées gouvernementales190.
D'autant plus que depuis le 30 octobre du même année, des
négociations sont menées à Lomé par le
président togolais Eyadema sous l'égide
de la CEDEAO entre les représentants de la
rébellion armée et le gouvernement ivoirien. Mais cela n'a
pas pu empêcher l'évolution de la situation en mi-janvier 2003.
Le 5 décembre, un charnier de plusieurs dizaines
de corps à l'instar de ceux découvertes en Somalie ,au
Rwanda, Burundi, témoigne des souffrances endurées par la
population vivant en Côte d'Ivoire. Plus grave explique Amnesty, ce que
de façon répétée
des violations du cessez-le-feu entraînent des massacres
et des déplacements de civils. le 31 décembre, les forces
gouvernementales ivoiriennes bombardent le village de pêcheurs de
Menakro au nord de la ligne de cessez-le-feu faisant une dizaine de victimes.
De même que
des accrochages sérieux ont eu lieu entre les forces
françaises de l'Opération Licorne et les
groupes rebelles du front ouest MPIGO, MLP, non signataires
alors de l'accord de cessez-le- feu. La perspective d'une participation aux
négociations proposées par la France a décidé ces
deux mouvements d'insurgés à signer à leur tour une
trêve des combats le 13 janvier 2003 à Lomé.
188 Source : Encyclopaedia universalis,
L'actualité du côte d'ivoire 1990 à 2001.
189 Mouvement Patriotique de la Côte
d'Ivoire
190 Cette trêve et la ligne de front
reposent sur un fragile équilibre. Les Etats appartenant
à la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest) ont décidé de la mise en place prochaine d'une force
d'interposition ouest-africaine.
Le 11 décembre, la France décide de
renforcer son dispositif miliaire qui, à la fin décembre
compte près de 2 500 hommes. Au terme d'un nouveau voyage en Côte
d'Ivoire du Ministre Dominique de Villepin, les 3 et 4 janvier, la
diplomatie française a obtenu des engagements du pouvoir et des
rebelles du MPCI. Un agenda de sortie de crise fixé par la France a
été accepté: le 15 janvier, réunion de toutes les
forces politiques ivoiriennes et une semaine plus tard, un sommet des
chefs d'Etat africains en présence de Kofi Annan,
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le départ des mercenaires, l'immobilisation des
hélicoptères ont été demandés et promis
par le Président Gbagbo. Promesse très incertaine car le 9
janvier, l'armée gouvernementale allait mitrailler un village
le long de la frontière libérienne.
Il a fallu donc attendre jusqu'au 20 décembre du
même année, pour que Dans une déclaration, le Conseil
de sécurité de l'O.N.U. se prononce explicitement en
invitant les belligérants à trouver une solution politique
négociée pour résoudre la crise, bien qu'une
délégation du Haut Commissariat de l'O.N.U. aux Droits de l'Homme
avait déjà mené une mission en Côte d'Ivoire fin
décembre 2002. Entre temps, de déviation en évolution,
à l'issue
des négociations de Marcoussis (22 janvier 2003), un
accord a été accepté par
tous191:reconnaissant Laurent Gbagbo en tant que Président
et la constitution d'un gouvernement transitoire de Réconciliation
Nationale. La mise en oeuvre de ces accords est difficile car le climat est
surtout marqué par des manifestations de soutien au pouvoir mais
hostiles aux accords de Marcoussis et à la France, assassinat
d'un opposant politique, nombreuses exactions dans l'ouest, démolition
d'habitations à Abidjan,...
Cependant, la communauté internationale maintient
la pression sur le Président Gbagbo pour enclencher l'application
des accords porteurs de la réconciliation nationale. Deux
résolutions du Conseil de sécurité de L'O.N.U. apportent
un soutien fort à ces accords
et donnent un mandat international aux forces armées
d'interposition françaises et africaines, avec la possibilité
d'usage de la force pour assurer la protection des civils se trouvant sur le
sol ivoirien. Simultanément la France envoie de nouveaux
renforts militaires192 tout en ayant proposé le retour
à ses ressortissants.
Ainsi, pour la position est l'attitude du conseil de
sécurité, notons «Près d'un an et 6
mois après la rébellion des forces
opposés au président Gbagbo, le conseil de
sécurité a décidé vendredi 25 mars 2004,
de créer l'Opération des Nations Unies en
Côte
d'Ivoire(ONUCI). La résolution 1528 des Nations
Unies prévoit le déploiement de 6240
Casques bleus à compter du 4 avril. Bien
que favorable à cet intervention, le président Gbagbo exige
dès le mois de mars le désarmement des forces en présence.
De son côté, l'ex- rébellion exige au préalable un
calendrier des reformes politiques et militaires de la part du
gouvernement193».
En bref, depuis le début de cette crise à ce moment
précis où nous écrivons ces lignes,
le conseil de sécurité a adopté sept
résolutions :
191chefs d'Etat de la CEDEAO, Union Africaine, Union
Européenne, Secrétaire général des Nations Unies.
Un consensus a été trouvé lors du sommet de Kléber
, 25 et 26 janvier 2003
192 450 soldats et 250 gendarmes
193 Ibrahima Dramé ,'La Côte d'Ivoire
sous tutelle internationale',
http://www.saphirnet.info. (article
paru le 03 mars 2004)
La Résolution 1514 (2003) ; la Résolution 1498
(2003) ; la Résolution 1479 (2003) ;
La Résolution 1464 (2003) ; la Résolution 1528
(2004) ainsi que cette dernière (résolution
1527) portant création de l'ONUCI.
Cette situation bien qu'elle soit similaire à tant
d'autres en Afrique, est d'autant plus inquiétante au point que le chef
des forces nouvelles194, Guillaume Soro a appelé le samedi

27 mars, la communauté internationale à
intervenir en Côte d'Ivoire pour assurer la fin des violences tout en
prévenant que le président Laurent Gbagbo "respir(ait) l'air de
ses derniers jours au pouvoir"195.
Tel propos ne manque de sens pour ceux qui croient encore
à ce pays, à ce continent et enfin cet autres Afrique qui
aspire à des lendemains meilleurs, tel qu'il figure tout
particulièrement et tout spécialement dans la déclarations
du millénaire.
B : LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE DANS LA DECLARATION DU
MILLENAIRE, VU DU CONSEIL DE SECURITE
147 chefs d'Etat et de gouvernement sur les 189 Etats membres de
l'organisation
des Nations Unies, représentant les pays riches et les
pays du sud196, ont participé du 6 au 8 septembre 2000,
à New York, au Sommet du Millénaire. La réunion
s'est terminée par l'adoption d'une "Déclaration du
Millénaire" dans laquelle les dirigeants de la planète ont
"décidé" notamment "de réduire de
moitié, d'ici à 2015, la proportion de la population
mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour,
celles des personnes qui souffrent
de la faim".
Et Profitant de cette occasion, les pays du sud ont appelé
les puissances occidentales à annuler en totalité la dette des
pays les plus pauvres.
Cependant, le principal défi que ce sommet a retenu et
auquel les Nations Unies ont à faire face aujourd'hui est de faire
en sorte que la mondialisation devienne une force positive pour
l'humanité entière, tel qu'il est affirmé par la
déclaration qui propose la réduction du fossé entre
pays riches et pauvres, par un meilleur partage des
bénéfices de la mondialisation, et rappelle également
l'engagement des Etats à promouvoir la démocratie
et l'Etat de droit. Ce document fixe aussi, parmi les
objectifs à atteindre au cours de cette décennie en cours, la
réduction des trois quarts de la mortalité maternelle et la
diminution
des deux tiers de la mortalité des enfants de moins
de cinq ans; la mise en place d'un accès facilité à
l'éducation de base de tous les enfants de la planète; la
maîtrise de la pandémie du sida et du "fléau du
paludisme". Soulignant entre autres que plus de 1,2 milliards
d'hommes
et de femmes vivent dans la plus grande
pauvreté avec moins de un dollar par jour,
194 Ex-rébellion
195 Côte d'Ivoire: Guillaume Soro
réclame une intervention internationale pour assurer la fin des
violences , samedi 27 mars 2004. Source : Url :
http://fr.rd.yahoo.com/news/article/rs1/*http://fr.news.yahoo.com/2
196 Les pays du sud regroupent près de la
moitié des 6 milliards de la planète, vivant avec moins de deux
dollars par jour

essentiellement en Asie du sud et en Afrique, un
continent ravagé par les guerres et le fléau
du sida qui y fera 40 millions d'orphelins en 2010.
C'est ainsi, qu'à l'issue de ce Sommet, Kofi Annan,
secrétaire général de organisation,
a souligné l'atmosphère de consensus qui a
prévalu entre les Etats membres au cours de la session par ces mots
:« Je suis frappé par l'extraordinaire convergence de vues sur
les défis
auxquels nous sommes confrontés, vous avez
dit que votre première priorité est
l'éradication de la pauvreté extrême. Vous avez
énoncé des objectifs pour y parvenir. [...] Si
ces mesures sont vraiment mises en oeuvre, nous savons tous
que le but peut être atteint ».
Ce faisant, le contenu de cette déclaration
adoptée à la 54éme session de
l'Assemblée générale baptisée pour l'occasion
Assemblée du Millénaire, du 6 au 8 septembre 2000
à New York, se résume aux huit points suivant :
I. Valeurs et principes, II. Paix, sécurité et
désarmement, III.Développement et élimination de la
pauvreté, IV. Protéger notre environnement commun, V. Droits de
l'homme, démocratie et bonne gouvernance, VI. Protéger les
groupes vulnérables,
VII. Répondre aux besoins spéciaux de
l'Afriqueet enfin, VIII.Renforcer l'Organisation des
Nations Unies.
Toutefois, bien qu'il lui soit réservé tout
particulièrement un volet à lui seul, l'Afrique
est également concerné par les autres points
de cette déclarations étant donnée que dans
l'ensemble, cette dernière a une portée
générale.
Ainsi, pour le premier volet (Valeurs et principes),
l'Assemblée souligne d'entrée l'importance de l'organisation
comme étant l'un des «fondements indispensables d'un monde plus
pacifique, plus prospère et plus juste », et ajoute qu' en
plus des responsabilités propres qu'ils doivent assumer à
l'égard de leurs sociétés respectives, ils sont
collectivement tenus de défendre au niveau mondial, les principes de
la dignité humaine, de l'égalité et de
l'équité.
Et en tant que dirigeants, ils ont donc des devoirs à
l'égard de tous les citoyens du monde,
en particulier les personnes les plus
vulnérables, et tout spécialement les enfants, à
qui l'avenir appartient. Ainsi ils se sont résolus à
instaurer une paix juste et durable dans le monde entier
conformément aux buts et aux principes inscrits dans la Charte. Par la
suite on
peut lire ceci : «nous réaffirmons notre
volonté de tout faire pour assurer l'égalité
souveraine de tous les Etats; le respect de leur intégrité
territoriale et de leur indépendance politique; le règlement
des différends par des voies pacifiques et conformément
aux principes de la justice et du droit international; le droit à
l'autodétermination des peuples
qui sont encore sous domination coloniale ou sous
occupation étrangère; la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats; le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; le respect de l'égalité des
droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion; et une coopération
internationale en vue du règlement des problèmes internationaux
à caractère économique, social, culturel ou
humanitaire . Nous sommes convaincus que le principal défi que nous
devons relever aujourd'hui est de faire en sorte
que la mondialisation devienne une force positive pour
l'humanité tout entière. Car, si elle offre des
possibilités immenses, à l'heure actuelle ses bienfaits
sont très inégalement répartis, de même que
les charges qu'elle impose. Nous reconnaissons que les pays en
développement et les pays en transition doivent
surmonter des difficultés particulières pour

faire face à ce défi majeur. La
mondialisation ne sera donc profitable à tous, de
façon
équitable, que si un effort important et soutenu est
consenti pour bâtir un avenir commun fondé sur la condition que
nous partageons en tant qu'êtres humains, dans toute sa
diversité.
Cet effort doit produire des politiques et des mesures,
à l'échelon mondial, qui correspondent aux besoins des pays
en développement et des pays en transition et sont
formulées et appliquées avec leur participation effective
».
Et plus loin, parlant de la solidarité, la
déclaration du millénaire affirme que «Les
problèmes mondiaux doivent être gérés
multilatéralement et de telle façon que les coûts
et

les charges soient justement répartis
conformément aux principes fondamentaux de
l'équité
et de la justice sociale. Ceux qui souffrent ou qui sont
particulièrement défavorisés méritent
une aide de la part des privilégiés
». quant aux partage des responsabilités, la
déclaration indique que «La responsabilité de la
gestion, à l'échelle mondiale, du
développement
économique et social, ainsi que des menaces
qui pèsent sur la paix et la sécurité
internationales, doit être partagée entre toutes les nations du
monde et devrait être exercée dans un cadre multilatéral.
Étant l'organisation la plus universelle et la plus
représentative
qui existe dans le monde, l'O.N.U. a un rôle central
à jouer à cet égard. Pour traduire ces valeurs communes
en actes, nous avons défini des objectifs auxquels nous
attachons une importance particulière ».
Ce faisant le plus consistant et le second volet qui
s'intitule symboliquement: Paix, sécurité et
désarmement. En effet, les 147 chefs d'Etat et de gouvernement
affirment explicitement dans cette volet, qu'ils «n'épargnerons
aucun effort pour délivrer nos peuples
du fléau de la guerre, qu'il s'agisse des guerres
civiles ou des guerres entre Etats, qui ont coûté la vie à
plus de 5 millions de personnes au cours de la dernière
décennie». C'est dire
que le cadre des conflits internes qu'on percevait comme
un «obstacle», notamment à
l'action du conseil de sécurité tend
à être dépasser `une façon solennelle. Dans
sens, ils indiquent qu'ils s'efforceront également
d'éliminer les dangers posés par les armes de destruction
massive. De cela ils décident:
-De mieux faire respecter la primauté du droit dans les
affaires tant internationales que nationales, et en particulier de veiller
à ce que les Etats Membres appliquent les règles et les
décisions de la Cour internationale de Justice, conformément
à la Charte des Nations Unies,
dans les litiges auxquels ils sont parties.
-D'accroître l'efficacité de l'O.N.U. dans le
maintien de la paix et de la sécurité en lui donnant les moyens
et les outils dont elle a besoin pour mieux assurer la
prévention des conflits, le règlement pacifique des
différends, la consolidation de la paix et la reconstruction
après les conflits.
-De renforcer la coopération entre l'O.N.U. et les
organisations régionales conformément aux dispositions du
Chapitre VIII de la Charte.
-De faire appliquer par les Etats parties les traités
conclus dans des domaines tels que
la maîtrise des armements et le désarmement,
ainsi que le droit international humanitaire et
le droit relatif aux droits de l'homme, et de demander
à tous les Etats d'envisager de signer
et de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale.
-De prendre des mesures concertées pour lutter
contre le terrorisme international et d'adhérer dès que
possible à toutes les conventions internationales pertinentes.
-De redoubler d'efforts dans l'accomplissement de notre
engagement à lutter contre le

problème mondial de la drogue.
-D'intensifier la lutte que nous menons contre la
criminalité transnationale dans toutes
ses dimensions, y compris la traite des êtres humains, leur
acheminement clandestin à travers
les frontières et le blanchiment de l'argent sale.
-De réduire autant que possible les effets
néfastes que les sanctions économiques imposées par
l'O.N.U. peuvent avoir sur les populations innocentes, de soumettre les
régimes
de sanctions à des examens périodiques et
d'éliminer les effets préjudiciables des sanctions
sur les tiers.
-De travailler à l'élimination des armes de
destruction massive, notamment les armes nucléaires, et de
n'écarter aucune solution possible pour parvenir à cet objectif,
notamment
en ce qui concerne la convocation éventuelle d'une
conférence internationale pour définir les moyens
d'éliminer les dangers nucléaires.
-De prendre des mesures concertées pour
mettre fin au trafic d'armes légères, notamment en
rendant les transferts d'armes plus transparents et en
encourageant l'adoption de mesures de désarmement au niveau
régional, compte tenu de toutes les recommandations de la
prochaine Conférence des Nations Unies sur le commerce
illicite
des armes légères ; et enfin, d'inviter
tous les Etats à envisager d'adhérer à la Convention sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, ainsi qu'au
Protocole modifié relatif aux mines se rapportant à la
Convention sur les armes classiques197 .
Toutefois, soulignons tout d'abord que tout ceci
s'adresse à la communauté internationale tout
entière. Et ensuite, il est à relever qu'à bien
des égards, toutes ces dispositions sont appelés en grande
partie à être mis en oeuvre par le conseil de
sécurité et ceux du fait que la plupart, par leurs formulations
vont dans le sens du maintien de la paix et
de la sécurité internationales.
Et pourtant, comme nous l'avons souligné tout au
début de ce chapitre, depuis la fin
de la guerre froide, à cause des
situations précaires et souvent catastrophiques qui
prédominent sur ce continent plus qu'ailleurs, l'Afrique s'est
trouvé au centre de l'action onusienne. Des lors, il n'est pas
étonnant qu'on retrouve dans cette déclaration un volet
spéciale Afrique, à savoir le point VII de cette
déclaration, intitulé symboliquement:
Répondre aux besoins spéciaux de l'Afrique, dont le
texte intégral de ce volet est le suivant :
«Nous soutiendrons la consolidation de la
démocratie en Afrique et aiderons les
Africains dans la lutte qu'ils mènent pour instaurer
une paix et un développement durables
et éliminer la pauvreté, afin d'intégrer
le continent africain dans l'économie mondiale. Nous décidons,
par conséquent :
-D'appuyer pleinement les structures politiques et
institutionnelles des démocraties naissantes en Afrique.
-D'encourager et de soutenir les mécanismes
régionaux et sous-régionaux de prévention des conflits
et de promotion de la stabilité politique, et d'assurer un financement
régulier aux opérations de maintien de la paix menées sur
le continent.
197 Volet II. Paix sécurité et
désarment.
-De prendre des mesures spéciales pour relever les
défis que sont l'élimination de la pauvreté et la
réalisation du développement durable en Afrique, y compris
l'annulation de la dette, l'amélioration de l'accès aux
marchés, l'accroissement de l'aide publique au développement
(APD) et des flux d'investissement étrangers directs, ainsi que des
transferts
de technologie198.
-D'aider l'Afrique à se doter des capacités
voulues pour freiner la propagation de la pandémie du VIH/sida et
d'autres maladies infectieuses 199».
Ainsi formulée, on ne peut que constater
l'engouement des Nations Unies face aux questions africaines. Ce faisant,
ceci n'a de sens que par la mise en place d'une structure et d'un
mécanisme capable d'assurer la mise en action d'une façon
effective d'un tel chantier.
C'est pourquoi, conscient de cela, la déclaration s'est
clôturée sur son volet Numéro
VIII, intitulé: Renforcer l'Organisation des Nations
Unies.
Dans ce dernier volet, l'Assemblée a souligner
qu'ils «n'épargnerons aucun effort pour faire de
l'Organisation des Nations Unies un instrument plus efficace aux fins de
la réalisation des objectifs prioritaires suivants :
-La lutte pour le développement de tous les
peuples du monde, la lutte contre la pauvreté, l'ignorance et la
maladie; la lutte contre l'injustice; la lutte contre la violence, la
terreur et la criminalité; et la lutte contre la
dégradation et la destruction de notre planète ».
delà, ils on décider par conséquent et entre autres:
*De redoubler d'efforts pour réformer les
procédures du Conseil de sécurité sous tous leurs aspects.
*De renforcer encore le Conseil économique et social, en faisant fond
sur ses récents succès, afin qu'il puisse être en mesure de
remplir le rôle qui lui est confié dans la Charte. *De renforcer
la Cour internationale de Justice, afin d'assurer la justice et le
régime
du droit dans les affaires internationales. *D'encourager des
consultations et une coordination régulières entre les
principaux organes de l'Organisation des Nations Unies dans l'exercice de
leurs fonctions. *De faire en sorte que l'Organisation dispose, en temps voulu
et de façon prévisible, des ressources nécessaires
pour s'acquitter de ses mandats.
*D'inviter instamment le Secrétariat à utiliser au
mieux ces ressources, conformément aux règles et
procédures clairement établies par l'Assemblée
générale, dans l'intérêt de tous les
États Membres, en adoptant les meilleures
méthodes de gestion, en utilisant les meilleures technologies
disponibles et en concentrant ses efforts sur les activités qui
reflètent les priorités dont sont convenus les Etats
Membres.*De garantir une plus grande cohérence des politiques et
d'améliorer la coopération entre l'Organisation des
Nations Unies, les organismes, les institutions de Bretton Woods et
l'Organisation mondiale du commerce, ainsi
que d'autres organismes multilatéraux, afin de suivre une
démarche pleinement coordonnée
vis-à-vis des problèmes de paix et de
développement. *De renforcer davantage la coopération
entre l'Organisation des Nations Unies et les parlements nationaux,
représentés
par leur organisation mondiale, l'Union interparlementaire, dans
divers domaines,
198 Ce problème de transfert de technologie
est assez déplorable quant on sait l'immense potentiels en matire
premier que recèle le continent africain et qui ne cesse d'être
découvert au jour le jour. Tout récemment en Angola, on vient de
découvrir un nouveau filon qui ne manquera de faire
réévaluer la positon de ce pays en tant que troisième
exportateur de pétrole de l'Afrique.
199 Volet VII. Répondre aux besoins
spéciaux de l'Afrique
notamment la paix et la sécurité, le
développement économique et social, le droit
international et les droits de l'homme, la démocratie et la
parité entre les sexes; ...200.
En bref, ce dernier est en quelque sorte une proposition sinon
une recommandation de remaniement du fonctionnement du système onusien
à défaut d'une reforme de l'organisation elle même. Et
parmi les causes qui ont alimenté le débat sur
l'idée de ce remaniement ou aussi du reforme du système
onusien,
A bien des égards les situations africaines qui ne
cesse de s'alourdir depuis le fin de la guerre froide jusqu'à
nos jours.
Cependant, dans son ensemble le contenu de la
déclaration nous renvoie aussi à une appréciation de
l'action future du conseil de sécurité. Ainsi, on peut
décèle une mise en cause sinon un fort désire
d'impliquer un peu plus et d'une façon consistante, le conseil de
sécurité étant donné son importance quant à
ses résolutions. Et à ce titre la formulation «redoubler
d'efforts pour réformer les procédures du Conseil de
sécurité sous tous leurs aspects », est assez
signifiante. D'autant plus que dans ce sens et s'exprimant à propos de
l'élargissement du Conseil de sécurité, Kofi Annan a
respectueusement suggéré
aux leaders politiques présents «qu'aux yeux
de leurs peuples, le fait qu'un accord soit difficile à trouver,
n'excuse pas leurs incapacité à le réaliser ».
Et par la suite, il ajoute que :
«Si vous voulez que les décisions du
Conseil commandent davantage de respect, surtout dans le monde en
développement, il vous faut aborder la question de sa composition en en
appréciant mieux l'urgence ». Rappelant également
ses suggestions d'étendre la réforme à
l'Assemblée, "qui a besoin d'être renforcée", et
au Conseil de tutelle dont "le rôle pourrait être revu",
il a indiqué qu'il allait créer un Groupe de haut niveau
composé de personnalités éminentes, chargé
d'étudier les questions qui mettent en jeu la paix et la
sécurité, les réponses à apporter, le
fonctionnement des principaux organes de l'O.N.U. et leurs
interactions. Enfin, il souligne tout magistralement que
«Les Nations Unies sont loin d'être
un instrument parfait, mais c'est un instrument
précieux».
En somme et en d'autres termes, le développement de
l'Afrique dans la déclaration du millénaire ne peut être
envisageable sans l'action du conseil de sécurité. En effet, il
ne fait
pas de doute pour personne que les conflits africains ont une
très grande part sur le retard
que connaît ce continent en matière de
développement comme dans l'autre sens le manque
de développement et la précarité des
conditions de vie sont aussi des facteurs influents sur la paix et la
sécurité en Afrique.
Ainsi, dans ce tourbillon de causes à effets en
matière de paix et de développement, le conseil de
sécurité joua et jouera un rôle indiscutable tout au long
de son existence sans qu'il
soit exempté d'une reforme. Dans ce sens que
K Annan, disait qu'il«faut aborder la question de sa
composition en en appréciant mieux l'urgence
201».
200 Volt VIII . Renforcer l'Organisation des Nations
Unies
201« Instaurer une instance coordinatrice de
haut niveau pourrait permettre de renverser la hiérarchie
actuelle des textes internationaux. Il s'agirait d'un Conseil de
sécurité économique et social qui aurait la même
capacité de décision que le Conseil
de sécurité actuel. Cet organe serait comme un
G8 élargi regroupant les grands pays du Nord et du Sud ainsi que les
pays ayant la population la plus nombreuse. Il serait accompagné d'un
secrétariat général qui fonctionnerait comme un procureur
signalant les décalages entre les promesses et les actes. Son rôle
serait d'inciter enfin au respect des normes fixées et de veiller
à l'application
Certes, bien des avancées considérables
sont à prendre en compte à l'instar des interventions du
conseil de sécurité dans des conflits internes
(Guerres civiles) sous la bannière du fameux droit
d'ingérence, ou le souci d'éviter des catastrophes humanitaires,
mais la prise en compte direct par le conseil de sécurité des
impératifs du développement économique et social des pays
africains constitue l'un des objectifs qui devrait permettre à
répondre d'une façon salutaire à ses questions
africaines202.
des programmes d'action. » source: STÉPHANE HESSEL,LE
MONDE DIPLOMATIQUE, JUILLET 2003 , vers un conseil de
sécurité économique et social, URL :
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/07/HESSEL/10235.
202 Et comme l'a souligné STÉPHANE
HESSEL certes l'O.N.U. « a organisé, dans les années
1990, de grandes conférences sur
la santé, les droits des femmes, la lutte contre la
pauvreté, les enjeux démographiques, les droits de l'homme et
fait adopter de beaux textes. Mais où en est leur mise en oeuvre
?». Ibid.
CONCLUSION
L'organisation des Nations Unies a été bâtie
avec des organes de nature diverse203 liés entre eux par une
certaine hiérarchie204 et par une répartition des
compétences leur conférant
une relative spécialisation et une certaine
autonomie qui n'excluent pas une nécessaire coordination. Cette
hiérarchie ne se limite pas entre organes principaux et subsidiaires,
mais
elle se traduise également par une position de force du
conseil de sécurité205. Cette dernière
s'entrevoie par cette relative spécialisation qui fait que
presque la majorité des autres
organes du système onusien sont tenus à son bon
vouloir de lui porter assistance sinon de
lui fournir des informations. Et ceci s`apprécie autour
du maintien de la paix et de la sécurité internationales, but
central de l'organisation et en même temps compétence
exclusive du conseil de sécurité.
Cependant, on ne peut parler de paix sans développement
puisque «la paix, apporte la sécurité nécessaire
à un développement206». D'autant plus
que «la paix, l'économie, l'environnement, la justice
sociale et la démocratie constituent les piliers du développement
durable. La croissance économique engendre les ressources
indispensables
aux progrès La justice sociale renforce le
tissu de la société et affermit la paix et le
développement. La démocratie favorise l'innovation, un meilleur
fonctionnement de l'Etat et
la stabilité nécessaire pour assurer un
développement durable207». Ceci dit ces
cinq
dimensions se retrouvent simultanément et par ricochet,
liés à ce champ d'action du conseil
de sécurité en Afrique. Ainsi presque toute
l'armada du système onusien est en quelque sorte
à la disposition du conseil de sécurité;
ce qui se justifie aisément par les multiples et diverses implications
que comporte cette lourde tache du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Toutefois depuis sa création jusqu'à la
fin de la guerre froide, il s'est avéré que l'action du
conseil de sécurité s'est trouvée bloquer par la pratique
automatique du droit de veto que ce soit par l'ex-URSS ou des Etats unis. Et il
a fallu donc attendre la fin de cette situation en 1989 pour voir un
renouveau du conseil de sécurité208. C'est dans
cette perspective que l'Afrique s'est vue prise en compte sur
l'échiquier mondial non par entremise comme du temps de la
guerre froide, mais par ses réalités qui font qu'ils
constituent dans ce monde d'interdépendance croissante, un acteur comme
tant d'autres sur
la scène internationale. Certes dans le contexte des
années 90 marqué par la recomposition
du système international et la relance de
l'interdépendance entre les nations et par
203 Organes : politiques, économiques,
sociaux, administratifs et judiciaires
204 Organes principaux et subsidiaires voir aussi
organes subsidiaires qui portent des organes et sous organes subsidiaires
205 C'est en guise d'exemple le sens certains
articles de la charte qui excluent la connaissance d'une affaire par
l'assemblée générale des Nations Unies tant que le conseil
ne se soit pas dessaisie de l'affaire ( article 12 paragraphe 1) ou aussi
certains autres qui donnent à ce dernier le pouvoir de demander
assistance et information aux autres organes sans qu'il soit reconnu un
pouvoir de ces derniers de la faire sur leurs propres
initiatives.
(article 65)
206 Ibid. Boutros B Ghali, Pour la paix et le
développement, P 3
207 Ibid.
208Mais que dire d'un conseil
de sécurité qui n'a d'existence que par une participation
dominée par ces mêmes
puissances ? Que dire d'un conseil de
sécurité qui n'a de force logistique que ceux fournis par ces
mêmes puissances ?
conséquent aussi d'un conseil de sécurité
plus libre de ses mouvements, la prise en compte
des questions africaines par ce dernier s'avère
être une évidence de droit comme de fait. Toutefois
à l'instar de la Somalie, le Rwanda, la Mozambique, la
Namibie, le Centre Afrique, le Congo, le Libéria, le Sahara
occidental et de nos jours la Côte d'ivoire, l'indignation face
aux conflits qui ont détruit ces Etats invite à
réévaluer l'action de ce dernier sur ce continent.
D'autant plus que dans ce monde contemporain plus étatique
qu'humaniste, c'est plus les intérêts individuels
qui priment sur le droit, le devoir voire aussi
sur les nécessités issues de
l'interdépendance des nations209. C'est dans ce sens que
l'action
du conseil de sécurité en Afrique est
nuancée voire à dénoncer.
A ce propos, le secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan, a ouvert une conférence sur le
génocide de 1994 au Rwanda en reconnaissant que l'O.N.U et lui
même portaient une part de responsabilité dans le massacre de
800.000 personnes, sur lequel la communauté internationale a dans un
premier temps fermé les yeux:: «La communauté
internationale a péché par omission», a dit Annan qui
à l'époque dirigeait les opérations de maintien de la paix
de l'O.N.U et qui a demandé aux pays de fournir des troupes :
«Je
croyais à l'époque que je faisais de mon mieux.
Mais j'ai réalisé après le génocide que j'aurais pu
et dû faire plus pour tirer la sonnette d'alarme et obtenir de
l'aide210».
Ainsi on peut dire qu'à bien d'autres
égards, que pour répondre aux besoins de l'Afrique à
partir de cette dernière décennie, le champ d'action du conseil
de sécurité a dû ou aurait dû intégrer un peu
plus d'avantage, en plus du maintien de la paix dans le sens d'éviter
les conflits armés, des domaines comme
l'humanitaire ainsi que des aspects relevant du cadre
socioéconomique. C'est en tout cas dans ce sens qu'on retrouve
parallèlement des programmes et des initiatives autonomes par rapport
au conseil de sécurité, mais liés à lui
par l'entremise du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Force est donc de constater qu'entre saisine et auto-saisine
du conseil de sécurité, le contexte et le scénario
conditionnent grièvement l'action de ce dernier sur ce continent
africain. Autrement dit, les conséquences désastreuses de
ces questions africaines, sont devenus par la pratique de ce conseil de
sécurité, la condition sine qua non pour qu'une action
soit mise en oeuvre. C'est ainsi que l'événementiel de cette
action arrive à trouver un autre sens quant à faire la
lumière sur les attitudes de coulisse du maintien de la paix
en Afrique, ainsi que par le constat tautologique des situations africaines
sur le terrain.
En somme, on peut dire que certes l'action du conseil de
sécurité face à ces questions africaines depuis 1990
à nos jours est assez salutaire, mais au même titre que
la bonne volonté qui vivifie la déclaration du millénaire
dont en particulier celle contenue dans son volet spécial pour
l'Afrique, force est de constater par mimétisme que cette action n'envie
en rien à celles des puissances étrangères qui le
plus souvent ne visent qu'à protéger leurs ressortissants,
leurs intérêts voir à s'en servir comme moyen
d'asseoir sur la scène internationale la politique de
légitimation symbolique qui lui est nécessaire.
209 « La société internationale
est le reflet d'une conscience commune des interdépendances multiples
», Pierre Marie Dupuy, droit international public. Source : Ibid. Nouvel
ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du
conseil de sécurité, P 150.
210Source : Grant McCool, Génocide rwandais:
Annan reconnaît des défaillances de l'O.N.U., http
//www.yahoo.com, (article paru
le vendredi 26 mars 2004).

BIBLIOGRAPHIE
V Charte des Nations Unies et Statut de la Cour Internationale
de Justice
DPI/511, Ré-impression de juin 1998.
V Basic Facts, about the United Nations, DPI2155, April 2001.
V Jean François Muracciole, L'O.N.U depuis 1945, Ellipses
1996
V Afrique, Désarmement Et Sécurité, UNIDIR
1991
V Mohammed Bedjaoui, Nouvel Ordre Mondial et Contrôle de la
Légalité des actes du conseil de sécurité, Brylant
Bruxelles 1994.
V Karel C.Wellens, Résolutions et déclarations du
conseil de sécurité (1946-
1992), Brylant Bruxelles 1993.
V Abdelwahab Biad, Droit International Humanitaire, Ellipses
1999
V Veynes et Viljoen, Protection des droits de l'homme en Afrique,
RMEI N°3, juin 1999.
V Pierre François Gonnidec, Relations Internationales
africains, Tome 53, Bibliothèque africaine et malgache, librairie
générale de droit et De jurisprudence, EJA 1996.
V ROBERT-ALIROBERT-ALI BRAC DE LA PERRIERE (Oeuvre collectif ),
Scandinavian Instituta of African Studios, 1989.
V La communauté internationale et les droits de la
personne humaine,(Euvre collectif), Travaux dédiés a la
mémoire de Driss Slaoui, Fondation Roi Abdul Aziz Al Saoud pour les
études islamiques et sciences humaines, journée
d'étude organisée le 07 février 200, Edition
2001.
V Franck Magnard et Nicolas Tenzer, La crise africaine: Quelle
politique pour
la France ?, PUF, 1988.
V Daniel Colard, la société internationale
après la guerre froide, Armand Colin
1996.
V Guy Lagelée et Gilles Manceron, Conquête mondiale
des droits de l'homme, Editions Cherche Midi et UNESCO 1998.
V Zartman, Africa as a subordinate state system in internationals
Relations, Internationals organisations, 1967.
V Michel .VIRALLY, L'O.N.U d'hier a demain, Paris, Edition du
Seuil, 1961.
V Alfred. KATZIN, L'O.N.U pour tous, France, Nations Unies,
1960
V GERBET, Pierre, GHEBALI, Victor-Yves, et MOUTON,
Marie-Renée, Société des Nations et Organisation des
Nations Unies, Paris, Edition Richelieu, 1973.
V Igor Oussatchev, du décret sur la paix, vers un monde
sans guerres et sans armes, Editions de l'agence de presse Novosti, Moscou
1987.
V Tran Van Minh, Encyclopédie juridique de l'Afrique, vol
I (La question de l'Erythrée ), PUF 1979.
V Achile Mbmbe, Afrique indocile, Karthala 1988.
V Bertrand Schneider, l'Afrique face a ses priorités,
économica, 1987.
V Younes Berrada, Théories des organisations
internationales, Cours polycopié
de la section 2émé année du
second cycle droit public (UF4), faculté des
Sciences Juridiques économiques et sociale de
Méknes, 2003/2004.
V CNUCED, Au service de la croissance et du développement,
30 ans et au-dela
(1964-1994), UNCTAD/EDM/ERCP/8, Nations Unies 1994.
V Boutros B Ghali, Agenda pour la paix, Nations Unies, 23 juin
1992.
V Boutros B Ghali, Pour ma paix et le développement,
DPI/1537,Nations Unies, octobre 1994.
(Les documents suivants sont tirés sur
le site web des Nations Unies :
www.un.org).
V Kofi Annan, Rapport sur les causes des conflits en Afrique, Les
conflits, une réalité a laquelle il faut faire face, 25 septembre
1997.
V Kofi Annan, Partnership For global community, Nations Unies
1998.
V Kofi Annan, Déclaration du Millénaire (06 au 08
septembre 2000) et
Application de la déclaration du millénaire, point
61 de l'ordre du jour du
58éme assemblée générale des Nations
Unies, 02 septembre 2003, A58/323.
V Kofi Annan, Rapports sur les opérations de maintien de
la paix en Afrique :
- Angola, 07 février 2003
- Burundi 14 novembre 2001 et celui du 18 novembre 2002.
- Centre Afrique 03 janvier 2003
- Cote d'ivoire 26 mars 2003 et celui du 08 août 2003
- Ethiopie/Erythrée 09 septembre 2003
- Guinée Bissau 09 juin 2003
- Liberia (R 1497/1478) 05 août 2003
- R D C (MONUC) 27 mai 2003
- Somalie 26 septembre 2000
- Sahara occidental 10 janvier 2002
- Sierra Leone 04 octobre 2000 et celui 05 septembre 2003
V Documents officiels de l'Assemblée
Générale, 47éme session, Supplément
n°6 (A/47/6/Rev.1), vol. I, programme 45, Distr. GENERALE A/RES/49/142,
1995.
(Tous ces documents ci-dessus sont donc
disponibles sur le site web des Nations Unies :
www.un.org).

REVUES ET JOURNAUX:
V Stephen Smith, La seconde pacification de l'Afrique, Le Monde
24juin 2003.
V KODJO EDEMEDEM, Le retard de l'Afrique peut être
rattrapé, Le Monde diplomatique, février 1980.
V GRESH ALAIN, l'Afrique australe, une "sphère de
conflits", Le monde diplomatique, février 1988.
V Achile Mbmbe, Déconfiture de l'Etat et risques de la
"Transition démocratique", Le Monde diplomatique, mai 1993.
V PHILIPPE LEYMARIE, Espoirs de renaissance, dérive d'un
continent, Le Monde diplomatique, avril 1999.
V Le Monde diplomatique, N ° 586, janvier 2003.
V Le Monde diplomatique, juillet 2003.
V Jeune Afrique l'intelligent, N ° 2151, avril 2002.
V Jeune Afrique l'intelligent, N ° 2154 avril 2002.
V Jeune Afrique l'intelligent, N ° 2251, du 29
février au 6 mars 2004.
V Economia, N ° 26, décembre 2002.
V Economia, N ° 29, mars 2003.
V Ecofinance, N ° 37, novembre 2003.

WEBOGRAPHIE:
V
http://wwww.onu.fr (Centre d'information des
Nations Unies)
V
http://www.un.org (Centre d'information des
Nations Unies)
V
http://www.dfait-maeci.gc.ca/peacekeeping/missions-fr
V http://www. Perspectives-africaines.com
V
http://www.french.peopledailly.com
V
http://www.monde-diplomatique.fr
V
http://www.hippiesylvain.free.fr
V
http://www.droitshumains.org
V
http://www.usinfo.state.gov
V
http://www.l'intéligent.com
V
http://www.lemonde.fr
V
http://www.wagne.net
V
http://www.rabac.com
V
http://www.amnesty.asso.fr
V
http://www.afrik.com
V
http://www.unsia.org
V
http://www.saphirnet.info
V
http://www.grip.org
V
http://www.yahoo.com

LOGICIELS REFERENTIELS: (SUR
CD-ROOM)
V LIRIS INTERACTIVE, Larousse Multimédia
Encyclopédique,
Paris,Larousse1996.
V ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS 8 (CD-Universalis), Copyright (c)
1995-2002, ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS IDM), 2002
(http://ww.idm.fr.)
V ATLAS MONDIAL MICROSOFT ENCARTA 1998, Microsoft Corporation,
Copyright(c)1997.
V LE MONDE DIPLOMATIQUE, Cd-Rom l'histoire au jour le jour
1939/2002 (c) 2002 COEDMON le monde, Emme et IDM.
V LE MONDE DIPLOMATIQUE, de 1980 a 2000, version 3082, Copyright
(c) SA CD-ROM SNI, Août 2000.



