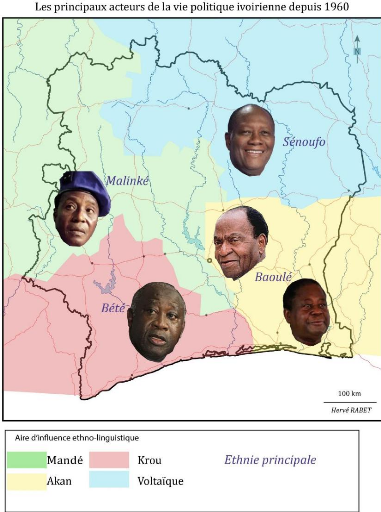
Page 85 sur 227
Figure 19: Carte des principaux acteurs de la vie politique
ivoirienne depuis 1960 (RABET,2020)
Page 86 sur 227
La période que nous allons maintenant aborder va de
1990 à 2011. Celle-ci, qui concerne principalement la succession de
Houphouët-Boigny, demeure le théâtre d'une construction
identitaire et citoyenne gangrénée par la violence dont les
principaux acteurs sont Henri Konan Bédié, Robert Gueï,
Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et les citoyens ivoiriens eux-mêmes.
Fin de règne
Les travaux de Claudine Vidal nous permettent de supposer que
Houphouët-Boigny, sachant surement que son état de plus en plus
délétère ne lui permettra pas d'achever son ultime mandat,
prend un ensemble de décisions censées garantir sa paisible
succession. La modification de l'article 11 de la Constitution en 1990, donne
la possibilité à Henri Konan Bédié, alors
président de l'assemblée nationale, d'achever le mandat
présidentiel en cas de disparition du président. Une autre
disposition, à savoir la nomination inédite d'Alassane Ouattara
au poste de premier ministre est simultanément mise en oeuvre. Celui-ci
dont la tâche principale est le redressement économique, est
également garant de l'ordre public lors des nombreuses absences
curatives du président (Vidal,2003).
Christian Bouquet ne manque pas de nous mentionner qu'hostile
envers la modification de l'article 11 de la constitution, le Front Populaire
Ivoirien (FPI) de l'opposant historique Laurent Gbagbo propose le 27 novembre
1993 la création d'une assemblée constituante et d'un
gouvernement de transition dont la mission pendant 12 mois serait de
réécrire la constitution et de concevoir un nouveau code
électoral plus en adéquation avec les aspirations
démocratiques du pays. (Bouquet,2005).
En vertu de l'application de l'article 11 de la constitution,
Henri Konan Bédié succède à feu Félix
Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Deux mois de deuil national
sont décrétés, durant lesquels les Ivoiriens contribuent
à un immense rituel funéraire collectif. Le 7 février
1994, des chefs d'État et délégations du monde entier se
rendent à la basilique de Yamoussoukro pour assister à la messe
funéraire du père de l'indépendance ivoirienne. Ces
funérailles extraordinaires, qui font l'unanimité, suscitent une
conscience d'unité nationale. Cette unité au-delà de la
symbolique, est également opérationnelle comme en témoigne
les nombreuses mobilisations de toutes les catégories sociales et
Page 87 sur 227
professionnelles sur l'ensemble du territoire. L'adieu au
père de l'indépendance est pour la Côte d'Ivoire l'unique
moment de son Histoire où le sentiment de fierté et
d'appartenance des ivoiriens à la « nation ivoirienne » sont
éveillés.
Les premières pratiques brutales qui
transgressèrent les normes de la paix civile, revendiquée par le
régime houphouëtiste comme son emblème, furent bien du fait
de Houphouët-Boigny lui-même via l'action de son gouvernement. Que
ce soit au travers d'assassinats de personnalités supposées trop
en savoir sur la corruption gouvernementale par de mystérieux escadrons
de la mort, de rumeurs de coups d'État commandités par
l'opposition, de violences (tabassages, viols) à l'encontre des
étudiants en mai 1991 et l'interdiction de leur nouveau syndicat ainsi
que l'emprisonnement de leurs leaders ou encore de l'enrôlement de nervis
(les « loubards ») par le pouvoir afin de maitriser les rues.
L'arrestation, en février 1992, des organisateurs d'une marche de
protestation parmi lesquels Laurent Gbagbo et le président de la Ligue
ivoirienne des droits de l'homme (LIDHO), marque l'avènement de la loi
anticasseur. Si elle ne le revendique pas dans le texte, cette loi induit par
sa mise en oeuvre l'interdiction des citoyens de manifester. Paradoxalement,
l'avènement du multipartisme, la libéralisation syndicale ainsi
que celle de la presse a pour conséquence une rupture de
l'équilibre fragile de la « paix civile » ivoirienne.
Le « dialogue à l'ivoirienne », qui permis
à Houphouët-Boigny de parfaire sa stature de Sage et à la
Côte d'ivoire d'être en « paix », s'est essentiellement
reposé sur la capacité de Houphouët-Boigny à se
montrer homme de modération, conciliateur, réconciliateur et
parfois oppresseur. La ligne de conduite adoptée depuis la fin de la
période de faux complot par Houphouët-Boigny fut pacifique.
Cependant, à partir de 1990, il ouvre une ère de brutalisation de
la vie politique et met en péril, ce qui aurait pu constituer
l'essentiel de son héritage, à savoir l'évitement de la
violence. Loin d'être perçues comme des épisodes passagers,
les violences d'État commises lors des années 1991 et 1992 sont
un basculement dans la pratique politique et citoyenne ivoirienne dans la
mesure où elles ancrent définitivement la violence comme moyen
d'expression politique acceptable (Vidal,2003).
Page 88 sur 227
Succession politique
La nomination de Henri Konan Bédié à la
tête du pays, n'est dans un premier temps pas reconnue par Alassane
Ouattara qui se ravise très vite face à la réticence des
militaires menés par le Général Robert Gueï à
embrasser sa cause. Laurent Gbagbo, quant à lui réaffirme sa
volonté du 27 novembre 1993, à savoir la constitution d'un
gouvernement de transition dont la tâche principale serait la
réécriture de la constitution ainsi que ses revendications de
1990 relatives au droit exclusif des autochtones à la
propriété foncière et la suppression du droit de vote des
étrangers favorables selon lui au maintien de l'hégémonie
politique du PDCI-RDA.
Henri Konan Bédié, à partir de 1994,
tente de s'inscrire dans la continuité de la politique d'ouverture de
son prédécesseur en proposant un projet de loi accordant le droit
de vote aux citoyens non-nationaux ressortissants de la Communauté
Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en application du protocole
portant citoyenneté de la communauté et inscrits sur la liste
électorale. Ce projet de loi rencontre une vive opposition menée
par le FPI, qui obtient gain de cause le 8 décembre 1994 avec l'adoption
d'un nouveau code électoral retirant le droit de vote aux
étrangers. Les articles 49 et 77 du nouveau code électoral vont
encore plus loin, en posant des conditions d'éligibilité
présidentielle et législative nationalistes. Dès lors, il
fallait disposer d'une ascendance ivoirienne remontant à au moins 2
générations, n'avoir jamais renoncé à la
nationalité ivoirienne et être résident de la Côte
d'Ivoire pendant les 5 années précédent le scrutin en
question sauf en cas de mandat international.
Alassane Ouattara, créateur du Rassemblement des
Républicains (RDR) apparait comme victime principale de cette
réforme électorale. L'ex premier ministre, né dans le nord
de la Côte d'Ivoire de parents originaires de la Haute Côte Ivoire
devenue Burkina Faso a occupé des fonctions au FMI avec la
nationalité burkinabè. Malgré l'exclusion
législative de Alassane Ouattara et le refus de la création d'une
commission nationale électorale indépendante souhaitée par
Laurent Gbagbo, la guerre de succession tant redoutée n'a finalement pas
lieu mais il apparaît clair qu'aucun des trois principaux
prétendants au pouvoir présidentiel, Henri Konan
Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne désarmerait
et que chacun se réserve pour l'échéance électoral
de 1995.
Page 89 sur 227
Les principales inquiétudes liées à
l'élection présidentielle de 1995 relèvent des doutes
populaires sur la capacité des 3 principaux prétendants à
l'investiture suprême à respecter les modalités
démocratiques. Le climat de grande peur, induit par l'annonce du
décès d'Houphouët-Boigny, aurait pu devenir de plus en plus
oppressant, jusqu'à susciter de dangereuses méfiances entre
personnes et entre groupes supposés prêts à l'offensive.
Là encore, rien de tel ne se passa et la peur se dissipa. Non parce que
Henri Konan Bédié était devenu Président de
manière pacifique mais parce que la Côte d'Ivoire toute
entière s'est consacrée aux funérailles
d'Houphouët-Boigny
L'élection présidentielle se tient le 23
octobre 1995. Elle est, pour l'opposition, essentiellement constituée
par le Rassemblement des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara et du
Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, l'occasion d'user de la
violence comme levier politique. Ce recours à la violence constitut une
rupture essentielle des modalités de la confrontation politique qui
avaient jusqu'alors existés. Bien que la gouvernance du Parti
démocratique de Côte d'ivoire (PDCI) ne soit pas immaculée
de violence, il en avait cependant l'exclusivité et usait de celle-ci en
premier lieu à l'encontre des opposants politiques
déclarés, des étudiants et des journalistes. Cette
violence mobilisait ainsi des corps spécialisés : forces de
l'ordre, personnel judiciaire, et plus rarement hommes de main.
Le président Henri Konan Bédié, durant
les vingt-trois mois de sa présidence, ne se prive pas d'utiliser les
moyens de coercition disponibles malgré sa volonté
supposée de parvenir à une « démocratie
apaisée ». Il faut dire que le PDCI-RDA, essentiellement
composé des vieux éléphants zélés du parti,
guère préparé au multipartisme, vient d'imploser : une
partie de ses membres a rejoint le RDR de Alassane Ouattara, allié de
circonstances du FPI au sein d'un front Républicain d'opposition
Cependant, Henri Konan Bédié, qui ne
lâche rien ou presque rien, notamment en matière de transparence
des élections, bénéficie d'un effet heureux de la
dévaluation du franc CFA et tient pour l'occasion un long discours
favorablement reçu par la population. Bien des signes montraient qu'il
serait le vainqueur des élections présidentielles. En 1995,
l'initiative de la violence est du fait des adversaires du pouvoir en place qui
déclenchent, en octobre, un « boycott actif » des
élections présidentielles. Ils engagent leurs militants dans le
combat de rue, provoquant ainsi destructions de biens, pillages et morts. Le
slogan
Page 90 sur 227
du boycott actif lancé par le Front républicain
tient en une formule : « empêcher la tenue des élections par
tous les moyens possibles » (Vidal,2003).
Les répercussions les plus graves se produisent dans
l'Ouest du pays où les communautés baoulés «
allogènes » sont victimes d'exactions de la part des «
autochtones ». Dans certains quartiers d'Abidjan, les manifestants se
livrent à toutes sortes de brutalités et terrorisent ceux qui
souhaitent voter. Cet épisode violent est rapidement contenu et l'ordre
public très vite rétabli. Cependant, pour la première
fois, depuis l'établissement du multipartisme, des organisations
politiques ont volontairement provoqué un climat d'émeute qui
aurait pu dégénérer en affrontements beaucoup plus
meurtriers. Cet épisode a été favorable à
l'émergence de deux formes de violence : les affrontements ouverts entre
communautés rurales « autochtones » et « allochtones
» et celle engendrée par la mobilisation des jeunesses urbaines
défavorisées qui estiment qu'elles ont plus à gagner
qu'à perdre dans ces désordres. De fait, les dirigeants
politiques du front républicain ont pris une décision qui n'eut
peut-être pas, sur le coup, des conséquences tragiques pour
l'ensemble de la nation, mais qui rendit concevable en tant que moyen politique
le recours à la violence de leurs partisans.
Devenu, malgré les tensions, président de la
république ivoirienne par la voie des urnes, Henri Konan
Bédié, doit faire face aux premières conséquences
de la dévaluation du Franc CFA de 1994 qui transforme la
récession, en crise économique. Pour la population, cela se
traduit par une baisse des revenus liés aux produits d'exportation,
notamment du cacao, première source de revenus du pays et premier
secteur d'emploi (25% de la population) ainsi que par une hausse des prix des
produits de consommation de base.
Le mécontentement populaire prend rapidement une
dimension de conflit interethnique. Dans le cas du conflit opposant les
bétés, ethnie de Laurent Gbagbo et les baoulés, ethnie
d'Henri Konan Bédié, il semble que la rivalité ne concerne
non plus seulement l'accession foncière mais traduit bien de la
volonté des bétés de mettre fin à
l'hégémonie socio-politique baoulé. Dans ce contexte, le
Général Robert Gueï, refuse d'engager ses troupes dans les
opérations de maintien de l'ordre de l'Etat, lors des violentes
manifestations de septembre et d'octobre 1995. Il est condamné pour cela
à de la prison mais bénéficie d'une grâce
présidentielle ainsi que d'une retraite anticipée dans
Page 91 sur 227
son village natal situé non loin de Man, dans l'ouest
du pays. Il ne reviendra sur le devant de la scène qu'en 1999
(Bouquet,2005).
L'étranger dans la société
ivoirienne
Dans le but d'apaiser les tensions sociales liées aux
enjeux de nationalité, de propriété foncière et
d'éligibilité politique, Henri Konan Bédié par
l'intermédiaire de la Cellule Universitaire de recherche et de
diffusions des idées des actions politiques de Henri Konan
Bédié (CURDIPHE) tente de redéfinir le contrat social
ivoirien en 1994 (Bouquet,2005).
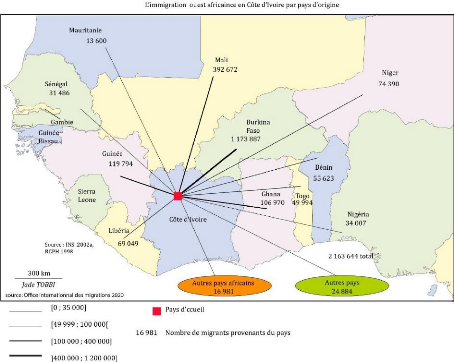
Figure 20: Carte de la migration ouest africaine en
Côte d'ivoire (TOBBI,2020)
Selon Alfred Babo, la période coloniale fut vectrice
d'une immigration massive de pays voisins pour dynamiser l'économie de
la colonie ivoirienne. La politique d'ouverture d'Houphouët-Boigny s'est
inscrite dans la continuité de la politique d'intégration des
Page 92 sur 227
étrangers menée par l'administration coloniale.
C'est alors qu'en 1998, la Côte d'Ivoire compte 15 366 672 habitants dont
4 000 047 de non nationaux, soit 26 % de la population totale (Babo,2012).
La Côte d'Ivoire se présente donc comme une
terre d'accueil pour les étrangers, principalement originaires d'Afrique
de l'Ouest. Ces derniers, totalement intégrés à la
société ivoirienne, bénéficient de conditions
favorables d'accès à la terre, à l'emploi et au droit de
vote. Si l'on considère l'intégration comme un processus qui
mène au fait qu'une population dans un milieu donné ne pose plus
de problème ni à elle-même ni à son environnement,
alors à partir des années 1990 l'importante population d'origine
étrangère en provenance d'Afrique de l'Ouest, a
recommencée, comme en 1958, à poser un problème à
la société ivoirienne. La politique de l'ivoirité, mis en
oeuvre à partir de 1994 par le président Henri Konan
Bédié, a fortement accentué si ce n'est influencé
le regard nouveau porté par les Ivoiriens sur les étrangers et
précipité la fracture sociale. (Babo,2012).
Au-delà de la définition de l'étranger
comme un individu ne bénéficiant pas de la nationalité du
pays dont il est résident, il convient de rappeler que la notion
d'étranger est l'une des plus discutées dans la sociologie. Cela
démontre que cette notion est évolutive, construite et
déconstruite selon les paradigmes dominant de l'époque dans
laquelle elle s'inscrit.
Nous pouvons légitimement nous interroger sur
l'influence politique exercée par l'administration où celle du
discours populaire dans le processus de construction de la
représentation de l'étranger au sein d'une société.
Sur la base de la dialectique de l'intériorité et de
l'extériorité, l'idéal-type de l'étranger, est
défini comme celui « d'une personne arrivée aujourd'hui
et qui restera demain » et dont l'obligation ou le désir de
rester dans le pays d'accueil provoque, inéluctablement la naissance de
relations entre l'immigré et ce pays (Simmel,1908).
S'inspirant de l'analyse simmélienne, Otthein
Rammstedt définit l'étranger comme le symbole des relations entre
hommes, mais souligne surtout que l'objet sociologique de l'étranger
pose l'unité entre le détachement d'un point spatial et la
fixation à ce même point. Si la notion d'étranger s'est
construite chez Simmel avec l'idée d'espace et de
Page 93 sur 227
mobilité, on peut noter que les nouvelles formes de
mobilité et le lien disparate des immigrés avec leurs pays
d'origine permettent de repenser cette notion (Babo,2012).
Mahamadou Zongo montre comment en l'absence de relations avec
le territoire d'origine, des enfants de parents burkinabés, nés
en Côte d'Ivoire, sont doublement étrangers.
Considérés comme des étrangers en Côte d'Ivoire, ils
le sont également au Burkina Faso où la majeure partie d'entre
eux d'entre eux ont été contraints de rentrer par la force
à l'occasion du conflit foncier de Tabou en 1999 et de la crise
militaro-politique débuté en 2002.
Finalement, ces « diaspos », ont eu le
sentiment d'être des étrangers chez eux, comme en témoigne
un émigrant en 1945 : « Le pays étranger n'est pas
devenu notre patrie, mais notre patrie est devenue un pays étranger
». Si cela est vrai pour les premiers émigrants, c'est encore
plus vrai pour leurs descendants qui ne disposent d'aucunes attaches au lieu de
provenance de leurs parents. Toutefois, contrairement à ce qu'affirmait
cet émigrant en 1945, le pays étranger est devenu bien leur
patrie. Ainsi, dans le cas des jeunes burkinabè, beaucoup d'entre eux
sont retournés en Côte d'Ivoire où ils se sentent membres
à part entière de la société d'accueil. Si nous
nous inscrivons dans la perspective de Georg Simmel, ces reflux montrent que
l'étranger ne demeure pas en dehors de la société
d'accueil. Bien au contraire, « l'étranger est membre du groupe
et la cohésion du groupe est déterminée par le rapport
particulier qu'il entretient avec cet élément »
(Zongo,2003).
Mais ce que ne révèle pas G. Simmel, c'est le
fait que les rapports sociaux dans la construction ou la déconstruction
de la notion d'étranger changent sous l'effet de facteurs sociaux,
économiques et politiques. Ainsi l'intégration de
l'étranger fait parfois place à son rejet. Historiquement,
l'appel, voire la course à l'étranger, considéré
comme principale richesse dans le cadre de la frontière interne, fut
à la base de l'établissement de communautés plus larges et
plus développées dans les sociétés
précoloniales ouest africaines (Babo,2012).
Plus récemment, en Côte d'Ivoire, comme dans
plusieurs pays africains, le tutorat a été le principe des
relations à la fois sociales, affectives et sacrées qui se sont
nouées entre les membres des communautés locales et «
leurs étrangers ». Cependant, la crise du tutorat
lui-même ainsi que les mutations subséquentes dans ces relations
dues aux
Page 94 sur 227
revendications et aux émancipations des
«étrangers» sont à la base d'une nouvelle
citoyenneté.
En Europe comme en Afrique, les «étrangers»
qui sont installés revendiquent désormais des droits sociaux et
politiques dans un monde où paradoxalement les instruments qui ont
contribué à son ouverture sont également sources de
craintes et de repli sur soi. L'inscription sur les listes électorales
est le premier rapport entre un individu issu de l'immigration et l'accession
à la citoyenneté (Césari, 1993). Mais on ne saurait
limiter la citoyenneté aux droits politiques, car chez Pierre Milza, ou
encore Dominique Schnapper, l'acquisition de droits sociaux est une des
premières voies pour accéder à la citoyenneté.
Cette nouvelle citoyenneté ne serait plus « purement
représentative » mais « participative et collective
», liée à « une implication effective dans la
vie locale » En effet, l'individu étranger ne souhaite plus
être assimilé à la notion d'immigré rattaché
à une considération de l'étranger comme un individu «
assisté et objet de la politique », mais bien à
celle de citoyen à part entière ayant des droits et des devoirs.
Il veut ainsi établir de nouveaux rapports non plus d'assistance ou
d'entraide, mais d'égalité au sein de la communauté de
citoyens qui l'accueil.
L'accès à la citoyenneté marque de
nouveaux rapports d'égal à égal avec autrui,
effaçant ainsi toutes différences, en particulier dans la vie
civique (Withol de Wenden,1996). Cette transformation à la fois mentale
et administrative révèle un paradoxe de l'intégration
ivoirienne, provoquant un sentiment de répulsion de l'étranger
croissant à l'origine d'une idéologie telle que
l'ivoirité (Babo,2012).
L'ivoirité
C'est à travers l'expérience social de
l'ensemble de ses individus qu'une société définit sa
représentation de l'étranger qu'elle exprime à travers sa
culture (Baxandall,1981). L'expérience sociale en Côte d'Ivoire,
au début des années 1990, a été marquée par
une crise d'identité à travers l'ivoirité
(Babo,2012).
Tentative de Konan Bédié de conciliation d'un
chauvinisme structurel des peuples ivoiriens et de l'écriture de sa
propre légende au coeur d'un nouveau contrat social ivoirien,
l'ivoirité s'appuie aussi sur une autre composante, qui va
précisément à
Page 95 sur 227
l'encontre des principes qui en font un instrument utile et
sain d'unité nationale et de clarification de la citoyenneté
ivoirienne.
Dans la mesure où, par son signifiant, elle implique
une définition essentialiste du peuple ivoirien, l'ivoirité est
conçue comme l'idéologie d'un pouvoir instrumentalisé par
l'Etat qui se doit d'être dirigé par un Homme fort pour atteindre
son plein potentiel (Vidal,2003). Nous retrouvons ici les derniers vestiges des
apprentissages idéologiques communistes d'Houphouët-Boigny.
La légitimité prétendue de Henri Konan
Bédié repose sur plusieurs considérations
ethnico-politiques. La première, est que son occupation de la plus haute
fonction de l'Etat démontre de sa force et de son exemplarité. La
seconde, est que son origine baoulé lui assure une
légitimité sociale à gouverner le pays. Henri Konan
Bédié ainsi que bon nombre de représentants
éminents de l'appareil d'État et du PDCI-RDA de l'époque,
sont baoulés, ethnie du pays akan implanté dans les parties
orientales et centrales du Sud ivoirien.
Henri Konan Bédié s'inscrit à la fois
dans la continuité du culte de la personnalité instauré
par Houphouët-Boigny mais également dans la rupture en tentant
d'étendre celui-ci à un culte de l'univers akan. Ce culte, reflet
d'une vision ethnocentrée de ceux qui exerçaient jusqu'alors le
pouvoir et au travers duquel l'ivoirité, par un pur jeu
autoréférentiel, pouvait prendre sa pleine dimension
d'idéologie nationale (Vidal,2003).
Soutenue par un appareil d'intellectuels et
d'écrivains rassemblés au sein de la Cellule Universitaire de
Recherche et de Diffusion des Idées du Président Henri Konan
Bédié (CURDIPHE), la justification de la légitimité
de l'ivoirité repose sur deux arguments principaux. Le premier
ethnocentré, admet que les traditions, les systèmes de
pensées et d'organisations akans sont les plus à même de
servir de moteur à la modernisation du pays. Henri Konan
Bédié prend inspiration sur les « Dragons d'Asie » dont
la croissance spectaculaire à partir des années 1990 s'est
appuyée sur un profond enracinement culturel permettant
l'émergence de régimes forts encadrant les sociétés
dans leurs processus de développement. Henri Konan Bédié
considère également que l'organisation sociale baoulé
bénéficie d'un harmonieux équilibre entre une «
aristocratie » qui exerce le pouvoir et une « plèbe »,
travaillant la terre et prédisposée à l'obéissance
au pouvoir
Page 96 sur 227
(Bédié, 1999). De filiation royale tribale,
Henri Konan Bédié s'estime ainsi être le légitime
leader de la nation ivoirienne.
Autrement dit, l'entreprise de Henri Konan
Bédié est une tentative de conciliation de l'héritage de
Houphouët-Boigny et de son propre legs, s'appuyant sur l'expérience
historique ivoirienne par laquelle le monde baoulé n'a cessé de
jouer au sein d'une Côte d'Ivoire où se conjuguaient croissance
économique et stabilité politique, tout à la fois le
rôle des gens de la terre et des gens du pouvoir, et de figurer ainsi au
premier plan de la vie nationale.
Cependant, malgré cet héritage essentiel, deux
choses distinguent l'ivoirité de Henri Konan Bédié de la
politique ethnocentrée d'Houphouët-Boigny. Contrairement à
cette dernière elle n'est pas compensée par les subtils
rééquilibrages ethnico-régionaux dans l'accès
à l'appareil d'État qu'Houphouët a pu d'autant mieux se
permettre que, durant la période du « miracle ivoirien »,
l'État fut un remarquable fournisseur d'emplois et redistributeur de
deniers publics, donnant au contraire à l'ivoirisation des emplois
publics, notamment des hautes fonctions politico-administratives, une
tonalité nettement baoulé, assimilant plus que jamais l'exercice
du pouvoir à l'ethnocratie baoulé.
Mais l'ivoirité se distingue encore plus nettement par
le fait d'utiliser la « baoulisation » comme un modèle de
défense d'intérêts plus étroitement nationaux,
c'est-à-dire en rompant effectivement avec cette autre dimension de la
politique « houphouëtienne » qui a permis à
quantité d'étrangers de travailler en Côte d'Ivoire et de
s'y assimiler. Autrement dit l'ivoirité en faisant du monde
baoulé, et plus largement akan, son fer de lance exclusif, attise le
sentiment d'exclusion des régions du nord méprisées depuis
l'indépendance et des krous, leurs principaux rivaux ethnique et
politique. (Babo,2012)
La tentative de redéfinition du contrat social
ivoirien par Konan Bédié est désavouée dans un
contexte où plus du tiers de la population issue de l'immigration est
exclu de la communauté ivoirienne, dès le début des
débats sur l'ivoirité. Sur une considération
ethno-politique, les individus présents dans le nord du pays commencent
à être considérés comme des citoyens de «
seconde catégorie » par les populations présentes dans le
sud du pays qui s'estiment être « les véritables ivoiriens
». Au sein des espaces urbains tel que celui du district d'Abidjan,
l'essentiel de l'activité économique informelle
Page 97 sur 227
est réalisé par des immigrés. Cela a pour
effet d'accentuer la stigmatisation des populations du nord du pays
amalgamées à la figure de l'étranger spoliant le travail
des ivoiriens (Babo,2012).
La rivalité politique qui oppose le Parti
Démocratique de Côte d'ivoire -Rassemblement Démocratique
Africain (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié, le Front Populaire
Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le Rassemblement des Républicains
(RDR) d'Alassane Ouattara a pour conséquence l'instrumentalisation de la
quête d'identité populaire, transformant celle-ci en une lutte
intercommunautaire plus en plus violente, contribuant à la brutalisation
la société urbaine. L'élection présidentielle de
1995 boycottée par l'opposition est un moment clef de la
légitimation politique de la violence et d'un enrôlement
inédit des jeunes sous des bannière politique et partisane.
Dans les régions rurales de l'Ouest, les
revendications foncières autochtones font particulièrement
échos auprès des jeunes déscolarisés et sans
emploi, rentrés dans leurs villages en quête d'un lopin de terre,
qui en viennent à s'organiser de façon martiale et autonome pour
défendre ce qu'ils considèrent être « leur territoire
» et à en chasser toute personne considérée comme
étrangère.
Dans la seconde moitié des années 1990, bien
avant le surgissement de la violence armée, on voit ainsi se multiplier
dans les villages et les petites localités du Sud-Ouest ivoirien, des
mouvements d'autodéfense et des milices plus ou moins ethniques
dirigées contre les allogènes. En réaction, les
allogènes s'organisent en structures analogues. L'institution sociale du
« barrage » se développe ce moment-là, avec ses
règles et ses acteurs, et la violence milicienne devient maître
dans certaines régions, prenant parfois la forme de pogroms comme
à Tabou, près de la frontière libérienne, en
novembre 1999 (Vidal, 2003).
Quelques années plus tard, on retrouvera pendant la
guerre, certains « barragistes » dans des groupes
d'autodéfense villageois, reproduisant leur savoir-faire du
road-block dans la lutte patriotique contre les « assaillants
» rebelles, ou le réaffecte à d'autres fonctions
miliciennes.
C'est dans ce contexte de contingence des luttes sociales et
politiques que s'amorce la transition militaire, qui accélére
malgré elle, la militarisation et la « milicianisation » du
champ politique ivoirien. Cependant considérer le putsch de 1999 comme
le basculement
Page 98 sur 227
de la société ivoirienne dans la violence est
une erreur manifeste. La violence était déjà
considérée, par l'essentiel de la population, comme partie
intégrante du système, comme indiquent les nombreux
témoignages des victimes des faux complots d'Houphouët-Boigny ou de
la coercition importante du régime Bédié. La chasse aux
étrangers de 1958 menée par les partisans de la LOCI qui a
mené à la création de la JRDACI est également
témoin de cet usage antérieur de la violence comme levier de
décision politique.
Hormis les épisodes précités des
années 1990, l'usage de la violence politique, toutefois, n'était
pas ostentatoire comme dans certains pays ; elle était plus subtile et
ciblée. La stabilité du régime était plus
assurée par le clientélisme institutionnalisé que par la
terreur. Certes, l'armée occupait une place importante dans le
système, notamment au sein de l'administration (douanes, corps
préfectoral) et des entreprises publiques, où les officiers
étaient nombreux. Mais, sur le plan symbolique, Houphouët-Boigny a
toujours veillé à déconnecter l'appareil militaire du
processus de légitimation politique. Le « Président-planteur
» tirait son aura d'autres registres que celui du fusil. Se méfiant
de sa propre armée, il la choyait financièrement et toléra
la pratique de la corruption de la part de ces derniers. Il s'est tout du long
de son règne reposé quasi exclusivement sur la « vieille
amie » française pour assurer la sécurité de son pays
et faisait en sorte que les FANCI (Forces armées nationales de
Côte d'Ivoire) demeurent une armée fantoche, composée
d'officiers fidèles, cantonnés à des taches de maintien de
l'ordre (Vidal,2003).
L'incapacité des héritiers
d'Houphouët-Boigny à fédérer la nation et à
proposer un avenir prospère au pays, a sans doute effrité
l'allégeance de l'armée dont le principal leader Robert Gueï
se trouvait exilé dans son village natal pour insubordination depuis
quelques années.
Page 99 sur 227
B. Résistance patriotique et rébellion :
brutalisation de la pratique citoyenne ivoirienne Transition
militaire et exclusion politique
D'après les travaux de Christian Bouquet nous pouvons
estimer qu'en 1999, après 6 années de gouvernance de Henri Konan
Bédié, la situation du pays est alarmante. La Côte d'Ivoire
fait face, à l'escalade de la violence interethnique entretenue par la
rivalité entre le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le
Rassemblement Des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara, une crise
économique, une corruption généralisée, un
népotisme ostentatoire et surtout un désengagement des bailleurs
de fonds internationaux.
Si le coup d'Etat du 24 décembre n'est pas du fait
d'une mobilisation sociale mais bien d'une initiative militaire, il ne souffre
d'aucune hostilité populaire. Dans ses premiers discours, le «
Général-Président » Gueï fait l'unanimité
populaire par son appel à la paix, la réconciliation nationale et
la tolérance. Sa ligne politique est celle du renouveau et de
l'assainissement des organes de gouvernance du pays. En outre il déclare
ne pas aspirer au pouvoir et s'engage à se retirer une fois les
conditions d'un suffrage universel sain établies.
Adepte du multipartisme, il consulte dès le 27
décembre 1999, 48 formations politiques sur 112 recensées pour la
composition de son gouvernement de transition. Si celui-ci eut pour vocation de
faire redescendre les tensions interethniques, il ne fera hélas que les
attiser. Sa composition jugée « trop nordique », pousse le FPI
à décliner sa participation. Il obtiendra 2 postes
supplémentaires pour revenir sur sa décision. Il faut dire que le
spectre d'Alassane Ouattara, président du RDR alors en exil politique,
cristallise l'action du FPI et la vie politique ivoirienne (Bouquet, 2005).
Le putsch de 1999 créer inexorablement une rupture
entre la Côte d'Ivoire et le reste monde. La nature putschiste du
régime de Robert Gueï est inacceptable pour la communauté
internationale dans la mesure où celui-ci vient se substituer à
un président élu démocratiquement. En interne, la
situation de conflit s'accentue avec de nombreux affrontements observés
dans l'ouest du pays. Accusé de complaisance à l'égard des
étrangers par le FPI, le Général-Président Robert
Gueï, dont les velléités de durée
Page 100 sur 227
politique se sont finalement révélées,
s'aligne au fil de sa régence sur la ligne politique du FPI et du
PDCI-RDA. Il déclare ainsi le 28 février 2000 que
l'ivoirité est un « bon concept ».
En adéquation avec le discours démocratique du
Général-président Gueï, le Comité National de
Salut Public (CNSP) propose en janvier 2000, un calendrier électoral
comprenant un référendum sur la constitution en juillet, une
élection présidentielle en septembre et une élection
législative en décembre. Ce référendum est
l'occasion d'un arbitrage citoyen relatif aux conditions
d'éligibilités des candidats à l'élection
présidentielle, présentes dans l'article 35 de la nouvelle
constitution ivoirienne. Le débat public s'articule essentiellement
autour du conflit politico-ethnique opposant le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR
de Alassane Ouattara sur l'éligibilité de ce dernier (Bouquet,
2005).
Marc le pape met en exergue qu'au coeur de ce conflit, se
trouve un antagonisme entre deux thèses irréconciliables. D'un
côté, les preuves de la nationalité d'Alassane Ouattara
sont fausses et en outre il s'est prévalu d'une autre nationalité
de ce fait il ne peut donc être candidat. La déclaration de Henri
Konan Bédié en 1999, qui qualifie Ouattara de «
burkinabè qui n'a pas à se mêler de nos affaires de
succession » démontre du ressentiment du sud ivoirien à
l'égard du président du RDR. De l'autre, l'identité
ivoirienne d'Alassane Ouattara est affirmée, démontrée, et
sa négation est vécue comme un acte insultant, humiliant pour
ceux dont le nom, l'origine et la carte d'identité rapprochent de lui
(Le pape, 2003).
A de fréquentes reprises, l'ancien Premier ministre
doit présenter, lors de ses discours, la généalogie
témoignant de ses origines ivoiriennes (Le Pape,2003). C'est ainsi,
qu'en août 1999, à l'occasion du congrès de son parti il se
déclare candidat à la présidentielle malgré les
conditions requises en matière de nationalité, de filiation et de
résidence qui sont censées l'en empêcher. Il se justifie
à travers les propos suivants : " Ma mère Hadja Nabintou
Cissé, originaire de Gbéléban au nord-ouest de la
Côte d'Ivoire, vit à Cocody, et tout le monde la connaît.
Mon père, El Hadj Dramane Ouattara, originaire de Kong au nord-est de la
Côte d'Ivoire, installé naguère à Dimbokro, y
était bien connu, notamment par le président Félix
Houphouët Boigny, et notre cour familiale est toujours là,
habitée par mon frère Sinaly Ouattara. Je suis né à
Dimbokro et tout le monde le sait".
Page 101 sur 227
Pour comprendre l'intensité des passions
suscitées par ce problème de nationalité, il est
nécessaire de rappeler qu'elles ne sont que la conséquence de
l'usage de l'ivoirité dans la vie publique et politique.
L'ivoirité ne recouvre rien de précis, c'est ce qui fait sa
force. Malgré des conditions hostiles, Alassane Ouattara se
présente malgré tout à l'élection
présidentielle (Le pape,2003).
L'avant-projet de constitution présenté le 28
février par la Commission consultative constitutionnelle et
électorale (CCCE), va dans le sens d'un durcissement des conditions
d'éligibilité. Ainsi l'article 35 stipule que : « le
président de la République doit être ivoirien d'origine,
né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine.
Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne
et ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. En
outre il doit avoir résidé sur le territoire ivoirien les 5
années précédent le scrutin duquel il est candidat
».
Si les conditions de présence sur le territoire et la
non prévalence d'une autre nationalité sont clairement des
critères qui vise à l'éviction politique de Ouattara, la
procédure de justification de l'ascendance nécessaire à
l'éligibilité politique et à l'accès à la
citoyenneté ivoirienne est perçue comme une exclusion par la
population présente dans le nord du pays, issue pour la majorité
de la tradition d'immigration ivoirienne (Bouquet,2005).
Le changement de vocable des opposants à la
candidature de Ouattara transformant « l'ivoirité » en «
identité ivoirienne » ne parvient pas à masquer la dimension
xénophobe de l'application politique de celle-ci. D'autant plus que le
RDR est alors accusé par son opposition et la Ligue ivoirienne des
droits de l'homme (LIDHO), d'entretenir une vaste fraude à la carte
d'identité depuis la nomination de Ouattara au poste de premier ministre
en 1990. En conséquence de cette accusation, la LIDHO exige une
révision des titres d'identité remis entre 1990 et 2000. Il n'est
pas aberrant de penser que dans le contexte de corruption
généralisée et structurelle de la Côte d'Ivoire, des
fraudes à la carte d'identité aient bien eu lieu, mais
l'accusation ouverte et ciblée de la LIDHO démontre du manque de
recul et maturité politique des citoyens et organisations
présentes en Côte d'ivoire à ce moment-là. En
réponse à la création de la LIDHO, jugée trop
complaisante du pouvoir et vectrice de la xénophobie sudiste, le
Mouvement ivoirien des droits de l'homme (MIDH) est créé.
Celui-ci opère en premier lieu dans la clandestinité et se fait
porte-parole des populations du nord, dont la stigmatisation attise la
colère.
Page 102 sur 227
Les sorties médiatiques de la première dame
ivoirienne de l'époque, Rose Doudou Gueï, précipitent un peu
plus le schisme entre un nord considéré alors par les populations
du sud comme acquis aux étrangers et un sud, lui-même
considéré comme envahi par ces mêmes étrangers,
marquant par ailleurs la fin de l'état de grâce de Robert
Gueï, qui ne parvient plus à se défaire de
l'étiquette du fascisme.
Dans le souci d'apaiser les populations du nord, il propose
le 27 avril 2000 une révision des conditions d'éligibilité
politique et d'accès à la citoyenneté. Si désormais
tout prétendant à l'investiture doit être né de
père « ou » de mère ivoirien d'origine, Alassane
Ouattara demeure exclu des prétentions présidentielles dans la
mesure où il s'est prévalu d'une autre nationalité
politique. Cette clause retirée par la Commission consultative
constitutionnelle et électorale (CCCE) précédemment est
alors réintroduite par Robert Gueï.
La montée des tensions consécutives à
cette décision pousse Robert Gueï à dissoudre son
gouvernement. Ce remaniement est l'occasion, d'évincer le RDR du
gouvernement. Si à partir de ce 27 avril 2000, l'essentiel de la
préoccupation de Robert Gueï est de soigner sa stature
présidentielle, il doit néanmoins faire face aux
conséquences de la « milicianisation » de l'armée
initiée par son putsch. La mutinerie provoquée par les militaires
le 4 juillet 2000, qui réclame un « trésor de guerre »
de 6 millions de francs CFA par homme, soit dans les environs de 9000€ par
tête démontre de cela (Bouquet,2005). Si elle fut maitrisée
par la répression, cette mutinerie témoigne également du
désengagement du corps militaire de sa vocation première à
servir et protéger les citoyens.
L'allégeance militaire ivoirienne au politique
dépend dès lors de 3 facteurs : la capacité du meneur
à répondre aux exigences économiques de ses troupes, sa
provenance ethnique et de sa volonté et capacité à
intégrer les nouvelles recrues à l'appareil
politico-militaire.
Six jours avant le référendum, le «
Général-président » Gueï modifie à
nouveau l'article 35 de la constitution qui est soumise au vote. Ainsi il
fallait bien être né de père « ET » de
mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Cet acte se présente
comme un contre-pied à l'appel d'Alassane Ouattara à voter en
faveur de la constitution le 26 mai 2000. En dépit de la
Page 103 sur 227
période de tension, la constitution est massivement
adoptée par 86,3% des suffrages exprimés avec un taux de
participation de 65,05% (Bouquet,2005).
Le reste de la campagne est marquée par
l'éviction définitive du RDR de l'élection ainsi que du
PDCI-RDA. Les deux candidats principaux à la présidence du 22
octobre 2000 sont alors Robert Gueï et Laurent Gbagbo. Si le premier ne
fait pas réellement campagne, le second certainement sur de sa victoire
profite de sa campagne pour mettre en garde le président sortant sur la
nécessité d'accepter pacifiquement les résultats du 22
octobre.
L'élection du 22 octobre 2000 marque le retour des
« conflits ouverts » sur le territoire ivoirien. Le FPI de Laurent
Gbagbo met en oeuvre un dispositif d'observation reposant sur l'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que sur la
mobilisation de la force armée pour bénéficier de la
lecture des résultats en temps réel. Ceci n'est pas du goût
du président sortant qui fait alors intervenir la « Brigade rouge
», une des milices qui lui est fidèle, à la Commission
Nationale Electorale, pour faire pression sur cette dernière. Le
ministère de l'intérieur annonce la dissolution de celle-ci
après qu'elle ait proclamée la victoire du Général
Gueï à 52,72% des votes exprimés.
La contestation de Laurent Gbagbo est suivie d'une
mobilisation de « patriotes », invités à descendre dans
la rue pour faire barrage à l'imposture du résultat. Si dans un
premier temps les affrontements entre les pro « Gueï » et les
« patriotes » de Laurent Gbagbo gangrènent les rues et
l'armée, causant 9 morts, la nature des heurts change rapidement. A la
proclamation des résultats définitifs faisant de Laurent Gbagbo
le nouveau président ivoirien, les « patriotes »
composés de civils et de militaires pour la plupart armées,
prennent alors pour cible les militants du RDR qui ont profités de
l'incertitude des résultats pour manifester en faveur de la tenue d'une
nouvelle élection. Les rues d'Abidjan prennent ainsi des airs de 1958
quand une véritable « chasse aux dioulas » ethnie
assimilée à Alassane Ouattara, est menée nous rappelant
les agissements de la Ligue des Originaires de Côte d'ivoire (LOCI). Le
bilan est de 155 morts, 316 blessés et 50 disparus. En outre, le premier
charnier, pratique qui se démocratisera pendant la rébellion
nordiste est découvert dans le quartier de Yopougon (Bouquet, 2005).
Le climat de violence ne s'efface pas fin avec la
proclamation définitive de Laurent Gbagbo à la tête de la
Côte d'Ivoire, dans la mesure où les élections
législatives de décembre 2000
Page 104 sur 227
s'inscrivent dans la continuité des
présidentielles, et ne donne qu'une victoire politique au FPI, qui en au
printemps 2001 préempte l'ensemble des sphères
législatives et exécutives ivoiriennes.
Longtemps considérée comme un modèle de
paix et de stabilité en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire,
poumon économique de la sous-région, bascule à la fin des
années 1990 dans un cycle de crise militaro-politique, qui met fin
à l'hégémonie du PDCI-RDA, le 24 décembre 1999.
Mené par le général Guei,
surnommé pour ce fait le « père Noel en treillis », le
putsch de 1999 selon Richard Banégas constitue un séisme dans la
trajectoire somme toute assez tranquille de la « révolution passive
» ivoirienne, une rupture dans les mécanismes de
dérégulation sociopolitique jusqu'alors en vigueur qui
s'exprimaient dans une idéologie politique de la paix et de la
cohésion sociale.
Mais, comme nous avons pu voir, ce putsch fait suite à
une montée des tensions qui s'amorce dès le début des
années 1990, sous le règne d'Houphouët-Boigny, avec la
répression féroce du mouvement démocratique qui est
mené par le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et un
syndicat étudiant qui allait devenir très puissant, à
savoir la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire (FESCI).
Ces violences d'Etat, qui ciblent les dirigeants des partis d'opposition et les
leaders étudiants, ont un important effet de crantage, dans la mesure
où elles légitiment en retour l'usage de la force et de la rue
contre un régime dont la forte répression est
considérée comme illégitime par la majorité de la
population. Elles constituent aussi un des premiers moments de la «
milicianisation » des luttes politiques ivoiriennes, le pouvoir
n'hésitant pas à louer les services de loubards surnommés
« vagabonds salariés » et plus communément
nommés « VS » dans les quartiers où ils
sévissent, pour casser les grèves et réprimer tout forme
d'oppositions au régime.
Les enquêtes menées par Richard Banégas
montrent que certains épisodes de cette période demeurent des
références importantes de la grande gente milicienne
d'après-guerre : ceux qui ont été les victimes directes ou
indirectes de cette coercition déléguée aux nervis du
régime y font souvent référence dans les justifications de
leur engagement, notamment les membres de la FESCI.
Page 105 sur 227
Le putsch de décembre 1999 rompt également avec
la trajectoire historique de cantonnement politique de l'armée. Il
inaugure un cycle de violence marqué par la multiplication de tentatives
de coups d'Etat et la radicalisation de la répression politique. On peut
retenir 3 effets majeurs de cette séquence. Elle contribue d'abord
à légitimer l'usage de la violence armée comme moyen
d'arbitrage politique. Dès lors les militaires en rupture de ban et les
jeunes miliciens deviennent les faiseurs de rois et les juges de paix de la
compétition politique. Bien entendu ils ne détiennent pas le
monopole de la légitimité politique mais la classe politique et
plus particulièrement les héritiers de l'houphouëtisme ne
peuvent plus gouverner sans eux. Le second effet majeur de la transition
militaire est l'accélération du double processus de «
milicianisation » de l'armée et de la société qui
s'était engagée dans la décennie
précédente.
Dès le début de la junte militaire, on peut
observer une désagrégation immédiate de l'appareil de
sécurité dont la gendarmerie, jusque-là
réputée pour sa discipline, qui se divise en de multiples
factions, qui obéissent souvent moins à la chaine de commandement
officiel qu'à des hiérarchies informelles et à des clans
personnels. En vérité, ce processus débute pendant la
gouvernance de Henri Konan Bédié, qui n'est pas parvenu à
garantir la cohésion des Forces armées nationales de Côte
d'ivoire (FANCI) comme son prédécesseur. Les sous-officiers
originaires de l'Ouest et surtout du Nord, très nombreux dans
l'armée et souvent d'extraction modeste, ont mal vécu la
dégradation de leurs conditions sous la présidence
Bédié.
Ce sont ces officiers qui mettent fin au régime de
Henri Konan Bédié en décembre 1999, confiant ensuite les
rênes du pays au général Robert Gueï. Dans le sillage
de ces jeunes mutins de décembre 1999, on voit alors se constituer des
factions militaires plus ou moins autonomes au sein de l'armée et des
structures parallèles qui deviennent très vite des milices
urbaines, plus ou moins affiliées à un « leader »
politique mais qui n'obéissent en vérité qu'à leurs
petits chefs militaires, dont le lieutenant Boka Yapi et le sergent-chef
Ibrahim Coulibaly dit « IB » que l'on retrouvera à la
tête de la rébellion de 2002. Leurs dénominations que l'on
peut qualifier de mafieuses tel que « Camorra », « Cosa Nostra
», « Brigades rouges » ou « Mafia » traduisent des
dérives criminelles de ce régime de transition se livrant
à toutes formes de violences et de pillages.
Page 106 sur 227
La veine tentative du général Guei de
restitution de l'ordre dans ces structures durant l'été 2000 par
le démantèlent du « PC Crise » et l'exil de « IB
» démontre de la grande inquiétude du «
Général-Président » relative à sa
capacité à les contrôler. Au vu de l'Histoire, il apparait
clair que le mal était déjà fait. Robert Gueï est
rapidement dépassé par les velléités de ses
partisans militaires comme civils qui l'ont fait roi et qui se
considèrent dès lors au-dessus des lois. De fait, le
troisième effet notable de cette transition militaire a
été de contribuer à une diffusion rapide de la violence
dans l'espace public et, surtout, de renforcer le sentiment d'impunité
de ceux qui l'utilisaient pour accumuler richesses et pouvoir
(Banégas,2010).
Rébellion et démocratisation des milices en
Côte d'Ivoire

Figure 21: La crise ivoirienne entre 2002 et 2007
(PARMENTIER, 2007)
Page 107 sur 227
La notion de milice, qui, de façon
générale, prête déjà à confusion,
définit ici plusieurs types de regroupements et modes d'action. On peut
en distinguer trois : les forces paramilitaires de l'Ouest, les groupes
d'autodéfense villageois et les milices urbaines constituées pour
l'essentiel des « jeunes patriotes » de Laurent Gbagbo. Toutes ces
structures n'ont pas forcement pris une part active aux combats, certaines se
spécialisant plutôt dans l'action de rue, l'intimidation et la
mobilisation de masse comme les Jeunes patriotes d'Abidjan ou la FESCI.
Précisons d'ailleurs que la situation de conflit
ouvert est très brève entre septembre 2002 et l'été
2003, avec quelques épisodes de violences sporadiques par la suite. Bien
que ces affrontements donnent lieu à des violences extrêmes dans
certaines zones, il faut souligner que les anciens combattants ont, en
comparaison d'autres situations, pas beaucoup ou pas longtemps combattu. La
typologie milicienne présentée plus haut est purement analytique
et non exhaustive car, d'une part, on constate que les frontières entre
ces divers mouvements sont très poreuses sur le terrain et, d'autre
part, on sait que ces mouvements participent d'une même nébuleuse
de forces parallèles qui ont été organisées et
financées en haut lieu par les premiers cercles du pouvoir
présidentiel (Banégas,2010).
Quoique non homogènes et pas toujours
coordonnées, ces diverses forces parallèles s'inscrivent dans un
continuum de privatisation de la violence et de para-militarisation du pouvoir
dont l'exercice, durant la guerre, s'est informalisé. Ces structures
sont très actives aux débuts du conflit ; ce sont elles qui
permettent au régime de se maintenir. Leurs activités par la
suite, varient en fonction des évènements ; certaines
disparaissent, d'autres font évoluer leurs fonctions et leurs raisons
sociales, mais la plupart se maintiennent et posent le défi majeur de
l'après-guerre. De par sa signification sociale et politique, le
phénomène milicien et son devenir s'est rapidement
révélé un facteur à considérer dans
l'appréciation du processus réconciliation post-conflit
(Banégas,2010).
Les racines de la guerre civile ivoirienne
débutée en 2002 sont rendues complexes par une pluralité
de causes allant de la crise économique et du chômage des jeunes
à la question de la citoyenneté en passant par la politique
foncière. Par conséquent, les acteurs que cette guerre civile
implique sont motivés par des logiques et des représentations
différentes rendant compte des dynamiques les impactant au début
du conflit.
Page 108 sur 227
L'approche des perceptions du conflit permet ainsi de
comprendre certaines logiques, souvent sous-jacentes, qui motivent les jeunes
combattants ivoiriens. Leurs représentations et leurs
compréhensions de la guerre diffèrent dans la majorité des
cas de celles de leurs hiérarchies politiques et militaires,
essentiellement communautaires. Mais ils trouvent cependant des justifications
de leur enrôlement dans les expériences de frustrations
identitaires.
L'évocation d'une lutte pour la liberté dans
laquelle les jeunes ivoiriens perçoivent des valeurs telles que le
sacrifice, l'abnégation ou encore le courage est à mettre en
rapport avec leurs volontés d'être partie prenante du processus de
transformation sociale, politique et économique du pays. La violence des
jeunes ivoiriens au plus fort de la crise repose sur un socle social et
communautaire qui fournit au conflit son ancrage local. Aussi, on peut observer
parmi les déterminants de leur enrôlement, l'implication de
ceux-ci à divers niveaux de l'instance familiale et communautaire.
L'enrôlement au sein d'une milice constituant le gage d'une
sécurité familiale et communautaire.
Michel Galy note par ailleurs, que la légitimation du
recours à la force armée tire ses arguments des
événements de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire.
Cette approche nous permet d'explorer les différentes significations que
prend le conflit dans les représentations collectives. Ainsi, il a
été mis en évidence le lien entre les perceptions de la
nature du conflit et un processus social de légitimation de
l'enrôlement des jeunes. Cependant, ces derniers s'opposent à
l'idée d'une sécession ou d'irrédentisme tout en
définissant l'idée de la patrie sur la base d'une
idéologie valorisée dans leur aire culturelle exclusive
(Galy,2010).
En somme, selon Moussa Fofana le conflit ivoirien
s'établit sur la base d'ancrages locaux et d'une accumulation de
frustrations antérieures, terreau fertile dans lequel chacun a
trouvé les justifications de son engagement. On ne peut occulter la
prédominance d'une idéologie victimaire dans la mobilisation des
combattants. La question identitaire posée au départ du conflit
est devenue une entrée possible pour attirer l'attention sur les
perceptions variées de la citoyenneté et les insuffisances des
mécanismes de régulation politiques, sociales et mêmes
économiques de la société ivoirienne (Fofana,2011).
Page 109 sur 227
Si les rebellions locales ont tout intérêt, pour
asseoir leur légitimité, à se poser dans un contexte
national et à nier les influences ou alliances extérieures, un
comparatisme rapide dévoile au contraire bon nombre de liens
étonnants, au-delà des discours. Si des chercheurs comme Stephen
Ellis et surtout Paul Ritchards ont mis l'accent sur les catégories
d'âge et d'ethnicité de rébellions socialement et
politiquement dominées, nous pouvons mettre en avant le caractère
spatialement périphérique, dans une double acceptation spatiale
et sociale de ces mouvements dans la crise ivoirienne.
Au regard de la période de conquête coloniale,
procédant des côtes vers l'intérieur, le caractère
politique des périphéries ivoiriennes dominées et
délaissées prend alors une dimension structurelle. Des chercheurs
comme Claude Raffestin, comparant les modes de construction de l'Etat, n'ont
pas hésité à généraliser ce
phénomène : quand l'Etat se montre fort et juste en son centre,
il est au contraire plus distant et coercitif au sein de ses territoires
constituant ses marges. Pour autant, nous nous abstiendrons de tout
déterminisme dans la mesure où un guérillero ne naît
pas tout armé à chaque frontière. Il faut pour cela des
circonstances particulières, une histoire propice, des financements, une
organisation, etc. Les mouvements rebelles d'Afrique de l'ouest ont souvent
été appréhendé au regard d'autres Etats africains,
la plupart d'entre eux patrimoniaux. Ainsi, l'économiste Paul Collier
prête aux « War Lords » des mentalités exclusivement
entrepreneuriales et des moeurs seulement capitalistiques.
Le discours structurant des rébellions peut avoir une
certaine consistance idéologique bien que leurs pratiques en
diffèrent sensiblement. Qu'il s'agit du discours anti-corruption et
anti-Krio (créole) du Front Révolutionnaire Uni (RUF) de Sierra
Leone, des revendications libératrices du Front national patriotique du
Libéria (NPLF) de Charles Taylor contre la dictature de Samuel Doe au
Libéria, ou encore des revendications pro-Rassemblement des
Républicains (RDR) illustrant des revendications nordistes contre
l'ivoirité défendu par le Mouvement Patriotique de Côte
d'ivoire en Côte d'Ivoire (MPCI). Autant de registres évocateurs
de revendications politiques, même s'ils heurtent l'idéal marxiste
des guérillas anciennes. A travers ces idéologies mobilisatrices
se dessinent les failles et les faillites des Etats concernés.
Fonction tribunitienne des guérillas devant la
corruption du système électoral, elles se heurtent cependant aux
structures sociales. Nous pensons ici à l'émancipation brutale
Page 110 sur 227
d'une jeunesse, dont la démographie galopante, conduit
à sa subordination structurelle. Elles ne proposent au mieux qu'une
alternance de prédation basée sur une certaine logique autochtone
du pouvoir : « à chacun son tour... de bouffer ! ».
L'imaginaire populaire ivoirien de la rébellion,
s'appuie essentiellement sur une logique complotiste qui considère que
l'instigateur véritable de celle-ci demeure caché, attendant
patiemment son heure. Selon cette considération, bon nombre d'ivoiriens
considèrent encore les mouvements insurrectionnels, dans sa seule
dimension de bras armé du RDR et de ses alliés, nonobstant les
terribles sévices subit par la population du nord de la part de rebelles
devenus très rapidement incontrôlables au fil de la
rébellion. Cette représentation comporte l'avantage provisoire de
rendre compte de l'autonomisation partielle de la rébellion et de son
ancrage territorial, l'un expliquant partiellement l'autre sans toutefois en
épuiser le sens.
Le mystère des origines de la rébellion qui
n'est pas sans rappeler celui des sociétés secrètes,
attire de nouveaux combattants, aventuriers des temps modernes de toute la
région, qui ont trouvé dans le nomadisme guerrier une situation
pérenne. Pour le camp présidentiel, dont les patriotes et
l'armée loyaliste constituent les forces, les rebelles sont à la
fois des militaires putschistes assoiffés de pur pouvoir, terroristes
islamistes, bataillon détaché burkinabé, ou encore
mercenaires déployés par les occidentaux en
général, français en particulier. Parfaitement
contradictoires, ces considérations ont le mérite de s'appuyer,
tour à tour sur d'indéniables indices tirés de la
chronologie du mouvement rebelle (Galy,2007)
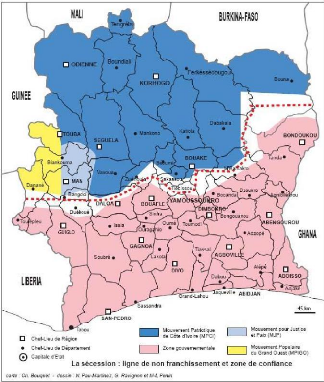
Page 111 sur 227
Figure 22: Les principales factions de la rébellion
ivoirienne (BOUQUET, Pau-Martinez, 2016)
Bien que la croissance rapide des effectifs rebelles soit due
au ralliement des militaires déchus de l'armée officielle, la
présence au début de la rébellion de mercenaires venus du
Libéria et de la Sierra Léone atteste indéniablement du
phénomène de nomadisme guerrier ouest-africains. Ce nomadisme
entraine l'importation de méthodes utilisées en Sierra Leone et
au Libéria telles que l'utilisation d'enfants soldats. Une majeure
partie des travailleurs de l'informel et des chômeurs urbains et ruraux
du Nord ivoirien se constitue en troupes supplétives aux soldats d'une
rébellion, au début inférieur à un millier
d'hommes. La rébellion bénéficie également à
travers eux d'un certain enracinement ethnique.
Plus hypothétique encore, la présence de
soldats burkinabè, avec ou sans uniforme, même s'il est de
notoriété publique que Ouagadougou sert de base arrière
aux leaders
Page 112 sur 227
rebelles qui y possédaient, grâce au
président Compaoré, villas et 4x4, subsides et armes, ainsi que
des facilités de voyage à l'étranger et
d'entraînement militaire. (Galy,2007).
De ces contingents hétérogènes, les
médias internationaux en ont trop vite fait une unité, à
la fois guérilla et mouvement politique. L'« opération MPCI
» a bien été, de l'avis de beaucoup, montée à
posteriori, après l'échec du putsch amenant à la
rébellion et son cantonnement par la force Licorne au Nord de la
Côte d'Ivoire. Celle-ci a néanmoins introduit des
réalignements inédits tout en favorisant un clivage inattendu
militaires/civiles. Le pouvoir rebelle, en dehors du clivage factionnel entre
les principaux leaders Ibrahim Coulibaly dit IB et Guillaume Soro, est plus
à concevoir comme une nébuleuse, faite d'agencements changeants,
de chefs de guerre et de leurs troupes, que comme un système de
commandement hiérarchisé. La reconnaissance des leaders locaux
tels que les « commandants de zones » dit « coms zone », en
charge d'un périmètre dont la surveillance est assurée par
des « commandements opérationnels » assignés à
des postes urbains, peut faire illusion de la réalité qui est
celle de rivalités incessantes pour les rackets, régulées
par les armes. Ainsi, une logique de fiefs se développe, symbole d'une
territorialisation de la violence, qui oblige les leaders rebelles à
tenter de nouer des alliances avec les pouvoirs autochtones, comme Koné
Zackaria, le chef de guerre de Vavoua. Un certain repli sur les fiefs est
observable, à partir de l'exécution du caporal-chef Bamba
Kassoum, taxé de pro-Ibrahim Coulibaly (IB) et bien avant, celle du chef
de guerre Adams, à Korhogo.
La violence militaire, criminelle ou politique, en zone
rebelle, est mal connue et documentée ce qui permet une importante
spéculation à son sujet. En termes de gouvernance et de
définition de la légitimité de la rébellion, de la
cohérence de ses pratiques avec son idéologie, le sujet est
pourtant crucial. La représentation de la violence peut cependant se
nuancer selon les temps et les lieux. Dans sa dimension chronologique, elle est
le fait de « violences de guerre » à l'encontre de
l'armée ivoirienne et des « corps habillés », de
massacres de fonctionnaires et de civils sudistes qui restent à
élucider, d'« épuration ethnique » largement
sous-évaluée, notamment de la part des acteurs humanitaires qui
collabore avec la rébellion en zone nord, en particulier dans la ville
de Bouaké ; et par un massacre ethnico-factionnel au sein de la
rébellion, lors de l'épuration violente par les miliciens de
Guillaume Soro.
Page 113 sur 227
Cela n'empêche pas une « violence ordinaire »
contre la population locale, régulière et sanglante, encore plus
mal connue, due en particulier à l'absence de forces de l'ordre au sein
de l'appareil militaire rebelle. A ce propos, la représentation
populaire de l'action rebelle est incarnée par le massacre gratuit, par
une des factions de la rébellion, de jeunes filles baoulés
exécutant dans un petit village près de Sakassou une danse
rituelle d'exorcisme de la violence. Cet épisode mineur, qui touche
autant les représentations que l'immolation des enfants de gendarmes
sudistes de Bouaké, a bien sûr à voir avec la perte d'une
certaine innocence du vivre ensemble et du temps des rituels remplacés
par celui de la violence pure.
Dans l'ouest, une « libérianisation » du
conflit conduit à des formes de violences plus anomiques, du moins
proches de celles observées lors du conflit du Libéria, à
tel point que la rébellion elle-même se débarrasse de
leaders comme le « pseudo Doe » et de groupes nomades qui enfreignent
les pratiques de la rébellion de Bouaké, elle-même pourtant
peu regardante sur les exactions contre les civils. Ainsi on peut
évoquer une « épuration ethnique sporadique » sur
plusieurs points de la zone rebelle, dans les territoires proches du
Libéria, contre les guérés en particulier. Il est vrai que
cette « libérianisation » du territoire ivoirien reste
partagée, puisque les deux camps loyalistes comme rebelles, ont
instrumentalisé des couples d'oppositions ethniques transfrontaliers,
depuis longtemps sous-jacentes ainsi que des groupes nomades mercenaires, issus
des conflits du Libéria et de la Sierra Leone, en quelque sorte
recomposés pour poursuivre leurs carrières guerrières
(Galy,2007).
L'évolution sanglante de l'Ouest porte tellement
préjudice à la rébellion que l'éviction du «
pseudo Doe », leader éphémère de l'inconsistant
Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) apparaît du fait du
leader Guillaume Soro. A Bouaké, capitale rebelle, les pratiques des
groupes « militaro-mafieux », dénommée « Camorra
», « Cosa nostra » ou encore « Ninja », qu'a connu
Abidjan sous la transition militaire du général Gueï, se
perpétuent voire s'accentuent. Cela n'étonne aucun analyste, tant
il est connu qu'un groupe des « fondateurs » de la rébellion
est justement issu de cette mouvance. Selon une enquête de la Ligue des
droits de l'Homme ivoirienne (LIDHO) de février 2003, « environ 80
% des violences sont perpétrées par les rebelles ». Il est
important de mentionner ce fait dans la mesure où il est quasiment
absent du traitement médiatique
Page 114 sur 227
international de la rébellion et constitue dès
lors un différentiel de représentation de la guerre entre
ivoiriens et étrangers, notamment européens.
A ce jour, un important travail d'enquête villageoise
reste à effectuer en particulier dans la zone nord. Des ONG
françaises, telles Action contre la faim (ACF), remarquent que la
violence systématique contre les populations civiles de l'Ouest au
moment des faits est sous-évaluée. Il faut y voir la conjugaison
d'incursions libériennes et de pratiques extrêmes, qui
échappent en partie au pouvoir de Bouaké, avec une
criminalisation des forces en présence, aggravée par un
système de représailles non seulement interethniques
(inter-ivoirien), mais avec les immigrants nordistes au sens large («
dioulas » et sahéliens) dans une compétition foncière
aiguë (Galy 2007).
Page 115 sur 227
Les dimensions mystiques du conflit ivoirien
Bien que mis à la marge des considérations
relatives à la guerre civile ivoirienne, l'approche par un angle
mystique du conflit peut apporter un éclairage sur les allures de «
guerre sainte » que peut prendre le conflit ivoirien à son
Momentum.
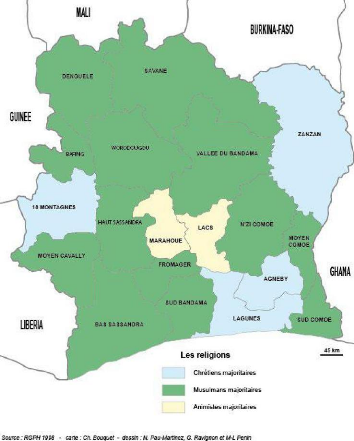
Figure 23 : Répartition ethnique et religieuse en
Côte d'ivoire (Bouquet, Pau-Martinez, 2016)
La Côte d'ivoire abrite essentiellement deux aires
cultuelles sur son territoire. L'islam est la religion la plus
représentée sur le territoire tandis que le christianisme est
majoritaire dans la zone ivoirienne la plus peuplé, à savoir la
région des lagunes.
Page 116 sur 227
Le spiritisme ivoirien se caractérise par un
syncrétisme entre les dogmes des religions monothéistes
dominantes et des pratiques et croyances vernaculaires tels que l'animisme et
le vodou.
Les jeunes patriotes menés par Charles Blé
Goudé, au-delà d'une certaine connivence ethnique avec le
président voue un véritable culte à celui surnommée
« Le christ de Mama », nom du village natal de Laurent Gbagbo. Le
président Gbagbo, ancien professeur de géographie et membre de
l'international socialiste, est un orateur né qui sait galvaniser les
foules, alternant les postures, allant d'un Mandela Ouest africain de par son
combat politique l'ayant mené en prison à un Thomas Sankara de
par sa relation tumultueuse au monde et à l'occident. Et manifestement
d'Houphouët-Boigny de par sa volonté de restaurer la pratique du
« dialogue à l'ivoirienne » disparu avec « le vieux
».
C'est en vertu de ces considérations, que la
représentation des jeunes patriotes, fervents chrétiens
évangélistes, pratiquants pour la plupart, du « Christ de
Mama » est celle d'un élu prophétique dont le rôle est
de restaurer la grandeur de la Côte d'Ivoire. Cette vision est largement
diffusée au sein de la population par un appareil religieu proche du
pouvoir, composée de pasteurs et de prophètes dont
l'intégrité au vu des événements peut être
remise en cause.
Cette représentation « messianique » de
Laurent Gbagbo est renforcée à mesure que sa ligne politique est
empreinte d'une valeur communautaire qui fait de l'ère Gbagbo,
l'ère de l'hégémonie bété, où chaque
membre de sa communauté « pourrait bouffer à son tour
». Ainsi l'accès aux privilèges du peuple bété
est récompensé par une allégeance que l'on peut qualifier
de fanatique de celui-ci à son président.
On peut retrouver actuellement à travers des meetings
du mouvement « Gbagbo Revient ! dit Gbor » les derniers vestiges du
culte voué à Laurent Gbagbo, devenu martyr depuis son
déferrement à La Haye. Le spectre d'un retour à la vie
politique de l'ancien leader du Front Populaire Ivoirien constitue une menace
majeure au fragile équilibre de « paix » présent sur le
territoire ivoirien depuis 2011.
L'essentiel des forces armées rebelles, composé
de jeunes pour la plupart désoeuvrés issus des villages du nord
du pays, est essentiellement de confession musulmane. Le courage de ces troupes
sur le champ de bataille provient, outre de l'alcool et de la drogue, de la
Page 117 sur 227
confiance en la protection des « fétiches »
prescrits par leurs marabouts familiaux. Il va de soi que l'efficacité
de ce que certains nommeraient placebo, ou encore efficacité magique
n'est rendu possible que par l'acceptation collective de l'existence d'une
transcendance dépassant la compréhension humaine.
L'émergence des dozos au coeur du conflit ainsi que
l'institutionnalisation de ceux-ci à partir de 2011 traduit d'un
amalgame entre des considérations mystiques et des impératifs
sécuritaires. On pourrait considérer cet amalgame comme un retour
à une forme d'organisation sociale précoloniale mais lorsque que
l'on s'intéresse de plus près à cette
institutionnalisation des dozos, il apparait évident qu'il
s'agit plus d'un opportunisme politique des principaux leaders des associations
de dozos que d'un retour à des valeur passés de la
société ivoirienne.
Entre modernisme et tradition ; l'institutionnalisation des
dozos
Rodrigue Fahiramane Koné met en avant que pour
comprendre son émergence politique et institutionnelle, il est
primordial de comprendre le caractère multidimensionnel du
phénomène dozo. En plus de la profondeur historique et de
l'épaisseur culturelle qu'évoque la confrérie dozo, son
association avec la problématique sécuritaire ivoirienne permet
d'éclairer sous un angle original l'histoire politique récente du
pays.
En Côte d'Ivoire la majeure partie des adeptes de la
confrérie dozo appartiennent aux ethnies Mandé (Malinké,
Bambara, Dioula) et Voltaïque (Sénoufo et Lobi). Les mandés
et voltaïques ont historiquement été implantés dans
la partie septentrionale du pays.
La plupart des travaux spécialisés sur ces
chasseurs font des empires Mandingue et du Mali le foyer originel de la
confrérie dozo. L'Empire mandingue fut une importante entité
politique du Moyen-Age ouest africain fondé au XIIIe siècle par
le souverain Soundjata Kéita. Cet Empire a su fédérer sur
une longue période un ensemble de communautés reconnues
aujourd'hui sous le vocable de communautés mandingues. La chute de cet
empire qui connait son apogée au XIVème siècle a
marqué l'expansion géographique, après plusieurs
migrations, des différentes communautés mandingues dans une large
partie de l'Afrique de l'Ouest.
Les associations de dozos en Côte d'Ivoire sont avant
tout des confréries de chasseurs traditionnels reflétant, du
point de vue anthropologique, une institution socio-culturelle
Page 118 sur 227
propre aux traditions de l'aire culturelle Mandé
répandue en Afrique de l'Ouest. L'institution fonde sa
légitimité à la fois sur une expérience historique
et culturelle ainsi qu'une chaine de valeurs, de principes et de croyances
relevant du symbolisme religieux.
La pratique magico-religieuse des dozos, n'est pas sans
influence, militairement efficace car elle est socialement acceptée et
ancrée au coeur de la croyance populaire. Ainsi il est populairement
admis que les chefs dozos comme Zakaria Koné, Bamba, Ibrahim
Konaté ou encore Chérif Ousmane disposent de pouvoir tel que la
transformation en animaux, l'invisibilité,
l'invulnérabilité aux balles, et la prescience.
Comme au Libéria, le look rebelle est une «
panoplie ethnique » du mysticisme des chasseurs : dreadlocks, kaolin,
attirail de miroirs, colliers de cauris, amulettes et tuniques destinés
à terrifier et terrasser l'adversaire.
L'affaiblissement de l'appareil sécuritaire de l'Etat
et l'instabilité politique ivoirienne au moment de la crise ivoirienne
se révèle être des opportunités savamment
exploitées par les associations de dozos. En s'appuyant sur la
symbolique culturelle, religieuse et l'imaginaire historique, les dozos ont su
construire un consensus au sein des populations sur l'efficacité de leur
offre sécuritaire. Toutefois l'engagement politique de certaines
associations de dozos au compte de la rébellion armée dans un
contexte national polarisé autour des identités ethniques a fini
par éroder l'image d'acteurs sécuritaires neutres et
politiquement indépendants.
Les associations de dozos tout en exerçant dans un
environnement politique contingent et un cadre légal flou,
négocient astucieusement leur ancrage dans l'espace public. Ces
stratégies d'adaptation laissent transparaitre une hybridation
organisationnelle, entre logique de fonctionnement traditionnel de la
confrérie et logique d'organisation administrative selon les exigences
de l'Etat moderne.
Les influences sur le système sécuritaire
officiel ainsi que les imaginaires et croyances associés aux dozos, le
positionnement des adeptes de la confrérie dans le système
sécuritaire et les collaborations officieuses entre autorités
sécuritaires et la confrérie à maints endroits sont autant
d'éléments témoignant de l'influence de la
confrérie dans le système sécuritaire officiel. La
description des abus imputés aux dozos a permis de mettre
également en évidence l'implication des dozos dans la production
de l'insécurité et de
Page 119 sur 227
soulever la question de leur responsabilité juridique
face à de tels abus. Si l'investissement sécuritaire dozos
en Côte d'Ivoire ne peut se comprendre qu'à la lumière
de l'histoire politique ivoirienne, il devient évident que les
modèles de structuration des associations de dozos au niveau national se
diffuse dans d'autres pays avec le recentrage sur des questions
sécuritaires.
Il demeure néanmoins que les dozos ont
été une force déterminante de l'accession au pouvoir
d'Alassane Ouattara en 2011. Celui-ci a également pu compter sur le
soutien de la communauté internationale et plus particulièrement
la France pour accéder à la fonction suprême ce qui
laissera une empreinte considérable dans les représentations des
ivoiriens et de la communauté internationale (R.F. Koné,2018)



