|
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLOQUE DE YAOUNDE
BP 11628 YAOUNDE - CAMEROUN

FACULTE DE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
THEME : LA PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN : cas des
centrafricains
Mémoire présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention du diplôme de Master en Droit
Public
Option : Droits de l'Homme et Action Humanitaire
Par :
KENGNI MELI Oriane Murielle
Licence en Droit Public Fondamental
Sous la direction de :
DrPATHE BAYANGA Alexandre Wilfried
Wieelnord
Chargé de cours statutaire à
l'Université Catholique d'Afrique Centrale
Sous la supervision de :
Pr Jean Didier BOUKONGOU
Professeur Titulaire de Droit International à
l'Université Catholique d'Afrique Centrale
Année académique :
2023-2024
AVERTISSEMENT
L'Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC)
n'entend accorder ni approbation, ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
DEDICACE
A mon feu Père :
MELI François
REMERCIEMENTS
Les deux années de Master qui ont conduit à la
rédaction de ce mémoire, ont été le résultat
de la contribution directe et indirecte de plusieurs personnes envers
lesquelles nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude. Ainsi, nos
remerciements vont :
v A Monsieur le Recteur de l'Université Catholique
d'Afrique Centrale-Institut Catholique de Yaoundé pour avoir
accepté de nous ouvrir ses portes pour notre formation ;
v Au Dr PATHE BAYANGA Wilfried Wieelnord Alexandre, pour avoir
accepté de diriger nos travaux de recherche, pour sa rigueur et ses
conseils qui ont permis la rédaction de ce mémoire ;
v Au Pr BOUKONGOU Jean Didier, pour son encadrement et ses
orientations scientifiques ;
v Au Dr AMOUGUI GALAOUA Pulchérie, Doyen de la
Faculté de Sciences Juridiques et Politiques pour nous avoir
accepté dans ladite Faculté et pour ses directives tout au long
de notre parcours académique ;
v A nos enseignants du Master en Droit Public, en particulier
le Dr ONANA Maurice Magloire non seulement pour sa coordination minutieuse mais
également pour son dévouement envers ses étudiants et ses
précieux conseils relativement au fond et à la forme du
présent document ;
v A mes camarades de promotion BEGUE Florence, DOUMDEOUDJE
Aimée et KESSEK Olivier Joël pour leur soutien moral et leur apport
scientifique ;
v A mes très chers parents, Monsieur et Madame BAYAGA
pour tous les sacrifices consentis dans le suivi de nos études ;
v A toute ma famille, pour le soutien inconditionnel et les
nombreux encouragements durant tout notre parcours universitaire.
v A tous ceux qui ont mis à notre disposition les
informations, la documentation et fait des observations et recommandations
utiles pour l'amélioration de ce mémoire.
v A tous ceux qui ont participé de près ou de
loin à la rédaction de ce mémoire, que l'absence de votre
nom ici ne soit pas perçue comme un signe d'ingratitude, car ils sont
écrits en lettre d'or dans mon coeur.
SIGLES, ABREVIATIONS ET
ACRONYMES
Al :Alinéa
APDHAC : Association pour la promotion
de la Paix et des Droits de l'Homme en Afrique Centrale
Art :Article
BIT : Bureau International du Travail
CADBE :Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant
CADHP : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
CDHC : Commission des Droits de l'Homme
du Cameroun
CESR : Commission
d'éligibilité au statut de réfugié
DGSN : Délégation
Générale à la Sûreté Nationale
DH : Droit de l'Homme
DIDH : Droit International des Droits de
l'Homme
DIH : Droit International Humanitaire
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la
Population
FMO : Forces de Maintien de l'Ordre
HCR : Haut-Commissariat pour les
Réfugiés
MINAT : Ministère de
l'Administration Territoriale
MINJUSTICE : Ministère de la
Justice
MINREX : Ministère des Relations
Extérieures
NDH : Nouveaux Droits de l'Homme
OCHA : Bureau du Coordonnateur des
Nations Unies pour les Affaires Humanitaires
OI : Organisations Internationales
OIM : Organisation Internationale pour
les Migrants
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
ONG : Organisation Non
Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OSC : Organisations de la
Société Civile
OUA : Organisation de l'Union
Africaine
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PIDCP : Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques
PIDESC : Pacte International relatif aux
Droits Economiques Sociaux et Culturels
PNUD : Programme des Nations Unies pour
le Développement
PRC : Présidence de la
République du Cameroun
RCA : République
Centrafricaine
UCAC : Université Catholique
d'Afrique Centrale
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance
RESUME
Le Cameroun depuis l'an deux mille onze a connu un important
afflux migratoire des ressortissants du continent africain et
particulièrement de la République Centrafricaine. Jadis connu
comme un pays de paix, le Cameroun fait récemment face à une
instabilité sécuritaire au niveau de ses frontières,
fragilisant à cet effet la protection des droits humains et
particulièrement le droit à la libre circulation. Le droit de
circuler librement est une prérogative capitale inhérente
à l'homme qui garantit de manière pratique la jouissance des
autres droits.
Au regard de cette instabilité sécuritaire, des
difficultés d'accès aux documents d'identification et des
contrôles abusifs, les réfugiés vivant dans la ville de
Yaoundé au Cameroun se retrouvent coincés entre le marteau et
l'enclume. C'est ce qui nous a amené à nous interroger sur
la protectiondudroit à la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun : cas
des centrafricains. De cette analyse, nous nous sommes
posés la question suivante :comment s'exerce la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés dans la ville
de Yaoundé considérant le contexte socio-politique actuel du
Cameroun ?En guise de réponse provisoire, nous pouvons
dire que le droit à la libre circulation est juridiquement garanti
cependant reste perfectible.
Suivant cet ordre d'idées, cette étude a
consisté d'une part en la recherche documentaire et d'autre part en la
technique de l'entretien, dans le but d'évaluer dans un premier temps
l'action de l'Etat camerounais vis-à-vis de la protection du droit
à la libre circulation des réfugiés, mais aussi d'obtenir
des informations avérées auprès des personnes
concernées par ladite étude.
En effet, grâce à la recherche documentaire, il
est ressorti que la protection du droit à la libre circulation des
réfugiés à Yaoundé est garantie par les textes et
les institutions. Cependant, la technique de l'entretien a permis de
démontrer qu'en dépit des efforts consentis par l'Etat et les
organismes d'appui, cette protection contient encore des failles sur le plan
juridique rendant sa mise en application difficultueuse. D'où la
nécessité pour l'Etat du Cameroun d'amender certaines
dispositions légales, notamment le Décret de 2011 portant
organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés au Cameroun et d'adopter une nouvelle politiquepropre
aux problèmes des réfugiés vivant à
Yaoundé.
Mots clés : Afflux migratoire,
réfugié, instabilité sécuritaire,droits humains,
protection, garantie, libre circulation, politique.
ABSTRACT
Since the year two thousand and thirteen, Cameroon has
witnessed a large influx of migrants from the Central African Republic. Once
known as a country of peace, Cameroon has recently experienced security
instability at its borders, undermining the protection of human rights,
particularly the right to freedom of movement. This right is a fundamental
prerogative inherent to all human beings, which in practical terms guarantees
the enjoyment of other rights.
In view of the unstable security situation, difficulties in
accessing identification documents and abusive controls, Central African
refugees living in the city of Yaounde in Cameroon find themselves caught
between a rock and a hard place. This led us to look into the
protection of refugees' right to free movement in Yaounde, Cameroon: case of
central Africans.Based on this analysis, we asked ourselves the
following question: how is the right to free movement of Central
African refugees protected in the city of Yaounde, given the current
socio-political context in Cameroon?By way of a provisional answer, we
can say that the right to free movement is legally guaranteed, however remains
perfectible.
Accordingly, this study consisted of documentary research on
the one hand, and interviews on the other, with the aim of firstly assessing
the action taken by the Cameroon Government to protect refugees right to
freedom of movement, and secondly, to obtain reliable information from the
people concerned by the study.
By way of documentary research, it emerged that the free
movement of Central African refugees in Yaounde is guaranteed by the texts and
Institutions. However, despite the efforts made by the State and the support
organizations, this free movement seems to be partial, hence the need for the
state of Cameroon to amend certain legal provisions, in particular the 2011
Decree on the organization and operation of bodies managing the status of
refugees in Cameroon and the adoption of a specific policy to refugees.
Key words:Migratory influx, refugee, security
instability, human rights, protection, guarantee, free movement,
policy.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES, ABREVIATIONS ET
ACRONYMES
iv
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : LE DROIT A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE : UN DROIT
GARANTI
13
CHAPITRE 1 : GARANTIE JURIDIQUE DU
DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU
CAMEROUN
14
Section 1 : GARANTIE NORMATIVE
CONSACREE
14
Section 2 : MECANISMES DE PROTECTION
DU DROIT A LA LIBRE CIRCUALTION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU
CAMEROUN
21
CHAPITRE 2 : OPERATIONNALISATION DU
DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU
CAMEROUN
31
Section 1 : MESURES ADOPTEES PAR LE
GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS EN VUE D'IMPLEMENTER LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION
DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE
31
Section 2 : JOUISSANCE DU DROIT A
LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU
CAMEROUN
38
DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU
DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU
CAMEROUN : UNE PROTECTION PERFECTIBLE
45
CHAPITRE 1 : MISE EN OEUVRE
DIFFICULTUEUSE DU DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE
YAOUNDE
46
Section 1 : OBSTACLES A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE RELATIFS AUX
NATIONAUX
46
Section 2 : ECUEILS A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES RELATIFS AUX SERVICES PUBLICS
53
CHAPITRE 2 : PERFECTIBILITE DE LA
PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE
YAOUNDE
63
Section 1 : MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE
DU DROIT A LA LIBRE CIRCULATION
63
Section 2 : MISE EN OEUVRE D'UN
PROCESSUS DE REINSERTION EFFICACE
68
CONCLUSION GENERALE
75
BIBLIOGRAPHIE :
78
LISTE DES ANNEXES :
ix
TABLE DES MATIERES
82
INTRODUCTION GENERALE
Le déplacement des populations d'un pays à un
autre pour des raisons de sécurité n'est pas nouveau.Depuis la
dernière décennie, les migrations forcées constituent en
Afrique une préoccupation particulière qui ne cesse de
s'intensifier, impliquant de nombreux défis.C'est dans ce sens que GERIT
JAN VAN HEUVEN dans « The problem of
Refugees » déclare : « The problem
of the refugee, is certainly one with which every human being, be he a refugee
or not, is or ought to be immediately concerned...it is unrealistic for anyone
who looks at the refugee ptoblem to say « it cannot happen
here ». No one has any absolute safeguard against becoming a refugee
himself »1(*).La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 19482(*) quant à elle stipule en son article 14(1)
« devant la persécution, toute personne a le droit de chercherasile
et de bénéficierde l'asile d'un autre pays ». L'asile
s'entend donc comme un lieu ou un territoire permettant à toute personne
de trouver protection et/ou d'échapper à des persécutions
ou poursuites. Ces personnes fuyant pour d'autres pays sont
appréhendées comme étant des
réfugiés3(*)
et demandeurs d'asile. Le Droit International Humanitaire s'appesantit ainsi
sur les questions du bien-être, de la garantie et de la protection des
droits des réfugiés en Afrique au regard des multiples conflits
auxquels fait face le continent. Ces migrations très souvent inattendues
et massives dont les principales causes se trouvent dans les conflits
armés, les atteintes aux droits de l'Homme, la violence, la
dégradation de l'environnement ont atteint depuis 2011 des proportions
alarmantes4(*), provoquant
à cet effet de nombreux déplacements des personnes et des biens
à la recherche d'un refuge sûr.
Le Cameroun, présenté comme un Etat pacifique et
reconnu comme l'une des principales terres d'accueil des réfugiés
de l'Afrique centrale en général et des Centrafricains en
particulier, n'est pas resté indifférent face à cette
situation, dans la mesure où il a ouvert ses frontières aux
nombreux centrafricains fuyant la guerre, respectant ainsi les Conventions et
Traités.
Partie prenante à plusieurs conventions et accords
internationaux liés à la protection des réfugiés,
c'est dans le préambule de sa Loi constitutionnelle n°96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la Loi n°2008/001 du 14
avril 2008 que le pays va une fois de plus affirmer son attachement au respect
des libertésfondamentales inscritesdans les différentes
normesinternationales et toutes les conventions yafférentes dument
ratifiées,notamment la Convention de Genève de 1951 relative au
statut des réfugiés qui stipule à son article
26 : « Tout Etat contractant accorderaaux
réfugiés se trouvantrégulièrement sur son
territoirele droit d'y choisir leur lieude résidence et d'y circuler
librement sous les réserves instituéespar la
règlementation applicableaux étrangers en général
dans les mêmes circonstances »5(*).
En effet, le droit à la libre circulation
estconsacrédans ledit Préambule en ces termes :
« tout homme a le droitde se fixer en tout lieuet de se
déplacer librement, sous réserves desprescriptions légales
relatives à l'ordre,à la sécurité età la
tranquillité publics »6(*).S'en tenant à cette disposition,les
réfugiés centrafricains vivant dans la ville de Yaoundé
devraient en principe se déplacer librement.Toutefois, le Cameroun
étant sujet à plusieurs troubles sécuritaires depuis
2011,connaît un certain nombre de limites face à la garantie de ce
droit. D'où l'importance de marquer un temps d'arrêt pour
questionner La protection du droit à la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé au Cameroun,
objet de la présente étude.
Ce sujet faisant l'objet de notre recherche, il serait donc
raisonnable de le contextualiser avant toute analyse approfondie.
I- CONTEXTE DE L'ETUDE
Tel que choisi, le sujet met en exergue une situation
socio-économique et politique complexe.
Du point de vue socio-économique, un
nombre record7(*) de
personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers à cause
des guerres, des violences et des persécutions.Nous assistons de ce fait
à une montée de l'hostilité et de la xénophobie au
sein de la population nationale8(*). La politisation des questions de
réfugiés et demandeurs d'asile au Cameroun traduit un sentiment
quelque fois négatif et conduit très souvent à des
conséquences néfastes non seulement pour les
réfugiés mais aussi pour les populations locales.Cette situation
pose donc un véritable défi sur le plan social. Sur le plan
économique, les conditions de vie de la plupart des
réfugiés ne sont pas évidentes, ceux-ci effectuent des
activités en majorité informelles pour survivre, leur
contribution sur l'économie est plus ou moins perceptible. De plus, au
regard des multiples difficultés rencontrées présentement
sur le territoire, les conditions sécuritaires ne sont pas toujours
garanties (entre les assassinats, les kidnappings, les viols et toute autre
sorte d'agression). Cettesituation pousse le gouvernement à intensifier
les contrôles d'identification mettant davantage les
réfugiés en situation de vulnérabilité, ces
contrôles ayant parfois un caractère abusif.
Du point de vue politique, le statut de
réfugié est le laisser-passer des réfugiés
présents sur le territoire camerounais.Il leur donne en principe tout ou
en partie les mêmes droits reconnus aux nationaux tels que le droit
d'ester en justice, le droit d'obtenir des titres d'identité et des
documents de voyage.
Après avoir évoqué les contextes
socio-économique et politique du droit à la libre circulation des
réfugiés, nous proposons la délimitation de notre
étude.
II- DELIMITATION DE
L'ETUDE
Elle consiste en la circonscription du champ de notre
étude. Il s'agit dès lors d'une triple délimitation
à savoir spatiale (A), temporelle (B) et matérielle (C).
A. Délimitation spatiale
L'espace géographique concerné par la
présente recherche est l'Etat du Cameroun, plus
précisément la ville de Yaoundé. Dans le cadre de cette
étude, nous avons choisi les arrondissements de Yaoundé
1er, de Yaoundé 4ème et de Yaoundé
6ème compte tenu du flux de réfugiés
centrafricains dans ces différentes localités.
B. Délimitation temporelle
La présente recherche s'étale de 2013 à
2024. La raison d'un tel choix réside dans le fait qu'en 2013, la
situation humanitaire en RCA était catastrophique. C'est l'année
marquant le début des hostilités entre la seleka
et les anti-balaka, causant l'arrivée massive
des populations centrafricaines sur le territoire camerounais9(*). Et l'année 2024 quant
à elle marque la fin de notre recherche.
C. Délimitation
matérielle
Cette délimitation consiste à distinguer les
différentes disciplines sur lesquelles nous nous sommes basés
pour effectuer notre recherche. A cet effet, l'étude sur la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés
centrafricains dans la ville de Yaoundé au Cameroun fait intervenir : le
Droit international public qui encadre les rapports et les
relations internationales entre les Etats membres à une convention ou un
accord international ; le Droit International Humanitaire
qui met un accent particulier sur la protection et la garantie des
droits des personnes en situation de vulnérabilité en
général ; le Droit International des Droits de
l'Homme qui a pour finalité de promouvoir la dignité
humaine et le respect des droits humains dans tout leur ensemble et le
Droit International des Réfugiés qui met en
exergue l'ensemble des textes qui protègent et promeuvent les droits des
réfugiés tant sur le plan international que national en mettant
un accent particulier sur les causes de leur déplacement, leur prise en
charge et les obligations qu'ont les Etats d'accueil et les institutions envers
eux.
Toutes ces disciplines interviennent pour promouvoir la
protection et la garantie des droits reconnus à l'Homme en
démontrant l'engagement des Etats, des Organisations Internationales et
des Organisations de la Société Civile, qui coopèrent pour
la valorisation et la promotion des droits humains. Dès lors, elles nous
ont permis de convoquer des instruments juridiques tant sur le plan
international que national ; notamment la Charte Internationale des Droits de
l'Homme, la Convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel de
1967, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, du
Statut du HCR de 1950, la Loi Constitutionnelle camerounaise de 1996
révisée, la Loi de 2005 portant statut des réfugiés
au Cameroun, la Loi n°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au
Cameroun, pour ne citer que ceux-ci.
La délimitation étant faite, il est judicieux
pour nous de définir les mots clés.
III- DEFINITION DES TERMES CLES
La définition des termes permet d'expliquer
les mots clés qui constituent la fondation de notre étude.
Il s'agitdonc de définir trois concepts à savoir :
protection (A), droit à la libre circulation (B) et
réfugiés (C).
A. Protection
En vertu de la résolution 428(v) de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 14 Décembre 1950, le HCR a
reçu le mandat des Nations Unies de veiller à la protection des
réfugiés et singulièrement à la recherche de
solutions durables à leurs problèmes10(*). Mais la notion de
protection est loin de trouver une parfaite définition. Ainsi,
pour le HCR, la notion de protection : «...comprend toutes
les activités qui contribuent à garantir les droits des
réfugiés. Celles-ci peuvent inclure des activités
d'assistance. Ces droits constituent à leur tour la base de la
définition de la « protection des réfugiés
»....Elle consiste à garantir des droits. Ces droits figurent dans
le droit international, et comprend trois branches pertinentes pour la
protection des personnes : Le droit international relatif aux droits de l'homme
; Le droit international des réfugiés ; Le droit international
humanitaire. »11(*)
Selon le Vocabulaire des termes juridiques de Gérard
CORNU12(*), le
terme protection se définit comme
« une précaution qui, répondant au besoin de celui ou de
celle qu'elle couvre, et répondant en général à un
devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne,
un bien contre un risque, à garantir sa sécurité et son
intégrité etc.., par des moyens juridiques et
matériels ; elle désigne aussi bien l'action de
protéger que le système de protection établi
».
Pour le Dictionnaire LAROUSSE13(*) le terme protection
s'entend comme « une action de protéger, de défendre
quelqu'un contre un danger, un mal, un risque ».
Nous retenons dès lors comme définition pour le
terme protection, celle du Dictionnaire LAROUSSE.
Cette définition est retenue du fait qu'elle exprime de manière
précise dans quelle optique nous envisageons aborder notre sujet.
B. Réfugiés
D'un point de vue étymologique, le terme
réfugié découle du verbe latin refugere qui
signifie « se réfugier ». Ce verbe à son tour
est tiré de fugere qui signifie
« fuir »14(*). Appréhendé sous cet angle, le
réfugié est une personne qui a trouvé refuge quelque part
pour échapper à une menace ou un danger réel ou virtuel,
le refuge lui-même étant entendu ici comme un asile, c'est
à dire un lieu où l'on se retire pour être en
sécurité.
La Convention de Genève relative au statut de
réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 apporte une
définition internationale au terme
réfugié en son article 1(2) ; ainsi est
réfugié « toute personne qui, craignant avec raison
d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays où elle avait la
résidence habituelle, à la suite de tels
évènements, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y
retourner »15(*).
De plus, pour élargir le champ d'action de cette
définition, la Convention de l'OUA faisant allusion aux problèmes
des réfugiés en Afrique en son article 1(2) stipule : est
réfugié « toute personne qui
du fait d'une agression, d'une occupation, d'une domination
étrangère ou d'évènements troublant gravement
l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine
ou du pays dont il a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour rechercher refuge dans un autre endroit
à l'extérieur du pays dont elle a la nationalité16(*) ».
Le Cambridge Essential English Dictionnary ira dans le
même sens pour définir le refugiécomme
:«Someone who has been forced to leave their country, especially
because of a war... »17(*)
Dans le cadre de ce travail, nous retiendrons comme
définition pour le terme
réfugié, les ressortissants
centrafricains ayant obtenu le statut de réfugié au Cameroun.
C. Droit à la libre circulation
Le concept à définir étant composé
de deux mots, nous définirons chacun d'entre eux. Le
droitpeut être appréhendé comme
« une prérogative attribuée à un individu dans
son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou
d'exiger d'autrui une prestation, dans le cadre du droit
subjectif »18(*). Pour ce qui est de la définition
du droitàlalibrecirculation, l'article 13
de la DUDH dispose : « (1) Toute personne a le droitde
circuler librementet de choisir sa résidenceà l'intérieur
d'un Etat. (2) Toute personne a ledroit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays ».
Nous retiendrons comme définition pour le
droit à la libre circulation, le
privilège qu'a toute personne d'aller et de venir sans risque
d'être interpellée.
Eu égardà ce qui précède, la
thématique sur la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé
peut être définit comme étant « l'action par
laquelle des réfugiés, ayant fui leur pays d'origine pour des
raisons de persécution,jouissent librement et pleinement, si les
conditions sont réunies, de la capacité d'aller et de venir
à l'intérieur de la ville de Yaoundé, sans
risqued'être interpellés ».
IV- INTERET DE
L'ETUDE
Le thème choisit présente à la fois un
intérêt scientifique (A) et social (B).
A. Intérêt scientifique
La présente étude revêt un
intérêt scientifique dans la mesure où elle peut susciter
l'amendement de certains textes de lois déjà existants ;
favorisant à cet effet la mise en oeuvre efficace et effectivede la
garantie du droit à la libre circulation des réfugiés dans
la ville de Yaoundé ; également contribuer de manière
concrète à l'enrichissement du débat scientifiqueautourde
la politisation des questionsde la garantie des droits des
réfugiés au Cameroun ; compte tenu du fait que les
réfugiés sont des personnes en situation de
vulnérabilité nécessitant une protection
particulière selon les objectifs fixés par les Nations Unies.
B. Intérêt social
La libre circulation des réfugiés est une
question assez sensible à aborder. L'intérêt revêt un
caractère social dans la mesure où priver toute personne de son
droit de circuler librement apparaîtcomme une violation de ses droits
civiques tels qu'énoncés dans les différents instruments
juridiques nationaux et internationaux. Par ailleurs, cette étude permet
de sensibiliser les réfugiés centrafricains sur les diverses
normes et les mécanismes relatifs au respect et à la garantie de
leurs droits, en vued'effectuer des réclamations en cas de violations ou
d'abus.
Ce sujet permet également un éveil des
consciences des populations nationales sur la nécessité du
respect des droits des réfugiés ; la sensibilisation,
l'information et l'éducation des populations sur les droits et
obligations en matière de migration mais également le
renforcement de l'accès à la justice et de l'action du juge en
cas de violations des droits des réfugiés au Cameroun. Cette
thématique revêt un intérêt social incontestable.
V- REVUE DE LITTERATURE
La question de la libre circulation des réfugiés
a fait l'objet de quelques travaux par certains auteurs qu'il convient
d'évoquer afin de mieux cerner notre thème de recherche.
Laurent LARDEUX,
dans « Collectifs cosmopolitiques de réfugiés
urbains en Afrique centrale : Entre droits de l'homme et « droit de
cité »19(*),
ressort l'idée selon laquelle, être un réfugié
paraît comme « un péché »selon des
nationaux. D'après lui, les réfugiés font l'objet de
stigmatisation au quotidien et sans répit, considérés
comme des « déchets à
évacuer », ils ne devraient pas pouvoir jouir des
mêmes droits qu'eux. Par rapport à ce point de vue, nous pensons
que les réfugiés, relativement à l'article 1 de la DUDH
sont des êtres humains libres et égaux devant jouir au même
titre que les nationaux de la dignité humaine et du respect de leurs
droits fondamentaux au sein des pays d'accueil. Il revient aux gouvernements
d'entreprendre des mesures efficaces et de mettre en oeuvre des
mécanismes de protection spécifiquespour garantir les droits des
réfugiés.
Michael KAGAN, spécialiste en droit de
l'immigration et des réfugiésexamine dans un article sur les
droits des réfugiés20(*) les obstacles juridiques et pratiques qui entravent
la mobilité des réfugiés et propose des solutions pour
garantir leur liberté de circulation. En effet, il
dit : « il faut expliquercomment convaincreles
gouvernement hôtesde donner plus
d'autonomieauxréfugiés » ; dans la même
lancée il ajoute : « ils ont besoinde droits
pourreconstruireleur viedans la dignité. Et pour cela, il faut que les
gouvernements s'engagent ». Selon lui, les
réfugiés urbains ont davantage besoinde droits
qued'aide,notamment « le droit de travailler, le droit de
circuler librement, le droit d'envoyer leurs enfants à
l'école »21(*). Nous rejoignons son point de vue dans la mesure
où, les droits des réfugiés sont des droits juridiquement
consacrés, cependant leproblème se pose dans leur
réalisation ; ce sont des droits écrits mais pas
appliqués. Le gouvernement camerounaispourrait à cet effet mettre
sur pieds des stratégies efficaces telles que la simplification des
procédures administratives, la facilitation d'accès aux services
publics et bien d'autres mesures évoquées dans notre
développement.
Quant à Mutoy MUBIALA,dans
« La mise en oeuvre du droit des réfugiés et des
personnes déplacées en Afrique22(*) », il examine les
défis auxquels sont confrontés les réfugiés sur le
continent africain. Dans ses écrits, il fait ressortir les
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du droit
applicable aux réfugiés en Afrique. Selon lui, les Etas
africainsen coopérationavec le HCRgagneraient à rechercherdes
solutions durablesface au phénomène de migrationqui mine le
continent depuis plusieursdécennies. Relativement à son point de
vue, nous pensons que la situation des réfugiés n'est pas
aisée, entre les accusations faites par les nationaux de banditisme, de
délinquance et bien d'autres, ils sont souvent confrontés
à des situations de vulnérabilité lors de leurs
déplacements à l'intérieur du pays d'accueil,
bafouéset lésés, les réfugiés font face
à l'inefficacité du contexte juridique qui leur est propre.
Serge LOUNGOU23(*), dans « La libre
circulation des personnes au sein de l'espace de la CEMAC : entre mythes
et réalités » considère le droit à
la libre circulation comme un mythe au regard des réalités qui
ébranlent la sous-région Afrique Centrale. A son avis, parler de
libre circulation des personnes tout simplement relève presque d'un
miracle ; pour lui, le refus pour les Etatsà appliquer le principe
communautairede la libre circulation des personnes se traduit
par l'invasion démographique, la spoliation économique, la
perversion sociale associée à la délinquance d'origine
étrangère24(*). Au regard de cette idée, nous pensons que le
véritable obstacle à la libre circulation relève des
consciences nationales qui manifestent ouvertement la discrimination à
l'égard des ressortissants étrangers.
Eu égard à ces auteurs, la question du droit
à la libre circulation des personnes en Afrique est une énigme
à résoudre.
VI- PROBLEMATIQUE
La protection du droit à la libre circulation des
réfugiés est unequestion assez complexe au vu du contexte dans
lequel elle s'exerce et des instruments juridiques mis en place pour lagarantir
; ce qui nous amène à nous poser la question de
savoir :comment s'exerce la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé
considérant le contexte socio-politique actuel du
Cameroun ?
VII- HYPOTHESE
Au regard des instruments juridiques assurant la protection
des droits des réfugiés au Cameroun à travers d'une part
les textes et d'autre part les institutions,il ressort que le droit à la
libre circulation des réfugiés est un droit juridiquement
garanti. Cependant, sur le terrain les réfugiés sontsemble-t-il,
encore victimes de pressions et de vulnérabilités dans les
espaces urbains de la ville de Yaoundé et subiraient par
conséquent d'innombrables abus de la part des nationaux.
VIII- CADRE METHODOLOGIQUE
La méthodologie25(*) est la science de la méthode utilisée
pour traiter un sujet ou un thème se rapportant à un domaine
scientifique donné, et ce, en vue de déterminer les
méthodes d'approche, les étapes du travail à faire, ainsi
que les moyens à mettre en oeuvre en vue de le réaliser. Le mot
méthode26(*) quant
à lui vient du grec ancien « methodos » qui signifie la
poursuite ou la recherche d'une voie pour réaliser quelque chose. Ainsi,
la méthode est la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à
la connaissance ou à la démonstration d'une vérité.
Le cadre méthodologique reposera donc sur les
méthodes d'analyse (1) et la technique de recherche (2).
1- Méthodes d'analyse
Pour répondre à la problématique de cette
étude, nous avons adopté une approche méthodologique
mixte.
a) Méthode juridique
La méthode juridique utilisée dans ce travail
est l'exégèse, elle nous a permis d'analyser les
normes juridiques internationales et nationales mises en place par l'Etat
camerounais en matière de protection du droit à la libre
circulation des réfugiés en général. Elle consiste
en l'identification des techniques et instruments universels du droit. On parle
de la méthode dite casuistique et de celle
dite dogmatique.
ï Premièrement, la Dogmatique
: pour la compréhension de notre sujet, elle nous a permis de
faire une analyse des normes juridiques relatives à l'action du Cameroun
dans la protection du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains présents dans la ville de
Yaoundé.
ï Deuxièmement, la
Casuistique: considérée comme
l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, elle nous a permis
en interprétant les décisions relatives à la protection
des droits des réfugiés au Cameroun de voir d'une part que les
réfugiés présents sur le territoire camerounais
rencontrent généralement un problème de documentation et
d'autre part subissent toute sorte d'abus de la part des nationaux. Ces
données nousont fourniles informations nécessaires pour
démontrer que malgré le cadre juridique relatif à la
protection des réfugiés au Cameroun, il existe encore des failles
limitant la jouissance effective du droit à la libre circulation de ces
derniers.
b) Méthode sociologique
La méthode sociologique consiste dans ce travail
à toucher véritablement du doigt la problématique des
réfugiés centrafricains vivant dans la ville de Yaoundé.
Elle a consisté à se rapprocher des réfugiés afin
d'obtenir des réponses concrètes relatives à leur droit de
circuler librement depuis leur arrivée sur le territoire camerounais,
les difficultés auxquelles ils font face dans la ville, leurs rapports
avec l'administration et les populations locales et enfin leurs suggestions
pour améliorer leur situation et condition de vie.
2- Techniques de recherche
La technique de recherche consiste en la mise en oeuvre de la
méthode retenue pour rassembler les données ou les informations
nécessaires à la rédaction du travail scientifique. Ces
techniques de recherche ont inclus :
a) Technique du questionnaire et de
l'entretien
Selon C. SELLTIZ, le questionnaire est
« l'obtention des renseignements sur ce que les personnes savent,
croient, ressentent, attendent, désirent, projettent, ou sur les
explications et les motifs qu'ils invoquent à l'appui de chacune des
attitudes qu'ils adoptent »27(*). L'entretien quant à lui est
« un procédé d'investigation scientifique,
utilisant le processus de communication verbale pour recueillir les
informations en relation avec le but fixé »28(*). Ces deux techniques ont
consisté à poser des questions aux réfugiés
centrafricains vivant dans la ville de Yaoundé pour avoir leur
appréciation sur le sujet et pour évaluer leur degré de
connaissance sur la thématique que nous sommes en train
d'étudier, mais aussi auprès des différents acteurs(HCR)
ayant la charge de garantir les droits des réfugiés.
Nous avons soumis notre questionnaire à soixante-quinze
(75) réfugiés centrafricains, soit 25 dans l'arrondissement de
Yaoundé 4 (Ekounou et Ekoumdoum), 25 à Yaoundé 6
(Biyem-assi) et 25 à Yaoundé 1 (Nlongkak et Elig-edzoa).
b) Technique documentaire
La technique documentaire selon Madeleine GRAWITZ29(*) est « l'ensemble
des opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline cherche
à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les
démontrent et les vérifient ». Elle a
été faite par l'analyse de contenu et a consisté en
l'exploitation des ouvrages à la bibliothèque, des manuels
liés à notre thème, des documents pertinents en la
matière, des documents officiels écrits et oraux, des articles,
des revues, des rapports des institutions nationales et internationales. Cette
recherche a été effectuée à la bibliothèque
de l'APDHAC, celle de l'Université Catholique d'Afrique Centrale(UCAC)
et celle de l'Université de Yaoundé 2 SOA.
IX- ARTICULATION DU
PLAN
L'étude sur la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au
Cameroun a ainsi été développée en deux parties. La
première partie portant sur la garantie du droit
à la libre circulation des réfugiés, à travers les
textes consacrés, les institutions et les mesuresprises par l'Etat
camerounais; et la seconde partie portant sur les
difficultés dans la mise en oeuvre effectivedu droit à la libre
circulation des réfugiés sur le terrain ; ainsi que les
stratégiesefficaces et durables à adopter par l'Etat camerounais
pour la garantie efficiente de ce droit.
Les informations collectées permettront de
répondre à notreproblématique.
PREMIERE PARTIE : LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES
REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE : UN DROIT GARANTI
Le phénomène de la migration forcée est
aujourd'hui généralisé à travers le monde, il
traduit dans une large mesure les crises et guerres qui causent la fuite de
nombreuses personnes avec pour espoir de trouver refuge dans un pays
frontalier. Ce phénomène marque de plus en plus
négativement les esprits à travers les effets quelques fois
pervers qu'il représente ; or en réalité, pour bien
d'autres aspects, il présente la modernisation du
XXIème siècle qui tend plus que jamais à
cultiver entre les humains un esprit de fraternité, du vivre ensemble,
et d'unité.
En effet, des pays tels que le Cameroun, connu comme terre
pacifique et d'hospitalité attirent le plus souvent ces migrants
forcés communément appelés réfugiés30(*) et demandeurs d'asile,
ressortissants des pays voisins ayant fuient leurs pays pour cause de
persécution, à la quête de sécurité et de
stabilité. Cet état des choses pose le problème de la
garantie de leurs droits en territoire camerounais. La garantie du droit
à la libre circulation peut se vérifier tant sur le plan
juridique (Chapitre 1), qu'opérationnel
(Chapitre 2).
CHAPITRE 1 :GARANTIE JURIDIQUE DU DROIT A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
Le droit à la libre circulation désigne
leprivilège qu'a une personne de se mouvoir ou se déplacer
librement sans crainte d'être interpellée. Cette mouvance peut
prendre la forme d'un déplacement à court, moyen ou long
terme31(*) en fonction de
la situation à laquelle fait face la personne qui jouit de ce
droit ; elle peut être régulière32(*) ou clandestine.
Le Cameroun, de par sa relative stabilité politique,
est un pays d'accueil des réfugiés de toutes les régions
d'Afrique, mais surtout d'Afrique Centrale. Au cour de ces dernières
années, certains pays tels que le Nigéria, le Tchad et la
République Centrafricaine ont connu de façon récurrente
plusieurs conflits ayant conduit à un flux migratoire important vers le
Cameroun ; ceci étant, force est de constater que le plus grand
nombre de réfugiés présent sur le territoire camerounais
sont les réfugiés centrafricains.
Sur le fondement de ce qui précède, le Cameroun
a adopté et ratifié bon nombre de textes contraignants et non
contraignants en plus des institutions mises en place, dans l'optique de
garantir les droits des réfugiés présents sur son
territoire. En ce sens, nous présenteronsd'abord la garantie normative
du droit à la libre circulation (Section 1) avant de
présenter la garantie institutionnelle (Section 2).
Section 1 : GARANTIE NORMATIVE CONSACREE
Pour parler de la garantie du droit à la libre
circulation des réfugiés, il faudrait au préalable que ce
droit soit consacré. Ainsi, la consécration des textes juridiques
assurant la protection du droit à la libre circulation est contenue dans
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui est le texte
à caractère universel principal qui garantit la libre circulation
des personnes. Ne mettant pas un accent particulier sur la libre circulation
des réfugiés, nous verrons dans un premier temps le cadre
normatif international associé à celui régional
(Paragraphe 1) et dans un second temps celui national
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Cadre
normatif international du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé au
Cameroun
Le fondement du droit à la libre circulation des
réfugiés est contenu dans plusieurs textes généraux
et spécifiques, en vue de garantir de façon particulière
les droits de ces personnes en situation de vulnérabilité. Il
s'agit des textes universels (A) et des textes régionaux (B).
A. Normes universelles relatives
à la protection des droits des réfugiés
Sur le plan universel, de nombreux textes à
caractère contraignant et non contraignant ont été
adoptés pour la garantie du droit à la libre circulation. La
question de la protection du droit à la libre circulation reconnu
à tous les êtres humains sans discrimination permet à tout
individu de se mouvoir et de séjourner librement au sein même de
leur territoire ou d'un Etat membre conformément aux traités et
accords signés entre les Etats33(*). Tel que précisé plus haut, il existe
des textes généraux et spécifiques garantissant le droit
à la libre circulation.
Les normes universelles d'ordre général parce
qu'elles s'appliquent à tous les individus sont : la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui
reconnaît à toute personne victime de persécution le droit
de chercher asile dans un autre pays en son article 14(1). Ceci étant,
toute personne ale droit de circuler librement comme le stipule l'article 13 du
même texte34(*).Cependant cette libre circulation doit se conformer
aux dispositions en vigueur au Cameroun. Dans la même optique, le
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques,
auquel le Cameroun a adhéré le 27 juin 1984dispose en son article
12(1) : « quiconque se trouve légalementsur le
territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa
résidence. »35(*). De ce qui précède, le droit de
circuler est garanti à la condition que le réfugié
jouissant de cette prérogative se conforme aux lois en vigueur dans le
pays.
La libre circulation comme un droit civil reconnu à
tous fait également l'objet d'une consécration juridique par des
normes spécifiques avec pour finalité la protection des droits
des réfugiés
On ne saurait parler du Droit des Réfugiés sans
parler du Droit International Humanitaire (DIH). Le DIH est un ensemble de
règles qui, pour des raisons humanitaires cherche à limiter les
effets des conflits armés ; protégeant ainsi les personnes
qui ne participent pas ou plus aux combats. Il se trouve essentiellement dans
les quatreConventions de Genève de 1949
complétées par les Protocoles additionnels de 1977
relatifs à la protection des victimes des conflits
armés. Le DIH protège les personnes qui ne participent
pas aux combats, comme les civils, le personnel médical ou
religieux ; il protège également ceux qui ont cessé
d'y prendre part, comme les combattants blessés, malades, les
naufragés ainsi que les prisonniers de guerre. Il s'applique aux
conflits armés internationaux et aux conflits armés non
internationaux qui sont considérés comme des conflits
armés opposant les forces armées régulières
à des groupes armés dissidents ou des groupes armés entre
eux au sein d'un Etat36(*). L'article 3 commun des quatre Conventions de
Genève fixe les règles limites applicables dans ce type de
conflit. Les conflits armés sont la première cause de fuite des
personnes de leurs pays pour un autre craignant pour leur vie ; en
d'autres termes, les conflits armés sont la principale cause du
phénomène de migration forcée ou déplacement
forcé, d'où la présence de plus de 117 millions de
personnesdéplacées de force dans le monde d'après un
aperçu statistique du HCR37(*).
Les droits des réfugiés ont été
consacrés pour la première fois par la Convention des
Nations Unies relative au Statut des Réfugiés
communément appelée Convention de Genève
du 28 juillet 1951, ratifiée le 23 octobre 1961 par le
Cameroun. Ce texte a été adopté afin de garantir une
protection effective et efficace des droits des réfugiés mais
aussi pour mettre fin aux violations et injustices que subissent cette
catégorie de personnes. Ce texte regroupe à cet effet tous les
droits reconnus aux réfugiés dont leur droit à la libre
circulation qui est une prérogative indispensable face aux traumatismes
qu'ils ont subi, pouvant ainsi concourir à leur épanouissement et
réinsertion sociale. C'est dans ce sens que l'article 26 de ladite
convention dispose : « Tout Etat contractant accordera aux
réfugiés se trouvant régulièrement sur son
territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler
librement sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général
dans les mêmes circonstances. »38(*) ; de même, elle ajoute en son article 3
que les Etats contractants devront appliquer les dispositions contenues dans
ladite Convention sans aucune discrimination. Il ressort de ces articles que
les réfugiés ont le droit de se mouvoir au sein du pays dans
lequel ils ont trouvé refuge dans le respect des lois en vigueur, et
qu'ils doivent être traité sans discrimination. Outre cette
Convention, le Protocole relatif au statut des réfugiés
de 1967 ratifié par le Cameroun le 19 septembre 1967,vient en
appui dans la mesure où il contraint les Etats contractants à
respecter et mettre en application effective les dispositions contenues dans
ladite Convention ; de plus, il établit une coopération
entre les autorités nationales et celles des Nations Unies prévue
à l'article 239(*)
dudit Protocole intitulé coopération des
autorités nationales avec les nations unies. De ces
dispositions, nous pouvons dire que le droit à la libre circulation des
centrafricains vivant à Yaoundé repose sur deux
éléments notamment la légitimité de la
présence et la conformité aux normesen
vigueur sur le territoire.
Hormis les normes universelles, il existe également les
normes régionales et sous régionales.
B. Normes régionales relatives
à la protection des droits des réfugiés
La communauté africaine a adopté des textes pour
répondre aux éventuelles situations auxquelles fait face
sapopulation. Nombreuses conférences ont été
organisées par les Nations Unies, les Etats africains et les
Organisations non gouvernementales dans le but de garantir les droits et
libertés fondamentaux sur le modèle des normes universelles.
C'est ainsi que la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples fut adoptée le 27 juin 1981 et
ratifiée le 20 juin 1989 par le Cameroun. Cette Charte consacre les
différents droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels reconnus à chaque individu, notamment le droit à la
libre circulation ; stipulé à l'article 12. Il dispose en
ses alinéas 1 et 2 le droit qu'a tout individu de circuler librement et
de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ; ses
alinéas 3, 4 et 5 disposent du droit qu'a toute personne en cas de
persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire
étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux
conventions internationales ; et aussi de l'interdiction pour les Etats
contractants d'expulser collectivement et de façon arbitraire les
étrangers40(*).
Dans ce contexte, les réfugiés jouissent de la capacité
à se mouvoir librement tout en se conformant aux lois en vigueur. Tout
être humain a des droits fondamentaux qui y sont inscrits, et dont les
Etats se doivent d'assurer la garantie et le respect. Cette charte confirme
davantage l'idée selon laquelle tous les êtres humains ont besoin
de liberté dans leurdéplacement. De même, dans la
perspective d'encadrer les mouvements migratoires massifs interafricains,
l'Union Africaine a adopté en 1969 et en 2009 des normes
régionales de protection des déplacés de force, compte
tenu de la complexité de l'asile en Afrique.
Ne s'éloignant pas des dispositions de la Convention de
Genève de 1951 relative aux statut des réfugiés, la
Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistance aux
personnes déplacées en Afrique de 2009communément
appelée Convention de KAMPALA ratifiée le 24 mai
2017et la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique de 1969
ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1985,traitent de façon
complémentaire et spécifique des problèmes des
réfugiés dans le contexte africain. Le refugié ici n'est
plus appréhendé exclusivement sous le prisme de la Convention de
Genève, mais il intègre désormais une approche
régionale en fonction des réalités socio-politiques et
économiques du continent41(*) ; le droit d'asile étant ainsi
accordé à toute personne victime de persécution, sans
aucune discrimination.Ayant proclamé leur motivation à vouloir
établir un cadre normatif spécifique à la protection des
personnes déplacées de force en Afrique, ces deux Conventions se
sont très peu penchées sur la question du droit à la libre
circulation de ceux-ci.
Cependant, un Document d'Addis-Abeba sur les
réfugiés et les déplacements forcés des populations
en Afrique42(*)fut adopté en 1994 à l'occasion
du Symposium de l'OUA et du HCR sur les réfugiés et les
déplacements forcés des populations en Afrique ; avec pour
principal objectif l'élaboration d'un plan d'action en vue de
déterminer les causes profondes des fluxmigratoires et d'y apporter des
recommandations efficaces pouvant réduire partiellement ou totalement ce
phénomène. S'ajoutant à ces textes régionaux,
le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples relatif aux Droits des Femmes du 11 juillet 2003
communément appelé Protocole de
Maputoratifié par le Cameroun le 13 septembre
2012,prévoit en son article 11 la protection des femmes dans les
conflits armés ; l'alinéa 3 stipule « les Etats
s'engagent à protéger les femmes demandeurs d'asile,
réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre
toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle
et s'assurer que de telles violences sont considérées comme des
crimes de guerre, de génocide et/ou des crimes contre l'humanité
et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant les
juridictions compétentes »43(*).
En sus du cadre normatif international de la garantie du droit
à la libre circulation des réfugiés, une multitude de
textes nationaux vient affirmer la garantie de ce droit au Cameroun.
Paragraphe 2 :
Garantie du droit à la libre circulation des réfugiés en
droit interne camerounais
« La protection des réfugiés est
une responsabilité collective qui incombe à tous les Etats
africains ainsi qu'à la communauté
internationale »44(*)
Le Cameroun, pays d'Afrique centrale reconnu historiquement
comme terre hospitalière et généreuse compte au sein de sa
législation nationale un ensemble de dispositifs traitant des questions
d'asile et de prise en charge des réfugiés. Connu comme la
destination première des réfugiés centrafricains au regard
des statistiques45(*), le
Cameroun est en effet partie prenante aux instruments juridiques internationaux
et sous régionaux en matière de promotion et de protection des
droits des réfugiés. Cette hospitalité se manifeste par
une consécration constitutionnelle (A) et une autre législative
et règlementaire (B).
A. Consécration constitutionnelle
du droit à la libre circulation
Le Cameroun à travers sa Loi N°96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la Loi N°2008/001 du 14
avril 2008 communément appelée La
Constitution, consacre et garantie les droits de l'Homme et ceux du
citoyen. Elle ne dispose pas d'un article particulier qui traite de la question
des réfugiés, encore moins du droit à la libre circulation
de ceux-ci, par ailleurs, c'est dans son préambule que sont
consacrés les droits de l'homme. Il dispose à cet effet
: « ...le Peuple camerounais, proclame que l'être
humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance,
possède des droits inaliénables et sacrés ; affirme
son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte des Nations
Unies, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les
conventions internationales y relatives et dument ratifiées, notamment
aux principes suivants :
- La liberté et la sécurité sont
garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de
l'intérêt supérieur de l'Etat ;
- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu
et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions
légales relatives à l'ordre, à la sécurité
et à la tranquillité publics ;
... ».46(*)
De cette partie du préambule, il ressort que
l'égalité est reconnue entre tous les Hommes sans distinction,
mais également que toute personne a le droit de se déplacer
librement conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire.De
plus, pour une protection plus élargie, le Cameroun ne s'est pas
limité au niveau de sa Loi constitutionnelle, il a également
adopté à travers son Législateur des lois et
règlements qui garantissent les droits des étrangers en
général, assurent leur protection au sein du territoire et
encadrent leur séjour au Cameroun.
B. Dispositif législatif et
réglementaire du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
Le Législateur camerounais n'est pas resté
indifférent face à la situation des réfugiés
présents sur le territoire ; c'est dans ce sens qu'il a
adopté divers textes de lois et règlements dans le but de
garantir leurs droits, d'assurer leur protection conformément à
la règlementation en vigueur au Cameroun. Avant d'y arriver, rappelons
que la Loi constitutionnelle camerounaise reconnaît au Législateur
la compétence de traiter de la question de la garantie des droits et
libertés fondamentaux. C'est à cet effet qu'à son
l'article 26 aux alinéas 1 et 2 (a, b) il est clairement reconnu la
compétence du Parlement en matière de vote des lois et les
domaines dans lesquels il exerce cette compétence.
C'estpar cettereconnaissance que les lois relatives aux
réfugiés et étrangers verront le jour au Cameroun.
Ainsi, la Loi N° 2005-6 du 27 juillet 2005
portant Statut des Réfugiés au Cameroun marque un
réel pas vers la reconnaissance de ce qu'est un réfugié,
de la reconnaissance de ses droits et de la garantie de ceux-ci par l'Etat du
Cameroun.47(*)La
même loi reconnaît aux réfugiés les droits et
obligations accordés aux nationaux à l'article 9 du chapitre III
intitulé Droits et obligations des
réfugiés48(*). Outre cette Loi, d'autres lois ont
été adoptées par le Législateur camerounais,
notamment la Loi n° 97/012 du 10 janvier 199749(*) relative aux conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au
Cameroun notamment les articles 27 et 28 relatifs à la
carte de réfugié et à la libre circulation des
étrangers au Cameroun; laLoi n° 2007/001 du 19 avril 2007
instituant le juge du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions
de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères ; pour ne citer que celles-ci. Ces Lois
ont pour finalité la garantie des droits des étrangers
présents sur le territoire camerounais ainsi que leurs obligations.
Au-delà des textes législatifs, des textes
réglementaires spécifiques aux réfugiés ont
également été adoptés. Il s'agit notamment du
Décret N° 20Il /389 du 28 novembre 2011 portant
Organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés au Cameroun50(*), qui étale de manière concrète
la prise en charge des réfugiés par les Commissions
instituées pour ce faire notamment la Commission
d'éligibilité au Statut de réfugié et la Commission
de recours des réfugiés et quiaccorde aux réfugiés
dans le respect de certaines limites, les mêmes privilèges qu'aux
nationaux. C'est le décret d'application de la Loi de 2005 relative au
statut des réfugiés.
En outre, nous distinguons également le
Décret N° 2008/052 du 30 janvier 2008 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret N° 2007/255/PM
du 04 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi
N° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de
séjour et de sortie des étrangers au Cameroun51(*).
La consécration législative et
règlementaire étant établie, il est nécessaire de
présenter le cadre institutionnel qui garantit les droits des
réfugiés au Cameroun.
Section 2 : MECANISMES DE PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE
CIRCUALTION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
Concernant la garantie fonctionnelledes droits des
réfugiés, le Cameroun comme la plupart des pays dans le monde
dispose d'une approche institutionnelle. C'est dans ce sens qu'il a
autorisé la mise en place, conformément aux lois n°90/053 du
19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association,
modifiée et complété par la loi n° 99/011 du 20
juillet 1999 et n° 99/14 du 22 décembre 1999 régissant les
organisations non gouvernementales, des structures spécifiques et
générales pour la garantie de leurs droits. A cet effet, on
distingue les acteurs internationaux (Paragraphe 1) des
acteurs nationaux (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
Acteurs internationauxà la protection des droits des
réfugiés
La protection du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains au Cameroun permet de souligner le
rôle des différentes parties prenantes qui oeuvrent pour garantir
les droits de cette catégorie de personnes en situation de
vulnérabilité. Plusieurs acteurs internationaux interviennent
dans ladite protection, mais la présente réflexion nous
amène à nous intéresser aux acteurs majeurs à
savoir : le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, la Croix-Rouge camerounaise, l'Organisation
Internationale pour les Migrantscomme acteurs spécifiques
(A) et les acteurs généraux (B)
tels que le Programme Alimentaire Mondial, ONU-Femmes, l'Organisation Mondiale
de la Santé, le Fond des Nations Unies pour la Population52(*)... etc.
A. Acteurs
internationauxspécifiques à la protection du droit à la
libre circulation des réfugiés centrafricainsà
Yaoundé
Tel que précisé plus haut, la protection du
droit à la libre circulationdes réfugiés
centrafricainsàYaoundé est perceptible à travers des
organes spécifiques. Leur spécificité découle du
fait qu'ils sont beaucoup plus aptes à gérer les
réfugiés relativement à leurs missions respectives.
Le Cameroun est une zone privilégiée de
destination des réfugiés centrafricains, en raison d'une part de
sa proximité frontalière avec le Pays mais aussi de sa relative
stabilité politique et de son potentiel socio-économique53(*).
Le HCR, principal organe international de
gestion des réfugiés au Cameroun félicite la
générosité du gouvernement camerounais et des
communautés locales qui, depuis 2013 ont accueilli plus de 479 000
réfugiés enregistrés54(*) jusqu'à ce jour, dont plus de 300 000
réfugiés centrafricains55(*) ; il appelle toutefois le gouvernement
camerounais à honorer davantage ses obligations découlant des
textes internationaux et régionaux sur la protection des droits des
réfugiés, ainsi que celles de la Loi camerounaise. En effet, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés est une
institution ayant pour rôle essentiel de militer en faveur de la
protection et de la garantie des droits reconnus aux
réfugiés ; ce rôle lui permet de poser des actes
d'humanité en appelant les pays voisins aux pays en crise à
maintenir leurs frontières ouvertes comme c'est le cas du Cameroun, afin
de permettre l'accès au territoire pour les personnes ayant fui leurs
pays d'origine pour cause de persécution en quête de
sécurité. Ce rôle lui reconnaît également la
compétencede contrôler les mouvements des réfugiés
une fois sur la terre d'accueil, de contrôler le respect et la garantie
de leurs droits par l'Etat d'accueil ; mais aussi de veiller à ce
que les réfugiés se conforment aux législations en vigueur
sur le territoire au risque d'être expulsé relativement à
l'article 14 de la Loi de 2005 portant statut des réfugiés au
Cameroun56(*).
Relativement aux obligations des réfugiés présents sur le
territoire camerounais, les articles 11 et 12 de ladite Loi disposent :
art.11 « tout réfugié est tenude se conformer auxlois
et règlementsen vigueurau même titre que les
nationaux » ; art.12 « toute personnequi acquiertle
statut de réfugiés'engage à menerà partir du
territoire nationalaucune activitédéstabilisatricecontrel'Etat
camerounais, contre son pays d'origineou contretout autre Etat ». Il
revient premièrement aux HCR avec l'appui des institutions nationales de
veiller à ce que tout désagrément ne soit pas causé
à l'endroit des réfugiés mais aussi, les
réfugiés doivent se conformer aux lois en vigueur.
Outre le HCR au Cameroun en matière de garantie
institutionnelle du droit à la libre circulation des
réfugiés, nous avons la Croix-Rouge ;
principalement compétente en matière d'assistance aux personnes
en situation de vulnérabilité, elle est reconnue officiellement
comme société nationale d'utilité publique en
196357(*). La Croix-Rouge
s'investit ainsi en procédant par des actions d'assistance aux
réfugiés centrafricains et tout autre réfugié se
trouvant sur le sol camerounais ; son action est encadrée sur le
plan normatif et institutionnel en vue de se conformer aux règles
particulières des lois du Cameroun. Elle déploie des
mécanismes de recherche de rétablissement des liens familiaux, de
liberté de mouvements, et de restauration de la dignité des
personnes.
Comme autre institution internationale au Cameroun, nous avons
l'Organisation Internationale pour les Migrants (OIM) ;
en tant qu'Organisme intergouvernemental, elle collabore avec ses partenaires
au niveau de la communauté internationale dans le but de résoudre
les problèmes liés aux flux migratoires, de mieux comprendre le
phénomène de migration massive et de promouvoir le respect de la
dignité humaine des migrants en général. Dans sa mission,
l'OIM apporte son aide de manière particulière aux
réfugiés vivants au Cameroun, elle s'assure de leur
développement économique ou autonomisation socio-professionnelle
sur le territoire. Les acteurs spécifiques présentés,
passons aux acteurs généraux.
B. Autres acteursà la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés
centrafricainsà Yaoundé
Comme autres acteurs internationaux, nous pouvons citer les
Organisations Internationales ; en premier lieule Bureau
International du Travail (BIT). Agissant en collaboration
étroite avec le HCR et l'OIM, le BIT apporte son aide aux
réfugiés sur le plan du développement économique et
social. En effet, en tant que réfugié, rare sont les
opportunités à pouvoir trouver un travail décent dans le
pays d'accueil, d'où la difficulté de se prendre en charge et de
jouir de son droit à un niveau de vie suffisant. Il n'a certes pas un
rôle conséquent, mais il participe à l'autonomisation des
réfugiés58(*) avec l'appui des autres organismes internationaux et
des institutions nationales. Son action est beaucoup plus visible dans les cas
de migration volontaire en quête d'un meilleur devenir. Outre le BIT,
nous avons également le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD). Le Cameroun signataire à
la Charte des Nations Unies se voit très souvent assisté par les
organisations onusiennes dans l'optique d'améliorer la situation de vie
de sa population.
On peut également citer ONU-Femmes,
qui garantit les droits de la femmeet de la jeune filleet promeut
l'égalité des genres. Les femmes réfugiées sont
très souvent victimes des violences basées sur le genre,
notamment : le viol, la torture, les traitements inhumains, l'esclavage
sexuel ou prostitution etautres formes de violences. Au Cameroun, ONU-Femmes a
pour rôle non seulement la sensibilisation et la promotion des droits de
la femme et de la jeune fille, mais aussi la garantieet le respect des droits
des femmes réfugiées avec l'appui de certaines institutions
nationales notamment le Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Famille.
En outre, nous avonsl'UNICEFqui oeuvre
pour la protection et la garantie des droits des enfants au Cameroun sans
distinction de statut juridique, mais également de leur
éducation59(*),
leur bien-être, et de la jouissance de leur meilleur état de
santé60(*). La
Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant (CADBE)
reconnaît en son article 23 les droits des enfants réfugiés
en vertu du droit International et du Droit interne applicable en la
matière. L'UNICEF dans sa mission est assistée par des
institutions nationales notamment le Ministère de l'Education de Base et
le Ministère des Affaires Sociales.
L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) oeuvrent également dans l'assistance des
réfugiés centrafricains vivants à Yaoundé, chacun
dans son domaine respectif, celui de l'alimentation et de la santé; sans
oublier le Fond des Nations Unies pour la Population
(FNUAP).
Les acteurs internationaux n'étant pas les seuls
à oeuvrer pour la garantie des droits des réfugiés, le
Cameroun compte aussi parmi ses institutions des acteurs spécifiques en
matière de protection et de garantie des droits des étrangers en
général.
Paragraphe 2 :Acteurs
nationaux
Pour assurer sa mission en faveur des réfugiés
centrafricains vivants sur son territoire, l'Etat du Cameroun comprend des
acteurs à la fois étatiques ou gouvernementaux (A) et non
étatiques (B).
A. Acteurs gouvernementaux
La garantie institutionnelle de la protection du droit
à la libre circulation des réfugiés centrafricains
àYaoundé fait intervenir bon nombre d'acteurs gouvernementaux. Ce
sont, le Ministère des Relations Extérieures
(MINREX), la Délégation Générale à
la Sûreté Nationale (DGSN), le Ministère
de l'Administration Territoriale (MINAT), le Ministère
en charge de la Justice (MINJUSTICE) et la Présidence
de la République du Cameroun (PRC).
En matière de migration au Cameroun, la
DGSN occupe un rôle central. Elle permet au pays de
monopoliser les moyens légitimes de circulation et de réguler
à sa convenance sous réserve des normes internationales
ratifiées, la circulation des personnes à l'intérieur du
territoire61(*). Cette
compétence s'exerce à travers l'application des normes relatives
à la délivrance des documents d'identification tels que le
passeport, la carte de séjour ; les contrôles aux postes de
frontière, l'exécution des mesures applicables aux
réfugiés mais aussi, la répression des délits
d'immigration.
Le MINREX pour sa part complète l'action de la DGSN en
matière de régulation des flux ; c'est à lui
qu'incombe la charge d'octroyer ou de refuser le statut de
réfugié. Le MINREX, à travers la Loi de 2005 relative au
statut des réfugiés au Cameroun, établi en son sein les
commissions relatives à la protection des réfugiés ;
il s'agit notamment de la Commission d'éligibilité au
statut de réfugié(CESR) et de laCommission de
recours des réfugiés62(*). Ces deux commissions sont d'une grande importance,
créées par le Décret de 2011 portant organisation et
fonctionnement des organes de gestion du statut des réfugiésau
Cameroun qui fixe les règles de procédure applicable à
ladite Loi. Ces deux entités juridiques sont en principe en
étroite collaboration avec le HCR dans le but de mieux coordonner et de
collecter des données propres aux demandeurs d'asile qui seront
reconnuss'ils sont éligibles, des réfugiés en fonction des
différents critères d'éligibilité. S'agissant
dela Commission d'éligibilité, elle
décide en premier ressort de l'octroi ou du refus du statut de
réfugié au demandeur d'asile ; quant à
laCommission de recours, elle statue en dernier ressort en cas
de constatation de la décision de refus de statut par la commission
d'éligibilité, afinde réévaluer le demandeur
d'asile à travers une comparution personnelle de ce dernier ; un
représentant du HCR peut être convié à assister aux
travaux en qualité d'observateur avec une voix consultative63(*). L'introduction de ce recours
suspend donc toute mesure d'expulsion nationale64(*).Après reconnaissance du statut de
réfugié, le réfugié bénéficie des
différents droits et obligations contenus à partir des articles 9
et suivants de la Loi de 2005 relative au statut de réfugié au
Cameroun, entre autre la liberté de circulation.
Tout comme la DGSN et le MINREX, le MINAT, le
MINJUSTICE et la PRCjouent également
un rôle important dans la protection des droits des
réfugiés centrafricains de la ville de Yaoundé. Pour sa
part, le MINAT s'occupe de l'accord des associations des
étrangers65(*) au
Cameroun après avis du MINREX et de la gestion des frontières
internationales. Le MINJUSTICE intervient dans les questions relatives à
la naturalisation66(*) ou
octroi de la nationalité camerounaise aux réfugiés. La PRC
quant à elle, joue un rôle de supervision générale
en matière de garantie des droits des réfugiés
centrafricains à Yaoundé. A ces acteurs, nous pouvons ajouter en
terme d'appui le Ministère des Affaires sociales, le Ministère de
l'Eau et de l'Énergie, le Ministère de l'Économie, de la
Planification et du Développement régional, le Ministère
de la Promotion de la Femme et de la Famille, et le Ministère de la
Santé publique67(*).
Jusque-là, les actions menées par les acteurs
étatiques participent de façon incongrue à la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés
centrafricains sur le territoire camerounais, c'est pour cette raison que les
acteurs non étatiques accompagnent le Gouvernement dans sa mission.
B. Acteurs non gouvernementaux
Les acteurs non gouvernementaux agissant pour la cause des
réfugiés au Cameroun sont les Organisations de la
Société Civile (OSC)et la Commission des Droits
de l'Homme duCameroun (CDHC). D'un point de vue global, les OSC jouent
un rôle important dans le développement du pays en travaillant aux
côtés du gouvernement, appuyant ses initiatives en fonction des
populations au sein des 10 régions du pays. Selon les dires de Zbigniew
Paul DIME LI NLEP, « la société civile est un vaste
conglomérat d'associations et d'individus qui se doit de créer un
capital confiance au sein de l'Etat et vis-à-vis de ceux qu'elle entend
représenter. C'est à cette fin que la société
civile camerounaise est constituée par une mosaïque d'associations,
de personnes indépendantes des pouvoirs publics, du clergé, des
professeurs d'universités, d'étudiants et des simples citoyens
qui émergent tous dans le cercle des droits
fondamentaux. »68(*). De cette hypothèse, on voit se
déployer sur le terrain plusieurs acteurs de la société
civile, notamment les Organisations non gouvernementales (ONG), les
églises et les médias. Au Cameroun, diverses ONG se
démarquent en matière de protection des droits des
réfugiés ; nous pouvons citer entre autres, le Service
International pour les Réfugiés et la Paix (SIRPAX) qui
mène une action constante auprès du gouvernement et de l'opinion
publique pour le maintien de la solidarité avec les
réfugiés et le respect des garanties fondamentales applicables
aux réfugiés. A côté d'elle, l'ONG Nouveaux Droits
de l'Homme (NDH) et son Programme d'Appui aux Réfugiés au
Cameroun mène également des actions en faveur des
réfugiés, notamment leur réinsertion
socioprofessionnelle ; elle octroie aussi des aides de subsistance aux
réfugiés69(*).
Outres les ONG, les églises contribuent
également à la protection des réfugiés au Cameroun.
L'Eglise Catholique par exemple à travers son ONG CARITAS qui signifie
« charité » en français, octroi des
allocations mensuelles aux réfugiés, des bourses d'études
ainsi que des fonds pour le fonctionnement des micro-projets
générateurs de revenus. Comme l'Eglise Catholique, les Eglises
Protestante, Evangélique et Baptiste participent aussi de façon
indéniable à la garantie des droits des réfugiés au
Cameroun ; leurs actions sont perceptibles à travers la
Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du
Cameroun (FEMEC)70(*)
créé en 2001, c'est un comité spécialisé sur
les questions de réfugiés, doté d'un fonds.
Dans cette protection du droit à la libre circulation
des réfugiés centrafricains, les médias
ne sont pas restés muets. Ils jouent un rôle important dans la
protection des droits des réfugiés dans la mesure où ils
promeuvent leurs droits et dénoncent les violences commises à
leur égard, ils agissent également en cas de danger de vide
juridique sur la question des réfugiés au Cameroun. Ce fut le cas
en 2002 lorsque, grâce à la dénonciation des médias,
plus de 1500 réfugiés nigérians ont pu
bénéficier de l'assistance de la Croix-Rouge
Camerounaise71(*).
En plus des OSC, plusieurs autres organisations interviennent
dans la protection des réfugiés au Cameroun, notamment le
Norwegian Refugee Council (NRC), le Danish Refugee Council (DRC), le Service
Jésuite pour les Réfugiés (SJR), Action contre la Faim,
Agence adventiste de secours et de développement, Africa Humanitarian
Action, AIDER, Association de lutte contre les violences faites aux femmes,
CARE International, Croix-Rouge française, FAIRMED, International
Emergency and Development Aid, International Medical Corps, International
Relief and Development, Plan - Cameroun, Première Urgence - Assistance
Médicale Internationale (PU-AMI), Public Concern, Services de secours
catholiques, Solidarités - International72(*).
S'agissant de la CDHC, c'est une institution nationale
indépendante créée par la Loi n°2019/014 du 19
juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la
Commission des Droits de l'Homme du Cameroun73(*). Cette Loi dispose en son article
1(2) : « la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun
est une institution indépendante de consultation, d'observation,
d'évaluation, de dialogue, de conciliation et de concertation en
matière de promotion et de protection des droits de l'homme ».
Elle a pour mission lapromotion et la protection des droits de l'homme mais
aussi la préventioncontre la torture dans tous les lieux de privation de
liberté. Le Chapitre 2 de ladite Loi fixe les missions qui sont propre
à la Commission. Il est important de noter que la Commission
coopère avec les organes des Nations Unies, les institutions
régionales et nationales, les organisations de lasociété
civile et les organisations nationales et internationales dans le but de mieux
appréhender la question des droits de l'Homme au Cameroun.
A cet effet, la Commission des Droits de l'Homme d Cameroun
joue un rôle important dans la protection des droits de l'homme en
général mais aussi des réfugiés sur le territoire
camerounais.
CONCLUSION DU PREMIER
CHAPITRE
Au demeurant, le chapitre un de notre travail portant sur la
garantie juridique du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
consistait dans un premier temps à démontrer la garantie
textuelle de ce droit tant sur les plans international, régional et
national.
Au long de nos développements, nous avons pu
démontrer que la protection du droit à la libre circulation des
réfugiés est avérée de par des textes juridiques
universels telle la DUDH de 1948 en ses articles 13 et 14 ; et nationaux
notamment la Loi de 2005 portant Statut des réfugiés au
Cameroun.
Outre cette garantie textuelle, nous avons également
démontré qu'il existe une garantie institutionnelle des droits
des réfugiés en général, chacune de ces
institutions oeuvrant d'une manière ou d'une autre à
protéger les réfugiés des abus auxquels ils peuvent faire
face, mais aussi à garantir leurs différents droits relativement
aux instruments qui les consacrent.
A cet effet, il ressort de ce qui précède que la
garantie du droit à la libre circulation des réfugiés
vivant dans la ville de Yaoundé au Cameroun est une affaire de plusieurs
acteurs, tant sur les scènes étatique et non étatique que
celles internationale et régionale sans oublier celle des organisations
de la société civile qui sont considérées comme des
acteursclés pour la défense des droits de l'Homme.
Par ailleurs, cette garantie n'est pas que juridique, elle est
aussi opérationnelle, d'où l'intitulé de notre second
chapitre portant sur l'opérationnalisation du droit à la libre
circulation des réfugiés dans la ville de Yaoundé au
Cameroun.
CHAPITRE 2 :OPERATIONNALISATION DU DROIT A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
Le droit à la libre circulation des personnes en
général est un droit fondamental qui concoure à
l'épanouissement et au bien-être de la personne humaine. Les
conflits armés, cause principale des déplacements forcés
des personnes craignant pour leurs vies, privent pour la plupart du temps ces
personnes de cette prérogative qui leur est inhérente. Circuler
librement signifie aller et venir d'un lieu à un autre au sein d'un
territoire ou d'un pays vers un autre. Au Cameroun, tel que
précisé plus haut, le droit à la libre circulation est non
seulement garanti par des textes mais aussi par des institutions. En
coopération avec le HCR, l'Etat du Cameroun en vue de
l'opérationnalisation du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains au sein de son territoire mène un
certain nombre d'actions.
C'est dans cette optique qu'on présentera
premièrement les mesures adoptées par le gouvernement camerounais
en vue d'implémenter le droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains au sein de son territoire
(Section 1) et deuxièmement, la jouissance effective de
ce droit à travers les effets produits par ces actions en matière
de libre circulation vis-à-vis des réfugiés centrafricains
et des autres réfugiés dans la ville de Yaoundé au
Cameroun (Section 2).
Section 1 : MESURES ADOPTEES PAR LE GOUVERNEMENT
CAMEROUNAIS EN VUE D'IMPLEMENTER LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES
DANS LA VILLE DE YAOUNDE
L'Etat du Cameroun, signataire aux différents textes
internationaux relatifs à la protection des réfugiés
oeuvre de manière effective à la protection des droits de
ceux-ci. D'abord par l'adoption des textes législatifs et
réglementaires, mais aussi par les actions menées par les
différentes institutions mises en place afin de garantir les droits de
cette catégorie de personnes vulnérables. Notons que c'est la Loi
de 2005 portant statut des réfugiés au Cameroun et son
Décret d'application de 2011 qui définissent les
différentes mesures adoptées par le gouvernement camerounais en
matière de protection des droits des réfugiés. Ainsi,
s'agissant du droit à la libre circulation des réfugiés au
sein du territoire, l'Etat du Cameroun a adopté comme première
mesure, l'accès aux documents (Paragraphe 1) et comme
autre mesure, les conditions d'éligibilité (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 :
Accès aux documents officiels
D'emblée, il faut préciser que la protection des
réfugiés au sein d'un pays d'accueil relève au premier
chef de cet Etat, travaillant en étroite collaboration avec le HCR qui
est l'organisme des Nations Unies disposant d'un mandat reposantprincipalement
sur la protection des réfugiés. Cette protection prend deux
formes dans la mesure où il existe une protection
temporaire, qui est une solution immédiate et à court
terme utilisée en cas d'arrivée massive des personnes ayant
fuient pour cause de conflits armés et violations
exagérées des droits de l'homme et toute autre forme de
persécutions ; et une protection subsidiaire qui
est une solution à long terme ayant une procédure
particulière en vue d'obtenir le statut de réfugié.
Au Cameroun, le gouvernement a mis en place des institutions
particulières (A) chargées d'étudier les
dossiers des demandeurs d'asile et d'octroyer le statut de
réfugié à ces deniers ; mais aussi chargées
d'établir la procédure d'obtention (B) de ce
statut au Cameroun.
A. Institutions chargées de la
fourniture des documents officiels aux réfugiés au Cameroun
C'est la Loi N°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut
des réfugiés au Cameroun qui crée en son article 16
alinéa 1 les différentes commissions de gestion des
réfugiés au Cameroun ; associée à son
Décret d'application N°2011/389 du 28 novembre 2011 portant
organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés qui en fixe les règles de procédure.Dans
ce sens, l'article 16(1) de ladite Loi dispose : « Il est
créé une Commission d'éligibilité au statut de
réfugié et une Commission des recours des réfugiés
dont l'organisation, le fonctionnement et les règles de
procédures sont fixés par décret. », de cet
article nous pouvons clairement ressortir que les institutions chargées
de l'octroi du statut de réfugiés au Cameroun sont la
Commission d'éligibilité et la
Commission de recours, chacune d'elle disposant d'une
compétence qui lui est propre et établie au sein du MINREX.
S'agissant de la Commission
d'éligibilité, l'article 8 du décret de 2011
dispose : « (1) La commission d'éligibilité est
saisie de toute demande en éligibilité et décide en
premier ressort de l'octroi ou du refus du statut de réfugié au
demandeur d'asile. (2) Toute demande d'asile est adressée au
Président de la Commission d'éligibilité et elle est
reçue par le Secrétariat technique. (3) Les demandes
déposées auprès des bureaux du HCR sont transmises au
Secrétariat technique. (4) Lorsque le HCR est saisi d'une demande
d'asile, il peut assister le demandeur d'asile dans l'accomplissement des
formalités y relatives. ». En d'autres termes, la Commission
d'éligibilité est le premier organe institutionnel
compétent en matière d'octroi ou de refus du statut de
réfugié au Cameroun ; elle est composée de huit (08)
membres et est assistée dans sa mission par le HCR à travers un
représentant qui prend part aux travaux de la Commission en
qualité d'observateur avec une voix consultative. La Commission
d'éligibilité a la compétence de reconnaître le
statut de réfugié « prima facie74(*) » en cas
d'arrivée massive des personnes en quête d'asile, sous
réserve de vérifications ultérieures au cas par cas
(article 12 Décret de 2011)75(*) ; il s'agit là d'une protection sous
forme temporaire relativement à l'article 7(1)76(*) de la Loi de 2005 portant
statut de réfugié au Cameroun. Par ailleurs, les décisions
de la Commission d'éligibilité sont susceptibles de
contestation77(*)
auprès de la Commission des recours.
La Commission des recoursquant à
elleest le second organe de gestion des réfugiés au Cameroun en
matière de fourniture des documents officiels, elle statue en dernier
ressort en cas de contestation ; « le recours est introduit
auprès du Secrétariat technique directement ou par le canal des
bureaux du HCR. La commission des recours est composée de cinq (05)
membres répartis comme suit : un Président, qui est un
représentant de la Présidence de la République ; un
vice-président qui est un représentant des services du Premier
Ministre ; les Membres à savoir : un représentant du
ministère de la Justice, un représentant du ministère des
Relations Extérieures, un représentant du ministère de
l'administration territoriale et de la décentralisation ;
assistée par un représentant du HCR qui peut être
invité à assister aux travaux en qualité d'observateur
avec voix consultative »78(*) ; la Commission dispose d'un délai de
deux (02) mois maximum après sa saisine pour se prononcer.
Précisons que les procédures devant les Commissions sont
en principe gratuites. Les membres des Commissions prêtent
serment devant le Tribunal de Grande Instance avant leur entrée en
fonction et se réunissent au moins une fois par mois sur convocation de
leurs présidents respectifs et en cas de besoin. Les décisions de
chacune des Commissions sont prises à la majorité simple des
membres présents ; en cas d'égalité des voix, celle
du président est prépondérante. Ces décisions sont
motivées et notifiées au Secrétariat technique.
Les institutions et leurs missions respectives étant
établies, présentons à présent la procédure
d'acquisition du statut de réfugié au Cameroun.
B. Procédure d'octroi du statut
de réfugié au Cameroun
Tel que précisé plus haut, la demande d'asile
conduisant à la reconnaissance officielle de réfugié
relève de la compétence des Commissions
d'éligibilité et des recours quitravaillent en étroite
collaboration avec le HCR, suivant un certain de nombre de règles
contenues dans la Convention de Genève de 1951 mais aussi et surtout
dans la législation camerounaise relative aux réfugiés. La
procédure de reconnaissance ne peut être engagée
qu'après le respect des critères d'éligibilité que
nous verrons plus bas.
Précisons tout d'abord que la procédure de
reconnaissance varie en fonction de chaque Etat d'accueil ; au Cameroun,
régie par le Décret n°2011/389 du 28 novembre 2011 portant
Organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés, la Commission d'éligibilité selon
l'article 879(*) dudit
Décret a été prévue pour connaître des cas de
demande d'asile et d'octroi du statut de réfugié. S'agissant de
la procédure proprement dite, notons premièrement que toute
demande d'asile est adressée au Président de la Commission
d'éligibilité et est enregistrée par le Secrétariat
technique dans un registre ouvert à cet effet ;les demandes
déposées auprès des bureaux du HCR sont également
transmises au Secrétariat technique ; toutefois, lorsque le HCR est
saisi d'une demande d'asile, il peut assister le demandeur d'asile dans
l'accomplissement des formalités y relatives. La demande d'asile
étant enregistrée, le Secrétariat technique l'instruit et
la transmet au Président de la Commission ; par la suite, le
demandeur d'asile est convoqué au Secrétariat technique pour un
entretien avec un agent dûment habilité chargé de
procéder à toutes les investigations nécessaires et de
recueillir toutes les informations complémentaires utiles sur sa
situation ; cette convocation est adressée deux semaines avant la
date de son entretien. Durant cet entretien, le demandeur d'asile a la
possibilité d'être assisté par un interprète. A
l'issue de cet entretien et des investigations subséquentes, un rapport
sur la demande d'asile est confectionné ; il contient un
exposé des faits, une analyse juridique fondée sur les
instruments relatifs au statut du réfugié et un état de la
situation sociale du demandeur d'asile. Après réception du
dossier instruit assorti du rapport du Secrétariat technique sur la
demande d'asile, la Commission d'éligibilité dispose d'un
délai maximum de deux (02) mois pour statuer,
délairenouvelable une fois(des délais qui ne sont pas
toujours respectés au regard du nombre de réfugiés n'ayant
pas toujours reçu de pièces d'identité depuis leur
arrivée au Cameroun)80(*). La Commission d'éligibilité peut
également ordonner une comparution personnelle du demandeur d'asile et
prescrire d'autres mesures d'instruction utiles en cas de manque d'informations
indispensables pour l'octroi du statut de réfugié81(*).
Par ailleurs, en vue d'assurer la protection des droits des
demandeurs d'asile, la Commission peut, en cas d'arrivée massive de
personnes en quête d'asile, et notamment devant l'impossibilité
matérielle de déterminer leur statut sur la base individuelle,
décider de leur reconnaître le statut de réfugié
prima facie sous réserves de vérifications
ultérieures au cas par cas. Les décisions de la Commission
d'éligibilité peuvent être contestées par la
Commission des recours ; précisons que les procédures devant
les commissions sont en principe gratuites.Ainsi, en cas de décision
favorable par les Commissions, le Secrétariat technique s'occupe de la
préparation des projets devant porter admission au statut de
réfugié. Le décret de reconnaissance du Statut de
réfugié est signé par le Président de la
République et s'accompagne de la délivrance d'un certain nombre
de documents82(*)utiles et
indispensables au réfugié. Il s'agira des documents officiels
permettant au réfugié de pouvoir jouir de son droit à la
libre circulation, mais aussi des autres droits et libertés
accordés aux nationaux suivant les dispositions en vigueur83(*). La durée de
validité de la carte de réfugié est de
deux (02) ans renouvelable suivant la réglementation en
vigueur.
Toutefois, pour bénéficier du statut de
réfugié et des privilèges qui vont avec, un certain nombre
de critères doivent être respectés conformément aux
dispositions internationales et nationales en vigueur.
Paragraphe 2 :
Critères d'éligibilité au statut de
réfugié
Pour qu'un demandeur d'asile soit reconnu comme un
réfugié, il devra remplir des critères
d'éligibilité précis quifaciliteront la reconnaissance du
statut de réfugié conformément aux normes internationales,
régionales et nationalesrelatives à la question de
réfugié. Etablis essentiellement par la Convention de
Genève de 1951, ces critères peuvent varier en fonction de
l'appréhension de chaque Etat membre, qui dispose d'une certaine
liberté dans la définition du terme
« réfugié » à travers leur
législation nationale. Par ailleurs, dans la majorité des cas,
c'est la définition de la Convention de Genève de 1951 qui est
prise en compte ; c'est le cas pour le Cameroun avec la Loi de 2005
portant Statut des réfugiés au Cameroun en son article 284(*) qui reprend la
définition de ladite Convention.
On distingue deux types de critères, à savoir
les critères d'inclusion (A), qui sont les
critères permettant aux demandeurs d'asile d'être éligibles
à l'obtentiondu statut de réfugié et les critères
d'exclusion (B)constituant les critères pour lesquels
la demande de statut est rejetée.
A. Critères d'inclusion au statut
de réfugié
En plus de la Convention de Genève de 1951, la
Convention de l'OUA de 1969 intègre à la définition du
terme réfugié d'autres critères d'inclusion dits
« critères généreux » sur le plan
régional. Les critères d'inclusion font référence
aux éléments qui forment le fondement de la détermination
du statut de réfugié ; ils sont indispensables pour qu'une
personne soit reconnue comme un réfugié.Tel que
précisé plus haut, c'est la Loi de 2005 à son article 2
qui détermine les critères d'inclusion au statut de
réfugié au Cameroun. D'après cette définition,
« ...toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée à cause de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, ...se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays ... » ; les critères qui ressortent de cette
définition sont donc la persécution, la crainte fondée et
la territorialité.
Le demandeur d'asile doit tout d'abord se trouver hors
des frontières du pays dont il a la nationalité ou dont
se trouve sa résidence habituelle ; cette territorialité
permet de faire une distinction explicite entre les personnes
réfugiées et les personnes déplacées internes.
Ensuite, le demandeur doit faire face à une crainte
fondée qui l'empêche de réclamer la protection du
pays dont il a la nationalité ou dont il a sa résidence ;
cette crainte doit être analysée de façon objective au
regard de la situation qui règne dans le pays d'origine du demandeur
d'asile et de sa situation personnelle ; il peut s'agir d'un
préjudice moral ou physique auquel il est exposé dans son pays,
un préjudice équivalent à de la persécution. Il
reviendra donc au demandeur d'asile de fournir toutes les indications
nécessaires qui permettront à la Commission
d'éligibilité d'apprécier si la crainte est fondée
ou non. Le critère de persécution renvoie
à des violations graves des droits de l'homme ou à d'autres
formes de préjudices autant plus graves. La persécution doit par
ailleurs être liée à l'un des motifs
énumérés dans la définition de
réfugié par les instruments internationaux et régionaux
(la race, la religion, l'appartenance à un groupe racial, la
nationalité, les opinions politiques, l'agression, les
évènements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou
la totalité du pays). Précisons que la persécution peut
émaner des personnes individuelles ou des entités non
étatiques, dans ce cas, la persécution est fondée
uniquement si les autorités du pays d'origine du demandeur d'asile ne
veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective et efficace à
celui-ci.
A côté des critères d'inclusion, il existe
des critères d'exclusion pour certaines personnes ne pouvant pas jouir
du statut de réfugié.
B. Critères d'exclusion au statut
de réfugié
Les critères dits d'exclusion sont les critères
ne permettant pas au demandeur d'asile d'acquérir le statut de
réfugié ; ils sont différents des clauses d'exclusion
qui sont définies comme des normes ou dispositions légales qui
refusent les avantages de la protection internationale aux personnes qui
désirent obtenir le statut de réfugié. Encadrés par
la Convention de Genève de 1951, les critères d'exclusion au
statut de réfugié sont nombreux. Ainsi, l'article 1.D, 1.E et 1.F
de ladite Convention présente clairement quels sont ces
critères ; l'exclusion aux termes de l'article 1.E85(*) signifie qu'une personne ne
peut bénéficier de la protection internationale d'un pays
d'accueil si celle-ci se réclame encore de la protection de son pays
d'origine ou du pays dont elle a fixé sa résidence ; en
d'autres termes, cette catégorie de personne ne peut
bénéficier de la protection accordée aux
réfugiés. L'article 1.F86(*) pour sa part concerne les personnes qui ne
méritent pas la protection internationale en raison de la commission de
certains crimes graves ; il s'agit là de l'exclusion des personnes dont
on aura de fortes raisons de croire qu'elles ont commis des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité, des crimes contre la paix
conformément aux dispositions internationales prévues en cas de
commissions de crimes graves de droit commun, commis en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ; aux
personnes qui se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et
principes des Nations Unies. Et enfin l'article 1.D87(*) qui traite de l'exclusion des
personnes bénéficiant d'une protection ou d'une assistance de la
part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ;
en d'autres termes, les personnes qui bénéficient
déjà de la protection et ou de l'assistance d'un organisme des
Nations Unies ne peut plus bénéficier du statut de
réfugié dans un pays d'accueil. Par ailleurs, ces critères
d'exclusion doivent être traités avec la plus grande
délicatesse dans la mesure où l'exclusion impliquerait des
conséquences graves pour ces personnes demandant l'asile. Pour parler
des clauses d'exclusion, l'article 1.C88(*) nous donne un éclairci des personnes dont le
titre de réfugié a cessé ; par exemple, le statut de
réfugié peut cesser si la personne s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la
nationalité ; si la personne a acquis une nouvelle
nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la
nationalité pour ne citer que ceux-ci.
Par ailleurs, l'obtention du statut de réfugié
permet la jouissance de plein droit desprérogatives exclusives aux
réfugiés mais également des différents droits et
libertés accordés aux nationaux relativement au dispositif en
vigueur.
Section 2 : JOUISSANCE DU DROIT A LIBRE CIRCULATION DES
REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
Tel que précisé plus haut, une fois le statut de
réfugié accordé, le réfugié
bénéficie d'un certain nombre de prérogatives qui lui sont
propres, mais aussi desdroits et libertés accordés aux nationaux
du pays d'accueil. Dans cette section, on présentera dans un premier
temps les prérogatives exclusives aux réfugiés
relativement à leur statut (Paragraphe 1) et dans un
second temps, les garanties offertes à ces derniers par l'Etat
camerounais(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
Prérogatives octroyées par le statut de
réfugiés
La reconnaissance officielle du statut de
réfugié octroie au réfugié des droits et des
obligations, mais aussi des privilèges ; également une
protection et une assistance qui relèvent de la compétence de
l'Etat du Cameroun et celle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR). Ces prérogatives sont consacrées
par les différents instruments juridiques à la fois nationaux et
internationaux ; dès lors elles ne sortent pas de l'ordinaire,
elles ont été instituées dans le but de permettre au
réfugié de pouvoir s'épanouir pleinement bien que
n'étant plus dans son pays d'origine ou dont il a établi sa
résidence, de s'y sentir comme chez lui et même mieux que chez
lui. Il s'agit donc là du droit d'aller et venir librement d'un lieu
pour un autre (A) et de la non-discrimination en
général (B).
A. Droit à la libre circulation
des réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
Consacré par les normes nationales, toute personne en
règle présente sur le territoire camerounais a le droit d'y
circuler librement, tout réfugié reconnu comme tel par l'Etat
camerounais reçoit une carte de réfugié après
obtention du statut de réfugié, dont la durée de
validité et les modalités de renouvellement sont fixées
par décret. L'article 9 de la Loi de 2005 portant statut des
réfugiés au Cameroun dispose le droit à la liberté
de circulation conformément aux dispositions des instruments
internationaux notamment les Conventions de Genève relative aux
réfugiés du 28 juillet 1951 et celle de l'OUA du 10 septembre
1969 relative aux réfugiés qui s'appliquent à tout
réfugié régulièrement installé au Cameroun.
En effet jouir pleinement de son droit à la libre
circulation revient pour les réfugiés centrafricains vivant dans
la ville de Yaoundé à pouvoir aller d'une ville à une
autre, de pouvoir se déplacer sans aucune crainte d'un lieu pour un
autre et même de pouvoir mener une activité, s'instruire ou se
procurer des soins de santé sans être arrêtés ou
interpellés arbitrairement.Le droit à la libre circulation des
réfugiés est un droit capital concourant à leur plein
épanouissement au sein de l'Etat d'accueil car qui dit libre circulation
dit liberté de mouvement, cette liberté de mouvement qui engendre
la jouissance des autres droits fondamentaux reconnus aux populations locales.
Toutefois, en vue de jouir de façon effective de cette
liberté, les réfugiés centrafricains de la ville de
Yaoundé ont l'obligation de se conformer aux lois et règlements
en vigueur au sein de l'Etat du Cameroun. L'Etat pour sa part a le devoir
d'assurer leur protection et de garantir les droits qui leurs ont
été octroyés par le statut de réfugiés.
B. Non-discrimination
Relativement à l'article 9 de la Loi de 2005 portant
statut des réfugiés au Cameroun, la Non-discrimination est le
premier droit accordé à toute personne reconnue officiellement
comme réfugié. Tout d'abord, qu'entend-t-on par le terme
discrimination ? Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies
l'appréhende comme « toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, dans
des conditions d'égalité, de l'ensemble des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ».89(*)
Le droit à la non-discrimination ou leprincipe de
non-discrimination est donc un droit à la fois complexe et fondamental
constituant la clé de voûte de la mise en oeuvre des droits
humains en général. Il implique que tous doivent être
traités de la même manière, protégés de la
même manière et pouvoir bénéficier au même
titre du respect de la personne humaine et de leur dignité. Il est
basé sur le principe de l'égalité pour tous, c'est
à ce titre que l'article 1 de la DUDH de 1948 dispose « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité. ».
La Convention Internationale sur l'Elimination de toutes les
formes de Discrimination Raciale à laquelle l'Etat du Cameroun a
adhéré le 27 juin 1984 énonce une panoplie d'articles
relatifs à la non-discrimination raciale. L'article 5 de ladite
Convention attire notre attention sur l'engagement des Etats parties à
interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses
formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité
sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale notamment dans la
jouissance des droits civils tels que le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ; des
droits économiques, sociaux et culturels et de tous les autres droits de
l'homme concourant à son épanouissement et son bien-être.
Les réfugiés étant donc reconnus comme toute personne
humaine bien que vulnérable ont eux aussi le droit d'accès
à tous lieux et services destinés à l'usage du public dans
la ville de Yaoundé, tels que les moyens de transport, les hôtels,
les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs.
Leur statut de réfugié leur donne
également le droit au divertissement et aux loisirs qui ne peut
être effectif que s'ils ont la possibilité de circuler librement.
Les droits octroyés par le statut de réfugié ainsi
énoncés, l'Etat camerounais a le devoir, après avoir
reconnu officiellement le demandeur d'asile comme un réfugié en
lui octroyant les documents officiels, de lui offrir un certain nombre de
garanties.
Paragraphe 2 :
Garanties offertes par l'Etat du Cameroun
Le premier garant de la protection des droits des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé est
l'Etat du Cameroun épaulé par le HCR et les autres institutions
nationales, internationales et non-gouvernementales qui oeuvrent chacune en
fonction de ses compétences. Ceci étant, l'Etat du Cameroun a
pour mission de s'assurer de ce que les réfugiés centrafricains
soient traités avec humanité, dignité et
égalité vis-à-vis des nationaux. A cet effet, en vue
d'assurer la garantie du droit à la libre circulation de ceux-ci, le
gouvernement veille à ce qu'ils ne soient pas sujets à de mauvais
traitements (A) et qu'ils ne fassent pas l'objet
d'interpellations arbitraires (B).
A. Garantie contre les mauvais
traitements des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé
Les mauvais traitements ou abus vis-à-vis des
réfugiés peuvent être physiques ou moraux. L'Etat
camerounais à travers ses différents instruments juridiques
garantit en principe la protection de ceux-ci contre ces abus. Il peut s'agir
de l'extorsion, qui renvoie à l'action de prendre quelque chose mais
surtout une somme d'argent à quelqu'un sans son accord ou sans qu'il ne
soit consentant90(*) ; aussi la stigmatisation, qui renvoie à
des injures ou des incriminations sans fondement, en principe, les
réfugiés centrafricains sont protégés de ces
agissements ; de toute sorte d'humiliation qui conduirait à une
atmosphère de peur et de méfiance vis-à-vis des nationaux.
La CDHC91(*) a mis en place un système de contrôle du
respect des droits humains au sein de l'Etat du Cameroun, de la mise en oeuvre
des dispositions relatives à la protection et à la valorisation
des droits humains mais surtout, elle veille à ce que le Cameroun
respecteles engagements pris par les Etats parties aux différentes
conventions relatives à la protection des droits humains en
général et des réfugiés en particuliers. Le HCR, le
MINDEF et la DGSN oeuvrentdans ce sens afin que les réfugiés
présents sur le territoire camerounais ne soient pas victimes d'abus ou
de toute autre forme de traitements dégradants.
B. Garantie contre les interpellations
et arrestations arbitraires
Les interpellations arbitraires sont une violation du droit
à la liberté, elles désignent l'arrestation, la
détention et la privation de la liberté d'une personne ceci dans
le non-respect du droit national et des standards internationaux. Elles sont
dites arbitraires parce que c'est l'acte par lequel une autorité prive
de liberté une personne sans base légale, elle constituerait donc
un délit et une atteinte grave aux droits humains.L'article 9 de la DUDH
dispose « Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé. »92(*), aussi le PIDCP dispose « Tout individu a
droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention
arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n'est pour des motifs graves et conformément à la
procédure prévue par la loi »93(*). S'appuyant sur cette
disposition, tout réfugié qui se trouve privé de sa
liberté par arrestation ou détention arbitraire a le droit
d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans
délai sur la légalité ou non de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale ;
le réfugié victime d'arrestation ou de détention
illégale a droit à la réparation. Le Cameroun étant
partie aux différents instruments internationaux, ces dispositions
devraient en principe s'appliquer en cas d'interpellation arbitraire d'un
réfugié centrafricain au sein de son territoire.
Notons tout d'abord que la carte de réfugié est
un document d'identification délivré au demandeur qui
bénéficie du droit d'asile, ayant une durée de
validité de deux ans renouvelables, elle permet en principe au
réfugié de circuler librement. Toutefois, en cas de changement de
localité à l'intérieur du territoire national, tout
étranger admis à séjourner ou à résider est
tenu de signaler aux autorités compétentes au moment de son
départ de l'ancienne localité et, sous huitaine94(*), à l'arrivée
à la nouvelle localité. Par ailleurs,tout réfugié
est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur au même
titre que les nationaux.
CONCLUSION DU DEUXIEME
CHAPITRE
Au demeurant, le deuxième chapitre portant sur
l'opérationnalisation du droit à la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé a permis de
démontrer que l'Etat de par ses différents démembrements
et l'appui des acteurs internationaux spécifiques et
généraux à la protection des réfugiés en
général oeuvrent dans ce sens à travers un certain nombre
de mécanismes à l'implémentation de ce droit sur toute
l'étendue du territoire camerounais.
Passant par l'octroi du statut de réfugié selon
une procédure déterminée et des critères
précis et par la jouissance effective de ce droit à travers les
prérogatives et les garanties offertes par l'Etat du Cameroun aux
réfugiés, ces mécanismes permettent en principe de
favoriser l'épanouissement des réfugiés et faciliter leur
liberté à se mouvoir sur l'ensemble du territoire.
Précisons par ailleurs que le dispositif camerounais en
vigueur relatif au statut des réfugiés dispose que tout demandeur
d'asile reconnu officiellement comme réfugié au Cameroun, se doit
de respecter les lois et dispositions en vigueur au Cameroun afin
d'éviter toute ambiguïté avec les forces de l'ordre et la
justice.
Nonobstant ces divers mécanismes, il serait hypocrite
de dire que ces derniers suffisent à faciliter et à garantir une
mise en oeuvre concrète du droit à la libre circulation des
réfugiés urbains au Cameroun.
Sur le terrain, les enquêtes menées prouvent
clairement que ces derniers font généralement face à des
situations désagréables, preuve de la protection lacunaire du
droit à la libre circulation de ces personnes en situation de
vulnérabilité au Cameroun.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Eu égard à ce qui précède, cette
première partie portant sur la garantie juridique du droit à la
libre circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé nous démontreà suffisanceque sur le plan
international comme national, les réfugiés sont tout d'abord des
personnes à part entière possédant des droits et des
devoirs ; de ce constat, ils doivent être traités avec
humanité, égalité et dans le total respect de leur
personne.
Par ailleurs, lalibre circulation est un droit capital pour le
bien-être, l'épanouissement et la réinsertion des
réfugiés en terred'accueil ; c'est un droit qui leur permet
de jouir de tous les autres droits humains.
Tout au long de cette partie, nous avons constaté que
sur le plan juridique, la protection de ce droit est avérée et
donc garantie, parce queconsacré et encadré par diversesnormes et
institutions tant sur le plan national qu'international.
Bien qu'au Cameroun bon nombre d'actions soient menées
par le gouvernement avec l'appui des organismes internationaux et non
gouvernementaux dans le but de garantirle droit à la libre circulation
des réfugiés urbains de la ville de Yaoundé, ces actionsne
sont pas efficaces dans leur application, encore moins suffisantes.
En effet, sur le terrain, les réfugiés sont
encore confrontés à de nombreuses difficultés qui portent
atteinteà leurs différentsdroits, notamment celui de la libre
circulation. Ces difficultés peuvent être d'ordre social,
sécuritaire, juridictionnel ou administratif.
C'est ce qui oriente notre deuxième partie vers la
recherche des solutions adéquates et durables en vue de rendre cette
protectionnon seulement perfectiblemais surtoutefficace et concrète.
DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DROIT A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN :
UNEPROTECTION PERFECTIBLE
Bien que garanti juridiquement, le droit à la libre
circulation des réfugiés est difficilement mis en oeuvre dans la
ville de Yaoundé. En effet, la protection du droit à la libre
circulation des personnes en général et des
réfugiés en particulierest assez complexe sur le planpratique. Du
fait de cette complexité les réfugiés se voient
abusés dans leurs droits et font face par la même occasion
à de nombreuses difficultés qui entravent leur droit à la
libre circulation.
Suivant cet ordre d'idées, nous démontrerons
dans un premier temps la mise en oeuvre difficultueusedu droit à la
libre circulation des réfugiés sur le plan factuel
(Chapitre 1), avant de proposer un ensemble de solutions qui
vont concourir à améliorer la protection du droit à la
libre circulation des personnes en général et des
réfugiés en particulier (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 :MISE EN OEUVREDIFFICULTUEUSEDU DROIT A LA
LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE
« La liberté de circulation est un droit
humain fondamental, et les réfugiés ne devraient pas être
traités comme des criminels pour avoir cherché à sauver
leur vie. »95(*)
La libre circulation des personnes en général au
Cameroun a rencontré de nombreuses difficultés depuis 2015 au
regard de l'instabilité sécuritaire du pays. Ces
difficultés se sont avérées être beaucoup plus
préjudiciables vis-à-vis des réfugiés. Bien que le
Cameroun soit considéré comme un Etat de droit mais surtout comme
une terre d'accueil et d'hospitalité, les réfugiés font
très souvent face à diverses violations de leurs droits,
notamment celui de la libre circulation ; qui est un droit civil capital
pour la réinsertion sociale, le bien-être et le réel
épanouissement des réfugiés en terre d'asile.
Dans ce sens, envisager de présenter
l'effectivité partielle de la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé revient à faire ressortir le grand écart qu'il y a
entre l'existence de la norme et son application96(*) sur le terrain. D'où la
mise en oeuvre difficultueuse du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains à travers d'une part les obstacles
relatifs aux nationaux (Section 1) et d'autre part les
écueils relatifs à l'accès aux services publics
(Section 2).
Section 1 : OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES
REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE RELATIFS AUX NATIONAUX
Parler des obstacles de la libre circulation des
réfugiés relatifs aux nationaux revient à parler des
agissements qu'ont les nationaux envers ces derniers. Nous le savons sans
doute, la présence des étrangers dans un pays n'est pas toujours
facile à accepter pour les nationaux, engendrant en eux quelques fois
des pulsions diverses. Ces obstacles peuvent être liés aux
agissements des forces de l'ordre (Paragraphe 1) ou aux
intimidations de la population locale (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
Agissements des forces de l'ordre entravant le droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé
De par leur qualification, il nous est presque impensable de
croire que les forces de l'ordre pourraient causer du tort aux
réfugiés au point de porter atteinte aux droits qui leurs sont
reconnus, ces mêmes agents de police et de gendarmerie qui
représentent le maintien de l'ordre, la justice et
l'équité en temps normal. Or, dans la pratique il n'en est rien,
les réfugiés sont malmenés par les forces de maintien de
l'ordre. Les pratiques courantes auxquelles elles ont recours sont les
interpellations et arrestations arbitraires (A) et l'extorsion
et/ou les tentatives de corruption (B).
A. Interpellations et arrestations
arbitraires
De manière générale, le Cameroun applique
une généreuse politique d'ouverture des frontières
à l'égard des demandeurs d'asile et accueille de nombreux
réfugiés ; mais l'observation du quotidien de cette
catégorie de personnes en situation de vulnérabilité donne
à voir que de sérieux obstacles demeurent,
précisément en rapport avec le droit à la libre
circulation. Commençons tout d'abord par définir ce qu'on entend
par interpellation et/ou arrestation arbitraire ; conformément aux
dispositions de l'article 9 de la DUDH du 10 décembre 1948,
« Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé. »97(*) ; l'article 9 (1) du PIDCP le complète en
ces termes « Tout individu a droit à la liberté et
à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être
privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et
conformément à la procédure prévue par la
loi. »98(*).
Relativement à ces deux articles, nous pouvons dire de l'interpellation
et/ou de l'arrestation arbitraire qu'elle est une violation du droit à
la liberté ; elle désigne donc la privation de
liberté d'une personne dans le non-respect du droit national ou des
standards internationaux.99(*) Très souvent l'oeuvre des forces de maintien
de l'ordre, les arrestations et/ou interpellations arbitraires font parties des
actionsqui entravent réellement le droit à la libre circulation
des réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé.
D'après le rapport de l'Ordre des Avocats au Barreau du
Cameroun sur l'état des Droits de l'Homme au Cameroun en
2017, « face à cette situation, les
réfugiés adoptent diverses stratégies pour éviter
ces difficultés. Certains se font délivrer frauduleusement des
cartes d'identité nationale camerounaise. »100(*) D'autres choisissent de
s'adonner de manière ponctuelle à la corruption ou l'extorsion
d'argent par les forces de l'ordre en cas de contrôle. Cette mauvaise
pratique de manipulation d'identité s'est finalement normalisée
à tel point que le danger pour le réfugié est moins le
défaut de carte de réfugié que le manque d'argent pour
donner aux agents. La Loi constitutionnelle camerounaise et le
Législateur interdisent les arrestations et les détentions
arbitraires et garantissent de ce fait le droit de toute personne de contester
devant le tribunal, la légalité de son arrestation ou de sa
détention et de recevoir compensation en cas de blessure grave des
suites d'une détention illégale ; toutefois, le gouvernement
n'a pas toujours respecté ces dispositions101(*).
Lors de nos descentes sur le terrain, nous avons
confrontés des agents de police qui justifiaient leurs actes en accusant
la situation sécuritaire actuelle du pays pour abuser des
réfugiés, prétextant que certains réfugiés
peuvent faire partir des rebelles qui cherchent à déstabiliser et
détruire le pays et affirmant qu'ils rencontrent de plus en plus des
falsifications ou fausses pièces d'identité lors de leurs heures
de rafles ; or, la Loi exige de la police qu'elle obtienne un mandat d'un
juge ou d'un procureur et qu'elle divulgue son identité et indique les
motifs de son arrestation avant d'appréhender un
« suspect », sauf cas de flagrant délit102(*).Que ces informations soient
avérées ou non, nul ne peut faire en principe l'objet d'une
arrestation arbitraire ; interpeller une personne sur la base d'un
soupçon est totalement illégal et délictuel.
Nous pensons fermement que ces actions doivent être non
seulement prohibées mais surtout réprimées par
l'autorité compétente en matière de délitsau
Cameroun, car ces arrestations ou interpellations arbitraires peuvent
être considérées comme tels103(*). En effet, selon un rapport
de U.S EMBASSY, la police, la gendarmerie les responsables des forces
armées et d'autres autorités gouvernementales auraient
continué d'arrêter et de détenir arbitrairement des
individus et, souvent, de les maintenir en détention prolongée
sans mise en accusation ou sans procès, et parfois au secret104(*).
B. Extorsion et tentatives de
corruption
Rappelons tout d'abord qu'une extorsion s'entend comme le fait
d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, un engagement, une
renonciation soit de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien
quelconque.105(*)Au
Cameroun, en dépit de la Commission Nationale Anti-Corruption, ce
phénomène prend de plus en plus de l'ampleur au sein des
administrations publiques. Certains agents du gouvernement s'adonnent à
coeur joie et sans état d'âme à cette mauvaise pratique.
Tel que l'a souligné la Commission des Droits de l'Homme du Barreau du
Cameroun dans leur rapport de 2017106(*) sur l'état des droits de l'homme au Cameroun,
au regard de certaines situations auxquelles font face les
réfugiés, ils sont souvent contraints à donner une
certaine somme d'argent aux agents de contrôle routier par peur
d'être inquiétés. La méconnaissance des droits dont
ils jouissent les exposent à ces pratiques malsaines orchestrées
par certains agents de l'Etat véreux à qui ces situations de
confrontation profitent la plupart du temps. Se basant sur les informations
collectées lors de l'entretien avec certains réfugiés
centrafricains vivant à Yaoundé107(*), lors des contrôles d'identité au
niveau des barrières de gendarmerie durant leur déplacement d'une
ville pour une autre, les forces de l'ordre après identification leur
demande souvent de descendre du bus papiers en règle ou non ; une
fois descendus du bus, ils sont menacés par ces derniers d'être
enfermés ou retenus sur place quid à interrompre brusquement leur
voyage. Certains font l'objet de violence et de brutalité par les forces
de l'ordre lorsqu'ils ne veulent pas coopérer du fait de la
régularité de leurs pièces d'identité108(*) ; ces agents
véreux les menacent et les contraignent à leur donner une
certaine somme d'argent s'ils veulent poursuivre leur voyage ou être
libérés et cette manoeuvre se fait pratiquement tout le long du
voyage à chaque point de contrôle. Ils extorquent des pots de vin
aux voyageurs et les harcèlent aux barrages routiers et aux postes de
contrôle dans les villes et sur la plupart des grandes routes ;
aussi, les séparatistes continuent d'imposer un confinement obligatoire
aux personnes mais restreignent également les déplacements
interurbains109(*).
Nous constatons avec désolation qu'au Cameroun les
réfugiés centrafricains ne peuvent pas effectivement se
déplacer librement comme le prévoit les textes internationaux
ratifiés et les normes internes; il existe encore un réel
problème d'implémentation de ce droit au sein du territoire.Bien
que la Constitution et les dispositions en vigueur garantissent la
librecirculation au Cameroun, le Gouvernement et les groupes armés non
étatiques restreignent parfois l'exercice de cette liberté du
fait d'un conflit armé interne.Au cours d'un entretien avec un personnel
du HCR, il en ressort que le problème de la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé provient en effet de
l'administration camerounaise qui selon lui ne fournit aucun effort pour
améliorer la situation de ces personnes. Il poursuit ses propos en
disant : « si les agents du gouvernement chargés
de la gestion des réfugiés y mettaient du leurs un tant soit peu,
nous pensons véritablement que les réfugiés se sentiraient
autant à l'aise que les camerounais, ils pourraient s'épanouir,
se déplacer avec aisance sans crainte d'être interpellés et
pourraient travailler dans la sérénité ; parce qu'il
faut le dire, les réfugiés sont discriminés et
marginalisés au Cameroun, ils sont misérables et le travail que
fournit le HCR pour les protéger et les assister n'est pas suffisant,
nous ne pouvons pas tout faire SEUL, telle est la triste réalité.
»110(*).
Il serait nécessaire pour le Gouvernement de prendre
des mesures drastiques à l'encontre de ces agents de police et
gendarmerie qui se donnent le luxe d'exercer ces combines en vue de favoriser
l'épanouissement effectif des réfugiés et faciliter leur
liberté de mouvements.
Paragraphe 2 :
Obstacles liés aux intimidations de la population locale
Accueillir des étrangers au sein de son territoire
n'est pas toujours vue d'un bon oeil par ses populations locales. Au Cameroun,
depuis l'an 2013, nous ne pouvons pas dire avec certitude que les
réfugiés centrafricains qui y ont été accueillis
officiellement se sont véritablement senti épanouis ; entre
les accusations à tort ou à raison des populations locales et les
mauvais traitements dont la plupart sont victimes. Au regard du contexte
socio-politique et économique du pays, les réfugiés
urbains font face à la discrimination et la stigmatisation des
populations locales (A) et à une marginalisation comme
nulle autre pareille (B).
A. Discrimination et stigmatisation des
réfugiés centrafricains par les populations de la ville de
Yaoundé
Bien que consacré par le préambule de la Loi
constitutionnelle camerounaise et par les autres instruments textuels
internationaux ratifiés et internes, le droit à
non-discrimination est le droit le plus violé vis-à-vis de tous
les autres droits au Cameroun. Entre les réfugiés et les
nationaux il existe constamment un véritable climat de tension
lié des fois aux rapports personnels qu'ils entretiennent entre eux ou
aux différentes histoires attribuées à tort ou à
raison à leur nationalité. Au cours de nos entretiens, il en
ressort que pour certains camerounais vivant à Yaoundé, les
réfugiés centrafricains sont des anciens combattants ayant commis
plusieurs exactions, venus au Cameroun pour se réfugier mais
également pour continuer à commettre leurs forfaits sachant
qu'ils seront protégés par les institutions mises en place pour
protéger les droits humains. Pour d'autres, il se dit que des
centrafricains qu'ils sont des agresseurs, des voleurs, des délinquants
et toute sorte de qualificatif dénigrant leur personne humaine ;
traités de tout et de rien, à la moindre situation dramatique ils
sont les premiers à être indexés ; qu'ils soient
accusés à tort ou à raison, les réfugiés
centrafricains font face à une stigmatisation particulière de la
part des « yaoudéens »111(*). Tous ces propos
désobligeants à leur endroit limitent leur mobilité au
sein de la ville pour la simple raison que ces idées se transmettent de
bouches à oreilles et laissent croire à tous les camerounais que
ces rumeurs au sujet des réfugiés centrafricains sont
avérées ; ayant pour effet la peur de se déplacer
pour ces derniers qui ne demandent qu'à être épanouis
après les persécutions dont ils ont été victimes
dans leur pays ou dans les pays à l'intérieur desquels ils
avaient établi leur résidence.
Toujours au cours de nos entretiens avec les
réfugiés centrafricains de la ville de Yaoundé, certains
nous ont révélé que ces rumeurs colportées à
leur sujet ont eu à coûter la vie à certains de leurs
frères, certains ont été victimes de violence de toutes
sortes et se sont retrouvés alités sans jamais pouvoir se
plaindre parce qu'à chaque fois qu'ils se rendaient dans les postes de
police, les officiers ne les prenaient pas au sérieux et au lieu de leur
porter secours, ils en profitaient pour les accuser et davantage les menacer de
les envoyer au cachot ou de les rapatrier dans leur pays sans prendre en
considération la déficit sécuritaire de la RCA. Toutes ces
situations de vulnérabilité ont été pour plusieurs
d'entre eux un énorme traumatisme.
L'afflux des réfugiés fait plus souvent craindre
le pire en termes d'insécurité, d'exportation du conflit
au-delà des frontières et de la dégradation de
l'environnement. Lors de nos investigations sur le terrain, nous avons eu
à échanger avec les populations autochtones de l'arrondissement
de Yaoundé 4ème sur leur avis relativement à la
cohabitation avec les réfugiés centrafricains, plusieurs d'entre
eux partageaient la même opinion en ceci que « les
réfugiés centrafricains sont des étrangers venus
s'accaparer de leurs terres, de leur patrimoine et de leur
identité ; ils détruisent délibérément
nos cultures, arrachent nos boutures de manioc, nos pieds de maïs, ou nos
buttes d'ignames, ils dévastent entièrement nos plantations. Ils
causent des dégâts volontaires et obéissent à un
désir de vengeance comme si c'était de notre faute qu'ils ont
traversés ces situations désastreuses ; nous souhaiterions
sincèrement qu'ils retournent dans leurs pays car ils sont
gênants. ». A partir de cette réflexion, il serait
audacieux de croire que les réfugiés puissent
véritablement se déplacer librement dans la ville de
Yaoundé. L'afflux migratoire a fait naître un caractère
xénophobe dans l'esprit des camerounais à tel point que certains
préfèreraient voir rentrer les centrafricains en RCA, que la
situation sécuritaire soit stable ou non112(*).
Cette situation est vraiment déplorable, nous pensons
que pour une cohabitation dans un esprit de fraternité, relativement
à l'article 1 de la DUDH113(*), il serait judicieux de renforcer le dialogue entre
les populations locales et les réfugiés.
B. Marginalisation des
réfugiés centrafricains par les populations de Yaoundé
Le Cameroun étant pourtant connu comme une terre
d'accueil, de solidarité et d'hospitalité, il n'est pas rare
d'assister à certaines situations faisant ressortir un caractère
marginal des populations de la ville de Yaoundé. Les
réfugiés centrafricains sont détestés et haïs
à la limite, victimes d'injures et de mauvais traitements portant ainsi
atteinte à leur intégrité physique et morale et
présentant un véritable obstacle à leur droit de circuler
librement. Malgré les nombreux instruments juridiques qui existent, la
situation sur le terrain est déplorable ; à la faveur des
entretiens avec de nombreux réfugiés urbains de la ville de
Yaoundé, certains sujets de préoccupation relatifs à
l'exercice de leurs droits fondamentaux ont retenu notre attention.
Il s'agit principalement des violences notoires114(*) auxquelles ces derniers font
face ; entre les violences et abus, les viols sur les jeunes filles et les
femmes, les agressions et des fois la torture, les réfugiés ne
parviennent pas à se sentir en sécurité, ils sont
obligés de se refermer sur eux-mêmes ce qui restreint leurs
mouvements dans la ville. La situation des réfugiés
centrafricains mineurs ne cesse de s'aggraver depuis quelques années,
entre l'absence d'identification, les mariages précoces, les rapts et
enrôlements dans les groupes armés etc... les femmes et les jeunes
filles sont victimes d'exploitation sexuelle et les jeunes garçons sont
enrôlés dans les groupes armés ; cette
catégorie de réfugiés sont des victimes spécifiques
dont la situation nécessite une étude minutieuse et
particulière.
Le rejet social des populations locales dont ils sont victimes
se traduit en une marginalisation sans précédent ; les
autochtones les accusent de vol dans les quartiers, un pousseur nous
affirmait « ils passent dans les quartiers voler les
poulets, les matelas ; parfois tu laisses tes habits dehors, ils viennent
les ramasser et partent avec. ». Relativement à cette
affirmation, l'on peut souligner que, même si ces accusations sont
avérées ou non, la plupart n'exerce aucune activité ;
sans compter qu'il pourrait y avoir des exagérations dans la mesure
où tout vol ou autre délit commis dans les quartiers leur sera
directement attribué, comme quoi le « vol » serait
devenu leur métier. Il est beaucoup plus facile pour les
yaoundéens de tout mettre sur le dos des centrafricains, les
considérant à cet effet comme des boucs émissaires sans
défense ; c'est dans ce sens que de nombreuses accusations
quotidiennes donnent l'ossature à ces rumeurs et récriminations
courantes. Une riveraine nous disait encore « c'est presque chaque
jour qu'on les attrape, c'est comme si on les envoie seulement, ils sont comme
les sourisdu village, dès que tu négliges ta chose ils viennent
seulement porter et fuient avec ! ».
Toutes ces allégations, aussi bien vraies que fausses
créent un réel climat de tension et un véritable
déficit de coexistence convivial entre les deux types de populations.
Aussi, l'augmentation des réfugiés crée la
raréfaction des espaces provoquant une sorte de
promiscuité ; les populations hôtes ont l'impression
d'être délaissé à la faveur des
réfugiés, ce qui conduit davantage à l'alimentation de la
haine qu'ont les nationaux pour les ces derniers. Pour remédier à
cela, nous pensons que les élites communales, les autorités
traditionnelles et les présidents de communauté centrafricaine
par arrondissement gagneraient considérablement à la mise en
oeuvre du dialogue interculturel, des politiques d'intégration
communautaire et de l'acceptation réciproque de tout un chacun sans
réserve discriminatoire de coutume, de religion, de tradition ou de
valeur sociale.
Section 2 : ECUEILS A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES
RELATIFS AUX SERVICES PUBLICS
Les Conventions de 1951 et de 1969 fixent le cadre juridique
permettant de conférer le statut de réfugiés à ces
derniers. Elles attribuent à l'Etat recevant l'afflux des personnes
victimes des situations énumérées dans les conventions, la
responsabilité et le pouvoir de conférer le Statut de
Réfugié. Ces dispositions ont été
internalisées dans plusieurs textes, notamment la Loi de 2005 portant
statut des réfugiés au Cameroun, le Décret de 2011 portant
organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés au Cameroun et l'arrêté ministériel
n° 0013/DIPL/ CAB du 06 Août 2012 sur la composition de la
Commission d'éligibilité au statut des réfugiés et
celle des recours des réfugiés.
Malgré la prépondérance de ces textes,
dans la pratique peu de personnes jouissent du statut de réfugié
au Cameroun. La législation en vigueur prévoit en principe la
possibilité d'accorder l'asile et le statut de réfugié et
dans ce sens le gouvernement a mis en place un système visant à
assurer la protection des droits des réfugiés, bien qu'il soit
poussif.
Dans cet ordre d'idées, les écueils liés
aux services publics relèvent des difficultés d'accès
à la documentation officielle (Paragraphe 1) qui
conduisent à des limitations d'accès aux autres services sociaux
de base (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
Difficultés d'accès à la documentation officielle par les
réfugiés
« Les réfugiés ont le droit de
chercher asile dans un pays sûr, sans être soumis à des
procédures bureaucratiques lentes et oppressives. »115(*)
La question relative à la protection des
réfugiés a suscité durant trois décennies beaucoup
d'intérêt dans le contexte camerounais, c'est dans ce sens que le
Parlement s'est incliné de manière particulière à
l'adoption d'une loi appropriée aux réfugiés à la
faveur du Document d'Addis-Abeba sur les réfugiés et les
déplacements forcés des populations en Afrique116(*) ; il s'agit de la Loi
n°2005/06 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés au
Cameroun. L'avènement de ce texte a fait naître plusieurs autres
textes réglementaires venant en complément à ladite Loi.
Cette Loi crée la CESR qui est chargée d'attribuer la
qualité de réfugié sans en préciser les
contours117(*).
La mise en oeuvre du système camerounais en
matière de documentation étant poussive, le HCR a continué
de fournir documents et assistance aux populations réfugiées. Cet
obstacle lié au système cause une réelle complexification
des démarches administratives se traduisant par la lenteur
(A) et la lourdeur des procédures
(B).
A. Lenteur des procédures
d'accès à la documentation par les réfugiés
Tel que nous l'avons précisé plus haut, la Loi
de 2005 et son Décret d'application de 2011118(*) crée la CESR et fixe
ses missions dont la fourniture des documents officiels aux
réfugiés relativement à l'article 8(1) du décret de
2011 qui dispose : « 1. La commission
d'éligibilité est saisie de toute demande en
éligibilité et décide en premier ressort de l'octroi ou du
refus du statut de réfugié au demandeur d'asile »,
lesdits documents sont la carte de réfugié, la carte de
voyage119(*). Dans
l'ensemble, le gouvernement ne fournit pas de documents d'identité en
temps voulu aux réfugiés et aux autres personnes ayant besoin
d'autres documents primaires. Les institutions nationales intervenant dans le
processus d'octroi du statut de réfugié font
généralement face à des cas de conflit de
compétence dans la mesure où leur nature juridique n'est pas
déterminée ; la Loi de 2005 s'est bornée à
indiquer qu'elle crée la CESR120(*) sans toutefois préciser sa nature juridique.
C'est dans ce sens que Boubakari OUMAROU se pose des questions qui manquent
inlassablement de réponses « la CESR est-elle un
établissement public doté d'une personnalité juridique
avec autonomie financière comme certains le
souhaiteraient ?121(*)s'agit-il d'un pendant du MINREX à
côté du Service des Affaires Spéciales et des
Réfugiés devenu Service des Réfugiés et des
Migrants ? ou s'agit-il d'une juridiction ?122(*) ».
Nous pouvons dire que, face à ces questionnements, la
législation camerounaise semble silencieuse. Relativement à la
question 8 du guide d'entretien n°1 portant sur la durée de la
procédure et en comparaison avec la Loi en vigueur portant statut des
réfugiés au Cameroun, qui dispose que la Commission
d'éligibilité dispose d'un délai maximum de deux (02) mois
pour statuer, les réfugiés centrafricains nous ont affirmé
que la procédure d'octroi du statut mettait un peu plus de huit (08)
mois suivant un ordre chronologique précis ; soit trois (03) mois
pour les papiers d'asile, trois (03) autres mois pour «l'acquis de
droit » et enfin trois (03) autres mois pour la délivrance de
la carte de réfugié. Nous notons une lenteur notoire des
administrations à délivrer les cartes de réfugié,
ce qui nous pousse à nous demander quelle peut en être la
cause ? le HCR ne serait-il pas indépendant en matière de
protection et d'assistance des réfugiés au Cameroun ? Nous
penchant sur le principe de souveraineté de l'Etat, le HCR serait
visiblement soumis au respect stricte des règles de l'Etat
d'accueil ; en d'autres termes, le rôle de protection des
réfugiés et donc de délivrance des cartes de
réfugié revient en premier ressort à l'Etat, le HCR
n'intervenant qu'en appui. C'est ce qui fait en sorte que dans la pratique, peu
de personnes jouissent du statut de réfugiés au Cameroun car la
reconnaissance juridique du statut du réfugié est butée
à différents problèmes notamment institutionnels et
pratiques qui hypothèquent la jouissance des droits qui leur sont
reconnus sur le plan international et national.
Certes le Cameroun compte un peu plus de 275 000
réfugiés centrafricains, mais nous pensons vivement que le
gouvernement devrait intensifier ses collaborations avec les acteurs
internationaux et non gouvernementaux spécifiques à la protection
des réfugiés en vue de pallier à cette défaillance
procédurale.
B. Lourdeur de la procédure
La lourdeur des procédures administratives au Cameroun
est un phénomène visible au sein de toutes les
administrations ; lié au problème du non-respect des
délais de traitement des affaires administratives prévus par la
loi, c'est un mal qu'il faudrait solutionner au plus vite. Relativement
à la procédure d'acquisition du statut de réfugié,
supposée avoir une durée de deux (02) mois seulement, les
demandeurs d'asile se retrouve à patienter pratiquement plus de neuf
mois pour que le statut de réfugié leur soit reconnu ; et
comme si cela ne suffisait pas, comme à l'accoutumée toutes les
décisions relatives à la gestion et à l'encadrement des
réfugiés ou à la réalisation des projets pour
ceux-ci au Cameroun passent au préalable par une consultation et une
approbation des autorités politico-administratives centrales. Le HCR ne
peut donc pas décider de manière unilatérale d'aller dans
le sens contraire de la volonté de l'Etat123(*). La Commission des Droits de
l'Homme au Barreau du Cameroun avait mentionné dans son rapport de
2017 « il se trouve que depuis plus d'une dizaine
d'années, pour des raisons inexpliquées et en tous cas
ignorées de la CDHB, le Gouvernement camerounais n'établit plus
de cartes de réfugié. Pour pallier ce manquement, le HCR
délivre aux réfugiés un document nominatif124(*) permettant son
identification et l'accès aux services des partenaires du
HCR. », cela signifierait-il que le document
délivré par le HCR à titre
« nominatif » est circonscrit dans la mesure où il
permet l'accès des réfugiés uniquement aux services
partenaires du HCR?
Cependant, malgré toutes ces précautions, la
seule reconnaissance du HCR ne permet pas au réfugié de
travailler légalement au Cameroun, encore moins de faire venir sa
famille, de bénéficier des services sociaux, de voyager hors du
pays d'asile ou même de circuler aisément.Il existe de fait un
vide institutionnel qui pénalise l'encadrement administratif des
réfugiés.
Ce déficit institutionnel, se note aussi au niveau de
la Commission prévue par la Loi de 2005 pour conférer le statut
de réfugié aux demandeurs. Cette Commission est très peu
opérationnelle, et constituée de membres non permanents
puisqu'elle est ad hoc. La conséquence est que plusieurs
milliers de personnes sont de facto privées du statut juridique de
réfugié et des droits qui vont avec. Cette
dénégation a pour effet, des tracasseries policières
incessantes pour les réfugiés urbains ; en bref, l'absence
de carte de réfugié établie par l'autorité
camerounaise se traduit en pratique par de nombreuses difficultés et
quiproquos. De concert avec le HCR, le Gouvernement devrait apporter une
réponse rapide et exécutive au problème
d'établissement des cartes de
réfugiésécurisées pour une meilleure protection des
droits des réfugiés sur le territoire camerounais.
Paragraphe
2 :Limitations d'accès aux autres services sociaux de base
Les réfugiés et les demandeurs d'asile
politiques sont des personnes vulnérables qui cherchent à se
faire accepter par les pays d'accueil en faisant prévaloir les risques
qu'ils encourent pour leur sécurité dans leur pays d'origine. Ils
vivent d'une prise en charge par les pays hôtes, mais juste suffisante
pour leur survie. Ils sont dans une angoisse perpétuelle car ne sachant
pas s'ils vont être acceptés par les populations
hôtes ; cette peur d'être rejetés empiète
véritablement leur droit de circuler librement.
Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons
dire que la situation des personnes reconnues comme
« réfugiés » n'est pas toujours
florissante au Cameroun, entre les agissements des FMO et la stigmatisation des
populations locales vis-à-vis d'elles, ces intimidations des nationaux
altèrent de manière considérable leur droit à la
libre circulation au sein du territoire. Cette violation du droit fondamental
de la liberté de mouvement mine gravement la jouissance de tous les
autres droits ; notamment le droit à l'éducation et à
un niveau de vie suffisant (A) et les difficultés
d'accès aux services hospitaliers (B).
A. Impact de la violation du droit
à la libre circulation sur le droit à l'éducation et
à un niveau de vie suffisant des réfugiés
centrafricains
Au vue du contexte socio-politique et économique du
Cameroun depuis l'an 2015, l'on assistait déjà à
l'accès précaire aux services essentiels, qui s'est davantage
détérioré avec l'afflux migratoire des
réfugiés sur le territoire camerounais. Il serait hypocrite de
dire que cette précarité est uniquement orientée vers les
réfugiés, car elle touche également les nationaux qui
vivent dans des conditions assez difficiles liées à l'inflation
et aux crises sécuritaires qui touchent nos différentes
régions. Il est nécessaire de préciser que le droit
à la libre circulation s'entend comme la faculté qu'ont les
individus à aller et venir au sein d'un territoire, sans contraintes ni
restrictions particulières125(*), de cette appréhension nous comprenons que la
liberté de circuler est un droit capital qui facilite ou favorise la
jouissance des autres droits fondamentaux. Au Cameroun, les
réfugiés font face à des difficultés dans
pratiquement tous les domaines, la violation du droit à la libre
circulation a un réel impact sur leur droit à l'éducation
et à un niveau de vie suffisant. C'est dans cette optique que lors de
nos entretiens avec les Présidents de communauté centrafricaine
par arrondissement, notamment les arrondissements de Yaoundé
4ème(Kondengui), Yaoundé
6ème(Biyem-Assi) et Yaoundé 1er (Nlongkak),
il en est ressortit plusieurs problèmes rattachés aux atteintes
à ces prérogatives.
Au sujet de l'éducation, les réfugiés se
plaignent de ce que leurs enfants sont moqués, humiliés et
discriminés dans les établissements publics, ils subissent des
frustrations quotidiennes de la part de certains enseignants et de leurs
camarades qui se laissent mettre des idées en tête par leurs
parents ou tuteurs légaux.D'aucuns s'indignaient du fait que les parents
développent un esprit de haine et de xénophobie à des
enfants d'un si jeune âge « comment peut-on justifier le
fait que des enfants en classe de CE2-CM1 âgés à peine de
07 ans puissent établir une différence entre les étrangers
et les camerounais ? comment justifier les propos racistes et haineux que
tiennent des enfants du primaire à l'égard d'autres enfants comme
eux et ce devant les enseignants ? c'est tout simplement honteux et
malheureux de voir à quel point certains parents inculquent de mauvaises
valeurs à leurs enfants. Au Cameroun, le réfugié n'a pas
de valeur, des fois nous pensons qu'il aurait été
préférable pour nous de mourir dans notre pays au lieu de venir
être traité comme des parias ou des animaux au
Cameroun. » ; cette manière de procéder va
totalement à l'encontre de ce que dispose l'article 13(1) du PIDESC, qui
stipule que les parties prenantes doivent reconnaître à tous la
capacité de jouir du droit à l'éducation dans le respect
de leur dignité et du plein épanouissement de leur
personnalité humaine.
Ne se rapportant pas forcément à la violation du
droit à la libre circulation, les réfugiés
déplorent le fait de ne pas véritablement être
assistés comme ils le souhaiteraient par le HCR du point de vue
éducationnel de leurs enfants. En effet, plusieurs déplorent le
fait qu'ils soient délaissés par le HCR, qui ne leur permet pas
d'être indépendants dans la prise de décision relative
à la question de l'éducation des enfants. Le Président de
la communauté de Yaoundé 4èmenous affirmait
que, « il n'existe pas réellement une assistance
sociale pour les réfugiés à Yaoundé ; il y'a
un problème de financement des établissements publics primaires
et secondaires. Le financement du HCR est conditionné, les enfants qui
vont dans les écoles publiques doivent obligatoirement réussir au
premier trimestre pour bénéficier de ce financement, faute de
quoi le HCR se détache de nous assister. Et ce n'est pas tout, les
réfugiés sont incompris, leurs points de vue ne comptent pas,
certains parents font souvent face à certaines difficultés dans
la mesure où les enseignements dans les écoles publiques
n'étant pas toujours adéquates et efficaces, d'aucuns
désirent inscrire leurs progénitures au privé, mais leurs
espoirs tournent au dérisoire lorsqu'ils se rendent au HCR pour demander
leur aide, pas la totalité mais une partie de la scolarité. Le
responsable qui les reçoit leur dit clairement que l'assistance sociale
n'est valable que pour les enfants inscrits dans les écoles publiques.
Nous réfugiés faisons face à une désolidarisation
marquante du HCR lorsque nous voulons un tant soit peu faire valoir les droits
qui nous sont reconnus. ». Relativement à ces propos, les
réfugiés n'ont pas la possibilité de choisir où
inscrire leurs enfants, ils sont dans l'obligation de se plier aux conditions
du HCR aussi strictes soient elles, or le PIDESC reconnait aux parents le libre
choix de l'établissement126(*) dans lequel ils voudraient inscrire leur
progéniture.
A propos des atteintes au droit à un niveau de vie
suffisant garanti par l'article 11127(*) du PIDESC qui reconnaît à toute
personne le droit d'être à l'abri du besoin ainsi que sa famille.
Il nous est difficile d'affirmer avec exactitude que les réfugiés
urbains de Yaoundé vivent à l'abri du besoin ; les descentes
sur le terrain nous ont permis de faire face à certaines
réalités auxquelles ceux-ci sont exposées, que ce soit en
matière de logement, d'alimentation, d'habillement ou de travail, les
réfugiés urbains vivent un véritable calvaire.
Déjà que trouver un travail n'est pas évident pour eux,
mais quand c'est le cas, ils sont abusés et exploités, ils font
des travaux qui portent atteinte à leur intégrité physique
en s'exposant à des dangers (gardiennage illégal, sans contrat de
travail, des propriétés reculées de la zone urbaine ;
exploitation des jeunes enfants, on les retrouve au bord de la route à
faire de la mendicité s'exposant à des dangers tels que la mort
ou des kidnapping) ... En effet, le fait que leur mobilité soit
restreinte, les réfugiés ont un accès limité
à des opportunités d'emploi décent quand bien même
ils en auraient ; un accès limité aux services sociaux
essentiels et à des conditions de vie décentes, les rendant ainsi
vulnérable à la pauvreté, à l'exploitation et
compromettant leur capacité à subvenir à leurs besoins et
ceux de leurs familles.
Le gouvernement en collaboration avec les Organisations
Internationales partenaires devraient prendre des mesures adéquates pour
pallier à cette situation, soit par la mise sur pied des
Activités régénératrices de revenues exclusivement
reconnues aux réfugiés, soit par l'apport des principaux moyens
de subsistance en fonction des besoins.
B. Difficultés d'accès aux
services hospitaliers liés à la violation du droit à la
libre circulation
Sur le plan sanitaire, la violation du droit à la libre
circulation a un effet à double tranchant ; non seulement elle leur
empêche de bénéficier des traitements médicaux
adéquats mais elle conduit également à des
décès. L'accès aux soins hospitaliers des
réfugiés urbains est une vue d'esprit ; déjà
qu'elle est « sélective » d'après les propos
d'un réfugié de l'arrondissement de Yaoundé
6ème, seuls les enfants âgés de 0-5 ans et les
personnes âgées de 60 ans et plus peuvent bénéficier
de la presque gratuité des soins de santé, soit un paiement de
30% des frais médicaux par les réfugiés et 70% par le HCR.
Au regard de cette affirmation, comment fera le réfugié qui n'a
pas d'emploi ou qui a un emploi aléatoire pour payer les 30%
demandés ? et pour ceux des réfugiés qui n'ont pas
l'âge requis, ne doivent-ils pas également jouir de soins
médicaux ? L'Etat devrait prendre des mesures pour résoudre
cette situation qui davantage crée en les réfugiés un
sentiment de discrimination ou de révolte envers les agents de services
hospitaliers, se disant que c'est une sorte d'arnaque ou d'escroquerie sous
prétexte qu'ils sont protégés par les textes
internationaux et donc en principe ils ne devraient payer aucun frais
médical128(*).
Comme autre difficulté liée à la libre
circulation entravant l'accès aux services hospitaliers par les
réfugiés, nous pouvons accuser l'état des routes ; en
effet, l'état actuel des routes dans certains quartiers de
Yaoundé ne facilite pas la libre circulation des réfugiés,
elle fragilise à cet effet leur droit à la santé dans la
mesure où cette défaillance routière leur cause un
véritable préjudice face aux urgences médicales qui des
fois, nécessitent des évacuations ou des soins approfondis. Les
informations collectées sur le terrain ont permis d'affirmer que le
déficit routier a déjà causé la mort de plus d'un
réfugié à Yaoundé.
Toujours dans le sens des impacts de la libre circulation sur
le droit à la santé des réfugiés, revenons sur le
fait que sur le plan psychologique ces personnes ont subi des traumatismes
psychiques et psychologiques dus à leur déplacement,
« lorsque nous fuyions la guerre, nous avons tout perdu, nos
maisons, nos biens, nos familles, nos parents ainsi que des proches ; nous
ne savons pas s'ils sont tous morts ou s'ils ont rejoint les rebelles, toutes
ces situations sont très émotionnelles. Quand nous arrivons
encore au Cameroun et qu'on ne peut pas aller et venir sans être
pointé du doigt, ça nous frustre davantage et ça nous rend
malades ; pour certains d'entre nous, les églises sont la seule
consolation. Quand tu arrives à l'hôpital ou dans un autre service
public et tu te présentes comme un réfugié, on te demande
le « mot de passe » si tu veux qu'on résolve ton
problème. Le mot de passe là représente une certaine somme
d'argent, si tu n'as pas d'argent on ne prend pas ton cas en charge ; nous
sommes mentalement affectés par toutes ces difficultés auxquelles
nous faisons face au quotidien ».
La restriction de la libre circulation peut ainsi
entraîner la détérioration de l'état de santé
global des réfugiés ; le respect de ce droit est essentiel
pour garantir aux réfugiés l'accès équitable et
adéquat aux services hospitaliers dont ils ont besoin pour
préserver leur bien-être129(*).
CONCLUSION DU PREMIER
CHAPITRE
Le présent chapitre avait pour objectif de
présenter les différents problèmes liés à la
libre circulation auxquels sont confrontés les réfugiés
urbains de la ville de Yaoundé au quotidien.
Il ressort de là que les réfugiés
rencontrent bon nombre de vulnérabilités notamment la violation
du droit à la libre circulation proprement dite, du fait des agissements
des forces de l'ordre à travers les arrestations et interpellations
arbitraires ; mais également du fait des nationaux de par la
marginalisation, la stigmatisation et la discrimination des
réfugiés en zone urbaine.
Nous avons pu constater à quel point certains
camerounais de la ville de Yaoundé haïssent les
réfugiés centrafricains peut-être à tort ou à
raison, bien que cela ne soit pas en accord avec les standards internationaux
et nationaux, notamment l'article 1 de la DUDH et le Préambule de la Loi
Constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996, qui prônent la
non-discrimination et le vivre ensemble dans un esprit de fraternité.
Outre ces difficultés relatives aux nationaux, les
réfugiés centrafricains font face àquelques
défaillances dans l'administration camerounaise à travers la non
fourniture des pièces d'identité requises pour tout
réfugié, la lenteur et la lourdeur des procédures qui
leurs causent un véritable préjudice à l'égard de
leur droit de circuler aisément.
Précisons par ailleurs que ce déficit de
circuler librement empiète sur d'autres droits sociaux de base tels que
le droit à l'éducation, à un niveau de vie suffisant et
à la santé. Il serait nécessaire pour l'Etat du Cameroun
et les institutions internationales spécialisées en la
matière de remédier le plus promptement possible à ces
problèmes.
CHAPITRE 2 : PERFECTIBILITE DE LA PROTECTION DU DROIT A
LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE
« La libre circulation des réfugiés
en Afrique est une question de justice et de dignité humaine. Il est
temps que nous reconnaissons les droits des réfugiés et que nous
travaillons à créer un espace de liberté et de
sécurité pour tous »130(*).
Au début du troisième millénaire,
l'afflux des réfugiés est de plus en plus croissant au Cameroun,
notamment ceux des nationalités centrafricaines et nigérianes.
Cette croissance est sans aucun doute liée à
l'insécurité sécuritaire qui règne dans ces
pays131(*).
Généralement installés dans les zones rurales,
enclavées et précaires qu'en milieux urbains, les
réfugiés des camps semblent rencontrés moins de
difficultés que ceux qui vivent dans les grandes villes.
En effet, les réfugiés urbains font face
à de sérieux défis qui portent atteinte à la
plupart de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de circuler librement
qui a également un véritable impact sur d'autres droits. Bien que
consacré et encadré par les textes et institutions nationaux et
internationaux, le droit à la libre circulation des
réfugiés est vraisemblablement bafoué au Cameroun. Au
cours de nos développements précédents, nous avons pu
relever les différentes situations qui restreignent la liberté de
mouvement auxquelles les réfugiés centrafricains sont
exposés dans la ville de Yaoundé.
Cependant, ces difficultés ne sont pas sans solutions.
C'est dans ce sens que nous proposerons diverses solutions qui pourront
améliorer et faciliter, si elles sont appliquées ; le droit
à la libre circulation des réfugiés au Cameroun en
général. Ainsi, la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés est perfectible de par la mise en oeuvre
progressive du droit à la libre circulation (Section 1)
et la mise en oeuvre du processus de réinsertion efficace
(Section 2).
Section 1 : MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU DROIT A LA
LIBRE CIRCULATION
La mise en oeuvre progressive du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé nécessite de relever au préalable que la
protection de ce droit au Cameroun existe mais elle est partielle et
présente des limites. Cette mise en oeuvre progressive consistera donc
à faire des amendements sur le plan juridique (Paragraphe
1) et à effectuer un recyclage du personnel en charge des
réfugiés à Yaoundé (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 :
Amendements sur le plan juridique en faveur de la libre circulation des
réfugiés à Yaoundé
La situation peu enviable des réfugiés vivant au
Cameroun suscite une réflexion approfondie sur les moyens
appropriés à mettre en oeuvre pour améliorer leurs
conditions de vie132(*).
Bien qu'étant consacrée, la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés n'est pas totalement effective à
Yaoundé, le Cameroun ne semble pas disposer d'une base juridique assez
solide qui assurerait avec efficacité la garantie des droits de l'Homme
en général et des réfugiés en particuliers.
Ceci dit, les amendements juridiques pourraient se faire
à travers l'harmonisation des textes (A) et les
formations juridiques (B).
A. Harmonisation des textes de loi
Parler de l'harmonisation des textes de loi renvoie à
la révision des lois nationales relatives aux réfugiés. En
effet, pour une mise en oeuvre progressive du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé, il serait judicieux de veiller au préalable à ce
que la législation nationale soit conforme aux traités
internationaux relatifs aux droits des réfugiés,
particulièrement en ce qui concerne la liberté de mouvement. Le
Cameroun a certes signé et ratifié les Conventions relatives
à la protection des réfugiés, mais relativement à
son principe de souveraineté, quelques réserves y ont
été émises. A cet effet, le législateur
camerounais pourrait par exemple revisiter certaines réserves
émises à l'endroit du droit à la libre circulation des
réfugiés de sorte qu'il puisse jouir pleinement de ce droit sur
le plan pratique comme les nationaux. Dans ce sens, les
réfugiés pourraient effectuer des voyages d'une ville à
une autre sans avoir forcément besoin d'aller signaler à l'avance
leur déplacement car les nationaux ne le font pas.
Aussi, il serait nécessaire de réformer
la Constitution de 18 janvier 1996 du fait qu'elle souffre de nombreuses
imperfectionsayant un impact négatif sur les droits des
étrangers en général133(*). Cette réforme permettrait à la norme
suprême de refléter l'idéal démocratique et
l'éthique des droits humains.Dans ce sens, le peuple participera au
processus d'adoption de la nouvelle Constitution et cette dernière
pourrait donner une définition claire des droits et libertés
reconnus aux individus, voire consacrer tout un chapitre à la
reconnaissance des droits humains au lieu de s'arrêter à
une présentation ramassée dans son préambule.
La mise en oeuvre progressive peut également se faire
à travers l'adoption des mesures spécifiques, c'est-à-dire
propres aux réfugiés. Il s'agirait de mettre en place des
réglementations spécifiques aux réfugiés qui
garantiraient de ce fait le droit des réfugier à se
déplacer librement à l'intérieur du pays et à
travers les frontières ; les réfugiés se
sentiraient beaucoup plus pris en considération au même titre que
les nationaux s'ils ont la possibilité de voyager sans crainte
d'être interpellés en ce sens qu'ils seraient en possession de
toutes les pièces d'identité facilitant leur déplacement
au sein du territoire. Il faudrait à cet effet adopter des
textesplus contraignants à l'endroit de toute personne qui violerait de
manière volontaire quelque droit reconnu aux
réfugiés, ils pourront dans cet ordre d'idées
êtres à l'abri des arrestations arbitraires, des discriminations
abusives et des atteintes portées à leur intégrité
physique. Le Cameroun devrait mettre réellement en application
les textes édifiés par le législateur,
précisément le Décret n°2012/359 du 16 juillet 2012
fixant les conditions d'application de la Loi n°96/07 du 08 avril 1996
portant sur la prévention et la répression de la torture et des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui
précise les modalités d'application de ladite Loi y compris en ce
qui concerne les réfugiés et demandeur d'asile dans le sens
où ceux-ci ne doivent pas être soumis à la torture ou
à des traitements inhumains ou dégradants.
B. Formation juridique
La formation juridique pourrait être nécessaire
en matière de protection des droits des réfugiés et des
droits de l'Homme notamment en ce qui concerne la liberté de circuler.
Cette formation contribuerait en effet à garantir que les
réfugiés bénéficient pleinement de la jouissance de
leurs droits et puissent librement accéder aux services et
opportunités dont ils ont besoin pour se reconstruire. Elle consiste
à sensibiliser les acteurs juridiques locaux sur les droits des
réfugiés et les mécanismes de protection disponibles pour
assurer le respect de leur liberté de circulation.
Il s'agira aussi de mettre en place des recours
juridiques pour assurer l'accès des réfugiés à des
mécanismes efficaces de recours en cas de violation de leur droit
à la libre circulation. Cette mesure pourrait s'avérer
efficace dans la mesure où le Juge pourra intervenir pour
réprimer les personnes coupables de ces violations et le
réfugié victime pourrait obtenir réparation. Elle
garantirait également l'accès à une justice
équitable telle que prévue par les articles 7, 8,10 et 11 de la
DUDH134(*).
En dépit des failles du système normatif
camerounais, nul ne peut nier que « les droits existent
déjà, il faut seulement les appliquer » comme
l'indiquait Josette NGUEBOU135(*) ; en effet le Juge national étant le
meilleur garant des libertés fondamentales de la personne humaine, il
serait très important pour l'Etat de renforcer ses
compétences, de le préserver de toute corruption et surtout
d'assurer son indépendance vis-à-vis du pouvoir
politique.
Amender le cadre juridique entourant la liberté de
circulation des réfugiés permettra en fin de compte de contribuer
à garantir efficacement le respect de leurs droits fondamentaux à
Yaoundé et à favoriser leur intégration dans la
société.
Paragraphe 2 :
Recyclage du personnel en charge des réfugiés à
Yaoundé
Le recyclage du personnel en charge des réfugiés
à Yaoundépeut grandement faciliter la libre circulation des
réfugiés en améliorant leurs compétences et
connaissances sur les droits des réfugiés, les procédures
administratives et les meilleures pratiques en matière d'accompagnement
des réfugiés. Il s'agira donc d'organiser des formations
théoriques continues (A) et des formations pratiques
d'étude de cas (B).
A. Organisation des formations
théoriques continues
Ces formations continues impliquent :
v Des sessions de développement professionnel : le
personnel travaillera sur lui-même afin de renforcer ses capacité
personnelle et professionnelle pour avoir une meilleure maîtrise de la
situation des réfugiés et des cas auxquels il sera soumis ou fera
face ;
v Des modules sur les droits des réfugiés, les
lois et régulation en vigueur : l'apprentissage des textes et lois
relatifs à la protection des réfugiés et de leur droit
à la libre circulation en particulier ;
v Les procédures administratives liées à
la gestion des réfugiés : maîtriser les
procédures, les étapes et les délais ;
v La sensibilisation interculturelle : le renforcement du
dialogue interculturel et l'intensification des démarches suscitant la
participation des leaders communautaires des réfugiés et de la
population locale pour favoriser la réinsertion sociale ;
v La communication efficace avec les réfugies : le
renforcement du dialogue entre les réfugiés et les populations
locales est une stratégie efficiente pour un meilleur vivre ensemble
dans un esprit de fraternité tel que prescrit par l'article 1 de la
DUDH ;
v La résolution des conflits entre les
réfugiés et les populations hôtes : l'encadrement des
populations locales par les agents du gouvernement sur la prise en charge des
réfugiés réduirait considérablement la naissance
des conflits entre les populations et les réfugiés, les
institutions pourraient prendre en considération l'impact qu'à
l'afflux des réfugiés sur la population et mettre en place des
stratégies qui leurs permettront de vivre dans la paix et
l'harmonie ;
v La gestion du stress et du traumatisme ainsi que d'autres
compétences pertinentes : mettre à la disposition des
réfugiés des psychologues qui les suivront jusqu'à
rétablissement total ou partiel de leur état psychique et
sociologique.
B. Instauration des formations pratiques
d'étude de cas
Il s'agira des mises en situation pratique, des études
de cas, des ateliers de travail en groupe et d'autres méthodes
interactives visant à renforcer les compétences et
améliorer les pratiques professionnelles sur le terrain. L'objectif ici
est d'actualiser les connaissances du personnel, d'améliorer leurs
compétences techniques et relationnelles, et de garantir une approche
efficace et humaine de la prise en charge quotidienne des
réfugiés.
En effet, les formations pratiques favoriseront la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés
centrafricains de la ville de Yaoundé en :
v Renforçant les compétences du personnel en ce
qui concerne les procédures d'accueil, d'enregistrement et
d'accompagnement qui pourra garantir une prise en charge plus efficace et
respectueuse des droits des réfugiés ;
v Permettant au personnel de mieux comprendre les besoins
spécifiques des réfugiés et d'adapter leurs services en
conséquence, par exemple pouvoir reconnaître et répondre
aux traumatismes et aux besoins psychosociaux des
réfugiés ;
v Simulant des situations concrètes et en mettant
l'accent sur la sensibilisation interculturelle et la communication efficace,
ces formations peuvent aider le personnel à développer des
compétences relationnelles essentielles pour établir des liens de
confiance avec les réfugiés, favorisant ainsi une meilleure
protection de leurs droits.
En investissant dans la formation du personnel on contribue de
façon conséquente à la création d'un environnement
plus favorable à la libre circulation des réfugiés.
Section 2 : MISE EN OEUVRE D'UN PROCESSUS DE REINSERTION
EFFICACE
« Les réfugiés ne doivent pas
être traités comme des étrangers, mais comme des citoyens
à part entière, avec les même droits et les mêmes
responsabilités que les citoyens du pays
d'accueil. »136(*)
Parler de la réinsertion efficace des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé revient
à ce que ces derniers puissent véritablement se sentir à
l'aise au milieu des nationaux, qu'ils puissent être épanouis et
jouir pleinement de leur droit à la libre circulation ;
c'est-à-dire se déplacer d'une ville pour une autre,
accéder aux services sociaux de base, pouvoir effectuer un travail
décent, vivre sans avoir la peur constante d'être indexé et
taxé de tout type de propos insultant et dégradant de leur
personne humaine ; cela signifierait également la
possibilité de bénéficier d'un véritable statut
juridique et donc de joui de la personnalité juridique et des
privilèges qui s'en suivent.
Ainsi, nous présenterons d'abord les démarches
pour une implémentation efficiente du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains (Paragraphe
1) avant de présenter les stratégies efficaces
facilitant cette libre circulation dans la ville de Yaoundé
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
Démarches favorisant l'implémentation efficiente du droit
à la libre circulation des réfugiés dans la ville de
Yaoundé
Les démarches d'implémentation sont les
différents moyens pouvant rendre, si elles sont mises en application, la
libre circulation des réfugiés centrafricains effective. Il
s'agira donc de la réelle collaboration entre les différents
acteurs de la protection des réfugiés en vue d'apporter des
réponses efficaces et rapides aux problèmes des
réfugiés (A) et la fourniture en temps
réel de la documentation nécessaire aux demandeurs d'asile
éligibles au statut de réfugié (B).
A. Réelle collaboration entre les
acteurs
Relativement à l'article 2 du Protocole relatif au
Statut des réfugiés de 1967, les Etats parties ayant
ratifié la Convention de Genève relative au Statut des
réfugiés se doivent de coopérer avec le HCR ou
toute autre institution des NU en vue de mieux garantir les droits de
réfugiés.
Outre la collaboration entre l'Etat et le HCR, on peut
également intensifier la collaboration entre les acteurs
nationaux à travers des réunions de coordination
multipartenaires, la collaboration entre les FMO et les
autorités locales qui permettront de lutter contre les
violations auxquelles font face les réfugiés urbains ; cette
collaboration avec les FMO permettrait également d'avoir une certaine
maîtrise au regard de l'indiscipline dont les réfugiés sont
accusés par les populations locale, ce qui améliorerait sans
aucun doute le vivre ensemble.
Une collaboration entre les élites communales,
les autorités traditionnelles et les responsables de communauté
centrafricaine par arrondissement contribuerait à une
implémentation effective des stratégies de protection des
réfugiés et de réduction des conflits avec les
riverains.
Par cette collaboration, le Gouvernement honorera ses
engagements internationaux relatifs aux droits des réfugiés et
demandeurs d'asile, notamment en régularisant à brève
échéance la situation des réfugiés
urbains.
Une sincère collaboration entre le Gouvernement
et les OSC permettrait d'identifier les violations rencontrées par ceux
des réfugiés urbains qui vivent dans des zones enclavées e
d'y apporter des solutions adéquates137(*). L'implication indépendante des OSC
dans la proposition, l'évaluation et la réalisation du droit
à la libre circulation des réfugiés serait un plus dans la
protection des droits des réfugiés urbains.
Aussi, la collaboration entre les institutions
gouvernementales favoriserait l'enrayement des pratiques de corruption au sein
des administrations ; la Commission Nationale Anti-Corruption a
déjà fait un grand pas dans ce sens, mais cela n'est pas
suffisant. Toutes les institutions nationales devraient collaborer avec elle
dans le but de dénoncer les personnes faisant recours à ces
pratiques vis-à-vis des réfugiés mais aussi des
nationaux.
La collaboration entre le Gouvernement et les
administrations douanière et frontalière pour favoriser la libre
circulation des biens et des personnes au Cameroun en
général.
La collaboration entre tous ces acteurs serait un
véritable bond en avant pour implémenter le droit à la
libre circulation au Cameroun.
B. Fourniture de la documentation
nécessaire à la libre circulation des réfugiés
à Yaoundé
Comme les nationaux, les réfugiés urbains ont
également besoin des pièces d'identité ; si pour les
camerounais il s'agit de la Carte Nationale d'Identité, pour les
réfugiés il s'agit plutôt de la Carte de
Réfugié. En l'état, c'est la seule pièce
justificative du statut juridique qui leur ai reconnu et qui leur permet de se
déplacer librement au sein d'un pays d'accueil. Il est bien beau de
consacrer l'octroi des documents officiels aux réfugiés, le
véritable problème se pose dans la pratique ; sur le
terrain, ces dispositions ne sont pas effectives, les réfugiés se
plaignent de ne pas avoir des cartes de réfugiés mais aussi
d'être arrêtés malgré leurs cartes.
Concernant premièrement la fourniture des cartes, nous
pensons que le Gouvernement devrait évaluer la situation
juridique des centrafricains enregistrés dans les zones urbaines et
donner une suite claire et précise sur le statut qu'elle entend leur
conférer.
Aussi, de concert avec le HCR, le Gouvernement devrait
apporter une réponse rapide au problème d'établissement
des cartes de réfugiés sécurisés pour une meilleure
protection des droits des réfugiés sur le territoire
camerounais.
Egalement, dans l'attente d'une réponse
définitive, l'Etat devrait organiser une sensibilisation de
masse sur le rôle de la carte du HCR.
Sur le plan pratique, les délais d'octroi de la carte
de réfugié devraient respecter les délais prévus
par les textes, pareillement, les procédures qui sont hyper lentes au
sein des administrations devraient être beaucoup plus faciles et
rapides.
Deuxièmement, les réfugiés en possession
de leurs cartes ne devraient plus faire l'objet d'arrestations arbitraires,
pour se faire, l'Etat pourrait adopter des politiques favorables aux
réfugiés de manière à ce que les interpellations
abusives soient véritablement sanctionnées avec toute la rigueur
possible et si celles-ci ont causé un préjudice quelconque au
réfugié, que celui par la faute duquel il est arrivé le
répare sans délai ; ceci permettrait non seulement de
faciliter la circulation effective des réfugiés mais aussi
d'encenser ces personnes immorales qui agissent dans un esprit de
supériorité et d'abus de pouvoir pour développer la peur,
la crainte et la méfiance auprès des réfugiés
centrafricains.
Paragraphe 2 : Autres
stratégies efficaces facilitant le droit à la libre circulation
des réfugiés dans la ville de Yaoundé
La situation socio-politique et économique actuelle du
Cameroun est quelque peu déplorable, dans la mesure où même
les nationaux n'arrivent pas à s'en sortir réellement, combien de
fois pour les centrafricains qui déjà sont des étrangers
mais qui sont surtout taxés de tous les noms ? Cette situation nous
pousse à émettre quelques suggestions efficaces à
l'endroit de l'Etat du Cameroun et des Institutions internationales et non
gouvernementales, notamment :
v Que des ateliers de réflexion soient menés
à l'initiative de l'Etat et/ou du HCR sur la question de la protection
juridique des réfugiés vivant sur le territoire
camerounais ;
v Contraindre les populations locales à respecter les
droits des réfugiés ;
v Créer un guichet unique d'enrôlement au sein
duquel on pourrait trouver les différents organes en charge de la
gestion des réfugiés au Cameroun, notamment les Commissions
d'éligibilité et celle de recours et un bureau du HCR ;
v Sensibiliser les populations sur la notion du «
vivre ensemble » avec les
réfugiés ;
v En partenariat avec le HCR, sensibiliser les
réfugiés sur les prérogatives inhérentes à
leur droit fondamental ;
v Créer des foras d'échanges entre les
responsables d'entreprises, les organisations de la société
civile et les réfugiés pour réfléchir sur la
stratégie d'insertion de ces derniers dans le monde du travail138(*) ;
v Le dialogue franc entre les institutions en charge de la
protection des réfugiés ;
v L'accès aux services sociaux de base de façon
équitable sans discrimination de genre, de nationalité ou
d'âge ;
v Les aménagements routiers pour faciliter la
circulation des personnes et des biens ;
v L'amorçage des politiques communes de
solidarité et de développement favorisant la libre
circulation139(*) ;
v La réduction considérable de la
criminalité transfrontalière qui fragile la
sécurité des personnes et impacte leur libre
circulation ;
v La création des AGR pour les réfugiés
urbains favorisant leur développement autonome et personnel ;
v L'implication réelle du HCR et des autres
institutions internationales dans les problèmes personnels des
réfugiés afin d'y apporter des solutions utiles.
Ces actions pourraient si elles sont appliquées,
garantir véritablement la libre circulation et favoriser la
sécurité et le respect entre les peuples.
CONCLUSION DEUXIEME
CHAPITRE
Ce second chapitre consistait à démontrer que la
protection du droit à la libre circulation des réfugiés
est certes existante de par sa consécration duale, notamment textuelle
et institutionnelle toutefois demeure perfectible.
Cette perfectibilité s'est déclinée en
deux actions conséquentes, à savoir celle de la mise en oeuvre
progressive du droit à la libre circulation, à travers des
amendements sur le plan juridique et le recyclage du personnel en charge de la
prise en charge des réfugiés.
Au long de notre développement, nous avons pu
comprendre que le droit à la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé ne pouvait pas
être totalement effectif du fait de certaines difficultés
indépendantes de leurs volontés auxquelles nous avons
proposé des solutions efficaces et durables.
Mais aussi de par la mise en oeuvre d'un processus de
réinsertion efficace, qui consistera en l'adoption de certaines
démarches et stratégies adéquates en vue de favoriser non
seulement le déplacement mais de plus en plus la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé et au Cameroun en
général.
Conscient de ce que les Lois sont faites par des hommes et que
l'Homme de par sa nature n'est pas un être parfait disposant du monopole
du savoir, nous espérons que les propositions faites à l'endroit
du Gouvernement et des autres Institutions internationales et non
gouvernementales leurs seront utiles afin de mieux implémenter le droit
à la libre circulation des personnes et des biens au Cameroun.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
La deuxième partie de notre travail consistait à
démontrer dans quelle mesure la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés serait partielle pour ne pas dire
lacunaire au Cameroun ; chose qui a été faite au cours de
nos différents développements.
Dans un premier temps nous avons relevé les nombreuses
difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés
urbains de la ville de Yaoundé, entre discrimination, marginalisation,
arrestations et interpellations arbitraires et les difficultés
d'accès à la documentation et aux services sociaux de base tels
que l'éducation, la santé ou encore le droit à un niveau
de vie suffisant. Les réfugiés, qui sont des personnes
douées de raison et de conscience, de droits et de devoirs
déplorent le fait d'être maltraités, lésés et
marginalisés par leurs semblables.
En dépit des initiatives prises par le Gouvernement
pour garantir leurs droits, ceux-ci sont de plus en plus victimes de violences
qui, dans la plupart du temps portent atteinte à leur vie.
Par ailleurs, bien que cette protection soit consacrée,
celle-ci reste perfectible.
Par conséquent, il nous revenaitdefaire des
propositions et suggestions durables et efficaces aux différentes
parties prenantes de la protection des droits de l'homme en
général et des réfugiés en particulier, afin de
garantir non seulement la mise en oeuvre progressive du droit à la libre
circulation des réfugiés, mais aussi de promouvoir le respect, la
fraternité et l'égalité entre les peuples au Cameroun.
Parmi ces propositions efficaces, nous avons l'adoption d'une
politique efficace propre aux réfugiés, le recyclage du personnel
en charge des réfugiés au Cameroun, la mise en application des
textes déjà existants et voire la création d'un guichet
unique d'enrôlement des demandeurs d'asile dès leur entrée
au sein du territoire camerounais dans le but de faciliter l'accès
à la documentation nécessaire pour leur libre circulation.
CONCLUSION GENERALE
In fine, porter une réflexion sur la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés dans la ville
de Yaoundé au Cameroun : cas des centrafricainsnous a
amené à nous interroger sur la question de savoir : comment
s'exerce la protection du droit à la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé considérant le
contexte socio-politique actuel du Cameroun ? Pour répondre
à cette question nous avons présenté dans un premier temps
la garantie juridique de cette protection consacrée par des textes et
institutions et dans un second temps sa perfectibilité dans la mise en
oeuvre.
S'agissant de la garantie juridique, nous avons
constaté qu'elle est textuelle et institutionnelle, et que l'Etat
camerounais a mis en place des mécanismes afin d'assurer son
opérationnalité.
Relativement à la consécration textuelle et
institutionnelle, nous avons noté que le droit à la libre
circulation des réfugiés est garanti par divers instruments
internationaux et nationaux. C'est dans ce sens que les textes internationaux
tels que la Convention de Genève relative au Statut des
réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948, le Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples de 1981, la Convention de l'Union Africaine de 1969
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique, la Convention Internationale relative aux
Droits de l'Enfant de 1989, la Convention contre la torture de 1984 et celle
contre l'élimination de toute sorte de discrimination à
l'égard des femmes de 1979, pour ne citer que ceux-ci garantissent les
droits des réfugiés en général et les
préservent contre toutes sortes de violations. Les textes nationaux
quant à eux ne sont pas restés muets face à la protection
du droit à la libre circulation des réfugiés ;en
l'occurrence : la Loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut
des réfugiés au Cameroun, la Loi n°97/012 du 10 janvier 1997
fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers au Cameroun ; et les textes
réglementaires,notamment : le Décret n°2007/255 du 04
septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi n°97/12
du 10 janvier 1997 fixant les conditions d'entrée, de séjour et
de sortie des étrangers au Cameroun, le Décret n° 20Il /389
du 28 novembre 2011 portant Organisation et fonctionnement des organes de
gestion du statut des réfugiés au Cameroun, qui garantissent au
niveau interne les droits des réfugiés.
S'agissant des institutions, elles sont aussi bien
internationales que nationales.Sur leplan international, nous pouvons citer
entre autres : le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, la Croix-Rouge Internationale, la Cour Africaine des
Droits de l'Homme et d'autres organismes internationaux qui veillent au respect
des droits humains.
Quant aux institutions nationales, le Ministère des
Relations Extérieures, la DGSN, le MINAT, la Présidence de la
République et les Organisations de la Société Civile,
oeuvrent davantage à la protection des droits des personnes sur le
territoire national ; leur contribution a beaucoup plus d'impact que celle
des organismes internationaux compte tenu du fait que celles-ci
maîtrisent mieux les réalités nationales sur le terrain.
En ce qui concerne l'opérationnalisation de la
protection du droit à la libre circulation, les institutions nationales
et internationales agissent en collaboration dans le but de fournir aux
réfugiés toute la documentation nécessaire, en outre,
l'Etat reconnaît aux réfugiés un certain nombre de
prérogatives dèsla reconnaissance de leur statut juridique. Par
conséquent, les garanties offertes par l'Etat aux réfugiés
pourraient les mettre à l'abri des violations de leurs droits.
S'agissant enfin de la perfectibilité de cette
protection, elle consistait au préalable à faire ressortir les
obstacles liés à cette libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé, avant de proposer des
solutions d'amélioration de ladite protection.
C'est dans ce sens que nous avons constaté que les
entraves à la libre circulation des réfugiés peuvent
être l'oeuvre des nationaux, notamment par les agissements des FMO et les
intimidations des populations locales ; elles sont également
liées aux difficultés d'accès aux services publics,
notamment les difficultés d'accès à la documentation dues
à la lenteur et à la lourdeur des procédures ; qui
ont un impactimportant sur l'accès aux autres services sociaux.
Quant auxpropositions d'amélioration, nous avons
émis des suggestions tant sur le plan juridique que pratique ;
notamment l'adoption des textes contraignants au niveau national, les garanties
juridictionnelles sur le plan national, le recyclage du personnel des
commissions en charge de la gestion des réfugiés à
Yaoundé, l'éducationet la sensibilisation des populations locales
sur le respect des droits des réfugiés, l'information des
réfugiés sur leurs différents droits et obligations envers
le pays d'accueil, une meilleure collaboration entre les différentes
parties prenantes, notamment :l'Etat et ses démembrements, le HCR
et les autres OI, les OSC, les autorités locales et les chefs de
communauté des réfugiés ; pour
l'implémentation efficace du droit à la libre circulation des
réfugiés dans la ville de Yaoundé.
Sommes toutes, le Cameroun et les Organisations de la
Société Civile avec l'appui des Organisations Internationales
jouent et continueront à jouer un rôle fondamental dans la
protection et la promotion des Droits de l'Homme en général et
des réfugiés en particulier ; en encourageant le dialogue et
l'adoption des politiques propres à cette catégorie de personnes
en situation de vulnérabilité.
Au demeurant, dans le cadre de l'intégration sous
régionale, le Cameroun resteen Afrique Centrale une terre d'accueil dans
laquelletous les peuples sans distinction de race, de nationalité, ni de
statut juridique vivent, cohabitent et développent leurs
activités dans un climat relativement pacifique.
BIBLIOGRAPHIE :
I. Manuels, dictionnaires :
A- Manuels
? Coordination et gestion des camps (CCCM), UNHCR, septembre
2023, 11pages.
? Droit de l'Homme, recueil des textes, République du
Cameroun, janvier 2018, 851pages.
? Le manuel Sphère : La Charte Humanitaire et les
Standards minimum de l'intervention humanitaire, Mai 2018, 508pages.
? Standards minimum pour la protection de l'enfance dans
l'intervention humanitaire, 2012, 299pages.
B- Dictionnaires
1- Dictionnaires généraux
? Dictionnaire Le Petit Larousse, Editions Larousse, Hachette
Livre, Paris, 2004,1664pages.
? Dictionnaire Hachette, Editions Hachette Livre, Paris, 1997,
991pages.
? Dictionnaire Le Robert, Editions Le Robert, Casablanca, 1951,
500pages.
2- Dictionnaires spécifiques
§ Dictionnaire des droits de l'homme, Dalloz, Paris, 2015,
960 pages.
§ Dictionnaire du droit international des droits de l'homme,
Bruylant, Bruxelles, 2017, 1184pages.
§ Dictionnaire universel des droits de l'homme, Paris,
éditions universitaires, 512pages.
II- Ouvrages :
A- Généraux
? Alphonse Zozime TAMEKAMTA, Le Cameroun face aux
réfugiés centrafricains : Comprendre la crise migratoire et les
résiliences subséquentes, Note d'analyses Sociopolitiques,
n°01, 01 avril 2018, CARPADD, Montréal.
? Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 8ème édition, Paris, PUF, 2000, 925pages.
? Luc CAMBREZY, Lassailly-JACOB. Véronique,
populations réfugiées de l'exil au retour, 419pages.
? Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, 11ème édition, Paris, Précis Dalloz, 2001,
1019pages.
? Philippe PEDROT (dir), Ethique, droit et dignité de
la personne~Mélanges Christian BOLZE, Economica, juin 1999,
427pages.
B- Spécifiques
? Boubakari OUMAROU, « La protection des
réfugiés au Cameroun », Saint Denis, 2018, 249pages.
? Isaac Constantin KAPANDE NDENGUE, « Les
problèmes des réfugiés au Cameroun : le cas des
réfugiés centrafricains dans la ville de Bertoua
(1965-2013) », 157pages.
? José DONABONI MANGA et Stephen AMBE MFORTEH (dir's),
Réfugiés et déplacés internes au
Cameroun : fragilités, normes et pratiques de
réhabilitation, Editions Connaissances et Savoirs, 2021,
341pages.
? Patrick DOLLAT, Libre circulation des personnes et
citoyenneté européenne : enjeux et perspectives,
Bruylant, Bruxelles, 1998, 560pages.
III- Thèses, Mémoires :
A- Thèses
? Alavi PARVIZ, Le rôle des acteurs internationaux dans
la protection des droits humains, thèse de doctorat
3ème cycle, Université de Nice, Science politique,
1986, 377pages,
www.thèses.fr, consulté
le 24 juin 2024.
? Robert Ebénezer NSOGA, la protection des
réfugiés en Afrique Centrale : quelle gouvernance des migrations
forcées pour les Etats centre-africains ? : le cas du Cameroun,
thèse soutenue le 03-07-2020 à Bordeaux 3 dans le cadre de Ecole
Doctorale Montaigne-Humanités (Pessac, Gironde), en partenariat avec Les
Afriques dans le monde (Pessac, Gironde) (laboratoire),
www.thèses.fr, consulté
le 24 octobre 2023, 493pages.
B- Mémoires
? Achille SOMMO PENDE, L'intégration sous
régionale en CEMAC à l'épreuve de la liberté de
circulation des biens et des personnes, UCAC-Master en Gouvernance et
politiques publiques, 2010,
www.mémoireonline.com,
consulté le 11 juillet 2024.
? Clément MOUGOMBILI, La liberté de
circulation : justification philosophique d'un droit humain
fondamental, Rennes, 30 septembre 2023,
www.mémoireonline.com,
consulté le 07 mars 2024.
? Martine AHANDA TANA, Le régime juridique des
étrangers au Cameroun, mémoire de DEA en Droit de la
personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi,
Cotonou/Bénin, 2004, 120pages,
www.mémoireonline.com,
consulté le 24 juin 2024.
? Philomène NGONO BOMBA, La gestion des migrants au
Cameroun, mémoire en DHAH, 2017, 68 pages.
IV- Articles :
1- Généraux
? Hathaway, C. J, «The Rights of Refugees Under
International Law», New York, Cambridge University Press,
2005.
? Alexandre BILAK, « L'Afrique face à ses
déplacés internes » in Politique
étrangère, 2016/1, Printemps, pp39-51.
? Laurent LARDEUX, « Collectifs cosmopolitiques de
réfugiés urbains en Afrique centrale : Entre droits de
l'homme et « droit de cité », Revue française de
sciencepolitique, vol.59, 2009/4, pp 783-804.
? Marc-Antoine PEROUSE de Montclos, « marges urbaines et
migrations forcées à l'épreuve des camps en Afrique de
l'Est », pp191-205.
? Richard TOMO DJAOWE, « les camps de réfugiés
au Cameroun : entre insécurité et protection »,
pp213-232.
? Samuel NGUEMBOCK, « les réfugiés en Afrique
de la protection précaire au cercle vicieux », pp60-69.
? Sophie ALBERT, « hommes et migrations », pp55-63.
2- Spécifiques
? Adam MAHAMAT, « Déplacés et
réfugiés au Cameroun : profils, itinéraires et
expériences à partir des crises nigériane et
centrafricaine », Canadian Journal of African Studies /
Revue canadienne des études africaines, 55 :3, DOI :
10.1080/00083968.2021.1880948,2021, pp585-607.
? Claire RODIER, « Réhabiliter le droit
d'asile par la liberté de circulation »,
RevueProteste, n°101, 2004,
http://www.gisti.org, consulté
le 11 juillet 2024.
? Hyacinthe ATANGANA BAMELA & Joseph Pierre NDAME,
« Crises sécuritaires, mobilités
transfrontalières et dynamique des marchés spontanés entre
ville et campagne dans l'arrondissement de Touboro (Nord-Cameroun) »,
AKOFENA, spécial n°4, novembre 2020, pp 19-32.
? Joséphine LEMOUOGUE, « Vers les terres
d'accueil en Afrique Centrale : La vulnérabilité des
réfugiés centrafricains au Cameroun et au Tchad »,
Revue Canadienne de Géographie Tropicale, 25 décembre 2021,
vol. 8 (2), pp11-15.
? Luc CAMBREZY, « réfugiés et migrants en
Afrique : quel statut pour quelle vulnérabilité ? »,
pp13-28.
? Serge LOUNGOU, « La libre circulation des
personnes au sein de l'espace de la CEMAC : entre mythes et
réalités », Revue Belge de Géographie,
Belgeo, 2010, pp315-330.
? Simon Pierre ZOGO NKADA, « La libre circulation des
personnes : réflexions sur l'expérience de la C.E.M.A.C. et de la
C.E.D.E.A.O. », Revue internationale de
Droitéconomique, 2011/1, pp113-136.
V- Documents :
A- Textes juridiques :
1. Internationaux :
o Universels :
? Déclaration universelle des droits de l'homme 10
décembre 1948.
? Déclaration de New-York pour les réfugiés
et les migrants de 2016.
? Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés du 22 novembre 1984.
? Convention de Genève de 1951 relative au statut de
réfugiés et son protocole additionnel de 1967.
? Résolution 428 de l'Assemblée
générale de l'ONU du 14 décembre 1950 portant statut du
HCR.
? Convention internationale pour l'élimination de toute
forme de discrimination raciale de 1965.
? Convention internationale pour l'élimination de toute
forme de discrimination à l'égard des femmes de 1979.
? Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants de 1984.
? Convention relative aux droits de l'enfant de 1989.
? Pacte International relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966.
? Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels de 1966.
o Régionaux :
? La Convention de l'Union Africaine sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de
Kampala de 2009) et ses deux protocoles.
? La Convention de l'Union Africaine de 1969 régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
? La Charte Africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1990.
? La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 27
juin 1981.
? Le symposium de l'Organisation de l'Unité Africaine et
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 1994,
« Document d'Addis-Abeba, sur les réfugiés et les
déplacés forcés de la population en Afrique »,
Addis-Abeba, OUA.
? Le Protocole au Traité instituant la Communauté
Economique Africaine relatif à la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et le droit d'établissement de 2018.
2- Nationaux :
o Législatifs :
? Loi n°2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des
réfugiés au Cameroun.
? Loi n°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au
Cameroun.
? Loi régissant les étrangers au Cameroun.
? Loi constitutionnelle camerounaise n°96/06 du 18 janvier
1996 modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du
14 avril 2008.
? Loi N°2019/014 du 19 juillet 2019 portant création
et fonctionnement de la Commission des Droits de l'Homme du Cameroun.
o Réglementaires :
? Décret n° 96/034 du 1er avril 1996 portant
création d'une Délégation générale à
la sécurité nationale.
? Décret n°2002/003 du 04 janvier 2002 portant
Organisation de la Délégation Générale à la
Sûreté Nationale.
? Décret n°2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les
modalités d'application de la loi n°97/12 du 10 janvier 1997 fixant
les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers au Cameroun.
? Décret n° 20Il /389 du 28 novembre 2011 portant
Organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés au Cameroun.
? Décret n°2008/376 du 12 novembre 2008, portant
Organisation Administrative de la République du Cameroun.
B- Rapports :
1. Internationaux :
? Comité International de la Croix-Rouge,
déplacés internes et droit international humanitaire.
? Rapport global 2015 du HCR.
? Rapport global 2022 du HCR.
? OIM : rapport sur les déplacements région de
l'extrême-nord, round 22 du 12-31 mars.
? Statistiques du HCR, 2021, disponible sur
www.unhcr.org.
2. Nationaux :
? OCHA Cameroun, rapport de situation, 7 juin 2023.
? Rapport de U.S EMBASSY in Cameroon sur les pratiques en
matière de droits de la personne au Cameroun, 26 juin 2024.
? UNHCR Cameroun, profil du camp Minawao, 20 janvier 2017.
? Human Rights Watch, rapport annuel du Comité National
des Droits de l'Homme et des Libertés du Cameroun.
? Conférence Ministérielle sur la situation des
réfugiés centrafricains au Cameroun, MINREX, décembre
2021.
? Déclaration de la CDHC à l'occasion de la
journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2021.
? Rapport du MINJUSTICE sur l'état des Droits de l'Homme
au Cameroun en 2019.
? Rapport du MINJUSTICE sur l'état des Droits de l'Homme
au Cameroun en 2018.
? Rapport du MINJUSTICE sur l'état des Droits de l'Homme
au Cameroun en 2017.
? Rapport du MIN JUSTICE sur l'état des Droits de l'Homme
au Cameroun en 2022.
LISTE DES ANNEXES :
ANNEXE 1 : GUIDE D'ENTRETIEN 1
ANNEXE 2 : GUIDE D'ENTRETIEN 2
ANNEXE 3 : LOI DE 2005 PORTANT STATUT DES REFUGIES AU
CAMEROUN
ANNEXE 4 :PHOTO ILLUSTRATIVE DU DOCUMENT NOMINATIF DELIVRE
PAR LE HCR A TITRE D'IDENTIFICATION DU REFUGIE AUPRES DU HCR ET DE SES SERVICES
PARTENAIRES
Annexe 1 : Guide d'entretien 1
Questionnaire pour les réfugiés
centrafricains de la ville de Yaoundé
Le questionnaire qui vous est soumis, entre dans le cadre
d'une recherche en vue de l'obtention d'un Master en Droit Public, parcours
Droit de l'Homme et Action Humanitaire. Il s'effectue sous le contrôle
académique de la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université Catholique d'Afrique Centrale. Ladite recherche porte sur
le thème : La protection du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé au Cameroun.
Date
Heure : de
à
Age :
Sexe :
Tranche :
1. Vous êtes au Cameroun depuis combien
d'années ?
2. Dans quelles conditions êtes-vous entré(e) au
Cameroun ?
3. Quelles difficultés avez-vous rencontré
depuis votre arrivée au Cameroun ? pourquoi ?
4. A date, quel est votre statut ? si
réfugié(e), quels sont les documents que vous
possédez ?
5. Avez-vous rencontré des difficultés pour les
obtenir ? oui/non ? si oui, lesquelles ?
6. Vos papiers sont-ils complets ? oui/non ?
7. Si oui, parvenez-vous à circuler librement dans la
ville de Yaoundé ? oui/ non ? si non, pourquoi ? ;
Si non, parvenez-vous à circuler librement malgré les papiers
incomplets ? oui/non ? si non, pourquoi ?
8. La procédure était-elle gratuite ?
oui/non ? pourquoi ? ; Combien de temps a-t-elle mise ?
9. Selon vous, le droit à la libre circulation des
réfugiés est-il protégé au Cameroun, est-il
effectif ? oui/non ? pourquoi ?
10. Selon vous, que faut-il faire pour améliorer et/ou
favoriser la libre circulation des réfugiés à
Yaoundé et au Cameroun en général ?
NB : Les informations collectées dans le
présent guide garderont un caractère confidentiel au terme de la
Loi N°91/023 sur les recensements et enquêtes statistiques au
Cameroun. Elles seront utilisées à des fins académiques et
scientifiques et ne peuvent en aucun cas être utilisées à
des fins de répressions socio-politiques et économiques. Ces
informations seront strictement anonymes et les résultats obtenus
pourront être partagés avec vous sur demande.
Annexe 2 : Guide d'entretien 2
Questionnaire pour les responsables des
réfugiés dans la ville de Yaoundé
Le questionnaire qui vous est soumis, entre dans le cadre
d'une recherche en vue de l'obtention d'un Master en Droit Public, parcours
Droit de l'Homme et Action Humanitaire. Il s'effectue sous le contrôle
académique de la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université Catholique d'Afrique Centrale. Ladite recherche porte sur
le thème : La protection du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé au Cameroun.
Date : Heure : de à
1. Quelle est votre fonction au sein de la structure ?
2. Quel rôle jouez-vous (la structure) dans la
protection des droits des réfugiés ?
3. A date, combien de réfugiés compte-t-on dans
la ville de Yaoundé ? Combien sont des centrafricains ?
4. De manière concrète, quelle est votre (la
structure) contribution à la protection du droit à la libre
circulation des réfugiés centrafricains dans la ville de
Yaoundé au Cameroun ?
5. Pensez-vous que le droit à la libre circulation des
réfugiés soit véritablement effectif dans la ville de
Yaoundé et au Cameroun ? oui/non ?
6. Si oui, comment cette protection se passe-t-elle
concrètement ? si non, quelles en sont les raisons ?
7. Selon vous, que peut-on faire pour faciliter ou
améliorer la protection du droit à la libre circulation des
réfugiés au Cameroun ?
NB : Les informations collectées dans le
présent guide garderont un caractère confidentiel au terme de la
Loi N°91/023 sur les recensements et enquêtes statistiques au
Cameroun. Elles seront utilisées à des fins académiques et
scientifiques et ne peuvent en aucun cas être utilisées à
des fins de répressions socio-politiques et économiques. Ces
informations seront strictement anonymes et les résultats obtenus
pourront être partagés avec vous sur demande.
ANNEXE 3 : LOI DE 2005 PORTANT STATUT DES REFUGIES AU
CAMEROUN
Annexe 4 : Photo illustrative du document
nominatif du HCR à titre d'identification du réfugié
auprès du HCR et ses services partenaires
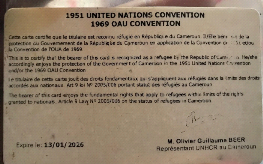
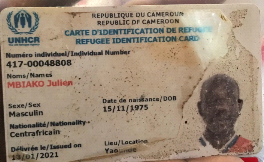
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES, ABREVIATIONS ET ACRONYMES
iv
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
SOMMAIRE
viii
INTRODUCTION GENERALE
1
I- CONTEXTE DE L'ETUDE
2
II- DELIMITATION DE L'ETUDE
3
A. Délimitation spatiale
3
B. Délimitation temporelle
3
C. Délimitation matérielle
3
III- DEFINITION DES TERMES CLES
4
A. Protection
4
B. Réfugiés
5
C. Droit à la libre circulation
5
IV- INTERET DE L'ETUDE
6
A. Intérêt scientifique
6
B. Intérêt social
6
V- REVUE DE LITTERATURE
7
VI- PROBLEMATIQUE
8
VII- HYPOTHESE
9
VIII- CADRE METHODOLOGIQUE
9
1- Méthodes d'analyse
9
a) Méthode juridique
9
b) Méthode sociologique
10
2- Techniques de recherche
10
a) Technique du questionnaire et de
l'entretien
10
b) Technique documentaire
11
IX- ARTICULATION DU PLAN
11
PREMIERE PARTIE : LE DROIT A LA LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE : UN DROIT GARANTI
12
CHAPITRE 1 : GARANTIE JURIDIQUE DU DROIT A LA
LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
13
Section 1 : GARANTIE NORMATIVE CONSACREE
13
Paragraphe 1 : Cadre normatif international du
droit à la libre circulation des réfugiés centrafricains
dans la ville de Yaoundé au Cameroun
14
A. Normes universelles relatives à la
protection des droits des réfugiés
14
B. Normes régionales relatives
à la protection des droits des réfugiés
16
Paragraphe 2 :Garantie du droit à la
libre circulation des réfugiés en droit interne camerounais
18
A. Consécration constitutionnelle du
droit à la libre circulation
18
B. Dispositif législatif et
réglementaire du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
19
Section 2 : MECANISMES DE PROTECTION DU DROIT
A LA LIBRE CIRCUALTION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
20
Paragraphe 1 : Acteurs internationaux
20
A. Acteurs internationaux spécifiques
à la protection du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains à Yaoundé
21
B. Autres acteurs de la protection du droit
à la libre circulation des réfugiés centrafricains
à Yaoundé
22
Paragraphe 2 : Acteurs nationaux
24
A. Acteurs gouvernementaux
24
B. Acteurs non gouvernementaux
25
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
28
CHAPITRE 2 : OPERATIONNALISATION DU DROIT A LA
LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
29
Section 1 : MESURES ADOPTEES PAR LE
GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS EN VUE D'IMPLEMENTER LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION
DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE
29
Paragraphe 1 : Accès aux documents
officiels
30
A. Institutions en charge de la fourniturede
la documentation officielle aux réfugiés au Cameroun
30
B. Procédure d'octroi du statut de
réfugié au Cameroun
32
Paragraphe 2 : Critères
d'éligibilité au statut de réfugié
33
A. Critères d'inclusion au statut de
réfugié
34
B. Critères d'exclusion au statut de
réfugié
35
Section 2 : JOUISSANCE DU DROIT A LIBRE
CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU CAMEROUN
36
Paragraphe 1 : Prérogatives
octroyées par le statut de réfugiés
36
A. Droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
36
B. Non-discrimination
37
Paragraphe 2 : Garanties offertes par l'Etat
du Cameroun
38
A. Garantie contre les mauvais traitements
des réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
38
B. Garantie contre les interpellations et
arrestations arbitraires
39
CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE
41
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
42
DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DU DROIT A LA
LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES CENTRAFRICAINS DANS LA VILLE DE YAOUNDE AU
CAMEROUN : UN DROIT PERFECTIBLE
43
CHAPITRE 1 : MISE EN OEUVRE PARTIELLE DU DROIT
A LA LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE
44
Section 1 : OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION
DES REFUGIES DANS LA VILLE DE YAOUNDE RELATIFS AUX NATIONAUX
44
Paragraphe 1 : Agissements des forces de
l'ordre entravant le droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
45
A. Interpellations et arrestations
arbitraires
45
B. Extorsion et les tentatives de
corruption
47
Paragraphe 2 : Obstacles liés aux
intimidations de la population locale
48
A. Discrimination et stigmatisation des
réfugiés centrafricains par les populations de la ville de
Yaoundé
48
B. Marginalisation des
réfugiés centrafricains par les populations de Yaoundé
50
Section 2 : ECUEILS A LA LIBRE CIRCULATION DES
REFUGIES RELATIFS AUX SERVICES PUBLICS
51
Paragraphe 1 : Difficultés
d'accès à la documentation officielle par les
réfugiés
52
A. Lenteur des procédures
d'accès à la documentation par les réfugiés
52
B. Lourdeur de la procédure
54
Paragraphe 2 : Limitations d'accès aux
autres services sociaux de base
55
A. Impact de la violation du droit à
la libre circulation sur le droit à l'éducation et à un
niveau de vie suffisant des réfugiés centrafricains
55
B. Difficultés d'accès aux
services hospitaliers liés à la violation du droit à la
libre circulation
58
CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE
60
CHAPITRE 2 : PERFECTIBILITE DU DROIT A LA
LIBRE CIRCULATION DES REFUGIES CENTRAFRICAINS DANS LA VILLE DE YAOUNDE
61
Section 1 : MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU
DROIT A LA LIBRE CIRCULATION
61
Paragraphe 1 : Amendements sur le plan
juridique en faveur de la libre circulation des réfugiés à
Yaoundé
62
A. Harmonisation des textes de loi
62
B. Formation juridique
63
Paragraphe 2 : Recyclage du personnel en
charge des réfugiés à Yaoundé
64
A. Organisation des formations
théoriques continues
64
B. Instauration des formations pratiques
d'étude de cas
65
Section 2 : MISE EN OEUVRE D'UN PROCESSUS DE
REINSERTION EFFICACE
66
Paragraphe 1 : Démarches favorisant
l'implémentation efficiente du droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
66
A. Réelle collaboration entre les
acteurs
66
B. Fourniture de la documentation
nécessaire à la libre circulation des réfugiés
à Yaoundé
68
Paragraphe 2 : Autres stratégies
efficaces facilitant le droit à la libre circulation des
réfugiés centrafricains dans la ville de Yaoundé
69
CONCLUSION DEUXIEME CHAPITRE
70
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
71
CONCLUSION GENERALE
72
BIBLIOGRAPHIE :
75
LISTE DES ANNEXES :
ix
TABLE DES MATIERES
82
* 1 Cité par Robert NSOGA
dans La protection des réfugiés en Afrique Centrale...le cas
du Cameroun », p.16.
* 2 La Déclaration
Universelle des droits de l'homme est adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à
Paris au Palais de Chaillot, par la Résolution 217(III) A.
* 3 Convention de
Genève de 1951 relative au Statut des réfugiés, article
1(2).
* 4Robert Ebénezer
NSOGA, « la protection des réfugiés en Afrique Centrale :
quelle gouvernance des migrations forcées pour les Etats
centre-africains ? Le cas du Cameroun », thèse soutenue le
03-07-2020 à Bordeaux 3 dans le cadre de Ecole Doctorale
Montaigne-Humanités (Pessac, Gironde), en partenariat avec Les Afriques
dans le monde (Pessac, Gironde) (laboratoire), 493p.
* 5 Convention des Nations Unies
relative au Statut des réfugiés de 1951.
* 6 Préambule de la Loi
constitutionnelle camerounaise de 1996.
* 7
https://bit.ly/3QeS2IS
, Global Trends Mid year report 2023,
UNHCR, the UN Refugee Agency, consulté le 28 octobre 2023.
* 8 Relativement à la
question n°3 du guide d'entretien 1.
* 9 Comprendre la crise
centrafricaine, « Mission de veille, d'étude et
réflexion prospective sur la crise Centrafricaine et ses dimensions
culturelles et religieuses », rapport final de la mission
effectuée en 2014, rue du Pic de Brette-75015 Paris-France.
* 10Statut du HCR de 1950,
Chapitre 1.
* 11HCR : « Module 1 :
qu'est-ce que la protection des réfugiés ?» Consulté
en ligne le 19décembre 2024
https://www.unhcr.org/fr/4b309d6110.pdf
* 12 Gérard CORNU,
Vocabulaire Juridique, Association Henri CAPITANT, 12e
édition, Dalloz, Paris, 2018.
* 13 Pierre Athanase
LAROUSSE, Le Petit Larousse, Editions Larousse, Hachette Livre, Paris, 2004.
* 14Larousse
étymologique, Paris, Larousse, 1971 , p.63.
* 15 Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés - Convention de
Genève, Nations Unies, Genève-Suisse, 1951.
* 16 Article 1 alinéa
2 convention de l'OUA du 10 septembre 1969.
* 17 Cité par Robert
NSOGA, Op.Cit.
* 18 Serge GUINCHARD,
Gabriel MONTAGNIER (Dir3.), Lexique des termes juridiques, Paris,
Dalloz 1988, p.179.
* 19Laurent LARDEUX, «
Collectifs cosmopolitiques de réfugiés urbains en Afrique
centrale : Entre droits de l'homme et « droit de cité », Revue
française de science politique, vol.59, 2009/4, pp.783-804.
* 20 The New Humanitarian,
Alternatives aux camps de réfugiés : la politique peut-elle
devenir la pratique ? Human Rights Analysis, 07 october 2014.
* 21Idem.
* 22 Mutoy MUBIALA, La
mise en oeuvre du droit des réfugiés et des personnes
déplacées enAfrique, Bruxelles (Belgique), Brulyant, 2006,
142p.
* 23 Serge LOUNGOU, «
La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la CEMAC : entre
mythes et réalités », Revue Belge de Géographie,
Belgeo, 2010, pp.315-330
* 24Idem.
* 25 Paulin IBANDA KABAKA,
« Méthodologie juridique : Méthode de recherche en
Droit », HAL open science, 2023, p.3.
* 26 Robert JACQUIN, «
Le titre du Discours de la Méthode est-il emprunté ?
», in Revue des sciences religieuses, 1952, vol.26, no 2, pp.143-145.
* 27C. Selltiz, L. Wrightsam et
Stuart « Méthodologies de recherche en sciences sociales »,
volume 11, Issue 2, Ed : Cambridge University Press, 1977, p.405.
* 28Idem.
* 29 Madeleine GRAWITZ,
méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 2001, p.34.
* 30Convention de
Genève de 1951 relative au statut de réfugié, article 1
alinéa 2.
* 31 Philomène NGONO
BOMBA, La gestion des migrants au Cameroun, mémoire-UCACA,
2017, p.13.
* 32 Conformément aux
dispositions légales.
* 33 Citoyenneté et
non-discrimination - Actu Juridique
https://www.actu-juridique.fr,
consulté le 28 février 2024.
* 34Idem.
* 35 Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966.
* 36 CICR, services
consultatifs en DIH, « Qu'est-ce-que le droit international
humanitaire ? », juillet 2004, 2p.
* 37
www.unhcr.org, consulté le 28
février 2024.
* 38 Convention des Nations
Unies relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, article
26.
* 39 Article 2 du Protocole
relatif au statut des réfugiés de 1967.
* 40 Article 12 de la CADHP de
1981.
* 41 Article 1 alinéa
2 de la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique.
* 42 Document d'Addis-Abeba
sur les réfugiés et les déplacements forcés des
populations en Afrique, 1994.
* 43 Article 11 du Protocole de
Maputo de 2003,
https://www.droitsafricainsonline.com
, Les droits africains des droits de l'Homme entre conception africaine et
conception universelle - Droits africains, consulté le 07 mars 2024.
* 44 Wole SOYINKA, extrait de
L'Open Sore of a Continent, 1996.
* 45 Appel global 2015 du
HCR - actualisation, Cameroun, 2015, p.2.
* 46 Préambule de la
Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996.
* 47 Articles 1 et 2 de
la Loi de 2005-6 portant statut des réfugiés au Cameroun, qui
définissent le réfugié relativement aux différentes
Conventions ratifiées.
* 48Article 9 de la Loi de 2005
portant statut des réfugiés au Cameroun.
* 49 Recueil des textes
législatifs et règlementaires applicables aux étrangers au
Cameroun, Centre de Recherche sur les Droits et les Devoirs de la Personne
Humaine, CRED, décembre 2012.
* 50Idem.
* 51 Recueil des textes
applicables aux étrangers aux Cameroun, Op.cit.
* 52 Appel Global du
HCR-Cameroun, 2015, p.5.
* 53 Philomène NGONO
BOMBA, La gestion des migrants au Cameroun, mémoire, 2017,
68p.
* 54 Govt. Cameroon,
UNHCR-2023, Cameroun : statistiques des personnes déplacées
de force (novembre 2023), publié le 14 décembre 2023.
* 55
https://www.eeas.europa.eu, 07
juin 2023, consulté le 07 mars 2024.
* 56 Article 14 de la
Loi de 2005, voire en annexe 3.
* 57 Décret n°
63/DF/6 du 09 janvier 1963, contenu dans le Statut de la Croix-Rouge
Camerounaise.
* 58 Article 23 (1) de la
DUDH de 1948 : « Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage. ».
* 59 Article 26 (2) de la
DUDH : « L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de
la paix. », Article 11 (1) de la CADBE de
1990 : « Tout enfant a droit à
l'éducation. ».
* 60 Article 14 (1) de la
CADBE : « Tout enfant a le droit de jouir du meilleur
état de santé physique, mental et spirituel
possible. ».
* 61 Philomène NGONO
BOMBA, La gestion des migrants au Cameroun, 2017, 68p.
* 62 Loi de 2005 portant statut
des réfugiés au Cameroun.
* 63 Décret de 2011
portant organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut des
réfugiés au Cameroun.
* 64 Article 13,
Idem.
* 65 Collectif des
réfugiés au Cameroun, cité par Laurent LARDEUX dans
« Collectifs cosmopolitiques de réfugiés urbains en
Afrique centrale Entre droits de l'homme et « droit de cité
» ; aux pages 791 et 794, Revue française de science
politique,ÉditionsPresses de Sciences Po, 2009/4 (Vol. 59), pp.783-804.
* 66 Article 9 de la Loi de
2005 portant statut des réfugiés au Cameroun, op.cit.
* 67 Appel Global HCR, 2015.
* 68 Zbigniew Paul DIME LI
NLEP, « la garantie des droits fondamentaux au Cameroun »,
Université Abomey-calavi, Bénin - DEA en Droit International des
Droits de l'Homme, 2004,
https://www.mémoireonline.com,
consulté le 07 mars 2024.
* 69Idem.
* 70Idem.
* 71 Cité par
Siméon Patrice KOUAM dans « Le statut des
réfugiés au Cameroun- étude critique de la Loi
n°2005/006 du 27 juillet 2005 », Université de
Yaoundé II - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit
Privé Fondamental, 2004, mémoireonline.com.
* 72 Appel Global du HCR au
Cameroun, 2015.
* 73
https://www.cdhc.cm, Centre de
documentation officiel de la Commission des droits de l'homme du Cameroun -
Site Officiel, consulté le 07 mars 2024.
* 74« Prima
facie » se traduit par « à première vue
ou de prime abord » en français, d'après le
Dictionnaire juridique.
* 75 Article
12 : « En cas d'arrivée massive de personnes en
quête d'asile, et notamment devant l'impossibilité
matérielle de déterminer leur statut sur la base individuelle, la
commission d'éligibilité pour décider de leur
reconnaître le statut de réfugié prima facie sous
réserve de vérifications ultérieures au cas par
cas ».
* 76 Article 7 (1) de
la Loi de 2005, voire annexe 3.
* 77 Article 13 (1),
Idem.
* 78 Article 3 Décret
n°2011/389.
* 79 Article 8 Décret
de 2011.
* 80Cnft questions 4,5
et 6 du guide d'entretien 1.
* 81 Article 9 et 10 du
Décret de 2011 portant Organisation et fonctionnement des organes de
gestion du statut des réfugiés au Cameroun.
* 82 Article 16,
Idem.
* 83 Article 13 de la Loi de
2005 portant Statut des réfugiés au Cameroun.
* 84 Article 2,
Ibid.
* 85 L'article 1. E
dispose : « Cette Convention ne sera pas applicable à une
personne considérée par les autorités compétentes
du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme
ayant les droits et les obligations attachés à la possession de
la nationalité de ce pays. »
* 86 Article 1. F,
Idem.
* 87 L'article 1. D,
Idem.
* 88 Article 1.C, Convention
de Genève de 1951.
* 89UN Human Rights
Commitee, 1989.
* 90 Dictionnaire Larousse.
* 91 Loi n°2019/014 du
19 juillet 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la
Commission des Droits de l'Homme du Cameroun.
* 92 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, 10 décembre 1948.
* 93 Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, 16 décembre 1966.
* 94 Huitaine : une
semaine ou huit jours, Kernerman English Miltilingual Dictionary,
Copyright 2013.
* 95 Ngugi Wa THIONG'O, extrait
de Décoloniser l'esprit, 1986.
* 96 Véronique
CHAMPEIL-DESPLATS, « Effectivité et droits de
l'homme : approche théorique », pp11-26.
* 97 DUDH, Op.Cit.
* 98 PIDCP,Op.Cit.
* 99 TRIAL International,
https://trialinternational.org
, consulté le 28 mai 2024.
* 100 Rapport de 2017 sur
l'état des droits de l'homme au Cameroun par la Commission des Droits de
l'Homme du Barreau du Cameroun, Yaoundé, 2017.
* 101 Rapport de U.S
EMBASSY sur les pratiques en matière de droits de la personne au
Cameroun, 26 juin 2024.
* 102Idem.
* 103 Jeremy BENTHAM,
« La classification des crimes et délits »,
Traité de législation civile et pénale,
« peuvent être considérés comme des
délits privés, des délits contre la personne ;
relativement les injures corporelles, les injures mentales, les
restrictions, la compulsion, le bannissement,
l'emprisonnement... »,
https://www.ledroitcriminel.fr
, consulté le 11 juillet 2024.
* 104Ibid, rapport US
Embassy.
* 105
https://www.legifrance.gouv.fr,
consulté le 1er juillet 2024.
* 106 Rapport CDHB, 2017.
* 107 Confère question
n°3 du guide d'entretien 1 du 10 juillet 2024 à 16h.
* 108Idem, question
n°7.
* 109Ibid. rapport de
US Embassy, juin 2024.
* 110 Confère
question n°5 du guide d'entretien 2 du 11 juillet 2024.
* 111 Camerounais
résidant dans la ville de Yaoundé.
* 112 José DONADONI
MANGA, Stephen MFORTEH AMBE (dir's.), Réfugiés et
déplacés internes au Cameroun. Fragilités, normes et
pratiques de réhabilitation, 341p.
* 113Art.1
DUDH : « Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. »
* 114 Relativement à
la question n°3 du guide d'entretien 1.
* 115 Ngugi Wa THIONG'O,
extrait de Moving the Centre, 1993.
* 116Document d'Addis-Abeba
sur les réfugiés et les déplacements forcés des
populations en Afrique, adopté par le Symposium de l'OUA et du HCR sur
les réfugiés et les déplacements forcés de
populations en Afrique du 8 au 10 septembre 1994, Addis-Abeba-Ethiopie,
5ème recommandation, Paragraphe 3.
* 117 Boubakari OUMAROU,
« Cadre juridico-institutionnel de protection du statut de
réfugié au Cameroun », Connaissances et Savoirs, 2021,
pp21-56.
* 118 Décret
n°2011/389 du 28 novembre 2011 portant Organisation et fonctionnement des
organes de gestion du statut des réfugiés au Cameroun.
* 119 Art. 13 Loi de 2005,
Op.Cit.
* 120 Art. 16,
Ibid.
* 121 Cité par
Martine AHANDA TANA, qui souhaitait comme en France, un Office Camerounais de
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OCPRA) ; selon
elle, « un tel office public devrait être doté d'une
personnalité juridique, de l'autonomie financière et
administrative », 2000, p92.
* 122 Simeon Patrice KOUAM,
Le statut des réfugiés au Cameroun - étude critique de
la Loi n°2005/006 du 27 juillet 2005,
www.memoireonline.com,
consulté le 10 juillet 2024.
* 123 Confère
question n°5 du guide d'entretien 2, du 10 juillet 2024.
* 124 Voir document en
annexe.
* 125 Achille SOMMO PENDE,
« L'intégration sous régionale en CEMAC à
l'épreuve de la liberté de circulation des biens et des
personnes », UCAC-Master en Gouvernance et politiques publiques,
2010,
www.mémoireonline.com,
consulté le 11 juillet 2024.
* 126 Art.
13(3), PIDESC 1966.
www.right-to-education.org,
consulté le 11 juillet 2024
* 127 Art. 11(1),
Idem.
* 128 Art.12 al
2-d « La création de conditions propres à assurer
à tous des services médicaux et une aide médicale en cas
de maladie. », PIDESC.
* 129 Art.
12(1) : « Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. »,
PIDESC.
* 130 Aminata Dramane
Traoré, l'Afrique face à la mondialisation, 2002.
* 131 Fatimatou NJIMBOKET
& Nicole MAMBO TAMNOU, Op.Cit, p.322.
* 132 Philomène
NGONO BOMBA, La gestion des migrants au Cameroun, Mémoire
soutenu à l'UCAC, 2017, p.44.
* 133 AHANDA TANA, Le
régime juridique des étrangers au Cameroun,
www.mémoireonline.com,
consulté le 21 juillet 2024.
* 134 DUDH du 10
décembre 1948.
* 135 Cité par
Philomène NGONO BOMBA dans La gestion des migrants au
Cameroun,Op.Cit, p.47.
* 136 Mahmood Mamdani, extrait
de Saviors and Survivors, 2009.
* 137 José DONADONI
MANGA, Stephen MFORTEH AMBE (dir's.), Réfugiés et
déplacés internes au Cameroun. Fragilités, normes et
pratiques de réhabilitation, 341p.
* 138 Rapport MINJUSTICE sur
la situation des Droits de l'Homme au Cameroun, 2022.
* 139 Cité par Achille
SOMMO PENDE,
www.memoireonline.com,
consulté le 21 juillet 2024.
| 


