B. La Chine : Premier producteur et exportateur
Mondial de textile
1.Malgré quelques points faibles, la Chine conserve
des atouts de premier plan
D'après un rapport de l'OMC, publié durant
l'été 2004, « la part de la Chine dans les importations
de vêtements devrait passer à 50% aux Etats-Unis après la
fin des quotas (pour 16% en 2002), et 29% en Europe (pour 20% en
2002). »
Le seul exemple des Etats-Unis (et de l'Union
Européenne, où la même tendance à été
constatée), est significatif de la force chinoise dans le secteur
textile. En effet, concernant les produits déjà
libéralisés avant le 1er janvier 2005, les exportations de la
Chine ont augmentées de 10 à 20 fois, occupant ainsi entre 40 et
60% de parts de marché selon les produits.
Les deux exemples suivants semblent représentatifs de
la situation : pour les sous-vêtements, les importations en provenance de
Chine sont passées de 16% du marché de l'Union Européenne
en 2001 à 42% en 2003 ; Aux Etats-Unis, les importations de
vêtements pour bébés de la Chine ont plus que triplé
en 2002.
Fort d'une population de plus d'un milliard d'habitants lui
permettant de bénéficier d'un réservoir de main d'oeuvre
illimité et de bas salaires, le pays a ainsi l'opportunité de
défier toutes les concurrences. La Chine est également le premier
employeur mondial avec 15 millions de travailleurs dans la filière
Par ailleurs, les entreprises qui s'approvisionnent en Chine
se heurtent à quelques imperfections. (graphique 1)
Celles-ci sont politiques : en effet, le pays
reste principalement marqué par la corruption, et les principaux pays
importateurs comptent mettre en place, pour pallier au mécanisme
irréversible de la fin des quotas, une sorte de riposte pouvant affecter
la croissance chinoise ;
Elles sont aussi techniques : les grandes zones
industrielles sont parfois sujettes à de lourdes pannes d'eau et
d'électricité, retardant ainsi les productions des usines ;
Ou encore sociales et salariales : malgré
les dizaines de millions de chinois en situation de sous-emploi, des
régions comme Shanghai ou le delta de la rivière Perle peinent
à trouver de nouveaux travailleurs notamment dans le secteur textile.
Cette difficulté est expliquée par la faiblesse des salaires
souvent payés avec des mois de retard, les conditions de travail
désastreuses, et l'amélioration toutefois légère
des revenus des paysans. Ceux-ci, au lieu de se transformer en ouvriers
d'usines à vêtements, continuent donc l'exploitation agricole des
terres. Ainsi il nous faut noter que la Chine se trouve à l'avant
dernier rang mondial concernant le salaire/horaire dans l'industrie de la
filature et du tissage. (graphique 2)
Le ministère chinois du Travail et de la
Sécurité Sociale pourrait donc finalement obliger les
sociétés chinoises à augmenter sensiblement les salaires
et améliorer les conditions de travail dans ces usines, de
manière à relancer l'affluence des travailleurs venus de la
campagne.
Néanmoins, ces augmentations seront de toute
évidence freinées, voire même inexistantes de par l'absence
de syndicats libres, aptes à revendiquer une hausse des salaires
significative.
Graphique 1 : les obstacles à
l'implantation des entreprises en Chine
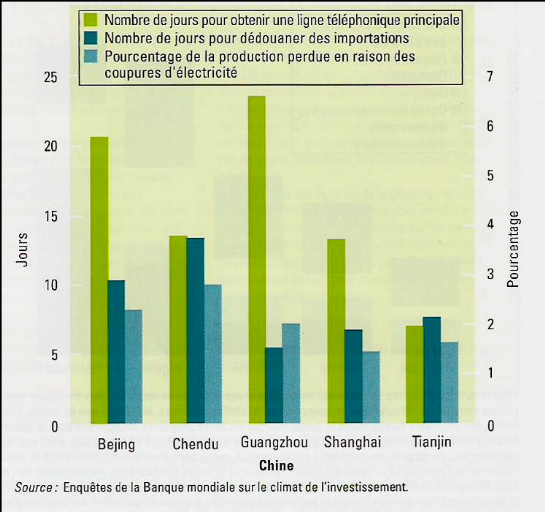
Graphique 2 : comparaison mondiale du coût du
travail dans l'industrie de la filature et du tissage (en dollars par
heure)
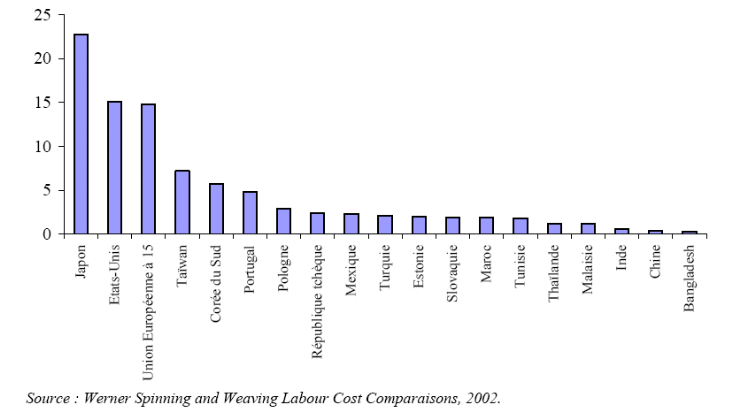
De toute évidence, la Chine apparaît comme
étant le « grand bénéficiaire » de
l'après 2005, et l'avantage compétitif du pays, découlant
principalement des violations des droits des travailleurs, est un moyen
évident de capter les investissements des grandes multinationales dans
le secteur textile-habillement.
En fait, et malgré ces quelques points faibles, les
grands acheteurs restent attirés par l'élément
décisif qu'est le prix dans le processus de production, ainsi que par
d'autres critères que la Chine maîtrise de mieux en mieux :
les délais de livraison, la qualité de production, les tarifs
douaniers, le taux de change, le niveau de la corruption, les infrastructures
de transport, l'état des communications et l`efficacité de
l'administration.
Il nous faut ajouter que la Chine se démarque surtout
par sa présence et sa diversité industrielle dans le secteur avec
une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production. Elle produit
elle-même la matière première et a ses propres ateliers de
confection : elle balaie ainsi l'ensemble de la chaîne de
production.
Elle a, de plus, su anticiper le démantèlement
de l'Accord Multifibres en augmentant sa capacité de production. Elle
dispose également d'ingénieurs performants et ainsi elle pourrait
presque rivaliser avec les pays développés qui « ont
été forcés » de se réfugier dans le haut
de gamme.
En fait, et de manière à maintenir des prix
attractifs et donc les plus bas possibles, les chinois ont recours à une
« stratégie d'intégration des industries du coton,
du textile et du vêtement ». En d'autres termes, les
exportateurs chinois ne consentent à importer qu'une très faible
partie des matières premières nécessaires à la
fabrication des vêtements.
Toutefois, la Chine n'aura pas attendu la levée des
quotas pour être performante dans la plupart de ces critères, et
les grands importateurs en sont conscients : ceux-ci sont loin
d'être avares de compliments lorsqu'il s'agit de la fiabilité de
leurs fournisseurs, de leur attitude
dite « pro-business », ou de leur grande
facilité à comprendre les attentes et les besoins du client.
Le récent développement du secteur textile,
à destination des marchés occidentaux (moins de 10 ans), permet
à ces fournisseurs de disposer d'usines équipées de
machines modernes. La Chine bénéficie également du
rayonnement financier mondial et des possibilités qui l'accompagne, de
certains centres d'affaires, comme Hong-Kong.
Enfin, de nombreuses critiques sont émises au regard
des aides apportées par le gouvernement chinois, dans le but d'optimiser
au maximum les exportations du pays. Celles-ci prennent par exemple la forme du
maintien intentionnel d'une monnaie sous-évaluée (cela facilite
les exportations), ou encore de prêts accordés par les Banques
d'Etat à quelques industriels, dont on sait d'avance qu'ils ne seront
jamais remboursés.
La Chine, et malgré les quotas qui ont longtemps
pénalisé ses exportations vers les marchés occidentaux,
reste donc et depuis plusieurs années, le premier producteur et
exportateur mondial de textile et d'habillement.
Ceci est en grande partie dû au fait que la Chine
possède certains atouts majeurs, autres que ceux déjà
cités précédemment, et que nous pouvons subdiviser en deux
catégories.
Ils sont d'abord internes : en effet, la masse critique
du pays et ses économies d'échelle ont permis la création
d'un véritable marché unifié, cela suppose en d'autres
termes, une réglementation relativement homogène ainsi que des
infrastructures de communication de part et d'autre du pays.
De plus, le paradoxe connu et vérifié dans un
grand nombre de parties du monde, du contraste entre l'élargissement des
échelles économiques (des firmes de plus en plus
mondialisées) et le rétrécissement des échelles
politiques (des pouvoirs locaux de plus en plus autonomes, des revendications
locales à l'indépendance et un intense mouvement de fragmentation
politique), n'a pas été constaté en Chine.
Le pays a su préserver les atouts de sa grande taille,
même si c'est au prix d'une puissante centralisation du pouvoir.
Enfin, la Chine est considérée comme un pays
unifié tant du point de vue de la langue que du point de vue
administratif : le Parti Communiste a joué un rôle clé
dans la mise en oeuvre de la réforme économique et même si
les règles administratives restent nombreuses, cela ne constitue en rien
un frein au développement. Selon les études de la Banque
Mondiale, « les obstacles au développement sont plutôt
moindres que dans les autres PED ».
Ces atouts sont aussi externes : la Chine appartient
à une région très dynamique du monde (l'Asie orientale et,
au-delà, le monde Pacifique). La diaspora chinoise a su en tirer parti.
En effet, au cours des quinze dernières années, les chinois de la
diaspora ont assuré 70% des Investissements Directs Etrangers en Chine.
Ainsi nous pouvons donner l'exemple de Macao et Hong-Kong, Taiwan
(première source des IDE en Chine), mais aussi celui des chinois de
Singapour, de Malaisie, ou des Etats-Unis. Ce sont ces populations qui
organisent les réseaux socio-économiques de cette vaste
région.
| 

