|

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DEPARTEMENT DE LETTRES MODERNES
Mémoire de DEA
(Littérature Comparée)
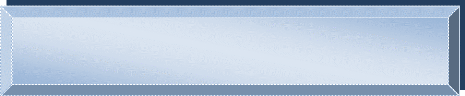
Du déclin du mythe impérial à
l'affirmation de l'identité noire : Au Coeur
des
ténèbres (1902) de Joseph Conrad, Batouala (1921)
de René Maran et
Cahier d'un retour au pays natal (1939)
d'Aimé Césaire.
Présenté Par : Sous la direction
de :
M.Amadou Hamé Niang M.Amadou Falilou
Ndiaye
Professeur titulaire
Année
académique
2007-2008
REMERCIEMENTS
Nous tenons, tout d'abord, à adresser nos plus profonds
et sincères
remerciements à notre directeur de recherche
Mr Amadou Falilou Ndiaye, qui a
dirigé ce travail, pour
tous ses conseils et ses encouragements avisés ainsi que
pour ses
travaux de recherche qui nous furent d'une aide précieuse. On
lui
exprime notre gratitude pour nous avoir guidés dans ce travail,
ménageant son
temps, son savoir, sa patience pour que ce travail
arrive à son terme.
Nos remerciements sont aussi adressés à nos
professeurs Mr Bakary Sarr,
Mr Alain Juillard, Mr
Souleymane Faye, Mr Ousmane Dia, Mr Pape Mody
Niang,
Mme Sarré, Mr Modou Ndiaye et Mr
Diarra.
Nous tenons à remercier également le chef du
département des Lettres Modernes
Mr Ibra Diene.
Un grand merci à Fatou Konaté et à
Augustin Coly qui nous ont assistés,
conseillés, soutenus tout
au long de ce travail.
Merci à vous tous.
DEDICACE
A notre père auquel nous tenons la force, la
ténacité et qui a tout sacrifié pour notre
éducation.
A notre mère cet ange de tendresse, de patience et de
générosité, dont la voix
résonne encore dans nos
oreilles pour nous
réveiller à l'aube et veiller ainsi au bon
déroulement de nos études.
A la mémoire de notre défunt grand-père
Mamadou Abdoulaye Niang, de nos
amis Aly Fall et Awa Yombé, de notre
oncle Mamadou Yaya Lo.
Ma reconnaissance est grande vis-à-vis de mon
frère Mamadou qui, en dépit de
la lourde charge familiale,
tient à me mettre dans les meilleures conditions pour
mon
épanouissement intellectuel.
A ma famille : Mamadou, Kadia, Woury, Racky Diop, Mohamed,
Boubou,
Abou, Dieynaba, Kadia Pam, Néné Lo, Racky Mama,
Néné Hawa, Kadia
Samba, Oumouyel, Malick, Ousmane, mes trois
homonymes, ma fiancée
Meissa.
A mes amis de toujours Chérif Guèye, Korguel
Niang, Mohamadou Diop, Abou
Guèye.
A mes camarades de promotion.
A tous nos amis.
SOMMAIRE
Remerciements Dédicace
Sommaire
Plan détaillé de la thèse 1
Glossaire 3
Introduction ..4
Plan raisonné 8
Partie rédigée : « Chap.III : Manifestations
de la décadence du mythe » ..12
Bibliographie commentée 25
- Commentaire d'un ouvrage ..26
· Homi K Bhabha, Les lieux de la culture. Une
théorie postcoloniale
(2007) 27
- Commentaire d'un article .31
· Jacques Chevrier, « Les romans coloniaux : enfer ou
paradis ? » .32
Bibliographie générale 37
PLAN DETAILLE DE LA
THESE
INTRODUCTION GENERALE
Première partie : Mythe de
l'Afrique et de l'Africain Chapitre I :
Imaginaire exotique du cadre naturel
I.1 : L'Ailleurs comme subversion du décor
littéraire traditionnel
I.2 : Evolution du mythe vers une altérité
géographique
Chapitre II : D'autres hommes :
perception mythique de la différence
II.1 : Opposition Sauvage et Civilisé
II.2 : Permanence du mythe de l'indigène
Deuxième partie :
Déclin du mythe impérial
Chapitre III : Manifestations de la
décadence du mythe
III.1 : Expression du malaise impérial
III.2 : Emergence d'un contre discours colonial
Chapitre IV : Formes de résistance
à l'Empire
IV.1 : Nature hostile
IV.2 : Indigènes insoumis
Troisième partie :
Identité et esthétique négro-africaine
Chapitre V : Revendication de la différence
V. 1 : Négritude : conquête d'une identité
V.2 : De l'expérience impériale à
l'attitude du Noir face à l'avenir
Chapitre VI : Processus de contestation
de la domination européenne
VI.1 : Modes d'expression du discours négro-africain
VI.2 : Rhétorique pour une civilisation de l'universel
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
GLOSSAIRE
Nous utiliserons les abréviations suivantes tout au cours
de cette étude :
Cahier : Cahier d'un retour au pays
natal C .t. : Au Coeur des
ténèbres
Batouala : Batouala
INTRODUCTION
L'expansion de l'impérialisme occidental est
accompagnée de la volonté de mythifier les terres et les hommes
que l'Europe soumettait à sa domination. Il fallait justifier les
conquêtes puis la colonisation. Aussi l'Afrique et les Africains sont-ils
vus à travers des prismes enchanteurs. La « vacuité »
et la « sauvagerie » sont les ténèbres dont l'Occident
se voit investi de la « mission » de civiliser.
Le mythe est érigé en doctrine dans les textes
littéraires, les travaux anthropologiques et ethnologiques encourageant
la volonté impérialiste. Dans son livre Le Nègre
romantique (1961), Léon-François Hoffman remonte
jusqu'à la Chanson de Roland, pour passer en revue les images
successives que les écrivains français se sont formés du
Nègre. Dans cette présente étude, notre champ d'analyse
étudiera le mythe de l'Afrique et de l'Africain dans la période
comprise entre la seconde moitié du XIXe siècle et l'aube du XXe
siècle. Cette période coïncide aussi bien avec
l'apogée du mythe impérial que l'apparition des premiers signes
de son déclin. Elle se caractérise par une curiosité
grandissante des « terrae incognitae ». En France ainsi qu'en
Angleterre, la conscience collective de l'époque est fortement
influencée par les textes évoquant la grandeur de l'Empire, avec
la mission impérative d'apporter ailleurs la Civilisation. Les
récits exotiques, en particulier Le roman d'un spahi (1881) de
Pierre Loti et de Kim (1901) de Rudyard Kipling cristallisèrent
le mythe de « l'homme blanc supérieur ». Ainsi, on retrouve
dans la masse textuelle, allant des revues et aux périodiques de tous
genres, la volonté de percer le mystère des espaces inconnus et
la mentalité des populations indigènes. L'interprétation
de la culture de l'Autre s'effectue à travers des
stéréotypes et clichés racistes. Par ailleurs,
l'imagination narrative établit une dualité manichéenne
entre l' « ici » et l' « ailleurs », chargeant le
récit de métaphores et de symboles dégradants. Il
s'agissait de présenter l'Autre, appelé aussi « sauvage
» avec des attributs démoniaques, l'Ailleurs, comme une terre de
désolation, marquée par la malédiction. Ces discours
justifiaient et légitimaient la colonisation.
Mais au tournant du siècle, des voix
s'élèvent pour dénoncer les conditions
déshumanisantes dans lesquelles sont réduites les populations
indigènes. Notre analyse partira des études postcoloniales pour
voir que malgré l'apologie de la grandeur impériale, s'insinuent
en filigrane dans les récits des doutes bouleversant la stabilité
de l'Empire. Dans Culture et Impérialisme (1993), Edward Said
s'appuie sur la critique littéraire pour revenir sur les
interprétations erronées de la représentation du monde non
occidental, évoquées déjà en 1978 dans
L'Orientalisme. L'Orient crée par l'Occident. Il montre comment
apparaît implicitement l'esthétique de la résistance
à l'empire chez des auteurs tels Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Albert
Camus, Giuseppe Verdi, Charles Dickens. Homi Bhabha prolonge cette
pensée dans Les lieux de la culture. Une théorie
postcoloniale (1994). Mais ce sont les travaux de Frantz Fanon, Albert
Memmi, Patrick Chamoiseau, Aimé Césaire qui vont tenter de
redécouvrir et de se réapproprier le passé des
indigènes que l'autorité coloniale a toujours nié. Quant
à Homi Bhabha, il invite même à dépasser
l'ordonnancement du monde, construit sur l'opposition binaire entre « eux
», les Autres, et « nous », les Européens. Le
caractère éminemment conflictuel de ces notions sera
exploré par Bernard Mouralis dans Les
contre-littératures (1975) où il montre que
l'avènement du texte négro-africain change la conception de la
différence.
C'est dans ce contexte dense de la critique postcoloniale que
nous allons soumettre l'étude des textes de notre corpus : Au Coeur
des ténèbres (1902) de Joseph Conrad, Batouala
(1921) de René Maran et Cahier d'un retour au pays natal (1939)
d'Aimé Césaire.
Ces trois textes illustrent chacun une période
donnée de l'histoire du malaise dans la relation entre colonisateurs et
colonisés. L'Afrique qui se profile dans la nouvelle de Conrad est un
lieu mythique, à la fois distant et vaguement familier. Pour Maran, le
mythe de l'Afrique « sauvage » et particulièrement de
l'indigène « irréfléchi » relève du
stéréotype déstabilisateur. Aimé Césaire,
dans son poème, va au-delà du doute conradien, de
l'inhumanité supposée des Noirs et de
la dénonciation des abus coloniaux chez Maran. Il
préconise un homme noir débarrassé de ses complexes pour
revendiquer son identité culturelle.
Ce schéma n'est pas exhaustif des nombreuses questions
que soulève notre sujet. Les contextes de production et de
réception expliquent la complexité de la problématique.
Quels sont les traits caractéristiques du mythe de
l'Afrique et de l'Africain dans le discours littéraire ? Comment la
relation du texte à l'environnement socioculturel peut-elle engendrer le
mythe et son déclin ? Sur quoi repose l'existence de la
différence ? Quelles sont les modalités de construction et de
représentation de l'identité ?
Nous nous intéresserons à la manière dont
les textes de notre corpus s'ouvrent sur « leurs différences
par rapport aux assertions du centre impérial »1.
Il est probable que l'expérience des écrivains ait déteint
sur leurs récits. Pour autant qu'ils ne restituent qu'une vision
généralisée de leur époque, le mythe de l'Autre ne
parait-il donc pas, avant tout, lié à la subjectivité et
à la position de l'observateur ? Dans Mythologies (1957),
Roland Barthes note que « l'astuce profonde de l'opération
-Bichon, c'est de donner à voir le monde nègre par les yeux de
l'enfant blanc : tout y a évidemment l'apparence d'un guignol
»2. De même, dans Mimésis. La
représentation de la réalité dans la littérature
occidentale (1969), Auerbach s'interroge sur l'ambivalence entre
l'imitation fictionnelle du réel et l'écart signifiant par
rapport à ce réel.
Dans la première partie de cette étude, nous
étudierons le mythe de l'Afrique et de l'Africain. La deuxième
partie sera une réflexion sur le déclin du mythe impérial
et la troisième partie sera consacrée à l'analyse de
l'identité et de l'esthétique négro-africaine.
1 B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, The
Empire Writes back. Theory and Practice in Post-colonial Literatures,
Londres, Routledge, 1989, p.3, Cité par J-.M. Moura,
Littératures francophones et théorie postcoloniale,
Paris, PUF, 1995, p.5.
2 Roland Barthes, Mythologies suivi de Le Mythe,
aujourd'hui (1957) in OEuvres complètes Tome I 1942-1965,
Editions établie et présentée par Eric Marty, Paris,
Seuil, 1993.
| 


