LES FLUX DE TRANSPORTS
DANS L'OUEST LYONNAIS
(EXAMEN DE LA SITUATION ANTERIEURE
A LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A89
DE BALBIGNY A LYON)
Sous la direction de S. Héritier

14vant de commencer ('étude des f(ux de transports dans
('ouest (yonnais, je sou/laiterais remercier toutes (es personnes qui m 'ont
aidé a mener a 6ien ce projet.
iMes premiers remerciements vont a mon directeur de
mémoire, iMonsieur Stép/lane .7-féritier, qui a toujours
su se rendre disponi6(e pour me prodiguer de nom6reux et précieux
consei(s.
Je tiens aussi a remercier iMonsieur Jean )ar(et, directeur de
('O6servatoire de ('1489, qui m'afourni gratuitement de mu(tip(es documents et
ouvrages et qui a organisé, en Juin 2007, un rassem6(ement des
c/lerc/leurs de ('O6servatoire de ('1489, ric/le d'enseignements.
(Durant mes rec/lerc/les, des organismes m'ont ouvert (eurs
portes. I( s'agit des (Divisions (Départementa(es et de (a (Division
cRégiona(e de ('cEquipement, du Consei( cRégiona( de
cR/lône-14(pes et de (a Communauté de Communes de cBa(6igny. Sans
eux, je n 'aurais pu conduire convena6(ement mon étude.
cEnfin, je voudrais adresser mes derniers remerciements a toute
ma fami((e, surtout Sandra, qui m 'a soutenu tout au (ong de ('avancée
de mon étude.
Pt~ffL4 ~~~t4%~L+
INTRODUCTION
Ce mémoire de Master 1 réalisé à
l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne a pour objet les flux de
transports dans l'ouest lyonnais avant la construction de l'autoroute A89 de
Balbigny à Lyon. L'autoroute A89 est une liaison transversale qui
reliera à terme Bordeaux à Lyon. L'étude qui suit ne prend
pas une si petite échelle. Il convient de définir notre secteur
d'étude. Lorsque nous parlons d'ouest lyonnais, nous ne parlons pas de
tout ce qui se trouve à l'ouest de Lyon. Les limites de notre
étude sont constituées par un triangle Roanne - Saint-Etienne -
Lyon. Certes, nous serons amenés à évoquer les
échanges avec le « Grand-Ouest lyonnais » : Massif Central
(Clermont-Ferrand), voire Bordeaux, mais la majeure partie de la
réflexion s'intéresse au triangle Roanne - Saint-Etienne - Lyon.
A l'intérieur de ce triangle, nous observerons tout
particulièrement les territoires directement concernés par la
mise en place future de l'A89. Il existe un Schéma de Cohérence
Territoriale de l'ouest lyonnais mais il ne s'étend pas plus loin que le
département du Rhône. Se caler sur ses limites ne permettait pas
de prendre en compte tous les flux en provenance de l'ouest en direction de
Lyon ou de l'Est. De plus, il a semblé intéressant de se projeter
de temps à autres hors de la zone d'étude à l'Est afin de
d'établir une comparaison. La carte ci-dessous présente la zone
d'étude.
Figure 1 : Localisation de la zone
d'étude
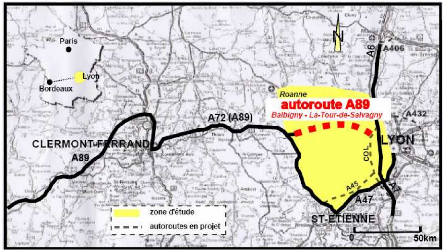
Source : Dossier d'enquête. Réalisation :
Pailler.S (2007)
La démarche retenue pour cette étude est
une démarche empirique. Elle consiste à
recueillir dans un
premier de temps des données qui seront ensuite exploitées et
mises en
comparaison avec des propos théoriques. Ainsi,
l'étude de terrain est privilégiée pour
permettre de faire une analyse spatiale. Les données de
comptages routiers ont été récoltées auprès
des Divisions Départementales de l'Equipement du Rhône et de la
Loire (DDE 69 et 42) ainsi qu'auprès de la Division Régionale de
l'Equipement de Rhône-Alpes. La DRE a élaboré le Dossier
d'enquête préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique en 2001. Ce document était une
référence tout au long de l'étude. Les informations
concernant le transport ferroviaire ont été fournies par le
Conseil Régional de Rhône-Alpes qui a la charge du transport
ferroviaire de voyageurs. Les informations thématiques, telles que
l'accessibilité, les motifs de déplacements, les coûts de
déplacements... ont été recueillies auprès de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne et du Syndicat mixte des
Transports de l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL). Les recherches ne
furent toutefois pas aisées pour principalement deux raisons. La
première est que la zone d'étude choisie ne correspond pas
strictement à des limites administratives et chevauche deux
départements. Chaque département réalise les études
qui le concernent. Ces études ne concordent pas forcément avec
celles réalisées par le département voisin (elles n'ont
pas le même thème, la même échelle, n'ont pas
été effectuées à la même date...). De plus,
les études mises à disposition par la région
Rhône-Alpes sont élaborées à une échelle trop
petite, et donc pas assez précise pour étudier l'ouest lyonnais.
L'étude proposée ici essaie de coordonner les diverses
informations récoltées pour construire une réflexion
cohérente à l'échelle du territoire concerné. La
seconde raison était le refus d'Autoroutes du Sud de la France (ASF) de
permettre l'accès à des comptages récents de trafic pour
des raisons de confidentialité liées à la stratégie
d'entreprise. De novembre à février, outre le temps
consacré à la lecture de nombreux ouvrages, les recherches de
données se sont perdues dans une recherche de chiffres récents.
Ainsi, pendant ces 4 mois, les recherches n'ont guère avancé. Ce
fut une des plus grosses erreurs dans la méthodologie car la quête
de données récentes a constitué l'unique recherche durant
cette période et n'a pas favorisé l'accès à
d'autres documents. Finalement, la mise en ligne d'informations sur les sites
des DDE et la rencontre des bonnes personnes ont permis d'avoir accès
à ces comptages. C'est à partir de là que la
découverte de nombreuses autres sources a débuté et que le
mémoire a pris forme.
La pratique du traitement de texte, la gestion des
données, l'élaboration de graphiques ne furent pas des
contraintes à la construction du mémoire. En revanche, la
réalisation de cartes s'est avérée plus difficile. Les
logiciels de cartographie n'étant pas connus, il fut nécessaire
de les découvrir et d'en apprendre les rudiments. Le principal outil
utilisé pour la réalisation de carte est Adobe Illustrator.
Les difficultés rencontrées pour l'usage des logiciels de
cartographie est la cause de la qualité graphique moyenne
des cartes réalisées malgré les nombreuses heures
passées à l'appréhension du logiciel.
Une réflexion sur les flux de transports
nécessite l'utilisation de concepts qu'il convient au préalable
de définir. Ces définitions sont extraites de différents
ouvrages. Elles permettent de cadrer épistémologiquement la
recherche et de ne pas confondre les termes employés. Parmi les concepts
abordés, les concepts de circulation, de flux et de mobilités
sont les plus importants. La définition du transport doit elle aussi
être clarifiée. Les définitions permettent de faire un tour
d'horizon des travaux sur les transports réalisés ces
dernières années.
Le terme de flux désigne une circulation entre lieux
sur une infrastructure. Il consiste en un déplacement qui à une
origine, une destination et un trajet. Il faut distinguer les flux en un point
et les flux entre deux points. En matière de trafic routier, un comptage
indique le nombre de véhicules par heure alors qu'une enquête
« origine-destination » permet de connaître les
déplacements entre deux zones, soit sur une voie donnée, soit
sans précision d'itinéraire. Törsten Hägerstrand (l'un
des pionniers de « la nouvelle géographie »), dans les
années cinquante/soixante, développant la Time Geography
(la seule focalisation sur l'espace n'est pas suffisante, les
phénomènes sociaux possèdent aussi une dimension
temporelle), met les flux au coeur de l'ambition géographique. Il
démontre que les individus sont pris dans des flux, des
interrelations... qui dépassent largement l'échelle locale. Les
flux entre deux zones sont fonction de leur « masse » respective
(population, commerces, emplois...) et fonction inverse de la distance qui les
sépare. Aujourd'hui, l'observation des déplacements sert à
penser le passage de la ville à l'urbain, les trajets domicile-travail
participant d'ailleurs directement en France à la construction
statistique des aires urbaines par l'INSEE. Les flux supposent des tuyaux de
toute sorte, dont les caractéristiques technico-économiques
pèsent lourd en termes d'enjeux territoriaux et politiques. Elaborer une
géo-socio-économie-politique des flux et des réseaux sur
lesquels ils circulent constitue d'ailleurs un objet scientifique de
première importance. La revue Flux, Cahiers scientifiques internationaux
Réseaux et Territoires créée par le CNRS se consacre
à cet objet (Lévy et Lussault, 2003, pp 367-3 68). Cette
revue est dirigé par Jean-Marc Offner qui a rédigé en 1993
un article dans la revue L'Espace Géographique :
« Les « effets structurants » du transport
: mythe politique, mystification scientifique » dans lequel il critique
l'absence conceptuelle en matière d'effet des transports, absence qui
conduit à considérer comme « mécaniques », et
donc prévisibles les effets d'un axe de transport. Auparavant, Plassard
évoquait cette idée en 1977 dans un
livre de référence qui a fait date : Les
autoroutes et le développement économique régional,
dans lequel il affirme que « la vision simpliste de
mécanismes de cause à effets ne peut être
conservée... la notion de potentialité semble être une des
voies efficaces qui permette ce changement de conception ». Ainsi,
lorsque notre étude abordera les effets prévus et/ou
espérés, nous préférerons le conditionnel et des
verbes exprimant la possibilité à un futur trop
déterministe.
La circulation est un principe de fonctionnement de tout
système car elle permet les échanges et les transferts sans
lesquels aucune interaction ni aucun dynamique ne seraient possibles. Par le
biais des distances, des temps de déplacements et des coûts de
transport, la circulation est un des facteurs essentiels pris en compte dans
l'élaboration de tous les modèles d'organisation de l'espace.
Elle est aussi productrice d'espace par les infrastructures qu'elle
nécessite et, parce qu'elle participe à la hiérarchisation
des lieux qu'elle relie, elle joue un rôle clé dans les
différenciations spatiales. Les espaces mis en liaison
génèrent des flux ou sont des relais du circuit (Lévy
et Lussault, 2003, pp 158-159).
La mobilité est l'ensemble des manifestations
liées au mouvement des hommes et des objets dans l'espace. C'est un
concept englobant dont il convient de décliner toutes les notions qui en
découlent (déplacement, transport, migration...) et qui sont
souvent confondues avec lui. Les groupes humains sont confrontés
à la maîtrise de la distance par la mobilité. Celle-ci ne
se limite pas au déplacement physique effectif et ses techniques (le
transport), mais embrasse les idéologies et les technologies du
mouvement en cours dans une société. Elle rassemble donc à
la fois un ensemble de valeurs sociales, une série de conditions
géographiques, économiques et sociales, un dispositif technique.
Les coûts (économiques, sociaux et temporels) de la
mobilité ont tendance à s'alourdir car la mobilité
augmente (Lévy et Lussault, 2003, pp 622 - 624). La
mobilité peut être déclinée en deux types : la
migration (changement définitif du lieu de résidence) et
circulation (changement temporaire de lieu) (Zelinsky, 1971, pp 219-249).
La migration implique donc un abandon de longue durée du lieu de
départ. Il conviendrait alors de préférer l'expression de
mouvement pendulaire à l'expression « migrations pendulaires
». Toutefois, la substitution d'une migration résidentielle par une
circulation domicile-travail remet en cause cette opposition
migration-circulation. Il est préférable de s'intéresser
à la visée de la mobilité : déplacements
touristiques, voyages d'affaires, migration résidentielle, circulation
pendulaire, shopping...
Les transports sont les dispositifs, modes et moyens,
permettant l'acheminement de personnes ou de biens matériels d'un lieu
vers un autre. Par extension, ensemble des moyens de la mobilité. Les
transports sont un outil dont disposent les sociétés pour
produire et gérer
leur espace, c'est-à-dire organiser la mise à
disposition des lieux les uns des autres. Ils permettent le franchissement
physique de la distance qui sépare les lieux. Les différents
modes de transports (routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien...)
sont choisis et sélectionnés par les individus non seulement pour
leurs qualités pratiques en terme de déplacement, mais aussi pour
ce qu'ils autorisent et ce qu'ils représentent. Les transports routiers
ne peuvent se passer de réseaux d'infrastructures dont les coûts
de construction et d'entretien sont supportés par la collectivité
(par les impôts si l'autoroute est gérée par l'Etat et par
un droit de péage si celle-ci est concédée à une
société privée). Les transports sont inscrits dans le
territoire, dont leurs réseaux en constituent l'armature. Les
réseaux de transports reflètent, entretiennent et amplifient les
anisotropies (lignes de force) du territoire. Ainsi, ils contribuent à
ses changements et imposent son aménagement. La vitesse des transports
définit un certain nombre d'échelles pertinentes pour
l'organisation du territoire, le nombre de ces échelles augmente avec la
création de modes de transports aux vitesses différentes.
L'intermodalité, est la mise en correspondance de plusieurs modes de
transports, elle combine donc plusieurs vitesses et échelles lors d'un
déplacement. L'intermodalité tend à se développer
car les déplacements font de plus à plus appel à divers
modes de transports. Le territoire s'en trouve recomposé à deux
niveaux : par l'inégal accès aux réseaux de transport et
par la mise en place d'un système qui brise la continuité
territoriale. Les réseaux de transports inversent l'ordre des
proximités. Ainsi, la connexion des grandes villes saute les espaces
intermédiaires, qui ne disposent alors d'aucun point d'accès
à un réseau dont l'échelle de référence les
dépasse. Il s'agit de « l'effet tunnel ». L'infrastructure
constitue alors une barrière pour les espaces intermédiaires qui
se voient infliger les nuisances de l'infrastructure. La création d'une
infrastructure à petite échelle peut alors se voir
confrontée à un refus de la part des habitants de l'espace
traversé. Ceux-ci perçoivent l'intérêt de la mise en
place de l'axe de transport mais ne souhaite pas le voir passer chez eux ou
à proximité. Il s'agit de l'effet NIMBY (not in my backyard)
(Lévy et Lussault, 2003, pp 93 7-938).
Une citation d'Emile Mérenne résume les
éléments que nous venons d'évoquer : « Les
déplacements de personnes, de biens, d 'informations... à travers
l 'espace caractérisent la circulation (ensemble des
déplacements), dont l 'intensité dans le temps et dans l 'espace
détermine le trafic (importance et fréquence de la circulation)
et les flux (déplacements massifs de personnes, de biens ou
d'informations). Ces déplacements font appel à des moyens
techniques ou moyens de transports (ensemble des techniques utilisées
pour effectuer les déplacements) qui s 'inscrivent dans les territoires
grâce aux voies de communication
(installations permettant la circulation des personnes et
des biens), à savoir la route, la voie d'eau, le rail, les conduites...
» (Mérenne, 2003).
Pour aller plus loin, Philippe Pinchemel précise que
les flux sont les éléments qui servent de base à
l'activité humaine : « Toute la vie humaine peut se lire
à travers les flux. Ils relient les hommes entre eux ou les hommes aux
lieux. Avant, les flux dans les régions concernaient uniquement de
faibles quantités de produits et d'hommes. Très rapidement, les
espaces régionaux, nationaux sont entrés dans un réseau
dense d'échanges intégrés au commerce mondial. Les voies
et modes de transports associés sont la réponse au
problème de la maîtrise de la distance. Avant la voie, l 'espace
est isotrope. Avec la voie, la dualité
proximitééloignement constatée pour le pôle joue
tout au long du tracé, créant une anisotropie spatiale forte
» (Pinchemel, 1997, p.97).
La littérature géographique fourmille donc
d'ouvrages abordant les flux de transports. Les études
réalisées par les observatoires autoroutiers enrichissent cette
littérature par leurs exemples concrets. Jusqu'à présent,
l 'Observatoire de l 'A89, dirigé par Jean Varlet, ne s'est pas
penché très précisément sur les flux de transports
dans l'ouest lyonnais. Ce mémoire constituera une des ressources
disponibles à l'étude des effets de l'A89 après sa mise en
place dans l'ouest lyonnais. En effet, lors d'une étude future de
l'organisation des flux de transports, et plus généralement, de
l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais avec l'A89, il s'avèrera
très utile de pouvoir établir une comparaison avec l'état
de l'ouest lyonnais avant la mise en service de l'autoroute.
La section que nous nous proposons d'étudier correspond
au dernier tronçon de l'autoroute A89, le tronçon permettant
d'achever la liaison autoroutière directe entre Lyon et Bordeaux.
L'ouest lyonnais est un espace soumis en grande partie à l'influence de
l'agglomération lyonnaise qui joue son rôle de métropole
régionale. Cette influence s'exprime notamment par de nombreux
échanges entre l'ouest lyonnais et son agglomération, elle est le
facteur principal de mobilité. La mobilité dans l'ouest lyonnais
se traduit pas des flux que l'on peut localiser et quantifier. Quel est
l'intérêt de connaître les flux qui circulent sur des axes,
sur des réseaux ? Y'a-t-il un lien entre les flux et les organisations
de l'espace ? L'organisation spatiale crée-t-elle les réseaux ?
Les réseaux créent-ils l'organisation spatiale ? Quelle est
l'influence d'une agglomération de la taille de l'agglomération
lyonnaise sur les mobilités au sein de sa périphérie ?
Quels peuvent être les modifications, les améliorations,
les perturbations de l'organisation spatiale de l'ouest
lyonnais engendrées par la mise en service de l'autoroute A89 ?
Pour tenter d'apporter des réponses à ces
questions, nous établirons un diagnostic des problèmes dont
souffre l'ouest lyonnais et observerons les enjeux liés à l'A89.
Une fois ce portrait de l'ouest lyonnais dressé, nous analyserons les
caractéristiques des flux de transports, qu'ils soient routiers ou
ferroviaires, ainsi que les motifs qui sont à la base des
déplacements. Enfin, nous discuterons des effets attendus de l'A89 dans
l'ouest lyonnais.
-1-
PRESENTATION
DE L'OUEST LYONNAIS
ET DES ENJEUX DE L'A89
|
L'étude géographique des flux de transports dans
l'ouest lyonnais se doit de considérer les transports comme faisant
partie intégrante d'un espace, d'un système géographique.
On ne peut extraire les flux de transports de l'espace dans lequel ils
s'exercent, avec lequel ils entretiennent des interactions. Une étude
purement sectorielle des transports n'en présente pas les enjeux
géographiques. Il est donc nécessaire de dresser un portrait
géographique de l'ouest lyonnais. Le dossier d'enquête publique
contient une présentation très précise de l'ouest
lyonnais. Parmi les éléments suivants, certains en sont extraits
pour comprendre les liens entre les réseaux de transport et leur milieu,
pour comprendre l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais. Lorsque la source
n'est pas indiquée, les données proviennent de ce document.
L'ouest lyonnais est un espace qui ne favorise pas les
déplacements, dont le dynamisme est faible. Ce territoire sera, d'ici
2012, traversé par le dernier tronçon de l'autoroute A89 dont les
caractéristiques seront observées.
I- L'ouest lyonnais, un espace qui ne favorise pas
les déplacements
L'étude des réseaux de transports ne peut se
faire sans avoir au préalable étudié le milieu physique
dans lequel ils s'inscrivent. En effet, celui-ci joue un rôle fondamental
dans le réseau actuel et a eu une forte influence sur le tracé de
la future autoroute.
1- Une topographie hostile aux infrastructures de
transport
La partie occidentale du tracé s'inscrit dans le relief
très prononcé des Monts du Tararois dont l'altitude
dépasse par endroits 900m, ce qui en fait un relief de moyenne montagne.
Au niveau météorologique, les précipitations sont
importantes et on observe une forte amplitude thermique entre
l'été et l'hiver. A partir de 500m, les risques de brouillard et
de givre sont très fréquents. De plus, Tarare compte en moyenne
89 jours de gelée par an. Pour se rendre compte des contraintes
climatiques de Tarare, on peut comparer le nombre de jours de gelée
à celui de villes alpines. Durant la période 1992-2002 (qui
correspond plus ou moins à la période de référence
du dossier d'enquête), Albertville comptait près de 65 jours de
gelées par an alors qu'il gelait 95 jours par an
à Bourg-Saint-Maurice. La station météo d'Albertville est
située à 335m alors que celle de Bourg-Saint-Maurice est à
près de 800m (Climathèque Météo-France,
2007). Les températures hivernales de Tarare s 'apparentent donc
à celles des villes moyennes des Alpes. La neige vient s'ajouter
à ces contraintes puisque son épaisseur est souvent
supérieure à 20 cm. Toutes ces conditions ne favorisent pas la
circulation routière, notamment sur la RN7, qui relie Roanne à
Lyon, à proximité de Tarare. Le projet de l'A89 a
été étudié en fonction de ces contraintes afin de
sécuriser au maximum le tronçon. Le relief, par exemple, a
contraint l'aménagement d'un tunnel long de 4 km pour franchir une
partie des Monts du Tararois. La présence de nombreux cours d'eau
nécessite la réalisation de viaducs. A l'Est, la topographie est
moins contraignante malgré l'écoulement de quelques cours d'eau.
Les transports engendrent une pollution qui nuit à la qualité des
cours d'eau, des études sur l'eau ont été
réalisées pour connaître les impacts environnementaux de
l'A89 sur le réseau hydrographique. Les contraintes topographiques de
l'ouest lyonnais sont un frein aux déplacements, aux mobilités.
La figure 2 présente ces contraintes.
Figure 2 : Les contraintes liées à la
topographie
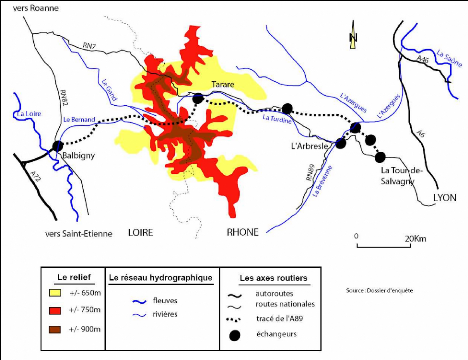
2- Les transports doivent s'adapter à la
diversité des territoires
Le territoire traversé par l'autoroute A89 n'est pas
homogène. Le long du tracé alternent des zones de plaine, de
montagne et de vallée ; des espaces agricoles et des zones industriels ;
des communes enclavées et d'autres soumises à l'influence de
pôles. Le long du tracé de la future A89, l'espace est
structuré par deux pôles : Tarare et l'Arbresle, le long de la
vallée de la Turdine. La figure ci-dessous présente une typologie
des communes traversées.
Figure 3 : Typologie des communes traversées
par le futur segment de l'A89
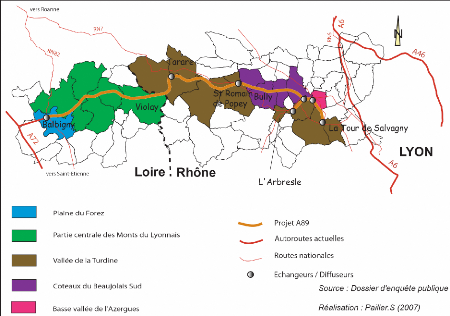
La plaine du Forez est le lieu de passage de nombreuses voies
de communications (RN82, A72, voie ferrée Roanne - Saint-Etienne) et est
traversée par la Loire. Elle est un enjeu stratégique pour le
département de la Loire et la région Rhône-Alpes car elle
dispose de grandes étendues vierges d'activités sur des surfaces
planes. Balbigny se trouve à la limite des zones d'influences de Roanne
et de Saint-Etienne et dispose de surfaces disponibles pouvant accueillir une
grande zone d'activité dont le projet est lié à l'annonce
de l'échangeur de Balbigny.
La partie centrale des Monts du Lyonnais accueille les Monts
du Tararois. Ils sont une véritable coupure entre les vallées du
Rhône et de la Saône et la plaine du Forez. L'usage du sol est
essentiellement agricole, orienté vers l'élevage.
La vallée de la Turdine constitue un axe de passage
dans lequel est aménagée la liaison routière entre Roanne
et Lyon (la RN7). On distingue deux pôles (Tarare en amont et l'Arbresle
en aval) qui ont une carte importante à jouer avec l'arrivée de
l'A89. Cet espace ne constitue pas une entité géographique
continue car il est découpé en son centre par les coteaux du
Beaujolais Sud. Toutefois, toutes les communes qu'elle traverse ont le
même passé industriel. Il s'agit des communes les plus dynamiques.
Ce sont ces communes qui se sont vues attribuer la présence d'un
échangeur.
Les coteaux du Beaujolais sont dominés par
l'activité vinicole. L'urbanisation est limitée et la population
est fortement attachée à son cadre de vie rural, ce qui nuit
à la création d'un axe autoroutier.
Enfin, la basse vallée de l'Azergues, qui constitue un
lieu de passage, est animée par des activités industrielles et
commerciales. Sa situation géographique, à la confluence des
vallées de l'Azergues et la Brévenne, son ouverture vers la haute
vallée de l'Azergues et la vallée de la Saône et ses
activités économiques en font un espace privilégié
pour les échanges.
La diversité des espaces offre des potentiels
variés. Si l'on considère que la différenciation spatiale
fonde la variété des lieux qui est à la source de
l'échange et du déplacement on comprend l'un des facteurs des
déplacements dans l'ouest lyonnais. (Lévy, Lussault, 2003,
p.624). Les potentialités de chaque territoire de l'ouest lyonnais
créent des déplacements car les habitants souhaitent
accéder aux ressources des autres territoires.
L'hétérogénéité des espaces crée
ainsi des déplacements.
Les vallées sont les espaces qui sont les plus
dynamiques, notamment grâce à l'industrie. C'est dans ces
vallées que se trouveront implantés les échangeurs de
l'A89. Actuellement, la fluidité des déplacements est liée
aux caractéristiques géoéconomiques des communes
traversées. Il est plus difficile de circuler sur la RN7 au coeur de
Tarare que sur les Coteaux du Beaujolais. Les activités
économiques engendrent et attirent des flux qui augmentent le nombre des
déplacements. A l'inverse, l'absence de zones industrielle et le faible
nombre de commerce sur les Coteaux du Beaujolais ne provoquent pas de
ralentissement lors de la traversée des villages. La circulation des
flux (nombre et fluidité) dépend des caractéristiques
socio-économiques des espaces traversés.
II- Le faible dynamisme de l'ouest lyonnais
1- Une croissance démographique en perte de
vitesse
1.1 : Hiérarchie urbaine de l'ouest lyonnais
L'agglomération du Grand-Lyon concentre la
majorité de la population de la zone d'étude. Elle regroupe
à elle seule plus d'un million d'habitants. Les autres grandes
agglomérations de l'ouest lyonnais sont, par ordre de grandeur,
Saint-Etienne (289 000 habitants), Roanne (74 000 habitants) et
Villefranche-sur-Saône (58 000 habitants). Ensuite, on trouve des villes
de taille inférieure, constituant des pôles plus modestes, dont le
fonctionnement est susceptible d'être modifié avec l'ouverture de
l'A89. Il s'agit par exemple de l'Arbresle (5 700 habitants) et Tarare (10 600
habitants). (Source : INSEE, RP 1999). La figure 3 présente la
répartition de la population le long de la future A89.
Figure 4 : Population le long de la future A89 en
1999
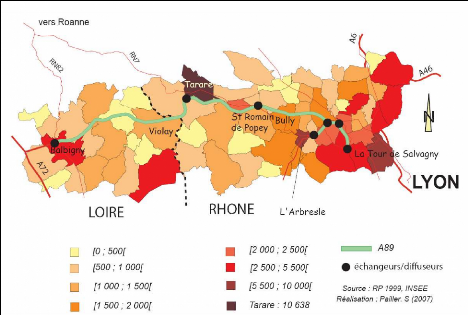
L'A89 traverse une zone peu peuplée, dont les communes
ont le plus souvent moins de 2000 habitants. Tarare est la commune la plus
peuplée des communes traversées par l'A89. Elle fait figure de
pôle démographique de l'ouest lyonnais. La pression
démographique décroît au fur et mesure que l'on
s'éloigne de Lyon vers l'ouest. On observe une corrélation entre
les communes ayant la population la plus élevée de la zone
d'étude et la présence de diffuseurs. Les diffuseurs seront donc
placés pour répondre aux éventuels besoins de la
population locale et des entreprises. De plus, cette localisation des
échangeurs permet une amélioration de la rentabilité du
tracé pour le concessionnaire : ASF.
1.2 : Une concentration de la population dans des
pôles urbains
La zone d'étude se caractérise par une
densité moyenne élevée de 156 habitants par km2
sans compter le Grand-Lyon, qui lui, connaît une très fort
densité : 2 390 habitants par km2. Sur la zone
d'étude, les contrastes de densité sont élevés. Des
cantons sont densément peuplés. Il s'agit par exemple du canton
de l'Arbresle (205 habitants par km2). Plus on s'éloigne du
Grand Lyon, moins les densités sont fortes. Tel est le cas pour les
cantons du Bois-d'Oingt ou pour Tarare, qui connaissent des densités
proches de la moyenne nationale.
Les cantons les moins densément peuplés sont
Amplepuis, Néronde et Saint-Symphorien de Lay. Ils ont une
densité inférieure à 80 habitants par km2.
1.3 : Une population vieillissante
Dans la Loire, la part des moins de 20 ans est
inférieure à 25%. Dans le Rhône, les moins de 20 ans vivent
au sud et à l'est de Tarare. Cette répartition
géographique des moins de 20 ans s'explique par l'influence de Lyon. En
effet, dans le Rhône, les communes étant proches de Lyon sont
celles qui présentent le plus fort taux de moins de 20 ans. A l'inverse,
plus on s'éloigne de Lyon, plus ce taux tend à diminuer. La
limite administrative entre le département de la Loire et celui du
Rhône s'accompagne d'une baisse d'environ 5 points de la part des jeunes
de moins de 20 ans. (Source : INSEE, RP 1999)
Les plus de 75 ans occupent une part importante de la
population dans les communes dont la part des moins de 20 ans est faible, dont
Tarare. Plus on s'éloigne de Lyon, plus la population vieillit. La
population de l'ouest lyonnais est donc vieillissante. Ce vieillissement est
plus prononcé à l'ouest de Tarare (Tarare compris) qu'à
l'est dont le dynamisme est lié à l'influence et aux
activités de l'agglomération lyonnaise. Les possibilités
de périurbanisation
offertes par l'A89 seront peut-être une solution pour
rajeunir la population en attirant de jeunes foyers travaillant et
résidant actuellement dans l'agglomération lyonnaise.
1.4 : La croissance de la population dans le Rhône
contraste avec le déclin démographique de la Loire
Entre 1990 et 1999, quatre cantons subissaient une
évolution démographique négative : Thizy,
Saint-Germain-Laval, Saint Symphorien en Lay et Roanne. Pour ce qui est du
dernier canton, il a connu 4000 départs. Cette fuite s'explique par de
lourdes pertes d'emplois dans les secteurs textiles et mécaniques.
A l'inverse, les autres cantons connaissent des augmentations
hétérogènes. Parmi les cantons qui voient leur population
s'accroître rapidement, on peut citer l'Arbresle et Le Boisd'Oingt. En
effet, ils comptent 15% d'habitants en plus entre 1990 et 1999.
La construction de résidences principales semble
être arrivée à saturation dans les communes proches du
Grand-Lyon. En revanche, les autres communes continuent de voir leur parc
immobilier s'agrandir. Les communes situées le plus à l'ouest de
notre zone d'étude accueillent de nombreuses résidences
secondaires.
Sur le tracé de l'A89, Balbigny fait exception en
matière de gain démographique. Elle est la seule commune à
gagner de la population entre 1990 et 1999. Dans le Rhône, les communes a
priori rurales sont celles qui gagnent de la population alors que le pôle
principal, Tarare, en perd. Nous avons là un phénomène de
périurbanisation avec un étalement de l'aire urbaine sur les
espaces ruraux. Les 4 diffuseurs de la partie terminale de l'autoroute se
situeront sur les communes qui connaissent le plus fort accroissement
démographique. Il est donc important de noter qu'en 1999,
c'est-à-dire 13 ans avant la mise en service prévue de
l'autoroute A89, les communes qui seront dotées d'un diffuseur
connaissaient déjà les plus fort taux d'accroissement
démographique. La limite entre le Rhône et la Loire est
très marquée avec un gain de densité dès lors que
celle-ci est franchie vers l'Est. Tarare connaît une très forte
baisse de sa densité. A l'inverse, Pontcharra-sur-Turdine et
Saint-Romain-dePopey connaissent un accroissement de leur densité. La
figure 5 permet d'identifier les évolutions démographiques
opposées de la Loire et du Rhône.
Figure 5 : Projection de population dans la Loire et
dans le Rhône jusqu 'en 2030
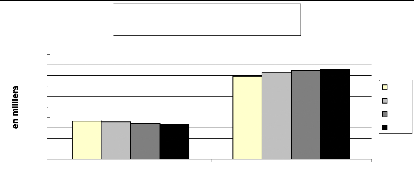
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200
0
Population de la Loire Population du Rhône
Projection de population dans la Loire
et dans le
Rhône jusqu'en 2030
2000 2010 2020 2030
Source : INSEE, oct. 2001
Ce tableau présente l'évolution prévue de
la population des départements du Rhône et de la Loire.
L'enclavement du nord du département de la Loire est l'une des raisons
de la perte démographique du département. Celui-ci perdrait
environ 10% de sa population en 30 ans. Le projet A89 pourrait en favoriser
l'ouverture, de Roanne notamment, et ainsi maintenir la population en place,
voire attirer de nouveaux habitants.
A l'inverse, le Rhône devrait voir sa population
croître d'environ 8% sur la même période. Si l'extension de
l'agglomération lyonnaise se fait actuellement vers le Nord, la plaine
de l'Ain et l'Est, l'A89 pourrait être un outil de
rééquilibrage du développement de la population vers
l'Ouest.
2- La diversité des profils socio-économiques
de l'espace traversé par la future A89
En 2004, l'INSEE établit une typologie des cantons de
toute la région Rhône-Alpes. Sur la base du recensement de
population 1999 (répartition de la population, densité de
population, âge, conditions de vie, logements, scolarisation, emploi) et
des informations sur le revenu disponible des ménages, les cantons de
l'ouest lyonnais peuvent être répartis en 5 classes. Cette
classification n'est pas unique et d'autres indicateurs permettraient
d'établir une typologie différente.
Figure 6 : Typologie des cantons de l'ouest
lyonnais
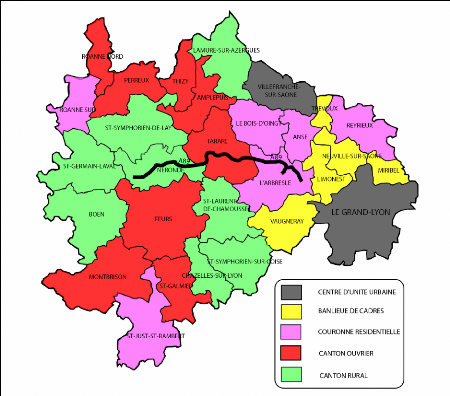
Source : INSEE, 2004
Les centres d'unités urbaines, en particulier celui du
Grand-Lyon présentent les caractéristiques habituelles des
grandes villes. Le nombre d'emplois offert est supérieur au nombre de
résidents : les habitants des espaces environnants (périurbains
ou ruraux viennent y travailler).
Les banlieues de cadres sont des cantons qui comptent 15% de
cadres dans leur population. Ceux-ci bénéficient du double
avantage d'un cadre de vie agréable et de la proximité de Lyon ou
Villefranche-sur-Saône. Au sein de ces banlieues, le niveau de vie est
élevé, le chômage faible et les trois-quarts des 15-24 ans
sont scolarisés. Les diverses activités de la population de ces
cantons nécessitent de nombreux déplacements quotidiens. Les
banlieues de cadres ne sont pas directement concernées par le projet
A89. En revanche, les
cantons de Vaugneray et de Limonest se situent à
l'embouchure de l'autoroute qui y déversera ses usagers.
La couronne résidentielle se trouve en
périphérie des grandes villes (Lyon, Roanne et Saint-Etienne).
Elle se caractérise par un habitat individuel et un nombre d'emplois
bien inférieur à celui des actifs résidents. Ainsi, les
habitants de l'Arbresle, du Bois-d'Oingt, d'Anse... effectuent chaque jour des
trajets domicile-travail vers Lyon ou une autre agglomération. Elle se
trouve à la limite de la zone d'influence de l'agglomération.
L'industrie est très présente dans les cantons
ouvriers et occupe plus du quart des actifs. Ces cantons sont marqués
par la présence de villes moyennes situées à égale
distance des pôles régionaux. Ils ne sont donc pas
réellement sous l'influence d'une agglomération. Le canton de
Tarare en est un bon exemple. Il se trouve à peu près à
égale distance de Roanne et de Lyon. Ses flux de transports sont
malgré tout tournés vers l'agglomération lyonnaise dont le
pouvoir d'attraction est plus fort que celui de Roanne.
Les cantons ruraux, pour terminer, se trouvent à
l'écart des grands axes de circulation, ils sont faiblement
peuplés. Après l'exode des actifs vers les pôles d'emploi,
les habitants âgés forment aujourd'hui une part importante de la
population. L'habitat est particulièrement ancien. L'agriculture est
encore très présente, elle fournit plus de 16% des emplois
(contre 3% en moyenne en Rhône-Alpes). Au delà des
activités agricoles, les cantons ruraux accueillent de nombreuses
résidences secondaires (26% du parc immobilier). Les déplacements
vers ces résidences secondaires engendrent des flux importants en fin de
semaine et lors des vacances. L'A89 pourrait être un facteur de
repeuplement des cantons ruraux. (Source : INSEE, 2004)
La carte de typologie des cantons montre que l'autoroute A89
traverse 3 cantons au profil différent : rural, ouvrier,
résidentiel. Elle semble pouvoir rapprocher les cantons ruraux des
centres intermédiaires et/ou régionaux, mais aussi étendre
les couronnes résidentielles sur les espaces ruraux.
3- Une faible activité économique
3.1 : Une industrie en reconversion
Sur la zone d'influence du projet, 93% des entreprises
comptent moins de 10 salariés. Ces entreprises sont à
majorité tertiaires (5 6%). En ce qui concerne les établissements
de plus de 10 salariés, 80 % d'entre eux emploient moins de 50
salariés. On trouve des établissements de plus de 200
salariés dans les cantons de Limonest (18 établissements), Feurs,
Tarare et l'Arbresle, qui comptent chacun 4 établissements de ce type.
Ces mêmes cantons comptent un nombre beaucoup plus important
d'entreprises de 10 à 50 salariés : 354 sur le canton de
Limonest, 89 sur Tarare, 94 sur l'Arbresle et 85 sur Feurs.
Le secteur d'activité dominant évolue en
fonction de l'éloignement à la métropole lyonnaise. En
effet, à proximité de Lyon, les activités tertiaires
dominent alors qu'en s'éloignant vers l'Ouest, les entreprises sont
orientées vers l'industrie. L'industrie est le secteur qui compte le
plus grand nombre de salariés (53% des salariés). Les trois
activités industrielles principales sont le textile-habillement
(malgré les pertes d'emplois, ce secteur est le plus important car il
regroupe près de la moitié des salariés), la
métallurgie et l'agroalimentaire. Le secteur tertiaire est quant
à lui présent sur les centres administratifs et moins sur les
cantons ruraux.
3.2 : Une agriculture qui contraint la localisation des
axes de transport
L'espace que traversera l'A89 est essentiellement agricole et
sylvicole. Le tracé de l'autoroute doit tenir compte de cette
donnée. Si traverser un espace dominé par des pâtures est
assez simple, traverser une vigne, qui plus est AOC l'est beaucoup moins.
L'autoroute empiètera sur près de 300 ha de terres agricoles dont
20 ha de vignes et 70 ha de bois.
L'élevage bovin constitue l'activité la plus
importante du territoire. Il est essentiellement localisé sur les
reliefs et est complété par une agriculture
céréalière. Le nombre d'exploitations est en baisse sur
l'ensemble du territoire concerné. Entre 1988 et 2000, Tarare a perdu
environ 50% de ses exploitations agricoles. Cette perte s'explique par
l'urbanisation des communes de la périphérie lyonnaise, la
périurbanisation.
La vigne est une culture à haute valeur ajoutée.
Elle se concentre sur les cantons d'Anse et du Bois-d'Oingt, ou elle
représente près de la moitié de la surface agricole utile.
La présence
des vignes est l'une des raisons qui ont fait abandonner le
projet de liaison directe entre l'A89 et l'A6.
III - Les enjeux liés à la mise en place
de l'A89
L'agglomération lyonnaise est desservie par de
nombreuses voies autoroutières. L'A6, en provenance du Nord, et
notamment de Paris, pénètre dans Lyon et cède sa place
à l'A7 qui se dirige vers le Sud de la France. A l'Est, l'A42 (puis A40)
rejoint le Nord Est de la France et la Suisse et l'A43 prend la direction des
Alpes et de l'Italie. L'unique autoroute qui fait la jonction entre Lyon et
l'ouest de la France est constituée de deux autoroutes (A47 et A72 puis
A89). Il n'existe actuellement pas de liaison autoroutière directe entre
Lyon et Clermont-Ferrand. La section Balbigny - La-Tour-de-Salvagny viendra
assurer cette liaison.
1- La faible accessibilité de l'ouest lyonnais
1.1 : L'absence d'un axe autoroutier entre le Nord de la
Loire et Lyon
La localisation des axes routiers est étroitement
liée à la topographie, les axes principaux se trouvent dans les
vallées. La section Balbigny - La Tour-de-Salvagny de l'A89 fera la
jonction entre l'A72 (ou A89) dans la plaine du Forez aux autoroutes à
A6 et A46. La RN7 est l'unique axe qui relie Roanne à Lyon en passant
notamment par Tarare et l'Arbresle. Elle emprunte la vallée de la
Turdine. La RN89, de Montrond-les-Bains à l'Arbresle par
Sainte-Foy-l'Argentière longe la Brévenne. A plus petite
échelle, la RN89 est l'axe qui relie par la route Lyon à
Bordeaux. La RN82 longe la Loire et relie Roanne à Saint-Etienne. Enfin,
la RN6 est parallèle à l'autoroute A6 au Nord de Lyon. L'ouest
lyonnais, dans sa partie septentrionale, est dépourvu d'axe
autoroutier.
Figure 7 : Le réseau autoroutier
actuel
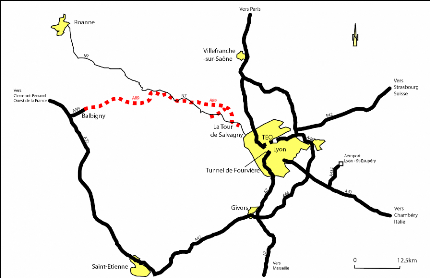
Source : Atlas Michelin 2005. Réalisation : Pailler.S
(2007)
Figure 8 : Accessibiité aux autoroutes dans
l'ouest lyonnais
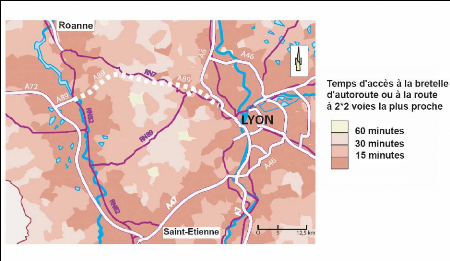
Source : DRE Rhône-Alpes
Les communes des Monts du lyonnais ne sont actuellement
traversées et desservies par aucune autoroute. Ainsi, l'ouest lyonnais
se trouve en moyenne à 30 minutes d'une autoroute. Il se peut même
que le temps d'accès à une autoroute soit d'une heure au sud de
Tarare. L'A89 peut améliorer ce temps d'accès à une voie
autoroutière et donc améliorer l'accessibilité de l'ouest
lyonnais.
1.2 : Des infrastructures ferroviaires limitées
Il n'existe pas de voie ferrée reliant directement
Balbigny à Lyon. En effet, les principales lignes relient les grandes
villes entre elles (Lyon - Saint-Etienne, Roanne - Saint-Etienne, Roanne -
Lyon). Ainsi, l'A89 ne viendra doubler la voie ferrée qu'à partir
de Tarare. Entre Tarare et Lyon, elle suivra plus ou moins le tracé de
cette voie ferrée.
Figure 9 : Accessibiité des gares TER de
l'ouest lyonnais
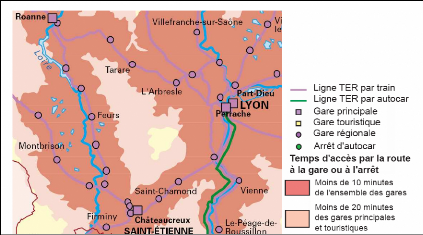
Source : DRE, Région Rhône-Alpes
Les riverains de la RN7 sont à moins de 10 minutes
d'une gare TER. Le coeur de l'ouest lyonnais, qui n'est traversé par
aucune voie ferrée se trouve à plus de 20 minutes d'une gare.
L'espace directement concerné par l'A89 est donc plutôt bien
desservi par le TER malgré un « angle mort » dans le coeur des
Monts du Lyonnais, qui n'est traversé par un aucune voie de
communication.
2- Description du tronçon Balbigny -
La-Tour-de-Salvagny de l'A89
L'autoroute A89 Balbigny- La-Tour-de-Salvagny traversera 22
communes réparties dans deux départements :
- dans la Loire : Balbigny, St-Marcel-de-Félines,
Néronde, St-Just-la-Pendue, Bussières, Ste-Colombe-sur-Gand,
Violay.
- dans le Rhône : Joux Tararre,
Saint-Marcel-l'Eclairé, Saint-Forgeux, Pontcharrasur-Turdine, Les Olmes,
Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-Germainsur-L'Arbresle, Chatillon
d'Azergues, Fleurieux-sur-L'Arbresle, Lozanne, Lentilly,
La-Tour-de-Salvagny.
Cette section terminale de l'A89 sera longue de 50km (+3,5km
pour l'antenne de l'Arbresle). Elle assurera une liaison directe, entre l'A72
dans la plaine du Forez et la RN7 (La-Tour-de-Salvagny). Elle comptera 7
diffuseurs (un dans la Loire : Balbigny, et six dans le Rhône :
Tarare-ouest, Saint-Romain-de-Popey, Fleurieux-sur-L'Arbresle, Pont-de-Dorieux,
La-Tour-de Salvagny et L'Arbresle). Il s'agit d'une autoroute à 2*2
voies. En raison du relief très accidenté du secteur qu'elle
traversera, elle demande la réalisation d'ouvrages d'art et de tunnel.
Ainsi, un conducteur se rendant de Balbigny à La-Tour-de-Salvagny
empruntera 3 tunnels (le tunnel de Violay d'une longueur de 4km, le tunnel de
Tarare d' 1 km de long et enfin, le tunnel de Chalosset d'1 km de long lui
aussi) et franchira les cours d'eau à l'aide 7 viaducs.
La concession de cette autoroute a été
attribuée aux Autoroute du Sud de la France (ASF) qui devront en assurer
la réalisation et l'entretien. Le coût de ce projet est
estimé à environ 1 milliard d'euros. Ce montant
élevé s'explique par le relief des Monts du Lyonnais qui donne
à l'autoroute les caractéristiques d'une autoroute de montagne.
Elle nécessite donc les aménagements que nous avons
évoqués : viaducs et tunnels. En contrepartie, l'autoroute sera
soumise à un droit de péage dont le montant sera similaire
à celui pratiqué sur les autoroutes de montagne du réseau
AREA. En plus du relief, la construction de ce dernier barreau autoroutier pose
certains problèmes. Les Monts du Lyonnais présentent une grande
diversité écologique. La partie terminale du projet traverse des
zones agricoles à forte valeur ajoutée. Pour cette raison, le
projet s'achève à La-Tour-de-Salvagny et débouche sur le
réseau local (RN7) (au lieu de rejoindre l'A6 comme il était
prévu lors du tout premier projet de liaison Balbigny - Lyon, mais les
contraintes liées à l'emprise sur des terres agricoles ont
fait
abandonner le projet), ce qui risque de renforcer la
saturation sur la RN7 et la RN6. Ainsi, la liaison entre l'A89 et l'A6 et l'A46
dont la demande de déclaration publique a été
déposée est indispensable pour relier l'A89 à l'axe
Nord/Sud français ainsi qu'à l'est lyonnais.
Figure 10 : Les communes traversées par
l'A89
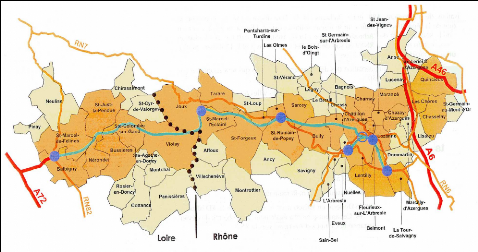
Source : DRE
Figure 11 : Les ouvrages d'art du
tracé
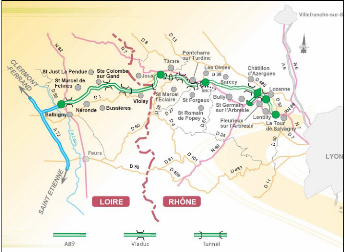
Source : ASF
3- Contribution d'A89 aux objectifs d'aménagement du
territoire
L'A89 sera chargée de plusieurs missions, à
différentes échelles.
3.1 : Les enjeux nationaux d'aménagement
L'objectif principal de la section d'autoroute est
d'intérêt national. Il consiste à achever la liaison
autoroutière de l'A89 entre Bordeaux et Lyon. D'une longueur de 517km,
l'A89 deviendra alors une grande liaison Est-Ouest permettant de relier la
région RhôneAlpes à la façade Atlantique par
autoroute. L'A89 est réalisée dans une logique de
tronçons. Le tracé réel de l'autoroute n'est pas aussi
droit que le laisse penser la figure 11. Au contraire, il présente de
nombreuses sinuosités qui correspondent à la volonté de
certains hommes politiques de voir passer l'autoroute à proximité
de leur commune. C'est pourquoi l'autoroute A89 a pour surnom «
l'autoroute des présidents ». Les problèmes de financement
et la volonté farouche de la part des acteurs locaux d'avoir un
accès à l'autoroute pour espérer profiter des effets
positifs de celle-ci (ouverture) sont les raisons qui font que la
réalisation complète de l'A89 progresse par petites touches.
Comme le montre la carte ci-dessous, il n'y a pas de relation entre la
progression géographique et la progression chronologique de l'autoroute.
On remarque que la phase d'achèvement de l'A89 date du début des
années 2000.
Figure 12 : Calendrier de la réalisation de
l'A89
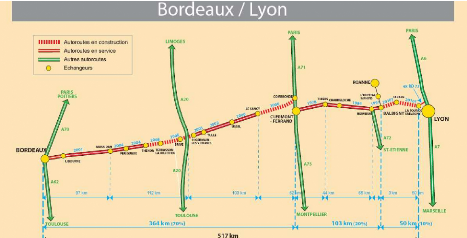
Source : ASF
L'A89 est une autoroute d'intérêt européen
car elle constitue un axe privilégié dans le cadre des
échanges entre le Nord-Est de l'Europe : Allemagne, Pays-Bas, Belgique,
Suisse et le Sud-Ouest : Espagne, Portugal et Océan Atlantique.
3.2 : Les enjeux supra-régionaux
Si nous observons maintenant les objectifs de l'A89 à
l'échelle supra-régionale, l'A89 répond à
l'objectif d'ouvrir Rhône-Alpes sur l'Auvergne, le massif central et le
Sud-Ouest de la France. En lien avec cet objectif, elle peut relier
Clermont-Ferrand au réseau des autoroutes et des villes
rhônalpines ainsi qu'à l'Est de l'Europe.
3.3 : Les enjeux régionaux
Elle contribuera aussi aux enjeux régionaux, nous
pouvons retenir quelques points essentiels. Tout d'abord, l'A89 constitue un
facteur pouvant favoriser le développement de villes moyennes telles que
Roanne et Tarare. De plus, elle améliorera la desserte de l'ouest
lyonnais qui ne présente actuellement aucune voie autoroutière.
Aussi, elle contribue à améliorer la desserte de la plaine du
Forez qui est considérée par la région comme un «
espace à enjeux ». Enfin, elle pourra être une alternative
à l'utilisation de la RN7 entre Roanne et Lyon, peu performante et
très fréquentée.
De plus, elle offrira la possibilité à l'A47 de se
délester d'une partie de son trafic, notamment les flux de poids lourds
en transit entre le Sud-Ouest et le Nord-Est.
3.4 : Les enjeux locaux
A l'échelle locale, l'A89 devrait favoriser le
désenclavement de Roanne. En effet, même si cette dernière
ne se trouve pas sur le tracé de l'A89, la mise à 2*2 voies de la
RN82 rapproche, en temps, et non pas en distance, les roannais de la liaison
Clermont-Ferrand-Lyon.
Elle permettra de créer une liaison entre la plaine du
Forez et Lyon, sans passer par Saint-Etienne. Dans le Rhône, l'A89 peut
contribuer à rééquilibrer vers l'Ouest le
développement départemental grâce à
l'amélioration des échanges avec les agglomérations de
Lyon et de Villefranche-sur-Saône.
La section A89 entre Balbigny et La-Tour-de-Salvagny doit donc
répondre à des objectifs divers et mutliscalaires.
L'ouest lyonnais est marqué par l'absence d'axes de
transports transversaux efficaces. Cette absence est considérée
comme l'une des raisons de la perte de vitesse démographique et
économique de l'ouest lyonnais. L'A89,qui est une solution à ce
déficit est porteuse d'espoirs pour les espaces qu'elle traversera qui
voient en sa mise en service une solution à leurs difficultés.
Nous allons maintenant plonger dans le coeur de notre étude avec
l'analyse de la répartition et de l'évolution des flux de
transports dans l'ouest lyonnais.
-2-
LES CARACTERISTIQUES
DES FLUX DE TRANSPORTS
DANS L'OUEST LYONNAIS
|
I- La prédominance des flux de transports
routiers
L'état des lieux du trafic actuel et l'évolution
du trafic depuis plusieurs années ont été
réalisés à partir des données de comptages
présents dans le Dossier d'enquête publique préalable
à la Déclaration d'Utilité Publique de 2001 (pour les
chiffres de 1991 à 1998) et de la Division Régionale de
l'Equipement de Rhône-Alpes pour les chiffres de 2002 à 2004. Les
comptages de 1999 à 2001 n'étaient pas disponibles. Les
données du dossier d'enquête publique se présentaient sous
forme de carte sur laquelle figuraient les comptages moyens journaliers de 1991
à 1998. Ces chiffres n'étaient pas toujours complets, en effet,
pour certaines sections, certaines années n'ont pas donné lieu
à un recensement du trafic. L'absence de chiffres pour la période
1999-2001 et les quelques données manquantes sur la période
1991-1998 ne nuisent pas trop à l'étude de l'évolution du
trafic, celle-ci s'intéressant essentiellement à la
période globale 1991-2004. Toutefois, la prise en compte de l'absence de
données est nécessaire dans la lecture des graphiques. En effet,
la forte hausse entre 1998 et 2002, présente sur de nombreux graphiques,
est due au fait que pour un même intervalle, 3 années ne sont pas
représentées. Il ne faut en rien y voir une forte hausse mais au
contraire, une hausse progressive.
La DRE a quant à elle réalisé en 2005 des
cartes de trafic pour les années 2002, 2003 et 2004. Elles se
décomposent en deux thèmes : trafic autoroutier et trafic sur
routes nationales. Le trafic est indiqué sur chaque point de comptage.
De plus, la DRE met en ligne, par l'intermédiaire de l'Observatoire
Régional des Transports, des cartes concernant le trafic sur les
autoroutes, les nationales et les départementales du Rhône. On
trouve aussi des tableaux permett ant de mesurer l'évolution mensuelle
du trafic en 2005 de quelques routes et autoroutes du département.
Toutes les données de trafic routier et autoroutier concernent les deux
sens de circulation.
1- Les flux circulent en grande majorité sur les
axes autoroutiers
1.1 : De plus en plus d'échanges avec l'ouest
Nous allons nous intéresser tout d'abord au trafic
provenant de l'Ouest : de Clermont-Ferrand et de Saint-Etienne. L'A89 Balbigny
- La-Tour-de-Salvagny sera le dernier maillon de l'autoroute provenant de la
préfecture auvergnate en direction de Lyon. Elle sera alors dans la
continuité de l'A72 (récemment rebaptisée A89 entre
Clermont-Ferrand et Balbigny) dont le trafic est étudié dans les
deux figures suivantes.
Figure 13 : Trafic autoroutier sur deux sections de
l'A 72 et le barreau existant de l'A89
|
Véhicules par jour
|
A72 Nord de
bifurcation A89 Est
|
A89 Est
Nervieux-Balbigny
|
A72
Nord de
Saint-
Etienne
|
|
1991
|
10 530
|
1 790
|
14 660
|
|
1992
|
11 290
|
2 330
|
15 820
|
|
1993
|
12 010
|
2 700
|
16 990
|
|
1994
|
12 540
|
3 010
|
17 990
|
|
1995
|
12 810
|
3 340
|
18 690
|
|
1996
|
12 790
|
3 470
|
19 050
|
|
1997
|
13 040
|
3 710
|
19 790
|
|
1998
|
13 570
|
4 110
|
20 840
|
|
2002
|
15 776
|
5 216
|
25 211
|
|
2003
|
16 252
|
5 446
|
26 183
|
|
2004
|
16 419
|
5 546
|
26 921
|
|
Taux de
variation
1991-2004
|
59,49%
|
209,83%
|
83,64%
|
Sources : DRE, Dossier d'enquête publique
Figure 14 : Evolution du trafic moyen journalier
entre 1991 et 2004 sur l'A 72 et l'A89
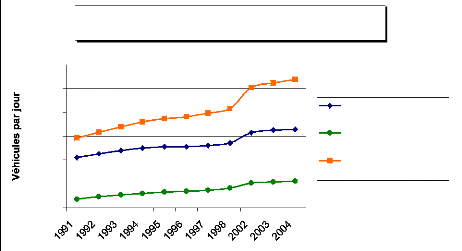
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Evolution du trafic moyen journalier entre 1991 et
2004
sur l'A72 et l'A89
A72 Nord de Balbigny
A89 Est Nervieux-Balbigny
A72
Nord de Saint-Etienne
Sources : DRE, Dossier d'enquête publique
Le trafic augmente constamment depuis 1991 sur les
différents secteurs étudiés. En 2004, plus de 16 000
véhicules empruntent l'A72 au Nord du barreau A89 Est. Ce barreau ne
supporte pas un trafic très élevé (moins de 6000
véh/j our) mais connaît en revanche une hausse extrêmement
élevée de celui-ci (il a triplé entre 1991 et 2004).
Enfin, le secteur de l'A72 situé au Nord de Saint-Etienne, avant le
passage du péage de Veauchette en venant du Nord, est celui qui supporte
le trafic le plus élevé. En plus de relier la préfecture
auvergnate aux préfectures stéphanoise et lyonnaise, il sert de
desserte de la plaine et des monts du Forez. Son trafic s'élève
en 2004 à près de 27000 véhicules par jour et a quasiment
doublé sur la période observée.
Les 3 sections étudiées de l'A72 et de l'A89
connaissent toutes les trois une hausse constante et progressive de leur
trafic. Cette hausse est le résultat d'une augmentation des
échanges entre Saint-Etienne et la plaine du Forez et le Nord de la
Loire. C'est aussi le résultat d'une augmentation des échanges
entre Rhône-Alpes et Auvergne.
Le schéma suivant représente les principaux flux
longue distance passant par l'A72. Les chiffres datent de 1994. Pour permettre
de présenter les flux actuels, il fut nécessaire de recalculer
ces flux en fonction de la croissance du trafic généralement
observée sur l'A72 entre 1994 et 2004. Cette croissance
d'élève à plus ou moins 40%. Ainsi, les estimations des
flux pour 2004 correspondent à une augmentation de 40%
des flux de 1994. Si les chiffres pour 2004 ne sont qu'approximatifs, le
schéma de la figure 15 présente de manière
intéressante les principaux flux longue distance passant par l'A72.
Figure 15 : Principaux flux de transit Est-Ouest via
l'A 72
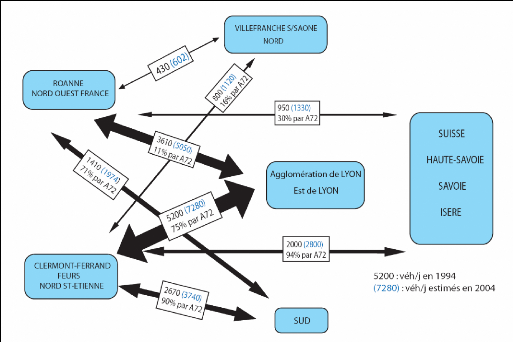
Sources : Dossier d'enquête publique, DRE.
Réalisation : Pailler.S (2007)
L'aire métropolitaine lyonnaise attire les flux les
importants passant par l'A72. Les échanges entre le Nord de
Saint-Etienne / Clermont-Ferrand et Lyon sont les plus importants. Ils
s'effectuent actuellement à 75% par l'A72. Parmi eux, nombreux sont ceux
qui pourraient s'effectuer par l'A89 lorsqu'elle sera mise en service,
notamment les flux entre Clermont-Ferrand et Lyon. On remarque que si seulement
11% des flux entre Roanne et Lyon se font via l'A72, 71% des échanges
entre Roanne et le Sud se font via ce même axe. L'A72 est donc un axe
préférentiel pour les flux Nord-Sud. Dans une moindre mesure, on
constate aussi cette préférence dans les échanges entre
Clermont-Ferrand / Nord de Saint-Etienne et le Sud qui se font à 90% par
l'A72.
Si l'on s'intéresse désormais aux flux vers
l'Est de la France, on constate une opposition d'itinéraire selon que
les échanges se font avec Roanne ou avec Clermont-Ferrand / le nord de
Saint-Etienne. En effet, seulement 30% des flux entre Roanne et l'Est se font
via l'A72. Les 70% restant se font donc essentiellement en traversant Lyon, par
le TEO notamment. A l'inverse, les flux entre Clermont-Ferrand / nord de
Saint-Etienne et l'Est se font à 94% via l'A72 ! Une partie de ces flux
pourrait se reporter sur la future A89.
Les usagers de l'A72 qui souhaitent se rendre à Lyon
contournent Saint-Etienne par le Nord-Est pour rejoindre l'A47 à
Saint-Chamond. La figure 16 présente le nombre de l'évolution
annuelle du trafic sur l'A47 de 1993 à 2004 à Givors.
Figure 16 : Evolution annuelle du trafic sur l'A47
de 1993 à 2004 à Givors
|
Givors
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Véhicules par jours
|
44 700
|
46 640
|
49 740
|
51 320
|
50 660
|
51 110
|
56 652
|
57 352
|
58 082
|
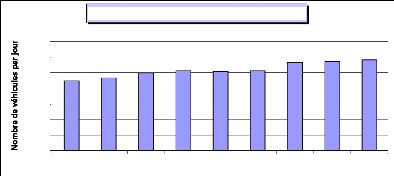
40 000
20 000
70 000
60 000
50 000
30 000
10 000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004
Evolution annuelle du trafic sur l'A47 à
Givors
Sources : dossier d'enquête publique, DRE
L'A47 est une autoroute interurbaine entre Saint-Etienne et
Givors puis Lyon par l'A7. Elle assure donc deux fonctions : la liaison entre
les deux métropoles régionales et la desserte locale. Le choix
des chiffres de comptage à Givors permet de ne pas prendre en compte le
trafic de desserte. Le dossier d'enquête concernant l'A45 entre
Saint-Etienne et Lyon permet de connaître la structure des flux circulant
de l'A47. Les chiffres qu'il présente complètent ceux recueillis
pour ce mémoire car ils ont été réalisés en
1999. A cette date, les
échanges entre Lyon et l'agglomération
stéphanoise étaient de l'ordre de 13 000 véhicules par
jour. Les relations de grand transit avec l'Ouest (A72) représentaient
10 000 véhicules par jour. On peut supposer qu'une partie de ces flux
sera reportée sur l'A89. Si l'on considère que le trafic
journalier augmente annuellement de 2,14%, on obtient environ 52 200
véhicules en 1999 à Givors. Ainsi, le trafic concerné
correspondant à la liaison Saint-Etienne - Lyon ou à un transit
vers l'Ouest représente de 40 à 45% du trafic de l'A47 à
Givors.
L'A47 est une autoroute ancienne dont les
caractéristiques rendent difficiles les conditions de circulation. Elle
est très sinueuse, la circulation est dense et les trafics
élevés. Les heures de pointe sont marquées par des
ralentissements aux abords de Saint-Etienne et pour traverser Givors. En raison
de l'étroitesse de la chaussée et de l'absence de bande
d'arrêt d'urgence, tout incident ou accident provoque des ralentissements
et des bouchons importants. Les temps de parcours sont donc aléatoires
et peuvent être soumis à de fortes variations. L'infrastructure
telle qu'elle existe aujourd'hui, malgré une croissance
modérée, semble arriver à saturation. La capacité
théorique d'une autoroute en 2*2 voies est comprise entre 30 000 et 50
000 véhicules par jour (Plassard, 2003, p.26). L'A47 a
supporté 58 000 véhicules par jour en 2004. Ce chiffre,
ajouté à la dangerosité de l'autoroute permet de
comprendre aisément la situation de saturation que connaît
l'A47.
1.2 : Lyon, un point de passage incontournable pour les
flux Est-Ouest
L'aire métropolitaine lyonnaise est traversée
par de nombreuses autoroutes qui en font un véritable carrefour
autoroutier. La Transversale Est-Ouest (TEO) de Lyon, le contournement Est de
Lyon (A46), l'A42 et l'A43 sont concernés par le projet A89. En effet,
ils constituent les axes autoroutiers permettant de rejoindre l'Est de la
France, et de l'Europe en provenance de l'Ouest.
TEO est une voie rapide d'une quarantaine de kilomètres
ouverte en 1997, limitée à 90 km. Elle relie Tassin-la-Demi-Lune
(Ouest de Lyon) au périphérique Est (Villeurbanne). La figure 17
montre l'évolution des flux de transports sur TEO.
Figure 17 : Evolution récente du trafic
Est-Ouest de Lyon par TEO
|
TEO ouest
|
TEO est
|
Périphérique
Est: sortie de
TEO
|
|
2002
|
53900
|
41331
|
90368
|
|
2003
|
53446
|
41668
|
89982
|
|
2004
|
54806
|
43252
|
87224
|
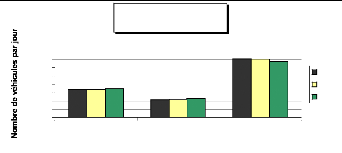
Evolution du trafic de TEO
de 2002 à
2004
TEO ouest TEO est Périphérique Est:
sortie de TEO
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
2002 2003 2004
Source : DRE
Depuis 2002, le trafic de TEO croît
légèrement. Il n'est pas homogène sur tout le
tracé, il est plus dense à l'Ouest. A la sortie Est, les flux
supportés par le périphérique (RN3 83) sont deux fois plus
importants que sur car il supporte aussi les flux en provenance et en direction
de l'A46.
Le contournement Est de Lyon est constitué de l'A46
Nord et Sud et de la RN346. Pour simplifier, et vues les
caractéristiques de voie rapide de la RN346, nous appellerons ici «
A46 », le contournement Est de Lyon. Il permet de desservir les communes
de l'est lyonnais mais aussi de faciliter les échanges Nord/Sud sans
passer par le centre de Lyon. L'A43, au Sud-Est de Lyon, est une autoroute qui
relie l'agglomération lyonnaise aux Alpes, et par conséquent
à l'Italie, en passant par Chambéry. Enfin, l'A42 relie
l'agglomération lyonnaise au Nord-Est de la France et à la
Suisse. Bien que ces trois axes autoroutiers ne fassent pas partie de l'ouest
lyonnais, il est intéressant de les étudier. En effet, ils seront
le prolongement vers l'Est de l'A89 qui rappelons-le, a parmi ses objectifs de
faciliter les flux de transports Est-Ouest nationaux et internationaux. L'A46
est analysée ici bien qu'elle supporte
essentiellement des flux Nord-Sud, car elle fait partie des
autoroutes de l'est lyonnais. Elle sera donc un lien entre l'A89 et les
autoroutes de l'Est (A42 et A43). Les points de comptages choisis sont
situés à l'Est de l'A432 (autoroute d'accès à
l'aéroport Lyon Saint-Exupéry) afin d'être
représentatifs des flux vers et en provenance de l'Est, sans prendre en
compte les flux entre les zones industrielles de l'est lyonnais,
l'aéroport et l'agglomération lyonnaise. Ils reflètent
ainsi réellement les échanges avec l'Est.
Figure 18 : Evolution du trafic moyen journalier de
trois autoroutes de l'est lyonnais
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
A46
Meyzieu
|
76
|
862
|
77
|
046
|
78
|
154
|
|
A43
péage de
Saint-
Quentin-
Fallavier
|
74
|
035
|
75
|
800
|
76
|
786
|
|
A42
péage de
Dagneux
|
61
|
007
|
57
|
780
|
59
|
790
|
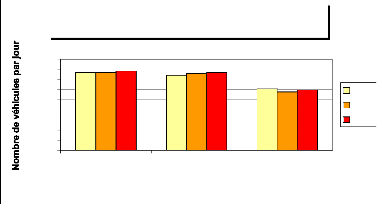
40 000
60 000
20 000
90 000
80 000
70 000
50 000
30 000
10 000
0
Evolution récente du trafic moyen journalier de
trois
autoroutes de l'est lyonnais
A46
Meyzieu
A43
péage de SaintQuentin-Fallavier
A42
péage de Dagneux
2002 2003 2004
Source : DRE
Les chiffres récoltés ne permettent pas de
retracer l'évolution de ces autoroutes avant 2002, ce qui
nécessite de ne pas donner trop d'importance aux résultats de
l'évolution constatée. Le trafic de l'A46 et de l'A43 tend
à augmenter alors que celui de l'A42 a plutôt tendance à
stagner, voire diminuer. L'axe qui supporte le trafic le plus dense est l'A46.
La proximité de Lyon et le transit Nord-Sud favorisent ce trafic
élevé. Le trafic de l'A43 est très proche de celui de
l'A46. Ils connaissent tous les deux la même progression et leur
valeur
actuelle est sensiblement la même. On ne peut cependant
pas dire que l'écoulement du trafic est identique car l'A46 est une 2*2
voies alors que l'A43 est une 2*4 voies. Le trafic est donc dense sur l'A46 et
plus fluide sur l'A43. L'importance du trafic sur l'A43, s'explique,
au-delà de la liaison avec les Alpes, par les flux de transports
nécessaires à l'activité économique le long du
tracé, notamment avec la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau. A l'inverse,
l'A42 est l'autoroute qui supporte le plus faible trafic. Si les conditions de
transit Est-Ouest sont améliorées, et ce par l'achèvement
de l'autoroute A89, le trafic de l'A42 pourrait augmenter.
1.3 : L'importance des flux Nord-Sud
Les flux les plus importants de l'aire métropolitaine
lyonnaise sont les flux Nord-Sud. L'autoroute A6 rentre dans Lyon par le tunnel
de Fourvière dont le trafic est présenté en figure 19.
Figure 19 : Evolution mensuelle du trafic moyen
journalier sous le tunnel de Fourvière de
1991 à
2004
|
Fourvière véhicules par jour
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
2003
|
2004
|
|
95 800
|
98 100
|
100 080
|
102 080
|
99 970
|
98 440
|
96 580
|
100 490
|
103 424
|
103 732
|
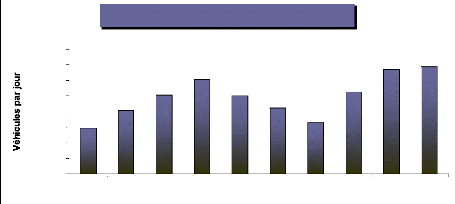
106 000
104 000
102 000
100 000
98 000
96 000
94 000
92 000
90 000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2003 2004
Evolution du trafic du tunnel de Fourvière -
A6
Source : DRE
Le tunnel de Fourvière est un secteur extrêmement
sensible dans la gestion des flux de transports de l'agglomération
lyonnaise. Son trafic est actuellement supérieur à 100 000
véhicules par jour. Depuis 1991, il subit un trafic qui
a crû de seulement 8,3 %. La croissance n'est pas aussi
régulière que sur les axes étudiés
précédemment. De 1991 à 1994, le trafic a augmenté
très rapidement puis a diminué symétriquement jusqu'en
1997. Cette fluctuation surprenante s'explique par réalisation en 1993
du contournement Est de Lyon. Après sa mise place, celui-ci a
attiré une partie du trafic transitant auparavant par le tunnel de
Fourvière (ce qui a fait baisser le trafic de ce dernier). Les
conditions de circulation sous le tunnel étant améliorées,
le trafic a augmenté de nouveau pour atteindre et dépasser les
valeurs de 1993. La hausse globale du trafic est faible car l'importance des
flux que peut supporter un axe routier ou autoroutier n'est pas extensible
à volonté. Le trafic du tunnel étant déjà
très important, celui-ci ne peut croître aussi rapidement que
celui sur un tronçon récent comme c'est le cas sur le barreau A89
Est.
Pour terminer l'analyse des trafics des autoroutes
liées à l'A89, nous allons observer le trafic de l'A6 en
direction du Nord et de Paris. Le point de comptage est localisé
à Dardilly, à moins de 5km de l'extrémité Est de
l'autoroute A89. Une partie des flux de l'A89 pourrait se reporter sur l'A6 via
l'échangeur de Limonest.
Figure 20 : Evolution du trafic à Limonest -
A6
|
A6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Limonest
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
Trafic
moyen
journalier
|
29 610
|
31 750
|
32 820
|
32 830
|
31 540
|
33 920
|
37 398
|
38 848
|
38 639
|
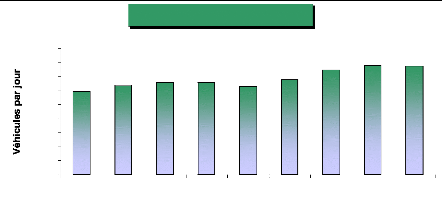
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004
Evolution du trafic à Limonest - A6
Sources : dossier d'enquête publique, DRE
Le trafic est croissant depuis 1993 sur l'A6 au niveau de
l'échangeur de Limonest. L'autoroute A6 supporte des flux en provenance
et en direction de Paris et du Nord de la France. Il ne s'agit pas ici de flux
traversant la France du Nord au Sud car ceux-ci empruntent plutôt le
contournement Est de Lyon (A46) pour éviter la traversée de Lyon.
Le trafic n'est pas très dense sur cette autoroute car il s'agit d'une
2*3voies. En effet, la capacité théorique d'une autoroute
à 2*3 voies est comprise entre 50 000 et 90 000 véhicules par
jour (Plassard, 2003, p.26). Le trafic sur l'A6 à Limonest
pourrait donc doubler tout en conservant une certaine fluidité. Le
passage par l'A6 des flux de l'A89 ne devrait donc pas poser de
problèmes de saturation sur l'A6.
Depuis 1991, les flux de transports autoroutiers de l'ouest
lyonnais et plus généralement, de l'aire métropolitaine
lyonnaise progres sent, ce qui traduit une hausse des mobilités. La
hausse des mobilités reflète l'attraction croissante de Lyon. Les
flux les plus importants sont les flux Nord-Sud. Ils contournent Lyon par
l'Est. Ils créent ainsi un très fort déséquilibre
entre les flux de transports dans l'est lyonnais et ceux de l'ouest lyonnais.
Ce déséquilibre est aussi la conséquence du nombre de
voies autoroutières à l'Est et à l'Ouest. Une seule voie
autoroutière permet d'accéder à Lyon par l'ouest alors
qu'on en compte 2, plus le contournement, à l'Est. L'A89 viendra
atténuer ce déficit autoroutier de l'ouest. Certains axes, tels
que l'A47 ou l'A6 sous le tunnel de Fourvière se trouvent
saturés, ce qui rend l'accessibilité à Lyon très
difficile, malgré la présence de nombreuses voies
autoroutières. Le nombre de voies autoroutières est
peut-être même l'une des causes de l'asphyxie lyonnaise
étant donné qu'elles favorisent et incitent les
déplacements.
2- La croissance du trafic local sur les routes nationales
2.1 : La RN7 : support des échanges entre Lyon et
Roanne
La RN7 est l'axe principal qui relie Roanne à Lyon en
passant par Tarare et l'Arbresle. L'A89 et la RN7 seront plus ou moins
parallèles à partir de Tarare. L'A89 s'achèvera à
LaTour-de-Salvagny, sur cette route nationale. L'étude de son trafic
permet de comprendre comment se répartissent les flux de transports
routiers de l'ouest lyonnais. Les figures 21, 22
et 23 représentent l'évolution et la
répartition du trafic moyen journalier de divers points de la RN7.
Figure 21 : Répartition et évolution
du trafic moyen journalier le long de la RN7
|
An née
|
Sud de Roanne
|
Saint-
Symphorien-
de-Lay
|
Ouest de
Tarare
|
Est de Tarare
|
Bully
(Ouest de
L'Arbresle)
|
La-Tour-
de-
Salvagny
|
Dardilly
|
|
1991
|
|
-
|
|
-
|
6
|
000
|
|
-
|
|
-
|
19
|
500
|
18
|
500
|
|
1992
|
|
-
|
|
-
|
6
|
000
|
|
-
|
|
-
|
19
|
900
|
16
|
800
|
|
1993
|
|
-
|
|
-
|
7
|
300
|
|
-
|
12
|
050
|
20
|
800
|
15
|
800
|
|
1994
|
|
-
|
|
-
|
8
|
700
|
|
-
|
12
|
000
|
21
|
780
|
16
|
100
|
|
1995
|
|
-
|
|
-
|
7
|
154
|
|
-
|
11
|
860
|
22
|
180
|
14
|
820
|
|
1996
|
|
-
|
|
-
|
7
|
543
|
21
|
030
|
13
|
660
|
22
|
780
|
14
|
830
|
|
1997
|
|
-
|
|
-
|
7
|
650
|
21
|
280
|
|
-
|
23
|
620
|
14
|
460
|
|
1998
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
21
|
280
|
|
-
|
24
|
910
|
14
|
270
|
|
2002
|
16
|
518
|
8
|
715
|
7
|
815
|
|
-
|
14
|
207
|
26
|
550
|
13
|
333
|
|
2003
|
16
|
522
|
8
|
798
|
7
|
777
|
22
|
036
|
13
|
021
|
26
|
842
|
13
|
143
|
|
2004
|
17
|
613
|
8
|
798
|
7
|
720
|
21
|
307
|
12
|
890
|
27
|
110
|
13
|
249
|
Sources : Dossier d'enquête publique, DRE
L'étude du trafic le long de la RN7 nous renseigne sur
plusieurs points.
Tout d'abord, on remarque que celui-ci est en constante
progression entre Roanne et La-Tour-de-Salvagny. De plus, il croît au fur
et à mesure que la route nationale se rapproche de Lyon. En effet, la
commune de Saint-Symphorien-de-Lay voit passer près de 8 800
véhicules par jour en 2004 alors que La-Tour-de-Salvagny en compte 27
110, soit trois fois plus. Le trafic s'intensifie à proximité de
Lyon.
Ensuite, le trafic est plus important à l'est des
villes que traverse la RN7 qu'à l'ouest. La figure 22 illustre bien ce
phénomène. L'ouest de Tarare (lieu-dit `Le Magnin') a un trafic
de 7 720 véhicules par jour alors que l'est en compte 21 307. De
même, la RN7 à l'ouest de l'Arbresle supporte un trafic de 12 890
véhicules par jour alors qu'à l'est en supporte 27 110. Ainsi,
l'est de Tarare et de l'Arbresle connaît un trafic deux fois plus grand
que l'ouest. Ce chiffre s'explique par le fait que ces deux communes sont
à l'intersection de routes départementales ou d'autres routes
nationales (à Tarare se rejoignent la D60, la D1 et la D8 et à
l'Arbresle se rejoignent la RN89 et la D485) dont le trafic vient s'accumuler
à celui de la RN7. Il révèle cependant que les flux de
transports sont attirés vers l'Est. Les flux de transports se
développant vers l'Est, on peut en déduire l'influence que Lyon
exerce sur
l'ouest lyonnais si l'on considère que
l'intensité du trafic laisse reflète l'intensité de
l'influence. De plus, la typologie des cantons (cf. figures 6 et 22) influe sur
l'importance des flux. Les flux sur la RN7 sont beaucoup plus importants dans
les cantons ouvriers et résidentiels que dans l'espace rural. Le poids
démographique des espaces traversés par la RN7 modifie fortement
la quantité des flux qu'elle écoule : les espaces ruraux supporte
des flux beaucoup moins élevés que les espaces urbains. La chute
du trafic au sud de Roanne en direction de Tarare s'explique par la bifurcation
sur la RN82 en direction de Balbigny et de l'A72.
Figure 22 : Schéma de répartition du
trafic le long de la RN7 de Roanne à Lyon
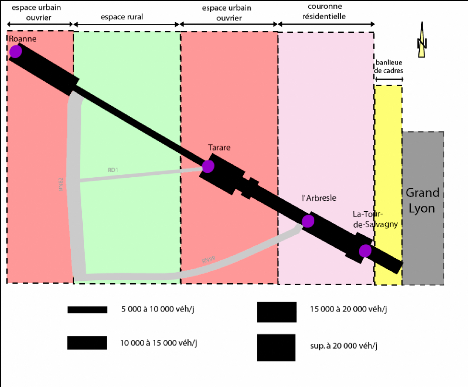
Source : DRE. Réalisation : Pailler.S (2007)
Enfin, les deux points de comptages les plus orientaux du
tracé présentent des évolutions inverses. Depuis 1991, le
trafic a augmenté de 39% sur la commune de La-Tourde-Salvagny alors que
durant la même période il a diminué de 28% à
Dardilly. Cette
différente s'explique par les caractéristiques
différentes de la RN7 à ces deux endroits. A LaTour-de-Salvagny,
la RN7 est une voie rapide à 2*2 voies alors qu'à Dardilly, il
s'agit d'une route à deux voies uniques. De plus, les usagers de la voie
rapide de La-Tour-de-Salvagny peuvent provenir ou aller en direction du Nord en
prenant la bifurcation au Nord de Dardilly vers l'A6 ou la RN6 ce qui
court-circuite la RN7 à Dardilly. L'achèvement de l'A89 à
LaTour-de-Salvagny apportera des véhicules sur une route nationale qui
supporte déjà un trafic très dense et croissant.
Figure 23 : Evolutions inverses du trafic de la RN7
sur deux points de comptages dans la
proche banlieue
lyonnaise
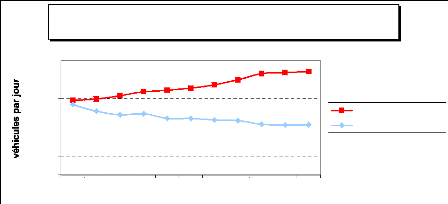
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Evolution du trafic de RN7 sur deux points de com
ptages dans la
proche banlieue lyonnaise
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004
La-Tour-de-Salvagny Dardilly
Sources : Dossier d'enquête publique, DRE
2.2 : La RN489 : liaison stratégique de la RN7
à la RN6
La RN489 est une section routière longue de deux
kilomètres qui relie la RN7 à la RN6 et l'A6. Elle est
bordée de terres cultivées et de forêts, il n'y a pas de
population résidant au bord de cette route. Les nuisances qu'elle
provoque sont donc essentiellement d'ordre écologique. Elle jouera un
rôle très important dans la liaison A89/A6 car elle supportera le
trafic entre ces deux autoroutes. Elle supporte actuellement un trafic de plus
de 20 000 véhicules par jour. L'A89 contribuera fortement à la
hausse du trafic de cette section, qui devra être aménagée
en conséquence. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution du
trafic de la RN489 entre 2003 et 2005. La RN489 gagne progressivement du trafic
depuis 2003.
Figure 24 : Evolution récente du trafic
à Dommartin - RN489
|
RN489
|
|
|
|
|
Dom martin
|
2003
|
2004
|
2005
|
|
Véhicules par jour
|
21 193
|
21 652
|
21 766
|
Source : DRE Rhône-Alpes
2.3 : Une légère baisse des flux de la RN89
qui relie l'agglomération lyonnaise à la plaine du Forez
La RN89 est la route nationale que longe l'A89 sur l'ensemble
de son tracé depuis Bordeaux. Elle traverse la plaine du Forez par
Boën et Feurs avant de rentrer dans le département du Rhône
par Sainte-Foy-l'Argentière puis l'Arbresle. Le point de comptage est
situé à l'entrée sud de la commune de l'Arbresle, à
Sain-Bel.
Figure 25 : Evolution annuelle du trafic de 1992
à 2004 sur la RN89 à Sain-Bel
|
RN89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sain-Bel
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
véhicules par jour
|
10940
|
11400
|
11400
|
10230
|
9720
|
9680
|
9770
|
9484
|
9638
|
9503
|
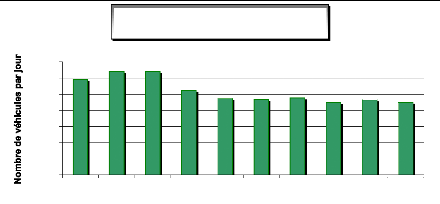
12 000
11 000
10 000
6 000
9 000
8 000
7 000
5 000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2004
Evolution du trafic de la RN89 à Sain-Bel
de
1992 à 2004
Source : DRE
Le trafic au Sud de l'Arbresle a diminué de 13% entre
1992 et 2004. Cette perte de trafic semble s'estomper aujourd'hui. La
comparaison avec le trafic à l'Est de l'Arbresle (27 100
véhicules par jour en 2004 et une progression du trafic d'environ 35%
sur la même
période) montre que les flux de transports routiers de
l'Arbresle, ainsi que le transit passant par l'Arbresle sont orientés
vers l'Est (Lyon) plutôt que vers le Sud-Ouest (Loire). La
présence d'un échangeur à l'Arbresle pourrait attirer des
flux en provenance de la plaine du Forez et de
Sainte-Foy-l'Argentière.
2.4 : La forte progression du trafic de la RN82 entre
Roanne et Balbigny
Le point de comptage est situé à Neulise, soit
10km au Sud de L'Hopital-sur-Rhins (intersection RN7/RN82). La RN82 supporte
ici les flux de transports entre Roanne et la plaine du Forez ou entre Roanne
et Saint-Etienne.
Figure 26 : Evolution annuelle du trafic de 1993
à 2004 de la RN82 à Neulise
|
Neulise
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
véhicules par jour
|
8 080
|
8 450
|
8 760
|
8 860
|
9 150
|
10 473
|
10 831
|
11 136
|
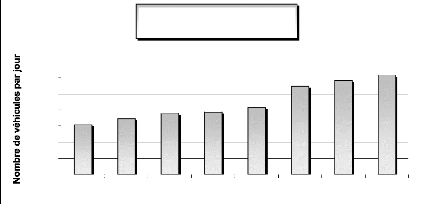
12 000
11 000
10 000
6 000
9 000
8 000
7 000
5 000
1993 1994 1995 1996 1997 2002 2003 2004
Evolution du trafic de la RN82
à Neulise de
1993 à 2004
Sources : dossier d'enquête publique, DRE
Le trafic de la RN82 à Neulise croît
progressivement depuis 1993. Il a progressé de 38%. L'A89 devrait
fortement modifier les flux circulant sur cet axe car il permettra notamment de
relier Roanne à Balbigny et donc à l'échangeur
ligérien de l'A89. Cette modification sera effective si les Roannais
empruntent l'échangeur de Balbigny pour accéder à l'A89.
Or, ceci n'est pas une évidence. Certes l'échangeur de Balbigny
est plus prêt de
Roanne (30km parcourus en 20 min) que l'est l'échangeur
de Tarare Ouest (40km parcourus en 36 minutes), mais il faut y ajouter la
distance et temps de parcours sur l'A89 pour effectuer le trajet Balbigny -
Tarare. Cette distance est d'environ 22km (Via Michelin). Si l'on
considère que l'usager emprunte l'autoroute à une vitesse moyenne
de 100km/h, il effectuera le parcours en 13 minutes. Ainsi, le parcours Roanne
- Tarare via Balbigny représenterait une distance d'environ 50km
effectués en près de 40 minutes : soit 10km de plus que le trajet
par la RN7 et quelques minutes de plus.
Mais ceci est sans prendre en considération la mise en
2*2 voies complète de la RN82. Actuellement, la RN82 est en 2*2 de voies
de Roanne à Neulise. Une fois les travaux achevés, la distance
sera sensiblement la même mais le temps de parcours sera réduit.
Ainsi, les travaux effectués (A89 et mise en 2*2 voies de la RN82)
permettront une contraction de l'espace-temps. Le passage par Balbigny, plus
long en kilomètres, mais plus rapide, serait plus agréable et
plus sûr que le passage par la RN7.
3- La saisonnalité des flux de transports routiers
dans l'ouest lyonnais
Les données utilisées pour cette analyse sont
mises en ligne sur le site de la Direction Départementale du
Rhône. Les comptages ont effectués en 2005. Ils auraient pu
être repris dans les études d'évolutions
réalisées précédemment mais la quantité des
comptages, et leur localisation ne permettaient pas une étude
exhaustive. De plus, il aurait été possible d'établir
l'évolution mensuelle du trafic de chaque sens de circulation. Cette
étude ne présentait pas un grand intérêt puisque sur
chaque section étudiée, les deux sens de circulation supportaient
à peu près le même trafic. On ne pouvait alors pas en
déduire une organisation particulière de l'espace. Les deux
cartes suivantes localisent les points de comptages sur les autoroutes A6 et
A47.

Figure 27 : Localisation du point de comptage sur
l'A6

Figure 28 : Localisation du point de comptage sur
l'A47
Source : DDE Rhône
3.1 : Les autoroutes A6 et A47 sont marquées par une
croissance estivale de leur trafic
Le tableau et les graphiques suivants montrent
l'évolution mensuelle du trafic sur deux axes autoroutiers
concernés par le projet A89. Il s'agit de l'A47 à l'ouest de
Givors et de l'A6 à Dardilly. Ces deux autoroutes connaissent la plus
forte intensité de leur trafic durant l'été. Elle sont des
autoroutes empruntées par les vacanciers pour se rendre vers ou revenir
de leur de villégiature. L'autre nom donné à l'A6 :
«l'Autoroute du Soleil » reflète la plus grande
fréquentation de cette autoroute durant le printemps et
l'été. On constate aussi que la fréquentation moyenne des
deux autoroutes n'est dépassée que pendant une moitié de
l'année. Le reste du temps, la fréquentation est
inférieure à la fréquentation moyenne. Comme nous venons
de le dire, la fréquentation la plus importante se concentre
l'été, hors durant cette période, le nombre de
déplacements domicile-travail diminue car les usagers habituels sont en
vacances. Rappelons que l'A6 peut supporter dans des conditions de
fluidité du trafic, environ
50 000 véhicules par jour. Hors, le mois où le
trafic mensuel est le plus important est Juillet avec 47 000 véhicules
par jour. L'infrastructure est donc adaptée à la circulation
estivale mais se retrouve surdimensionnée le reste de l'année
à Limonest. On ne peut en dire de même pour l'A47. Son trafic est
très important toute l'année et sa moyenne annuelle est
supérieure à sa capacité théorique. Le trafic que
l'A47 subit pendant l'été ne fait qu'ajouter des véhicules
sur un axe déjà saturé. L'A89 pourrait délester une
partie du trafic estival de transit de l'A47 et ainsi améliorer la
fluidité de la circulation de cet axe surchargé.
Figure 29 : Evolution mensuelle du trafic de l'A6
et de l'A47
|
Janv.
|
Fév.
|
Mars
|
Avr.
|
Mai
|
Juin
|
Juil.
|
Août
|
Sept.
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
M.J.A
|
|
A6-
Dardilly-
Porte de
Lyon
|
30
|
999
|
33
|
765
|
34
|
635
|
38
|
386
|
40
|
138
|
38
|
916
|
47
|
824
|
44
|
643
|
36
|
356
|
35
|
487
|
33
|
414
|
35
|
739
|
37
|
525
|
|
A47- Givors Ouest
|
54
|
017
|
57
|
102
|
58
|
325
|
59
|
531
|
59
|
928
|
62
|
421
|
62
|
375
|
58
|
312
|
56
|
944
|
57
|
506
|
56
|
319
|
55
|
639
|
58
|
202
|
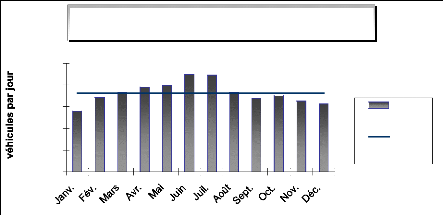
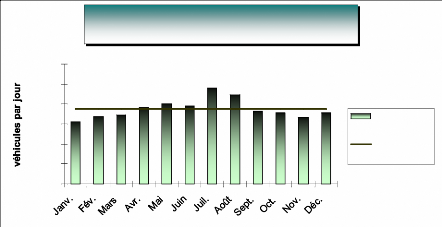
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Evolution mensuelle du trafic sur l'A6 à
Dardilly
en 2005
A6- Dardilly- Porte de Lyon
M.J.A
Source : DDE 69. Réalisation : Pailler.S
(2007)
3.2 : Une diminution estivale des flux dans la banlieue
résidentielle de Lyon
Nous allons observer l'évolution mensuelle des flux de
transports à La-Tour-deSalvagny et à Sain-Bel, au sud de
l'Arbresle. Les deux points d'observation se situent dans des espaces où
résident des actifs du Grand-Lyon (cf. figure 6). Nous sommes donc sur
des axes où les flux domicile-travail sont nombreux.
Sur la RN7 et la RN89, l'écart à la moyenne du
trafic annuel de chaque mois est plutôt faible. Le trafic des deux routes
nationales se répartit de manière plus ou moins homogène
tout au long de l'année. Toutefois, on constate une diminution des flux
sur la RN89 et la RN7 durant l'été. Nous avons là un effet
de saisonnalité inverse de celui constaté sur les autoroutes A6
et A7. Pendant l'été, de nombreux actifs (qui circulent sur ces
axes le reste de l'année pour se rendre à leur travail) partent
en vacances. Le nombre de déplacements domicile-travail diminue, ce qui
diminue le nombre total de déplacements. Il y a donc une
corrélation entre le nombre de flux et les caractéristiques
socio-démographiques des communes concernées. Ce
phénomène de baisse estival des flux est classique dans toutes
les communes résidentielles (C. Jamot, réunion Observatoire
A89, 2007). Nous apporterons un élément de réponse
à la progression hivernale des flux à Sain-Bel en étudiant
l'évolution mensuelle des flux à Tarare.
Figure 30 : Evolution mensuelle du trafic dans la
banlieue résidentielle de Lyon
|
Janv.
|
Fév.
|
Mars
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sept
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc.
|
Moyenne annuelle
|
|
RN7 La-Tour-de-
|
25 805
|
25
730
|
27 213
|
27 212
|
28 063
|
31 276
|
27 351
|
23 230
|
28 383
|
27
|
888
|
27
326
|
27 128
|
27 217
|
|
Salvagny
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RN89
Saint-Bel
|
8 703
|
8 792
|
9 398
|
9
772
|
9 950
|
10
146
|
9 791
|
8 843
|
10
210
|
11
|
661
|
9 997
|
10
430
|
9 808
|

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
M.J.A
10 000
5 000
0
Evolution du trafic mensuel de la RN7 à
La-tour-de-Salvagny
en 2005
RN7 La-Tour-deSalvagny
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Evolution du trafic mensuel de la RN89 à
Sain-Bel en 2005
RN89 Saint-Bel
M.J.A
Source : DDE 69. Réalisation : Pailler.S
(2007)
3.3 : La saisonnalité de la RN7 à l'ouest de
Tarare
Le point de comptage est situé au lieu-dit « Le
Magnin », à l'ouest de Tarare.
Figure 31 : Evolution mensuelle du trafic sur la RN7
et la RN89
|
Janv.
|
Fé v.
|
Mars
|
Avr
|
Mai
|
Juin
|
Jui l
|
Aoû t
|
Sept
|
Oct.
|
Nov.
|
Dé c.
|
Moyenne annuelle
|
|
RN7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarare Ouest
|
6 547
|
6 739
|
7 194
|
7 510
|
7 761
|
7 602
|
8 283
|
7 525
|
7
755
|
7 620
|
7 117
|
6 779
|
7 369
|
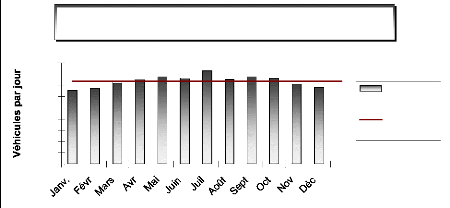
4 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
3 000
2 000
1 000
0
Evolution du trafic mensuel de la RN7 à l'Ouest
de Tarare en
2005
RN7 Tarare
Ouest M.J.A
Source : DDE 69. Réalisation : Pailler.S
(2007)
Les flux de transports de Tarare sont supérieurs
à la moyenne annuelle de Mai à Octobre. Le relief des Mont du
Tararois soumet, en hiver, la circulation aux intempéries (neige,
brouillard) et à la formation de congères sur les routes, ce qui
ne favorise pas les déplacements. Par ailleurs, la progression du trafic
à Sain-Bel constatée durant l'hiver peut s'expliquer par le
contournement des Monts du Tararois par le Sud et la RN89.
A l'inverse des deux points de comptages
précédents, les flux atteignent leur nombre maximum pendant
l'été, en Juillet plus précisément. Les loisirs et
le tourisme dans les Monts du Tararois peuvent expliquer cette progression du
trafic estival. Cette pointe est quand même beaucoup moins marquée
que celles des autoroutes. La RN7, hors de l'aire métropolitaine
lyonnaise, permet d'écouler les flux à vocation
touristiques locaux et régionaux, mais ne constitue pas un axe
préférentiel de transit.
4- L'importance de la circulation des poids lourds
Les chiffres que nous venons de citer correspondent au nombre
total de véhicules circulant sur les axes étudiés. Nous
allons maintenant nous intéresser plus précisément au
trafic des poids lourds. Celui-ci reflète le dynamisme des
échanges et les conditions de circulation sur les axes de circulation.
L'étude du trafic en 2004 permettra de voir, après la mise en
place de l'A89, si celle-ci provoque des modifications dans l'organisation des
flux de transports, et notamment dans le choix des itinéraires. La
possible création d'entreprises le long du tracé peut aussi
générer un apport de flux.
Les données récoltées ne permettent pas
d'étudier les trafics sur la RN82 et la RN89 dans le département
de la Loire. En revanche, les axes directement en concurrence avec l'A89, la
RN7 et l'A72 pourront être observés. L'absence de données
concerne des axes dont la fréquentation par les poids lourds est la
moins importante de l'ouest lyonnais.
La figure 32 présente la répartition du trafic
de poids lourds de l'agglomération lyonnaise et de l'ouest lyonnais. La
part des poids lourds dans le trafic total varie énormément selon
les axes. Elle peut en effet varier de moins de 5% à plus de 20%. Les
axes poids lourds représentent en moyenne 13% des flux sur les axes
autoroutiers. Le nombre de poids lourds supportés par les
différents axes varie de moins de 1 000 véhicules par jour
à plus de 15 000. Malgré cette
hétérogénéité, l'étude de la
circulation des poids lourds permet de dégager les grands
itinéraires empruntés.
Les RN 7 et 89 ne peuvent pas supporter le même trafic
de poids lourds que peuvent le faire les autoroutes. Par conséquent, ce
sont elles qui connaissent la plus faible circulation de poids lourds. La
liaison Tarare - l'Arbresle constitue la section de la RN7 sur laquelle le
nombre de poids lourds est le plus important. Les échanges sont plus
dynamiques entre ces deux pôles de l'ouest lyonnais que sur les autres
sections.
L'autoroute qui sert actuellement de liaison entre
Clermont-Ferrand et Lyon (A72 + A47) a une proportion de poids lourds plus ou
moins équivalente sur l'ensemble de son tracé dans les
départements de la Loire et du Rhône. Le trafic est à quant
à lui de plus en plus élevé à mesure que
l'agglomération lyonnaise est proche. En 2004, moins de 2 000 poids
lourds circulent sur l'A72 au Nord de Balbigny alors que 7 600 camions
empruntent l'A47 à Givors.
Ainsi, le nombre de poids lourds augmente sur l'ensemble du
tracé mais, étant donné que le trafic de véhicules
légers augmente lui aussi, la part des poids lourds est constante.
Sur l'actuel barreau de l'A89, de Nervieux à Balbigny,
très peu de poids lourds circulent. L'A89 débouche sur la RN82
(Balbigny, Roanne). Le nombre de poids lourds est faible mais leur part dans la
circulation totale est de plus de 25%. La fréquentation du barreau
existant de l'A89 reflète une activité économique qui
attire et provoque des flux de marchandises. La mise en place de l'A89 pourrait
accroître le nombre de véhicules, et donc, augmenter le nombre de
poids lourds sur cette section. La part des poids lourds au sud de Roanne est
elle aussi forte, près de 20%. Les échanges de marchandises sont
importants entre la plaine du Forez et Roanne et entre Roanne et le
département du Rhône.
Le trafic Nord-Sud se fait essentiellement par le
contournement Est de Lyon. Ainsi, la part des poids lourds au coeur de
l'agglomération lyonnaise est inférieure à 10%,
excepté le passage du tunnel de Fourvière où elle est plus
élevée. C'est sur les voies pénétrant dans Lyon,
RN7 et A43 intérieure, que la part des poids lourds est la moins
importante et leur nombre y est réduit. La municipalité lyonnaise
contrôle l'accès des poids lourds à la ville. A l'inverse,
au Nord et au Sud, le nombre de poids lourds peut s'élever à plus
de 15 000 véhicules par jour et représenter plus de 20% du trafic
total. Les flux de marchandises de transit Nord - Sud contournent donc Lyon par
l'Est.
L'ouest lyonnais ne connaît pas un trafic de poids
lourds élevé. Il constitue essentiellement la desserte des zones
d'activités locales. A l'inverse, le trafic est très dense
à l'est. L'agglomération lyonnaise attire les flux de transports
mais souhaite aussi les repousser en périphérie. L'arrivée
de l'A89 sur la RN7, engendrerait un apport de flux de marchandises, sur un axe
préservé qui connaît actuellement moins de 5% de poids
lourds. La ville de Lyon, dont le trafic est saturé, ne peut donc pas
accueillir des véhicules supplémentaires, qu'ils soient
légers ou lourds. Selon Michel Mercier, président du Conseil
Général du Rhône, « l'A89 n'a rien à faire dans
Lyon » (Le Pays, 03/03/06). Nous verrons par la suite les
alternatives à l'arrivée de l'A89 à
La-Tour-de-Salvagny.
Figure 32 : Répartition du trafic de poids
lourds en 2004
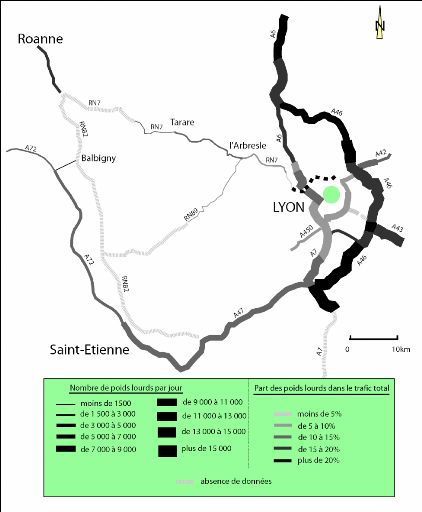
Source : DRE Rhône-Alpes. Réalisation :
Pailler.S. (2007)
5- Bilan du trafic routier et autoroutier de l'Ouest
lyonnais
Nous venons d'observer en détails la répartition
et l'évolution des flux de transports dans l'ouest lyonnais. La carte
ci-dessous permet de se donner une « image » des flux de transports
dans l'ouest lyonnais en 2004.
Figure 33 : Répartition du trafic routier et
autoroutier de l'ouest lyonnais en 2004
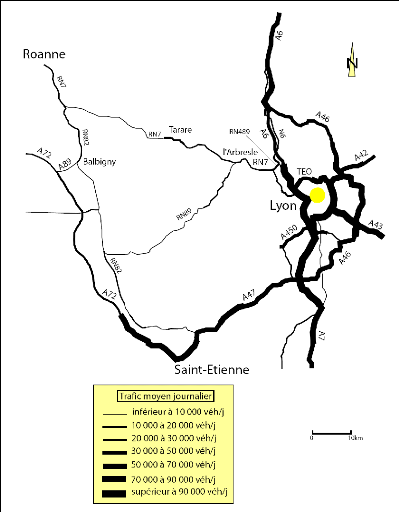
Source : DRE Rhône-Alpes. Réalisation :
Pailler.S. (2007)
Les principales caractéristiques des flux de transports
routiers de l'ouest lyonnais :
- Fort déséquilibre entre la quantité et
la qualité des axes routiers de l'ouest lyonnais et de l'est lyonnais.
Ce déséquilibre se traduit par un trafic beaucoup plus
élevé à l'est qu'à l'ouest. L'A89 viendra densifier
et peut-être dynamiser le réseau routier de l'ouest lyonnais
- Le trafic est globalement croissant depuis 1991. Il est
décroissant sur la RN7 à l'entrée ouest de Lyon.
- Les flux de transit Nord/Sud sont plus importants que les flux
Est/Ouest et contournent Lyon par l'Est (A46).
- Le réseau routier et autoroutier de Lyon et sa
périphérie supporte un fort trafic estival, ce qui conforte la
position de carrefour routier de Lyon.
- L'A89 pourrait récupérer une partie du trafic de
transit de l'A47 et ainsi la délester de quelques véhicules.
II- Le transport ferroviaire, un mode concurrent
du transport routier
L'étude des flux de voyageurs ferroviaires permettra
d'établir une comparaison entre les caractéristiques des flux
routiers et des flux ferroviaires. Elle se base sur les chiffres de 2006 du
Conseil Régional de Rhône-Alpes. Les données
collectées sont des tableaux retranscrivant le nombre de voyageurs sur
différentes sections ferrées de l'Ouest lyonnais ainsi que la
fréquentation des gares. Les chiffres sont établis à
partir des ventes enregistrées par la SNCF. Ils concernent uniquement
des voyages directs et excluent les correspondances en provenance d'un autre
train. Les trois axes observés sont Saint-Etienne - Lyon, Roanne -
Saint-Etienne et enfin, Roanne - Lyon. Il s'agit des lignes principales de
l'Ouest lyonnais, sur lesquelles l'A89 aura une plus ou moins grande influence.
La figure ci-dessous présente la desserte ferroviaire des axes majeurs
de la région Rhône-Alpes. Seuls les trains assurant cette desserte
sont comptabilisés.
Figure 34 : Desserte ferroviaire des grandes liaisons
inter-cités de Rhône-Alpes en 2005
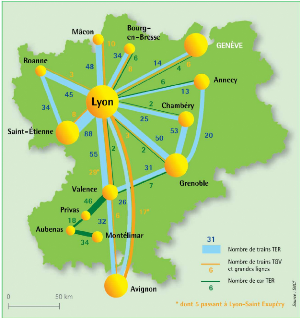
Cette carte présente la structure en étoile du
réseau ferroviaire de la région Rhône-Alpes à partir
de Lyon. Toutes les villes moyennes sont reliées directement à
leur préfecture de région. Les liaisons qui nous
intéressent forment le triangle Roanne - Lyon - Saint-Etienne. L'axe
Saint-Etienne - Lyon est celui le mieux desservi de toute la région (88
trains TER par jour). La liaison Roanne - Lyon est deux fois moins
dotée, seulement 45 trains circulent quotidiennement sur cet axe.
Enfin,la liaison Roanne - Saint-Etienne compte 34 trains soit le même
nombre qu'entre Lyon et Bourg-en-Bresse. L'offre de transport correspond
à une forte demande et les flux de l'ouest lyonnais sont parmi les plus
importants de la région RhôneAlpes.
1- L'axe Saint-Etienne - Lyon : un axe majeur
Cette liaison n'est pas vraiment concernée par le
projet A89. Cependant, elle se situe à l'ouest de Lyon et offre une
vision intéressante des échanges entre Saint-Etienne et Lyon. Ces
échanges reflètent l'aire d'influence de chacune des deux
métropoles.
Figure 35 : Nombre de voyageurs sur l'axe
Saint-Etienne - Lyon en 2006
|
Origine
|
Destination
|
Voyages/jour
2006
|
Evolution 2006/2005
|
|
ST ETIENNE
|
LYON
|
5 900
|
2,80%
|
|
ST
CHAMOND
|
LYON
|
1 700
|
10,70%
|
|
RIVE DE
GIER
|
LYON
|
1 700
|
12,40%
|
|
GIVORS VILLE
|
LYON
|
2 900
|
11,60%
|
|
ST
CHAMOND
|
ST ETIENNE
|
900
|
17,70%
|
|
RIVE DE
GIER
|
ST ETIENNE
|
750
|
-5,00%
|
|
GIVORS VILLE
|
ST ETIENNE
|
450
|
7,20%
|
Source : Région Rhône-Alpes
Sur l'axe Saint-Etienne - Lyon, les flux les plus importants
sont ceux qui correspondent aux voyages de Saint-Etienne vers Lyon (5900
voyages par jour). A eux seuls, ils représentent 41% des flux de l'axe
Saint-Etienne - Lyon, et deux fois plus que la seconde
section la plus importante (Givors - Lyon). Les flux sont deux
fois plus importants en direction de Lyon qu'en direction de Saint-Etienne sur
l'ensemble du tracé. En effet, les axes Saint-Chamond - Lyon ou de
Rive-de-Gier - Lyon comptent chacun 1700 voyages par jour alors que les axes
Saint-Chamond - Saint-Etienne et Rive-de-Gier - Saint-Etienne n'en comptent
respectivement que 900 et 750. De même, sur l'axe Saint-Etienne - Lyon,
cinq voyageurs sur six au départ de Givors se rendent à Lyon,
contre seulement un pour Saint-Etienne.
Si la liaison Saint-Etienne - Lyon est celle qui supporte le
plus gros trafic, c'est elle qui connaît l'évolution la moins
prononcée, seulement 2,8% d'augmentation entre 2005 et 2006. Les flux
orientés vers Lyon et ayant pour origine Saint-Chamond, Rive-de-Gier ou
Givors ont une progression quasi-similaire. Toutefois, l'augmentation du nombre
de voyageurs en valeur absolue est plus importante entre Givors et Lyon car le
trafic y est 1,7 fois plus important que sur les deux autres sections. Les flux
de transports ferroviaires entre Givors et Lyon illustrent l'influence qu'a
Lyon sur Givors. L'intégration récente de Givors à
l'agglomération du Grand-Lyon est l'une des explications à cette
hausse des échanges.
A l'inverse, les flux au départ de ces mêmes
gares, et orientés vers Saint-Etienne connaissent des évolutions
hétérogènes : le trafic de l'axe Saint-Chamond -
Saint-Etienne progresse de plus de 17% alors que celui de l'axe Rive-de-Gier -
Saint-Etienne régresse de 5%. Le fait que les flux entre Givors et
Saint-Etienne augmentent de 7,2% ne permet pas de dire que la limite de l'aire
d'influence de Saint-Etienne s'arrête entre Saint-Chamond et Rivede-Gier.
La légère baisse subie entre Rive-de-Gier et sa préfecture
semble plutôt être la conséquence des nuisances
générées par les travaux de rénovation de la gare
de Rive-de-Gier. En direction de Saint-Etienne, les voyageurs empruntant le
train à Rive-de-Gier, et vivant entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond ont
peut-être préféré prendre le train à
Saint-Chamond (ce qui pourrait expliquer la forte croissance des flux entre
Saint-Chamond et Saint-Etienne).
L'analyse de l'axe ferroviaire Saint-Etienne - Lyon indique
l'aire d'influence des métropoles stéphanoise et lyonnaise. Le
poids démographique et économique de Lyon attire deux fois plus
de voyageurs que Saint-Etienne. Givors est très sensiblement
orientée vers Lyon et fait même désormais partie de
l'agglomération lyonnaise. Si deux fois plus de voyageurs se rendent de
Saint-Chamond à Lyon plutôt qu'à Saint-Etienne ne signifie
pas que Saint-Chamond est plus influencée par Lyon que Saint-Etienne. Il
s'agit simplement du fait que les voyageurs entre Saint-Chamond et
Saint-Etienne préfèrent utiliser leur véhicule personnel
plutôt que le train, en raison de la proximité des deux villes.
L'influence de Saint-
Etienne décroît progressivement en direction de Lyon
alors que l'influence de Lyon tend à s'accroître vers l'Ouest, et
donc vers Saint-Etienne.
2- L'axe Roanne - Saint-Etienne : de faibles
échanges
Un voyageur souhaitant se rendre de Balbigny à Lyon par
le train sera contraint de passer par Saint-Etienne. En effet, il n'existe pas
de liaison directe entre Balbigny et Lyon. De même, il ne pourra se
rendre directement à Tarare, il devra prendre la direction de Roanne,
puis Tarare. Ainsi, l'axe Roanne - Saint-Etienne supporte aussi un trafic de
voyageurs se rendant dans le Rhône. Le tableau ci-dessous décrit,
section par section, le trafic de l'axe Roanne - Saint-Etienne.
Figure 36 : Nombre de voyageurs sur l'axe Roanne -
Saint-Etienne en 2006
|
Origine
|
Destination
|
Voyages/jour
2006
|
Evolution 2006/2005
|
|
ST ETIENNE
|
ROANNE
|
502
|
12,60%
|
|
ST ETIENNE
|
FEURS
|
531
|
15,50%
|
|
ST ETIENNE
|
ST GALMIER
VEAUCHE
|
445
|
22,60%
|
|
ST ETIENNE
|
MONTROND LES BAINS
|
327
|
7%
|
|
ROANNE
|
BALBIGNY
|
232
|
15,80%
|
|
ST ETIENNE
|
BALBIGNY
|
205
|
7,90%
|
|
ST ETIENNE
|
LE COTEAU
|
176
|
-8%
|
|
ROANNE
|
FEURS
|
144
|
8,40%
|
Source : Région Rhône-A lpes
Chaque jour, environ 500 personnes effectuent le trajet entre
Saint-Etienne et Roanne par le TER. Cette liaison constitue la deuxième
liaison le plus importante de l'axe Saint-Etienne - Roanne. Cette position est
à relativiser avec la taille des villes. En effet, les échanges
entre la préfecture de la Loire et sa sous-préfecture sont
légèrement plus élevés que les échanges
entre cette même préfecture et une ville de 8100 habitants,
Veauche (Recensement 1999). Cette faiblesse relative des échanges
s'explique par l'éloignement entre Saint-Etienne et Roanne (environ
85km).
Les voyages entre Saint-Etienne et la plaine du Forez (Feurs,
Veauche, Montrond-lesBains) sont les plus importants. Ce sont aussi eux qui
connaissent la plus forte évolution entre 2005 et 2006. La
périurbanisation au Nord de Saint-Etienne, dans la plaine du Forez est
l'une des raisons de ces nombreux échanges.
Les trajets entre Roanne et Balbigny et entre Saint-Etienne et
Balbigny seront les directement concernés par la mise en place de l'A89.
En effet, le projet de l'A89 suscite une vive ébullition
économique à Balbigny et si l'implantation d'un échangeur
est bien accompagnée par les collectivités locales, Balbigny
pourrait voir s'implanter de nouvelles entreprises. Les zones
d'activités de Balbigny et de ses alentours attirent actuellement plus
de deux cents personnes, que ce soit de Roanne ou de Saint-Etienne. Entre 2005
et 2006, les voyageurs effectuant le trajet entre Roanne et Balbigny ont
augmenté de 15,8%, soit deux fois plus qu'en provenance de Saint-Etienne
(7,9%). Cette augmentation reflète l'attirance qu'exerce Balbigny sur la
sous-préfecture ligérienne, et la perte d'emploi que cette
dernière connaît. Si Balbigny parvient à finaliser ses
projets de zones d'activités en lien avec l'A89, les voyages en
direction de Balbigny pourraient continuer leur progression.
3- L'axe Roanne - Lyon : un concurrent de la future A89
La dernière liaison que nous allons étudier est
l'axe Roanne - Lyon. Entre Tarare et Lyon, il sera doublé entre Tarare
et Lyon par l'A89. Le tableau ci-dessous présente les trafics des
différentes sections de la ligne Roanne - Lyon.
Figure 37: Nombre de voyageurs sur l'axe Roanne -
Lyon en 2006
|
Origine
|
Destination
|
Voyages/jour
2006
|
Evolution 2006/2005
|
|
LYON
|
ROANNE
|
1 578
|
6%
|
|
LYON
|
TARARE
|
885
|
17%
|
|
LYON
|
L'ARBRESLE
|
862
|
17%
|
|
ROANNE
|
TARARE
|
132
|
5%
|
Source : Région Rhône-A lpes
Le trajet Lyon - Roanne est celui qui compte le plus grand nombre
de voyageurs (1578 voyages par jour). L'évolution de son trafic est
faible. Les liaisons entre Lyon et
Tarare, et entre Lyon et l'Arbresle comptent plus ou moins le
même nombre de voyages, respectivement 885 et 862. Elles ont aussi la
même augmentation entre 2005 et 2006 : 17%. L'influence de Lyon sur ces
deux sections, est donc identique. A l'inverse, Roanne a une influence moindre
sur Tarare. En effet, la liaison Roanne - Tarare ne compte que 132 voyages par
jour, soit près de sept fois moins que la liaison Lyon - Tarare, et ce,
malgré un temps de parcours inférieur de 10 minutes à
celui de Tarare - Lyon (source SNCF). La route concurrence le rail sur cette
section. Par ailleurs, l'évolution de cette ligne est quasiment la
même que celle qui relie Roanne à Lyon.
Pour résumer les flux de ces trois axes, nous pouvons
observer la figure 38. Elle présente la fréquentation des lignes
ferroviaires de l'ouest lyonnais en fonction de l'origine et de la destination
des trajets. Le sens des flux correspond à celui précisé
dans les tableaux précédents. On constate la forte domination des
flux Saint-Etienne - Lyon et les disparités dans la desserte de l'ouest
lyonnais. Les échanges entre Saint-Etienne et Lyon sont les flux
nombreux de tout l'ouest lyonnais. Les échanges entre Saint-Etienne et
Lyon et entre Roanne et Lyon sont les plus importants sur leur ligne
respective. En revanche, sur l'axe Roanne - Saint-Etienne, les échanges
entre Saint-Etienne et Feurs sont plus nombreux qu'entre Saint-Etienne et
Roanne. Cela traduit la faiblesse des liens en Saint-Etienne et sa
sous-préfecture, notamment en raison de la distance qui les
sépare. La distance est un facteur majeur de préférence
pour le train. En effet, il est très utilisé pour effectuer des
trajets d'une distance supérieure à 50km. Nous verrons par la
suite que c'est essentiellement le coût du transport qui motive ce
choix.
Figure 38 : Schéma simplifié de la
répartition des flux de transports ferroviaires quotidiens
du
triangle Lyon - Saint-Etienne - Roanne en fonction de l'origine et de la
destination des
trajets en 2006
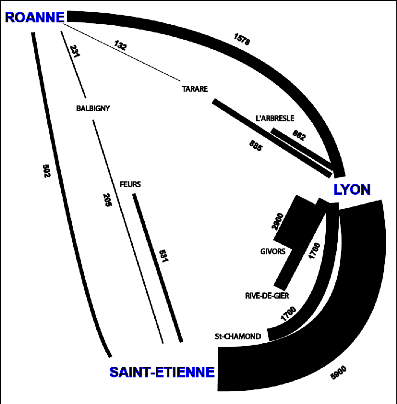
Source : Région Rhône-A lpes.
Réalisation : Pailler.S (2007)
4- La fréquentation croissante des gares de l'ouest
lyonnais
Désormais, intéressons nous à la
fréquentation des gares. Le tableau et le graphique cidessous
présentent l'évolution de la fréquentation des gares de
l'Ouest lyonnais depuis 1997. La gare de Saint-Etienne Chateaucreux ne figure
pas sur le graphique car sa fréquentation très
élevée ne permet pas une lecture précise de la
fréquentation des autres gares. Les valeurs correspondent au nombre de
total de voyageurs, au départ ou l'arrivée de chaque gare.
Figure 39 : Fréquentation des gares de
l'ouest lyonnais de 1997 à 2006
|
GARE
(ORIGINE +
DESTINATION)
|
BALBIGNY
|
FEURS
|
ROANNE
|
SAINT-
ETIENNE
|
L'ARBRESLE
|
TARARE
|
|
1997
|
78 154
|
153 131
|
600 047
|
1 852 854
|
398 370
|
200 509
|
|
1998
|
82 614
|
155 152
|
607 916
|
1 924 352
|
442 210
|
206 973
|
|
1999
|
90 715
|
167 535
|
635 033
|
1 988 055
|
460 792
|
218 397
|
|
2000
|
93 617
|
165 364
|
645 550
|
2 128 849
|
494 388
|
234 328
|
|
2001
|
103 150
|
167 326
|
639 523
|
2 157 938
|
493 392
|
230 364
|
|
2002
|
106 879
|
165 563
|
660 867
|
2 241 654
|
498 745
|
244 014
|
|
2003
|
105 446
|
158 335
|
661 211
|
2 212 020
|
532 870
|
267 582
|
|
2004
|
112 780
|
153 634
|
710 990
|
2 408 358
|
545 792
|
294 138
|
|
2005
|
118 580
|
165 667
|
754 507
|
2 659 403
|
569 075
|
313 388
|
|
2006
|
127 460
|
188 621
|
797 213
|
2 688 847
|
610 385
|
353 385
|
|
Evolution 1997-2006
|
63,1%
|
23,2%
|
32,9%
|
45,1%
|
53,2%
|
76,2%
|
Source : Région Rhône-A lpes
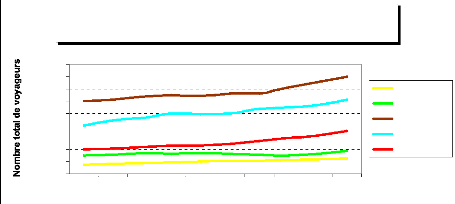
400 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
300 000
200 000
100 000
0
Evolution de la fréquentation des gares de
l'Ouest lyonnais de
1997 à 2006
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
BALBIGNY FEURS ROANNE L'ARBRESLE TARARE
Source : Région Rhône-A lpes
La gare de Saint-Etienne-Chateaucreux est la gare qui
connaît le plus grand trafic. Cette domination est simplement due
à l'importance de la préfecture de la Loire. Le second pôle
ligérien est Roanne qui compte trois fois moins de voyageurs que la gare
de Saint-Etienne. La différence de fréquentation des deux gares
s'explique, entre autres, par le poids démographique des deux villes et
par l'absence du TGV à Roanne. Ensuite, viennent les deux gares du
Rhône : l'Arbresle et Tarare. La gare de Tarare connaît cependant
une fréquentation environ deux fois moins importante (353 000 voyageurs)
que celle de l'Arbresle (610 000 voyageurs). Enfin, les deux gares de la plaine
du Forez, Balbigny et Feurs sont les moins fréquentées. La
fréquentation des gares de l'ouest lyonnais semble être
corrélée à la proximité d'un pôle urbain ou
à la présence de la gare au sein d'un pôle urbain.
L'ensemble des gares voit son trafic augmenter depuis 1997,
même si la progression a ralenti de 2000 à 2003. On assiste
quasiment à un doublement du nombre total de voyageurs en 10 ans. Les
trois gares directement concernées par le projet A89 (les gares des
communes traversées par l'autoroute) sont les trois gares qui
connaissent la plus forte progression de leur fréquentation (progression
moyenne : 65%). Balbigny est une commune dont le dynamisme est récent.
Les zones d'activités dont elle dispose, et la proximité de
Roanne et Saint-Etienne sont à l'origine de cette progression du trafic
ferroviaire. Pour les communes de Tarare et surtout de l'Arbresle, les
échanges avec la métropole lyonnaise sont la principale source de
la hausse du trafic, l'Arbresle étant une couronne résidentielle
de la métropole lyonnaise.
5- Les échanges entre Lyon et les deux plus grandes
agglomérations du tracé de l'A89 (Bordeaux et Clermont-Ferrand)
décroissent vers l'ouest
Les liaisons TER Lyon - Clermont-Ferrand et Lyon - Bordeaux
sont des liaisons fortement concernées par le projet A89. En mai 2007,
seulement quatre trains CORAIL circulent dans les deux sens entre Bordeaux et
Lyon sur un tracé plus ou moins parallèle à celui de
l'A89. Il n'existe pas de liaison TGV entre ces deux villes. Pourtant, elles
sont reliées quotidiennement par une vingtaine de TGV (2 sens), dont la
moitié passe par Paris. Les temps de parcours en train CORAIL varient de
7h20 à 10h47 (voyages-sncf). Le TGV est plus rapide, il permet un temps
moyen de parcours d'environ 6h. Mais le TGV n'est pas en concurrence avec
l'A89, seul les trains CORAIL le sont.
De même, la liaison Clermont-Ferrand - Lyon ne
bénéficie pas du passage du TGV, elle se trouve sur la ligne
Bordeaux - Lyon. Actuellement 20 trains TER circulent directement entre les
deux villes et 8 nécessitent des correspondances à
Saint-Germain-des-Fossés ou Saint-Etienne-Chateaucreux. La durée
du voyage varie de 2h23 à 2h56 (voyages-sncf). Le tableau ci-dessous
présente la répartition des voyageurs sur l'axe Bordeaux - Lyon
en fonction de la gare d'origine et celle de destination en 1999.
Figure 40 : Matrice des principales
origines/destinations de la liaison Bordeaux - Lyon
Trafic moyen journalier
- double sens - 1999
754
Destination Origine
|
Roanne
|
Lyon
|
TOTAL
|
|
Bordeaux
|
21
|
153
|
174
|
|
Périgueux
|
3
|
32
|
35
|
|
Brive
|
2
|
12
|
14
|
|
Tulle - Ussel
|
2
|
11
|
13
|
|
Limoges
|
8
|
46
|
54
|
|
Guéret
|
-
|
16
|
16
|
|
Montluçon
|
-
|
48
|
48
|
|
Clermont-
Ferrand
|
120
|
280
|
400
|
|
TOTAL
|
156
|
598
|
|
Source : Dossier d'enquête publique
La liaison Clermont-Ferrand - Lyon est celle qui, en 1999,
intéresse le plus grand nombre de voyageurs (280 passagers), soit
près du double du trafic de voyageurs entre Bordeaux et Lyon (153
passagers). Les relations entre Clermont-Ferrand et l'ouest lyonnais (Lyon y
compris) représentent plus de la moitié du trafic total. La mise
en service de l'A89 de Balbigny à La-Tour-de-Salvagny pourrait capter
une partie des flux de l'axe ferroviaire Clermont-Ferrand - Lyon en
améliorant le temps de parcours entre les deux préfectures de
région. Les gares situées à l'ouest de Clermont-Ferrand ne
fournissent qu'un faible nombre de passagers. La liaison Clermont-Ferrand -
Roanne représente un trafic de 120 voyageurs par jour, soit plus de la
moitié de la liaison Clermont-Ferrand - Lyon. Mais si l'on compare la
taille de l'agglomération lyonnaise à celle de Roanne, on peut
affirmer que les liaisons entre
Roanne et Clermont-Ferrand est, proportionnellement à
la population de Roanne par rapport à celle de Lyon, plus
élevées que les liaisons Clermont-Ferrand - Lyon. Roanne s'ouvre
vers l'Ouest et vers la région Auvergne.
Les principales caractéristiques des flux de
transports ferroviaires :
- Le trafic ferroviaire est en constante progression sur
l'ensemble de l'ouest lyonnais. - Les échanges entre les trois grands
pôles Lyon, Saint-Etienne et Roanne sont globalement les plus
importants.
- Sur les axes reliant ces grandes villes, le trafic varie.
Lyon absorbe une grande partie des flux ferroviaires, en provenance des petites
gares régionales mais aussi de Roanne et Saint-Etienne.
- Les gares des communes traversées par l'A89,
Balbigny, Tarare et l'Arbresle ont connu ces dix dernières années
une progression moyenne de plus de 60% de leur fréquentation.
- Sur l'ensemble du tracé de l'A89, les liaisons entre
Clermont-Ferrand et Lyon sont les plus importantes. Les échanges entre
Roanne et Clermont-Ferrand laissent à penser à une ouverture vers
l'ouest de Roanne.
III- Les conditions de déplacement
La compréhension des choix de mobilité passe par
la connaissance des conditions de déplacements. Elles guident les choix
modaux et les choix de parcours. Connaître ces conditions de
déplacement permet d'envisager les meilleurs aménagements pour
satisfaire au mieux la demande. Cela peut aussi faire prendre conscience des
mesures à prendre pour modifier les comportements des usagers. Nous
étudierons les coûts et les motifs de déplacements.
1- Les coûts de déplacement : remettent en
cause l'usage de l'automobile
1.1: Rappels sur la notion de coût de
déplacement
Il n'existe pas un unique coût de déplacement,
mais plusieurs : le coût ressenti par l'usager, le coût complet, le
coût généralisé et les coûts externes. La
première différence que l'on peut constater est celle qui
concerne les deux coûts monétaires : le coût ressenti et le
coût complet. Le coût complet est celui qui correspond à
toutes les dépenses que l'usager supporte lors d'un déplacement.
Pour un déplacement en train, il s'agit essentiellement du simple prix
du billet. Ce coût est le même que celui ressenti par l'usager, le
coût ressenti étant la somme dépensée a priori pour
le déplacement.
A l'inverse, pour un transport automobile, le coût
ressenti est différent du coût complet. Le coût ressenti
correspond à l'ensemble des dépenses directement
nécessaires au déplacement. Il s'agit principalement des
coûts de carburant, et éventuellement, de péage et de
stationnement. Pourtant, se déplacer en voiture nécessite
d'autres coûts qui ne sont pas supportés pour le simple
déplacement effectué. Il s'agit par exemple de l'acquisition du
véhicule et/ou de son crédit, des frais d'assurance, d'entretien,
de l'usure du véhicule, voire même le coût de l'obtention du
permis de conduire. Pour connaître le coût complet d'un
déplacement en voiture, il faut calculer une moyenne de ces coûts
par kilomètre parcouru, à laquelle on ajoute le coût
ressenti par l'usager.
On ne peut limiter le coût d'un déplacement au
simple coût monétaire. En effet, le déplacement engendre
une consommation de temps. L'intégration de ce temps au coût
complet permet de définir un coût généralisé.
Il convient au préalable de donner une valeur au temps, cette valeur est
définie par les pouvoirs publics. Nous calculerons
séparément le coût
complet et le temps nécessaire des déplacements
de l'ouest lyonnais, nous ne calculerons donc pas le coût
généralisé.
Enfin, les coûts externes correspondent aux
dépenses engendrées par les déplacements non subies par
les usagers. Ils sont alors aux frais de la collectivité. Il s'agit par
exemple de la pollution atmosphérique, de l'effet de serre, du bruit,
des accidents corporels non pris en charge par les assureurs... (Merlin,
1984. Plassard, 2003).
Le coût des déplacements n'est donc pas une
notion très facile à cerner mais son étude permettra de
comparer le coût des déplacements automobiles aux
déplacements ferroviaires et de voir si l'amélioration du
réseau autoroutier grâce à l'A89 peut favoriser une baisse
des coûts de déplacements.
1.2 : Les temps et coûts des déplacements : la
concurrence transport routier / transport ferroviaire
L'étude des coûts et temps des
déplacements a été réalisée à partir
des données des sites Internet : MAPPY et Via Michelin. Ces deux sites
présentent les distances entre deux points, le temps de parcours et le
coût ressenti par l'usager. A cela, nous ajouterons le coût non
ressenti par l'usager pour définir le coût complet de chaque
trajet. En 2002, le CCAF (Comité des Constructeurs Automobiles
Français) précisait que ce coût non ressenti
s'élevait à 22,4 centimes d'euros au kilomètre. Les
coûts pour le transport automobile ont été calculés
sur la base d'un véhicule automobile léger moyen de type Golf,
306, Focus... Le prix moyen du litre de carburant retenu est de 1 ,20€,
qui correspond à une moyenne entre le prix du litre de gasoil et du
litre d'essence constaté dans diverses stations essence en Mars 2007.
Mappy et Via Michelin n'indiquent pas les mêmes temps de parcours ni
coûts de carburant. C'est pour cela que les données
calculées par les deux sites figurent dans le tableau ci-dessous. En ce
qui concerne les déplacements ferroviaires, le site de
réservation de l'agence de voyages de la SNCF a été
consulté. La durée et le coût du déplacement
correspondent à un trajet effectué un matin de semaine, le jeudi,
entre 6h30 et 1 1h00. La durée du trajet est une durée moyenne
car celle-ci varie, en fonction des correspondances notamment. Il en est de
même pour le coût qui peut varier en fonction des horaires. Le
tarif moyen constaté a été retenu. Il s'agit du prix d'un
billet unique et non pas d'un trajet effectué avec une carte
d'abonnement (abonnement de travail, étudiant : carte OURA).
Il n'existe pas de liaison rapide directe entre Bordeaux et
Lyon. Seul le TER circule directement entre ces deux villes pour un temps de
parcours d'environ 8h. Toutefois, il est possible de se rendre de Bordeaux
à Lyon par TGV en passant par Paris. Le temps de
parcours est inférieur de deux heures puisqu'il ne faut
que 6h, dont 2h de correspondance à Paris.
Figure 41: Comparaison temps de parcours/coût
en voiture personnelle et TER
|
Distance
parcourue
en Km
|
Temps VL
|
Temps TC
|
Coût ressenti
VL en €
|
Coût complet
VL en €
|
Coût TC en€
|
|
Clermont-Ferrand - Lyon
|
202
|
2:06
|
- 2:03
|
03:00
|
31,09 - 29,95
|
76,34 - 75,20
|
27,00
|
|
Lyon - Roanne
|
85
|
1:19
|
- 1:17
|
01:30
|
6,43 - 8,24
|
25,47 - 27,28
|
13,70
|
|
Lyon - Saint-Etienne
|
61
|
0:48
|
- 0:48
|
00:49
|
4,77 - 6,59
|
18,43 - 20,25
|
9,20
|
|
Saint-Etienne - Roanne
|
86
|
1:00
|
- 1:00
|
01:09
|
9,83 - 11,99
|
29,10 - 31,25
|
11,40
|
|
Roanne - Balbigny
|
32
|
0:27
|
- 0:27
|
00:27
|
2,46 - 3,38
|
9,63 - 10,55
|
5,60
|
|
Balbigny - Tarare
|
29
|
0:31
|
- 0:32
|
01:45
|
2,24 - 3,26
|
8,74 - 9,76
|
10,30
|
|
Balbigny - Lyon
|
71
|
1:09
|
- 1:12
|
de 1:40 à
3:05
|
6,52 - 7,42
|
22,42 - 23,32
|
14,80
|
|
Tarare - l'Arbresle
|
19
|
0:18
|
- 0:19
|
00:14
|
1,46 - 1,77
|
5,72 - 6,01
|
3,10
|
|
Tarare - Lyon
|
42
|
0:41
|
- 0:40
|
00:54
|
3,21 - 4,22
|
12,62 - 13,63
|
8,50
|
|
l'Arbresle - Lyon
|
25
|
0:25
|
- 0:24
|
00:40
|
1,87 - 2,63
|
7,47 - 8,23
|
6,50
|
Sources : Mappy, Via Michelin, SNCF
31,09: MAPPY 29,95: VIA MICHELIN
Ce tableau permet de comparer les avantages du train et/ou de
la voiture en terme de temps gagné ou de coût du transport. Le
premier constat que l'on peut faire est que le temps du trajet est sensiblement
le même entre un déplacement en train et un déplacement
automobile. Le transport ferroviaire est légèrement plus long que
le transport routier sauf entre Tarare et l'Arbresle. On peut considérer
qu'ils sont identiques entre Lyon et Saint-Etienne, Roanne et Balbigny et entre
Saint-Etienne et Roanne. Toutefois, il convient de rajouter au temps de
parcours du train un temps de précaution avant l'embarquement pour
accéder à la gare, acheter le billet, trouver son quai et un
temps d'arrivée pour quitter la gare. F. Plassard estime ces deux temps
à plus ou moins 30min. Ainsi, il faut ajouter 30 minutes aux temps de
déplacement ci-dessus pour connaître le temps réel
nécessaire à un déplacement ferroviaire. Ainsi, prendre le
train pour effectuer un long trajet permet de diminuer l'importance relative du
temps de précaution et du temps d'arrivée. Dans l'ouest lyonnais,
il s'agit des parcours Roanne - Lyon, Saint-Etienne - Lyon et Saint-Etienne -
Roanne. A
l'inverse, pour les courts trajets : l'Arbresle - Lyon ou
Tarare - l'Arbresle, le temps nécessaire avant et après le voyage
double le temps de parcours. Le trajet Balbigny - Lyon est celui qui
connaît le plus de variabilité de la durée du
déplacement. Il peut en effet varier du simple au double, de 1h40
à plus de trois heures et est le trajet qui nécessite le plus
important temps de déplacement de toutes les liaisons observées.
Ceci s'explique par l'absence de liaison directe entre Balbigny et Lyon. On
fait le même constat pour les déplacements routiers. Il n'existe
pas d'axe routier direct entre Balbigny et Lyon ce qui augmente le temps de
parcours. Les 86 kilomètres entre Roanne et Saint-Etienne sont parcourus
en 1h alors qu'il faut 1h10 pour parcourir les 71 kilomètres entre
Balbigny et Lyon. L'A89 offrira une liaison autoroutière directe entre
Lyon et Balbigny, le temps de parcours sera alors réduit à moins
d'une heure.
Une autre donnée est essentielle dans le choix du mode
de transport, le coût. La part du budget d'un ménage
consacrée aux transports était en 2002 de 15%. Il s'agit donc
d'une part très importante, supérieure au budget consacré
à l'alimentation (14,8%) (Plassard, 2003, p. 71). La
possibilité pour les ménages de diminuer ce coût
permettrait de le reporter sur d'autres dépenses. Or, nombreux sont les
ménages à penser que se déplacer en voiture est plus
avantageux que prendre le train. La figure 41 montre en effet que le coût
ressenti lors d'un trajet en voiture est inférieur au coût du
même trajet effectué en train. Choisir de voyager en voiture peut
alors paraître plus avantageux. De plus la voiture permet
d'accéder directement à destination, est plus rapide que le train
et n'impose pas de contraintes horaires. Cette énumération des
avantages de l'automobile explique la prépondérance de l'usage de
la voiture dans les déplacements. Mais le coût ressenti n'est pas
le coût réel d'un déplacement automobile. Il faut observer
le coût complet pour connaître le coût réel d'un
déplacement automobile. Le coût complet est presque 4 fois plus
important que le coût ressenti. Ainsi, un voyage en train devient moins
onéreux qu'un voyage en voiture. Plus la distance augmente, plus le
train se révèle avantageux financièrement. Sur le plus
long trajet : Clermont-Ferrand - Lyon, le prix du billet de train est 2,8 fois
inférieur au coût du déplacement automobile. Sur les axes
majeurs de l'ouest lyonnais (Roanne - Lyon, Saint-Etienne- Lyon et
Saint-Etienne - Roanne), le prix du billet de train équivaut à la
moitié du coût d'un déplacement automobile. Sur les courts
trajets, le prix du billet de train reste inférieur au coût
déplacement automobile mais la différence est beaucoup moins
importante que dans les cas précédents. Enfin, on observe que
rejoindre Balbigny à Tarare en train coûte plus cher que de le
faire en voiture. Le prix du billet de train étant calculé en
fonction de la distance parcourue, sachant qu'il n'y a
pas de liaison directe Balbigny - Tarare, ce trajet se fait via
Le Coteau, ce qui augmente la distance entre les deux communes, et donc, le
coût du déplacement.
Bilan de chaque liaison :
- Clermont-Ferrand - Lyon : le temps de parcours est
1/3 plus court en voiture qu'en train. Toutefois, le coût du
déplacement automobile peut favoriser le train car l'heure gagnée
en voyageant en voiture revient à 50€.
- Lyon - Roanne / Saint-Etienne - Roanne : l'avantage
est au train qui revient deux moins cher que la voiture pour un temps de
parcours quasiment identique. De plus, sur la liaison Roanne - Lyon, via la
RN7, les conditions de circulation sont très mauvaises. L'axe est
ancien, présente des dénivelés importants, traverse les
bourgs (la traversée de Tarare en plein centre-ville est difficile)...
Le train offre des conditions de transports bien plus satisfaisantes et le
temps de parcours n'est pas aussi aléatoire que par la route.
- Saint-Etienne - Lyon : le temps de parcours est
identique entre les deux villes et le coût d'un billet de train
correspond à la moitié d'un trajet automobile. De plus, si on
ajoute le prix du ticket de stationnement, les ralentissements sur l'A47 et
à l'entrée de Lyon... le train est réellement plus
avantageux sur cette liaison.
- Balbigny - Lyon : le transport ferroviaire est plus
long et aléatoire que le transport routier mais le temps perdu est
compensé par un coût 1,5 fois moins élevé. Les
avantages des deux modes se compensent si bien qu'aucun n'est plus favorable
que l'autre. Si l'on souhaite préserver l'environnement, on choisira le
transport ferroviaire.
- Balbigny - Tarare : l'absence de liaison ferroviaire
entre ces deux communes nuit à la concurrence entre les deux modes de
transport. La route est plus avantageuse. Le temps de parcours est trois fois
moins long qu'en train et le coût du déplacement est moins
élevé qu'en train.
- Tarare - l'Arbresle: il s'agit de la seule liaison
où le train est plus rapide que l'automobile. De plus, le coût du
billet de tain est inférieur au coût du déplacement
routier. Le train est plus avantageux que l'automobile. Toutefois, les temps de
précaution et d'arrivée nécessaires au déplacement
ferroviaire augmentent la durée du déplacement. Le coût
ressenti est plus faible que le coût du billet. La perte de temps et le
coût ressenti étant les deux éléments les plus
facilement appréhendables par l'usager, l'usage de la voiture peut
être préféré au train.
- Roanne - Balbigny : la durée du trajet est
identique entre les deux modes. Le trajet en automobile revient deux fois plus
cher que le trajet par le train. L'avantage est donc au train.
- Tarare - Lyon / l'Arbresle - Lyon : le temps de
parcours est inférieur en voiture. Le train nécessite une
dépense inférieure à l'automobile. Les deux modes sont
équivalents. Les difficultés de circulation sur la RN7
(embouteillages, enneigement) peuvent faire préférer le train.
Ce bilan de chaque axe présente les avantages et
inconvénients théoriques de chaque axe. Le transport ferroviaire
est celui qui se révèle le plus avantageux sur l'ouest lyonnais.
Pourtant, il n'est pas le plus utilisé. Les temps de précaution
et d'arrivée nécessaires au déplacement ferroviaire
augmentent la durée du déplacement. Le coût ressenti est
plus faible que le coût du billet du train. La perte de temps et le
coût ressenti étant les deux éléments les plus
facilement appréhendables par l'usager, l'usage de la voiture peut est
préféré au train. De plus, la voiture permet à
celui qui se déplace d'être dans une relative intimité, de
ne pas être contraint de voyager debout dans un train surchargé,
d'écouter la radio, d'avoir la climatisation... Toutefois, ce
comportement semble changer. Nous avons vu précédemment que le
trafic ferroviaire augmentait fortement dans l'ouest lyonnais. La hausse des
prix des carburants incite de plus en plus les usagers à voyager en
train, celui-ci étant moins cher. Les ménages
préfèrent réaliser des économies sur le budget
transport au détriment de quelques minutes passées en plus dans
les transports collectifs, ce qui augmente leur pouvoir d'achat.
1.3 : Les temps de parcours : étude de 2
itinéraires concurrents de l'A89
Le gain de temps que permettra de réaliser une
autoroute est une donnée essentielle pour sa réalisation et pour
la fréquentation qu'elle connaîtra. De Balbigny à Lyon
Perrache, nous allons observer 2 itinéraires concurrents de la future
A89, l'un privilégiant l'autoroute (A72 et A47) et l'autre
préférant la route nationale 7. Ces itinéraires
correspondent aux itinéraires actuellement les plus rapides et donc les
plus empruntés, pour se rendre de Balbigny à Lyon. Les
données du site Mappy ont été utilisées pour
comparer les 2 itinéraires. Signalons que les temps de parcours
observés s'entendent en période normale de trafic, sans pause et
hors embouteillages ou ralentissements. Il convient alors de préciser
que l'écoulement du trafic n'est pas toujours aisé et
régulier dans la proche périphérie lyonnaise et les temps
de parcours peuvent varier fortement entre Tarare et Lyon ainsi qu'entre
Saint-Etienne et Lyon. L'itinéraire empruntant la RN7 bifurque sur la
RD1 à Tarare en direction de Balbigny. Sur cet itinéraire, les
temps de parcours intermédiaires sont calculés de gare à
gare. En revanche, sur les autoroutes, les temps intermédiaires sont
approximatifs (on ne peut pas prendre les gares comme lieu de
référence étant donné qu'elles ne se trouvent pas
sur les axes autoroutiers). Le temps de parcours de l'A89 est donné
à titre indicatif et est approximatif. Il est calculé en fonction
des temps de parcours actuels. Cet itinéraire emprunte la RN7 pour
rejoindre l'A89 à La-Tour-de-Salvagny et se décompose ainsi :
Lyon Perrache - La-Tour-de-Salvagny : 15km parcourus en 17min,
La-Tour-de-Salvagny - Balbigny : 50km parcourus en 30min.
Ce type de carte figure dans le dossier d'enquête
préalable à la DUP réalisé par la DRE en 2001. Elle
n'a pu être reprise dans son intégralité car elle
présentait des anomalies, volontaires ou non, qui favorisaient
l'autoroute. Parmi elles, l'itinéraire empruntant la RN7 allait
jusqu'à L'Hôpital-sur-Rhins, en direction de Roanne. Ainsi, le
parcours était rallongé d'une trentaine de kilomètres et
de 20 minutes. Ce trajet de 101 kilomètres était parcouru en
1h29. Le temps de parcours par la RN7 était supérieur à
celui par l'autoroute (1h07), bien que ce dernier était plus long
(120km). On voyait alors que l'autoroute permettait de réduire
l'espace-temps. Pourtant, prendre cette autoroute fait faire un long
détour. La mise en place d'une autoroute directe entre Balbigny et Lyon
semble alors être le meilleur moyen pour réduire très
significativement l'espace-temps. Mais le tracé choisi par la route
nationale n'était pas le plus court, ni en temps, ni en
kilomètres parcourus. La carte avait pour but de montrer l'avantage
temps-kilomètres parcourus généré par
l'autoroute.
Figure 42 : Temps de parcours cumulés de
Lyon Perrache à Balbigny : étude de
deux
itinéraires
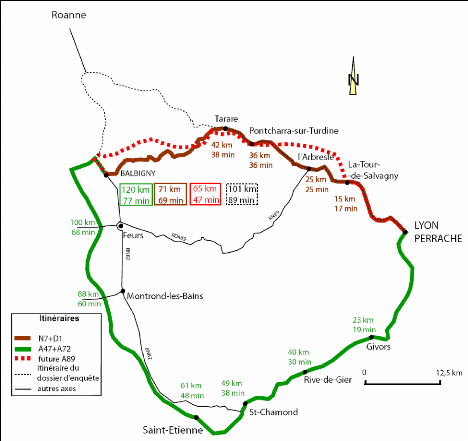
Source : Mappy. Réalisation : Pailler.S.
(2007)
L'itinéraire réellement le plus court, dans tous
les sens du terme, est celui qui emprunte la RN7 puis la D1 de Tarare à
Balbigny. Certes, le temps de parcours est à peine plus faible que celui
par autoroute mais la distance est 1,7 fois moins longue. Ainsi, le trajet par
la route réduit le trajet de 50km par rapport à l'autoroute. Pour
relier Lyon à Balbigny, il est préférable d'emprunter la
route plutôt que l'autoroute.
Après la mise en service de l'autoroute A89, la donne
va changer. L'itinéraire A47+A72 pourrait ne plus être qu'un
souvenir puisque l'A89 sera une liaison directe entre Lyon et Balbigny. Le
temps de parcours sera alors de 47 minutes, soit une demi-heure de
moins que le tracé autoroutier actuel et la longueur du
parcours sera quant à elle réduite de 55km (65 kilomètres
par A89 et 12 actuellement).
Le seul tracé qui restera en concurrence avec l'A89
sera alors celui passant par la RN7. Il sera plus long de 16km et
nécessitera 22 minutes de plus. La contrepartie de ce gain de temps sera
le paiement du péage, qui devrait avoisiner 4 ou 5€. L'autoroute
permettra d'éviter la traversée difficile des bourgs de
l'Arbresle et de Tarare, et de circuler dans des conditions de circulation plus
fluides, et plus sûres.
1.4 : La saturation des axes autoroutiers
Les temps de parcours que nous venons d'observer sont des
temps de parcours théoriques, ils s'entendent lorsque
l'écoulement du trafic est fluide. Or, les trafics ne sont pas fluides
en permanence dans l'agglomération lyonnaise. Bien au contraire, aux
heures de pointes, des axes et/ou carrefours autoroutiers subissent des
embouteillages réguliers. La carte suivante présente la
localisation et la durée des encombrements des voies
autoroutières de l'agglomération lyonnaise à l'heure de
pointe du matin. Les déplacements sont plus concentrés le matin
que le soir, c'est pourquoi il est intéressant d'observer les
embouteillages rencontrés durant la période de pointe du
matin.
L'écoulement des flux dans l'agglomération
lyonnaise est perturbé par de nombreux ralentissement et embouteillages.
On remarque que presque toutes les intersections entre les flux Nord/Sud et
Est/Ouest sont saturées durant au moins une heure le matin. Les
encombrements augmentent le temps de trajet pour se rendre au travail et
demandent de prévoir un temps de parcours plus large pour arriver
à l'heure au travail. Ils augmentent considérablement les temps
de parcours et nuisent à l'accessibilité de Lyon et son
agglomération. Ainsi, l'agglomération lyonnaise pourtant bien
desservie quantitativement, subit une sorte d'enclavement fonctionnel par
dysfonctionnement de son réseau routier.
Le point le plus critique est le passage de Fourvière,
célèbre pour le franchissement difficile de son tunnel : «
Lyon est maintenant au moins autant connue pour ses bouchons sous le tunnel
de Fourvière que pour sa gastronomie » (Plassard, 2003,
p.110).
Figure 43 : Les points de congestion sur le
réseau autoroutier de l'agglomération lyonnaise
le
matin
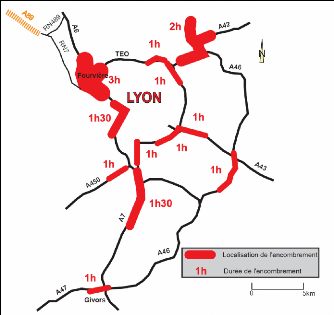
Source : DDE 69
Chaque matin, trois heures d'embouteillages perturbent la
bonne circulation des flux au niveau de Fourvière. La situation est donc
critique. L'A89 déversera une partie de son trafic sur la RN7 qui
pénètre dans Lyon, au droit de Fourvière. On comprend
alors aisément les craintes exprimées par les responsables
politiques de Lyon. Tout le trafic de l'A89 ne se déversera pas dans
Lyon. En effet, l'A89 aura surtout un rôle dans les échanges
Est-Ouest. On peut alors imaginer qu'une partie du trafic contournera Lyon par
le Nord via la RN489 (qui sera aménagée en conséquence)
puis l'A6 et l'A46. Cependant, il est vrai que les échanges entre Lyon
et l'ouest lyonnais, ainsi que l'ouest de la France, passeront par
Fourvière.
Pour les flux de transit Est-Ouest, les difficultés
seront reportées à l'Est, à la bifurcation entre l'A46 et
l'A42 (en direction de Genève). Actuellement, on compte deux heures
d'embouteillages matinaux à cet endroit. Ce carrefour est un point de
passage indispensable aux flux Est-Ouest et le trafic induit par l'A89
s'ajoutera au trafic actuel.
Les apports de trafic induits par l'arrivée de l'A89 ne
pourront qu'aggraver la qualité médiocre de l'écoulement
des flux au nord de l'agglomération lyonnaise.
2- Les motifs de déplacements
Jusqu'à présent, nous avons observé
comment s'organisent et se répartissent les flux de transports dans
l'ouest lyonnais ainsi que leur coût. Nous allons maintenant nous
maintenant nous pencher sur les moteurs de la mobilité dans l'ouest
lyonnais en observant les motifs de déplacements.
2.1 : Les mobilités domicile-travail : premier motif
de déplacement dans le Rhône
2.1.1 :
Généralités sur les navettes domicile-travail en
Rhône-Alpes
Dans un premier temps, nous allons aborder les motifs
généraux de déplacements. L'INSEE, dans ses lettres des
Novembre 2000 et de Septembre 2006, présente l'évolution des
trajets domicile-travail et le lien entre la localisation des habitants et la
présence d'équipements routiers.
En 1999, 63% des actifs de Rhône-Alpes travaillaient
hors de leur commune de résidence alors qu'ils étaient 55% en
1990 et 40% en 1975. Le lieu de résidence n'est plus fonction du lieu de
travail. La distance entre les deux tend à s'accroître. Dans les
communes résidentielles de l'ouest lyonnais vivent de nombreux actifs de
l'agglomération lyonnaise. Ainsi, de 1990 à 1999, la distance
à vol d'oiseau parcourue par les actifs a augmenté de 10%. Les
choix des lieux de résidence et de travail seraient désormais
plus conditionnés par des critères de temps que de distance.
L'accessibilité est un facteur qui introduit actuellement une
différence importante entre les parties accidentées de l'ouest et
l'est de Lyon dans la répartition des différents hommes et des
activités (Lettre Insee, 2000). L'A89 sera une des clés
de l'amélioration de l'accessibilité en diminuant les temps de
parcours vers Lyon. Elle peut alors devenir une source de mobilités
résidentielles vers l'ouest. En 1999, 10 500 Auvergnats travaillaient en
Rhône-Alpes (Lettre Insee, 2000). Parmi eux, ceux qui se rendent
dans les Monts du Lyonnais, à Lyon et à l'est de la région
par la route ou l'autoroute bénéficieront d'un gain de temps
grâce à l'A89.
Les trajets domicile-travail reflètent l'influence de
l'agglomération lyonnaise. Les aires de déplacements domicile
travail révèlent les contours de l'influence de Lyon sur
l'ouest
lyonnais et l'agglomération de Saint-Etienne. La figure 44
présente les communes dont au moins 20% des actifs travaillent dans
l'agglomération la plus proche.
Figure 44 : Communes dont au moins 20% des actifs
travailent dans l'agglomération
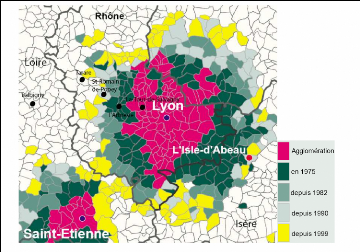
Source : INSEE, Nov.2000
Depuis 1975, l'influence de l'agglomération lyonnaise
croît de manière concentrique. Aujourd'hui, elle dépasse
très largement les limites du département du Rhône à
l'Est, ce n'est pas le cas à l'Ouest. En 1999, Tarare ne faisait pas
partie des communes dont au moins 20% des actifs travaillent dans
l'agglomération lyonnaise mais se trouvait à la limite de la zone
d'influence de l'agglomération. Il est possible qu'en 2007 Tarare soit
intégrée à cette zone d'influence. L'autre pôle de
l'ouest lyonnais, l'Arbresle, était en revanche intégré
à l'aire d'influence lyonnaise depuis 1975. L'extrémité
Est du tracé de l'A89, La-Tour-de-Salvagny, est englobée dans
l'agglomération lyonnaise. Cette carte montre que l'A89 traversera,
jusqu'à Saint-Romain-de-Popey, des communes dont moins de 20% des actifs
travaillent dans l'agglomération lyonnaise
Au Sud-Ouest, la zone d'influence de l'agglomération
lyonnaise a atteint la limite du département et déborde
même sur le département de la Loire. La zone d'influence
stéphanoise quant à elle n'a pas tout à fait atteint cette
même limite. Les habitants de cette zone limitrophe sont donc
influencés presque équitablement pas les deux
agglomérations. Toutefois, Givors et Grigny ont intégré le
1er Janvier 2007 la communauté d'agglomération du
Grand-Lyon.
L'étalement vers le Sud-Ouest de l'agglomération
lyonnaise et vers le Nord-Est de l'agglomération stéphanoise tend
à créer une conurbation. L'étalement des deux
agglomérations (périurbanisation) génère une hausse
des mobilités.
2.1.2 : Premiers résultats de l'Enquête
Ménage Déplacement
Une enquête ménage déplacement a
été réalisée de novembre 2005 à avril 2006
sur l'ensemble de l'aire métropolitaine lyonnaise par le Syndicat mixte
des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise
(SYTRAL). Elle concernait 460 communes et 1,9 millions d'habitants. Elle a
recensé et décrit 90 000 déplacements. Voici la
méthodologie de l'enquête :
Figure 45 : La méthodologie de
l'enquête ménage déplacement
|
Les grands principes d'une méthodologie
standard
- Les enquêtes portent sur un échantillon
représentatif de la population
- Les enquêtes sont administrées lors d'interviews
en face-à-face au domicile des personnes - Tous les membres du
ménage, âgés de 5 ans et plus, sont interrogés
individuellement - Tous les déplacements de la veille sont
recensés et décrits précisément : durée,
motif... - Seuls les jours ouvrables sont concernés
- Tous les modes de transport sont étudiés : marche
à pied, deux-roues, transports en commun, voiture
particulière.
Questionnaires complémentaires
En plus des questionnaires classiques des enquêtes
ménages, un questionnaire complémentaire d'opinion est
posé à une personne du ménage de plus de 16 ans,
tirée au sort. Dans la présente enquête, ces questionnaires
complémentaires étaient différents suivant les
territoires. Des questionnaires spécifiques ont ainsi été
passés sur l'agglomération lyonnaise, sur le Nord Isère,
le Viennois, le Beaujolais et l'ensemble des autres secteurs
périurbains.
Enquête ménage et enquête cordon
Les enquêtes ménages sont réalisées
auprès des résidents d'un périmètre. Elles
n'apportent donc aucune information sur les déplacements des personnes
qui résident en dehors mais se déplacent dans le
périmètre, ainsi que sur les flux de livraison et de
marchandises. Elles sont donc complémentaires avec les enquêtes
« cordon », comme celle réalisée en 2005 autour de
l'agglomération lyonnaise par la Direction départementale de
l'équipement du Rhône, qui permettent de mesurer tous les trafics
routiers entrant et sortant d'un territoire.
|
Source : Sytral
Dans l'ouest lyonnais, l'étude s'arrête plus ou
moins aux limites du Scot de l'ouest lyonnais et à celles du Beaujolais,
autrement dit, aux communes de notre zone d'étude appartenant au
département du Rhône. Les communes du département de la
Loire n'ont pas participé à cette EMD. Les communes à
l'est de Saint-Romain-de-Popey et Savigny sont incluses dans le Scot ouest
lyonnais alors que celles à l'ouest sont intégrées au Scot
du Beaujolais. Les résultats définitifs de l'enquête ne
seront disponibles qu'en Juin 2007 et ne peuvent donc être
intégrés à notre étude. Toutefois, le SYTRAL a
déjà réalisé une synthèse des premiers
résultats dont on peut tirer les conclusions suivantes :
- Deux déplacements sur trois concernent
l'agglomération lyonnaise. 4,1 millions de déplacements se
produisent dans l'agglomération, et près de 600 000 en
échange avec elle. Cette intensité (67% du total des
déplacements) est à mettre en corrélation avec le poids
démographique de l'agglomération lyonnaise dans l'aire
métropolitaine (64 %). Il existe un lien entre le poids
démographique d'une commune ou d'une agglomération et le nombre
de déplacements qu'elle émet, reçoit, supporte.
- Chaque habitant réalise en moyenne entre 3,9
déplacements par jour dans le Beaujolais (Tarare). Ce résultat
est conforme aux grandes tendances nationales. Il consacre entre 57 et 80
minutes par jour en moyenne à ses déplacements
- Les TER et les cars assurent 4 % à 5 % des
déplacements dans le Beaujolais, 1 à 2 % des déplacements
sont effectués en deux-roues (vélo et deux roues
motorisés). L'usage combiné des modes de transports
(déplacements multimodaux) représente seulement 2% des
déplacements.
- La moitié des déplacements sortant d'un Scot
est un échange avec l'agglomération lyonnaise. Les
échanges avec l'agglomération lyonnaise se font en moyenne
à 85 % en voiture. Ceux effectués en car et en TER
représentent, selon les liaisons, entre 6 et 12 %.
- Entre 16 h et 18 h, les déplacements sont nombreux,
avec les retours du travail, de l'école, mais aussi pour tout autre
motif. Une pointe très forte existe le matin, dans la tranche 8 h-9 h,
surtout pour des déplacements liés au travail, aux études
ou à l'accompagnement. La pointe d'usage des transports collectifs se
situe plus tôt, entre 7 h et 8 h.
- La voiture est utilisée de façon
prépondérante : elle assure 58 % du total des
déplacements, 71 % des déplacements pour aller au travail, 70 %
des accompagnements. Mais les différences sont très fortes entre
les habitants de l'agglomération lyonnaise et les autres. La voiture est
utilisée pour moins d'un déplacement sur deux par les habitants
du Grand Lyon, mais pour les trois quarts de leurs déplacements par les
habitants des autres secteurs de l'aire métropolitaine. C'est pour aller
au travail que les habitants parcourent les distances les plus longues et
qu'ils utilisent le plus la voiture (dans 71 % des cas). Ils s'en servent
principalement en « solo ». Les habitants de l'ouest du
département du Rhône effectuent en moyenne 27,7km par jour.
- L'usage des transports collectifs urbains est
particulièrement développé dans le Grand Lyon (et encore
plus dans Lyon et Villeurbanne). Cet usage est plus faible dans les autres
agglomérations, qui disposent d'un réseau moins dense. Les femmes
utilisent plus les transports collectifs que les hommes.
(SYTRAL)
Figure 46 : Les modes de transport de l'aire
métropolitaine lyonnaise
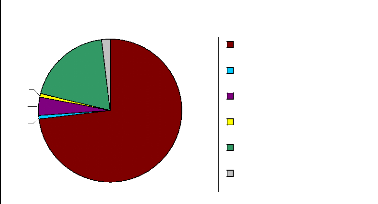
4%
1%
1%
19%
2%
73%
voiture particulière
transports collectifs urbains
autres transports collectifs (TER)
deux roues
marche à pied
autres modes de transport
Source : Sytral
Le mode de transport le plus largement utilisé est la
voiture particulière, elle permet d'effectuer les trois quarts des
déplacements. Elle présente de nombreux avantages : elle permet
de se rendre partout, offre un certain confort à l'usager, peut
transporter 4 à 5 personnes en même temps... La marche à
pied qui représente un cinquième des déplacements est un
mode adapté aux déplacements de courte distance, de type urbains.
Elle ne permet pas de réaliser de longs trajets entre l'ouest lyonnais
et le centre de Lyon par exemple. Pour
effectuer ce trajet, ceux qui ne souhaitent pas utiliser leur
voiture, ou ceux qui n'en disposent pas, utilisent à 4% des moyens de
transports collectifs tels que le TER. Les transports collectifs urbains sont
très peu utilisés car ils ne sont pas très
développés en périphérie de Lyon et des villes
comme Tarare ou l'Arbresle ne possèdent pas un réseau urbain de
transports en communs très performant. Le vélo, de même que
la marche à pied est essentiellement utilisé pour les courts
trajets. La moto, qui permet d'être moins ralenti dans les
embouteillages, expose son usager aux intempéries (les
températures négatives de l'hiver dans les Monts du Tararois
notamment n'incitent pas à circuler en deux-roues) et limite les
chargements possibles.
Figure 47 : Les motifs de
déplacements
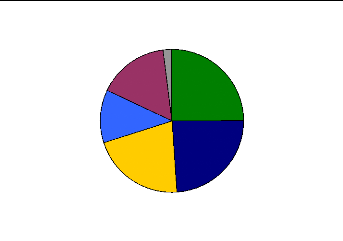
accompagnement
16%
études 12%
loisirs
21%
autres 2%
achats services
25%
travail 24%
Source : Sytral
Les motifs de déplacements permettent de comprendre
pourquoi la voiture est préférée à l'ensemble des
autres modes de transports. On peut regrouper les motifs « travail »
et « études » qui correspondent à des trajets
réguliers contraints. A eux deux ils représentent 36% des motifs
de déplacements. Ils ne nécessitent pas d'être
effectués en voiture particulière. En revanche, les achats et
services, qui occupent un quart des déplacements, sont plus aisés
en voiture car ce mode de transport permet de transporter les produits
achetés. Les loisirs représentent 21% des déplacements.
Les loisirs sont souvent pratiqués le soir ou le week-end, à des
horaires où les services de transports en communs sont moins
performants. De plus, ils
demandent parfois de transporter du matériel
encombrant, ce qui est peu évident en transports en commun. Une part
importante des accompagnements, qui correspondent à 16% des
déplacements, est constituée par les accompagnements d'enfants
à l'école. La voiture est très utile car elle peut
transporter plusieurs enfants, même en bas âge (ce qui est moins
pratique en train ou en bus).
La figure 48 présente les mobilités
engendrées pour se rendre au travail. Elle permet de constater le
rôle résidentiel que joue l'ouest lyonnais à
l'échelle de l'aire métropolitaine lyonnaise. En effet, il s'agit
du secteur qui émet le plus de flux domicile-travail de toute l'aire
métropolitaine lyonnaise. Le second pôle résidentiel est le
nord de l'Isère. Sur cette figure sont aussi représentés
les échanges entre le SCOT de l'ouest lyonnais et les SCOT du Beaujolais
et des Rives du Rhône (ce type d'échange entre les autres SCOT de
l'aire métropolitaine lyonnais n'est pas représenté car il
n'apporte rien à notre réflexion). Ces échanges sont
minimes par rapport à l'attrait qu'exerce Lyon sur les communes de
l'ouest lyonnais.
Figure 48 : Les navettes domicile-travail dans l'aire
métropolitaine lyonnaise
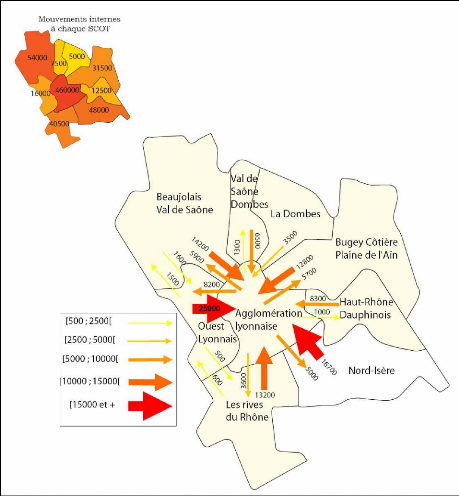
Source : Inter-Scot, DDE Rhône
2.2 : Etude de cas : la RN489
En 2005, une enquête cordon a été
réalisée sur l'agglomération lyonnaise pour
connaître les motifs de déplacements et les origines/destinations
des usagers des routes. De nombreux postes d'enquêtes ont
été disposés sur l'ensemble de l'agglomération
lyonnaise dont un poste se trouvait à l'intersection de la RN7 et de la
RN489, au Nord Ouest de Lyon, à proximité de la fin de l'A89 et
de l'autoroute A6. Les enquêteurs interrogeaient les occupants des
véhicules en direction de l'ouest. Les comptages ont été
effectués du 7 septembre au 21 septembre 2005. La carte ci-dessous
permet de localiser précisément le point d'enquête.
Figure 49 : Localisation du point d'enquête
cordon sur la RN489
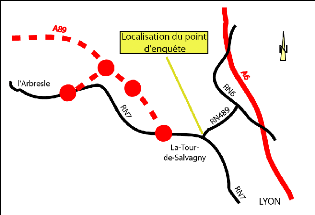
Source : Enquête cordon. Réalisation :
Pailler.S (2007)
2.2.1 : Variation des flux durant la période
d'observation
Nous aurions pu présenter les données
chiffrées dans la partie dédiée aux comptages. Il est
préférable de les indiquer ici afin de rendre plus lisibles les
résultats. Le tableau cidessous présente le nombre de
véhicules interrogés le Jeudi 15 Septembre 2005 (donc un jour
ouvrable) et le nombre total de véhicules passant par le point de
comptage.
Figure 50 : Comptages des véhicules et
nombre d'enquêtes réalisées
|
Véhicules légers
|
Poids lourds
|
|
La-Tour-
de-
Salvagny
RN489/RN7
|
Moyenne
24H jours
ouvrables
|
Comptages de 6h à 20h
|
Interviews réalisées
|
Taux de sondage
|
Moyenne
24H jours
ouvrables
|
Comptages de 6h à 20h
|
Interviews réalisées
|
Taux de sondage
|
|
8122
|
7837
|
1894
|
24%
|
1164
|
821
|
249
|
30%
|
Source : DDE 69
96,5% des voitures circulent entre 6h et 20h alors que
seulement 70,5% des poids lourds circulent sur cette même tranche
horaire. De nombreux poids lourds préfèrent se déplacer de
nuit car les conditions de circulation, notamment la fluidité du trafic,
sont meilleures. De plus, les entreprises, magasins, surtout les centres
commerciaux, sont approvisionnés durant la nuit ; des entreprises
nécessitent de recevoir les marchandises avant l'ouverture de leurs
portes et de leurs bureaux. Ainsi, près de 30% des poids lourds
circulent entre 20h et 6h à La-Tour-de-Salvagny.
Sur l'ensemble des véhicules qui circulent sur la
RN489, un quart des véhicules légers et près d'un tiers
des poids lourds ont pu être interrogés. Ce taux permet une
connaissance poche de la réalité des déplacements passant
par la RN489, et plus globalement, des déplacements de la proche
banlieue de l'ouest lyonnais.
La figure 51 ci-dessous permet de visualiser l'évolution
du trafic au cours des 14 jours de sondages.
Figure 51 : Evolution quotidienne du trafic sur la
RN489
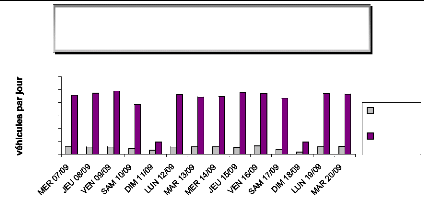
12000
10000
4000
6000
2000
8000
0
Evolution quotidienne du trafic
du Mercredi 7
Septembre 2005 au Mardi 20 Septembre 2005
sur la RN489
Poids lourds
Tous les véhicules
Source : DDE69
Durant les 14 jours, 112 988 véhicules dont 14 261
poids lourds ont circulé sur la RN489. La part des poids lourds parmi le
nombre total de véhicules est de 12,6%. Cette valeur correspond à
la moyenne du trafic de poids lourds généralement
constatée dans l'ouest lyonnais.
La moyenne journalière de ces 14 jours est de 8 070. Il
s'agit là des véhicules quittant le Grand Lyon pour se rendre
vers l'ouest. Si l'on se réfère aux chiffres observés dans
les comptages des flux routiers, on se rend compte que la part des flux vers
l'Ouest est légèrement plus faible que vers l'Est. En effet, en
2005, 21 766 véhicules circulaient sur la RN489 dans les deux sens.
Ainsi, 13 696 véhicules (21 766-8 070) entraient dans
l'agglomération lyonnaise durant cette même période. Le
Grand Lyon attire plus de flux qu'il n'en émet.
Le jour qui connaît le trafic le plus chargé est
le vendredi, aussi bien pour l'ensemble des véhicules que pour les poids
lourds. Les départs en week-end, les personnes travaillant à Lyon
et rentrant chez elles le week-end, l'obligation de rentrer pour les poids
lourds car ils ne peuvent circuler du samedi 22h au dimanche 22h, sont les
raisons de cette hausse du trafic le Vendredi. Par conséquent, le trafic
est plus faible le week-end et le dimanche est le jour où le nombre
véhicules en circulation est le moins élevé. Le lundi est
lui aussi un jour où le trafic est élevé, car c'est le
jour où l'activité économique reprend : les poids lourds
bloqués le weekend repartent le lundi. Le trafic connaît un creux
au milieu de la semaine.
2.2.2 : Les moyennes horaires du trafic
L'enquête cordon présente aussi l'avantage de
connaître les moyennes horaires des flux de la RN489. Le tableau
ci-dessous présente les moyennes horaires.
Figure 52 : Moyennes horaires du trafic sur la
RN489
|
Moyennes horaires
Nombre de véhicules
RN489
|
Tous
véhicules
|
Poids lourds
|
% poids lourds
|
|
Période
|
336
|
42
|
12,5
|
|
Jours ouvrables
|
387
|
49
|
12,7
|
|
Jours ouvrables
7h/10h
|
440
|
60
|
13,6
|
|
Jours ouvrables
16h/19h
|
993
|
114
|
11,5
|
|
Trafic de nuit 22h/6h
|
59
|
6
|
10,2
|
Source : DDE69
Les moyennes horaires des flux de transports indiquent
l'attraction du Grand Lyon. La fin de journée (16h/19h : 993
véhicules) connaît un trafic plus de deux fois supérieur au
matin (7h/10h : 440 véhicules). Le soir, les actifs travaillant à
Lyon et les personnes y ayant une activité retournent dans la commune
où ils résident, dans l'ouest lyonnais. Les chauffeurs de poids
lourds n'échappent pas à cette règle. Ils prennent la
direction de l'ouest en fin de journée, pour y transporter les
marchandises chargées dans la journée ou ramener le
véhicule ou se rendre à leur domicile/dépôt
lorsqu'ils sont vides (18% des poids lourds interrogés étaient
vides).
2.2.3 : Les motifs de déplacements
Le tableau suivant présente le nombre d'occupant et les
motifs de déplacements des véhicules légers.
Figure 53: Occupation des véhicules
légers et motifs de déplacements sur la RN489
|
VL
|
Domicile /
Travail-Etudes
|
Travail-Etudes
/ Domicile
|
Affaires
professionnelles
|
Autre
|
Tous motifs
|
|
Nombre moyen
d'occupants
|
1,09
|
1,08
|
1,2
|
1,54
|
1,26
|
|
Part du motif
|
11%
|
27%
|
30%
|
32%
|
100%
|
Source : DD69
Les déplacements domicile-travail représentent
38% des déplacements. Si l'on ajoute les 30% concernés par des
affaires professionnelles, 68% des déplacements sont effectués
pour satisfaire à des besoins professionnels. La majorité des
véhicules qui effectuent le trajet domicile-travail ne transportent
qu'une personne. Le co-voiturage permet de transporter près de 300
personnes, soit 300 véhicules en moins sur la route. Pour les affaires
professionnelles, les déplacements sont plus souvent effectués
à au moins 2 personnes. Il peut s'agir de déplacements en
réunion de membres d'une entreprise, de l'utilitaire d'un artisan
transportant ses ouvriers... Les autres motifs de déplacements
représentent 32% de l'ensemble des déplacements. Parmi ces motifs
figurent la visite de la famille ou d'amis, l'accompagnement scolaire des
enfants, les déplacements pour les loisirs, les achats... La nature de
ces déplacements fait qu'ils sont souvent effectués à
plusieurs.
Ainsi, les déplacements familiaux et amicaux
s'effectuent plus facilement à plusieurs que les déplacements
domicile-travail. Dans le cadre d'un trajet à plusieurs, les frais de
déplacement
individuel sont minimisés, la voiture présente
donc un réel avantage. A l'inverse, pour une personne seule, le
transport automobile est plus onéreux que le transport ferroviaire par
exemple (cf. les coûts de transports). Les déplacements
domicile-travail effectués en voiture, en solo, sont ceux qui
coûtent le plus à l'usager
L'analyse des motifs de déplacements prouve encore une
fois l'attrait de l'agglomération lyonnaise. 27% des véhicules
légers se rendent à leur domicile alors que seulement 11% (soit
2,5 fois moins) se rendent sur leur lieu d'activité. Rappelons que les
chiffres concernent des flux d'orientation Est-Ouest, il s'agit donc de flux en
provenance de l'agglomération lyonnaise et à destination de
l'ouest lyonnais. La fonction de résidence des communes de la proche
banlieue de l'ouest lyonnais est ici confirmée par les flux de
transports.
2.2.4 : Les origines et destinations des flux
Pour terminer l'étude sur l'enquête cordon, nous
allons observer l'origine et la destination des flux passant par la RN489.
Elles sont présentées dans les deux tableaux cidessous.
Figure 54 : Origine/Destination des
véhicules légers sur la RN489
|
Destination
|
|
Origine
|
Territoire de l'inter-scot
|
Reste de région
Rhône-Alpes
|
Reste de la
France et étranger
|
Total
|
|
Interne au cordon
|
5347
|
1352
|
197
|
6896
|
|
Territoire de l'inter-scot
|
552
|
125
|
19
|
696
|
|
Reste de région
Rhône-Alpes
|
155
|
57
|
49
|
261
|
|
Reste de la France
et étranger
|
160
|
70
|
38
|
269
|
|
Total
|
6214
|
1604
|
303
|
8122
|
Source : DD69
Figure 55 : Origine Destination des poids lourds
sur la RN489
|
Destination
|
|
Origine
|
Territoire de l'inter-scot
|
Reste de région
Rhône-Alpes
|
Reste de la
France et étranger
|
Total
|
|
Interne au cordon
|
376
|
191
|
34
|
600
|
|
Territoire de l'inter-scot
|
149
|
101
|
45
|
295
|
|
Reste de région
Rhône-Alpes
|
30
|
46
|
16
|
92
|
|
Reste da la France
et étranger
|
104
|
64
|
9
|
177
|
|
Total
|
659
|
402
|
104
|
1164
|
Source : DD69
Sur la RN489, 84,9% des véhicules légers
proviennent du cordon, donc du Grand-Lyon et 8,6% proviennent de l'inter-scot
(les 10 SCOT de l'aire métropolitaine lyonnaise forment l'inter-scot).
Seulement 6,5% des véhicules ont une provenance extérieure
à l'aire métropolitaine lyonnaise.
La majorité des flux a pour origine le cordon et pour
destination l'inter-scot (65,8%). La seconde destination des flux est le reste
de la région Rhône-Alpes (16,6%) des flux. Ici, le reste de la
région Rhône-Alpes correspond essentiellement à l'ouest
lyonnais non intégrée dans le SCOT de l'ouest lyonnais. Ainsi,
Lyon échange 4 fois plus avec sa proche banlieue qu'avec le reste de
Rhône-Alpes.
Sur l'ensemble des flux, 76,5% ont pour destination
l'inter-scot, 19,7% Rhône-Alpes et seulement 3,7% prennent la direction
du reste de la France ou de l'étranger. L'aire métropolitaine est
un véritable carrefour routier duquel partent et par lequel transitent
de nombreux flux.
Les flux de grand transit ne concernent que 38
véhicules, soit 0,45%. La RN489 n'est donc actuellement pas un axe de
grand transit, mais est surtout importante dans l'aire métropole
lyonnaise. L'A89 permettra d'écouler des flux de grand transit
d'orientation EstOuest. Si aujourd'hui seulement 38 véhicules
légers effectuent ce trajet via la RN489, on peut supposer qu'avec le
confort proposé par l'A89, ce chiffre augmentera. Sans quoi,
réaliser une liaison Est-Ouest pour 38 véhicules n'aurait pas
grand intérêt.
Pour les poids lourds, les flux en provenance du cordon et
à destination de l'inter-scot ou du reste de la région
Rhône-Alpes sont aussi les plus importants. Cependant, nous avons
observé la domination sans conteste des flux à destination de
l'inter-scot pour les véhicules légers. Pour les poids lourds, la
donnée est différente. Les flux de poids lourds en provenance du
cordon et à destination de l'inter-scot ne représentent que 32%
de l'ensemble du trafic des poids lourds. Les flux en provenance de l'ouest de
la région Rhône-Alpes et à destination de l'inter-scot (30)
sont bien inférieurs aux 104 véhicules provenant du reste de la
France. L'ouest lyonnais (SCOT ouest lyonnais exclus) approvisionne moins
l'agglomération lyonnais que ne le font le reste de la France ou les
autres pays. En revanche, les flux en provenance de l'agglomération
lyonnaise sont plus importants à destination de l'ouest lyonnais que
vers le reste de la France. On peut en conclure que Lyon alimente l'ouest
lyonnais mais l'ouest lyonnais n'alimente pas Lyon. L'ouest lyonnais est une
périphérie peu dynamique de Lyon qui peut déstabiliser son
fonctionnement. Il n'apporte qu'un faible poids économique à
l'agglomération lyonnaise. La volonté de
rééquilibrer l'étalement de l'aire métropole
lyonnaise vers l'ouest, notamment via l'A89 permettrait de contrebalancer le
déficit économique de l'ouest lyonnais. Toutefois, le faible
poids économique de l'ouest lyonnais est du à son
caractère résidentiel.
Le trafic de grand transit ne concerne que 9 poids lourds.
Ajoutés aux 38 véhicules légers, 47 véhicules
effectuent un trajet de grand transit. Ce chiffre ne signifie pas que seulement
47 véhicules par jour traversent la France d'Est en Ouest. En effet,
nous avons vu que le grand transit préfère emprunter les voies
rapides et donc l'A47 via Saint-Etienne puis l'A72 ce qui explique le faible
passager par la RN489. L'A89 devrait relancer le grand transit passant par le
Nord-Ouest de Lyon.
Pour conclure, on peut distinguer le trafic d'échange
à partir du cordon (agglomération lyonnaise) et le trafic de
transit. Le trafic de transit correspond à l'ensemble des flux n'ayant
ni pour origine et destination l'agglomération lyonnaise. Les flux
d'échange représentent 80% de l'ensemble des flux alors que les
flux de transit ne sont équivalents qu'à 20%. La carte cidessous
représente la part de chacun de ces deux types de trafic, tous
véhicules confondus. Pour information, les flux d'échange se
décomposent ainsi : véhicules légers (6896) et poids
lourds (600) ; quant aux flux de transit, ils se découpent ainsi :
véhicules légers (1226) et poids lourds (565).
Précédemment, nous avons indiqué que la part des poids
lourds sur la RN489 correspondait à environ 12,5% de l'ensemble des
flux. L'étude de l'origine et de la destination des poids lourds nous
montre qu'ils représentent 8% des flux d'échange et 31% des flux
de transit.
Figure 56 : Répartition du trafic :
échange/transit sur la RN489
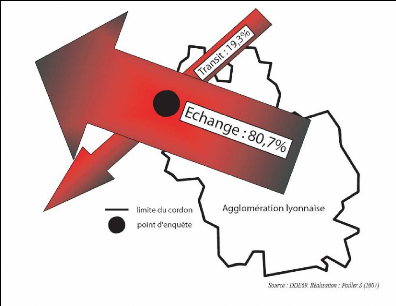
2.3 : Les déplacements dans le Roannais
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne a
réalisé en 2002 une étude sur les mobilités
domicile-travail dans le département de la Loire. Les chiffres qu'elle a
utilisés sont issus du recensement de la population de 1999. Elle a
observé les déplacements des trois arrondissements du
département. Nous n'observerons que celui de Roanne, qui est le plus
concerné par la future A89.
Pour comprendre les déplacements dans le Roannais, nous
allons observer les différents motifs de déplacements : les
trajets domicile-travail, l'accompagnement scolaire et les achats.
2.3.1 : Les déplacements domicile-travail dans le
Roannais
Figure 57 : Les déplacements
domicile-travail : entrées et sorties de l'arrondissement de
Roanne
en 1999
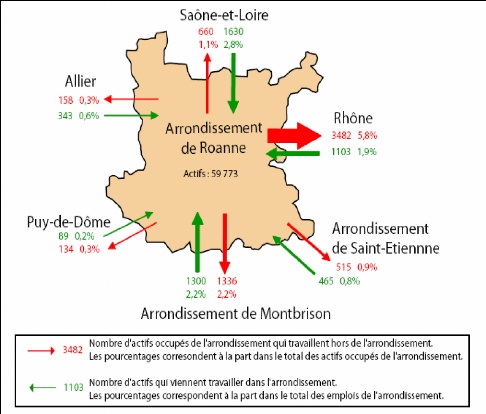
Source : CCI Saint-Etienne. Réalisation : Pailler.S
(2007)
L'arrondissement de Roanne, pôle économique du
Nord de la Loire, connaît de nombreuses migrations quotidiennes de
travail. Mais Roanne n'attire pas beaucoup d'actifs, au contraire, elle en
émet plus qu'elle n'en reçoit. Les deux seuls départements
qui émettent plus de flux qu'ils n'en reçoivent de Roanne sont
l'Allier et la Saône-et-Loire. Ceux deux départements, sont,
à proximité de Roanne, essentiellement ruraux. Il s'agit donc
d'un
échange classique entre un espace urbain et un espace
rural. Ici, un espace urbain attire les ruraux d'autres départements.
Cette attraction de Roanne sur les espaces ruraux n'en fait
pas un arrondissement attractif. En effet, sur l'ensemble des échanges
avec le Rhône, le Puy-de-Dôme et les deux autres arrondissements de
la Loire, le solde émission/réception d'actifs est
négatif. Ceci signifie qu'il y a plus d'actifs qui partent travailler
hors de l'arrondissement de Roanne que d'actifs qui viennent y travailler. Lyon
est une métropole qui attire car elle reçoit plus de flux qu'elle
n'en émet. Roanne est en perte de vitesse économique et les
possibilités de relance économique offertes par l'A89 doivent
être gérées au mieux pas les pouvoirs publics Roannais.
Les départs de Roanne vers le Rhône sont les plus
nombreux. Il sont supérieurs au total de l'ensemble des autres
déplacements sortant de Roanne, et donc supérieurs aux
déplacements vers le reste du département de la Loire. Nous avons
donc une remise en cause des limites du département. Roanne fait certes
partie du département de la Loire mais 5,8% de ses actifs travaillent
dans le Rhône contre seulement 3,1% dans le reste du département.
Roanne est orientée vers le Rhône, et non vers la Loire. Si l'A89
favorise le désenclavement de Roanne, ce ne sera en direction du Sud de
la Loire mais bien du Rhône, voire de Balbigny si la zone
d'activité en projet est réalisée. Les nouvelles
mobilités engendrées par l'A89 conforteront la création
d'un nouveau territoire au Nord de la Loire, dont les limites
différeront des limites des territoires politiques et administratifs
actuels. L'A89 pourrait alors remettre encore plus en cause le découpage
administratif du département. Balbigny marquerait la limite entre les
deux territoires.
2.3.2 : Les mobilités liées aux
accompagnements scolaires
Figure 58 : Distance aux établissements
scolaires dans le roannais
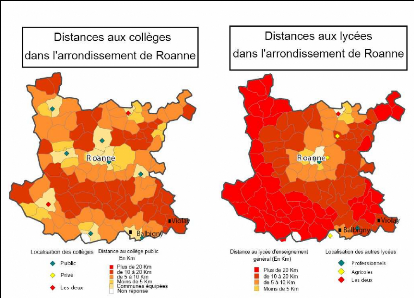

Roanne, et son agglomération sont bien
équipées en collèges et lycée. En revanche,
l'arrondissement de Roanne est plus dépourvu. Toute la partie ouest de
l'arrondissement se trouve à plus de 20km d'un lycée. L'espace
situé entre Roanne et Balbigny se trouve à plus de 20km d'un
établissement d'études secondaires. Il s'agit d'un espace rural.
Balbigny est doté d'un collège et d'un lycée, elle est la
seule commune du Sud de l'arrondissement à disposer de ces deux
établissements. Sur le tracé de l'A89, les communes ne disposent
pas d'établissements scolaires de ce type. Les élèves de
ces communes se rendent à Balbigny pour suivre les cours du
collège et du lycée. L'arrondissement de Roanne est globalement
mal équipé en établissements d'études secondaires,
ce qui augmente le nombre et la longueur des déplacements pour s'y
rendre
2.3.3 : Les mobilités liées aux achats dans la
Loire
Figure 59 : Attractivité des
hypermarchés de la Loire
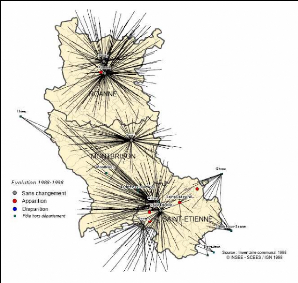
Les supermarchés du Roannais attirent les habitants de
tout l'arrondissement et quelques uns de Saône-et-Loire et du
Rhône. Ils n'attirent pas les habitants du reste du département de
la Loire. Les hypermarchés présents dans l'arrondissement de
Roanne se concentrent dans l'agglomération roannaise. Cette localisation
nécessite des déplacements de longue distance pour s'y rendre.
2.3.4 : L'enclavement provoqué par l'éloignement
à l'autoroute Figure 60: Distance à une bretelle
d'autoroute en 1998
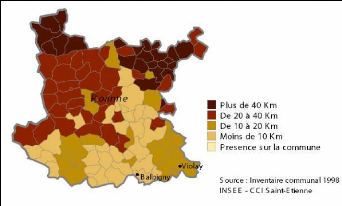
Le Nord de l'arrondissement de Roanne se trouve à plus
de 40km d'un accès à une autoroute (ici, l'A72). Ainsi, il faut
au minimum 40 minutes à un habitant de l'extrême nord du
département de la Loire pour accéder à une autoroute. La
mise en place de l'A89 ne changera pas la distance à un accès
autoroutier. Cependant, la mise ne 2*2 voies de la RN82 entre Roanne et
Balbigny réduire la distance-temps entre ces deux villes. Nous avons vu
précédemment que les Roannais avaient meilleur
intérêt d'accéder à l'A89 à Tarare. La mise
en 2*2 voies de la RN82 ne réduira pas le temps de parcours vers le
Rhône, mais vers le Sud (plaine du Forez, Saint-Etienne). L'A89, qui
porte tous les espoirs de Roanne pour son désenclavement semble
être trop au Sud de la ville pour que celle-ci en tire pleinement
profit*. Toutefois, Roanne pourra tenter d'attirer à elle une partie des
flux Est-Ouest de l'A89 pour essayer de relancer son économie.
2.3.5 : Bilan des flux en direction de Roanne
Figure 61: Flux vers la ville la plus
fréquentée, Roanne, en 1998
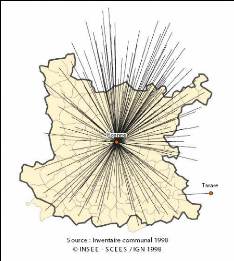
*Lucien Deveaux, président de la CCI de Roanne
déclare en 2001 : « C'est notre dernière chance sur le
plan économique et démographique... On a l 'exemple de
vallées qui n 'ont pas été irriguées et qui ont
été rayées de la carte. C'est le danger que court Roanne
».
Dire que Roanne est le pôle de son arrondissement est
une évidence, mais cette carte le rappelle. Tous les flux convergent
vers Roanne qui attire grâce à ses entreprises, ses services, ses
établissements scolaires, ses grandes surfaces... Au Sud de
l'arrondissement, deux communes sont attirées par Roanne, mais on peut
dire que l'influence de Roanne dans la Loire se limite à son
arrondissement. Elle a une influence très importante sur la
Saône-etLoire au Nord. On remarque enfin que la commune de
Saint-Cyr-de-Valorges est plus attirée par Tarare que par Roanne.
Le roannais fonde ses espoirs de développement sur
l'A89. Son développement économique est tourné vers le
Rhône. Or, le seul axe qui relie Roanne à Lyon et au
département du Rhône en général est un axe ancien
qui ne peut plus assurer une qualité de circulation suffisante. Roanne
est donc enclavé. Pourtant, étant donné que Roanne est le
pôle du Nord, elle continue d'attirer les habitants et actifs des
campagnes voisines. L'amélioration des conditions de circulations
offerte par l'A89 est considérée par les acteurs
socioéconomiques Roannais comme un facteur de relance économique
et de désenclavement. Les mobilités dans le Roannais remettent en
cause les limites administratives du département de la Loire qui n'en
reflètent pas les activités socio-économiques.
-3-
LES EFFETS ATTENDUS
DE l'A89
Nous venons d'observer la situation actuelle des flux de
transports dans l'ouest lyonnais. La mise en place de l'A89 devrait engendrer
des modifications dans l'organisation des espaces, dans la répartition
des flux et des mobilités. Il est intéressant de se projeter dans
l'avenir pour estimer les effets que peut avoir l'autoroute sur l'ouest
lyonnais. Notre analyse prospective s'appuiera sur des réflexions issues
de la géographie des transports, en prenant en compte les
différents projets d'aménagement de l'ouest lyonnais. Nous
terminerons en évoquant les effets connus d'une autre section
autoroutière pour les comparer aux effets attendus de l'A89.
I - Réflexions sur l'aménagement du
territoire par
les transports
Les éléments de réflexion qui vont suivre
permettent de cadrer épistémologiquement l'étude
prospective des effets de l'A89. Ils sont issus des courants de pensée
actuels. Les citations d'auteurs, d'ordre général, apparaissent
en italique et les réflexions personnelles qu'elles ont suscitées
ont une police classique.
1- Les effets des transports
La notion d'effets a alimenté de nombreux
écrits. Parmi eux, nous retiendrons celui de Jean-Marc Offner : «
Les effets structurants du transport : mythe politique, mystification
scientifique » publié en 1993.
De nombreuses études mettent en doute la
réalité d'une causalité linéaire entre le
développement d'une offre nouvelle de transport et des transformations
spatiales, sociales ou économiques. Dire qu'il existe des effets
structurants de reviendrait à dire que l'on peut prévoir les
conséquences de l'implantation d'une autoroute, comme si ces
conséquences étaient mécaniques (donc
répétitives et prévisibles) (Offner, 1993, p.2).
Dans son article critique des effets structurants, Offner
prend l'exemple de l'extension du réseau de tramways à Los
Angeles à la fin du XIXème siècle. On constate que
l'étalement urbain de Los Angeles se fait simultanément à
l'extension du tramway. Il paraîtrait alors logique, a priori, de penser
que le tramway est à l'origine de l'extension de la ville, et qu'il a
« fait la ville ». On en déduit
alors les effets structurants des transports. Mais ce raisonnement est
infondé scientifiquement. La nouvelle organisation de la ville s
'inscrit dans une représentation de l'habitat qui apparaît au
milieu du XIXème siècle aux Etats-Unis (Offner, 1993, p.3) :
la possession d'une maison individuelle dans un cadre périurbain, voire
rural. Le tramway n'est pas la cause de l'étalement, il est simplement
une technique favorisant la volonté de desserrement et
d'éloignement des centres.
Il cite Plassard : La vision simpliste de
mécanismes de cause à effet ne peut être conservée
dès qu 'on étudie les relations entre autoroute et
développement régional (...). Il faut affirmer clairement que de
telles déclarations sur les bienfaits des autoroutes, nombreuses chez
les hommes politiques, ne reposent sur aucun fondement scientifique (...). L
'introduction de la notion de potentialité semble être une voie
efficace qui permette ce changement de conception. Il convient de s `affranchir
de toute vision déterministe dans la géographie des transports
(Plassard, 1977).
Il ajoute aussi une citation de Harmelle : la route, les
moyens de transport, ne sont ni au fondement ni les moteurs de l
'échange et de la bonne fortune mais au contraire, sur un espace
quelconque, quand pré existent des motifs d'échange, des
pôles de production, un désir du dehors (...), alors des routes
sont frayées, des techniciens innovent, des moyens de transport plus ou
moins adaptés voient le jour (Harmelle, 1982).
Enfin, il rappelle qu'Arthur Young, parcourant les routes de
la France avant 1789, s 'émerveille de leur qualité. Il dit
qu 'elles sont les plus belles d 'Europe, les mieux construites, les mieux
entretenues, les plus larges. Mais il les trouve
désespérément vides de trafic, alors que les chemins
boueux et incommodes de l 'Angleterre de la même époque sont
encombrés. (Offner, 1993, p.4).
Offner pense que : Une des erreurs commises pour analyser
les effets d'une autoroute est de comparer un `avant' et un `après' l
'autoroute, comme si la variable `transport' pouvait être
étudiée comme un élément isolé. Une vision
systémique (l 'infrastructure de transport est intégrée
dans un système géographique, économique, social...) du
changement vise à prendre en compte tous les facteurs d'évolution
de l 'espace. Cela permet de ne pas décontextualiser l 'autoroute du
contexte politique, économique, social qui a permis sa
réalisation. (Offner, 1993, p.5). L'étude que nous nous
sommes proposés de faire ici tentait d'inscrire les transports dans
l'espace auquel ils appartiennent. Des éléments
géographiques, économiques et sociaux ont été
abordés. Leur prise en compte sera indispensable à une analyse
des effets de l'A89 après sa construction.
De plus, une nouvelle offre de transport peut ne pas
modifier les comportements de déplacement si les usagers du
réseau actuel ne considèrent pas la nouvelle infrastructure comme
une aubaine à saisir (Offner, 1993, p.6).
A chaque espace, chaque activité, chaque
société correspond un moyen de transport optimal. Pour rendre
compte des relations entre transport et organisation de socio-économique
de l'espace. La notion de « congruence » est utilisée par
Offner pour décrire ces relations. La congruence permet de saisir
les tendances structurelles préexistantes dans lesquelles l
'infrastructure s 'intègre. On peut ainsi mieux comprendre l 'histoire
des transports et préparer plus scientifiquement l'avenir (Offner, 1993,
p. 7).Une infrastructure, pour qu'elle permette un
développement, doit s'intégrer au mieux dans la
société qui la construit et répondre à ses
objectifs. L'autoroute n'engendrera pas un type de développement, elle
permettra de mettre en place un projet de développement dans lequel elle
est intégrée. Nous étudierons par la suite les projets de
l'ouest lyonnais.
Pourtant, les effets d'une autoroute servent le discours
des politiques et alimentent la presse car ils permettent d'expliquer
clairement les choses et de présenter les intérêts da
réalisation (Offner, 1993, p.8). Les acteurs politiques du roannais
par exemple affirment publiquement que leur salut viendra de l'autoroute.
Ainsi, les défenseurs de l'autoroute créent une
mythification autour de ses effets structurants. Ce mythe
légitime leur action. Les discours politiques simplifient les recherches
scientifiques pour défendre leur projet. Le mythe politique a ses
limites, en raison d'une insuffisance conceptuelle. La géographie des
transports doit renouveler ses paradigmes pour pouvoir prendre en compte le
caractère dynamique et stratégique des interactions entre
transport et espace (Offner, 1993, p.10). Varlet confirme cela quelques
années plus tard : le fondement des recherches est bien passé
d'une simple logique d'effets à une logique d 'interactions
(Geocarrefour, 2002).
L'étude des effets de l'A89 ne devra pas être
fait dans une logique de tronçon mais dans une logique de réseau.
Les conséquences de la mise en service d'infrastructures vont
dépendre des stratégies qui seront mises en place par les divers
acteurs socio-politicoéconomiques. La nouvelle infrastructure produit
des effets de réseau qui influent sur les mobilités (choix de
l'itinéraire ou du mode de transport (Plassard, 2003). Avec l'A89,
les usagers entre Roanne et Lyon auront le choix entre la RN7 et l'A89 et entre
l'automobile et le
train. Les effets d'une autoroute dépendent et sont
fonction des stratégies d'acteurs qui l'accompagnent.
2- Réflexions sur la géographie des
transports et le lien entre transport et aménagement du territoire
Ces réflexions sont tirées d'un ensemble
d'ouvrages consultés durant la réalisation de l'étude.
La croissance de la mobilité résulte de
l'amélioration de l'accès aux ressources (les moyens de
communication et de transport étant plus performants, il est plus
aisé de se déplacer). La mise en place de l'A89
déclenchera de nouvelles mobilités par les améliorations
de circulation qu'elle offrira.
L 'accessibilité d'un lieu ne renvoie pas
uniquement à la possibilité d'atteindre ou non un lieu mais elle
reflète la pénibilité du déplacement. On
considère que l 'accessibilité est mauvaise quand les
investissements à fournir pour accéder à un lieu peuvent
conduire au renoncement du déplacement. Les indicateurs
d'accessibilité reflètent la performance du système de
transport. En 1992, le Commissariat Général du Plan indique que
l'aménagement du territoire consiste à « donner des chances
comparables de développement aux territoires urbains et ruraux par une
amélioration substantielle de leur accessibilité ». L
'enclavement d 'un lieu est la conséquence de sa mauvaise
accessibilité. Un territoire est dit `enclavé' quand il est
entouré par des territoires beaucoup mieux accessibles que lui. Les
investissements d'infrastructures de transport constituent la composante
première du désenclavement. La Loi d'Orientation pour
l'Aménagement et le Développement du Territoire (LOADT) de 1995
stipule que « en 2015, aucune partie du territoire français
métropolitain continental ne sera situé à plus de
cinquante kilomètres ou quarante cinq minutes d'automobile soit d'une
autoroute, soit d'une route express à deux fois deux voies en
continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par
le réseau à grande vitesse ». Or, cet
aménagement coûte cher aux collectivités. Ainsi, les axes
prioritaires sont ceux qui ouvrent les territoires les plus peuplés.
C'est pourquoi les mailles du réseau structurant de l'ouest lyonnais
sont très grandes. A l'intérieur de ces mailles, l'irrigation des
espaces est difficile. La liaison Balbigny - La-Tour-de-Salvagny coûtera
environ un milliard d'euros. Cette somme ne pouvant être
supportées par la collectivité, la concession a été
attribuée aux
ASF. Sans cette concession, l'A89 n'aurait pu être mise
en service, ou aurait creusé un déficit énorme dans les
caisses de la collectivité. L'A89 et la mise en deux fois deux voies de
la RN82 constituent une réponse à la directive de la LOADT de
1995.
Grâce à la réalisation du `maillon
manquant', l'A89 se retrouve intégrée dans un réseau de
flux internationaux. Le réseau européen supporte une
quantité de plus en plus importante des flux de transit, pour lesquels
on ne peut pas dire qu 'il y aurait équivalence entre la croissance du
trafic et l 'intérêt des régions traversées. L
'accroissement du trafic de transit va développer davantage les effets
de pôle que les effets de traversée. Les grands centres
émetteurs ou récepteurs de trafic vont bénéficier
des améliorations de l 'accessibilité, mais les régions
traversées ne vont récolter aucun avantage de ce trafic qu 'elles
ne verront que passer, peut-être même en subiront-elles les
nuisances, en termes de coupure spatiale, de bruit, d'encombrement et de
pollution. La situation de la région Rhône-Alpes illustre bien
cette transformation : bénéficiant d'un axe autoroutier nord-sud
qui, en théorie lui donne une bonne accessibilité vers la
Méditerranée et vers Paris, elle n 'est en réalité
plus en mesure d'en bénéficier en raison de l 'importance du
trafic de transit. Non seulement celui-ci ne peut plus s 'écouler de
façon fluide, mais en plus les infrastructures qu 'il sature deviennent
inutilisables pour les déplacements régionaux. On assiste
à une simplification du réseau de transport, délaissant
les noeuds intermédiaires (Plassard, 2003). L'A89
n'améliorera pas les caractéristiques intrinsèques de la
RN7. Pour profiter des effets de traversée induits par l'autoroute, les
pôles régionaux (Balbigny, Tarare, l'Arbresle)
bénéficieront d'un échangeur. Le développement d'un
réseau routier autour de ces échangeurs est nécessaire
pour assurer la diffusion du trafic routier à travers tout le territoire
concerné par l'A89. La mise à deux fois deux voies de la RN82 au
Nord de Balbigny répond à cet objectif d'amélioration de
la diffusion du trafic vers Roanne. En revanche, la RN7 à Tarare et
l'Arbresle ne peut accueillir convenablement l'écoulement des flux de
l'A89. Des travaux sont nécessaires.
L'A89 permettra de raccourcir l'espace-temps entre deux
communes, entre deux échangeurs alors que les relations avec les autres
points de l'espace resteront inchangées. Il s'agit de «
l'effet-tunnel » qui favorise les échanges entre les deux communes
reliées par l'autoroute au détriment des échanges avec les
communes intermédiaires. Balbigny et Tarare seront reliées par
l'A89, leurs échanges pourraient alors s'accroître grâce au
gain de temps permis par l'A89. Les échanges entre Balbigny et Violay ne
pourraient être améliorés. Ils pourraient même
diminuer si Balbigny renforce ses échanges avec Tarare. L'A89 provoque
ainsi un froissement de l'espace, pour reprendre l'expression de Jean
Viard. Les transports
redessinent les contours administratifs et isolent certains
espaces au profit des pôles. D'après Plassard, les transformations
de la structuration de l'espace engendrées par l'A89 peuvent constituer
à terme deux espaces superposés ayant chacun sa propre logique de
fonctionnement. On aurait d'une part un espace constitué par l'ensemble
des villes bien reliées entre elles par l'A89 (la distance-temps entre
ces communes sera réduite) et d'autre part les communes où les
déplacements seront toujours fonction de distance parcourue.
Le développement du réseau autoroutier fait que
l'on doit de moins en moins parler des effets de tronçons autoroutiers
mais de plus en plus parler des effets de réseau autoroutier.
L'intérêt du tronçon Balbigny - Lyon dans cette approche
réside davantage dans la fermeture du réseau inachevé que
dans la possibilité d'écouler une trafic local ou
régional. Une étude ultérieure sur les effets de l'A89,
proposée par la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs
(LOTI) du 30 décembre 1982*, devra considérer l'A89 dans son
ensemble et non pas uniquement les 50 derniers kilomètres de
l'autoroute.
* La loi LOTI incite les sociétés en charge de
grands projets d'infrastructures à évaluer l'efficacité
économique et sociale de ceux-ci dans les trois à cinq ans qui
suivent leur mise en service. Il s'agit du `bilan LOTI'. Au-delà de
cette incitation, les sociétés concessionnaires d'autoroutes
telles que ASF ont mis en place un observatoire d'autoroute qui permet,
grâce à des recherches universitaires, d'établir ce
bilan.
II - Les projets d'aménagement de l'ouest
lyonnais
1- Les compatibilités d'A89 avec la Directive
Territoriale d'Aménagement lyonnaise (DTA)
1-1 : Concilier trafic de transit et trafic
métropolitain
L'aire métropolitaine lyonnaise se trouve sur un
carrefour d'échanges Nord/Sud - Est/Ouest, régionaux, nationaux
et internationaux. Ses échanges viennent s'ajouter au trafic
métropolitain. Le principal objectif d'aménagement de la
métropole lyonnaise, et de l'ouest lyonnais en particulier, est
d'arriver à créer une harmonie entre les flux de transit et les
flux locaux, pour que l'un n'empêche pas le bon fonctionnement de
l'autre. Le niveau de service offert par le système de transport de
l'aire métropolitaine lyonnaise doit permettre un trafic
d'échanges efficace et subvenir aux besoins des mobilités dans la
métropole elle-même. Actuellement, la métropole est
très bien reliée aux réseaux autoroutier et ferroviaire
nationaux et européens mais son accessibilité n'est pas optimale
du fait des problèmes de circulation et de la saturation
rencontrés sur les axes desservant Lyon (enclavement fonctionnel par
dysfonctionnement des réseaux). La DTA vise une amélioration de
l'accessibilité de la métropole lyonnaise.
Comme nous l'avons vu, la voiture est le mode
préférentiel pour les déplacements dans la
métropole lyonnaise. Réduire la circulation automobile
permettrait de rendre plus fluides les déplacements internes de la
métropole. Ces déplacements, et notamment les déplacements
domicile-travail, n'ont cessé d'évoluer vers un allongement des
distances. La mise en service de l'A89 doit être particulièrement
encadrée pour ne pas contribuer à l'étalement urbain, et
ainsi augmenter l'allongement des distances des trajets domicile-travail. Les
transports collectifs doivent être renforcés pour améliorer
leur attractivité et permettre un basculement de certains usagers de la
voiture individuelle au transport en commun, et ainsi, de limiter la croissance
du trafic automobile. Mais l'automobile n'est pas le seul facteur de
l'encombrement des axes routiers. La qualité de circulation sur un axe
routier est aussi fonction de la part des poids lourds. Le report des
marchandises produites et consommées par la métropole sur
d'autres modes de transport que la route, tel que le fer est une solution
à la réduction des poids lourds. En effet, les activités
de l'aire métropolitaine génèrent un trafic
fret en augmentation avec en conséquence le risque de
saturation et d'accroissement des nuisances.
1.2 : La concertation est nécessaire pour
développer une stratégie de développement à
l'échelle métroolitaine
Les acteurs publics du territoire de la métropole
demandent la lisibilité de l'ensemble des projets de l'Etat à 20
ans et leur inscription dans un système qui montre la cohérence
des projets de l'Etat entre eux, mais aussi leur cohérence avec les
projets des différentes autorités organisatrices de transport. La
coopération entre les Autorités Organisatrices de Transport (AOT)
est nécessaire pour harmoniser les horaires, l'information, la
billettique, la tarification et pour débattre des priorités en
matière d'investissement. La concertation et la coopération
à l'échelle métropolitaine sont nécessaires pour
harmoniser les projets dans une politique globale de développement. Les
politiques de transports ne peuvent continuer d'être
étudiées sectoriellement. Les transports doivent être
pensés de manière globale afin de coordonner les modes de
transports entre eux. Cela passe notamment par la modification des
systèmes de tarification s'ils ne sont plus adaptés aux nouvelles
mobilités. Depuis fin 2006, une première étape a
été franchie avec la mise en place d'un titre de transport
unique, avec une tarification commune selon la zone dans laquelle se
déroulent les trajets. Il s'agit par exemple de la carte OURA qui permet
au voyageur de ne pas être obligé de se procurer un billet pour
chaque mode de transport qu'il utilise dans une zone donnée. Ceci
facilite l'intermodalité.
2- Le projet de Contournement Ouest de Lyon : une
infrastructure complémentaire à l'A89
Lyon souhaite écarter les trafics de transit des zones
urbaines avec des contournements routiers, tout en respectant les contraintes
environnementales et urbanistiques. Le Comité Interministériel de
l'Aménagement et du Développement du Territoire (CIADT) du 18
décembre 2003 énumère les infrastructures qui sont
à réaliser. Le Contournement Ouest de Lyon est l'un des grands
projets de la DTA lyonnaise.
L'objectif du contournement autoroutier est de sortir le
trafic de transit de l'agglomération lyonnaise. Conformément au
schéma arrêté par le CIADT du 18 décembre 2003, le
contournement autoroutier de Lyon se fera à l'ouest de
l'agglomération car il fait
passer les flux de transit de Villefranche-sur-Saône
à Vienne à l'écart de l'agglomération, tout en
captant les flux issus de l'A 45 et de l'A 89 et en reliant mieux les
agglomérations stéphanoise et roannaise à la vallée
du Rhône.
Le contournement autoroutier à l'ouest de Lyon ne
comprendra aucun diffuseur avec le réseau de voirie locale, et visera en
particulier, à une consommation minimale d'espace. A l'inverse, les
diffuseurs prévus sur les autoroutes radiales en projet, l'A89 et l'A45,
ellesmêmes connectées au contournement : pourraient voir les
territoires situés à moins de 10-15 minutes de ces diffuseurs
subir une forte pression, pour le développement résidentiel comme
pour les installations à vocation économique (cf. V.
Vandaele, 2007).
La réalisation du contournement n'atteindra son
objectif que si les infrastructures libérées dans le centre de
l'agglomération, autoroutes A6 et A7 dans leur traversée
Fourvière/Perrache, sont rapidement requalifiées en boulevard
urbain. Sinon, la capacité libérée par le trafic de
transit lors de la mise en service du contournement (COL) sera
appropriée par du trafic local, ce qui serait contraire aux orientations
de la DTA et aux objectifs du plan des déplacements urbains (PDU) de
l'agglomération lyonnaise. L'articulation des calendriers des mises en
service du contournement autoroutier à l'ouest (COL), du Tronçon
Ouest du Périphérique (TOP) et de la requalification des
autoroutes A6/A7 dans le secteur de Fourvière/Perrache est
impérative.
Le COL est donc un projet complémentaire de celui de
l'A89. Sans sa réalisation, l'A89 débouche dans l'aire
métropolitaine lyonnaise si elle n'a pas de liaison avec l'A6/A46, elle
ne joue alors pas son rôle de liaison vers l'Est de la France et
l'Europe.
3- L'indispensable liaison A89 - A6/A46
Le tout premier tracé de la section Balbigny - Lyon de
l'A89 était une liaison A72 - A6. La partie terminale du tracé a
été abandonnée pour des raisons de nuisance
environnementale, ce qui arrêta complètement le projet Balbigny -
Lyon. La renaissance du projet était dépendante d'un nouveau
tracé terminal. L'achèvement de l'A89 a donc été
établi à La-Tour-de-Salvagny.
Cependant, le Plan de Déplacement Urbain de Lyon
précise qu'aucune voie « pénétrante » ne peut
être construite dans l'agglomération lyonnaise. Or, l'A89,
à l'heure actuelle, s'achèverait à l'entrée du
Grand-Lyon, ce qui serait contraire aux orientations du PDU. C'est pourquoi il
est nécessaire de réaliser une infrastructure permettant
d'assurer une
continuité autoroutière avec l'est lyonnais,
sans passer par Lyon. Si aucun aménagement n'est proposé, les
usagers de l'A89 auront deux possibilités pour se rendre à l'Est,
soit ils empruntent le TEO, qui, nous l'avons vu, connaît un trafic
surchargé, soit ils rejoignent l'A6 puis l'A46. Cette solution est la
plus probable, mais actuellement, les routes permettant d'accéder
à l'A6 ne peuvent écouler ces flux, elles ne peuvent supporter
une telle charge de trafic. C'est pourquoi il convient de les aménager.
Elle constituerait la partie nord du COL et ferait la liaison avec l'A6.
L'ancien ministre des transports, Dominique Perben, affirme, lors du
débat du 7 février 2006 au Sénat, que cette section sera
aménagée : « Je reviens sur le raccordement à
hauteur de Lyon. Il a été évo qué lors de
l'enquête publique de 2001 et a fait l'objet d'engagements précis
de l'État. Deux aménagements sont prévus : d'une part, le
raccordement de la nouvelle section à l'autoroute A6, qui se fera en
empruntant la voirie existante, laquelle sera aménagée afin de
lui donner des caractéristiques autoroutières ; d'autre part, un
barreau de liaison entre les autoroutes A6 et A46... Les études
d'avant-projet sommaire sont en cours d'achèvement. Les enquêtes
publiques seront lancées à l'été 2007. Mais ces
aménagements devraient être réalisés d'ici à
2012, c'est-à-dire, je le répète, en même temps que
la construction de la partie principale de l'ouvrage ; cela me semble de nature
à rassurer celles et ceux que la question du raccordement aux autoroutes
existantes inquiétait ». D.Perben souligne un
élément important : il convient de finaliser les deux
infrastructures en même temps, sans quoi les flux de l'A89 viendraient
s'accumuler sur la RN7 et dans Lyon. La figure 62 présente cette
liaison.
Figure 62 : la liaison A89/A6
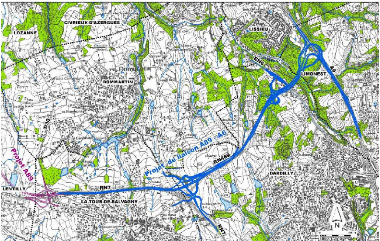
Source : DRE Rhône-Alpes
4- L'A45 : une infrastructure concurrente de l'A89
Le projet d'autoroute A45 est un projet qui ne cesse de faire
couler de l'encre depuis une trentaine d'années. Le trafic sur l'A47 est
très dense et cette autoroute ne permet pas d'assurer une bonne
circulation des flux, à la fois en termes de qualité mais aussi
de quantité. Ces conditions de circulation paralysent le dynamisme de la
vallée du Gier et de Saint-Etienne. La création de l'A45, entre
Lyon et Saint-Etienne serait un axe plus ou moins parallèle à
l'A47 et permettrait de la délester d'une partie des flux, notamment les
flux Lyon - Saint-Etienne. Ainsi, les autoroutes A89 et A45 se verraient
respectivement écouler les flux Clermont-Ferrand - Lyon et Saint-Etienne
- Lyon. L'A47 pourrait alors redevenir une voie rapide urbaine, permettant la
desserte locale. De plus, l'A45 améliorerait l'accessibilité de
Saint-Etienne, ce qui pourrait lui être profitable pour relancer son
économie. Une liaison fiable, de trente minutes environ entre Lyon et
Saint-Etienne faciliterait les échanges entre les deux
préfectures. Ces échanges participent d'un objectif clairement
définit par la DTA : créer une conurbation Lyon - Saint-Etienne
de près de 2 millions d'habitants afin de disposer d'une
métropole régionale pouvant d'importance européenne.
Figure 63 : Les projets autoroutiers de l'ouest
lyonnais
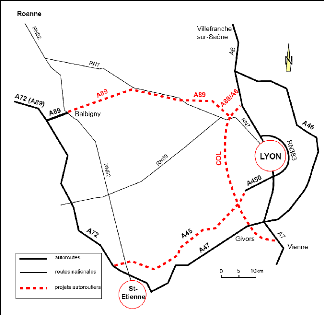
Source : Chatard.S. Réalisation : Pailler.S.
(2007)
5- La concurrence RCEA / A89
La Route Centre Europe Atlantique (RCEA) constitue une des
grandes liaisons EstOuest reliant la façade Atlantique (de Bordeaux
à la Bretagne) au reste de l'Europe. Comme le montre la carte
ci-dessous, la RCEA est une route concurrente de l'A89, elle lui est
parallèle. Elle constitue un itinéraire privilégie pour
les poids lourds car elle est gratuite. Les poids lourds ne peuvent
dépasser 90km/h sur autoroute et les fortes pentes de l'A89 les
ralentissent. En termes de vitesse, la RCEA, de par sa géométrie
(2*2 voies sur une grande partie du tracé) offre quasiment les
mêmes avantages que l'autoroute, outre les ralentissements à
l'entrée des villes.
De plus, de nombreux chauffeurs, slaves et portugais entre
autres, paient les péages autoroutiers en argent liquide. Ils
préfèrent garder cet argent pour eux et emprunter une route
gratuite, même s'ils perdent légèrement du temps.
Enfin, la RCEA est une route « conviviale », sur
laquelle les chauffeurs trouvent des relais routiers plus chaleureux que les
aires d'autoroutes de l'A89 (L.Gatineau, réunion Observatoire A89,
2007).
Figure 64 : Le tracé de la RCEA dans le
réseau autoroutier français

Source :
www.agglo-moulins.fr
Actuellement, les flux de marchandises Est-Ouest utilisent
plus la RCEA que l'A89. En plus des raisons que nous venons d'évoque,
l'A89 n'est pas encore achevée jusqu'à Lyon. Des tronçons
manquent entre Bordeaux et Clermont-Ferrand (ils ne figurent pas sur la carte),
notamment à l'ouest de Brive, entre Terrasson-La-Villedieu et Thenon.
Mais l'A89 sera une liaison autoroutière directe entre Lyon et Bordeaux
d'ici 2012. L'A89 présentera alors un tracé achevé pouvant
rivaliser avec la RCEA. Reste à savoir si les chauffeurs de poids lourds
modifieront leurs habitudes et accepteront de s'acquitter des péages de
l'A89.
6- L'amélioration du réseau ferroviaire
6.1 : Les orientations de la DTA
Le réseau ferroviaire est ici entendu comme comprenant
les lignes elles-mêmes, les connexions aux réseaux de transports
collectifs urbains, les centres d'échanges intermodaux (gares, gares
avec parking de rabattement, gares avec transports collectifs interurbains...).
L'objectif est de réutiliser au mieux les capacités existantes.
Parmi les liaisons régionales intéressant la métropole
lyonnaise, il faut citer, en premier lieu, la liaison ferroviaire Saint-Etienne
- Lyon qui est la plus fréquentée de la région. La part de
voyageurs du mode ferroviaire entre les deux villes pourrait encore être
augmentée grâce à une amélioration du niveau de
service.
Pour rendre possible au plan économique l'accroissement
de l'offre de transport collectif, il faut une densité importante de
demandeurs. En effet, si le nombre de voyageurs est insuffisant, l'offre de
transports est peu satisfaisante (peu de trains, tarifs
élevés...), ce qui laisse la part belle à l'automobile.
L'automobile ne cesse donc de s'accroître ce qui diminue le nombre de
voyageurs sur le réseau ferroviaire. Les recettes diminuent, le
réseau ferroviaire devient moins rentable et cette baisse de
rentabilité diminue la qualité de l'offre. Ceci nourrit l'attrait
pour la voiture. Pour inciter les usagers à choisir les transports en
commun au lieu de à la voiture, le service doit être performant
avec le moins de ruptures de charge possibles. Des études montrent
qu'une amélioration du TER dans l'ouest lyonnais permettrait de
multiplier
par 10 la fréquentation (SYSTRA-SOFRETU-SOFRERAIL,
1996).
Le réseau ferré dessert les secteurs d'urbanisation
ancienne (vallée du Gier), qui sont géographiquement proches des
axes autoroutiers ; il peut desservir aussi des secteurs
d'urbanisation plus récente. Son organisation en
étoile autour de Lyon et de Saint-Etienne peut permettre de mieux capter
les déplacements centre-périphérie.
Le Schéma Régional des Transports (SRT)
approuvé en novembre 1997 par la région Rhône-Alpes
favorise développement des transports ferroviaires régionaux,
pour les liaisons régionales de différentes missions :
inter-cités, maillage régional, comme desserte périurbaine
et desserte locale.
La desserte en transport ferroviaire régional sera
progressivement mise en oeuvre selon les principes de régularité,
de cadencement, de fréquence élevée et de
complémentarité entre trois niveaux de desserte :
inter-cités et maillage régional et périurbain.
6.2 : Les améliorations du réseau
ferroviaire
Pour favoriser les transports ferroviaires et parvenir ainsi
à diminuer la prépondérance des déplacements en
véhicules particuliers, le Réseau Ferré Français
prévoit plusieurs aménagements dans l'ouest lyonnais. Sur notre
zone d'étude, les modifications consisteront à améliorer
la performance du réseau ferroviaire (hausse de la vitesse) et à
proposer un cadencement plus serré et régulier (un train toutes
les 15 minutes). Ce projet a été déclaré
d'utilité publique en Janvier 2007. La ligne Roanne - Lyon sera donc
améliorée ce qui renforcera sa concurrence avec l'A89. De plus,
certains tronçons bénéficient déjà
d'améliorations (l'Arbresle - Lyon), ce qui peut habituer les usagers
à l'usage du TER.
Sur la ligne Clermont-Ferrand - Lyon, elle aussi concurrente
de l'A89, des projets ont été finalisés depuis 2005,
notamment le raccordement de Saint-Germain-des-Fossés. Clermont-Ferrand
n'est actuellement pas desservie par le TGV et la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Clermont-Ferrand/Issoire souhaite que cette « situation
inacceptable » prenne fin et qu'une liaison TGV relie la préfecture
auvergnate à Lyon : « La Chambre de Commerce et d'Industrie de
Clermont-Ferrand/Issoire demande solennellement que les décisions
urgentes soient prises aux différents niveaux de responsabilité
concernés pour mettre en service, dans les plus brefs délais, une
liaison ferroviaire Clermont-Ferrand/Lyon en 1h30 maximum » (CCI
Clermont-Ferrand, 11/2006). Cette liaison serait aussi une opportunité
pour Roanne, ville par laquelle elle passerait. Une liaison Clermont-Ferrand -
Lyon serait une concurrente directe de l'A89. La figure 65 présente les
nombreux projets ferroviaires de l'ouest lyonnais.
Figure 65 : Les nombreux projets d'amélioration
du réseau ferroviaire
de l'ouest lyonnais
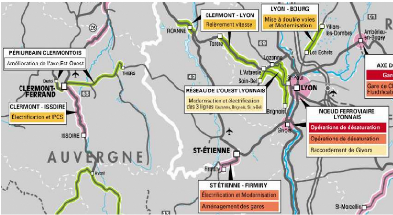
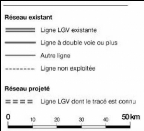
Source : Réseau Ferré Fran çais,
2005
III- Les effets de l'A89
1- Les estimations de trafic : une source fiable ?
La mise en place d'une autoroute modifie l'organisation et les
systèmes d'échanges de l'espace qu'elle traverse.
Le réseau de transports de l'ouest lyonnais progresse
par petites touches et évolue de manière continue. Nous avons vu
que parmi les projets de l'ouest lyonnais, l'amélioration du
réseau ferroviaire et la mise en service de l'A45 sont concurrentes de
l'autoroute A89. A l'inverse, le Contournement Ouest de Lyon est
complémentaire car il améliorerait l'écoulement des flux
de l'A89 vers l'Est et le Nord. Mais l'A45 et le COL ne sont que des projets et
leur mise en service n'est pas certaine. Ainsi, il est difficile de
connaître avec précision l'état du réseau routier
dans 20 ou 30 ans. La DRE, dans la Dossier d'Enquête Publique,
propose des hypothèses sur la répartition des flux de
transports après la mise en service de l'A89. Pour cela, elle
établit plusieurs scenarii qui sont fonction de l'évolution
générale du trafic. Les critères retenus sont le
coût des carburants, le niveau de vie, les variations des coûts du
transport ferroviaire. Ensuite, elle les combine à des hypothèses
de réseau favorables ou non à l'A89 (très
défavorable, défavorable, favorable, très favorable) en
fonction de la concurrence ou de la complémentarité des
infrastructures en projet. La variabilité des critères et la
méconnaissance du future réseau routier font qu'il est difficile
de connaître les flux dans plus ou moins 20 ans. Etudier ici les scenarii
proposés n'apporterait pas une analyse précise, fondée et
vérifiée. Cette étude des effets circulatoires devra
être faite lorsque l'A89 sera en service.
A titre indicatif, voici un exemple de croissance du trafic si
l'on considère que la Taxe Intérieur sur les Produits
Pétroliers continue de progresser et que les tarifs ferroviaires
diminuent.
Figure 66 : Exemple de scénario de
croissance du trafic
VL < 20km : 1,5% par an PL intérieur : 0,5% par an
VL < 20 à 100km : 2,5% par an PL échange : 4,5%
par an
VL > 100km : 3,5% par an PL transit : 5,5% par an
Source : Dossier d'Enquête Publique
Tellement de scenarii sont possibles, en fonction de la
distance parcourue, de l'évolution des critères retenus, de
l'évolution des réseaux de transport qu'il est très
improbable de déterminer quel scénario sera le bon.
2- Les effets connus d'une section de l'A89
Il est intéressant d'observer les effets connus de
l'A89 (anciennement A72) à l'Est de Clermont-Ferrand afin d'estimer les
effets envisageables de l'A89 dans l'ouest lyonnais. Cette section est choisie
car il s'agit de la voie autoroutière qui constituera le tracé
final de l'A89. Ces effets ont été étudiés par M.
Dubost et J.C. Edouard, de l'Observatoire de l'A89 en 2003.
2.1 : Croissance du trafic sur l'A89
L'observatoire de l'A89 a conduit en 2003 une étude sur
les effets de l'A89 à l'Est de Clermont-Ferrand de Thiers à
Noirétable. Il a été constaté une croissance
régulière du trafic autoroutier dès sa mise en service.
Cependant la nature du trafic n'était pas régulière et
l'autoroute était fortement marquée par un
phénomène de saisonnalité en période estivale. Le
nombre de véhicules en gare de Thiers-Ouest a triplé entre 1979
et 2001. Cette croissance n'est toutefois pas univoque sur l'ensemble du
tracé. Le nombre dé véhicules s'intensifie en direction de
l'Ouest, donc de Clermont-Ferrand. L'agglomération clermontoise attire
et émet des flux importants, comme le fait l'agglomération
lyonnaise (dans une moindre mesure tout de même). Deux tendances
apparaissent dans la nature du trafic : la croissance du nombre de
véhicules légers et la diminution de la part des poids lourds
dans le trafic total.
Avant la mise en service de l'autoroute, la RN89 est l'unique
système d'échange routier. Elle constitue donc un axe majeur qui
structure le territoire. Elle relie et dessert un ensemble de bourgs et la
ville de Thiers. Avec la mise en place de l'A89, on assiste à un
véritable « court-circuitage » durant quelques années
de la RN89, même si certains flux subsistent.
2.2 : Les effets sur la RN89
M. Dubost, qui a réalisé cette étude, se
propose de comparer le trafic d'une portion de l'A72 (Thiers-Ouest /
Thiers-Est) à la section de la RN89 correspondante (Les Molles / La
Monnerie-le-Montel). En 1999, le trafic moyen journalier de l'A89
s'élève à 15 236 véhicules alors que les postes de
comptage des Molles et de La Monnerie enregistrent respectivement 7 844 et 6703
véhicules par jour, soit 51,5 % et 44 % des flux circulant sur l'A89. En
1992, sur cette même section, les parts du trafic aux deux points de
comptages étaient de 63,2 % et 48,1 %. Il ne faut pas y voir une baisse
du trafic de la RN89. En effet, les flux de l'A72 ont augmenté et les
flux de la RN89 se sont maintenus. C'est pourquoi la part relative des flux sur
la RN89 a diminué. La RN89 est un axe dont la fréquentation est
identique et soutenue grâce au flux locaux. D'après des
enquêtes locales, l'auteur affirme que la RN89 sert essentiellement aux
flux de courte distance, les flux de longue distance préfèrent
quant à eux l'A89.
La mise en service de l'A89 a eu des conséquences
rapides sur le trafic de la RN89. Le ralentissement, voire la baisse du trafic
sur la RN89 était prononcé durant les années suivant la
mise en service de l'A89. Cependant, après quelques années,
l'itinéraire gratuit entre à nouveau en phase de croissance, ce
qui se traduit par une augmentation des flux. L'autoroute a permis à la
RN89 de se libérer d'une partie de son trafic, ce qui a
amélioré les conditions de circulation sur cet axe. La croissance
des déplacements et du parc automobile a profité de cette aubaine
pour circuler à nouveau sur la RN89 et relancer son dynamisme.
L'autoroute est donc un facteur permettant l'accroissement
général du trafic. L'A89 et la RN89 s'inscrivent dans un contexte
d'accroissement des flux. Si l'A89 a capté certains flux, il s'agit
essentiellement des flux de transit ou d'échanges interurbains.
L'existence d'un système d'échanges à
deux vitesses a induit des comportements sociaux économiques
différents selon l'emprunt de l'itinéraire payant ou gratuit.
Tous les usagers ne peuvent s'affranchir du droit de péage, ce qui les
contraint à continuer de se déplacer sur la route nationale, et y
maintenir ainsi un nombre élevé de flux.
3- Constats préalables à l'étude des
effets de la section Balbigny - La-Tour-de-Salvagny de l'A89 sur l'organisation
spatiale de l'ouest lyonnais
Pour terminer notre étude, nous pouvons évoquer
quelques points essentiels à prendre en considération lors d'une
future étude des effets de l'A89.
Les diffuseurs et échangeurs de l'A89 seront
implantés là où la croissance démographique et
l'activité économique sont les plus élevées. Cette
implantation répond donc à une demande. L'A89 ne pourra alors
être considérée comme l'unique facteur de la croissance de
la population et des activités. Elle peut en revanche conforter les
tendances actuelles : un étalement urbain vers l'ouest de
l'agglomération lyonnaise.
L'A6, sous Fourvière, a connu une baisse de son trafic
à partir de 1994 suite à la réalisation du contournement
Est de Lyon (A46). Après quelques années, le trafic a
retrouvé ses valeurs antérieures. De même, la RN89 à
l'Est de Clermont-Ferrand a connu une baisse de son trafic lors de la mise en
service de l'A89. Les conditions de circulation étant meilleures sur la
RN89, son trafic augmente pour atteindre à nouveau les valeurs
antérieures à la construction de l'A89. On constate donc que la
mise en service d'un axe autoroutier fait chuter considérablement les
flux circulant sur l'axe qu'il vient concurrencer. Après quelques
années, le trafic sur l'axe court-circuité progresse et redevient
le même que celui précédent la mise en service de
l'autoroute. Ainsi, l'autoroute crée un trafic qu'elle supporte
elle-même. A court et moyen terme, elle n'apporte pas
nécessairement un trafic supplémentaire sur les axes initiaux. On
peut supposer que l'A89 prélèvera une partie du trafic de la RN7
durant quelques années. Les conditions de trafic s'améliorant sur
cet axe, il sera de nouveau approprié par de nombreux véhicules,
ceux qui effectuent de courts déplacements. L'A89 pourrait quant
à elle supporter des flux de plus longue distance.
L'autoroute produit un espace à deux vitesses. Les
usagers de l'autoroute sont ceux qui parcourent les plus longs trajets. Les
déplacements locaux préfèrent emprunter la voirie
initiale. Nous avons observé les avantages de la voiture
particulière et du train et avons pu constater que les longs trajets
sont plus économiques en train. Il pourra alors être
intéressant d'étudier la concurrence entre les deux sur
l'ensemble du tracé de l'A89, de Bordeaux à Lyon.
CONCLUSION
GENERALE
Les transports dans l'aire métropolitaine lyonnaise
constituent un enjeu majeur pour son bon fonctionnement. Ils sont
nécessaires à ses échanges mais peuvent aussi la
paralyser. Les mobilités, pour diverses raisons, augmentent constamment
depuis plus de 15 ans. Il convient alors d'envisager des aménagements
qui permettent de faire circuler de nombreux flux dans de bonnes conditions.
Les flux de transports nous ont permis d'identifier
l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais. La proche banlieue lyonnaise est
essentiellement résidentielle. Sa population effectue quotidiennement
une majorité de déplacements pour se rendre sur leur lieu de
travail. La quantité des flux domicile-travail entre Lyon et sa banlieue
ouest permet d'identifier les limites de son influence. Actuellement,
l'influence de Lyon n'a pas encore franchi la limite administrative entre la
Loire et le Rhône dans les Monts du Tararois. Tarare reste un pôle
intermédiaire entre Lyon et Roanne. En revanche, elle l'a atteinte au
Sud-Ouest et de nombreux résidents de la Vallée du Gier, voire de
Saint-Etienne, travaillent dans l'agglomération lyonnaise. Plus
l'influence de Lyon s'étend, plus les mobilités augmentent pour
s'y rendre. L'A89 offre des possibilités d'extension de l'aire
d'influence lyonnaise vers l'Ouest en contractant « l'espace-temps ».
Cet éloignement du centre engendre des déplacements, qui
nécessitent des infrastructures, qui permettront à leur tour de
s'écarter du centre etc... La société crée des
modes de transports qui lui correspondent, qui répondent à ses
besoins. C'est donc la société qui crée les transports.
Mais les nouvelles offres de transports recomposent les territoires qu'elles
traversent, elles en modifient leur fonctionnement, leur organisation. Dans ce
cas, ce sont les infrastructures et les flux de transports qui créent
les organisations spatiales, la société. Ainsi, la
société se crée elle-même et les transports sont un
outil qui permet les changements, les modifications, les mutations de
l'organisation spatiale.
L'automobile est le mode de transport le plus courant.
Pourtant, les chiffres montrent qu'il est moins avantageux que le train,
surtout financièrement. Mais ce dernier souffre d'un manque
d'infrastructures rapides, efficaces, et d'une offre encore insuffisante. Les
projets d'aménagement du réseau ferroviaire, la mise en place
d'une nouvelle tarification, le cadencement des trains... sont censés
favoriser le développement du transport ferroviaire, un mode de
transport qui par ailleurs est moins contraignant pour l'environnement. Le
transport ferroviaire est un mode alternatif au transport routier à
condition d'être optimisé. Toutefois, il est nécessaire de
parvenir à faire évoluer les mentalités. Trop de trajets
sont effectués en véhicule personnel alors qu'ils pourraient
l'être en transport collectif. Il s'agit essentiellement des navettes
domicile-travail qui représentent la part la plus importante des motifs
de
déplacements dans l'ouest lyonnais. L'accroissement de
la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail devrait
à terme ne plus pouvoir être supporté financièrement
par les ménages s'ils continuent d'utiliser autant leur automobile. La
hausse du coût des carburants et l'augmentation des distances parcourues
risquent de donner aux transports une part encore plus importante dans le
budget des ménages. Les transports ferroviaires, grâce à
leurs avantages financiers, s'ils sont aménagés pour satisfaire
une demande grandissante, pourraient réduire sensiblement l'utilisation
de l'automobile.
Le roannais voit en la mise en service de l'A89 entre Balbigny
et La-Tour-deSalvangy une solution à son ouverture et à sa
relance économique. Il ne faut pas oublier que l'autoroute permet
à un territoire d'exprimer au mieux ses capacités et ses
potentialités. Le moteur des échanges est le besoin
d'échanger et non pas la possibilité d'échanger. La mise
en service de l'A89 doit être accompagnée par les acteurs locaux
pour permettre un développement économique. Ce n'est pas
l'autoroute qui créera les richesses mais les stratégies des
acteurs en lien avec l'autoroute. Les négociations pour obtenir la mise
en 2*2 voies de la RN82 de Roanne à Balbigny afin de se relier à
l'A89 ont demandé beaucoup d'efforts. Il est nécessaire de ne pas
considérer l'ouverture économique de Roanne comme acquise par la
simple amélioration de son accessibilité. Les efforts sont
à poursuivre, cette fois-ci pour relancer les activités
économiques et refaire de Roanne une ville attractive.
Il est difficile de prévoir comment s'organisera
l'ouest lyonnais avec l'A89, même si on peut en estimer les grandes
tendances. Cette étude a permis de dresser un portrait de l'ouest
lyonnais et des forces qui l'animent. Elle sera utile à l'étude
des effets de l'A89 lorsqu'elle sera en service. Elle pourra alors permettre
à des chercheurs et des étudiants, de connaître
l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais antérieure à la mise
en service de l'A89.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
BAVOUX, J.J et alii, Géographie des transports,
Armand Colin, 2005, 231p.
BENOIT, J. -M., BENOIT P. ET PUCCI D., La France à 20
minutes. La révolution de la proximité, Belin, 2002,
271p.
BERNADET, M., Le transport routier de marchandise,
Fonctionnement et dysfonctionnements, Economica, 1997, 324 p.
BERTHELOT, J.M. (dir.), Mobilités et ancrages. Vers un
nouveau mode de spatialisation ?, l'Harmattan, 1996, 159p.
BONNAFOUS, A., PATIER-MARQUE, D., PLASSARD, F.,
Mobilité et vie quotidienne, collection transport espace
société, Presses Universitaires de Lyon, 1981, 172p.
BONNET, J., L'automobile dans la ville, le cas de
l'agglomération lyonnaise, Revue Géographique De Lyon,
n°4, 1997.
BONNET, M. ET DESJEUX, D., Les territoires de la
mobilité. Presses universitaires de France. 2000.
DE LA MORSANGLIERE, H., Le transport des banlieusards,
presses universitaires de Lyon, 1982, 291p.
DERYCKE, P.H., Espace et dynamiques territoriales,
Economica, Paris, 1992, 336p.
DUPUY, G., La dépendance automobile, Symptômes,
analyses, diagnostic, traitements, collection Villes, Anthropos, 1999, 1
60p.
ECKERT, D., Evaluation et prospective des territoires,
collection Dynamiques du territoire, Reclus, La Documentation
Française, 1996, 256p.
GENEAU DE LAMARLIERE, I., STASZAK, J.F., Economie et
opacité de l'espace, in : Principes de géographie
économique, Bréal, 2000, 448p.
JOATTON, R., Les transports au futur, collection
Dominos, Flammarion, 1996, 126p.
JOUVE, B., Les politiques de déplacements urbains en
Europe, l'innovation dans cinq villes européennes, l'Harmattan,
2003, 191p.
JOUVE, B. ET LEFEVRE, C., Métropoles
ingouvernables, le réseau de villes comme territoire de la
régulation : la métropole lyonnaise, collection SPET,
ELSEVIER, 2002, 203p.
LEFEVRE, C., OFFNER, J.M., Les transports urbains en
question, CELSE, 1990,221p.
LEVY, J.P., DUREAU, F., L 'accès à la ville,
les mobilités spatiales en questions, l'Harmattan, 2002, 411p.
LEVY, J., LUSSAULT, M., Dictionnaire de la géographie
et de l'espace des sociétés, Belin, 2003, 1034p.
MARCONIS, R., « La gestion des mobilités, La
réorganisation des grands réseaux de transport en Europe
occidentale » in : La planète nomade, Les mobilités
géographiques aujourd 'hui 1998, Belin, pp.1 27-144.
MAY, N., et alii, La ville éclatée,
éditions de l'Aube, 1998, 355p.
MERLIN, P., La planification des transports, enjeux et
méthodes, Paris, Masson, 1984, 220p. MERLIN, P., Les transports
urbains, Que sais-je? , PUF, 1992.
OFFNER, J.M, PUMAIN, D., Réseaux et territoires,
significations croisées, l'Aube territoire, 1996, 281p.
PLASSARD, F., Les autoroutes et le développement
régional, Economica et Presses Universitaires de Lyon, 1977,
341p.
PLASSARD, F., Introduction à l'analyse des transports,
(cours en ligne), 2003, 120p. Disponible sur :
http://perso.orange.fr/site-plassard/cours.htm.
PINCHEMEL, P ET G., La face de la terre, Armand Colin,
1997, 515p.
QUINET, E., Analyse économique des transports,
Presses Universitaires de France, 1990, 302p.
QUINET, E., Principes d'économie des transports,
Economica, 1998, 420p.
ROCHEFORT, M., Dynamiques de l'espace français et
aménagement du territoire, l'Harmattan, 1995.
RONCAYOLO, M., La ville et ses territoires, Folio
essais, Gallimard, 1990. TEFRA, M., Economie des transports, Ellipses,
1996, 189p.
VARLET, J. (dir.), Autoroutes, Economie et Territoire, Actes
du Colloque de Clermont-Ferrand, mai 1995, CERAMAC, Université
B.Pascal de Clermont-Ferrand, 1997, 424p.
VARLET, J., Dynamique des réseaux de transport et
recompositions territoriales, Habilitation à diriger des
recherches, Université de Toulouse-Le Mirail, 1997.
VARLET, J. (dir.), Autoroutes et aménagements,
interactions avec l 'environnement, collection Gérer
l'environnement, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2004,
328p.
WEIL, M., La transition urbaine. Le passage de la ville
pédestre à la ville motorisée, Liège,
éditions P.Mardaga, 1999,149p.
WOLKOWITSCH, M., Géographie des transports,
collection Cursus, Armand Colin, 1992, 191p.
Articles de revues / Revues
BARRE, A., Le réseau autoroutier français: un
outil rapidement valorisé, des effets controversés, Annales
de Géographie, n°593-594, 1997.
BEYER, A., Morphologie dynamique et territoires en
réseaux, L'évolution spatiale et organisationnelle de la
messagerie française, Annales de géographie, n°608,
1999.
CASTEL, J.C., Les liens entre l'organisation urbaine et les
déplacements dans la perspective de maîtrise du trafic automobile,
CERTU, 2006, 64p.
DABLANC, L., Le transport des marchandises en ville,
Flux, n°34, 1998.
HARMELLE, C., Les piqués de l 'aigle. Saint-Antonin et
sa région (1850-1940). Révolutions de transports et changement
social. Recherches, n°47,48, 1992.
MARCONIS, R., Métros, VAL, Tramways... La
réorganisation des transports collectifs dans les grandes
agglomérations de province en France, Annales de Géographie,
n°593-594, 1997.
MONTES, C., Les transports dans l'aménagement urbain
à Lyon, Geocarrefour, Lyon, 2003, 264 p.
OFFNER, J.M., Réseaux, territoires et organisation
sociale, La Documentation Française, 1994, 60p.
OFFNER, J.M., Les «effets structurants» du
transport : mythe politique, mystification scientifique, L'Espace
géographique n°3, 1993, pp. 233-242.
PLASSARD, F., La mobilité induite par les
infrastructures, Table Ronde 105 de la Conférence Européenne
des Ministres des Transports, CEMT, pp.1 17-150.
PLASSARD, F., Transport et territoire, La Documentation
francaise / PREDIT, 2003, 104p.
ZELINSKY, W., The Hypothesis of the Mobility Transition,
Geographical Review, vol. 61, n°2, 1971, pp. 219-249.
Autoroutes, acteurs et dynamiques territoriales,
Geocarrefour, vol.77, n°1, 2002.
Géographies de l'automobile et aménagement des
territoires, INRETS, Université de Paris X, 1997, 167p.
Infrastructures de transports et organisation de l'espace en
France au seuil du XXI siècle, Annales de géographie,
n°593-594, 1997.
Réseaux et Territoires en interconnexion, Flux,
n°3 8, 1999.
Etudes statistiques
Atlas économique et social de la région
Rhône-A lpes, INSEE, 1996, 64p.
Atlas régional des transports, région
Rhône-Alpes, 2005.
Forte extension des navettes domicile-travail, La lettre
INSEE Rhône-Alpes, n°70, 2000.
Les bassins de vie structurent et renouvellent l 'analyse de
l 'espace rural, La lettre INSEE, n°26, 2004.
Les chiffres clés de la Loire, Les chambres de
commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, édition 2006-2007, 12p.
Les chiffres clés du Rhône, Les chambres de
commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, édition 2006-2007, 12p.
Les équipements routiers structurent la localisation
des habitants, La lettre INSEE RhôneAlpes, n°59, 2006.
Monts du Lyonnais et du Beaujolais, Portrait de
Territoire, INSEE, 2004, 17p.
Région stéphanoise, malgré le poids de
Saint-Etienne, une majorité de déplacements de proximité,
La lettre INSEE Rhône-Alpes, n°83, 2002.
Rhône-Alpes : 6,6 millions d'habitants en 2030,
INSEE Rhône-Alpes résultats, n°89, 2001. Rhône
Alpes, l 'encyclopédie, éditions Musnier-Gilbert, 1993,
862p.
Six grandes familles de cantons, La lettre INSEE
Rhône-Alpes, n°30, 2004.
Une méthode pour analyser des liens structurant un
territoire, La lettre INSEE Rhône-Alpes, n°80, 2002.
SYSTRA-SOFRETU-SOFRERAIL, Evolution du réseau
ferroviaire de l'ouest lyonnais, SNCF, décembre 1996.
Etudes traitant de l'autoroute A89
BRIOT, A., CHATARD, S., L 'accès ouest de Lyon,
Observatoire A89/EDYTEM, 2004.
BRIOT, A., L 'accès ouest de Clermont-Ferrand,
étude de la liaison entre Clermont-Ferrand et
Saint-Julien-Puy-Lavèze par la RN89, Observatoire A89/EDYTEM,
2003.
CLADET, V., Balbigny et l'A89 : l'impact du futur tron
çon autoroutier, sur les projets d'aménagements de territoire,
d'un point de vue industrialo - économique, sur Balbigny et la
Communauté de Communes de Balbigny, Observatoire
A89/Université Jean Monnet - Saint-Etienne, 2007.
DUBOST, M., EDOUARD, J.C., A72 et RN89 à l'est de
Clermont-Ferrand entre Thiers et Noirétable, Observatoire
A89/EDYTEM, 2003, 81p.
VANDAELE, V., Entreprises et zones d'activités du
Haut Forez de l'ouest lyonnais : état des lieux et perspectives avant la
mise en service du tron çon autoroutier A89 Balbigny -
LaTour-de-Salvagny, Observatoire A89/Université Jean Monnet -
Saint-Etienne, 2007.
VARLET, J. (dir.), Rapport d'activités 2003,
Observatoire A89/EDYTEM, 2004. VARLET, J. (dir.), Rapport d'activités
2004, Observatoire A89/EDYTEM, 2005. VARLET, J. (dir.), Rapport
d'activités 2005, Observatoire A89/EDYTEM, 2006.
VARLET, J. et alii, Le Terrassonais, laboratoire des
dynamiques engendrées par la construction de l'autoroute A89,
Observatoire A89/EDYTEM, 2005, 117p.
Atlas des dynamiques des territoires et de l'environnement de
l'autoroute A89 (1986-2003), sous la direction de J. VARLET, Observatoire
A89/ARTERES, 2006, 135p.
Autoroute A89 Balbigny - La-Tour-de-Salvagny, Dossier
d'enquête préalable à la déclaration publique
d'utilité publique des travaux, Direction Régionale de
l'Equipement, 2001.
Autoroute A45 Saint-Etienne - Lyon, Avant-Projet Sommaire,
Dossier de consultation sur le choix d'un tracé au sein du fuseau du
kilomètre, Direction Régionale de l'Equipement, 2000.
Contournement autoroutier de Lyon, dossier pour le
débat, DRE Rhône-Alpes, CETE Lyon, 1999, 60p.
Directive Territoriale d 'Aménagement de l 'aire
métropolitaine lyonnaise, Préfecture de région
Rhône-Alpes, Octobre 2006, 80p.
Liaison A89 - A6, point d'avancement sur le dossier, DRE
Rhône-Alpes, CETE Lyon, février 2007.
Schéma régional des transports (1997),
Conseil Régional Rhône-Alpes, 2001, 39p.
Réunion annuelle de l'Observatoire de l'A89 dirigée
par J.Varlet, Terrasson-Lavilledieu (19), 7et8 Juin 2007.
Ressources Internet
Tous les sites Internet présentés ci-dessous ont
été consultés plusieurs fois durant la réalisation
de l'étude, à des dates diverses. Ils ont fait l'objet d'une
dernière visite le 09/06/2007 pour vérifier le contenu. A ce
jour, toutes les informations qui ont permis la réalisation de
l'étude sont disponibles sur tous les sites suivants :
ALCALY. Alternative aux contournements autoroutiers de Lyon.
Disponible sur :
http://www.alcaly.org/
Association des Sociétés Françaises
d'Autoroutes (ASFA). Le site portail des sociétés d'autoroutes.
Disponible sur :
http://www.autoroutes.fr/
Autoroute A45. A45, site officiel. Disponible sur :
http://www.a45.fr/
Autoroute A89. La transversale Bordeaux - Clermont-Ferrand.
Disponible sur :
http://membres.lycos.fr/a89/
Autoroutes du Sud de la France (ASF). Vous entrez sur les
Autoroutes du Sud de la France. Disponible sur :
http://www.asf.fr/
Canal Géo. Ressources vidéos en géographie.
Interview filmée de S.Lecorre sur les autoroutes et leur rôle dans
l'aménagement du territoire. Disponible sur :
http://www.canal.u.fr/canalu/affiche_programme.php?sequence_id=634646086&programme_
id= 1 140704073&num_sequence=0&format_id=1 1085
Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports et
l'Urbanisme (CERTU). Mobilités et transports. Disponible sur :
http://www.certu.fr/certu/jsp/CtuMobiliteLevel0.jsp#
Chambre de Commerce et d'Industrie de Clermont-Ferrand/Issoire.
Prospective et territoires. Disponible sur :
http://www.clermont-fd.cci.fr/prospective/prospective.php#89
Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne. Observatoire
de l'économie locale. Disponible sur :
http://www.saint-etienne.cci.fr/Observatoire_De_Leconomie/
Communauté de communes de l'Arbresle. Bienvenue au pays de
l'Arbresle. Disponible sur :
http://www.cc-pays-arbresle.fr/accueil.php
Conseil Générale de la Loire. Le site Internet du
Conseil Général de la Loire en Rhône-Alpes. Disponible sur
:
http://www.loire.fr/display.jsp?id=j_4149
Délégation Interministérielle à
l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires
(DIACT). Observatoire des Territoires. Disponible sur :
http://www.territoires.gouv.fr/
Direction Départementale de l'Equipement de la Loire.
Bienvenue sur le site du Ministère de l'Équipement dans le
Rhône. Disponible sur :
http://www.rhone.equipement.gouv.fr/
Direction Départementale de l'Equipement de la Loire.
L'Equipement dans la Loire. Disponible sur :
http://www.loire.equipement.gouv.fr/
Direction Régionale de l'Equipement Rhône-Alpes.
L'équipement en Rhône-Alpes. Disponible sur :
http://www.rhone-alpes.equipement.gouv.fr/
Division Régionale de l'Equipement. Comptages routiers
2005. Disponible sur :
http://www.rhone.equipement.gouv.fr/route/comptages/Autoroute_Brochure.html
EPURES, Agence stéphanoise d'urbanisme. Synthèse
des études sur les transports. Disponible sur :
http://www.epures.com/pages/d2-syntheses/d2-trans.html
Forum SARA. Forum des sites amoureux des routes et autoroutes.
Disponible sur :
http://forum.sara.free.fr/
Hyrondelle. Le site des voies rapides du Sud Loire. Disponible
sur :
http://www.hyrondelle.net/
INSEE Rhône-Alpes. Le portail de la statistique de votre
région.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/home/home_page.asp
MAPPY. Plans, itinéraires, guide d'adresses en Europe.
Disponible sur ;
http://www.mappy.fr/
Moulins Communauté. Ensemble, construisons notre avenir.
Disponible sur :
http://www.agglo-moulins.fr/fr/investir_dessertes.asp
Multitud. La carte OURA ! arrive à Lyon !. Disponible sur
:
http://www.multitud.org/pub/article2.asp?id=140&article=yes&idReseau=1&mode=recherche
Observatoire A89. Qui est-il ? Que fait-il ? . Disponible sur :
http://www.asf.fr/rubriques/A89/Accueil/Accueilmaitre.html
Observatoire Partenarial Lyonnais en Economie (OPALE). Les
Publications. Disponible sur :
http://www.opale-lyon.com/site/page_main.asp?ContentID=4
Observatoire Régional des Transports (ORT). Disponible sur
:
http://www.rhone.equipement.gouv.fr/transports/observatoire/observatoire.htm
Région Rhône-Alpes. Schéma régional
des transports, un cadre de référence de la politique
régionale des transports. Disponible sur :
http://www.srt.rhonealpes.fr/
Région Rhône-Alpes. Site officiel de la
région Rhône-Alpes. Disponible sur :
http://www.rhonealpes.fr/
Réseau Ferré de France. Gestionnaire des
infrastructures ferroviaires. Disponible sur :
http://www.rff.fr/pages/accueil.asp
Roanne7. Informations sur le projet d'autoroute A89. Disponible
sur :
http://www.roanne7.net/article.php3
?id_article=69#forumsart
Sénat. Bienvenue au Sénat. Un site au service du
citoyen. Disponible sur :
http://www.senat.fr/
Via Michelin. Itinéraires, cartes et plans, tourisme,
hôtels et restaurants. Disponible sur :
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/tpl/hme/MaHomePage.htm
Agence de voyages SNCF. Bienvenue sur
voyages-sncf.com : agence de
voyages, billets de train, et d'avion, voiture de location, chambre
d'hôtel. Disponible sur :
http://www.voyages-sncf.com/leisure/fr/launch/home/
Les articles de journaux
De nombreux articles de journaux sont parus dans la presse.
Ci-dessous figurent les articles les plus importants et ceux cités dans
l'étude.
BELLON, M.A., L'A89 dans les starting-blocks. Le
Progrès. 12/10/06.
BOUCAUD, J., L'A432 en 2011, l'A89 en 2012, l'A45 en 2015. Le
Progrès. 13/07/06. DA FONSECA, M., Derrière l'A89, l'avenir
du COL en question. Le Progrès. 24/02/06. F.B., Immobilier :
« aucun effet immédiat ». Le Progrès.
01/11/06.
F.S., Autoroutes : Gérard Collomb veut éviter
l'asphyxie de l'agglomération lyonnaise. Le Progrès.
30/03/06.
GUTTIN-LOMBARD, F., A89 : le raccordement à l'A6 se ferait
via Lissieu. Le Progrès. 07/02/07.
MAURET, N., L'Assemblée nationale donne son feu vert
à l'A89. Le Progrès. 24/02/06. VAIZAND, J.F., J.-B.
Devernois, une stratégie pour le Roannais. Le Pays.
17/11/06.
VEROT, P.O., Adoption définitive de l'autoroute A89 par
l'Assemblée nationale. Le Pays. 03/03/06.
VEROT, P.O., Autoroutes A89 : ASF tâte le terrain. Le
Pays. 20/10/06.
TABLE DES FIGURES
Page
Figure 1 : Localisation de la zone d'étude 4
Figure 2 : Les contraintes liées à la
topographie 13
Figure 3 : Typologie des communes traversées par le
futur segment de l'A89 14
Figure 4 : Population le long de la future A89 en 1999
16
Figure 5 : Projection de population dans la Loire et dans le
Rhône jusqu 'en 2030 19
Figure 6 : Typologie des cantons de l 'ouest lyonnais
20
Figure 7 : Le réseau autoroutier actuel 24
Figure 8 : Accessibilité aux autoroutes dans l 'ouest
lyonnais 24
Figure 9 : Accessibilité des gares TER de l 'ouest
lyonnais 25
Figure 10 : Les communes traversées par l'A89
27
Figure 11 : Les ouvrages d'art du tracé 27
Figure 12 : Calendrier de la réalisation de l'A89
28
Figure 13 : Trafic autoroutier sur deux sections de l 'A 72
et le barreau existant de l 'A89 33
Figure 14 : Evolution du trafic moyen journalier entre 1991
et 2004 sur l'A72 et l'A89 34
Figure 15 : Principaux flux de transit Est-Ouest via l'A72
35
Figure 16 : Evolution annuelle du trafic sur l'A47 de 1993
à 2004 à Givors 36
Figure 17 : Evolution récente du trafic Est-Ouest de
Lyon par TEO 38
Figure 18 : Evolution du trafic moyen journalier de trois
autoroutes de l'est lyonnais 39
Figure 19 : Evolution mensuelle du
trafic moyen journalier sous le
tunnel de Fourvière de 1991 à 2004 40
Figure 20 : Evolution du trafic à Limonest - A6
41
Figure 21 : Répartition et évolution du trafic
moyen journalier le long de la RN7 43
Figure 22 : Schéma de répartition du trafic le
long de la RN7 de Roanne à Lyon 44
Figure 23 : Evolutions
inverses du trafic de la RN7 sur deux points de comptages
dans la proche banlieue lyonnaise 45
Figure 24 : Evolution récente du trafic à
Dommartin - RN489 46
Figure 25 : Evolution annuelle du trafic de 1992 à
2004 sur la RN89 à Sain-Bel 46
Figure 26 : Evolution annuelle du trafic de 1993 à
2004 de la RN82 à Neulise 47
Figure 27 : Localisation du point de comptage sur l'A6
49
Figure 28 : Localisation du point de comptage sur l'A47
49
Figure 29 : Evolution mensuelle du trafic de l'A6 et de l'A47
50
Figure 30 : Evolution mensuelle du trafic dans la banlieue
résidentielle de Lyon 52
Figure 31 : Evolution mensuelle du trafic sur la RN7 et la
RN89 53
Figure 32 : Répartition du trafic de poids lourds en
2004 56
Figure 33 : Répartition du trafic routier et
autoroutier de l'ouest lyonnais en 2004 57
Figure 34 : Desserte ferroviaire des grandes liaisons
inter-cités de Rhône-Alpes en 2005 59
Figure 35 : Nombre de voyageurs sur l'axe Saint-Etienne -
Lyon en 2006 60
Figure 36 : Nombre de voyageurs sur l'axe Roanne -
Saint-Etienne en 2006 62
Figure 37 : Nombre de voyageurs sur l 'axe Roanne - Lyon en
2006 63
Figure 38 : Schéma simplifié de la
répartition des flux de transports ferroviaires quotidiens du triangle
Lyon - Saint-Etienne - Roanne en fonction de l'origine et de la
destination des trajets en 2006 65
Figure 39 : Fréquentation des gares de l'ouest
lyonnais de 1997 à 2006 66
Figure 40 : Matrice des
principales origines/destinations de la liaison Bordeaux - Lyon
Trafic moyen journalier - double sens - 1999 68
Figure 41: Comparaison temps de parcours/coût en
voiture personnelle et TER 72
Figure 42 : Temps de parcours
cumulés de Lyon Perrache à Balbigny : étude de
deux
itinéraires 77
Figure 43 : Les points de congestion sur le réseau
autoroutier de l 'agglomération
lyonnaise le matin 79
Figure 44 : Communes dont au moins 20% des actifs travaillent
dans l'agglomération 81
Figure 45 : La méthodologie de l 'enquête
ménage déplacement 82
Figure 46 : Les modes de transport de l 'aire
métropolitaine lyonnaise 84
Figure 47 : Les motifs de déplacements 85
Figure 48 : Les navettes domicile-travail dans l 'aire
métropolitaine lyonnaise 87
Figure 49 : Localisation du point d'enquête cordon sur
la RN489 88
Figure 50 : Comptages des véhicules et nombre
d'enquêtes réalisées 89
Figure 51 : Evolution quotidienne du trafic sur la RN489
89
Figure 52 : Moyennes horaires du trafic sur la RN489
90
Figure 53 : Occupation des véhicules légers et
motifs de déplacements sur la RN489 91
Figure 54 : Origine/Destination des véhicules
légers sur la RN489 92
Figure 55 : Origine Destination des poids lourds sur la RN489
93
Figure 56 : Répartition du trafic :
échange/transit sur la RN489 95
Figure 57 : Les déplacements domicile-travail :
entrées et sorties de l'arrondissement
de Roanne en 1999 96
Figure 58 : Distance aux établissements scolaires dans
le roannais 98
Figure 59 : Attractivité des hypermarchés de la
Loire 99
Figure 60 : Distance à une bretelle d'autoroute en
1998 99
Figure 61 : Flux vers la ville la plus
fréquentée, Roanne, en 1998 100
Figure 62 : La liaison A89/A6 112
Figure 63 : Les projets autoroutiers de l 'ouest lyonnais
113
Figure 64 : Le tracé de la RCEA dans le réseau
autoroutier français 114
Figure 65 : Les nombreux projets
d'amélioration du réseau ferroviaire
de l'ouest lyonnais 117
Figure 66 : Exemple de scénario de croissance du
trafic 118
ANNEXES
Ces annexes rassemblent quelques documents de travail qui
constituent des données brutes
Type de carte utilisée pour connaître
le trafic récent
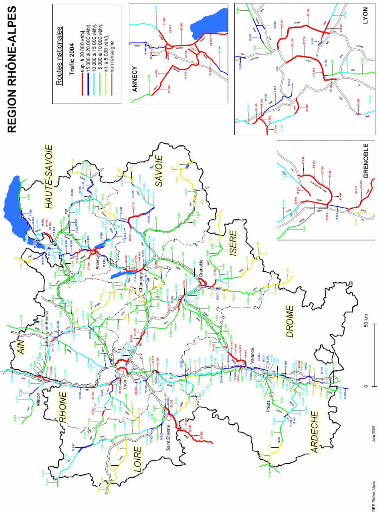
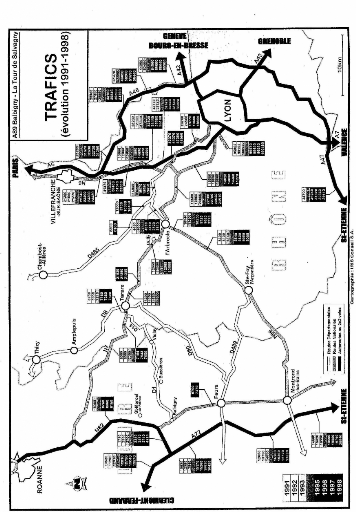
Carte de connaissance du trafic de 1991 à
1998
Carte du trafic tous véhicules et poids
lourds
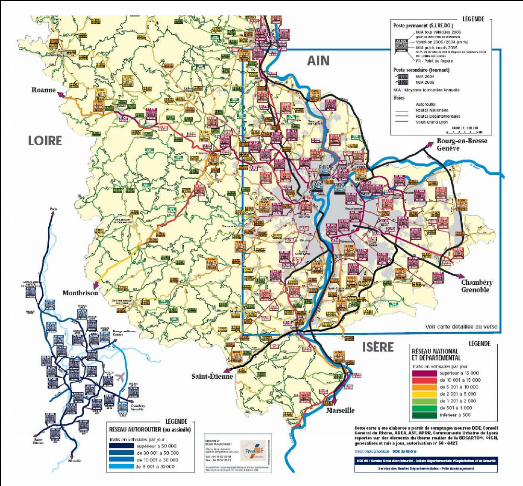
Tableau d'évolution mensuelle du trafic
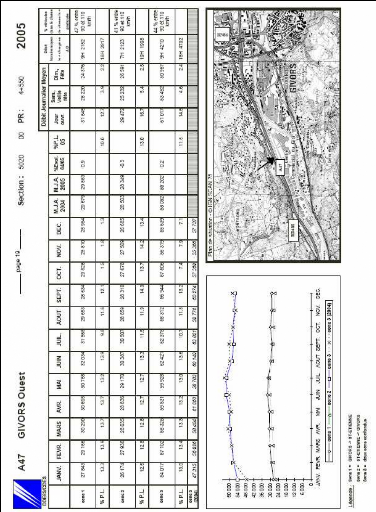
Communiqué de presse de la DDE du Rhône
à propos de l'enquête cordon
L'État, la communauté urbaine de Lyon, le
Département du Rhône et la région RhôneAlpes se sont
associés pour réaliser une vaste enquête de circulation
routière autour de l'agglomération lyonnaise en septembre-octobre
2005. Cette « enquête cordon » a pour objectif de mieux
connaître les trafics routiers entrant dans l'agglomération ou qui
la traversent. La dernière enquête date de 1990, l'actualisation
des données anciennes de 15 ans est nécessaire. L'organisation en
a été confiée à la DDE du Rhône.
Dans le cadre d'un arrêté préfectoral,
cette enquête consiste à interviewer, en 30 secondes, des
automobilistes et des chauffeurs de poids lourds circulant sur les principales
routes et autoroutes autour de l'agglomération lyonnaise. 36 postes
d'enquête ont été définis. Pendant les mois de
septembre et octobre, lors d'une dizaine de journées parmi les plus
représentatives de la circulation générale ont
été enquêtés par ALYCE, bureau d'études
spécialisé basé à Lyon. Aux feux tricolores et aux
péages autoroutiers trois questions étaient posées
à chaque conducteur : d'où venez-vous, où allez-vous, pour
quel motif ?
Cette enquête fait partie d'un dispositif global
d'enquêtes complémentaires. En effet, le SYTRAL a
réalisé en fin d'année, au domicile des ménages,
une enquête « ménage déplacements » de l'aire
métropolitaine lyonnaise. Ces enquêtes permettront, aux
collectivités publiques notamment, de mieux comprendre le fonctionnement
du système de transport et ainsi être en mesure de travailler
à la résolution des principaux problèmes. L'enquête
cordon apparaît, dans ce contexte, comme une opération
d'importance primordiale, puisqu'elle est nécessaire à la
connaissance des principaux flux routiers d'une part, à l'étude
des projets de transports d'autre part. En effet, les enjeux liés aux
transports, et plus particulièrement à la circulation automobile,
sont nombreux, qu'ils soient économiques ou d'environnement.
TABLE DES MATIERES
PARTIE 1 : Présentation de l'ouest lyonnais
et des enjeux de l'A89 11
I- L'ouest lyonnais, un espace qui ne favorise pas les
déplacements 12
1- Une topographie hostile aux infrastructures de transport
12
2- Les transports doivent s'adapter à la diversité
des territoires 14
II- Le faible dynamisme de l'ouest lyonnais
16
1- Une croissance démographique en perte de vitesse 16
1.1 : Hiérarchie urbaine de l'ouest lyonnais 16
1.2 : Une concentration de la population dans des pôles
urbains 17
1.3 : Une population vieillissante 17
1.4 : La croissance de
la population dans le Rhône
contraste avec le déclin démographique de la
Loire 18
2- La diversité des profils socio-économiques de
l'espace traversé par la future A89 19
3- Une faible activité économique 22
3.1 : Une industrie en reconversion 22
3.2 : Une agriculture qui contraint la localisation des axes de
transport 22
III - Les enjeux liés à la mise en place
de l'A89 23
1- La faible accessibilité de l'ouest lyonnais 23
1.1 : L'absence d'un axe autoroutier entre le Nord de la Loire
et Lyon 23
1.2 : Des infrastructures ferroviaires limitées 25
2- Description du tronçon Balbigny - La-Tour-de-Salvagny
de l'A89 26
3- Contribution d'A89 aux objectifs d'aménagement du
territoire 28
3.1 : Les enjeux nationaux d'aménagement 28
3.2 : Les enjeux supra-régionaux 29
3.3 : Les enjeux régionaux 29
3.4 : Les enjeux locaux 29
PARTIE 2 : Les caractéristiques des flux de
transports dans l'ouest lyonnais 31
I- La prédominance des flux de transports
routiers 32
1- Les flux circulent en grande majorité sur les axes
autoroutiers 33
1.1 : De plus en plus d'échanges avec l'ouest 33
1.2 : Lyon, un point de passage incontournable pour les flux
Est-Ouest 37
1.3 : L'importance des flux Nord-Sud 40
2- La croissance du trafic local sur les routes nationales 42
2.1 : La RN7 : support des échanges entre Lyon et Roanne
42
2.2 : La RN489 : liaison stratégique de la RN7 à
la RN6 45
2.3 : Une légère baisse des flux de la RN89 qui
relie l'agglomération
lyonnaise à la plaine du Forez 46
2.4 : La forte progression du trafic de la RN82 entre Roanne et
Balbigny 47
3- La saisonnalité des flux de transports routier de
l'ouest lyonnais 48
3.1 : Les autoroutes A6 et A47 sont marquées par
une croissance estivale
de leur trafic 49
3.2 : Une diminution estivale des flux dans la banlieue
résidentielle de Lyon 51
3.3 : La saisonnalité de la RN7 à l'ouest de
Tarare 53
4- L'importance de la circulation des poids lourds 54
5- Bilan du trafic routier et autoroutier de l'Ouest lyonnais
57
II- Le transport ferroviaire, un mode concurrent
du transport routier 59
1- L'axe Saint-Etienne - Lyon : un axe majeur 60
2- L'axe Roanne - Saint-Etienne : de faibles échanges
62
3- L'axe Roanne - Lyon : un concurrent de la future A89 63
4- La fréquentation croissante des gares de l'ouest
lyonnais 65
5- Les échanges entre Lyon et les deux plus grandes
agglomérations du tracé de l'A89 (Bordeaux et Clermont-Ferrand)
décroissent vers l'ouest 67
III- Les conditions de déplacement
70
1- Les coûts de déplacement 70
1.1 : Rappels sur la notion de coût de déplacement
70
1.2 : Les temps et coûts des déplacements :
la concurrence transport routier / transport ferroviaire 71
1.3 : Les temps de parcours : étude de 2
itinéraires concurrents de l'A89 76
1.4 : La saturation des axes autoroutiers 78
2- Les motifs de déplacements 80
2.1 : Les mobilités domicile-travail dans le Rhône
80
2.1.1 : Généralités des navettes
domicile-travail en Rhône-Alpes 80
2.1.2 : Premiers résultats de l'Enquête
Ménage Déplacement 82
2.2 : Etude de cas : la RN489 88
2.2.1 : Variation des flux durant la période
d'observation 88
2.2.2 : Les moyennes horaires du trafic 90
2.2.3 : Les motifs de déplacements 91
2.2.4 : Les origines et destinations des flux 92
2.3 : Les déplacements dans le Roannais 95
2.3.1 : Les déplacements domicile-travail dans le
Roannais 96
2.3.2 : Les mobilités liées aux accompagnements
scolaires 98
2.3.3 : Les mobilités liées aux achats dans la
Loire 98
2.3.4 : L'enclavement provoqué par l'éloignement
à l'autoroute 99
2.3.5 : Bilan des flux en direction de Roanne 100
PARTIE 3 : LES EFFETS ATTENDUS
DE L'A89 102
I- Réflexions sur l'aménagement du
territoire
par les transports 103
1- Les effets des transports 103
2- Réflexions sur la géographie des transports et
le lien
entre transport et aménagement du territoire 106
II- Les projets d'aménagement de l'ouest
lyonnais 109
1- Les compatibilités d'A89 avec la Directive
Territoriale
d'Aménagement lyonnais (DTA) 109
1.1 : Concilier trafic de transit et trafic
métropolitaine 109
1.2 : La concertation est nécessaire pour
développer
une stratégie de développement à
l'échelle métropolitaine 110
2- Le projet de Contournement Ouest de Lyon : une infrastructure
complémentaire à l'A89 110
3- L'indispensable liaison A89 - A6/A46 111
4- L'A45 : une infrastructure concurrente de l'A89 113
5- La concurrence RCEA / A89 114
6- L'amélioration du réseau ferroviaire 115
6.1 : Les orientations de la DTA 115
6.2 : Les améliorations du réseau ferroviaire
116
III- Les effets de l'A89 118
1- Les estimations de trafic : une source fiable ? 118
2- Les effets connus d'une section de l'A89 119
2.1 : Croissance du trafic sur l'A89 119
2.2 : Les effets sur la RN89 120
3- Constats préalables à l'étude des effets
de la section
Balbigny - La-Tour-de-Salvagny de l'A89
sur l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais 121
Conclusion générale 122
Bibliographie 125
Table des figures 134
Annexes 137


