CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons présenté le
matériel utilisé, tout en insistant sur leur
spécification, ainsi que la méthodologie de conception de la
partie matérielle (APTE) et de la partie logicielle (UML). A travers la
formulation détaillée des différentes méthodes
utilisées pour la conception du système, nous pourrons facilement
dégager des résultats dans le prochain chapitre.
60

61
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, il sera question pour nous de
présenter et d'analyser les résultats de notre travail notamment
les résultats de la conception matérielle et logicielle. Enfin,
nous ferons une étude comparative entre la solution technologique que
nous proposons et celle existante sur le marché.
I. CHOIX DES PARAMETRES A MONITORER
Comme annoncé dans le chapitre précédent,
le choix des paramètres à monitorer se fera à
l'aide de la méthode AMDEC. Le tableau suivant nous
présente l'AMDEC du groupe électrogène SDMO.
Elément
|
Défaillance
|
Evaluation
|
Choix
|
|
Effet
|
Causes
|
Mode de détection
|
F
|
D
|
G
|
C
|
|
Coupure des
enroulements
|
Pas de
tension à
la sortie
|
Accidentelle
|
Visuel
|
1
|
3
|
3
|
9
|
|
|
|
Visuel
|
1
|
3
|
3
|
9
|
|
Stator
|
Coupure des
enroulements
|
|
Visuel
|
1
|
3
|
3
|
9
|
|
|
|
Visuel
|
1
|
3
|
3
|
9
|
|
Ventilateur
|
Insuffisance d'air
|
Arrêt du
GE
|
Rupture courroie
|
|
4
|
4
|
32
|
|
Radiateur
|
Obturation
|
|
|
4
|
4
|
16
|
|
Pompe à
eau
|
Débit insuffisant
|
|
|
4
|
4
|
16
|
|
Réservoir
|
Fuite
|
Arrêt du
GE
|
Rouille, choc
|
|
4
|
4
|
16
|
|
|
Injecteur
|
Injection à baisse pression
|
Baisse de
performan ce
|
Déréglée
|
|
2
|
3
|
3
|
12
|
|
Batterie
|
Tension insuffisante
|
Pas de
démarrage
|
Défaut alternateur
|
Mesure
|
2
|
3
|
3
|
12
|
|
Capteurs
|
Pas de signaux
|
Aucune sécurité
|
Pas d'alimentation, vieillissement, court-circuit
|
Visuel
|
1
|
4
|
4
|
16
|
|
Vilebrequin
|
Jeu
|
Baisse des performan ces
|
Usure des
coussinets
|
|
4
|
4
|
16
|
|
|
|
4
|
4
|
16
|
|
Bielle
|
Jeu
|
Baisse des performan ces
|
Usure des
coussinets
|
|
4
|
4
|
16
|
|
Piston
|
Jeu
|
|
|
4
|
4
|
16
|
|
|
Maintenance corrective Maintenance préventive
62
De ce qui précède, il ressort clairement que le
système d'alimentation en carburant, le système de
refroidissement, l'alternateur, le système de démarrage et les
parties mobiles et fixes doivent faire l'objet d'une surveillance permanente
afin d'éviter des arrêts brusques du groupe
électrogène. Nous retenons ainsi les paramètres suivants
:
· Température du moteur : Cette
valeur permet de connaître les conditions thermiques de fonctionnement,
en tenant compte de la charge du moteur, de la température ambiante et
de l'efficacité de sa ventilation. Il est donc important de surveiller
cette température afin de s'assurer qu'elle ne sorte pas de sa plage de
fonctionnement faute de quoi on assiste à une surchauffe qui peut
occasionner l'usure des pièces.
· Pression d'huile : il est important
de surveiller la pression d'huile car si elle baisse, le moteur du Groupe
électrogène ne sera plus refroidi correctement ce qui pourrait
causer le grippage de ses organes et des pannes bien plus graves.
·
63
Niveau de carburant : le carburant sert au
fonctionnement direct du moteur thermique du groupe électrogène.
En cas de manquement, le GE cessera automatiquement de fonctionner. La
surveillance du niveau de carburant permettra donc d'assurer un fonctionnement
ininterrompu du GE, une réduction des coûts de carburant et
d'exploitation, la prévention des pannes et donc la prolongation de la
durée de vie du GE.
· Régime moteur : la tension de
sortie du générateur est étroitement liée à
la vitesse de rotation du moteur. Il est donc important de garder le moteur au
bon régime ou à peu près pour maintenir le courant
électrique à une fréquence de 60 Hz et produire la tension
appropriée.
· Tension de la batterie : pour la mise
en route du GE, le démarreur a besoin d'être alimenté en
tension continue pour fonctionner et c'est à la batterie de le faire.
Cependant, lorsque la tension de la batterie est inférieure à 12
V, elle ne peut plus accomplir sa mission : le groupe ne pourra donc pas
démarrer. Il est donc primordial pour celui en charge des groupes,
d'avoir une visibilité sur la valeur de la tension de la batterie.
· Puissance active : la puissance
représente la quantité d'énergie fournie par unité
de temps d'un système à un autre. Pour dimensionner la puissance
du GE, il est primordial de recenser toutes les charges. Nous comprenons donc
qu'il y `a une corrélation entre la puissance et la charge. En
fonctionnement, on peut se trouver en surcharge et ceci aura un impact
significatif le groupe.
II. RESULTAT DE LA CONCEPTION MATERIELLE
II.1 PRESENTATION DE LA CARTE ELECTRONIQUE
FABRIQUEE
II.1.1 PRESENTATION DU FICHIER SCHEMATIQUE CONCUE SUR
EASYEDA
Les figures suivantes présentent le câblage des
différents groupes fonctionnels (du point de vue schématique)
nécessaires à la réalisation de la fonction de monitoring
par la carte.
La première figure présente le bloc
d'alimentation. Sur notre APM403, nous avons une source d'alimentation
disponible de 24 Volts. Dans notre projet, les composants ESP32, SIM800L et
MAX485 consomment du 3.3 et 5 Volts pour leur fonctionnement. Ainsi pour
alimenter ces derniers, nous avons intercalés des régulateurs de
tension LM2596S-5.0/TR (tension d'entrée : 4.5-40V, tension de sortie
:5V) et LM1117IMPX-3.3/NOPB (tension d'entrée max : 15V, tension de
sortie : 3.3V).
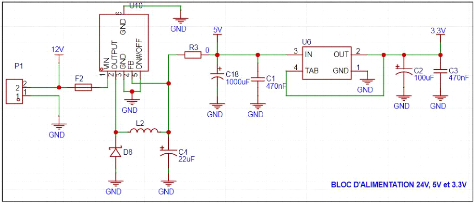
64
Figure 44: Bloc d'alimentation
La seconde figure nous présente le câblage de
notre microcontrôleur ESP32. Ce dernier est connecté à
quasi tous les composants de notre carte électronique et c'est lui qui
se charge du de la récupération et l'envoie des
données.
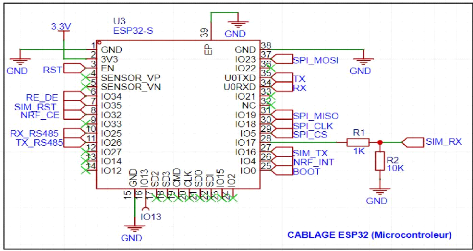
Figure 43: Câblage de l'ESP32
La troisième figure présente le circuit de BOOT
et de RESET de notre microcontrôleur. Les deux boutons EN et BOOT de la
carte permettent de contrôler l'état de l'ESP32. EN : Ce bouton,
appelé également RESET permet de redémarrer de force
l'ESP32. BOOT : L'utilisation seule de ce bouton n'a pas grand
intérêt. Il agit sur le comportement de l'ESP32 lors du
démarrage (lors du boot).
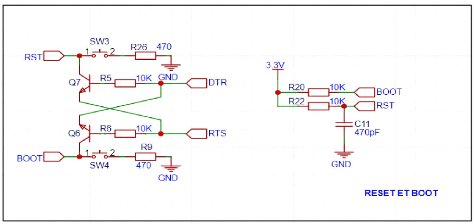
65
Figure 45: câblage des boutons reset et boot
La quatrième figure nous présente le
schéma de câblage du module radio NRF24L01. Ce module est
connecté à l'ESP32 d'où il recoit des informations et les
émet à une fréquence de 2.4 GHz.
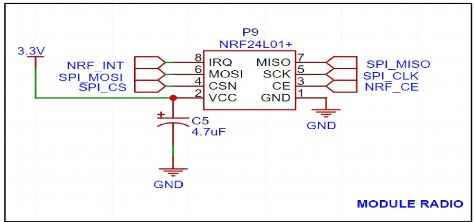
Figure 46: Câblage du module radio NRF24L01
La cinquième figure présente le schéma de
câblage de notre convertisseur TTL to RS485 encore
appelé
MAX485. Ce dernier se charge de récupérer les informations au
niveau du groupe
électrogène, via le protocole de communication
MODBUS, puis il convertit ces données en langage compréhensible
par notre microcontrôleur.
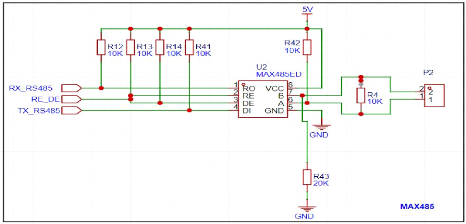
Figure 47: Câblage du MAX485
La sixième figure présente le câblage de
la communication série. Ici il s'agit du port USB. Nous allons utiliser
ce port pour téléverser le programme sur notre carte et pour des
éventuelles opérations de maintenance.
En outre, sur ce schéma, on peut voir qu'en dehors de
notre sortie USB, on dispose également d'un convertisseur CP2102-GMR. Il
se branche sur le port USB et permet d'envoyer et recevoir les signaux
TTL/CMOS. C'st grâce à lui que l'ESP32 se met automatiquement en
mode FLASH lors du téléversement.
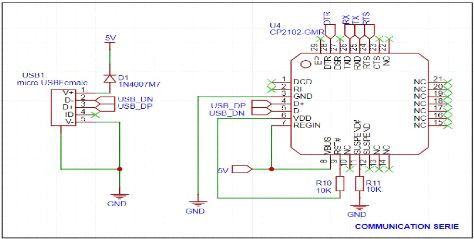
Figure 48: câblage de la communication
série
66
La dernière figure nous présente le câblage
des diodes électroluminescentes témoins de fonctionnement des
différents composants.
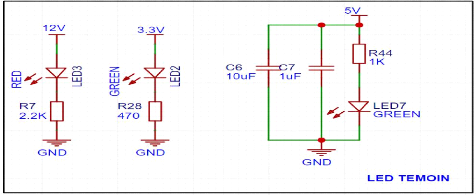
Figure 49: câblage des LED du circuit. II.1.2
PRESENTATION DU FICHIER PCB
Les fichiers PCB stockent des informations sur la disposition,
les connexions et d'autres spécifications de conception d'une carte de
circuit imprimé. Ils contiennent diverses données telles que des
dimensions, des couches, des guides de perçage, des masques, etc.
Les figures suivantes nous présentent respectivement
les faces de dessus et de dessous de notre carte de circuit imprimé.
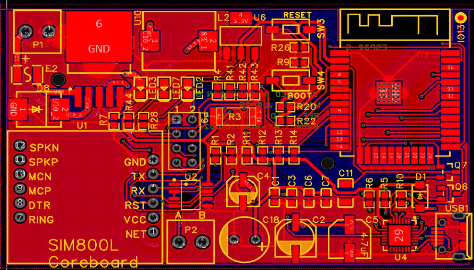
Figure 50: Vue de dessus de notre carte
67
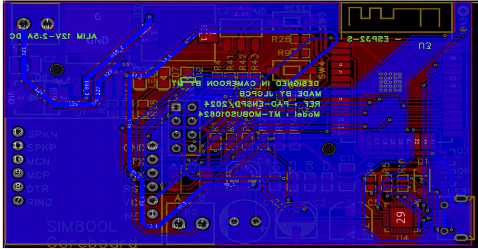
68
Figure 51 Vue de dessous de notre carte II.1.3 VUE 2D
DE LA CARTE ELECTRONIQUE
La figure suivante nous présente une vue 2D de notre carte
de circuit imprimé.
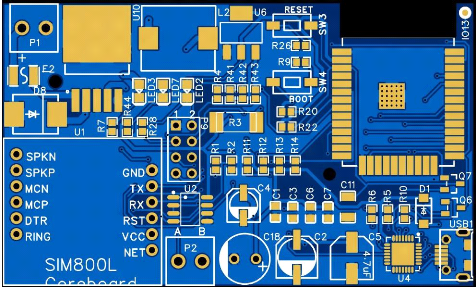
Figure 52: Vue 2D de notre carte
électronique
II.1.4 VUE 3D DE LA CARTE ELECTRONIQUE
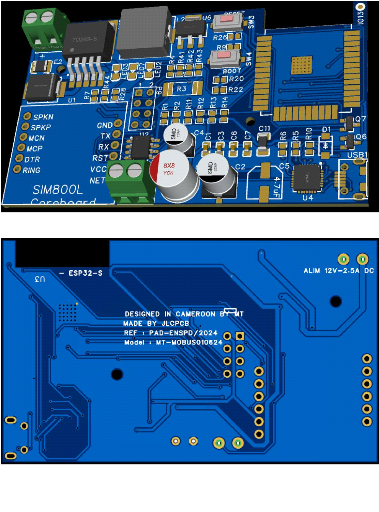
Figure 54: Vue de dessus
Figure 53: Vue de dessous
69
Cette vue nous permet de visualiser notre carte avec ses
composants. Elle nous donne un aperçu de la carte physique avant
fabrication. La suite nous en fait une représentation.
70
| 


