|
AOUT 2025
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

Département de Biologie Clinique
B.P. 1825

MEMOIRE I
Evaluation de niveau des
connaissances, attitudes et
pratiques sur les dons de sang à
Lubumbashi
YOTE NTAMBILA Elie
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du diplôme de Bachelier en Sciences
Pharmaceutiques
ANNÉE ACADÉMIQUE 2024-2025
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

Département de Biologie Clinique
B.P. 1825

MEMOIRE I
Evaluation de niveau des
connaissances, attitudes et
pratiques sur les dons de sang à
Lubumbashi
YOTE NTAMBILA Elie
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du diplôme de Bachelier en Sciences Pharmaceutiques
Directeur : PhD. LONGANGA Albert
Professeur
Encadreur : MUJINGA Rachel
Assistante
DEDICACE
YOTE WT4MBIL4 ELIE I
À tous ceux que j'aime et qui m'aiment d'un
amour vrai et sincère...
YOTE NTAMBILA ELIE II
REMERCIEMENTS
De prime abord, j'adresse mes sincères et humbles
gratitudes au Très-Haut, mon Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ pour les merveilles qu'il ne cesse
d'accomplir dans ma vie ;
Mes sincères remerciements sont adressés au
Professeur LONGANGA Albert pour avoir
accepté de diriger au bon port ce travail malgré
son temps chargé. Ses orientations ont été d'une
importance capitale dans la réalisation de ce travail ;
Je remercie chaleureusement l'Assistante MUJINGA
Rachel pour le temps qu'elle a consacré
dans l'encadrement de ce mémoire ; sans son aide et ses
multiples conseils, ce travail ne serait pas mis sur pied ;
Je remercie de manière particulière mes
très chers parents, Papa MWANZA André-Michel
et
Maman SENGA Nathalie, pour leur
accompagnement tant sur le point moral que sur le point
financier ;
Mes remerciements particuliers à TSHITA
Rebecca pour l'assistance émotionnelle et les
encouragements ;
Mes remerciements sincères sont adressés
à ces personnes qui n'ont cessé de s'imprégner de
l'état d'avancement de ce travail et qui m'ont aidé dans sa
réalisation, j'ai cité KIDIOBWE
Fidèle, EMAKANA
Daniella, BIAMWA Ruby et KABINDA Cornellia
;
A ma chère famille YOTE, mes
frères et soeurs KITAMBALA Meschack, KIBWE Myriam, KIBANZA
Déborah, LUVIMBA Paola, SENGA Israël et MAMBWE
Samuel, pour leur
présence naturelle, qui n'a cessé de me pousser
à bosser durement pour la responsabilité que je porte
d'être aîné d'une si magnifique famille ;
A tous ceux qui, de près ou de loin, ont
participé de manière active et particulière (chacun selon
sa part) à la réalisation de ce mémoire, je
présente toute ma gratitude.
A vous tous, MERCI BEAUCOUP, que DIEU VOUS BÉNISSE
!!!
YOTE NTAMBILA Elie
YOTE WT4MBIL4 ELIE III
RÉSUMÉ
Le don de sang est un acte vital qui permet de sauver des
vies, notamment en cas d'urgences médicales, d'interventions
chirurgicales, ou dans le traitement de maladies chroniques comme la
drépanocytose. En République Démocratique du Congo, le
besoin en produits sanguins reste préoccupant, en particulier à
Lubumbashi où les appels à la mobilisation sont fréquents.
Dans ce travail, l'objectif était de déterminer le niveau de
connaissances, les attitudes et pratiques liées aux dons de sang
à Lubumbashi.
Il s'est agi d'une étude transversale descriptive qui a
été réalisée dans la ville de Lubumbashi sur une
période allant de janvier à juillet 2025. Les données ont
été collectées à l'aide d'un questionnaire
structuré portant sur les aspects sociodémographiques, les
connaissances, attitudes et pratiques liées aux dons de sang.
L'enquête avait été menée
auprès de 413 participants, les résultats ont montré que
100% des universitaires et 97% de ceux ayant un niveau d'étude
secondaire avaient déjà entendu parler du don de sang,
principalement via les professionnels de santé et les médias ;
96% jugeaient important de donner du sang, et 90% estimaient que ce geste
permet de sauver des vies. Toutefois, seuls 22% des participants avaient
déjà donné leur sang, majoritairement à la demande
pour un proche. Les principaux obstacles étaient la peur de la faiblesse
physique (49%), la douleur (42%) et le manque d'information (24%). Le niveau de
connaissance sur la quantité à prélever et la
fréquence du don restait insuffisant chez une large proportion des
enquêtés.
Bien que la population présente une attitude
globalement favorable vis-à-vis du don de sang, les bonnes connaissances
et pratiques effectives restent insuffisantes. Il apparaît
nécessaire de renforcer la sensibilisation ciblée, de former les
leaders communautaires, et d'encourager des campagnes régulières
pour faire du don de sang un véritable acte citoyen et solidaire.
Mots-clés : Don de sang,
Connaissances, Attitudes, Pratiques, Lubumbashi, Sensibilisation, Transfusion
sanguine
YOTE WT4MBIL4 ELIE IV
ABSTRACT
Blood donation is a vital act that saves lives, particularly
in medical emergencies, surgical procedures, or in the treatment of chronic
diseases such as sickle cell disease. In the Democratic Republic of Congo, the
need for blood products remains a concern, particularly in Lubumbashi where
calls for mobilization are frequent. In this work, the objective was to
determine the level of knowledge, attitudes, and practices related to blood
donation in Lubumbashi.
This was a descriptive cross-sectional study carried out in
the city of Lubumbashi over a period from January to July 2025. Data were
collected using a structured questionnaire covering socio-demographic aspects,
knowledge, attitudes and practices related to blood donation.
The survey was conducted among 413 participants, the results
showed that 100% of university students and 97% of those with a secondary
education level had already heard about blood donation, mainly through health
professionals and the media; 96% considered it important to donate blood, and
90% believed that this gesture saves lives. However, only 22% of participants
had already donated blood, mostly at the request of a loved one. The main
obstacles were the fear of physical weakness (49%), pain (42%) and lack of
information (24%). The level of knowledge about the quantity to be collected
and the frequency of donation remained insufficient among a large proportion of
respondents.
Although the population has a generally favourable attitude
towards blood donation, good knowledge and effective practices remain
insufficient. It appears necessary to strengthen targeted awareness, train
community leaders, and encourage regular campaigns to make blood donation a
genuine civic and solidarity act.
Keywords : Blood donation, Knowledge,
Attitudes, Practices, Lubumbashi, Awareness, Blood transfusion
YOTE WT4MBIL4 ELIE V
SOMMAIRE
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
RÉSUMÉ III
ABSTRACT IV
SOMMAIRE V
ABRÉVIATIONS ET SIGLES VIII
TABLE DES FIGURES IX
TABLE DES TABLEAUX X
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LA TRANSFUSION
SANGUINE 3
I.1. Introduction à la transfusion sanguine 3
I.1.1. Définition 3
I.1.2. Historique de la transfusion sanguine (Socin, 2021) 3
I.2. Composants du sang 4
I.2.1. Description des principaux composants du sang 4
I.2.2. Fonctions biologiques de chaque composant 4
1.2.2.1. Plasma 4
I.2.2.2. Globules rouges 4
I.2.2.3. Globules blancs 5
I.2.2.4. Plaquettes 6
I.2.3. Traitement du sang 6
I.3. Groupes sanguins 7
I.3.1. Système ABO 7
I.3.2. Étude génétique du système
ABO 7
I.3.3. Système rhésus (RHD) 7
I.3.4. Groupage ABO-RHD 7
I.3.4.1. Epreuve globulaire (test de Beth-Vincent) 8
I.3.4.2. Epreuve sérique (test de Simonin) 8
I.3.5. Principe du groupage sanguin : l'agglutination des
hématies ou hémagglutination 8
I.4. Indications de la transfusion sanguine 8
I.4.1. Indications de la transfusion de plaquettes 8
I.4.2. Indications de la transfusion de plasma 9
I.4.3. Indication des concentres de granulocytes 10
I.5. Dépistage 10
I.6. Hémovigilance 10
YOTE WT4MBIL4 ELIE VI
1.7. Sécurité de la transfusion sanguine 10
CHAPITRE II. GENERALITES SUR LE DON DE SANG 12
II.1. Définition et objectifs du don de sang 12
II.1.1. Définition 12
II.1.2. Objectifs 12
II.1.2.1. Sauver des vies 12
II.1.2.2. Garantir l'accès continu a des produits sanguins
sûrs 12
II.1.2.3. Assurer la sécurité transfusionnelle
12
II.1.2.4. Contribuer à la solidarité et renforcer
le lien social 13
II.1.2.5. Soutenir la recherche médicale 13
II.2. Historique du don de sang (Cartwright, 2023). 13
II.3. Types de dons de sang 15
II.3.1. Sang complet 15
II.3.2. Don de thrombocytes 15
II.3.3. Don de plasma 15
II.4. Donneurs de sang 16
II.5. Défis sur le don de sang 16
CHAPITRE III. MATÉRIEL ET METHODES 17
III.1. Cadre de l'étude 17
III.2. Type et période d'étude 18
III.3. Population d'étude 18
III.3.1. Critères d'inclusion 18
III.3.2. Critères d'exclusion 18
III.3.3. Variables étudiées 18
III.4. Matériel 19
III.5. Méthodes 19
III.6. Analyse des données 19
III.7. Considérations éthiques 20
CHAPITRE IV. RESULTATS 21
IV.1. Connaissances sur le don de sang 21
IV.1.1. Sexe, l'âge, le niveau d'études et la
profession 21
IV.1.2. Niveau d'études et le fait d'avoir entendu parler
du don de sang 22
IV.1.3. Niveau d'études et connaissances sur les
conditions requises pour un don de sang
22
IV.1.4. Quantité ou volume à prélever et
fréquence de don de sang au cours d'une année
23
IV.1.5. Tests pré-transfusionnels et risques potentiels
pour le donneur de sang 24
YOTE WT4MBIL4 ELIE VII
IV.1.6. Don de sang et sauvegarde des vies 24
IV.1.7. Don de sang et connaissance de l'âge minimum pour
faire un don de sang 25
IV.2. Attitudes sur le don de sang 26
IV.2.1. Don de sang et son importance dans la communauté
26
IV.2.2. Don de sang et les causes de la peur 27
IV.3. Pratiques sur le don de sang 28
IV.3.1. Enquêtés ayant déjà fait un
don de sang 28
IV.3.2. Motivations des enquêtés ayant
déjà fait ou pas un don de sang 29
IV.3.3. Disponibilité des enquêtés à
participer à un don de sang 30
IV.3.4. Proposition des enquêtés en vue de
l'amélioration du don de sang 30
IV.3.5. Enquêtés et leurs communes de
résidence 31
CHAPITRE V. DISCUSSION 32
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 35
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 36
ANNEXE a
YOTE WT4MBIL4 ELIE VIII
ABRÉVIATIONS ET SIGLES
AMM: Association Médicale Mondiale AVK: Antivitamine-K
CAP: Connaissances, Attitudes et Pratiques CGR: Concentré
de Globules Rouges
CP: Concentré de Plaquettes
CR-IDF: Conseil régional Île-de-France
CSCQ: Centre Suisse de Contrôle Qualité
CTS: Centres de Transfusion Sanguine
EFS: Établissement Français du Sang
G/L: Gramme par Litre
GB: Globules Blancs
GR: Globules Rouges
IgM: Immunoglobulines M
L: Litres
ML: Millilitres
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
OPS: Organisation Panafricaine de la Santé
PFC: Plasma Frais Congelé
PSL: Produits Sanguins Labiles
RDC: République Démocratique du Congo
RFI: Radio France Internationale
TCA: Temps de Céphaline Activé
TIH: Thrombopénie Induite par l'Héparine
TP: Taux de Prothrombine
VIH: Virus de l'Immunodéficience Humaine
YOTE WT4MBIL4 ELIE IX
TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Carte de la ville de Lubumbashi 18
Figure 2 : Répartition des enquêtés selon le
niveau d'étude et le fait d'avoir entendu parler du
don de sang 22
Figure 3 : Répartition des
enquêtés connaissant les conditions requises pour un don de sang
22 Figure 4 : Répartition des enquêtés en fonction de la
connaissance de l'âge minimum pour
faire un don de sang en RDC 25
Figure 5 : Répartition des enquêtés sur la
peur de donner de leur sang 27
Figure 6 : Répartition des enquêtés ayant
déjà donné ou non de leur sang 28
Figure 7 : Répartition des enquêtés selon la
proposition pour améliorer la collecte de sang 30
Figure 8 : Répartition des enquêtés selon
leurs communes de résidence 31
YOTE WT4MBIL4 ELIE X
TABLE DES TABLEAUX
Tableau I : Répartition des enquêtés selon le
sexe, l'âge, le niveau d'études et la profession 21 Tableau II :
Connaissances des enquêtés sur la quantité à
prélever lors d'un don et la
fréquence du don de sang au cours d'une année
23
Tableau III : Répartition des enquêtés sur la
question de savoir si le sang est testé d'abord
avant d'être transfusé et les risques potentiels
pour le donneur 24
Tableau IV : Répartition sur le don de sang
vis-à-vis de la sauvegarde des vies 24
Tableau V : Répartition des enquêtés sur la
question de l'âge minimum pour faire une un don
de sang en RDC 25
Tableau VI : Répartition des
enquêtés par rapport à la volonté de faire un don
bénévol de sang
26
Tableau VII: Répartition des enquêtés sur les
causes de la peur de donner de leur sang 27
Tableau VIII : Répartition des enquêtés sur
les raisons à faire ou pas un don de sang 29
Tableau IX : Répartition des enquêtés sur la
volonté de participer à une campagne dans une
banque de sang à Lubumbahi 30
YOTE WT4MBIL4 Elie 1
INTRODUCTION
Dans les soins de santé la transfusion sanguine joue un
rôle crucial. Elle bénéficie aux patients atteints de
maladies potentiellement mortelles, telles que la drépanocytose et la
thalassémie, qui ont besoin de sang ou de ses constituants. La
transfusion sanguine permet aux patients d'avoir une meilleure qualité
de vie. En outre, elle facilite les actes médicaux et chirurgicaux
complexes, ce qui rend cette pratique indispensable dans les soins de la
mère et de l'enfant, ainsi qu'en cas de catastrophes naturelles ou
provoquées par l'homme (OMS, 2024). En RDC, il faut plus de 600 000
unités de sang par an, selon le Programme national de transfusion
sanguine (RFI, 2020). Mais les centres de transfusion sanguine, que ce soit
à Kinshasa ou à Lubumbashi font face à une faible
mobilisation des donneurs bénévoles.
Plusieurs études ont été
réalisées dans le monde notamment au Cameroun où la
majorité des enquêtés (61,59%) avaient
présenté une connaissance insuffisante sur le don de sang, Le
manque d'information, la peur de contracter une maladie étaient les
principales causes entravant le don de sang (Fouda et al., 2024). Au
Soudan, une étude avait été également
réalisée et avait révélé que 25% des
participants avaient de bonnes connaissances sur le don de sang (Sayedahmed et
al., 2020). En Arabie-Saoudite, une étude avait
démontré que la plupart des participants 58% et 59% ne
connaissaient ni l'âge minimum ni le poids pour un don de sang (Almulhim
et al., 2020). À Bamako, au Mali, les participants qui
n'avaient jamais donné de leur sang avaient justifié leur acte ou
réticence à la suite du manque d'information et de temps, des
raisons culturelles et un manque de confiance au personnel du Centre de
Transfusion du Mali (Fomba et al., 2023).
Depuis plusieurs décennies les banques de sang
recourent aux dons de pour pallier aux problèmes liés au manque
de sang ; ces dernières années la méfiance commence de
plus en plus à s'installer au sein de la population congolaise de
manière générale, et particulièrement celle de la
ville de Lubumbashi. Cette méfiance pourrait être dû
à une connaissance insuffisante par rapport à
l'intérêt de dons de sang. C'est dans cette optique que ce travail
s'inscrit avec comme objectif général de contribuer au
fonctionnement régulier de banque de sang à Lubumbashi pour
sauver de plus en plus des vies.
YOTE WT4MBIL4 Elie 2
Les objectifs spécifiques étaient de :
- Déterminer le niveau des connaissances, attitudes et
pratiques sur les dons de sang
- Identifier les facteurs qui influençant les dons de
sang.
- Proposer des recommandations pour améliorer la
mobilisation des donneurs volontaires.
Ce travail comporte deux parties dont la première concerne
la revue de la transfusion sanguine et de dons de sang; et la deuxième
se focalise sur les résultats du terrain, et la discussion avec les
travaux antérieurs.
PREMIERE PARTIE : REVUE DE
LA LITTÉRATURE
YOTE WT4MBIL4 ELIE 3
CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS SUR LA
TRANSFUSION SANGUINE
I.1. Introduction à la transfusion sanguine
I.1.1. Définition
La transfusion consiste en l'administration du sang ou l'un de
ses composants appelés produits sanguins labiles (PSL), désignant
principalement les concentrés de globules rouges (CGR), toujours «
mono-donneurs », les concentrés de plaquettes (CP) et le plasma
frais congelé (PFC) provenant d'un ou plusieurs « donneurs ».
Le premier maillon de la chaîne transfusionnelle est le don
bénévole (Foucreau et al., 2024).
I.1.2. Historique de la transfusion sanguine
(Socin, 2021)
Nous sommes en 1492, le Pape Innocent VIII se meurt. Ses
médecins avaient épuisé toutes les thérapies
disponibles à l'époque, basées principalement sur des
saignées. Selon la légende, le Pape mourant aurait
bénéficié de l'une des premières tentatives de
transfusion de sang recensées dans l'histoire. Il y eut un
médecin, Giacomo din San Genesio, qui proposa de lui faire boire le sang
de trois enfants, sacrifice inutile qui aurait provoqué leur mort, sans
pour autant éviter le décès du Pape.
Jean Baptiste Denis (1643-1704), médecin de Louis XIV
réalise l'une des premières transfusions « directes »
avec succès. Le patient, ayant 15 ans, souffrait d'une fièvre
prolongée, traitée par une vingtaine des saignées par les
médecins. Affaibli, le patient reçoit alors le sang d'un agneau
avec une très bonne tolérance, en se rétablissant. Cet
exploit fut publié dans une revue scientifique de la
Société Scientifique de Londres Philosophical Transactions, du 22
juillet 1667.
Les transfusions sanguines se développent
progressivement par la suite, mais la sécurité de la
procédure et les conséquences sur la physiologie du sang restent
encore très approximatives jusqu'au début du
20ème siècle. La coagulation du sang,
l'incompatibilité de différents groupes sanguins, les
réactions transfusionnelles, l'indisponibilité de sang en
réserve, sont autant les difficultés qui entraveront les
transfusions sanguines.
Les chirurgies, les hémorragies post-partum ou encore
les blessures de guerre sont les facteurs ayant incité les soignants
à développer les techniques de transfusion sanguine.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 4
En 1900, le chercheur autrichien Karl Landsteiner (1868-1943)
découvre les groupes sanguins. Cette découverte aboutit au
premier système de classement de ces groupes, le système ABO.
Au début du 20e siècle, tous les
éléments sont mis en place pour rendre possible des transfusions
sanguines, sans qu'il y ait des phénomènes de coagulation, et
avec la possibilité de stocker le sang du donneur, pour le faire
ultérieurement.
En 1940, Karl Landsteiner, en collaboration avec Alexander
Wiener, identifie le facteur rhésus, responsable de la maladie
hémolytique du nouveau-né.
I.2. Composants du sang
I.2.1. Description des principaux composants du sang
Le sang se compose de cellules et de plasma.
? Le plasma contient des protéines diverses, dont les
immunoglobulines, l'albumine et les facteurs de coagulation.
? Les cellules du sang se divisent en trois catégories
:
- Les globules rouges qui transportent l'oxygène des
poumons aux tissus et captent le gaz carbonique qui est éliminé
ensuite par les voies respiratoires ;
- Les globules blancs qui défendent l'organisme contre
les agressions des microbes, bactéries et virus ;
- Les plaquettes qui empêchent le saignement en
colmatant les lésions des vaisseaux (Tazerout et Galinier, 2017).
I.2.2. Fonctions biologiques de chaque composant 1.2.2.1.
Plasma
De couleur dorée, le plasma est la partie liquide du
sang dans laquelle circulent les cellules sanguines comme les globules rouges
(GR), les globules blancs (GB) et les plaquettes. Il est composé
à 90% d'eau et se régénère très vite. Il
contient des protéines qui ont un intérêt
thérapeutique majeur pour les patients (EFS, 2023).
I.2.2.2. Globules rouges
Les globules rouges (érythrocytes ou hématies)
sont des cellules anucléées, biconcaves, qui sont remplies
d'hémoglobine, et ces dernières transportent l'oxygène et
le dioxyde de carbone
YOTE WT4MBIL4 ELIE 5
entre les poumons et les tissus. Les globules rouges sont
produits dans la moelle osseuse par un processus appelé
érythropoïèse (Anslem, 2024).
I.2.2.3. Globules blancs
Les leucocytes, couramment appelés globules blancs,
sont des cellules sanguines essentielles au bon fonctionnement du
système immunitaire. Elles permettent à l'organisme de se
défendre contre les infections causées par des bactéries,
des virus, des champignons et des parasites.
Ces cellules sont produites dans la moelle osseuse avant de
circuler dans le sang et les tissus lymphatiques. Il existe plusieurs types de
leucocytes, chacun ayant une fonction spécifique : les neutrophiles, les
lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles et les basophiles (Coudrey,
2024).
? Lymphocytes (Montenon, 2024).
Elles représentent 20% à 40% des globules blancs.
Il en existe trois sous types :
? Les lymphocytes B possèdent une mémoire. Tels
des archers, ils produisent des anticorps spécifiques aux types de
pathogènes rencontrés.
? Les lymphocytes T possèdent une mémoire. Tels
des fantassins, ils détruisent les cellules contaminées à
travers un corps à corps
? Les lymphocytes NK ou natural killers, quant à eux,
n'ont pas de mémoire. Ils font partie de nos défenses
immunitaires innées.
- Monocytes
Les monocytes représentent 2 à 10% des globules
blancs. Ils sont produits dans la moelle osseuse et évoluent ensuite en
macrophages ou en cellules dendritiques.
Les macrophages participent à l'élimination des
cellules pathogènes en les «absorbant», c'est la phagocytose.
Les cellules dendritiques sont quant à elles impliquées dans le
déclenchement des réponses immunitaires.
- Granulocytes ou polynucléaires
Les granulocytes font partie du système immunitaire
inné. Ils se divisent en plusieurs catégories
:
YOTE WT4MBIL4 ELIE 6
? Les neutrophiles: Ils représentent 40% à 75%
des globules blancs, et sont la première ligne de défense. Ils
ont aussi un rôle de phagocytes et sécrètent des
molécules qui amplifient la réaction inflammatoire.
? Les éosinophiles: Ils représentent 1% à
3% des leucocytes, ils régulent la réaction inflammatoire.
? Les basophiles: Ils représentent 1% des leucocytes,
ils activent la réaction inflammatoire.
I.2.2.4. Plaquettes
Les plaquettes sont des fragments circulants de cellules
jouant un rôle dans la coagulation. Nous avons la
thrombopoïétine qui contrôle le nombre de plaquettes
circulantes en stimulant la moelle osseuse à produire des
mégacaryocytes, qui à leur tour éliminent des plaquettes
à partir de leur cytoplasme. La thrombopoïétine est produite
dans le foie à un taux constant ; son taux circulant est
déterminé par son taux de fixation à des plaquettes
circulantes et éventuellement aux mégacaryocytes de la moelle
osseuse et par la mesure dans laquelle les plaquettes circulantes sont
éliminées. Les plaquettes circulent pendant 7 à 10 jours.
Près d'un tiers sont toujours séquestrées temporairement
dans la rate.
La numération plaquettaire est normalement comprise
entre 140 000 à 440 000/uL (140 à 440 × 109/L).
Cependant, ce taux peut varier légèrement selon les phases du
cycle menstruel, diminuer au cours de la grossesse près du terme
(thrombopénie gestationnelle) et augmenter en réponse aux
cytokines inflammatoires (thrombocytose secondaire ou réactionnelle).
Finalement, les plaquettes sont détruites par l'apoptose, un processus
indépendant de la rate (Kuter, 2024).
I.2.3. Traitement du sang
Le sang prélevé sur une solution anticoagulante
peut être stocké et transfusé à un patient dans un
état non modifié. Il s'agit là de transfusion de «
sang total ». Par contre, le sang peut être utilisé plus
efficacement s'il est séparé en ses composants, tels que les
concentrés de globules rouges, les concentrés de plaquettes, le
plasma et le cryoprécipité. Il peut ainsi répondre aux
besoins de plusieurs patients (OMS, 2023).
YOTE WT4MBIL4 ELIE 7
I.3. Groupes sanguins
La connaissance des groupes sanguins a progressé en
lien étroit avec le développement de la transfusion sanguine.
Mais la découverte des premiers d'entre eux, les groupes du
système ABO, apparaît comme un des premiers succès de
l'immunologie naissante : très antérieure à l'essor de la
transfusion sanguine, elle est due à Karl Landsteiner et date de
1900-1901. Cette découverte lui vaudra le prix Nobel de Physiologie ou
Médecine en 1930 (Aymard, 2017).
I.3.1. Système ABO
Le système ABO est un système allotypique
de groupe sanguin défini par trois gènes-allèles :
deux allèles codominants A et B, et un allèle silencieux
(amorphe) O, situés sur le chromosome numéro 9 en position q34 et
qui définissent la présence ou l'absence de :
- Deux antigènes A et B sur les globules rouges, les
tissus et les sécrétions.
- Deux anticorps anti-A et anti-B « naturels » et
réguliers de type IgM dans le sérum (Khebri, 2020).
I.3.2. Étude génétique du
système ABO
Le gène du système de groupe sanguin ABO est
porté sur le chromosome 9, la transmission des génotypes
s'effectue selon la loi de Mendel.
Les gènes A et B ont une expressivité
phénotypique propre qui masque celle du gène O, alors les
gènes A et B ont une transmission dominante dans les groupes A et B, et
dans le groupe AB la transmission est codominante, dans le groupe O elle est
récessive (Khebri, 2020).
I.3.3. Système rhésus (RHD)
Le système RHD détermine quant à lui, la
présence ou l'absence de l'antigène D sur les globules rouges.
S'il est présent, l'individu est Rhésus D positif (+) ; s'il est
absent, l'individu est Rhésus D négatif (-). Les anticorps
anti-RHD sont des anticorps irréguliers de type IgG, acquis à
l'occasion d'un épisode transfusionnel ou d'une grossesse (CSCQ,
2017).
I.3.4. Groupage ABO-RHD
Pour définir à quel groupe ABO appartient un
individu, il existe deux techniques complémentaires : l'épreuve
globulaire et l'épreuve sérique. Cela pour éviter toute
erreur transfusionnelle. Pour définir le RHD, seule la technique
globulaire est utilisée.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 8
I.3.4.1. Epreuve globulaire (test de
Beth-Vincent)
Cette épreuve consiste à mettre en
évidence les antigènes à la surface des globules rouges du
patient à l'aide d'anticorps spécifiques par agglutination des
globules rouges (hémagglutination) afin de déterminer le groupe
sanguin du patient.
I.3.4.2. Epreuve sérique (test de
Simonin)
Cette épreuve consiste à mettre en
évidence les anticorps contenus dans le plasma du patient à
l'aide de globules rouges de groupe sanguins connus, également par
hémagglutination (CSCQ, 2017).
I.3.5. Principe du groupage sanguin : l'agglutination des
hématies ou hémagglutination
Un groupe sanguin se définit par la présence ou
l'absence de certaines molécules antigéniques à la surface
du globule rouge (ou hématie, ou érythrocyte) ; et pour le
système ABO particulièrement, il y a présence d'anticorps
« naturels » anti-A et anti-B dans le plasma (ou dans le
sérum, après coagulation).
Les antigènes des globules rouges et anticorps
plasmatiques sont mis en évidence par des réactions
d'agglutination (sur plaque, sur microplaque, en tube, en gel de
microfiltration) en présence de sérums-tests anti-A ou anti-B
(épreuves globulaires) ou d'hématies-tests A ou B
(épreuves plasmatiques).
À titre d'exemple, une personne de groupe O n'a sur ses
hématies ni antigène A, ni antigène B mais elle a dans son
plasma des anticorps « naturels » anti-A et anti-B.
Un anticorps est une molécule protéique,
produite par le système immunitaire pour se fixer à une
molécule étrangère, dite antigène (pour antibody
generator). Ce mécanisme de lien antigène-anticorps est
spécifique à chaque couple, de manière comparable à
une clef et une serrure (Aymard, 2017).
I.4. Indications de la transfusion sanguine I.4.1.
Indications de la transfusion de plaquettes
La transfusion de concentrés plaquettaires a pour but
de maintenir une hémostase efficace dans un contexte de
thrombopénie et ainsi de prévenir ou d'arrêter un
saignement.
Les seuils de numération plaquettaire justifiant la
transfusion dans un contexte périopératoire sont à
pondérer par l'existence de facteurs de risque hémorragique. En
curatif, la transfusion de
YOTE WT4MBIL4 ELIE 9
plaquettes est indiquée en cas de saignement actif
lorsque la thrombopénie est considérée comme la cause du
saignement. En prophylactique, la transfusion de plaquettes doit être
prescrite chez l'adulte lorsque le taux est inférieur à 10 G/L,
seuil considéré comme à risque hémorragique. Des
seuils plus élevés seront à retenir en fonction du
contexte clinique (par exemple : thrombopénie centrale profonde avec
fièvre, seuil à 20 G/L). Par ailleurs, la Haute Autorité
de santé définit des seuils à visée prophylactique
en cas de chirurgie ou de geste invasif (par exemple : transfusion si
thrombopénie < 50 G/L pour un geste tel que la biopsie
ostéomédullaire ou seuil à 100 G/L pour chirurgie
ophtalmologique) (HAS-ANSM, 2015).
L'efficacité entre un concentré plaquettaire
d'aphérèse et un mélange de concentrés de
plaquettes issus de sang total est identique.
I.4.2. Indications de la transfusion de plasma
Prenant en compte les données d'efficacité et de
sécurité (cliniques et toxicologiques) ainsi que le recul
d'utilisation, il n'existe pas d'argument pour recommander un plasma par
rapport à un autre. Le plasma est indiqué notamment dans les cas
suivants :
- Hémorragie d'intensité modérée,
peu évolutive ou contrôlée (temps de céphaline
activée, TCA >1,5) ;
- Choc hémorragique et situations à risque
d'hémorragie massive, en association à des concentrés de
globules rouges, avec un ratio plasma frais congelé/concentré de
globules rouges compris entre 1/2 et 1/1 ;
- Micro-angiopathie thrombotique (purpura thrombotique
thrombocytopénique et syndrome hémolytique et urémique
avec critères de gravité) ;
- Coagulation intravasculaire disséminée
obstétricale, lorsque le traitement étiologique ne permet pas de
contrôler rapidement l'hémorragie ; coagulation intravasculaire
disséminée avec effondrement des facteurs de la coagulation (taux
de prothrombine, TP inférieur à 35-40 %), associée
à une hémorragie active ou potentielle (acte invasif) ;
- En cas de surdosage grave en antivitamine-K (AVK), dans deux
rares situations : absence de concentré de complexe prothrombinique, ou
absence de concentré de complexe prothombinique ne contenant pas
d'héparine en cas d'antécédents de thrombopénie
induite par l'héparine (TIH) (HAS-ANSM, 2012).
YOTE WT4MBIL4 ELIE 10
I.4.3. Indication des concentres de
granulocytes
La transfusion curative de granulocytes, plus rare, peut
être indiquée, en complément de la chimiothérapie
anti-infectieuse, chez les patients ayant réuni les trois
critères suivants : un pronostic favorable, une neutropénie
centrale sans espoir de sortie rapide d'aplasie (ou défaut fonctionnel
documenté des polynucléaires neutrophiles), associé
à un état infectieux sévère non
contrôlé par chimiothérapie anti-infectieuse (Laget et
al., 2020).
I.5. Dépistage
L'OMS recommande un dépistage systématique des
infections dans tous les dons de sang avant leur utilisation. Il devrait
être obligatoire pour le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et
la syphilis et effectué suivant un système répondant
à des exigences de qualité (OMS, 2023).
I.6. Hémovigilance
L'hémovigilance représente l'ensemble des
procédures de surveillance couvrant la totalité de la
chaîne transfusionnelle, du don et de la collecte du sang et de ses
constituants, à l'approvisionnement, la transfusion et au suivi des
receveurs. Il s'agit du suivi, de la notification de l'investigation et de
l'analyse des manifestations indésirables liées au don de sang,
au traitement du sang et à la transfusion sanguine et des mesures prises
pour prévenir la survenue ou la récurrence de telles
manifestations (OMS, 2017).
- Objectif de l'hémovigilance
L'objectif de l'hémovigilance est l'amélioration
constante de la qualité de la chaîne transfusionnelle à
travers des mesures correctives et préventives visant à
améliorer la sécurité du donneur et du patient, à
améliorer l'adéquation de la transfusion et à
réduire le gaspillage. Un système d'hémovigilance
ressemble essentiellement à tout cycle d'amélioration continue de
la qualité et présente des éléments et des
activités identiques. En tant que tel, l'hémovigilance doit
être intégrée dans chaque étape de la chaîne
transfusionnelle et dans chaque organisation responsable d'un
élément de cette chaîne (OMS, 2017).
1.7. Sécurité de la transfusion
sanguine
La plupart des transfusions sont sûres et
réussies. Cependant, des réactions légères
surviennent occasionnellement et, rarement, des réactions graves voire
fatales peuvent se produire.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 11
Les complications les plus fréquentes sont la
fièvre et les réactions allergiques ; Les réactions les
plus graves sont les suivantes la surcharge volumique les lésions
pulmonaires, la destruction des globules rouges due à une
incompatibilité entre le groupe sanguin du donneur et du receveur.
Les réactions rares comprennent la maladie du greffon
contre l'hôte dans laquelle les cellules transfusées attaquent les
cellules de la personne qui reçoit la transfusion, les infections ; les
complications d'une transfusion massive (mauvaise coagulation, baisse de la
température corporelle, faibles taux de calcium et de potassium)
(Sarode, 2024).
YOTE WT4MBIL4 ELIE 12
CHAPITRE II. GENERALITES SUR LE DON DE SANG
II.1. Définition et objectifs du don de sang
II.1.1. Définition
Le don de sang est un acte volontaire, anonyme et
bénévole qui consiste à autoriser le
prélèvement d'une certaine quantité de son sang ou de
produit sanguin ; le don de sang consiste à donner gratuitement un peu
de son sang. Il s'agit de don de sang total ou du don d'un des composants du
sang (plasma ou cellules) (Pottier, 2017). Il doit être un acte
volontaire chez un donneur bien informé et conscient de l'importance du
don (Rakotoniaina, 2023).
II.1.2. Objectifs
II.1.2.1. Sauver des vies
· Un seul don peut sauver jusqu'à trois vies,
grâce à la séparation du sang en composants (OMS, 2022 ;
CR-IDF, 2025).
· Il est indispensable pour prendre en charge :
? Les urgences (accidents, hémorragies,
accouchements)
? Les interventions chirurgicales
? Les maladies chroniques
(drépanocytose, cancers, hémophilies...) (OPS, 2025).
II.1.2.2. Garantir l'accès continu a des produits
sanguins sûrs
· Pour faire face à une demande permanente
(urgences, maladies, opérations, catastrophes).
· Pour les pays à revenu faible ou
intermédiaire, la pénurie est particulièrement critique :
les besoins ne diminuent jamais (OMS, 2022).
II.1.2.3. Assurer la sécurité
transfusionnelle
· Basée sur la sélection des donneurs,
l'anonymat, le volontariat, la non-rémunération et le
bénévolat. Un modèle reconnu plus sûr que les dons
rémunérés.
· Le sang est testé systématiquement (VIH,
hépatite, bactéries...), et tout don suspect est
écarté (Estelle, 2018).
YOTE WT4MBIL4 ELIE 13
II.1.2.4. Contribuer à la solidarité et
renforcer le lien social
? Le don de sang est un acte citoyen,
engagement volontaire au bénéfice de la
communauté.
? Il favorise un climat de solidarité locale et
mondiale, notamment mis en avant chaque 14 juin lors de la Journée
mondiale du don de sang (Nyombe, 2025).
II.1.2.5. Soutenir la recherche
médicale
? Les dons non utilisés pour transfusion peuvent servir
à la recherche, à l'élaboration de réactifs ou de
nouveaux traitements (CR-IDF, 2025).
II.2. Historique du don de sang (Cartwright,
2023).
Jusqu'en 1628, les scientifiques pensaient que le sang
était produit par le foie. C'était sans compter sur la
découverte majeure du docteur anglais William Harvey à cette
même date. Celui-ci découvrit la circulation sanguine et
l'importance du coeur dans la propulsion et la circulation du sang. En effet,
Il constata que le coeur jouait un rôle de pompe et que les deux
ventricules, en contractant leurs parois, assuraient la propulsion du sang dans
les artères.
C'est vers 1650 que les premières transfusions sanguines
furent réalisées entre animaux.
En 1667, la première transfusion chez l'homme avec du
sang d'agneau, fut réalisée à Montpellier par le
médecin français Jean-Baptiste Denis. Le premier patient à
avoir subi la première transfusion sanguine était
âgé de 15 ans et souffrait de fièvre depuis des mois. Il
survit et guérit grâce à cette transfusion. Le docteur
Denis retenta l'expérience sur 4 autres sujets. Les deux premiers
survécurent. Le troisième mourut, mais la transfusion sanguine
n'en fût pas la cause. Le quatrième sujet reçut une
première transfusion de sang de veau. Mais l'état pathologique ne
s'améliorant pas, le Docteur Denis décida de réaliser une
deuxième transfusion. Cependant, ce dernier décéda d'un
choc hémolytique aigu. Ce choc était lié à la
destruction des globules rouges transfusés au receveur.
En 1818, Après un nombre trop important de
décès dû aux transfusions sanguines de sang animal vers les
humains, l'anglais James Blundell tenta les premières transfusions
interhumaines dès 1818. Obstétricien, Blundell espérait
également, grâce à ces transfusions interhumaines, pouvoir
contrôler les hémorragies post-partum. Cependant, deux obstacles
entravèrent l'expansion des transfusions interhumaines notamment
l'ignorance des groupes sanguins et la coagulation du sang immédiatement
après son prélèvement.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 14
En 1900, en comparant le sang de différents sujets,
Karl Landsteiner fît une découverte majeure celle du groupe
sanguin ABO. Grâce aux succès et aux échecs de transfusions
de sang entre humains qu'il a réalisées et comparées, il
comprit qu'il existait des incompatibilités entre divers sangs humains.
Cette découverte permit d'améliorer considérablement le
taux de réussite des transfusions et lui valut le Prix Nobel de
médecine en 1930. Sa date d'anniversaire a été retenue
pour la célébration de la journée mondiale du donneur de
sang.
Le 27 mai 1914, Albert Hustin, médecin belge, est le
premier à réaliser une transfusion de sang en utilisant du sang
conservé grâce aux propriétés anticoagulantes du
citrate de soude. Grâce à ce citrate, le sang pouvait, à
cette époque, être conservé pendant 4 jours.
En 1940, Karl Landsteiner et Alexander Solomon Wiener firent
la découverte de l'antigène Rh (D). Ils constatèrent que
ce nouvel agglutinogène était responsable d'accidents
inexpliqués de la transfusion. Les transfusions devinrent de plus en
plus sûres pour les receveurs.
En 1943, John Freeman Loutit et Patrick Loudon Mollison mirent
au point et ensuite, améliorèrent des solutions anticoagulantes
et préservatrices. Ces solutions permettaient de conserver le sang total
pendant 21 jours.
C'est aussi à cette période que se
développèrent les premiers Centres de Transfusion Sanguine
(CTS).
A partir des années 60, les transfusions furent
adaptées aux besoins spécifiques des malades en tel ou tel
composant du sang.
Aujourd'hui, grâce aux prouesses scientifiques, le temps
de conservation du sang s'élève à 42 jours.
De plus, des analyses pointilleuses sont effectuées sur
les échantillons prélevés lors du don, pour
déterminer le groupe sanguin du donneur et détecter toute
anomalie qui pourrait révéler un risque pour la santé tant
du donneur que celle du receveur.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 15
II.3. Types de dons de sang
Outre le don classique de sang complet, il existe d'autres types
de don de sang. II.3.1. Sang complet
Le don de sang « classique » est le don de sang
complet, lors duquel on prélève environ 450 ml de sang au
donneur. Il s'agit là du don le plus fréquemment requis parmi
tous les types de don. Un don de sang complet permet de fabriquer
différentes préparations, qui serviront à traiter
différentes maladies.
? Durée et fréquence des dons de sang
complet
Si l'on inclut toutes les étapes de la
procédure, le don de sang demande environ 45 minutes. De manière
générale, il convient de respecter un délai de 10 à
12 semaines entre deux dons (habituellement ne pas plus de trois fois par an
pour les femmes et pas plus de quatre fois par an pour les hommes).
II.3.2. Don de thrombocytes
Lors d'un don de thrombocytes (plaquettes sanguines), la
donneuse ou le donneur se voit prélever uniquement des thrombocytes
à l'aide d'un séparateur de cellules. Les plaquettes sont
séparées du sang et retenues tandis que les autres composants
sanguins sont réinjectés à la donneuse ou au donneur.
? Durée et fréquence du don de
thrombocytes
Il faut compter entre 60 et 90 minutes pour parvenir à
séparer suffisamment de thrombocytes du sang. La quantité
prélevée correspond environ à 500 millilitres. Les
thrombocytes se régénérant en quelques jours dans un
organisme en bonne santé, il est généralement possible de
retourner au don en l'espace de 14 jours (Barhum, 2024).
II.3.3. Don de plasma
Comme pour le don de thrombocytes, le sang est acheminé
vers un appareil d'aphérèse dans lequel, sous l'effet de la
centrifugation, le plasma est séparé des autres composants
sanguins. Les cellules sanguines sont ensuite réinjectées
à la donneuse ou au donneur. Lors d'un don de plasma, le donneur se voit
prélever jusqu'à 650 ml de plasma en fonction de son poids
corporel.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 16
? Durée et fréquence du don de
plasma
Un don de plasma demande environ 40 minutes. Ce type de don ne
faisant perdre qu'une part infime de cellules sanguines à l'organisme,
il est en principe possible de retourner au don après une pause de deux
semaines (Barhum, 2024).
II.4. Donneurs de sang
Au niveau mondial, 33 % des dons de sang proviennent de
femmes, mais ces proportions varient considérablement.
Le profil d'âge des donneurs de sang montre que,
proportionnellement, plus de jeunes donnent du sang dans les pays à
revenu faible et intermédiaire que dans les pays à revenu
élevé. Les informations démographiques relatives aux
donneurs de sang sont importantes pour la formulation et le suivi des
stratégies de recrutement. Il en existe 3 types de donneurs de sang
notamment les volontaires ou rémunérés, les proches ou
membres de la famille et les rémunérés (OMS, 2023).
II.5. Défis sur le don de sang
Dans de nombreux pays, la demande dépasse l'offre, et
les services transfusionnels sont confrontés à la
difficulté de mettre à disposition une quantité suffisante
de sang tout en garantissant la qualité des produits sanguins et la
sécurité transfusionnelle. Le don de sang volontaire non
rémunéré constitue le fondement d'un approvisionnement en
sang sûr et de quantité suffisante. De plus, le don de plasma
volontaire non rémunéré est crucial pour soutenir les
patients atteints d'un large éventail d'affections de longue
durée, telles que l'hémophilie et le déficit immunitaire
(OMS, 2024).
DEUXIEME PARTIE :
EXPÉRIENCE PERSONNELLE
YOTE WT4MBIL4 ELIE 17
CHAPITRE III. MATÉRIEL ET METHODES
III.1. Cadre de l'étude
L'étude a été réalisée dans
la ville de Lubumbashi, deuxième ville de la République
démocratique du Congo (RDC), sous forme d'une enquête
auprès de la population. L'étude a couvert toutes les sept
communes de la ville de Lubumbashi.
? Présentation de la ville de
Lubumbashi
Créée en 1910, Lubumbashi
(ex-Élisabethville) est située dans le Sud-Est de la
République Démocratique du Congo, à une altitude variante
entre 1220 et 1240 mètres. Jusqu'en 2015, Lubumbashi a été
le chef-lieu de la province du Katanga avant de devenir, avec le
démembrement des provinces de 2015, le chef-lieu de la province du
Haut-Katanga. La ville de Lubumbashi couvre une superficie de quelque 747
km2 et est divisée en 7 communes dont six urbaines
(Lubumbashi, Kamalondo, Kenya, Katuba, Kampemba et Rwashi) et une urbano-rurale
communément appelée commune Annexe. En 2017, la population de
Lubumbashi a été estimée à quelque 2 028 198
habitants (Dibwe, 2020).
- Limites territoriales
La ville de Lubumbashi est ceinturée par le territoire
de Kipushi, ses limites géographiques sont déterminées
comme suit :
? Au nord : par le quartier Kassapa à 15 km de la route
Likasi dans la commune annexe ; ? Au sud : par le quartier Kalebuka et
Kasungami dans la commune annexe ;
? A l'Est : par la rivière Kamasaka ;
? A l'Ouest : par le quartier Kisanga et Munua.
La commune Annexe constitue l'espace vert de la ville et forme
la ceinture de cette dernière à tous les points cardinaux
(Makema, 2015).

YOTE WT4MBIL4 ELIE 18
Figure 1 : Carte de la ville de
Lubumbashi
III.2. Type et période d'étude
Il s'est agi d'une étude descriptive transversale sur
le niveau des connaissances, attitudes et pratiques de la population de la
ville de Lubumbashi vis-à-vis du don de sang. L'étude s'est
étalée sur une période allant de janvier à juillet
2025.
III.3. Population d'étude
Notre étude a porté sur une population
constituée d'hommes et de femmes dont l'âge allait de 17 à
47 ans qui ont représenté la population de la ville de Lubumbashi
auprès de laquelle l'étude a été menée.
III.3.1. Critères d'inclusion
Les critères d'inclusion étaient : être
habitant de Lubumbashi et avoir au moins 17 ans pour participer à cette
étude.
III.3.2. Critères d'exclusion
Tous ceux qui n'ont pas donné un consentement libre et
éclairé de participer à l'étude ont
été exclus.
III.3.3. Variables étudiées
Les éléments suivants ont été pris en
compte lors de notre étude :
YOTE WT4MBIL4 ELIE 19
- L'identification des personnes enquêtées
comprenant un code relatif au prénom, la tranche d'âge, le sexe,
la profession et le niveau d'étude;
- Les connaissances sur le sang, son origine, son
utilité et les problèmes liés au sang; - Les connaissances
du don de sang volontaires;
- Le don de sang volontaire et les attitudes liées au
don du sang comprenant les connaissances, la perception du don de sang, les
barrières au don de sang;
- pratique des dons de sang et le nombre de fois;
- La participation à une organisation ou association;
- Les connaissances sur le centre national de transfusion
sanguine, son rôle et sa localisation;
- L'appréciation de la transfusion sanguine et les
motivations futures pour le don de sang volontaire;
- La précision du lieu favorable pour le don et des
moyens de communications et d'information importants sur le don de sang
volontaire.
III.4. Matériel
Le matériel ayant servi au recueil des données a
été constitué principalement d'un questionnaire
structuré et prétesté.
III.5. Méthodes
Pour la collecte des données, nous avons
procédé par une enquête à l'aide d'un questionnaire
auprès de la population de la ville de Lubumbashi. Notre descente a
été effectuée dans toutes les communes de ladite ville.
Pour ce faire, les questionnaires ont été
distribués aux enquêtés qui les remplissaient et les
remettaient à l'enquêteur. Des traductions des questionnaires en
swahili, langue locale ont été faites pour les personnes ne
pouvant parfaitement pas lire et répondre facilement en français.
Le dépouillement a été fait manuellement afin
d'éviter la perte des données qualitatives.
III.6. Analyse des données
Les données recueillies en rapport avec les
connaissances, attitudes et pratiques de la population de la ville de
Lubumbashi vis-à-vis du don de sang volontaire, ont été
saisies et analysées au moyen d'Excel.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 20
III.7. Considérations éthiques
Cette étude est un mémoire de fin de cycle
à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l'Université
de Lubumbashi. Le consentement verbal, libre et éclairé a
été obtenu auprès de chaque participant, âgé
de 17 ans à 47 ans et plus. L'anonymat et la confidentialité des
informations ont été strictement respectés. Aucun risque
physique ou psychologique n'était associé à cette
enquête, conformément aux principes de la Déclaration
d'Helsinki (AMM, 2013).
YOTE WT4MBIL4 ELIE 21
CHAPITRE IV. RESULTATS
Cette enquête sur le niveau des connaissances, attitudes et
pratiques du don de sang à Lubumbashi a permis d'analyser 413
questionnaires.
IV.1. Connaissances sur le don de sang
IV.1.1. Sexe, l'âge, le niveau d'études et
la profession
Tableau I : Répartition des enquêtés
selon le sexe, l'âge, le niveau d'études et la
profession
|
Caractéristiques
|
|
Effectif (n)
|
Fréquence (%)
|
|
Sexe
|
Masculin
|
194
|
47
|
|
Féminin
|
219
|
53
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Age
|
17 ans
|
42
|
10
|
|
18-27 ans
|
203
|
49
|
|
28-37 ans
|
76
|
18
|
|
38-47 ans
|
53
|
13
|
|
47 ans <
|
39
|
10
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Niveau d'études
|
Secondaire
|
97
|
23
|
|
Universitaire
|
316
|
77
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Profession
|
Elèves
|
37
|
9
|
|
Etudiants
|
138
|
33
|
|
Professionnels de santé
|
11
|
3
|
|
Libéraux
|
76
|
18
|
|
Autres
|
151
|
37
|
|
Total
|
413
|
100
|
Dans cette étude, les femmes étaient
prédominantes (53%) par rapport aux hommes ; la tranche d'âge
allant de 18 à 27 ans était la plus représentée
soit un taux de 49%. Quant au niveau d'études, les enquêtés
ayant un niveau d'étude universitaire ont été
majoritairement représentés (76%). Pour ce qui est de la
profession, les étudiants ont été les plus
prédominants (33%) dans cette étude.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 22
IV.1.2. Niveau d'études et le fait d'avoir entendu
parler du don de sang
|
350
|
|
|
|
100% 100%
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
250
|
|
|
|
|
|
|
200
|
|
|
|
|
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|
100%
|
97%
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
50
|
|
|
3%
|
|
0%
|
|
0
|
Secondaire
|
Universitaire
|
|
Effectifs
|
97
|
316
|
|
Oui
|
94
|
316
|
|
Non
|
3
|
0
|
Figure 2 : Répartition des
enquêtés selon le niveau d'étude et le fait d'avoir entendu
parler du don de sang
La figure 2 a montré que parmi les enquêtés,
100% des universitaires avaient déjà entendu parler du don de
sang alors que ceux de secondaire représentaient respectivement 97%
ayant déjà entendu parler contre 3% n'ayant jamais entendu parler
du don de sang.
IV.1.3. Niveau d'études et connaissances sur les
conditions requises pour un don de sang
350
300
250
200
150
100%
90%
100%
100 65%
50 35% 10%
|
0
|
Secondaire
|
Universitaire
|
|
Effectifs
|
97
|
316
|
|
Oui
|
34
|
283
|
|
Non
|
63
|
33
|
Figure 3 : Répartition des
enquêtés connaissant les conditions requises pour un don de
sang
La figure 3 quant à elle montre le niveau de
connaissance sur les conditions requises pour faire un don de sang ; Il ressort
une prédominance de 90% des universitaires comparativement à
YOTE WT4MBIL4 ELIE 23
seulement 35% de ceux du secondaire. La somme de ces
résultats montre que 77% connaissaient les conditions requises pour
donner du sang.
IV.1.4. Quantité ou volume à
prélever et fréquence de don de sang au cours d'une
année
Tableau II : Connaissances des
enquêtés sur la quantité à prélever lors d'un
don et la fréquence du don de sang au cours d'une
année
|
Caractéristiques
|
|
Effectif(n)
|
Fréquence (%)
|
|
Quantité à prélever
|
250 ml
|
88
|
21
|
|
450 ml
|
64
|
16
|
|
1 l
|
76
|
18
|
|
Je ne sais pas
|
185
|
45
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Fréquence du don
|
Tous les mois
|
67
|
16
|
|
Tous les 3 mois
|
92
|
22
|
|
Tous les 6 mois
|
85
|
21
|
|
Je ne sais pas
|
169
|
41
|
|
Total
|
413
|
100
|
Pour ce qui est du niveau de connaissance sur la
quantité de sang à prélever lors d'un don, 45%
d'enquêtés ont déclaré ne pas connaître la
quantité prélevée, alors que 18% ont déclaré
qu'on prélève 1 litre, 21% pour 250 ml et seulement 16% ont
parlé de 450 ml. 41% ne savaient pas à quelle fréquence on
peut donner du sang dans une année, 22% ont parlé de tous les 3
mois, 21% et 16% ont parlé de tous les 6 mois et tous les mois
respectivement.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 24
IV.1.5. Tests pré-transfusionnels et risques
potentiels pour le donneur de sang
Tableau III : Répartition des
enquêtés sur la question de savoir si le sang est testé
d'abord avant d'être transfusé et les risques potentiels pour le
donneur
|
Caractéristiques
|
|
|
Effectif (n)
|
Fréquence (%)
|
|
Le sang est systématiquement testé avant la
transfusion
|
Oui
|
|
389
|
94
|
|
Non
|
|
5
|
1
|
|
Je ne sais pas
|
|
19
|
5
|
|
Total
|
|
413
|
100
|
|
Risques potentiels pour le donneur
|
Fatigue temporaire
|
|
327
|
79
|
|
Acquisition maladies
|
des
|
6
|
1
|
|
Aucun risque
|
|
3
|
1
|
|
Je ne sais pas
|
|
77
|
19
|
|
Total
|
|
413
|
100
|
De ce tableau, il ressort que 94% avaient
déclaré qu'effectivement le sang est testé avant toute
transfusion alors que 5% des enquêtés n'en savaient rien et 1% ont
déclaré que le sang n'est pas testé avant transfusion. 79%
des enquêtés avaient également déclaré que la
fatigue temporaire est l'un des risques potentiels pour le donneur de sang
alors que 19% n'en savaient rien, 1% avaient évoqué le fait que
le donneur risque d'acquérir certaines maladies et 1% ont parlé
d'aucun risque.
IV.1.6. Don de sang et sauvegarde des vies
Tableau IV : Répartition sur le don de sang
vis-à-vis de la sauvegarde des vies
Caractéristique Effectif (n) Fréquence
(%)
|
Le don de sang peut-il sauver des vies
|
Oui 372 90
|
|
Non 13 3
|
|
Je ne sais pas 28 7
|
|
Total 413 100
|
Ce tableau a montré que 90% des enquêtés
pensaient que le don de sang peut servir à sauver des vies Alors que 7%
n'en savaient rien et 3% pensaient que le don de sang ne sauve pas de vie.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 25
IV.1.7. Don de sang et connaissance de l'âge
minimum pour faire un don de sang
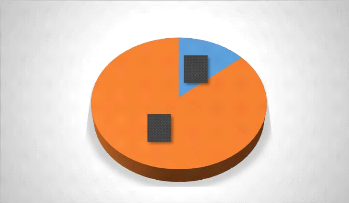
86%
Oui
Non
14%
Figure 4 : Répartition des
enquêtés en fonction de la connaissance de l'âge minimum
pour faire un don de sang en RDC
La figure 4 a montré que 86% d'enquêtés
connaissent qu'il y a un âge minimum pour donner de son sang en RDC alors
que 14% d'enquêtés n'avaient pas cette connaissance.
Tableau V : Répartition des enquêtés
sur la question de l'âge minimum pour faire une un don de sang en
ROC
|
Age (ans)
|
Effectif (n)
|
Fréquence (%)
|
|
15
|
0
|
0
|
|
18
|
344
|
97
|
|
21
|
1
|
0
|
|
Je ne sais pas
|
11
|
3
|
|
Total
|
356
|
100
|
Il ressort de ce tableau que sur 86% d'enquêtés
qui pensaient qu'il existe un âge minimum en RDC pour faire un don de
sang, 97% d'entre eux pensent qu'à partir de 18 ans on peut faire un don
de sang.
IV.2. Attitudes sur le don de sang
IV.2.1. Don de sang et son importance dans la
communauté
Tableau VI : Répartition des enquêtés
par rapport à la volonté de faire un don bénévole
de sang
Caractéristiques
Est-ce important de donner de son sang pour sauver des
vies ?
Possibilité de donner de son sang à un
inconnu
Possibilité de donner de son sang à un
membre de famille
Est-ce le don de sang doit être encouragé
dans sa communauté (Coutume, Religion, ...) ?
Sources de l'information
|
Effectif (n)
|
Fréquence (%)
|
|
Oui
|
397
|
96
|
|
Non
|
2
|
1
|
|
Sans opinion
|
14
|
3
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Oui
|
239
|
58
|
|
Non
|
47
|
11
|
|
Peut-être
|
127
|
31
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Oui
|
303
|
73
|
|
Non
|
30
|
7
|
|
Peut-être
|
80
|
20
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Oui
|
246
|
60
|
|
Non
|
27
|
6
|
|
Je ne sais pas
|
140
|
34
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
Famille
|
78
|
19
|
|
Télévision
|
86
|
21
|
|
Radio
|
47
|
11
|
|
Réseaux Sociaux
|
32
|
8
|
|
Amis
|
29
|
7
|
|
Professionnels de santé
|
141
|
34
|
|
Total
|
413
|
100
|
YOTE WT4MBIL4 ELIE 26
De ce tableau, il ressort que 96% d'enquêtés
avaient reconnu qu'il est important de donner du sang pour sauver des vies ;
58% sont prêt(e)s à donner de leur sang à un inconnu et 73%
sont favorables de donner de leur sang à leur membre de famille ; 60%
avaient souhaité que le don soit encouragé dans les
communautés ; pour la majorité d'enquêtés (34%)
avaient déjà entendu parler du don de sang via les professionnels
de santé.
IV.2.2. Don de sang et les causes de la peur
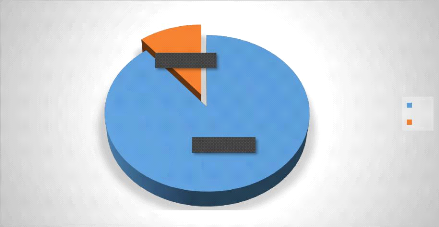
Non; 45; 11%
Oui; 368; 89%
Oui Non
Figure 5 : Répartition des
enquêtés sur la peur de donner de leur sang
La figure 5 a montré que 89% craignent de donner de
leur sang alors qu'il n'en était pas le cas pour 11% de nos
enquêtés.
Tableau VII: Répartition des enquêtés
sur les causes de la peur de donner de leur sang
Caractéristiques Effectif (n) Fréquence
(%)
La peur de donner de son sang
Douleur 154 42
Maladie 36 10
Faiblesse 178 48
11
Douleur et
Faiblesse 42
Total 368 100
YOTE WT4MBIL4 ELIE 27
Le tableau VII a révélé que 48% avaient peur
de donner de leur sang à cause de la faiblesse ressentie après le
don, 42% eux c'est à cause de la douleur de la piqûre de seringue,
tandis que 11% ont peur de ces deux aspects en commun.
IV.3. Pratiques sur le don de sang
IV.3.1. Enquêtés ayant déjà
fait un don de sang
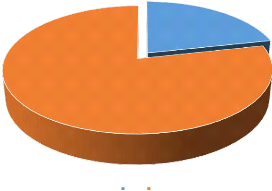
Non; 324;
78%
Oui Non
Oui; 89; 22%
YOTE WT4MBIL4 ELIE 28
Figure 6 : Répartition des
enquêtés ayant déjà donné ou non de leur
sang
La figure ci-dessus a montré que seulement 22%
d'enquêtés avaient déjà donné de leur sang
comparativement à ceux qui n'avaient jamais fait un don de sang soit 78%
d'enquêtés
YOTE WT4MBIL4 ELIE 29
IV.3.2. Motivations des enquêtés ayant
déjà fait ou pas un don de sang
Tableau VIII : Répartition des
enquêtés sur les raisons à faire ou pas un don de
sang
|
Caractéristiques
|
|
Effectif (n)
|
Fréquence (%)
|
|
Oui
|
Campagne de don
|
18
|
20
|
|
Demande pour un proche
|
59
|
66
|
|
Volontariat
|
12
|
14
|
|
Total
|
89
|
100
|
|
Fréquence
|
1 fois
|
58
|
65
|
|
2-3 fois
|
23
|
26
|
|
Plus de 3 fois
|
8
|
9
|
|
Total
|
89
|
100
|
|
Non
|
Manque d'information
|
77
|
24
|
|
Peur
|
183
|
57
|
|
Raison de santé
|
37
|
11
|
|
Pas intéressé
|
27
|
8
|
|
Total
|
324
|
100
|
Le tableau ci-haut a montré que sur les 89
enquêtés ayant déjà donné de leur sang, 59
soit 69% c'était sur la demande pour un proche. En rapport avec la
fréquence, 58 enquêtés soit 65% n'avaient donné de
leur sang qu'une seule fois. Pour ceux qui n'avaient jamais fait un don de
sang, la peur était la plus grande cause soit 57% des
enquêtés.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 30
IV.3.3. Disponibilité des enquêtés
à participer à un don de sang
Tableau IX : Répartition des enquêtés
sur la volonté de participer à une campagne dans une banque de
sang à Lubumbahi
|
Caractéristiques
|
|
Effectif (n)
|
Fréquence (%)
|
|
Connaissance d'un lieu ou un centre de collecte de
sang à Lubumbashi
|
Oui
|
239
|
58
|
|
Non
|
174
|
42
|
|
Total
|
413
|
100
|
|
La disponibilité à participer à une
campagne
|
Oui
|
104
|
25
|
|
Non
|
236
|
57
|
|
Peut-être
|
73
|
18
|
|
Total
|
413
|
100
|
Ce tableau a révélé que parmi les
enquêtés ; 58% connaissaient le centre de collecte situé
dans la commune Kamalondo. 25% ont été prêt(e)s à
participer à une campagne de don de sang alors que 18% étaient
hésitants et 57% quant à eux n'étaient pas
prêt(e)s.
IV.3.4. Proposition des enquêtés en vue de
l'amélioration du don de sang
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 ; 44%
|
|
|
|
|
|
127 ; 31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 ; 25%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Motivation moyennant Sensibilisation de la Instauration
de plusieurs
quelque chose communauté structures de
collecte
Figure 7 : Répartition des
enquêtés selon la proposition pour améliorer la collecte de
sang
La figure ci-dessus a montré que 44% des
enquêtés avaient proposé de renforcer la sensibilisation
dans la communauté ; 31% avaient parlé de la motivation moyennant
quelque
YOTE WT4MBIL4 ELIE 31
chose pour encourager au don et 25% quant à eux avaient
suggéré dit qu'il faut instaurer plusieurs structures de collecte
de sang.
IV.3.5. Enquêtés et leurs communes de
résidence
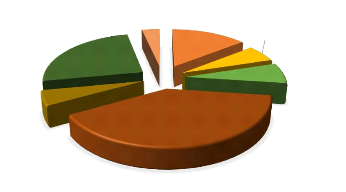
Ruashi
3%
Lubumbashi
25%
Annexe
14%
Kamalondo
6%
Kampemba
7%
Kenya
5%
Katuba
40%
Figure 8 : Répartition des
enquêtés selon leurs communes de résidence
La figure ci-dessus a montré que les
enquêtés de la commune de Katuba ont été
majoritairement représentés (40%) suivis de ceux des communes
Lubumbashi (25%), Annexe (14%), Kampemba 7%, Kamalondo (6%), Kenya (5%) et
Ruashi (3%).
YOTE WT4MBIL4 ELIE 32
CHAPITRE V. DISCUSSION
La présente étude a été
menée auprès de 413 participants et habitants de la ville
à Lubumbashi, elle a permis de constater que la majorité de la
population enquêtée avait déjà entendu parler du don
de sang, qui est un geste d'ultime importance et qui sauve des vies. Cependant
plusieurs ont été prêts à donner de leur sang
à un membre de famille ou à un proche. En pratique, une
minorité des enquêtés avaient déjà
donné de leur sang mais le plus souvent sur demande d'un proche ; la
peur constituait le frein principal au don de sang sous prétexte que
cela engendrait une faiblesse ou une douleur.
S'agissant du sexe des participants, dans notre étude,
les femmes étaient plus nombreuses (53 %) que les hommes. Cette tendance
diffère des résultats obtenus ailleurs. En Éthiopie,
à l'Université d'Arsi et à l'Université des
sciences et technologies d'Adama, 84,4 % des participants étaient des
hommes (Gebresilase et al., 2017). De même, à
l'Université de Samara, 67 % étaient de sexe masculin (Tadesse et
al., 2018). En RDC, à Kinshasa, Ngole et al. (2018)
ont observé une prédominance masculine (71 %). En Arabie
Saoudite, Almulhim et al. (2020) ont rapporté 66,5 % d'hommes,
tandis qu'au Cameroun, à Kribi, Fouda et al. (2024) ont
également constaté que la majorité des donneurs
étaient masculins (30,3 %). La prédominance féminine
observée dans notre étude pourrait s'expliquer par une plus
grande disponibilité des femmes à participer à
l'enquête.
Pour ce qui concerne l'âge des participants, dans notre
étude, l'âge des enquêtés se situait majoritairement
entre 18 et 27 ans (49 %). Ce résultat rejoint plusieurs études
où les jeunes constituent le groupe le plus représenté.
À l'Université d'Arsi en Éthiopie, 84,4 % des participants
avaient entre 18 et 24 ans (Gebresilase et al., 2017). À
Kinshasa, 40 % avaient entre 20 et 24 ans (Ngole et al., 2018). Au
Cameroun, à Kribi, 59,6 % se situaient entre 21 et 30 ans (Fouda et
al., 2024). Cette prédominance des jeunes pourrait s'expliquer
par la participation massive des étudiants.
S'agissant des connaissances sur le don de sang, nos
résultats révèlent que 99 % des participants avaient
déjà entendu parler du don de sang, ce qui traduit une
sensibilisation élevée. Toutefois, 45 % ignoraient la
quantité de sang prélevée et 41 % ne connaissaient pas la
fréquence possible des dons, ce qui montre un déficit
d'informations pratiques. Dans notre étude, 94 % savaient que le sang
est systématiquement testé avant transfusion et 90 %
reconnaissaient son rôle vital dans le sauvetage des vies.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 33
Ces résultats sont supérieurs à ceux
rapportés ailleurs. En Arabie Saoudite, Almulhim et al. (2020)
ont trouvé que seulement 58 % avaient un bon niveau de connaissance. En
Éthiopie, Gebresilase et al. (2017) ont rapporté 79,4 %
de bonnes connaissances chez les étudiants en sciences de la
santé et 13,9 % chez les étudiants non spécialisés.
À Kinshasa, 33,4 % des étudiants avaient de bonnes connaissances
(Ngole et al., 2018). À l'Université de Gondar, en
Éthiopie, 48,2 % des participants avaient un niveau satisfaisant (Melku
et al., 2018). Dans la bande de Gaza, Alsarafandi et al.
(2023) ont montré que 54,7 % avaient de bonnes connaissances, tandis
qu'à Kribi, 61,59 % avaient un niveau insuffisant (Fouda et
al., 2024). À l'Université de Wachemo, en
Éthiopie, Mussema et al. (2024) ont trouvé 77,6 % de
participants avec un bon niveau. Ces comparaisons montrent que la population de
Lubumbashi est bien informée, mais reste limitée sur les aspects
techniques du don.
S'agissant des attitudes vis-à-vis du don de sang, dans
notre étude, 96 % jugeaient le don important et 73 % étaient
prêts à donner pour un membre de famille, contre 58 % pour un
inconnu. Les principales sources d'information provenaient des professionnels
de santé (34 %). Ailleurs, d'autres sources dominaient : à Kribi,
la télévision représentait la première source
(31,92 %) (Fouda et al., 2024), tandis qu'à Madagascar, les
médias jouaient un rôle central (Rakotoniaina et Rakoto, 2023).
Nos résultats rejoignent aussi ceux de Tadesse et
al. (2018), qui ont observé 65,8 % d'attitudes favorables
à Samara (Éthiopie). À Hosanna (Éthiopie), Mussema
et al. (2023) ont trouvé 49,5 % d'attitudes positives, tandis
qu'à Wachemo (Éthiopie), 79,6 % affichaient une attitude
favorable (Mussema et al., 2024). La forte acceptabilité dans
notre étude s'explique par la solidarité familiale et
communautaire, caractéristique des sociétés africaines.
Malgré un niveau de connaissance élevé et
des attitudes favorables, la pratique du don reste faible : seuls 22 % avaient
déjà donné leur sang, dont 66 % à la demande d'un
proche et 14 % par volontariat. Parmi eux, 65 % n'avaient donné qu'une
seule fois. La peur de la douleur et de la faiblesse (89 % des
enquêtés) reste le principal obstacle.
Ces résultats sont proches de ceux observés dans
d'autres pays africains. À l'Université d'Arsi, 27,2 % des
étudiants en sciences de la santé et 22,8 % des non-sciences de
la santé avaient déjà donné (Gebresilase et
al., 2017). À Wachemo, 19,3 % étaient donneurs (Mussema
et al., 2024). À Kinshasa, 15,2 % des étudiants avaient
déjà donné leur sang, surtout pour sauver une vie
YOTE WT4MBIL4 ELIE 34
(74,2 %) ou répondre à la demande d'un proche
(24,5 %) (Ngole et al., 2018). À Hosanna, 29,15 % donnaient
positivement leur sang (Mussema et al., 2023).
Enfin, 25 % des enquêtés de Lubumbashi se
déclaraient prêts à participer à une campagne, et 44
% proposaient de renforcer la sensibilisation dans la communauté. La
majorité des participants provenaient de la commune de Katuba, ce qui
reflète une proximité géographique avec
l'enquêteur.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 35
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Cette étude portait sur l'évaluation des
connaissances, attitudes et pratiques liées aux dons de sang dans la
ville de Lubumbashi. Une enquête transversale a été
menée au moyen d'un questionnaire standardisé auquel 413
enquêtés avaient participé.
Pour le niveau des connaissances, les résultats ont
montré que la quasi-totalité des enquêtés avaient
déjà entendu parler du don de sang (100 % des universitaires et
97 % des secondaires), principalement via les professionnels de santé et
la télévision. 90 % des enquêtes reconnaissaient que le don
de sang sauve des vies et que le sang est systématiquement testé
avant toute transfusion, mais des lacunes subsistaient notamment sur la
quantité à prélever ainsi que la fréquence possible
du don. Sur le plan des attitudes, 96 % considéraient le don comme
important et 73 % se disaient prêts à donner à un membre de
famille, mais seulement 58 % accepteraient de donner à un inconnu.
Toutefois, la peur constituait un frein majeur liée à la
faiblesse physique et à la douleur. En termes des pratiques, seuls 22 %
avaient déjà donné leur sang, principalement à la
demande pour un proche (66 %), et 65 % ne l'avaient fait qu'une seule fois. Par
ailleurs, 58 % connaissaient l'existence d'un centre de collecte, mais à
peine 25 % se déclaraient disposés à participer à
une campagne. Ces résultats confirment que, malgré une exposition
satisfaisante à l'information et des attitudes globalement positives,
les connaissances demeurent fragmentaires et les pratiques très
limitées. Les principales barrières sont d'ordre psychologique
(peur), informationnel (manque de connaissances précises) et social (don
motivé surtout par les liens familiaux).
À la lumière de ces constats, plusieurs
perspectives s'imposent : Renforcer les campagnes de sensibilisation,
notamment dans les établissements scolaires et universitaires,
en mettant l'accent sur la sécurité du don, la
régularité possible et les centres existants ;
Former les leaders communautaires et religieux pour qu'ils jouent un
rôle actif dans l'encouragement au don volontaire, en
déconstruisant les mythes et fausses croyances ; Intégrer le don
de sang dans les politiques de santé publique comme un acte citoyen de
prévention, avec éventuellement des incitations
non financières (certificats, journées de reconnaissance, etc.) ;
Approfondir la recherche, notamment en menant des études qualitatives
pour explorer les freins culturels, psychologiques et religieux, et en
comparant les résultats entre différents milieux urbains et
ruraux.
YOTE WT4MBIL4 ELIE 36
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Almulhim A, Kabbani A, Alhizami K, Alsomaly Y, Almatter A,
Alsumaien A et Mohammedin A. (2020). Évaluation de
l'attitude, du niveau de connaissance et de sensibilisation au don de sang dans
un échantillon de la communauté saoudienne : une étude
transversale. IJMDC. 4 (9) : 1428-1432.
Alsarafandi M, Sammour A, Elijla Y, Aldabbour B, Mahaisen D,
Shiha H, Alasttal A, Dalloul N et Abuhaiba A. (2023). Connaissances, attitudes
et pratiques des étudiants en médecine de la bande de Gaza
à l'égard du don de sang volontaire: une étude
transversale. BMC Health Serv Res. 23(1): 1333. Doi:
10.1186/s12913-023-10338-5
Anselm C. (2024). Hématies (globules
rouges).
https://www.kenhub.com/fr/library/anatomie/hématies-globules-rouges
Association Médicale Mondiale. (2013).
Déclaration d'Helsinki - Principes éthiques applicables à
la recherche médicale impliquant des êtres humains.
https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-dhelsinki-de-lamm-principes-ethiques-applicables-a-la-recherche-medicale-impliquant-des-etres-humains/
Barhum L. (2024). À quelle
fréquence pouvez-vous donner du sang?
https://www.verywellhealth.com/how-often-can-you-donate-blood-7500959
Cartwright M. (2023). Découverte
de la Circulation Sanguine par William Harvey.
Centre Suisse de Contrôle de Qualité (2017).
Les systèmes ABO et Rhésus. 2 :1.
Coudrey B. (2024). Leucocytes : tout ce que
révèle une prise de sang. Biogroup biologie médicale.
Conseil régional Île-de-France.
(2025). Pourquoi donner?
https://dondesang-cridf.org/le-don-du-sang
Dibwe D. (2020). Lubumbashi et l'idée de
mémoire orale. p2.
Estelle B. (2018). Le don du sang.
https://www.sante-sur-le-net.com/sante-quotidien/dons-et-greffes/don-du-sang
Établissement français du sang
(2023). Le plasma on vous dit tout.
https://dondesang.efs.sante.fr/articles/le-plasma-vous-dit-tout#:~:text=Le%20plasma%20est%20la%20partie,th%C3%A9rapeutique%20majeur
%20pour%20les%20patients.
Fomba M, Baby M, Diarra A, Maiga B, Tessougue E, Traore M,
Togora G et Bakayo S. (2023). P-015 Réticence au don de
sang au CNTS de Bamako. Transfusion Clinique et Biologique. 30 (1) :
s62.
https://doi.org/10.1016/j.tracli.2023.09.065
Foucreau M, Joguet-Babut M et Occhiali E. (2024).
Les règles de bonnes pratiques pour la transfusion sanguine :
le point de vue du comité IDE reanimation de la SFAR.
: 475-478.
Anesthésie et Réanimation. 10 (5)
https://doi.org/10.1016/j.anrea.2024.03.024
YOTE WT4MBIL4 ELIE 37
Gebresilase H, Fite R et Abeya S. (2017). Connaissances,
attitudes et pratiques des étudiants à l'égard du don de
sang à l'université d'Arsi et à l'université des
sciences et technologies d'Adama: une étude transversale comparative.
BMC Hématologie. 17(20).
Gebresilase H, Fite R & Abeya S. (2017). Knowledge,
attitude and practice of students towards blood donation in Arsi university and
Adama science technology university: a comparative cross-sectional Study.
Biomed Central Hematology. 10.
HAS-ANSM (2012). Transfusion de plasma
thérapeutique : produits, indications.
https://www.has-sante.fr/jcms/c
1264081/fr/transfusion-de-plasma-therapeutique-produits-indications
HAS-ANSM (2015). Transfusion des plaquettes :
produits, indications.
Khebri (2020). Le système ABO. 7 : 7.
Kuter D. (2024). Revue générale
des troubles plaquettaires. Le Manuel MSD.
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/h%C3%A9matologie-et-oncologie/thrombop%C3%A9nie-et-dysfonctionnement-des-plaquettes/revue-g%C3%A9n%C3%A9rale-des-troubles-plaquettaires
Laget L, Chiaroni J et Pirenne F. (2020).
Transfusion sanguine et produits dérivés du sang :
Indications, complications. Hémovigilance. La Revue du
Praticien. 70 (5) : e167-174.
https://www.larevuedupraticien.fr/article/transfusion-sanguine-et-produits-derives-du-sang-indications-complications-hemovigilance
Makema G. (2015). Administration publique et le
développement socio-économique. Cas de la ville de Lubumbashi.
https://www.memoireonline.com/04/19/10692/m_Administration-publique-et-le-developpement-socio-economique-Cas-de-la-ville-de-Lubumbashi0.html
Melku M, Asrie F, Shiferaw E, Woldu B, Yihunew Y, Asmelash D
and Enawgaw B. (2018). Knowledge, Attitude and Practice
Regarding Blood Donation among Graduating Undergraduate Health Science Students
at the University of Gondar, Northwest Ethiopia. Ethiop J Health Sci.
28(5):571-582. doi: 10.4314/ejhs.v28i5.8. PMID: 30607072; PMCID: PMC6308782.
Montenon I. (2024). Leucocytes bas : quand
s'inquiéter de son taux de globules blancs ? Qare.
https://www.qare.fr/sante/prise-de-sang/leucocytes-bas/
Mussema A, Bawore G, Abebaw T, Tadese W, Belayineh M, Yirga A,
Mohammed T, Seid A. (2023). Voluntary blood donation
knowledge, attitude, and practice among adult populations of Hosanna Town,
South Ethiopia: a community-based cross-sectional study. Front Public Health.
11:1141544. doi: 10.3389/fpubh.2023.1141544. PMID: 37383266; PMCID:
PMC10296759.
Ngole M, Heugang D, Sumbu B, Muwonga J et Kayembe D.
(2018). Connaissances, attitudes et pratiques des
étudiants de l'Université de Kinshasa sur le don
bénévole de sang /
YOTE WT4MBIL4 ELIE 38
Knowledge, attitude, practice of students about voluntary blood
donation at the University of Kinshasa. 11(2).
Nyombe E. (2025). Evolution du don
bénévole de sang en RDC. Radio Okapi.
https://www.radiookapi.net/2025/06/13/emissions/parole-aux-auditeurs/evolution-du-don-benevole-de-sang-en-rdc
OMS (2023). Sécurité
transfusionnelle et approvisionnement en sang.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability
OMS (2024). Journée mondiale du donneur de sang
2024.
https://www.paho.org/fr/campagnes/journee-mondiale-du-donneur-sang-2024
OMS. (2022). Principaux messages.
https://www.who.int/fr/campaigns/world-blood-donor-
day/2022/key-messages
OMS. (2022). Produits sanguins: pourqui donner son sang?
https://www.who.int/fr/news-
room/questions-and-answers/item/blood-products-why-should-i-donate-blood
OPS. (2025). Journée Mondiale du Don
de Sang.
https://dondesang-cridf.org/le-don-du-sang
Pottier R. (2017). Le don du sang à la lumière
de l'anthropologies. Transfusion Clinique et
Biologique 24 (4): 458-461
Rakotoniaina A et Rakoto A. (2023). P-006
Évaluation des connaissances, attitudes, pratiques sur le don de sang
à Toliara. Transfusion Clinique et Biologique. 30 (1): s59-s60.
https://doi.org/10.1016/j.tracli.2023.09.057
RFI. (2020). RDC: les drépanocytaires
affectés par le manque de sang.
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200614-rdc-les-dr%C3%A9panocytaires-affect%C3%A9s-le-manque-sang
Sarode R. (2024). Précautions et
réactions indésirables lors de la transfusion sanguine.
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-sang/transfusion-sanguine/pr%C3%A9cautions-et-r%C3%A9actions-ind%C3%A9sirables-lors-de-la-transfusion-sanguine
Sarode R. (2024). Procédure de don du
sang. Le Manuel MSD.
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-sang/transfusion-sanguine/proc%C3%A9dure-de-don-du-sang
Sarode R. (2024). Produits sanguins. Le Manuel
MSD.
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/h%C3%A9matologie-et-oncologie/m%C3%A9decine-transfusionnelle/produits-sanguins
Sayedahmed A, Mohamedali A, Ghalib K, Alkhair A, Ahmed M and
Fadul T. (2020). Knowledge, attitudes and practices regaarding
blood donation among sudanese population. ISBT Science Series. 15 (2):
221-230.
https://doi.org/10.1111/voxs.12551
Socin H. (2021). L'épopée de la
transfusion sanguine citratée. Vaisseaux, Coeur, Poumons.
26 (6): 34-38.
Tazerout M et Galinier Y. (2017). Manuel
d'aide à la kformation en transfusion sanguine. Coordination
Régionale d'Hémovigilance. Toulouse. 40: 2-3.
ANNEX
? Questionnaire ayant servi d'enquête
UNIVERSITÉ DE LUBUMBASHI Faculté des
Sciences Pharmaceutiques
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE : CONNAISSANCES, ATTITUDES ET
PRATIQUES SUR LE DON DE SANG A LUBUMBASHI
/
Prénom du participant :
|
Sexe : M Âge :
|
/ F
|
|
s 17 ans
s [18-27 ans]
s [28-37 ans]
s [38-47 ans]
s Supérieur à 47 ans
Niveau d'études :
Profession :
Commune de résidence :
Partie 1 : Connaissances sur le don de sang s
Avez-vous déjà entendu parler du don de sang ? (Oui
|
/ Non
|
)
|
/ Non
)
/ 450 ml
s Savez-vous quelles sont les conditions requises pour donner
du sang ? (Oui s Selon vous, quelle est la quantité de sang
prélevée lors d'un don (environ) ? (250 ml
|
/ 1 litre
|
/ Je ne sais pas
|
)
|
s À quelle fréquence peut-on donner son sang sans
risque pour la santé ? (Tous les moi / Tous
|
les 3 mois
|
/ Tous les 6 mois
|
/ Je ne sais pas
|
)
|
|
s Est-ce que le sang donné est systématiquement
testé avant transfusion ? (Oui
|
/ Non
|
/ Je
|
|
ne sais pas
|
)
|
/
s Quels sont les risques possibles du don de sang pour le donneur
? (Fatigue temporaire
|
Acquisition de maladies
|
/ Aucun risque
|
/ Je ne sais pas
|
)
|
|
s Le don de sang peut-il sauver des vies ? (Oui
|
/ Non
|
/ Je ne sais pas
|
)
|
/
YOTE WT4MBIL4 ELIE A
s Connaissez-vous des maladies qui nécessitent des
transfusions sanguines fréquentes ? (Oui
Non )
)
/ Non
/ 18 ans
s Pensez-vous qu'il existe un âge minimum
légal pour donner son sang en RDC ? (Oui s Si
OUI quel est, selon vous, l'âge minimum pour donner son
sang en RDC ? (15 ans
|
/ 21 ans
|
/ Je ne sais pas
|
)
|
|
Partie 2 : Attitudes envers le don de sang
s Trouvez-vous important de donner son sang pour
aider les autres ? (Oui
|
/ Non
|
/ Sans
|
opinion )
|
s Seriez-vous prêt(e) à donner
votre sang à un inconnu ? (Oui
|
/ Non
|
/ Peut-être
|
)
|
|
s Seriez-vous prêt(e) à donner
votre sang à un membre de votre famille ? (Oui
|
/ Non
|
/ Peut-
|
|
être
|
)
|
/ Non )
/ Maladie / Faiblesse après
s Avez-vous peur de donner votre sang ? (Oui
s Si OUI, quelle est la principale raison de
votre peur ? (Douleur
s Pensez-vous que le don de sang soit
encouragé dans votre communauté (Coutume, Religion, ...) ?
(Oui
/ Non
)
/ Je ne sais pas
/
s Quelles sources d'information vous
influencent le plus sur le sujet du don de sang ? (Famille
|
Télévision
|
/ Radio
|
/ Réseaux sociaux
|
/ Amis
|
/ Professionnels de santé
|
)
|
Partie 3 : Pratiques relatives au don de sang
|
s Avez-vous déjà donné
votre sang ? (Oui
|
/ Non
|
)
|
)
/
s Si oui, combien de fois avez-vous donné
du sang ? (1 fois / 2-3 fois / Plus de 3 fois
s Quelle était la raison principale pour
laquelle vous avez donné du sang ? (Campagne de don
|
Demande pour un proche
|
/Volontariat
|
/
|
YOTE WT4MBIL4 ELIE B
Autre : )
s Si non, pourquoi ? (Manque d'information /
Peur / Raisons de santé / Pas intéressé
Autre : )
/ Non )
s Connaissez-vous un lieu ou un centre de
collecte de sang à Lubumbashi ? (Oui
s Seriez-vous prêt(e) à participer
à une campagne de don de sang dans les prochains mois ? (Oui
s Que faudrait-il améliorer pour
encourager davantage le don de sang à Lubumbashi ? (Question ouverte)
R/
| 


