Annexe 6 : danger hauteur

Annexe 7 : Esquisse de MAD, Version 1. Prise de
décision d'un Rider Expert face à une nouvelle situation
70
« Muret en descente »
|
Slider un nouveau
|
Evaluer le risque
Identifier les intentions
|
|
|
|
|
Observer le milieu
|
|
|
Caractériser le spot
|
|
|
|
|
Anticiper
|
|
Prévoir les conséquences d'un slide
|
|
|
|
|
Evaluer plusieurs slides en relation
|
|
avec les contraintes du milieu
|
|
71
Répondre au but ultime : slider le muret
Prévoir le slide
Interpréter les conséquences
Prévoir un slide
de niveau moyen
Simulation de la tâche
Avancer
Reculer
Inclinaison du corps à 15° Anticiper
Avancer jusqu'au muret
Apprécier des
caractéristiques du muret
Agir sur son propre corps
Réguler sa vitesse
Sauter
Prévoir l'impact
Positionner en l'air
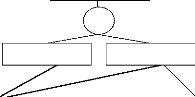
Mauvais calage
Si
Calage
Echec
Réussite
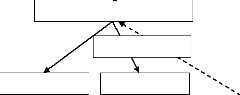
Anticiper la chute
Chute
Non chute
Retour sur évaluation
de la tâche
réalisée au
vu du but à atteindre
De manière subjective Par le collectif
Non validé
Validé
Arrêt
Recommencer
Evaluation d'un
nouveau Slide
72
Annexe 8 : l'automatisation
Piéron distingue « des automatismes primaires,
innés, et des automatismes secondaires, acquis ». Lautrey,
définit l'automatisation comme ceci : « En psychologie
cognitive, le traitement automatique de l'information est
généralement caractérisé par l'absence de
coût attentionnel, l'absence de contrôle, l'absence de conscience,
le parallélisme des opérations et la rapidité
d'exécution.». Dans les années 1880, John Hughlings
Jackson, médecin anglais, insistait sur « la dissociation
automatico-volontaire dans le comportement » et avançait
l'hypothèse de l'existence de mécanismes cérébraux
dans les processus automatiques. Selon Leplat, il est difficile de
définir l'automatisation car « le caractère automatique
est lié à des mécanismes internes qui ne sont pas
directement observables, mais doivent être inférés
».
Perruchet (1988) attribue une place particulière
à l'inconscience dans le processus d'automatisation: le mouvement est
« opérationnalisé par l'incapacité des sujets
à verbaliser, ou plus généralement à
témoigner intentionnellement par une réponse symbolique de la
nature d'un processus ou d'un événement ». Ainsi,
Wallon (1942) avait déjà noté qu' « il arrive que
la conscience n'ait plus part à des processus dont les termes avaient
une valeur représentative mais l'ont perdue ». On peut
expliquer le phénomène des mouvements devenus automatiques de
cette manière, et leurs liens avec la notion de compétence.
| 


