CHAPITRE III : PRÉSENTATION, ANALYSE ET
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 43
3.1 Introduction 43
xi
3.2 Présentation des résultats
expérimentaux 43
3.3 Analyse des paramètres géotechniques
observés 45
3.4 Interprétation des résultats
46
3.4.1 Stabilité générale du
système 46
3.4.2 Efficacité de la
végétalisation 46
3.4.3 Réduction de l'humidité
résiduelle 46
3.5 Discussion des performances techniques 46
Formule utile d'analyse : 46
3.6. Représentation graphique de la partie
stabilisée à 31 jours de stabilisation 47
Conclusion partielle 47
CONCLUSION GENERALE 48
Références 50
ANNEXES 53
1. A-1 53
2. A-2 : Croissance progressive du vétiver en
photo (Jour 1, 5, 14, 21,31) 54
3. A-3 : MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET
GÉOTECHNIQUE DE LA
STABILISATION D'UNE PARCELLE DE 625 m2 PAR
PNEUS, VÉTIVER ET PAPYRUS 56
1
CHAPITRE 0 : INTRODUCTION GENERALE
0.1. Etat de la question
Les sols marécageux posent un défi majeur pour
la construction en raison de leur faible portance, de leur saturation en eau et
de leur instabilité. Dans la cellule Londo, située à
Butembo, une zone sujette aux inondations, ces problèmes se manifestent
par des tassements et des effondrements, rendant difficile l'aménagement
durable du territoire.
Face à ces défis, cette étude vise
à proposer une solution innovante basée sur l'utilisation de
matériaux recyclés combinés à des techniques de
bio-ingénierie adaptées au climat tropical de Butembo. L'objectif
est de renforcer les propriétés mécaniques des sols tout
en réduisant les coûts de stabilisation et en limitant l'impact
environnemental des travaux.
0.2. Problématique
Les sols marécageux présentent des défis
pour le développement des infrastructures en raison de leur faible
portance, de leur forte saturation en eau et de leur sensibilité aux
inondations. Ces caractéristiques entraînent des tassements
différés, une instabilité structurelle et des
difficultés de mise en oeuvre des fondations. Malgré les efforts
pour adapter les méthodes conventionnelles de stabilisation, celles-ci
restent souvent coûteuses et peu adaptées aux conditions
locales.
Dans plusieurs régions tropicales, la stabilisation des
sols marécageux repose sur des solutions classiques comme l'ajout de
chaux ou de ciment (Bernard & Rousseau, 2021), qui ont un impact
écologique et un coût élevé. De plus, ces approches
ne traitent pas durablement le problème des remontées capillaires
et de l'affaiblissement du sol en période de fortes pluies. Pour le cas
de Londo, il est donc crucial d'explorer des alternatives innovantes, à
la fois économiques et respectueuses de l'environnement, pour assurer
une stabilité durable des infrastructures.
Les matériaux recyclés et les techniques de
bio-ingénierie représentent des solutions prometteuses pour
améliorer les caractéristiques mécaniques des sols tout en
réduisant les coûts et l'impact environnemental. Toutefois, leur
efficacité et leur mise en oeuvre dans un contexte tropical comme celui
de Butembo nécessitent une analyse approfondie.
2
Dès lors, la question suivante se pose :
Comment stabiliser efficacement les sols marécageux de Londo
en intégrant des matériaux recyclés et des techniques de
bio-ingénierie, tout en assurant une solution économique et
durable ? Où trouver ces matériaux à longue échelle
?
Cette étude vise à répondre à
cette problématique en explorant une méthode innovante et
applicable aux conditions locales.
0.3. Objectifs
a) Objectif général
L'objectif général de ce présent travail
est de développer et évaluer une approche innovante pour la
stabilisation des sols marécageux en intégrant des
matériaux recyclés et des techniques de bio-ingénierie.
b) Objectifs spécifiques
> Identifier les caractéristiques géotechniques
des sols marécageux de Londo.
> Étudier l'impact des matériaux recyclés
(ex. pneus usagés, déchets de construction) sur
la stabilisation des sols.
> Sélectionner des plantes adaptées au climat
tropical de Butembo pour renforcer la
cohésion du sol.
> Modéliser et évaluer la performance des
solutions proposées à travers des études de
terrain et des simulations.
0.4. Hypothèses de recherche
Pour réaliser notre travail, nous avons
élaboré les hypothèses suivantes :
> L'utilisation de matériaux recyclés
améliore la portance et la stabilité des sols
marécageux.
> Les techniques de bio-ingénierie, en particulier
l'utilisation de plantes adaptées, permettent de limiter
l'érosion et d'améliorer la cohésion des sols.
> Une combinaison de ces techniques offre une solution
économique et durable pour la stabilisation des sols
marécageux.
3
0.5. Justification de l'étude
Cette étude se justifie par :
> L'urgence du problème : Londo fait face à
des inondations fréquentes qui compromettent la stabilité des
infrastructures.
> L'intérêt scientifique : Tester une approche
innovante en combinant matériaux recyclés et
bio-ingénierie.
> L'impact économique et environnemental :
Réduire les coûts de stabilisation et favoriser l'usage de
ressources locales.
0.6. Délimitation de l'étude
> Délimitation spatiale : : L'étude est
menée dans la cellule Londo, précisément sur un lopin de
terrain expérimental de 3 mètres sur 4 mètres (3x4 m),
situé dans le quartier de l'Évêché à
Butembo.
> Délimitation temporelle : L'étude couvre
une période d'analyse de 12 mois afin d'observer l'évolution des
sols stabilisés.
> Délimitation thématique : L'étude se
concentre sur des méthodes alternatives et innovantes de stabilisation,
en excluant les solutions classiques telles que les fondations profondes.
0.7. Limites de l'étude
Dans ce travail nous allons nous focaliser sur des
observations de terrain. L'absence de tests en laboratoire constitue une limite
importante.
0.8. Subdivision du travail
Outre l'introduction générale et la conclusion
générale, ce travail comportera trois chapitres :
> CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES MATERIAUX RECYCLES ET LA
BIO-INGENIERIE DANS LA STABILISATION DES SOLS
> CHAPITRE II : METHODOLOGIE DE STABILISATION DU SOL
MARECAGEUX DE LONDO
> CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION
DES RESULTATS
4
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES MATERIAUX RECYCLES ET
LA
BIO-INGENIERIE DANS LA STABILISATION DES SOLS
Le présent chapitre vise à établir les
fondements théoriques et techniques de la stabilisation des sols
marécageux à travers l'usage de matériaux recyclés
et de la bio-ingénierie. En s'appuyant sur des références
scientifiques et des expériences de terrain, il explore les
propriétés géotechniques des pneus usagés, des
débris de béton et des plantes tropicales adaptées. Cette
base permettra de justifier les choix méthodologiques du chapitre
suivant et d'ancrer la démarche dans une logique de durabilité,
d'innovation et d'adaptation locale.
Section 0 : Contexte territorial - Présentation
de la cellule Londo (ville de Butembo)
Avant d'aborder le vif du présent chapitre, il est
essentiel de situer le cadre géographique et social dans lequel cette
recherche a été menée. La cellule Londo constitue le
périmètre d'étude choisi pour expérimenter une
méthode innovante de stabilisation des sols marécageux à
base de matériaux recyclés et de techniques de
bio-ingénierie.
0.1. Situation géographique
La cellule Londo fait partie des huit cellules du quartier de
l'Évêché, lui-même situé dans la commune
Bulengera de la ville de Butembo (Nord-Kivu). Elle est délimitée
de la manière suivante :
- À l'Est, par la cellule Vuhumbi
et le quartier Mutiri ;
- À l'Ouest, par la rivière
Kimemi, qui la sépare des cellules
rivière-Kimemi et Vungi
A ;
- Au Nord, par le quartier Kalemire
;
- Au Sud, par la cellule
Makoka.
Ce positionnement géographique place Londo dans une
zone semi-urbaine soumise à des dynamiques de croissance rapide, avec un
développement foncier accru, souvent non planifié. Une carte du
quartier est présentée en annexe (figure A.1), avec la cellule
Londo encerclée en jaune.
5
0.2. Données démographiques
Selon les données de recensement 2024, la cellule compte
2 956 habitants, répartis
comme suit :
Hommes
801
Femmes
557
Garçons
690
Filles
908
Total
2 956
Tableau 1 : Effectif de la population de la cellule Londo
lors du recensement de l'année 2023
Cette population est concentrée sur une superficie
estimée à 1,33 km2, soit une densité d'environ
2 222 habitants/km2, ce qui témoigne d'une pression
foncière non négligeable, particulièrement dans un
environnement dont les sols sont hydromorphes et peu adaptés à la
construction.
0.3. Composition socioculturelle
La majorité des habitants appartient au groupe ethnique
Yira, composé notamment des clans Basukali, Baswagha, Bahira, Batangi,
Bahambo, Bakira, Bamate, entre autres. Bien que des individus d'autres tribus
soient également présents, ils y forment une minorité
sociale.
Ce contexte culturel est déterminant dans la conception
de solutions d'aménagement, car il faut tenir compte des
représentations locales liées à l'eau, à la terre,
à la construction, mais aussi à la perception du recyclage et des
plantes utilisées en bio-ingénierie.
0.4. Gouvernance locale
Sur le plan administratif, la cellule Londo est
subdivisée en blocs (ou dix maisons), encadrés par :
- KATEMBO MUHESI Guillaume - MUHINDO SYAHOMBIRE - PALUKU
MBUTUTU
- ISAMBIRO Jeanne
L'ensemble est placé sous la gestion de Madame KAVIRA
IVAMBA Cyprianose, cheffe de cellule, assistée de son adjoint KAKULE
SUMBANDELI Denis. Cette organisation locale joue un rôle clé dans
l'acceptation sociale du projet de stabilisation, notamment en facilitant
l'expérimentation participative sur terrain et l'adhésion
communautaire.
6
Section 1 : Généralités sur les
déchets - Cas particulier des pneus usagés
1.1. Définition des
déchets
Les déchets sont des résidus d'activités
humaines ou naturelles, considérés comme n'ayant plus
d'utilité immédiate pour leur détenteur. Selon la
Directive 2008/98/CE, un déchet est : « Toute substance ou tout
objet dont le détenteur se défait ou a l'intention ou
l'obligation de se défaire » (Union européenne, 2008).
Dans le secteur du génie civil, les déchets
représentent à la fois un enjeu écologique et une
opportunité technique :
- Enjeu écologique, car leur accumulation non
maîtrisée pollue l'air, les sols et les nappes phréatiques
;
- Opportunité technique, car certains déchets
peuvent être revalorisés comme matériaux secondaires,
notamment pour le remblayage, le traitement des sols, ou encore dans la
fabrication de bétons alternatifs (Ademe, 2021).
1.2. Classification des
déchets
Les déchets peuvent être classés selon
plusieurs critères :
Critère
Origine
Propriétés
État physique
Valorisation
Types
Ménagers, industriels, agricoles, BTP, hospitaliers
Dangereux, non dangereux, inertes
Solides, liquides, gazeux
Recyclables, compostables, inertes, non recyclables
Tableau 2 : Classification des déchets selon les
critères
En génie civil, les déchets les plus
utilisés pour la valorisation des sols sont :
- Les déchets inertes : béton
concassé, brique, céramique ;
Tableau 3 : Composition physico-chimique d'un pneu
7
- Les déchets non biodégradables :
plastiques, caoutchouc, pneus, géosynthétiques. 1.3. Les
pneus usagés : un défi et une opportunité
1.3.1. Problématique mondiale des pneus en fin
de vie
Chaque année 1,5 milliard de pneus atteignent leur fin
de vie dans le monde (ONUDI, 2020). Le stockage ou l'incinération
sauvage de ces pneus provoque :
- Pollution des sols et de l'air (émission de dioxines)
;
- Prolifération de moustiques en saison humide (eaux
stagnantes) ; - Risque d'incendies toxiques.
À Butembo, les pneus sont souvent abandonnés ou
utilisés de façon informelle, sans encadrement technique.
Pourtant, ils peuvent jouer un rôle d'amendement géotechnique,
notamment dans les sols hydromorphes.
1.3.2. Composition physico-chimique du
pneu
Un pneu est un matériau composite structuré. En
moyenne, sa composition massique est la suivante (Ali et al., 2019) :
Constituant
Caoutchouc (naturel + synthétique)
Noir de carbone
Acier
Textiles (nylon,
rayonne)
Additifs (soufre, zinc)
Pourcentage
40-60 %
20-30 %
10-15 %
5-10 %
2-4 %
Fonction
Élasticité, résistance à la
fatigue
Renforcement, protection UV
Armature (ceintures, talon)
Renforcement interne
Vulcanisation, résistance au feu
8
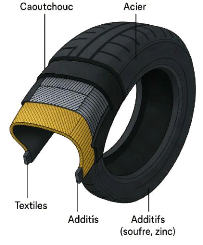
Figure 1 Coupe structurelle d'un pneu 1.3.3.
Propriétés géotechniques du pneu
Les propriétés mécaniques du pneu en font
un matériau d'ingénierie potentiel. Il peut être
utilisé seul ou en mélange avec un sol. Les
caractéristiques les plus importantes sont :
Propriété
Densité sèche (ñd)
Porosité
Résistance au cisaillement (ö)
Cohésion apparente (c)
Coefficient de perméabilité (k)
Valeur typique
450-600 kg/m3 (granulats de pneus)
Élevée (drainage excellent)
30-45° (si mélangé avec sable)
0 à 30 kPa (selon humidité et taux)
10-2 à 10-3 m/s (haute
perméabilité)
Tableau 4 : : Propriétés géotechniques
d'un pneu
Avec yd = ms ~
? ms = masse sèche du matériau (en N) ? V =
volume total du matériau (en m3)
9
? ?d = poids volumique sec (kN/m3) 1.3.4.
Modes d'utilisation en génie civil
Les pneus peuvent être utilisés sous
différentes formes transformées :
- Pneus entiers : fondations de murs de soutènement, murs
de soutènement éco-tyres, remblais ;
- Pneus coupés : en bandes ou demi-cercles pour le
drainage ;
- Broyats de pneus : comme granulats ou amendement
géotechnique.

Figure 2 : Pneus comme remblais légers
1.3.5. Modes alternatifs d'utilisation
Dans un contexte comme celui de Butembo, où
l'accès aux engins de chantier est très limité, il est
impératif d'utiliser des méthodes manuelles de stabilisation
adaptées au terrain et aux ressources locales. Les pneus usagés,
souvent perçus comme un déchet, peuvent être
transformés en matériaux de stabilisation efficaces sans
traitement mécanique lourd (ONUDI, 2020 ; Ali et al., 2019).
De plus, les autorités techniques conseillent un
drainage soigné autour des structures en pneus pour assurer leur
longévité (Pangea Biotecture, 2022).
10
A. Utilisation de pneus entiers pour le
soutènement
Les pneus entiers peuvent être disposés en
quinconce ou en colonnes verticales, sans engins, et remplis de terre ou de
gravier stabilisé. Leur forme circulaire répartit bien les
charges et facilite un drainage naturel. Cette méthode est idéale
pour :
- Créer des bordures de soutènement sur des pentes
instables ;
- Limiter l'érosion latérale dans les terrains
marécageux ;
- Former des murs simples ou marches sur des zones glissantes ou
inondables.
Des études montrent que ces murs de pneus, bien
empilés, peuvent résister à des pressions latérales
significatives (HR Wallingford, 2004).
B. Empilement vertical de pneus pour remblai
stabilisé
Dans des zones saturées, les pneus sont empilables
verticalement. Remplis manuellement de sol ou de gravats, puis compactés
à la main, ils forment des colonnes absorbantes qui améliorent la
portance du sol. Cette approche :
- Renforce localement la structure du sol ;
- Favorise le drainage vertical ;
- Peut servir de base stable pour des allées
piétonnes temporaires ou des plateformes.
C. Découpe simple pour drainage ou
canalisation
À l'aide de machettes ou de lames chauffées, il
est possible de découper manuellement des pneus en bandes ou
demi-cercles. Ces pièces servent à :
- créer des rigoles de drainage longitudinal,
- stabiliser les berges de petits canaux,
- agir comme éléments souples sous des zones
végétalisées.
Ce procédé artisanal permet une
adaptabilité locale, tout en limitant le coût et la
complexité des installations.
D. Perspectives d'usage technique
Des recherches sur des murs de pneus montrent que cette
technique peut être structurée sans béton ou métal:
les pneus remplis offrent une solution de soutènement alternative peu
coûteuse, fiable et durable (Barros et al., 2019).
11
E. Synthèse des avantages
Critère
Accessibilité
Économie
Écologie
Participation
Durabilité
Avantage des techniques manuelles en pneus
Réalisables sans machine ni électricité
Pas d'achat ni location d'engins
Valorisation des déchets pneus
Mobilisation communautaire sur site
Matériau stable, résistant à
l'humidité
Tableau 5 : Principaux atouts des pneus usagés en
stabilisation manuelle
Sans recourir à des engins ou traitements industriels,
ces techniques permettent de valoriser des pneus usagés en
éléments de stabilisation manuelle. Elles offrent une solution
validée empiriquement, durable, économique et appropriante par la
communauté locale.
1.3.6. Avantages et limites techniques
Avantages
Léger et non biodégradable
Drainant et peu compressible
Disponibilité gratuite ou à bas coût
Adapté au renforcement des sols mous
Inconvénients
Inflammabilité (si exposé)
Résistance à la traction faible
Besoin de transformation (main d'oeuvre)
Recyclage difficile après usage secondaire
Figure 3 : Avantages et limites techniques d'utilisations
des pneus en GC
Les pneus usagés, en apparence inutiles, sont en
réalité une matière première secondaire
précieuse pour le génie civil. Ils possèdent des
caractéristiques mécaniques et hydrauliques utiles pour
stabiliser les sols mous ou saturés d'eau.
Dans un contexte urbain ou semi-rural tel que Londo à
Butembo, leur réutilisation permet de :
- Réduire les coûts de stabilisation, - Valoriser un
déchet abondant,
12
- Améliorer les propriétés du sol
marécageux, avec un faible impact environnemental. La section suivante
abordera les débris de béton recyclé, un autre
matériau clé dans la
stabilisation durable.
| 


