SECTION 2 : Les débris de béton
recyclé dans la stabilisation des sols
t t é é l
2.1. Contexte général
Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP)
génère à lui seul environ 70 % des déchets solides
dans le monde industrialisé (OCDE, 2022). Parmi ces déchets, les
gravats de démolition et en particulier le béton concassé
représentent une source massive de matière recyclable.
Ces débris après traitement peuvent être
valorisés comme :
- Granulats recyclés pour bétons non structurels, -
Couche de fondation routière,
- Stabilisant pour sol mou ou instable,
- Remblai technique.
Cette valorisation s'inscrit dans une logique
d'économie circulaire, en réduisant l'extraction de granulats
naturels et en limitant les dépôts sauvages.
2.2. Composition et typologie des débris de
béton
Le béton est un matériau composite,
constitué de granulats en 70 à 80 %, de pâte de ciment
hydraté, d'eau et parfois d'adjuvants.
Lorsque ce béton est démoli, ses fragments
contiennent :
Composant
Granulats (naturels)
Pâte de ciment hydratée
Pourcentage typique
60-70 %
20-30 %
Rôle dans le sol
Squelette granulaire - portance
Effet liant secondaire, stabilisation
13
|
Fines de démolition
|
5-10 %
|
Remplissage, influence
perméabilité
|
sur
|
la
|
|
Ferraillage résiduel
|
< 2 %
|
À trier lors du concassage
|
|
|
Tableau 6 Composition moyenne des débris de
béton recyclé -(adapté de Hofmann & Müller,
2018)
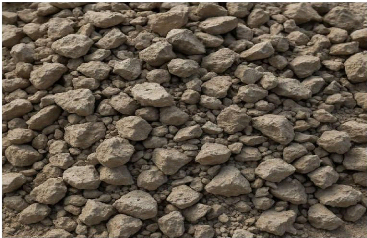
Figure 4 : Exemple de béton concassé prêt
à être utilisé 2.3. Propriétés
géotechniques du béton recyclé
Le béton recyclé est granulaire, mais
présente une texture rugueuse et une porosité plus
élevée que les granulats naturels. Ses principales
propriétés géotechniques sont :
Propriété
Densité sèche (ñd)
Porosité (n)
Angle de frottement interne (ö)
Cohésion (c)
Valeur typique
1800 à 2100 kg/m3
20 à 30 %
35 à 45°
5 à 25 kPa (si compacté)
Utilité géotechnique
Bonne compacité
Drainage et respiration du sol
Stabilité en talus
Liant partiel avec la matrice naturelle
Figure 5 : Schéma de production du béton
recyclé
14
|
|
|
|
Perméabilité (k)
|
10-4 à 10-5 m/s
|
Permet contrôlée
|
une
|
infiltration
|
|
|
|
Tableau 7 : Propriétés géotechniques
typiques du béton recyclé (Siddique & Naik, 2020;
Eurocode
7,2004)
Avec n = (1 - 1)d1
1)) x 100
? pd : densité sèche du béton
concassé
? ps : densité des grains (environ 2500 kg/m3
pour béton)
2.4. Techniques de traitement et
transformation
Avant d'être utilisé, le béton recyclé
subit plusieurs étapes de traitement :
1°) Tri des déchets de démolition
(enlèvement bois, plastiques, ferraille)
2°) Concassage primaire, puis secondaire
3°) Tamisage pour calibrer les granulométries
4°) Stockage à sec ou traitement hydraulique
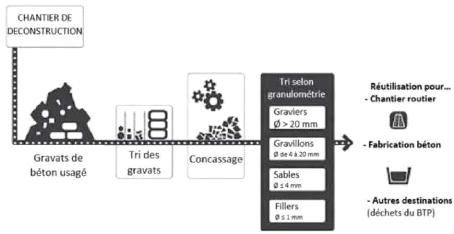
15
2.5. Avantages dans la stabilisation des sols
L'intérêt d'utiliser du béton
recyclé dans la stabilisation des sols réside dans sa
capacité à améliorer la portance, sa texture rugueuse
favorable à l'adhérence ainsi que sa perméabilité
modérée utile en sol marécageux :
- Effet drainant ? prévient l'accumulation d'eau dans les
sols ;
- Réduction du gonflement des argiles grâce
à l'alcalinité résiduelle ; - Augmentation de la portance
CBR du sol ;
Le California Bearing Ratio (CBR) d'un sol argileux peut
passer de 4 % à 15 % après stabilisation par béton
concassé (Siddique et al., 2020).
- Coût réduit (disponibilité locale en zone
urbaine).
2.6. Limites et précautions d'usage
a. Limites
? Variabilité du matériau ;
? Présence de chlorures ou sulfates ? risque chimique
pour les sols ; ? Effritement sous chargement répété s'il
n'est pas bien compacté.
b. Recommandation
Toujours combiner le béton concassé avec un
protocole de compactage normalisé (Proctor ou VBS) pour éviter
les tassements différentiels.
2.7. Cas d'application : sols hydromorphes
Dans le cas d'un sol hydromorphe comme celui de Londo à
Butembo, le béton recyclé permet de :
- Créer un matelas drainant en fond de couche ;
- Amender la texture du sol (sol fin + gravats) ;
- Limiter l'infiltration permanente vers les nappes souterraines
;
- Préparer le sol à recevoir un
végétal dans une approche de bio-ingénierie (cf.
Section
3).
L'utilisation des débris de béton recyclé
s'inscrit pleinement dans les stratégies durables du BTP. Ce
matériau, longtemps considéré comme un rebut, devient un
vecteur de stabilisation écologique et économique des sols
à faible portance. Il offre de nombreux
16
avantages structurels à condition de respecter un tri
sélectif, un concassage calibré, et une application
adaptée au contexte géotechnique.
Il constitue un complément pertinent aux
matériaux végétalisables, et sa combinaison avec les pneus
ou la bio-ingénierie (Section 4) représente une innovation
à fort potentiel.
Section 3 : Développement de la
bio-ingénierie dans la stabilisation des sols
3.1. Introduction générale à la
bio-ingénierie des sols
La bio-ingénierie des sols, également
appelée ingénierie écologique, constitue une discipline
innovante au sein du génie civil contemporain. Elle se définit
comme l'ensemble des techniques qui utilisent des matériaux vivants
(essentiellement des plantes) et leurs structures (racines, tiges, rhizomes)
souvent combinés à des éléments inertes
(géotextiles, bois, pierres, grillages), dans le but de stabiliser les
terrains, prévenir l'érosion et favoriser la
régénération des milieux dégradés (Gray
& Sotir, 1996 ; Schiechtl & Stern, 1996).
Contrairement aux techniques traditionnelles de stabilisation
comme par exemples les murs en béton armé, gabions, enrochements,
béton projeté ; la bio-ingénierie propose une alternative
plus souple, intégrée et durable. Elle présente un triple
avantage : écologique (préservation de la biodiversité,
amélioration du microclimat), économique (coût
réduit de mise en oeuvre et d'entretien) et social (acceptabilité
par les populations locales, esthétique paysagère).
Dans le contexte des sols marécageux de la cellule
Londo à Butembo, caractérisés par une forte
humidité, une portance faible et une vulnérabilité accrue
aux inondations, la bio-ingénierie représente une solution
hautement pertinente. Elle répond aux défis locaux en limitant
l'impact environnemental tout en assurant une stabilité progressive du
sol.
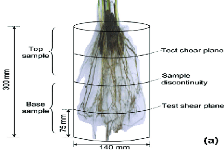
17
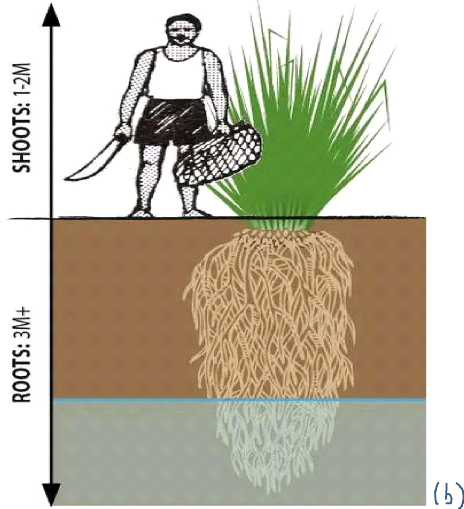
Figure 6 : (a) et (b) Illustrations des interactions entre
les plantes et le sol dans le cadre de la bio-ingénierie.
3.2. Principes techniques de la bio-ingénierie des
sols
3.2.1. Mécanismes d'action
Les plantes utilisées dans la bio-ingénierie
agissent à plusieurs niveaux :
- Action mécanique directe des racines : les
systèmes racinaires renforcent le sol par ancrage et cohésion.
Cela s'apparente à un "armement biologique" du sol.
18
- Drainage biologique : certaines espèces (comme le
vétiver ou le papyrus) favorisent l'assèchement naturel par
évapotranspiration.
- Réduction de l'érosion : la couverture
végétale atténue l'impact des gouttes de pluie,
réduit le ruissellement et stabilise la couche arable.
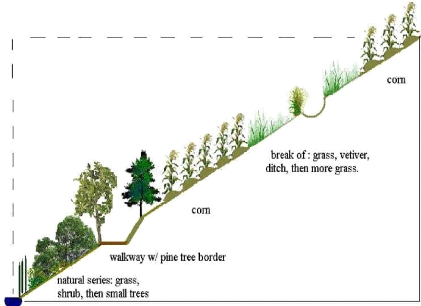
Figure 7 : Schéma des mécanismes d'action des
plantes sur la stabilisation des sols. 3.3. Avantages et
inconvénients des techniques bio-ingénieriques
Tableau 3.1 : Avantages
Avantages
Réduction des coûts de construction
Intégration environnementale
Auto-régénération du système
végétal
Commentaire
Matériaux disponibles localement (plantes, terre,
bois), peu de machinerie lourde
Conformité aux objectifs du développement
durable
Les systèmes biologiques se développent et
s'adaptent avec le temps
Pd = V
19
|
|
|
|
|
|
|
Amélioration microclimat
|
de
|
la
|
biodiversité
|
et
|
du
|
Favorise le retour de la faune et de la flore
indigène
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 8 : Avantages des techniques
bio-ingénieriques. Tableau 3.1 :
Inconvénients
Inconvénients
Délai de mise en oeuvre
Efficacité variable selon les espèces choisies
et le climat local
Nécessite un suivi et un entretien régulier
Moins adapté aux zones fortement urbanisées ou
très pentues sans renforcement
Commentaire
Nécessite un temps de croissance des
végétaux
Choix des plantes doit être adapté au site
(climat tropical, niveau de nappe)
Désherbage, replantation possible, surtout au
début
Parfois nécessite une hybridation avec des techniques
classiques
Tableau 9 : inconvénients des techniques
bio-ingénieriques
3.4. Paramètres géotechniques à
intégrer dans la conception bio-ingénierique
Pour qu'une solution bio-ingénierique soit efficace, elle
doit s'appuyer sur les paramètres géotechniques du sol. Les
formules ci-dessous permettent d'évaluer la capacité portante et
la stabilité :
a. Teneur en eau (W)
MhMS
w = x 100
MS
Avec :
· Mh = masse humide
· MS = masse
sèche
b. Densité sèche (ñd)
MS
20
Avec :
· Ms =masse sèche
· V =volume de l'échantillon
c. Porosité (n)
~~
~ = 1 -
Ps
Avec :
· ps= densité des particules solides
(généralement 2,65g/cm3 pour les sols
silteux/argileux)
d. Cohésion racinaire (Cr)
Inspirée des recherches de Wu et al. (1979) :
· Tr= résistance au cisaillement des
racines
· Ar surface racinaire
· At = surface totale
3.5. Plantes adaptées à la
bio-ingénierie en climat tropical humide
Espèce
|
|
Rôle principal
|
|
Remarques
|
|
Image
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vetiveria zizanioides
|
|
|
Drainage, stabilisation racinaire
|
|
Tolère humidité
extrême, croissance rapide
|
|
|
Pennisetum
purpureum (herbe à éléphant)
|
|
|
Protection contre
l'érosion
|
|
Haute biomasse,
couverture rapide du sol
|
|
|
Les terrains saturés et instables, comme ceux
rencontrés à Londo (Butembo), exigent des solutions
économiques, facilement applicables et respectueuses de
l'environnement.
21
Typha australis
Cyperus papyrus
Assèchement et
filtration naturelle
Fixation en terrain inondé
Utilisée dans les zones humides,
marécageuses
Forte densité racinaire, bon pour berges et zones
marécageuses

Tableau 10 : Espèces végétales
adaptées à la bio-ingénierie en climat tropical humide.
3.6. Perspectives et intégration en génie
civil
Dans les projets de génie civil en milieu humide comme
à Londo, la bio-ingénierie doit être intégrée
dès la phase de conception :
? En prémisse aux travaux classiques pour consolider le
terrain ;
? En complément des solutions techniques
conventionnelles (ex. : géotextiles, drainage contrôlé)
;
? En entretien durable post-construction (protection des
talus, régulation hydrique, prévention de l'érosion).
Section 4 : Combinaison de matériaux
recyclés avec la bio-ingénierie
4.1. Introduction générale
L'innovation dans la stabilisation des sols marécageux
passe aujourd'hui par une intégration réfléchie entre
matériaux recyclés et techniques de bio-ingénierie. Cette
approche hybride, qui associe le potentiel structurel des matériaux tels
que les pneus usagés et les débris de béton à la
fonction écologique et mécanique des plantes comme le papyrus, le
vétiver ou l'herbe à éléphant, ouvre une nouvelle
voie en génie civil durable.
22
L'assemblage manuel de pneus usagés, combiné
à la plantation de végétaux à forte capacité
de fixation et de transpiration, répond à ces exigences, tout en
valorisant des déchets souvent négligés.
4.2. Justification du choix technologique
· Les pneus usagés non broyés,
disposés manuellement en couches compactées, offrent une
structure flexible, résistante à l'humidité et à la
déformation.
· Les végétaux sélectionnés
(vétiver, papyrus, herbe à éléphant) assurent une
fixation racinaire profonde et une régulation hydrique du sol.
· L'approche manuelle permet une adaptation aux moyens
locaux, sans besoin de machinerie lourde.

Figure 8 : : Disposition des pneus en nappe
horizontale
4.3. Méthode d'assemblage
· Mise en place manuelle des pneus en nappe horizontale
· Remplissage de terre stabilisée ou débris
de béton recyclé dans chaque pneu
· Compactage avec pilon manuel
· Plantation des végétaux dans les
interstices
· Arrosage contrôlé et suivi de croissance
23

Figure 9 : : Plantation de vétiver entre les pneus
remplis de sol compacté 4.4.Principe d'interaction des
pneus non broyés et de la végétation
Les pneus usagés entiers, disposés selon une
trame de type alvéolaire, jouent un rôle de renfort par
confinement latéral et dissipation de l'énergie. Une fois remplis
de sol compacté manuellement, ils deviennent des unités
semi-rigides à haute capacité portante.
Le modèle mécanique simplifié de cette
interaction peut être exprimé par :
- Gadm : contrainte admissible augmentée (kPa)
- Nf : force de frottement latéral (kN) - Seff : surface
effective de base (m2)
4.5. Comportement mécanique global
L'interaction entre les pneus et les racines des plantes
induit une augmentation de la cohésion apparente du sol. Le
modèle simplifié d'amélioration de la résistance
est exprimé par :
Ce f f = Co + OCpneus +
OCraCines ? co:
cohésion initiale du sol
24
· Ocpneus: effet de confinement et de friction interne des
pneus
· Ocracines: contribution mécanique des racines
profondes
4.6. Tableau comparatif des composants
Élément
|
Rôle principal
|
|
|
Avantage spécifique
|
Pneus usagés Vétiver Papyrus Herbe à
éléphant
|
|
Confinement latéral Stabilisation verticale Drainage et
stabilisation Couverture et fixation
|
|
|
Réutilisation de déchets, faible coût
Racines profondes, croissance rapide Évapotranspiration
élevée
Densité racinaire élevée,
esthétique
|
|
Tableau 11 : Caractéristiques comparées des
matériaux recyclés et végétaux
intégrés. 4.7. Formulation de la capacité
portante
La capacité portante du sol amélioré peut
être modélisée avec la formule de Terzaghi modifiée
:
qu = ce!!Nc + yD!Nq + 0.5yBNy
Équation 1 Formule adaptée ici pour estimer
la portance du sol renforcé par pneus compactés
et
enracinement végétal
où :
· qu: pression admissible du sol
amélioré
· ce!!: cohésion effective
améliorée
· y: poids volumique du sol
· D!: profondeur de la base de l'élément
stabilisateur
· B: largeur de l'élément stabilisateur
· Nc, Nq, Ny: coefficients
de portance dépendant de l'angle de frottement interne du sol. Les
valeurs de Nc, Nq et Ny sont en annexe.
25
Conclusion partielle
Ce premier chapitre a permis de poser les bases
théoriques et techniques nécessaires à la
compréhension de notre démarche innovante de stabilisation des
sols marécageux. Nous avons exploré d'une manière
générale la problématique des déchets solides,
notamment les pneus usagés et les débris de béton, tout en
analysant leur potentiel de réutilisation dans une logique
d'économie circulaire.
L'approche par bio-ingénierie, ensuite
détaillée, s'est révélée
particulièrement adaptée aux environnements instables tels que
les zones humides, en raison de son caractère écologique,
économique et durable. Enfin, la combinaison entre matériaux
recyclés et techniques bio-ingénieriques ouvre la voie à
une solution novatrice, applicable dans des contextes contraignants comme celui
de la cellule Londo.
Ces fondements théoriques permettent d'aborder avec
rigueur et cohérence le chapitre suivant, qui exposera de manière
détaillée la méthodologie mise en oeuvre pour stabiliser
de manière efficace et durable le sol marécageux de notre zone
d'étude à Butembo.
26
| 


