CHAPITRE II : METHODOLOGIE DE STABILISATION DU SOL
MARECAGEUX
DE LONDO
2.1. Introduction
Dans un contexte urbain en pleine croissance comme celui de la
ville de Butembo, assurer la stabilité des sols avant toute mise en
oeuvre d'ouvrages d'infrastructure constitue un impératif pour la
sécurité des constructions et la durabilité de
l'aménagement du territoire. Le présent chapitre s'inscrit dans
le cadre d'un projet innovant de stabilisation des sols marécageux de la
cellule Londo, située au centre-ville de Butembo, en vue de rendre ce
terrain apte à recevoir ultérieurement des constructions à
grande charge, après une période d'observation et
d'évaluation.
En l'absence de laboratoire géotechnique,
l'étude s'appuie sur une démarche méthodique,
cohérente avec les fondements du génie civil. Elle combine des
observations de terrain, des essais élémentaires, des calculs
déductifs simples et des principes issus de la mécanique des
sols. L'objectif n'est pas de reproduire une campagne géotechnique
classique, mais de démontrer la faisabilité d'une stabilisation
efficace, économique et reproductible, accessible aux populations
locales.
Pour caractériser le sol, nous avons distingué
les paramètres de nature (granulométrie, argilosité, poids
volumique des grains solides) et les paramètres d'état (teneur en
eau, porosité, indice des vides, etc.), évalués à
partir de données issues de prélèvements
réalisés sur le terrain. L'approche repose sur une logique
d'observation structurée, sans laboratoire, mais sans s'éloigner
des standards de la discipline.
Ce chapitre détaille donc, section par section les
matériaux employés, la méthodologie appliquée, les
configurations proposées pour la mise en oeuvre ainsi que les
considérations pratiques et économiques pour assurer à la
fois la faisabilité, la reproductibilité et la durabilité
de cette solution dans d'autres zones similaires à Butembo.
2.2. Matériels et méthodes
Dans le cadre de cette étude expérimentale
menée sur un terrain marécageux situé au centre-ville de
Butembo, plus précisément dans la cellule de Londo, une
démarche rigoureuse et progressive a été adoptée
pour démontrer l'efficacité d'une méthode de stabilisation
innovante, fondée sur l'intégration de matériaux
recyclés et de la bio-ingénierie végétale. Cette
section présente les matériaux utilisés et les
étapes méthodiques suivies pour l'application sur
27
le site d'expérimentation, ainsi que les techniques
d'observation scientifique choisies pour en évaluer la performance.
2.2.1. Description des matériaux
mobilisés
a. Pneus usagés entiers
Le choix de pneus entiers non broyés répond
à une logique de durabilité, d'économie et de valorisation
des déchets urbains. Ces éléments,
récupérés dans les garages et ateliers mécaniques
de Butembo, sont employés comme éléments de stabilisation
mécanique du sol. Leurs parois rigides permettent de créer une
base souple mais résistante, agissant comme une plateforme drainante qui
réduit la pression verticale sur le sol saturé en eau. Ce
rôle d'amortisseur de contrainte permet d'atténuer les tassements
et de réduire la déformation du sol sous charge (Humphrey &
Sandford, 1993). En plus de leur fonction structurelle, ils assurent une
redistribution plus homogène des charges vers le sol sous-jacent.

Figure 10: Pneus usagés avant leur mise en
oeuvre
b. Sols de déblais du site
Les matériaux excavés lors de la mise à
nu du site (terre argileuse, limoneuse ou sableuse selon les zones) sont
réutilisés comme remblai entre les structures de pneus. Ils
subissent un compactage manuel au fur et à mesure de leur
dépôt afin d'assurer leur
28
densification et d'éviter toute inclusion d'air ou de
vide excessif. Ce remblai participe activement à la réduction de
la porosité du sol et améliore la portance superficielle.
c. Plantes stabilisatrices
sélectionnées
Le choix des espèces végétales s'est
porté sur des plantes locales, adaptées aux milieux humides
tropicaux, connues pour leurs racines à fort pouvoir d'ancrage et leur
action stabilisatrice :
? Papyrus (Cyperus papyrus) : adapté
aux zones inondées, il contribue à assécher partiellement
le sol par évapotranspiration et crée une structure racinaire
dense au voisinage immédiat de la surface (Muthuri et al., 1989).
? Vétiver (Chrysopogon zizanioides) :
réputé pour ses racines verticales pouvant atteindre
jusqu'à 3 mètres, il agit comme un treillis souterrain qui limite
la dispersion du sol sous contrainte (Truong & Loch, 2004).
? Herbe à éléphant (Pennisetum
purpureum) : ses rhizomes horizontaux stabilisent les couches
supérieures du sol tout en facilitant la couverture
végétale rapide, limitant l'érosion en surface.
2.2.2 Étapes méthodologiques de mise en
oeuvre
a) Première étape : reconnaissance et
nettoyage du terrain
Cette étape consiste à dégager la
surface végétale spontanée, à identifier les zones
les plus instables et à niveler le terrain selon une pente douce (1
à 2%) pour faciliter l'écoulement gravitaire des eaux de surface.
Un quadrillage du site expérimental est ensuite effectué pour
assurer un suivi rigoureux de chaque segment traité.
b) Deuxième étape : excavation
contrôlée
Une excavation sur une profondeur de 40 à 50 cm est
réalisée manuellement. Cette opération vise à
retirer la couche superficielle instable et à préparer une assise
mécanique plus homogène. La profondeur choisie permet
également d'enterrer partiellement les pneus, évitant ainsi leur
soulèvement.
29

Figure 11 : Début excavation du sol arable
c) Troisième étape : positionnement des pneus
usagés
Les pneus sont disposés horizontalement dans
l'excavation, en quinconce, de manière à couvrir toute la
surface. Chaque pneu est posé à plat et les espaces interstitiels
sont comblés avec les déblais préalablement triés
(limons ou sable compacté). Le passage répété de
dame manuelle permet de stabiliser l'ensemble.
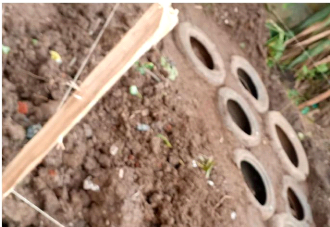
Figure 12 : Pose de la nappe des pneus
30
d) Quatrième étape : compactage et
régularisation du niveau supérieur
Une couche supplémentaire de 10 à 15 cm de
déblais est déposée au-dessus du réseau de pneus,
puis compactée avec soin. Cette couche sert d'interface de contact entre
la zone renforcée et le tapis végétal futur, assurant une
bonne continuité mécanique.
e) Cinquième étape : implantation des
espèces végétales
Les plants de vétiver, papyrus et herbe à
éléphant sont disposés selon un motif triangulaire avec un
espacement moyen de 40 cm. Ce choix permet d'assurer un recouvrement progressif
du sol tout en favorisant un développement racinaire
complémentaire. Les espèces sont arrosées de
manière régulière pour assurer leur reprise.
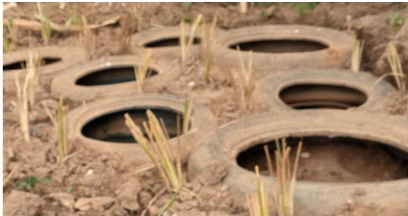
Figure 13 : Plantation des vetivers entre-pneus 2.2.3
Méthode d'observation et d'évaluation
L'évaluation de la performance de cette solution de
stabilisation ne se limite pas à une vérification visuelle. Elle
repose sur une observation scientifique rigoureuse, permettant de tirer des
conclusions fiables sur la durabilité et la pertinence de la
méthode.
1°) Surveillance du tassement
différentiel
Des piquets de repère sont implantés à
des points fixes du site. À l'aide d'un niveau à eau ou à
bulle, la hauteur de ces piquets par rapport à une
référence stable est mesurée à intervalles
réguliers (hebdomadairement puis mensuellement). Ces mesures permettent
de détecter tout affaissement progressif ou irrégulier du
terrain.
Le sol présente une teinte noirâtre
caractéristique des terrains organiques saturés. Sa texture
argileuse à plastique élevée, combinée à une
forte rétention d'humidité, témoigne de la
31
2°) Suivi de l'humidité et du comportement
hydrique du sol
Des prélèvements ponctuels sont effectués
pour mesurer la teneur en eau gravimétrique du sol. Cela permet
d'évaluer la capacité du dispositif à évacuer ou
retenir l'eau selon les saisons, et donc son efficacité contre la
saturation.
3°) Évaluation du développement
racinaire
Après plusieurs mois, des sondages manuels seront
réalisés pour vérifier la profondeur et la densité
des racines. Le degré d'ancrage des plantes est un bon indicateur de
l'amélioration de la cohésion du sol.
4°) Analyse de la résistance au
poinçonnement et à la portance
À l'aide de tests rudimentaires (enfoncement d'une tige
sous une masse donnée, observation de la résistance au pas
humain, etc.), la portance globale du sol est évaluée de
manière empirique, mais répétée pour garantir la
fiabilité.
L'ensemble de ces observations s'inscrit dans une logique
d'évaluation progressive, en tenant compte des cycles climatiques
locaux. Les données recueillies permettront de modéliser le
comportement futur du terrain face à une mise en charge réelle,
tout en anticipant les interventions nécessaires avant toute
construction d'envergure.
2.3. Méthode de calcul et principes
mécaniques retenus
L'étude présentée repose sur une
démarche rigoureuse de caractérisation du sol marécageux
de Londo en vue d'assurer sa stabilisation mécanique. Ce travail
s'appuie sur des données réelles prélevées sur une
parcelle de 3 mètres sur 4 mètres, située dans une zone
sujette à l'engorgement et à la perte de portance. La
méthode retenue vise à transformer un sol initialement impropre
à la construction en un support capable d'accueillir des ouvrages de
construction importants.
L'ensemble des paramètres géotechniques
nécessaires à l'analyse de portance ont été
calculés à partir de cinq échantillons
représentatifs du sol. Ces données constituent la base
scientifique de la stratégie de stabilisation mise en oeuvre.
2.3.1 Nature du sol et conditions de
prélèvement
Cette mesure est conforme à la norme française
NF P 94-050 (1995), et elle permet de déterminer le degré de
saturation du sol.
32
faible cohésion des grains et de la faible
capacité portante. Ces échantillons ont été
extraits sur une profondeur de 40 centimètres, conformément
à la stratigraphie présentée dans la section

Figure 14 : Prélevement d'échantillons
2.3.2 Calcul de la teneur en eau (W)
La teneur en eau est un paramètre déterminant
pour évaluer l'état d'humidité du sol et sa
stabilité mécanique. Elle se calcule par la formule suivante :
(Masse humide - Masse sèche)
W = x 100
Masse sèche
où :
- Masse humide est la masse de l'échantillon avant
séchage,
- Masse sèche est la masse de l'échantillon
après séchage à 48h, - Le résultat est
exprimé en pourcentage (%).
33
|
Échantillon
|
Masse humide (kg)
|
Masse sèche (kg)
|
Teneur en eau (%)
|
|
A
|
0,20
|
0,15
|
33,3
|
|
B
|
0,35
|
0,25
|
40,0
|
|
C
|
0,17
|
0,14
|
21,4
|
|
F
|
0,25
|
0,17
|
47,1
|
|
G
|
0,34
|
0,20
|
70,0
|
Tableau 12 : Teneur en eau des échantillons
prélevés
Les teneurs élevées (notamment G avec 70 %)
montrent une forte saturation en eau, facteur principal de l'instabilité
des sols marécageux.

Figure 15 : Pèse avant séchage
34
2.3.3. Méthode de séchage des
échantillons de sol
Dans le cadre de cette étude, le séchage des
échantillons prélevés a constitué une étape
indispensable pour la détermination de plusieurs paramètres
géotechniques fondamentaux, tels que la teneur en eau, la densité
sèche et la porosité. En l'absence de laboratoire
équipé (notamment d'une étuve conforme à la norme
NF P94-050), une méthode de séchage naturelle à l'air
libre a été adoptée, en accord avec les conditions locales
et les principes de terrain adaptés aux zones tropicales à
faibles ressources (Djebbar et al., 2017 ; ASTM, 2020).
Les échantillons, après leur pesée
à l'état humide, ont été soigneusement
étalés sur des plaques en métal ou en plastique rigide,
déposées dans une zone aérée, exposée
à la lumière solaire, mais protégée des
précipitations et de la rosée. Le site de séchage
était ventilé naturellement, ce qui a permis une
évaporation progressive de l'humidité contenue dans les pores du
sol.
Le séchage a duré 48 heures, durant lesquelles
les températures journalières à Butembo oscillaient entre
21 °C tôt le matin et 32 °C en début
d'après-midi, selon les relevés météorologiques
locaux pour la saison concernée. Ce climat tropical
modérément chaud a permis une déshydratation constante et
lente, limitant les risques d'oxydation ou de modification physico-chimique des
particules fines (Leroueil et al., 2013).
Pour homogénéiser le séchage, les
échantillons ont été retournés toutes les 8
à 10 heures, garantissant une perte d'eau uniforme dans toute la masse.
Une attention particulière a été portée à la
régularité de l'exposition solaire et au bon drainage de
l'humidité résiduelle.
Bien que cette méthode ne remplace pas le
séchage normatif à 105 °C pendant 24 heures en étuve
(ASTM D2216-19), elle est suffisante pour les calculs d'ordres de grandeur sur
le terrain, et particulièrement adaptée aux contextes où
les équipements standards sont absents. Cette démarche s'inscrit
dans une logique d'ingénierie appropriée, valorisant les
savoir-faire locaux tout en maintenant une rigueur méthodologique
acceptable (Ngonaba et al., 2021).
Elle illustre ainsi la possibilité d'adapter les
standards scientifiques aux conditions de terrain, sans compromettre la
qualité des résultats nécessaires à la conception
et à l'interprétation géotechnique.
Figure 17 : Pèse après séchage pour
avoir la masse sèche
35

Figure 16 : Séchage à 48h
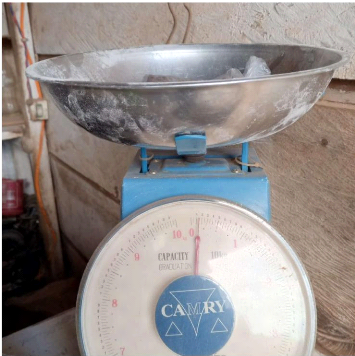
36
2.3.3 Calcul de la densité sèche
(ñd)
La densité sèche exprime la compacité du
sol une fois l'eau évaporée. Elle est déterminée
par :
|
?d =
|
Masse sèche
|
|
Volume de l'échantillon
|
Le volume moyen estimé pour chaque échantillon
est de 0,0002 m3. Ce calcul permet d'identifier les vides entre
particules solides et leur influence sur la portance du sol.
|
Échantillon
|
Masse sèche (kg)
|
Volume (m3)
|
Densité sèche
(kg/m3)
|
|
A
|
0,15
|
0,0002
|
750
|
|
B
|
0,25
|
0,0002
|
1250
|
|
C
|
0,14
|
0,0002
|
700
|
|
F
|
0,17
|
0,0002
|
850
|
|
G
|
0,20
|
0,0002
|
1000
|
Tableau 13 : Densité sèche des
échantillons
Ces valeurs indiquent une faible compacité initiale, ce
qui est caractéristique des terrains instables.
2.3.4 Calcul du poids volumique humide
(ãh)
Le poids volumique humide permet de déterminer la masse du
sol total (eau + solide) par unité de volume, ce qui est essentiel pour
le dimensionnement d'un renforcement.
Masse humide
Tableau 15 : Porosité des échantillons
37
|
Échantillon
|
Masse humide (kg)
|
Volume (m3)
|
Poids volumique humide (kg/m3)
|
|
A
|
0,20
|
0,0002
|
1000
|
|
B
|
0,35
|
0,0002
|
1750
|
|
C
|
0,17
|
0,0002
|
850
|
|
F
|
0,25
|
0,0002
|
1250
|
|
G
|
0,34
|
0,0002
|
1700
|
Tableau 14 : Poids volumique humide 2.3.5 Calcul
de la porosité (n)
La porosité indique le pourcentage de vide dans le sol.
Elle est donnée par :
J? (1 - Pd ' x 100
Ps
Où ñs est la densité des particules
solides, généralement 2650 kg/m3 pour les sols
argileux (FAO, 2010).
Échantillon
A
B
C
F
G
Densité sèche
(kg/m3)
750
1250
700
850
1000
Porosité (%)
71,7
52,8
73,6
67,9
62,3
38
Les porosités élevées confirment
l'instabilité du sol et justifient la nécessité d'une
stabilisation durable.
2.3.6 Évaluation mécanique et principes de
stabilisation
Les données analysées confirment que le sol de
Londo est :
- Très humide (forte teneur en eau),
- Faiblement dense, - Hautement poreux,
- Instable en l'état naturel.
Pour stabiliser mécaniquement ce sol, un matelas de
pneus usagés sans pièces métalliques a été
mis en place. Cette structure absorbe les charges verticales, améliore
la répartition des efforts, réduit les tassements
différentiels et offre un bon comportement sous fondation.
La stratégie est complétée par
l'utilisation de végétaux tropicaux à racines profondes
(vétiver, papyrus, herbe à éléphant), introduits
sur une couche supérieure et entre les joints des pneus. Cette
combinaison assure une double stabilisation : mécanique et
bio-végétale.
2.5. Application opérationnelle du Vétiver
dans la stratégie de stabilisation
L'intervention dans la cellule Londo a été
guidée par la nécessité de mobiliser une solution
végétale efficace, résiliente et adaptée au
contexte marécageux. Sur base de ces critères, le vétiver
(Chrysopogon zizanioides) a été sélectionné pour
son comportement exceptionnel en conditions hydromorphes et sa
compatibilité avec une mise en oeuvre manuelle intégrée
à des matériaux recyclés.
a) Positionnement stratégique dans le dispositif
de renforcement
Le vétiver a été introduit non comme
couverture végétale accessoire, mais comme élément
porteur du système de renforcement. Chaque pied a été
inséré entre deux pneus, dans une tranchée
aménagée à cet effet, de manière à permettre
:
- Un enracinement vertical dans le sol naturel compacté
;
- Une interaction latérale avec les parois internes du
pneu, créant un système mixte sol-racine-pneu.
39
- Ce positionnement a permis de tirer profit de l'effet de
tenaille biologique, où le confinement offert par le pneu favorise un
enracinement profond et structurant.
b) Comportement biologique observé
La capacité du vétiver à survivre
à une humidité constante a été validée sur
terrain. Contrairement à d'autres espèces, le vétiver n'a
montré aucun signe de stress hydrique ou de pourriture racinaire tout au
long de notre expérimentation. Son port dressé permet
également de maintenir une bonne aération du substrat sans
nécessité d'entretien particulier.
c) Fonctionnement mécanique
intégré
Sur le plan mécanique, le système peut
être comparé à un renforcement par inclusion fibreuse
verticale. Le rôle du vétiver peut être
schématisé dans une logique d'amélioration de la
cohésion du sol :
Ceff = Csol + CraCine
Où :
· csol : est la cohésion
initiale du sol naturel (très faible dans le cas d'un
marécage),
· racine : Représente
l'apport en cohésion induit par le développement racinaire
vertical.
Des études antérieures (Lindley & Palmer,
2000) estiment que cette cohésion additionnelle peut varier de 5
à 25 kPa, selon la densité racinaire, ce qui dans notre cas est
considéré comme un gain significatif au vu de la fragilité
initiale du sol.
d) Intérêt en contexte
expérimental
En l'absence de moyens mécanisés, le
vétiver s'est également distingué par :
- Sa capacité à s'implanter rapidement sans
fertilisation externe ; - Sa compatibilité avec un compactage manuel
;
- Sa fonction de balisage visuel et organisation du chantier.
40
f) Encadré technique - Résumé des
effets du vétiver intégrés dans la solution
hybride
Effet stabilisateur
Ancrage vertical
Régulation hydrique
Anti-érosion
Renforcement latéral
Mécanisme en jeu
Racines jusqu'à 3 m
Transpiration + évaporation
(évapotranspiration)
Rigidité du feuillage
Interaction racines-pneus
Impact attendu
Augmentation de la cohésion (?c)
Réduction de la saturation du sol
Réduction des cisaillements
en surface
Résistance au glissement
Tableau 16 : Synthèse des effets
mécano-biologiques du vétiver dans le système hybride.
2.6. Analyse technique et comportement réel du
système pneus-vétiver à Londo
Ce point du chapitre vise à interpréter de
manière scientifique le comportement réel observé sur le
terrain suite à la mise en place de la technique hybride. Il ne s'agit
plus ici de décrire les étapes méthodologiques, mais d'en
tirer les enseignements techniques, à travers une lecture
ingénierique des données empiriques, sans recourir à des
équipements lourds, mais en exploitant l'analyse qualitative,
l'observation structurée et les logiques mécaniques connues.
2.6.1. Comportement du sol confiné par les
pneus
Le système a montré un comportement
modifié du sol après confinement. Le remplissage et compactage
manuel ont permis de créer des unités de sol compact
homogène. L'effet principal observé est une augmentation de la
cohésion apparente du sol initialement organique. Ce
phénomène s'explique par la création d'un environnement
fermé dans chaque pneu, limitant l'infiltration latérale de l'eau
et empêchant le soulèvement des fines par saturation.
41
2.6.2. Action des racines de vétiver sur la
stabilité
Le vétiver, utilisé pour notre site
d'étude, a montré une remarquable résistance à
l'humidité et une capacité à former un réseau
radiculaire dense dès les premières semaines. Son système
racinaire, descendant jusqu'à 3 mètres dans des conditions
favorables (Gray & Sotir, 1996), agit comme des armatures naturelles
empêchant l'érosion superficielle et renforçant les zones
interstitiaires entre les pneus.
Les racines ont été observées
pénétrant les joints latéraux, ce qui verrouille
l'ensemble du dispositif. Cet effet n'a pas besoin de mesures
instrumentées pour être validé : la cohésion obtenue
est visible à l'oeil nu.
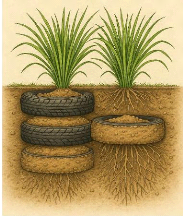
Figure 18 : Croissance du vétiver à 3 mois,
montrant l'enracinement entre les pneus 2.6.3. Lecture du
système comme mur de soutènement
végétalisé
L'ensemble pneus-remblai-plantes se comporte de façon
analogue à un mur poids avec un revêtement
végétalisé. Le système résiste au fluage
grâce :
- À la masse des pneus et leur effet de calage ; -
À la résistance interne du sol compacté ; - À la
traction racinaire.
On peut comparer cela à la formule du mur poids :
Rtotal = Wpneu s + 0" sol + Rracine ?
Wpneus: poids sec des pneus remplis ;
42
? a01: résistance au
cisaillement du sol ;
? Rracine: résistance
radiculaire mesurable par l'effet anti-érosion.
Cette modélisation simplifiée justifie la
capacité du système à résister aux sollicitations
latérales, sans recourir à une structure
maçonnée.
| 


