|
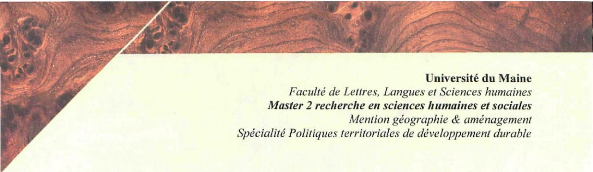
Universite du Maine
Faculte de Lettres,
Langues et Sciences humaines
Master 2 recherche en sciences humaines et
sociales
Mention geographie & amenagement
Specialiti Politiques
territoriales de developpement durable
Regards sur la traduction juridique
du developpement durable

L'exemple du marche public de
restauration scolaire de Strasbourg
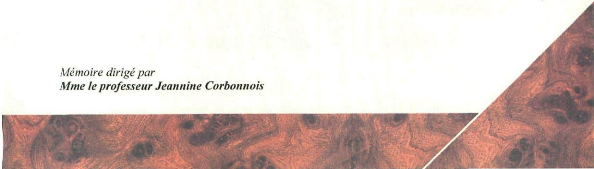
Itlemoire dirige par
Mme le professeur Jeannine Corbonnois
Cyrille Emery
Les opinions exprimées dans ce mémoire sont
propres à leur auteur
et n'engagent pas l'Université du
Maine.
Université du Maine
Faculté de lettres, langues et sciences
humaines
Master 2 recherche en sciences humaines et sociales
Mention géographie &
aménagement
Spécialité politiques territoriales de
développement durable
Regards sur la traduction juridique
du développement durable
L'exemple du marché public de
restauration scolaire de Strasbourg
Cyrille Emery
2010
Mémoire dirigé par
Mme le professeur Jeannine
Corbonnois
ABREVIATIONS
AJDA Actualité juridique du droit
administratif
Bull. Bulletin (civil ou criminel de la Cour de
cassation)
CA Cour d'appel
CAA Cour administrative d'appel
Cass. Cour de cassation
Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation
Civ. Chambre civile de la Cour de cassation
Cons. cone. Conseil de la concurrence
(Autorité de la concurrence)
CE Conseil d'État
CE Ass. Assemblée du contentieux du Conseil
d'État
CE Sect. Section du Conseil d'État
CEE Communauté économique
européenne
Chr. Chronique
CJCE / CJUE Cour de justice des Communautés
européennes / Cour de justice de l'Union européenne
Concl. Conclusions
D. Recueil Dalloz
D. Aff. Recueil Dalloz Affaires
Dr. adm. Revue Droit administratif
GAJA Grands arrêts de la jurisprudence
administrative
Gaz. Pal. Gazette du Palais
JO Journal officiel de la République francaise
JOCE / JOUE Journal officiel des Communautés
européennes / Journal officiel de l'Union européenne
JOAN Journal officiel de l'Assemblée nationale
Obs. Observations
Rec. Recueil
RDP Revue de droit public
RFDA Revue francaise de droit administratif
Sect. Section
TA Tribunal administratif
TC Tribunal des conflits
TCE Traité instituant la Communauté
européenne (Traité de Rome)
SOMMAIRE
Sommaire détaillé en fin de document.
I. La difficile traduction juridique du developpement
durable............................................ 6
A. Developpement durable : des definitions
multiples....................................................................10
Une definition
po/ysemique............................................................................................................................11
Les trois pi/iers du deve/oppement
durab/e............................................................................................12
La soutenabi/ite forte et /a soutenabi/ite
faib/e......................................................................................13
Une notion diffici/e a traduire
juridiquement.........................................................................................15
B. Enjeux et debats
.......................................................................................................................................16
Un constat qui ne fait pas /'unanimite
........................................................................................................16
Une experience ma/heureuse : /e droit du
deve/oppement...............................................................19
Faut-i/ poser /a question autrement
7.........................................................................................................20
C. La bonne echelle spatiale : l'echelle territoriale
...........................................................................31
L'Etat n'est sans doute pas /a bonne
eche//e............................................................................................31
Un substitut : /a gouvernance
territoria/e.................................................................................................38
II. La traduction juridique du developpement durable a l'echelle
territoriale ............40
A. L'exemple du locavorisme
....................................................................................................................41
La preference /oca/e : une mode promise a un be/ avenir
.................................................................43
La preference /oca/e : une mode interdite par /e
droit........................................................................47
Deve/oppement durab/e et
/ocavorisme....................................................................................................51
L'interdiction imp/icite du x de/oca/isme »
..............................................................................................52
B. Le marche public de restauration scolaire de
Strasbourg.........................................................54
Adoption d'un P/an c/imat
territoria/..........................................................................................................54
Les caracteristiques du
marche.....................................................................................................................56
Les enseignements du marche
strasbourgeois.......................................................................................65
Conclusion............................................................................................................................................67
I. La difficile traduction juridique du
développement durable
Ç Depuis le début de l'humanité, on sait
qu'il faut adapter des règles générales aux cas
particuliers : c'est ce que font quotidiennement les gouvernements des
États. Il y a une interdépendance entre tous les niveaux de
l'espace È1 (i-P. Paulet).
A l'issue du sommet de Copenhague, les États ont
démontré leur relative incapacité à s'accorder sur
des objectifs contraignants. S'ils acceptent volontiers de reconna»tre
l'urgence qui s'attache à de nouvelles formes de développement
économes en carbone et en ressources naturelles, ils peinent à
traduire ce constat en objectifs. Et à transformer ces objectifs en une
production normative, c'est-à-dire en droit.
Pour ce qui concerne la France, les 257 articles de la loi
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement2 (Grenelle II) constituent néanmoins un
engagement substantiel et cohérent en faveur de la traduction juridique
des objectifs de développement durable.
L'article 254 de la loi souligne ainsi, qu'Ç en
référence à ses engagements internationaux et nationaux en
matière de territoires et de villes durables, l'État encourage
les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21
locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs
groupements È. Ë cette fin, l'État pourra conclure en vertu
de la loi, des conventions territoriales particulières pour fixer des
modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier de ces
projets.
Le projet de recherche ici présenté porte sur la
traduction des objectifs du développement durable dans les textes
normatifs, de l'échelon international à l'échelon
territorial. Il part d'un constat que personne (ou presque) ne conteste. Depuis
cinquante ans, l'humanité est entrée dans une phase sans
précédent de son histoire :
Ç En 2007, pour la première fois,
l'espèce humaine est devenue majoritairement urbaine. La population
mondiale s'accro»t de 70 millions d'individus par an. La survie de plus de
la moitié de la population mondiale est menacée par la hausse du
niveau marin. 1,2 milliard d'individus sont touchés par les risques de
désertification. 1 milliard
1 Paulet (J.-P.), Géographie urbaine, Paris,
éditions Armand-Colin, 2009, p. 112.
2 JO 13 juillet 2010 ; Le Moniteur des travaux publics et du
b%otiment, 23 juillet 2010, cahier détaché n2.
d'individus n'ont pas accès à une eau saine. 930
millions de personnes vivent dans des bidonvilles. Depuis 1960, l'empreinte
écologique de l'homme a triplé ; l'utilisation des pesticides a
été multipliée par 4 ; la banquise a fondu à 40 %.
50 % des espèces vivant sur Terre pourraient avoir disparu d'ici 2100
>>3.
A ce rythme, la plupart des experts affirment que le
développement économique actuel n'est plus soutenable ; et qu'il
nous conduit tout droit à l'ab»me. Depuis plus de quarante ans, des
universitaires, des politiques, des chercheurs de tous horizons, se mobilisent
pour alerter l'opinion mondiale.
En 1968, les fondateurs du Club de Rome ont demandé
à des chercheurs du Massassuchetts Institute of Technology (MIT), et
notamment au professeur Dennis Meadows et à son épouse Donnella,
de rédiger un rapport sur les limites de la croissance. En 1972, ce
rapport intitulé Ç Limits to Growth >> dresse un constat
sombre pour l'avenir de l'humanité. De cette analyse, conduite à
partir d'un modèle mathématique, il résulte que si les
hommes ne modifient pas sensiblement leurs modes de vie, si la croissance
démographique se poursuit et si les ressources non renouvelables sont
pillées à un rythme aussi effréné,
l'humanité court inévitablement à sa perte.
La réputation des rédacteurs du rapport, celle
des membres éminents du Club de Rome et la date de la publication du
rapport - un an avant le premier choc pétrolier - firent de ce document
un best-seller mondial vendu à quinze millions d'exemplaires.
Les chocs pétroliers et la crise des ressources
naturelles et des matières premières semblent pour le moment
avoir donné raison aux auteurs du rapport. Le professeur Dennis Meadows
a actualisé en 2004 les conclusions initiales auxquelles il était
parvenu. Celles-ci demeurent identiques, voire plus alarmistes qu'elles ne
l'étaient à l'origine.
Parallèlement, la stabilité du monde,
consécutive aux accords de Yalta et à la guerre froide, a
volé en éclat avec l'effondrement du mur de Berlin. La
disparition de l'empire soviétique a laissé face à face
des pays occidentaux, riches mais éprouvés par plusieurs chocs
pétroliers, et une recherche incessante des matières
premières, les pays de l'ExUrss, ruinés par cinquante ans de
Ç communisme >>, et des pays en développement ou
émergents dont le destin est, à ce jour encore, incertain.
3 Citoyens de la Terre, Palais de l'Élysée, 2
février 2007.
C'est à cette période qu'appara»t la notion
de développement durable (qui était déjà
utilisée dans le rapport << Meadows È) : à la fois
comme une réponse à la question environnementale (y compris celle
de la ma»trise des ressources), et comme une réponse à la
question du déséquilibre entre nations riches et pays pauvres.
Créée en 1983 au sein des Nations Unies, la
Commission mondiale pour l'environnement et le développement (CMED) a
rendu un rapport présenté par Mme Gro Harlem Bruntland en 1987.
Ce rapport, dénommé << Notre avenir à tous È,
eut un retentissement planétaire, et on lui doit d'avoir
popularisé la notion de développement durable.
Aujourd'hui, tous les pays, toutes les entités
publiques régionales ou locales, réfléchissent et
préparent l'avenir de l'homme sur la Terre. Mais si la prise de
conscience est réelle, elle est encore récente. Et les solutions
contestées.
Ë ce stade, on se demande si le développement
durable va rester à l'état de projet utopique, ou bien s'il va
finir par prendre corps dans nos sociétés. De ce point de vue, le
niveau d'intégration (ou la mesure de l'intégration) du
développement durable dans notre droit international, national puis
local (par voie contractuelle ou unilatérale), peut être
révélatrice de la volonté des pouvoirs publics d'en faire
le paradigme de leurs politiques publiques.
Jusqu'à ce jour, le développement durable
n'était pas vraiment apparu comme un élément obligatoire
pour la mise en Ïuvre des politiques publiques, notamment au niveau
territorial. Jusque là en effet, seul le code des marchés
publics, depuis l'entrée en vigueur du décret du 1er aoüt
2006, imposait explicitement aux collectivités publiques de prendre en
compte les objectifs du développement durable dans leurs
décisions d'achat (article 5). Mais ce code ne donnait aucune
définition du développement durable.
Des ministères ont été
créés, des constats établis, des << Grenelle
È organisés, des engagements pris. Mais si ces engagements ne se
transforment pas en une production normative, c'est-à-dire en un corpus
d'obligations (ou de responsabilités) assorties de sanctions, alors les
déclarations, les discours ou les accords ne serviront à rien.
C'est à ce constat désabusé que la loi du
12 juillet 2010 (Grenelle II) apporte partiellement une réponse.
Complétant le code de l'environnement, elle vient ajouter à
l'article L. 110-1 dudit code un III et IV libellés de la manière
suivante :
Ç III. L'objectif de développement durable, tel
qu'indiqué au II, répond, de facon concomitante et
cohérente, à cinq finalités :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et les générations ; 4°
L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° Une dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation responsables.
IV. L'Agenda 21 est un projet territorial de
développement durable. È
Les dispositions contenues à l'article 253 de la loi du
12 juillet 2010 contiennent ainsi des affirmations qu'on ne saurait contredire
et qui ne peuvent que rallier la majorité des suffrages. Si leur valeur
est incontestable, leur portée est néanmoins
particulièrement faible. On ne voit pas comment il sera possible de
sanctionner le non respect d'objectifs de développement durable,
traduits par cinq finalités dont le contenu est aussi
généreux qu'impossible à appréhender en
droit4.
Comme l'explique le professeur Jacques Chevalier, Ç la
norme juridique est à la fois le produit de rapports de force politiques
et un instrument privilégié d'objectivation de l'ordre politique
et de régulation des comportements politiques È (J. Chevalier,
Paris, CURAPP, 1993, p. 5). Ë ce stade, on voit bien que la loi
révèle le consensus produit par les deux Ç Grenelle
È successifs et qu'elle opère en effet une objectivation de
l'ordre politique autour de priorités nationales. On ne voit pas comment
appliquer ces dispositions juridiquement.
4 On pourrait naturellement soulever dans un litige l'absence
d'Agenda 21 au niveau territorial. Mais l'Agenda 21 n'est pas rendu obligatoire
par ces dispositions. Et aucune sanction n'est prévue en cas d'absence
de ce document.
Pierre Lascoumes ajoute qu'une analyse de l'action publique
dans laquelle le droit prend toute sa place s'impose dans le domaine du droit
de l'environnement, oü il est démontré que la loi ne saurait
être réduite à un impératif et à son
application, qu'une << politique ne peut ainsi être
résumée à un ensemble de commandements et que les
activités d'interprétation et de mobilisation par les
différentes catégories d'acteurs sociaux sont
déterminantes dans la réalisation des objectifs
>>5. Mais justement, oü est cet << ensemble de
commandements >> qui caractérise le droit ?
Le professeur Jacques Commaille explique, pour sa part, que
<< le jeu des règles de droit ou avec elles lors des mises en
Ïuvre des politiques peut faire également l'objet d'approches
croisées, de même que l'évaluation des politiques publiques
est susceptible d'appara»tre indissociable d'une évaluation
législative, la recherche de l'efficacité du droit étant
liée à celle de l'efficacité des politiques
concernées >>6. L'idée que le droit est la
traduction d'objectifs politiques et que leur évaluation permet à
son tour de modifier le droit est incontestable. Encore faut-il que l'on ait
une définition de ce que pourrait être le développement
durable. Car, ce qui est remarquable, c'est que la loi en France utilise les
termes de développement durable, mais elle se garde de les
définir.
| 


