PARTIE 1 - HISTOIRE ET MYTHES, PETIT RETOUR EN
ARRIERE
« Le caractère le plus profond du mythe, c'est
le pouvoir qu'il prend sur nous, généralement à notre
insu. »
Denis de Rougemont
Avant d'avoir le visage qu'il a aujourd'hui, le
phénomène techno a du naître, évoluer, être
influencé, migrer et subir la répression. Plus qu'un simple
historique, il est nécessaire d'entrevoir ses influences, ses acteurs et
ses déboires afin de comprendre ce qu'il est devenu.
De plus, ce mouvement musical, comme beaucoup d'ailleurs, est
ancré dans son temps. En effet, « les formes sous lesquelles elles
s'assemblent (les styles de musiques) sont attachées à des
époques, à des moments de l'histoire. » (Racine, 2004).
Ainsi, comme le jazz ou le rock à leur époque, la techno est un
indicateur des orientations idéologiques des jeunes (et des moins
jeunes) qu'elle conquiert. Il s'agira donc ici de montrer en quoi son ascension
en dit long sur les peurs et les espérances d'une
génération.
Il faut aussi noter que, comme beaucoup de
phénomènes culturels, la techno apporte avec elle ses mythes. Un
mythe, un récit qui se veut fondateur et explicatif d'une pratique
sociale, est généralement basé sur des faits ayant
réellement existé, mais leur apporte bien souvent une embellie
notoire. En ce qui concerne la scène française, il s'agira donc
de montrer l'importance du Sound System* de la Spiral Tribe dans la naissance
du mouvement et les influences du mythe qu'elle véhicule.
I- La naissance du virus house
La musique techno prend ses origines dans la house
noire américaine des clubs de Detroit et Chicago. Au début des
années 80, elle se joue encore dans des clubs fermés,
réservés le plus souvent aux habitués. Ce qui n'est alors
encore que de la house-techno sera transporté jusqu'à
Ibiza par quelques DJ et deviendra ce qui est alors appelé à
l'époque le balearic-beat*. Ses basses
répétitives et ses ondes hypnotiques jouées par des DJs
espagnols résonnent sur toute l'île jusqu'au petit matin. Lorsque
les clubs ferment, on continue sur la plage. Des touristes anglais,
lassés par la trop forte popularité de San Antonio, affluent
à Ibiza pour y trouver « the jouissance of Amnesia, where nobody is
but everybody belongs » (Redhead, 1993). Déjà, ils
trouvent dans la danse qui accompagne cette nouvelle vibration
une absence du « gaze » sur les corps.
A la fin de l'été 1987, quelques DJs
britanniques importent le balearic-beat dans les clubs anglais ; les
touristes reviennent au pays avec un nouveau style et une nouvelle drogue,
l'ecstasy*. Très vite, le virus de la house est transmis dans
les villes du Nord de l'Angleterre, notamment Liverpool et Manchester où
le club de l'Hacienda devient l'étendard de cette nouvelle vague. C'est
l'obligation de fermeture des clubs à deux heures du matin qui pousse la
jeunesse à organiser des « wharehouse parties »
(littéralement des « soirées entrepôt »), sortes
d'afters privés mis en place à la fermeture des boîtes de
nuit et diffusant de la musique house. Peu à peu, ces
soirées sont organisées indépendamment des sorties de
clubs dans des hangars désaffectés ou des champs. Une nouvelle
esthétique est née. La house devient
l'acidhouse*. Les jeunes fans adoptent le smiley jaune
(sourire béat aux yeux ronds) sur leurs T-shirts en guise de
référence aux années psychédéliques. On est
en 1989.
De son côté, la presse anglaise fustige ce nouvel
élan. Dès ses débuts, ils associent l'acid-house
au LSD - aussi appelé Acid - et à sa cousine proche inscrite au
tableau des stupéfiants en 1985 que les touristes d'Ibiza avaient
ramenée dans leur poches, l'ecstasy. Les tabloïdes titrent sur
« L'horreur de l'acid-house », « Des orgies de sexes et de
drogues » et lancent un appel : « Interdisez ces chansons du diable !
» (Kyrou, 2002). La panique morale est née autour de cette musique
supposée favoriser la consommation de drogue chez les jeunes. A ce
moment là, les wharehouse parties ne sont pas encore des
rave-parties, il faudra pour cela que la répression s'en
mêle. Mais l'on voit déjà apparaître la polarisation
de l'univers techno entre une frange qui reste dans les carcans de la vie
nocturne tolérée et une frange qui se marginalise pour pouvoir
continuer la fête.
II- Festivals et répression britanniques
Influences new age travellers et punks
Parallèlement à cette migration de la vague
house au Royaume-Uni, les grands concerts gratuits (« free
festivals ») se développent dès le début des
années 80. Y affluent ceux que l'on appelle les new age
travellers. Ces voyageurs anglais ont suivi la voie ouverte par les
hippies quelques décennies plus tôt. Depuis la fin des
années 70, les travellers ont choisi une vie d'itinérance en bus
ou en caravane. Ils voyagent de festivals en festivals par convois de
véhicules qui leur servent de maison
consommation et le matérialisme sont rejetés en
bloc.
police les traque et essaie de stopper les convois et les
festivals.
Le festival du solstice d'été à Stonehenge
est
plus tard des hippies, le lieu de convergence annuelle des
festival, en juin 1984, ils sont quelques 50
2003). C'est à la suite de ce rassemblement d'une ampleur
encore jamais vue que
police renforcent leurs raids dans les groupes de 1985 que la
plus forte vague de répression touche les resté dans les
mémoires tant il a été violent. C'est la b
Act est voté en 1986 sous l'impulsion du
Gouvernement Thatcher. Il incorpore un paragraphe réglementant les
convois de masse.
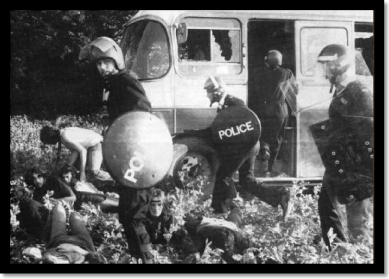
1er juin 1985. Brutalités policières à la
bataille de Beanfield.
L'explosion de la scène punk londonienne a
également joué un rôle imp cette histoire. Ces
crusties (littéralement «
tabula rasa musicale afin d'avoir la plus grande
liberté de création possible. Ils squattent les immeubles
abandonnés et appellent à l'autogestion
Mais cette autogestion et la multiplication des espaces
occupés sans droits ni titres amènent le Premier Ministre
Margaret Thatcher à faire voter le Housing Act (Acte sur
l'habitat) en 1988 (Spault, 2008). Ce texte propulse les punks à la rue
et sur les routes, où ils finiront par rencontrer les new age
travellers. Les punks viennent finalement grossir les rangs des amateurs
du festival de Stonehenge.
Naissance des premiers Sound Systems et rave-parties
C'est lorsque les premiers Sound Systems
itinérants naissent que la techno rencontre le magma des new age
travellers et des crusties dans les grands festivals anglais. Un
Sound System (littéralement « système de son ») est
à l'origine l'ensemble du matériel nécessaire à
l'émission de musique électronique en plein air (tables de
mixage, enceintes, groupe électrogène...). Par extension, c'est
aussi le nom donné au groupe de musiciens qui posent du son (jouent de
la musique) grâce à ce matériel. Les premiers Sound Systems
sont nés en Jamaïque avec la musique dub*. L'idée
est arrivée en Angleterre par la voie de l'immigration. Comme on l'a vu,
l'interdiction d'ouverture des clubs après deux heures du matin, mais
aussi la censure de toute musique électronique sur les ondes
britanniques à la fin des années 80 par le gouvernement Thatcher
(Mousty, 2003) renforcent le phénomène des wharehouse
parties.
Les premières fêtes techno, les
rave-parties s'organisent dès octobre 1990, notamment sous
l'impulsion des Spiral Tribe. C'est aux alentours de Londres que ce
Sound-System s'est constitué. Les premiers mois après sa
formation, la « Spi » se fait une place dans les soirées
underground* londoniennes, jusqu'à prendre la route en juin
1991. Elle devient alors l'un des principaux acteurs de la scène
rave anglaise de l'époque et jouera un rôle important
dans l'arrivée du mouvement en France. Les membres du groupe propulsent
l'esthétique techno plutôt joyeuse jusqu'alors dans un versant
plus sombre. Ils sont underground : ils rejettent la musique
mainstream*. Ils sont hardcore*, leur « musique se veut
bruit : on s'approprie les pollutions sonores que la société
rejette, et on les revendique en ce qu'elles ont de plus insupportable comme
pour construire une frontière implicite. » (Kyrou, 2002). Comme les
punks, ils prônent un modèle d'autogestion ; comme les new age
travellers, ils vivent dans leur camion et vont de fêtes en
fêtes. Leur seule revendication : « The right to party !
» (Le droit de faire la fête).
Diversité des événements techno
Plusieurs types d'événements techno existent
alors à l'époque. La principale césure réside dans
la légalité ou l'illégalité des soirées
organisées. Les free-parties sont clairement dans le versant de
l'illégalité. Elles ont été la réponse
à la répression menée par le gouvernement. Le mot
free fait ici référence à la liberté
d'accès de ces fêtes, de par leur prix libre et l'absence de
service d'ordre à l'entrée. Leur illégalité les
entraîne dans des endroits reculés, où les forces de
l'ordre ne pourront pas les trouver à temps. Pour s'y rendre, les
raveurs ont recours à des techniques d'éviction de celles-ci.
« Petit à petit, l'odeur du gasoil utilisé pour les groupes
électrogènes, va remplacer celles des cotillons foulés. Le
cadre va se faire plus rude, plus radical par manque de moyens, et ces
fêtes vont attirer de plus en plus de monde [...]. » (Mousty,
2003).
De l'autre côté, on trouve les fêtes
légales, qu'elles soient soirées en clubs ou rave parties. Pour
ce qui est des clubs, ils respectent la fermeture légale à deux
heures du matin, et pratiquent des politiques de sélection à
l'entrée très peu appréciées des partisans de
free-parties. Le clubbing, pratique festive incorporée à
l'imaginaire bien pensant anglais, est à l'opposé des raves
hardcore qui se construisent bel et bien dans cette opposition. En ce qui
concerne les rave-parties, ce sont des soirées organisées sur le
mode free-party mais accédant aux exigences de la légalité
: demandes d'autorisations, mise en place d'un service d'ordre...
Criminal Justice Act et migration
En mai 1992, les autorités britanniques empêchent
les convois de se rendre sur le lieu où la fête d'Avon est
généralement célébrée. Le convoi change de
route et s'établit à Castlemorton (Worcestershire). Face à
50 000 ravers, une dizaine de Sound System ont posé du son,
dont la Spiral Tribe qui sera poursuivie en justice pour « troubles
à l'ordre public avec préméditation » à l'issu
de ce festival. La multiplication des raves dans les campagnes britanniques et
les débordements du festival de Castlemorton en 1992 encouragent le
gouvernement à prendre des dispositions spécifiques. Le
Criminal Justice Act est voté en 1994. Il est notamment
composé d'une clause spécifique concernant les manifestations
techno et les travellers. Les raves sont alors définies comme
« un rassemblement en plein air de cent personnes ou plus
(autorisées ou non à occuper les lieux) dans lequel une musique
amplifiée est jouée durant toute la nuit (avec ou sans
permission) ». La loi interdit ces réunions sous l'emblème
d'une musique « aux rythmes répétitifs » et permet aux
autorités la saisie immédiate du matériel sonore en cas
d'infraction.
En 1992, après que la Spiral Tribe soit sortie
innocente du procès attenté à son encontre, ses membres
organisent une fête en plein coeur de Londres pour le solstice
d'été, le site de Stonehenge étant totalement
encerclé par les forces de police. C'est sur les anciens docks de Canary
Wharf, sur l'Isle of Dog qu'ils frappent une dernière fois avant de
quitter le lendemain matin le sol anglais pour la France. Ils impulsent de
cette manière un grand mouvement de migration des Sound Systems fuyant
la répression. En effet, c'est en 1994, après le vote du
Criminal Justice Act, que la plupart des Sounds Systems anglais
rejoignent les Spiral Tribe sur les routes européennes. En Angleterre,
la scène s'étouffe. Les quelques Sound Systems restant se
heurtent désormais à une police beaucoup plus organisée.
L'avenir de la techno hardcore se joue désormais ailleurs.
III- Importation du mouvement en France
Scène européenne
En France, la techno avait déjà fait ses
premières apparitions dès 1988 et 1989 dans quelques clubs de
Paris : le Boy, le Rex et le Palace, lors de
soirées spécialisées. Et « si la composante
homosexuelle de la mouvance techno était importante [à ce moment
là], elle constitue aujourd'hui un fait relativement marginal mais, pour
ces raisons historiques, bien intégré. » (Racine, 2004).
Mais c'est en 1990 que les premières rave-parties fleurissent dans
l'hexagone, du fait de la connexion en réseaux des mondes festifs de
Londres et de Paris. Ici aussi, c'est par le principe des afters que
la techno underground conquis les coeurs, notamment par l'intermédiaire
des mix du dimanche matin du DJ Manu le Malin. Déjà, la
division de la techno en deux mondes et deux systèmes de
représentation, celui des clubs branchés parisiens et celui des
afters undergrounds, est bien réelle.
Ailleurs en Europe, les réactions à
l'arrivée de la techno sont souvent plus précoces, et surtout
beaucoup moins influencées par l'esthétique hardcore des Sound
Systems anglais. En Allemagne, l'arrivée de l'acid-house
coïncide avec la Chute du Mur de Berlin. L'Europe baigne dans une
vague d'optimisme. Les berlinois de l'Est découvrent tous les espaces
qu'il est possible d'investir sans être obligé de demander
d'autorisation. La première Love Parade prend place de manière
imprévue dès juillet 1991. Dans la capitale allemande, les clubs
fleurissent. « Les pièces du puzzle se rejoignent à la
faveur du vent nouveau : libération politique sur les rythmes des
pioches dont on a encore en mémoire les coups sur le mur [...].
»
(Kyrou, 2002). En Italie et en Espagne, le milieu des
années 90 sonne l'heure des premières organisations de grands
festivals techno européens. Ainsi, dans les alentours de Barcelone, le
festival Sonar sera le premier d'une longue lignée. Plus au
Nord, en Belgique et aux Pays-Bas, la fièvre techno monte dès le
début des années 90. Ici, c'est le new-beat qui fait
fureur, une house aseptisée qui fera très peu de fans dans le
versant hardcore importé par les Sound Systems anglais.
Mais c'était sans compter sur la volonté de
transmission du virus des Spiral Tribe et autres Sound Systems qui suivront
leurs traces sur les routes d'Europe.
Evolution française vers la free-party
Fin juin 1992, les Spiral Tribe atterrissent à Paris,
et s'y installent. Ils conquièrent la scène parisienne et
imposent leur image : une bande de travellers anglais hardcore. Ils se
font connaître en province avec une tournée dès la fin
1992, notamment du côté de Montpellier. L'année suivante,
ils sont à l'origine de l'organisation du premier festival
français. Ainsi, en juillet 1993 aux alentours de Beauvais, les Spiral
Tribe et les Nomads (Sound System français) posent le son du premier
teknival. Contrairement à ce qui se pratiquait en Angleterre du
fait de la présence des new age travellers et des punks, la
seule musique à être jouée ici est de la techno. A la suite
de cet événement, nombre de Sound Systems sont
créés à leur image dans l'hexagone
(Hérétiks, Troubles fêtes ou OQP) et les free-parties
prolifèrent. La même année, le magazine mensuel
Coda, commentateur de la scène rave française et
internationale, tire son premier exemplaire. Les magasins
spécialisés vendant les disques vinyles nécessaires
à la création et au mix techno se
créent partout en région parisienne. Ils sont aussi le lieu
oüles adeptes peuvent trouver les flyers*, ces petits
papiers indiquant les soirées à venir et le
numéro de l'infoline*, répondeur
téléphonique donnant des informations sur le lieu de la
fête au dernier moment.
Le mythe Spiral Tribe
Même si d'autres Sound System ont émigré
en Europe dans le but de transmettre le virus techno, les Spiral Tribe restent
en France considérés comme les fondateurs de la free-party, du
style de techno qui s'y joue et des modes de vie qui s'y attachent.
Dès leur arrivée à Paris, les membres du
Sound Systems se divisent en deux sousgroupes informels. Certains, que l'on
appellera les techno travellers auront pour vocation de
prendre la route afin de faire connaître leur
musique de par le monde. Les autres resteront sur
; SP 23
Paris afin d'entretenir le label Network 23
(créé lorsqu'ils étaient encore à Londres
dans sa versio
n française). L'idée est ici de favoriser
la création techno et de presser les vinyles nécessaires
à celle-
ci. Déjà, avec cette première
différenciation dans les approches de l'univers techno
, on voit apparaître une des ambiguïtés
du mouvement, celle d'une esthétique
underground recherchant une certaine
reconnaissance.

Un des multiples logos présents sur les
flyers de la Spiral Tribe,
reconnaissables entre
tous par les fans.
La branche techno travellers de la Spiral Tribe est donc
celle qui a pris la route, d'abord en France, et qui a
impulsé le premier teknival. A partir de 1993,
les Spis entament
ndre un
leur campagne européenne. Au départ, ils
prennent la route pour tenter de rejoi collectif d'artistes sculpteurs
utilisant toutes sortes de machines et de vieux véhicules, les
Mutoïds . Ils finissent par les rattraper aux alentours
de Rome. La fusion a lieu. Ensemble, ils parcourent les routes
d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et du Portugal et y organisent des
événements musico-
artistiques.
Ils poussent vers l'Europe de l'Est aux alentours de 1995
et organisent le premier teknival tchèque.
C'est la volonté de conquête de l'Ouest
américain qui signe une nouvelle césure dans
le g
roupe. Ceux qui en ont les moyens financiers partent,
les autres restent. Le voyage aux Etats-Unis est une
débâcle. De leur côté , ceux qui
n'ont pas pu partir, créent de nouveaux Sound Systems
sur le modèle de la Spiral Tirbe. Ainsi, Kaos crée les Sound
Conspiracy et prend de nouveau la route, cette
fois -ci vers Goa* en Inde, berceau des full moon
parties.
Mais plus que leur parcours, c'est bien du mode d'organisation
du groupe et de leurs revendications que nait le mythe. D'abord, il faut noter
que, même si la Spiral Tribe est à l'origine de l'organisation de
nombreux événements techno en France et en Europe, la
frontière assez floue du groupe et sa tendance à se poser comme
initiateur augmente considérablement la perception du nombre de
soirées organisées. En effet, d'une part cela s'explique par
l'attitude choisie par les membres fondateurs de la Spiral Tribe : ils se
posent d'eux-mêmes comme les leaders du mouvement. De cette façon,
ils catalysent l'essor de la mouvance free-party à leur manière.
D'autre part, un amalgame est rapidement fait entre les Spiral Tribe et
l'ensemble des DJs et travellers qui ont participé à un moment
où à un autre à une soirée organisée par
eux. D'ailleurs, cet amalgame est en partie créé par l'attitude
même des membres fondateurs, n'hésitant pas à
répéter lors de chaque free-party : « If you come in the
tribe, you're a Spiral Tribe ! » (Si tu viens dans la tribu, tu es un
Spiral Tribe). Ce Sound System semble donc omniprésent à
l'époque de l'essor de la free-party en France, alors même que la
plupart des membres sont soit à Paris, soit sur les routes d'Europe de
l'Est. Au final, « seul les acteurs ou les passionnés connaissent
les différentes déclinaisons de sounds systems présents
à cette époque. C'est en partie cette méconnaissance qui a
mythifié le sound system et ses membres. » (Mousty, 2003).
Le DVD documentaire sur les World Traveller Adventures jouera
également un rôle important dans la transmission du mythe à
ceux « qui n'étaient pas là ». Il retrace d'une part
l'histoire de la naissance de la Spiral Tribe en Angleterre et de ses
déboires avec les autorités, et d'autre part trois voyages en
Afrique, en Inde et en Europe de l'Est de sound systems
dérivés de la Spiral Tribe tel que Sound Conspiracy. Sur
fond d'humanitaire et d'itinérance, ils organisent des soirées
techno un peu partout dans le monde pour que la musique ne s'arrête
jamais (« music never stops »). C'est par cette
volonté de transmettre leur passion qu'ils deviendront les
emblèmes d'une mouvance musicale en création. Ils
véhiculeront grâce à ce prosélytisme non seulement
leur musique, mais aussi leurs idéaux contestataires et
hardcore.
Accueil du mouvement par les médias et la
société
De 1988 à 1993, le mouvement passe plutôt sous
silence. Mais très vite en France, comme chez nos voisins anglo-saxons,
la scène rave est associée à la consommation et au
marché de drogue. Du fait de la prédominance de la techno
hardcore des Spiral Tribe, c'est aussi le caractère jugé
inhumain et a-musical de ce nouveau style qui est traité. C'est la
réaction des journaux locaux aux différentes petites raves
organisées dans leur région qui
lance la spirale de la panique morale. Jusqu'en 1996, les
journaux nationaux reprennent le sujet et produisent des articles alarmants,
comme ce texte tiré du Nouvel Observateur par Etienne Racine (2004) :
« Les consommateurs d'ecsta, on les repère
à la mini-bouteille d'Evian qu'ils ont à la main pour
éviter la déshydratation. Ils sont les seuls à se tenir
à un centimètre de l'air vibrant des enceintes. Ils y resteront
jusqu'au matin. Mais la grande star de la soirée, c'est bien sûr
le haschich [...]. Affalés dans les bosquets, ils sont peut-être
2000 à faire tourner des pétards. Les plus cassés
cherchent fébrilement dans la terre les restes imaginaires de leur
boulette. On dirait une gigantesque fumerie d'opium en plein air, rassemblant
des étudiants, des fumeurs occasionnels et des scotchés de la
défonce. »
De leur côté, les autorités commence
à se saisir du sujet et lancent une première action
répressive et préventive gouvernementale avec la parution en
janvier 1995 de la circulaire « Les raves, des soirées à
hauts risques : mission de lutte anti-drogue » par la Direction
Générale de la Police Nationale. L'idée est que les raves
ne pouvant malheureusement pas faire l'objet d'une action répressive du
fait des risques dus à une intervention immédiate, doivent faire
l'objet d'une action préventive d'interdiction (Racine, 2004). A
l'échelle locale, une action plus directe est menée par la mairie
d'Avignon en mai 1996 qui établit un arrêté
précisant que « les soirées musicales
dénommées rave-parties sont strictement interdites sur le
territoire communal ».
Mais le mouvement commence à s'organiser. Les
interdictions sont jugées abusives par les organisateurs. Ainsi,
à la suite de l'annulation de la rave Polaris prévue le 24
février 1996 à Lyon mise en oeuvre par des tenanciers de
discothèque ayant fait pression sur la mairie, le collectif Technopol
est crée. Cette association a pour objectif « la défense de
la culture, des arts et des musiques électroniques issues des mouvements
house et techno ». Elle offre un cadre légal et officiel à
la mouvance rave-party. L'association parviendra à obtenir une victoire
symbolique en faisant annuler l'arrêter anti-rave de la mairie d'Avignon.
Outre Technopole, la volonté d'organisation du mouvement est visible
dans la présence d'autres associations sur le terrain. Ainsi, en 1997,
Médecins du Monde lance sa Mission rave. Elle a pour but
d'avoir une action préventive sur les effets et les risques des drogues
et est financée par une action gouvernementale. Déjà, en
1995, un collectif de teufeurs avait vu le jour dans ce but, l'association
Techno Plus.
| 


