|
UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES

![]()
SUJET

Présentée par
Seyba DANFAKHA
Etudiante 4ème année de Droit Public
Option : Relations
Internationales
Sous la Direction de
M. Seydou Nourou TALL
Docteur en Droit Public
Relations Internationales
Année académique 2002-2003
DEDICACES
Je dédie spécialement ce travail:
§ Amon père Samba DANFAKHA et à ma
mère Maïmouna KANTE eux qui ont su m'indiquer très tôt
le chemin du savoir et consentir moult sacrifices pour que je le suive
§ A ma tante Néné SARR
§ Ames frères Lamine, Pisco, Fadigui (Barcelone),
Ibrahima (Valence)
Bathie, Mountaga, Dady, E! Hadji en signe
d'encouragement.
§ A mes soeurs : Ndèye Saly et Kama
§ A mes amis Ndiaga Ngom, Cheikh Ly, Lamine Ndiaye, Alpha
Dieng
§ A Adama Diallo et sa famille,
§ A Marième Sy,Paris Cergy
§ A tous mes amis de la promotion
REMERCIEMENTS
Je saisis cette opportunité, pour formuler de
sincères remerciements:
§ Amon encadreur M. Seydou Nourou Tall non seulement pour
l'assistance précieuse qu'il m'a apportée dans le cadre de ce
mémoire mais encore et surtout pour le bon enseignement qu'il m'a
prodigué.
Je remercie également
§ Le Personnel de la Médiathèque (CESTI)
§ Aboubacar Demba Cissokho, journaliste à l'APS
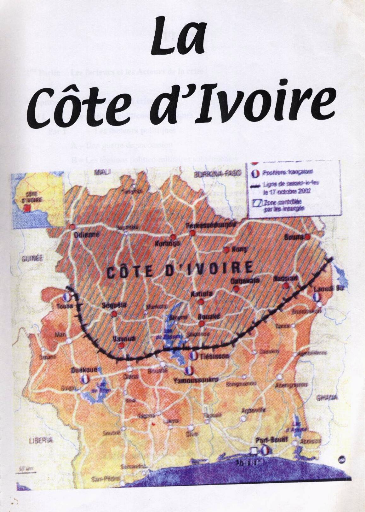
PLAN
INTRODUCTION
7
1ÈRE PARTIE: LES FACTEURS
ET LES ACTEURS DE LA CRISE
13
CHAPITRE I : LES FACTEURS DE LA CRISE
14
SECT I : LES FACTEURS
POLITICO-ÉCONOMIQUES
14
Par I : Les facteurs politiques
14
A- Une guerre de succession
14
B- Les tensions politico-militaires
subséquentes
15
Par II : Les facteurs économiques
18
A- La récession économique
18
B- Une économie géo-ethnique
20
SECT II : LES FACTEURS SOCIO-JURIDIQUES
21
Par I : Un état à composante
hétérogène
21
A: Un pays d'immigration
21
B- Un Etat multinational
22
Part II : Une nation en construction
24
A- La Préexistence de 1'Etat
24
B- L'ivoirité
26
CHAPITRE II : LES ACTEURS DE LA CRISE
29
SECT I : LE CAMP DES LOYALISTES
29
Par I : La famille
présidentielle.
29
A- Le Président Laurent Gbagbo
29
B- Simone Ehivet Gbagbo : une militante dans
l'âme
31
Par II : Le proche entourage
présidentiel
32
A- Mathias Doué
32
B- Laurent Donan Fologo
33
SECT II : LES OPPOSANTS AU RÉGIME DE
GBAGBO
33
Par I : Les héritiers de la
pensée d'Houphouët
34
A- Les « fils spirituels d'Houphouët
34
B- Robert Guei
35
Par II : Les Mouvements Rebelles « Forces
Nouvelles »
36
A- Le Mouvement Patriotique de Côte
d'Ivoire
36
B- Les autres mouvements rebelles
37
DEUXIÈME PARTIE : LES TENTATIVES DE
SORTIE DE CRISE
39
CHAP. I : LES MÉDIATIONS
INTERVENUES
40
SECT I : LES MÉDIATIONS
RÉGIONALES
40
Par I: Les médiations individuelles
40
A- La médiation
sénégalaise
40
B- La réconciliation de Bamako
41
Paragraphe II : Les médiations
institutionnelles
42
A. La création du groupe de contact
42
B- L'échec du sommet de Lomé
43
SECTION II : LES MÉDIATIONS
INTERNATIONALES
44
Paragraphe I : La table ronde de
Linas-Marcoussis
44
A. La naissance d'un processus de normalisation et
de réconciliation
45
B- Un accord de réformes juridiques
47
paragraphe II: Les obstacles à
l'application des accords de Marcoussis et de Kléber
48
A- Les blocages relatifs à l'attribution des
portefeuilles de la défense et de l'intérieur
49
B- La Naissance d'un nationalisme ivoirien
51
CHAPITRE II : LA RECHERCHE DES CONDITION
D'UNE PAIX DURABLE
53
SECT I: LE SOMMET D'ACCRA
53
Par I : La nouvelle donne issue du sommet
d'Accra
53
A-- La création du Conseil National de
Sécurité
53
B- La signature d'une délégation de
compétence
54
Par II : La nécessité d'une
sécurisation de l'intégralité territoriale
55
A- La rencontre de Kara
56
B- La signature de cessation des hostilités
entre les mouvements rebelles et l'armée Ivoirienne (FRANCI).
56
SECT I : UNE SITUATION PRECAIRE
57
Par I : Un front politico-économique
instable
57
A- Les difficultés liées à la
conduite d'une politique gouvernementale
58
B-- Un timide redynamisme économique
59
Par II : Une réalité permanente
des hostilités
60
A- - Un cessez-le-feu fragile
60
B- Une flagrante violation des droits humains
61
CONCLUSION
64
BIBLIOGRAPHIE
66
LISTE DES ABRÉVIATIONS
68
ANNEXES
69
INTRODUCTION
Constituée comme colonie française par un
décret du 17 Octobre 1899 mettant fin au Soudan français, la
Côte d'Ivoire fut réorganisée dans le cadre de l'Afrique de
l'Ouest par les décrets du 1er Octobre 1902 et du 18 Octobre
1904. Elle devint indépendante le 07 Août 1960.
La Côte d'Ivoire est limitée au Nord Est par le
Burkina, au Sud par le Libéria, à l'Est par le Ghana, au Nord
Ouest le Mali, à l'Ouest par la Guinée.
Pays en pointe, la
Côte d'Ivoire occupe en Afrique une place privilégiée. Les
conditions naturelles ne constituent pas en Côte d'Ivoire une entrave au
développement économique.
Le pays, vaste, quadrilatère de 315 000 km2 est peu
accidenté. On n'y rencontre que quelques petits massifs dont la hauteur
n'excède général pas 600 m, sauf dans la région de
Man où quelques pitons rocheux émergent du massif du mont Nimba
et atteignent 1340 m d'altitude.
Comprise entre 4° 20' et 10 ° 50 ` de latitude Nord,
la Côte d'Ivoire fait la transition entre les climats équatoriaux
et les climats tropicaux.
Mais du point de vue agricole, la Côte
d'Ivoire a des possibilités de cultures très diverses. Au Sud
dans la zone forestière aux essences très recherchées, le
climat et les sols sont favorables à la production du café, du
cacao et de la banane de chine. Le manioc, le maïs, la banane Plantin, le
riz fournissent la majeure partie de l'alimentation. Au Nord, la région
des savanes boisées convient surtout aux cultures vivrières et
à l'élevage. Dans ces conditions, les ressources agricoles sont
essentielles et la Côte d'Ivoire se manifeste à l'échelle
mondiale par ses exportations.
La Côte d'Ivoire constitue la
première puissance de l'Afrique occidentale, francophone, et
deuxième en Afrique subsaharienne après le Nigeria.
Economiquement viable le café et le cacao dont elle est le premier
producteur mondial ont permis une accumulation de capitaux et un
développement économique sans précédant dans la
sous -région.
La Côte d'Ivoire détient 45 % de la masse
monétaire de l'UEMOA et de 40% du produit intérieur brut. La
croissance due au café et au cacao ont entraîné « le
miracle Ivoirien ». Cependant ce miracle va subir un coup du fait des
cours du café et du cacao au milieu des années 80.
Erigée en colonie de peuplement, la Côte d'Ivoire
est forte d'une population de 15 millions dont 40 % d'étrangers. On
retrouve au pays des lagunes ébriées en grande partie des
ressortissants Burkinabé, des Maliens, Sénégalais, Libano
- Syriens et autres européens. Sur le plan ethnico-religieux, la
Côte d'Ivoire présente une mosaïque où se côtoie
une soixantaine d'ethnies, parlant 60 dialectes différents,
répartie en quatre groupes : les Bétés à l'ouest
les Baoulés au centre-ouest, les dioulas et les Senoufs au Nord.
Cette diversité ethnique se double d'autogamismes
religieux entre 50 % de musulmans, 30 % de chrétiens et 20%
d'animistes.
Le phénomène de la composante nordiste peut
s'analyser à travers la volonté manifeste d'Houphouët Boigny
d'exporter la main d'oeuvre de l'ex-Haute Volta (actuel Burkina).
La Haute Volta à été pendant longtemps
une partie intégrale de la Côte d'Ivoire jusqu'à sa
dissolution en 1947 en trois parties : une partie a été
rattachée à la Côte d'Ivoire, une autre au Soudan
français, et enfin la dernière au Niger. Elle a été
reconstituée en 1947.
La côte d'Ivoire, éléphant d'Afrique,
depuis la mort d'Houphouët Boigny le 7 décembre 1993 n'a jamais
été en paix avec elle-même. Son héritage
n'était qu'une « bombe à retardement ». Dès sa
mort on assista à des problèmes de succession qui sont aussi
liés à la situation actuelle du pays. Ils étaient quatre
à se battre pour sa succession. Il s'agit respectivement du
Général Gueï, de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri
Konan Bédié.
Invoquant l'article 11 de la Constitution qui permet au
Président l'Assemblée nationale d'assurer la vacance,
Bédié devint président par intérim. De ce fait
quelques mois après la mort de Houphouët, effectivement en
septembre 1994, naîtra le Rassemblement des Républicains
d'Alassane Ouattara parti implanté dans le nord. Ce qui explique son
caractère identitaire et régional.
Henri Konan Bédié introduit le concept
d'ivoirité dans la Constitution. La polémique sur
l'Ivoirité qui impose de prouver ses origines pour participer à
la compétition électorale n'est qu'un des épisodes de la
domination d'élites issues du sud. Cette identification sectaire a
servi, depuis la mort d'Houphouët, les hommes qui se sont
succédés à la tête de l'Etat ivoirien.
C'est en décembre 1999 que la situation a totalement
basculé avec la mutinerie qui avait fini de se transformer en coup
d'Etat et porter le Général Gueï
au pouvoir. Avec
l'insurrection du 19 septembre 2002, déclenchée par une partie de
l'armée en rupture de ban, la Côte d'Ivoire renoue avec la crise.
Par crise il faut entendre la période où les
difficultés économiques, politiques et idéologiques sont
ressenties comme paroxystiques.
La crise qui secoue la Côte d'Ivoire se rapproche plus
à une lutte armée qui oppose au sein d'un même Etat
d'importantes fractions de la population.
Pour sortir de la crise,
différentes médiations ont été entreprises. La
médiation
se définit comme un mode de règlement
politique des conflits consistant dans l'interposition d'une tierce personne
qui ne se borne moins pas de persuader les parties mais leur proposer en plus
une solution.
Elles se sont opérées au plan individuel, sous
-régional, régional, et enfin l'échelle internationale.
Au plan individuel, nous pouvons retenir les médiations
du président Sénégalais Abdoulaye Wade et du
président malien Amadou Toumani Touré.
Le sommet du 29 septembre de la CEDEAO Accra s'est
concrétisé par la
création du groupe de contact
dirigé par le président Togolais Gnassimbé
Eyadéma, avant de connaître un nouveau lifting avec le sommet
d'Accra du 6
mars 2003.
La France longtemps confinée dans une politique non
interventionniste depuis le fiasco politico-militaire rwandais de 1994 avec
l'opération turquoise, a envoyé un contingent militaire pour non
seulement sécuriser ses ressortissants mais aussi protéger ses
intérêts économiques. En effet, il y a 210 filiales
d'entreprises françaises sur le territoire Ivoirien, soit le quart de
filiales françaises implantées dans la zone franc.
Pour trouver une solution diplomatique à la situation,
un accord été signé à Marcoussis dans la banlieue
parisienne après 10 jours de conclave. Ont pris part à ce huis
clos, les différents protagonistes de la crise à savoir les trois
mouvements rebelles (le MPCI, MJP, MPIGO) et les différentes
entités politiques. Les accords de ce huis clos ont été
avalisés par le Sommet des Chefs d'Etat de Kléber le 25 et 26
Janvier 2003.
Dans le cadre de l'étude de ce sujet, un certain,
nombre de questions doivent être posées.
Dans un Etat
multinational comme la Côte d'Ivoire, quel sont les critères de
détermination de la nationalité ?
A quelle ivoirité se réfère la Côte
d'Ivoire ?
Pourquoi les rebelles contestent-ils le pouvoir ?
Etaient-ils en droit de contester un pouvoir
démocratiquement élu ?
En Afrique, un coup d'Etat, une rébellion ne sont-ils
pas en train d'être érigés en mode d'accession au
pouvoir?
Le processus de l'intervention française, n'est-il pas
signe d'un grand retour du néocolonialisme?
L'Etude du sujet
à travers de multiples données nous permet de déceler un
intérêt au triple plan : géo-économique, politique
et actuel.
Sur le plan géopolitique, la Côte d'Ivoire est en
proie à des conflits ouverts ou mal éteints avec le
Libéria et la Sierra-Léone. Situé au Sud-Ouest le
Libéria est aujourd'hui le principal pourvoyeur de milices tant du
côté gouvernemental que celui des mouvements rebelles. Au nord
Est, Blaise Compaoré, Président du Burkina Faso est accusé
par Abidjan de déstabiliser la Côte d'Ivoire par son aide
supposée aux rebelles. Sur la moitié Nord Ouest, la Côte
d'Ivoire partage une frontière avec le Mali fermée sans attendre
le début de la présente crise. La Guinée ayant
également fermé sa frontière à l'Ouest semble se
murer dans une certaine neutralité. Cependant, le Ghana, à l'Est
ne souffre d'aucune friction sérieuse de l'ivoirité. De
surcroît, la Côte d'Ivoire offre un marché juteux aux
trafiquants d'armes.
Sur le plan économique, la crise a eu d'importantes
répercussions sur la bonne marche de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet, la Côte d'Ivoire
contribue à 40 % du PIB. De surcroît, le port d'Abidjan constitue
une des principales portes d'ouverture pour les pays enclavés tels le
Mali, le Niger et le Burkina.
Avec la suspension du trafic, ces derniers réorganisent
les circuits d'approvisionnement vers d'autres ports notamment à
Lomé, à Cotonou, à Dakar et même à
Téma au Ghana.
Au plan politique, la crise en Côte d'ivoire s'explique
par une dynamique de pouvoir. Les différents protagonistes luttent pour
la conquête ou le maintien du pouvoir. En effet, d'abord corporatistes,
les revendications des mutins deviennent par la suite politiques en demandant
le départ du Président Laurent Gbagbo et l'organisation
d'élections où prendraient part toutes les sensibilités
politiques. Il est surtout actuel.
La Côte d'Ivoire réputée stable, renoue
avec la spirale de la violence susceptible d'embraser toute la
sous-région.
L'objet de notre réflexion sera basé sur une
approche synthétique mettant en exergue d'une part les divers
éléments qui sont inter-relation entre eux et d'autre part, les
facteurs historiques, socio-politique et économiques. C'est pourquoi,
l'étude de ce sujet appelle différentes questions :
Quels sont les différents déterminants sous
-jacents la société ivoirienne ? et qui sont les protagonistes de
la crise ?
Quelles sont les solutions qui ont été
préconisées pour sortir de la situation de crise ?
Les questionnements nous conduisent à exposer dans un
premier mouvement les facteurs et les acteurs de la crise et de montrer dans un
deuxième mouvement les tentatives de sortie de crise.
1ÈRE PARTIE : LES
FACTEURS ET LES ACTEURS DE LA CRISE
La mutinerie du 19 septembre 2002 apparaît à tous
les observateurs avertis de l'évolution de la Côte d'Ivoire comme
l'aboutissement d'une accumulation de phénomènes dont 1e pays a
été le théâtre au cours de cette
décennie1(*). La
mutinerie déclenchée par une partie de l'armée en rupture
de ban n'est qu'une des facettes de la crise qui secoue le pays. En effet, la
particularité de la Côte d'Ivoire au plan politico-ethnique et
économique a instauré une situation de rébellion pour
combattre une répartition du pouvoir politique ou des richesses.
Par
facteur de la crise, il faut entendre les nombreux déterminants sous
jacents la société ivoirienne car l'instabilité qui
caractérise le pays trouve ses fondements dans des racines profondes.
Quant aux acteurs, ce sont les différents protagonistes. Ils se
subdivisent d'une part en la famille présidentielle en la personne de
Laurent Gbagbo et son épouse Simone et de l'entourage
présidentiel, et d'autre part les opposants au régime à
savoir les « fils spirituels» de Houphouët
Boigny avec Henri K. Bédié, Alassane Ouattara et Robert Guei et
enfin les mouvements rebelles que sont le Mouvement Patriotique de Côte
d'Ivoire (MPCI), principal mouvement, du Mouvement pour le Justice et la Paix
(MJP) et du Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) né plus
tard. Qu'ils soient du pouvoir, de l'opposition ou de la rébellion, leur
principal objectif reste la lutte pour la conquête ou le maintien au
pouvoir.
Circonscrite en Côte d'Ivoire, la crise menace la
stabilité de la sous -région.
CHAPITRE I : LES FACTEURS DE
LA CRISE
Deux séries de facteurs sont à
l'origine de la crise. Ils sont à la fois politico - économique
et socio -juridique
SECT I : LES FACTEURS
POLITICO-ÉCONOMIQUES
L'environnement politico-économique est l'un des
facteurs les plus marquants car obéissant à la logique des
événements internes liés aux institutions. Ces facteurs
s'expliquent par une guerre de succession entraînant des tensions
politico -militaires subséquentes.
Par I : Les facteurs politiques
De tous les facteurs, ils apparaissent comme les plus
récurrents. En effet, la crise politique engendrée par la
succession de Houphouët Boigny dans des conditions controversées a
entraîné une situation d'affrontassions entre Henri Konan
Bédié et Alassane Dramane Ouattara, débouchant du coup
à des tensions politico-militaire après le refus en 1995 de la
candidature de Alassane Dramane Ouattara.
A- Une guerre de succession
Dès la fin des cérémonies
funéraires qui ont suivi le décès du Président
Houphouët le 07 Août 1993, une bataille de succession s'est
engagé entre le Président de l'Assemblée Nationale, Henri
Konan Bédié, successeur en vertu de l'article 112(*) de la Constitution et le Premier
Ministre d'alors Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier a été
soupçonné de vouloir commettre un «hold-up»
constitutionnel3(*) au
mépris des textes qui l'écartaient du pouvoir pour investir
automatiquement Henri Konan Bédié au trône.
L'hésitation de l'ancien Premier
Ministre Alasane Dramane Ouattara
à passer le pouvoir au Président de l'Assemblée Nationale,
Henri Konan Bédié avait suscité une grave crise politique
qui avait fait craindre le chaos à la Côte d'Ivoire. Car en 1992,
suite à une sortie politique télévisée Ouattara
annonçait son intention de succéder à Houphouet Boigny.
La crise s'est accentuée à la veille des
élections présidentielles lorsque l'ancien Premier Ministre a
annoncé sa candidature à la magistrature suprême. Le
Président Bédié a refusé sa candidature en
contestant l'éligibilité de Ouattara au motif de sa
nationalité Burkinabé. Le Côte d'Ivoire était au
bord de la guerre civile lorsqu'in extremis, Ouattara s'est retiré. On
s'attendait donc à un apaisement du climat politique et social lorsque
Laurent Gbabgo, candidat du Front Populaire Ivoirien, a lancé un mot
d'6rdre de boycott. Les manifestations furent réprimées
violemment par le pouvoir en place en application du décret
N°95-721 du décret N°95-721 du 25 septembre 1995 qui
interdisait les manifestations publiques. La tension politique était
à son paroxysme : 30 morts furent dénombrés. Le
Général Robert Guei était également
soupçonné de connivence avec Alassane Ouattara4(*).
B- Les tensions
politico-militaires subséquentes
Bédié élu en 1995, les marches et sit-in
du Front Républicain se sont poursuivis pour contester sa
légitimité « entachée de fraude » et «
entachée de violence et de sang »5(*). Pour désamorcer la
crise, le Président Bédié a formé un gouvernement
d'ouverture en faisant appel d'abord à Bernard Zadi Zaourou de l'USD,
ensuite Francis Wodié du PIT et enfin Adama Coulibaly du R.D.R mais
l'opinion n'a accordé une grande importance à cette ouverture
parcimonieuse faite au cas par cas. La tension politique n'a donc pas
baissé puisque le F.P.I a non seulement refusé l'offre mais
accusé d'autant, l'USD et le PIT de trahison à la cause de
l'opposition. Par ailleurs, le Rassemblement Démocratique des
Républicains frustré de n'avoir pas été
consulté par l'intégration d'Adama Coulibaly l'a exclu du parti.
Néanmoins, le FPI qui a fait un pari sur l'avenir a réussi
à conclure des accords avec le gouvernement sur les conditions de
déroulement des élections de l'an 2000. Ce qui n'était pas
le cas du RDR. Dès lors, l'échiquier politique ivoirien s'est
trouvé transformé : Le Front Républicain FPI-RDR faisait
désormais place à l'Alliance PDCI-FPI. Rassuré au niveau
interne par cette alliance et se fondant sur la décision des chefs
d'Etat au dernier Sommet de l'OUA à Alger en Juillet, de ne plus
siéger avec un gouvernement issu d'un putsch, le Président
Bédié pensait avoir suffisamment de marge de
sécurité pour relancer le débat sur la nationalité
d'Alassane Ouattara. C'est ainsi que, démarrant sa campagne
électorale, il affirmait sans ambages « qu'Alassane est
Burkinabé par son père »6(*) remettant à l'ordre du jour la
nationalité et l'éligibilité de Ouattara.
La scène politique s'est de nouveau mise en
ébullition et la riposte s'est traduite par une série de marches
dont la dernière a conduit à l'arrestation de neuf leaders du
RDR.7(*)
Robert Guei arrivé au pouvoir par le biais du putsch a
formé un gouvernement d'ouverture. Mais très vite des fissures
sont apparues.
La perspective de l'élection 2000 a
déchaîné des luttes partisanes. Le FPI s'est allié
de fait avec le PDCI. Après neuf mois d'expectative, l'élection
s'est jouée à guichet fermé ; la Cour Suprême
n'ayant validé que cinq candidatures sur dix sept postulants,
éliminant Ouattara et tous les prétendants du PDCI. Gbagbo est
élu avec 62 % d'abstention. La présidence de Gbagbo a
commencé sous de mauvais auspices. En effet, dès les
élections de décembre, la candidature à la
députation de Ouattara était refusée.
Sous la pression de ses partenaires, le Forum de
réconciliation s'est tenue d'Octobre à Décembre 2001
constituant ainsi le point d'orgue du processus avec les quatre leaders :
Bédié, Ouattara, Gbagbo, Guei, débouchant ainsi à
l'octroi d'un certificat de nationalité à Alassane Ouattara. Mais
ce Forum était illusoire comme le révèlent les violences
actuelles.
Cette crise s'est déroulée aussi sur fond de
crispations militaires.
En effet, une fois installé, Guei s'est brouillé
avec ceux qui l'ont porté au pouvoir. Il limogea ainsi les officiers
généraux du Nord qui l'avaient porté au pouvoir à
savoir : le Général Abdoulaye Coulibaly et Lansana Palenfo.
D'autres n'ont pu s'échapper qu'en prenant le large (Ibrahima Coulibaly
« lB »). Il recrute
de centaines de miliciens de sa région
d'origine, Man, se constitue une garde personnelle de plusieurs dizaines
d'hommes de son village Guessessou. C'est
avec cette force de
frappe(Zinzins) qu'il s'engage dans l'épreuve de l'élection
présidentielle.
Après son élection Gbagbo tente de restructurer
l'armée. Il remplace le Chef d'Etat Major le général
Diabakhaté, officier du Nord par Mathias Doué. Il décide
de démobiliser les Zinzins car devant faire face «aux
impératifs de la masse salariale de la fonction publique ». Cette
démobilisation a été le facteur déclenchant de la
mutinerie du 19 septembre.
La mutinerie a lieu sur fond de crise économique.
Par II : Les facteurs
économiques
La crise économique des années 1980 a mis fin au
miracle ivoirien. Longtemps considérée comme le grenier de
l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est en proie à une crise
économique. La géographie du pays a correspondu à une
structuration économique.
A- La récession
économique
La crise économique est due à des facteurs aussi
bien internes qu'externes.
S'agissant des facteurs externes il faut retenir trois
éléments dont les effets ont été néfastes
pour l'économie ivoirienne et pour les ivoiriens : le programme
d'ajustement structurel, la dévaluation du franc cfa ; et la baisse des
cours du prix du café et du cacao.
Le programme d'ajustement structurel appliqué à
la Côte d'Ivoire n'a pas donné de résultats satisfaisants
quant au relevant de l'économie. Le désengagement de l'Etat dans
les investissements sociaux pour s'orienter vers des secteurs productifs, la
privatisation des entreprises publiques qui implique nécessairement des
licenciements massifs, et l'alignement sur les prix mondiaux qui conduit
à la disparition des entreprises non concurrentielles, ont
débouché sur un accroissement de la pauvreté.
La dévaluation, du CFA, intervenue en janvier 1994 a
été imposée par la banque mondiale et le F.M.I et
acceptée par la France et les pays de la zone franc. Elle devait
permettre à l'économie ivoirienne de mieux se comporter sur le
marché international notamment au niveau des exportations, mais le prix
des biens importés augmentant, la dévaluation a signifié
pour la population une diminution de son pouvoir d'achat et une augmentation du
coût de la vie.
La baisse des cours des prix du café et du
cacao revêt une importance capitale en côte d'Ivoire, puisqu'elle
aggrave l'état de pauvreté des populations rurales.
En effet,
le café et le cacao étant les principales productions
rentières de la côte d'Ivoire, la variation de leur cours reste le
baromètre de l'état de richesse ou
de pauvreté de ces
populations.
S'agissant des facteurs internes, leur impact sur les
populations a été plus important en raison de leur lien avec la
morale, d'autant plus que les scandales financiers et l'affairisme ont
marqué la société ivoirienne.
En effet, la scène politique ivoirienne a
été émaillée de n ombreux scandales
économiques et financiers. Ces différents scandales qui
défient toute morale politique, économique et sociale ont terni
l'image de la Côte d'Ivoire tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.
Il ressort également à l'intérieur que
les différents scandales prouvés ont révélé
que le trésor public a été l'objet de plusieurs
détournements de deniers publics.8(*)
Il ressort également de ces scandales que
des investissements faramineux ont été effectués sans
couverture budgétaire dans le chef lieu et dans le village natal de
Bédié.9(*)
A l'extérieur c'est le détournement de fonds
d'aides de l'Union Européenne à la Côte d'Ivoire
destinés à la santé qui est à l'origine de la
détérioration de son image. Cette affaire conduisant au
relèvement des fonctions du ministre de la santé M.
Guikahué, qui a amené l'union Européenne à
suspendre sa coopération avec la Côte d'Ivoire, a causé un
préjudice énorme à l'état qui non seulement a
été privé de tout appui budgétaire, mais
également de tout nouveau projet d'investissement.
En outre la
Côte d'Ivoire présente un économique géo -ethnique.
B- Une économie
géo-ethnique
En Mai 1961, Houphouët Boigny déclarait à
Karogho, ville du nord « Il faut qu'à l'intérieur de notre
Côte d'Ivoire nous réalisons l'unité de tous les ivoiriens,
et surtout l'égalité entre tous les ivoiriens, qu'ils soient du
nord, du sud, de l'ouest ou de l'Est »10(*)
La différence géo-ethnique s'est faite sur fond
de différences régionales et de mouvements de populations.
En Côte d'Ivoire, en effet, on distingue le Sud du Nord
qui reste déshériter malgré les progrès accomplis.
C'est au sud que sont concentrées toutes les grandes productions
exportables, de café, de cacao, de bananes, d'ananas.
Ce
phénomène a été l'origine d'importants mouvements
de populations vers le sud.
Les populations du nord sont largement
constituées de Dioulas terme désignant les commerçants.
Une analyse détaillée des revenus, des comportements sociaux et
du niveau de vie, permet à SAMIR ArviiN11(*) de dire que les populations du nord détiennent
une part importante de l'économie. En effet par le biais des vagues de
migratoires, le centre -ouest et le sud-ouest ont été
submergés par des migrants qui ont occupé la majeure partie des
espaces cultivés.
L'agriculture paysanne se développa
grâce à une immigration spontanée massive en provenance des
zones de savanes de la côte d'ivoire, mais aussi du
Burkina et du
Mali. Quant à l'agriculture industrielle elle se développa
grâce à l'exécution d'un programme initial de grandes
plantations. De véritable « réseaux de
recrutement» furent mis sur pied. Le Burkina Faso fournit 35 %
à lui seul de travailleurs. Lorsque les populations autochtones ont
senti que le glas Krou avait commencé, ils se mirent à jouer le
jeu des plantations villageoises dans la décennie 1980. En 1998 la loi
sur la propreté foncière, autorisait l'expropriation de tous les
« étrangers ». Le conflit foncier qui a opposé en
novembre des autochtones Krou dans la sous -préfecture de Tabou à
des immigrés Lobi a donné lieu au départ
précipité de 15 000 Burkinabé dépouillés
ainsi de leurs propriétés foncières.12(*)
Ces facteurs politico-économiques s'ajoutent des
facteurs socio-juridiques.
SECT II : LES FACTEURS
SOCIO-JURIDIQUES
Pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent,
le président H. Boigny s'est attelé à une
intégration de peuples immigrés, nécessitant la
construction d'une unité nationale.
Par I : Un état à
composante hétérogène
Créée artificiellement par la colonisation, la
Côte d'Ivoire est traversée par flux migratoires dus au miracle
Ivoirien. L'hétérogénéité de son peuplement
explique son caractère multinational.
A: Un pays d'immigration
Dans l'empire colonial français, la Côte d'Ivoire
était sélectionnée comme une colonie de plantation qui
devait être mise en valeur par la main d'oeuvre transférée
de force des territoires voisins alors peuplés. Depuis le début
du XXe siècle des milliers de migrants ont été
forcés de venir travailler sur les plantations de Côte d'Ivoire.
Même après la fin du travail forcé en 1946 ce mouvement
migratoire s'est poursuivi jusqu'à l'indépendance et sous
l'impulsion de planteurs locaux qui avaient besoin de maintenir cette
main-d'oeuvre L'administration coloniale avait aussi recruté du
personnel dans les pays où le niveau d'instruction était plus
élevé qu'en Côte d'Ivoire en particulier au
Sénégal et au Dahomey. Une deuxième vague s'est
effectuée au milieu des années 70. Ces migrants sont le plus
souvent des hommes adultes venus en Côte d'Ivoire s'installer avec leurs
familles. Les impératifs de l'exploitation coloniale ont fait que les
limites de la colonie ont fréquemment changé. Elles n'ont
été fixées avec celle de la Haute Volta (actuel Burkina
Faso) du Mali (ancien Soudan Français) et du Niger qu'en 1947.
Houphouët Boigny a été élu en 1945
député au Parlement au titre d'un territoire de la Côte
d'Ivoire qui comprenait alors l'actuelle Côte d'Ivoire et le Burkina.
La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 15 millions d'habitants dont 6
à 7 millions sont originaires de la sous -région.
La politique coloniale de peuplement de la Côte d'Ivoire
explique donc le plus le caractère cosmopolitique de sa population par
rapport à celle des autres territoires de l'Afrique de l'Ouest.
B- Un Etat multinational
L'Etat multinational se caractérise par une
diversité de nationalité en son sein.
Confiant dans les
résultats de sa politique, le Président Houphouët Boigny
déclarait le jour de la fête nationale en 1964 « la Nation
peut comprendre le Gourou, Bétés, des Baoulés, les
Yacoubous, des Dioulas et bien d'autres races comme la France par exemple des
Bretons, des Auvergnats, des Basques »13(*) frontières coloniales
de la Côte d'Ivoire comme celles des autres pays africains ont
séparé les peuples naguère unis dans la même
aventure historique. E n effet, l'histoire culturelle du Nord du pays
s'apparente à celle de certains pays voisins. Ainsi le royaume de Kong
fondé par les ancêtres de M. Alassane Ouattara s'étendait
du XXè siècle à la conquête coloniale sur un
territoire que se partagent la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso,
tout comme le Nigéria, le Tchad et le Niger se partagent le territoire
occupé par les anciens royaumes du Kanem et de Bornou ou comme l'ancien
Etat de l'Adamtwa qui s'est trouvé divisé entre le Cameroun et le
Nigéria. Toute cette diversité a justifié l'expression de
«puzzle humain»14(*) qu'emploie Gabriel Rougerie. La diversité
ethnique est à l'origine d'une diversité religieuse. En effet,
trois religions principales coexistent en Côte d'Ivoire : l'animisme,
l'Islam et le Christianisme.
L'Animisme a été pendant longtemps la religion
dominante. Certains peuples comme les Koulango, les Lobis du Nord-Est, les
Senoufos qui y restés attachés ont été convertis
à l'Islam.
L'Islam s'est répandu d'abord dans le nord du pays
à partir du XVe siècle puis a été diffusé
vers le sud par les dioulas commerçants. Aujourd'hui elle
représente la communauté la plus importante.
Le christianisme est beaucoup plus récent. Son
implantation date de la colonisation. Sa diffusion a donc suivi le mouvement de
pénétration du territoire par les Français, du sud vers le
nord s'opposant ainsi aux influences islamiques septentrionales.
La
Côte d'Ivoire compte près d'une soixantaine d'ethnies qui se
regroupent en 4 grands ensembles.
Le groupe Akan est localisé au Centre et au Sud-Est
composé de Agnis, Baoulé et des populations lagunaires
Ebriées. Ensuite il y a le groupe Krou au sud constitué de
populations isolées et des Bétés ; le groupe
voltaïque au nord, nord-est constitué de Senoufo, de Kalango, Lobi
; le groupe Mandé subdivisé en deux branches à l'ouest et
centre-ouest, et Mandé du sud avec les Gourou et Dans, Yacoubo, le
nord-ouest constitué de Malinkés et de Dioulas.
Il y a une
correspondance entre la politique et la géographie. En effet de ces
ensembles régionaux, il en résulte que Henry Konan
Bédié est issu du sud -est, Robert Gueï de l'ouest, Laurent
Gbagbo du sud-ouest et Alassane Ouattara du nord. Comme beaucoup d'Etats
Africains, la Côte d'Ivoire présente un substrat national en
construction.
Part II : Une nation en
construction
La nation est une certaine qualité de la population
d'un Etat ou même d'un groupement humain à l'intérieur ou
à travers des Etats. Celle de la Côte d'Ivoire s'est
trouvée en perpétuelle construction du fait de la
préexistence de l'Etat.
Aujourd'hui l'ivoirité se trouve en déphasage de
la conception de l'unité prônée par Houphouët.
Boigny.
A- La Préexistence
de 1'Etat
La Côte d'Ivoire se présentait en 1960 comme un
pays profondément divisé. Ses frontières
héritées de la période coloniale ne correspondaient pas
à des divisions naturelles, physiques ou humaines. Elle englobe de
nombreux groupes humains, de races, d'origines différentes, de coutumes
différentes, sans compter les importantes minorités
étrangères africaines ou européennes. Dans ces conditions,
la Côte d'Ivoire était bien en 1960 un Etat mais elle était
loin de constituer une nation. C'est pourquoi, le Président
Houphouët Boigny déclarait à Ghagnoa en Août 1961
«Nous sommes condamnés à réaliser l'unité ou
à périr.15(*)
La Nation se définit comme une communauté dont
les membres se sentent liés les uns aux autres par un ensemble de
facteurs de nature historique, raciale, linguistique, économique
culturelle et qui les distinguent en même temps des autres
communautés voisines.16(*)
En Afrique et plus particulièrement en Afrique noire,
c'est l'Etat qui s'est imposé comme réalité
première, personne juridique, reconnue par les instances
internationales. C'est par l'Etat que naît la Nation ou du moins qu'elle
s'efforce de naître.
Talcott Person disait « que le drame en Afrique est que,
c'est l'Etat qui préexiste à la Nation. »
C'est pourquoi dès son accession accès au
pouvoir le Président H. Boigny s'est efforcé de supprimer tous
les facteurs de divisions susceptibles de dresser les uns contre les autres les
différents éléments de la population ou d'entretenir entre
eux un mur d'incompréhension nuisible à la formation d'une Nation
par une modernisation des institutions traditionnelles et par une
intégration des immigrants.
Mais en réalité comme dit Jean Ziegler «
deux rationalités concurrentes se développent, se
compénètrent ou s'affrontement dans les germes
républicains ». La première étant la genèse de
l'intersubjectivité nationale et de la seconde rationalité surgit
l'Etat ravissant. Il n'existe pratiquement pas d'Etat-Nation et L.S Senghor, de
reprendre que l'Etat en Afrique plus qu'ailleurs « c'est surtout le moyen
de réaliser la nation. Seule l'action des pouvoirs publics est capable
de faire de nos populations diverses un temple, une communauté où
chaque individu s'identifiera à la Collectivité et celle-ci
à tous ses membres.17(*)
B- L'ivoirité
Le concept a été inventé par
Bédié pour caractériser l'ivorien dans sa vie sociale et
culturelle. L'ivoirité peut être appréhendée sous
trois aspects.
L'ivoirité est d'abord été conçue
comme « une affirmation nationale ». En effet, le pouvoir a
entrepris de se doter d'une nouvelle légitimité en proposant que
la Côte d'Ivoire s'emploie de travail de réflexivité en
déclinant fortement son identité dans le but apparent de
s'autopromouvoir comme une nation mature capable de s'appuyer sur son histoire
et sa diversité culturelle pour affronter les défis de la
modernisation18(*). Ce qui
fut appelé ivoirité ou encore «l'esprit du nouveau contrat
social du Président Henri Konan Bédié », conception
qui sera mise en oeuvre par un cercle d'intellectuels et d'universitaires
à travers la cellule universitaire de recherche et de diffusion des
idées et actions politiques du Président Bédié
(CURDIPHE). Mais ce n'était qu'une définition de surface propre
à masquer de très pernicieux ferments de division, car
l'ivoirité telle qu'elle commença à servir de fondement
légitime au pouvoir de Bédié durant la campagne
électorale de 1995 fut à l'origine de vives contestations du
côté des principaux partis de l'opposition surtout du RDR.
L'ivoirité telle apparue cinq ans plus tard avec l'installation au
pouvoir de Konan Bédié, pouvait être
interprétée comme une habile stratégie pour se
démarquer
résolument des libéralités
d'Houphouët Boigny.
Dans la recherche de légitimation, l'ivoirité
peut-être comprise comme une volonté de s'aligner sur les
politiques menées par l'Europe et notamment la France à
l'égard de l'unification en d'autres termes comme une façon
semble-t-il assez raisonnable pour un Etat moderne de contrôler ses flux
migratoires et définir en toute indépendance les ayant droits
à sa citoyenneté.
L'ivoirité s'affirme comme une
redéfinition pernicieuse de la citoyenneté.
L'on retrouve ici
l'affaire Alassane Ouattara en l'occurrence la détermination
obstinée de Konan Bédié à exclure le leader du RDR
de la compétition électorale au motif qu'il serait
burkinabé. Le Président ivoirien fait voter dès 1995,
à l'Assemblée Nationale une loi obligeant tout candidat à
la magistrature suprême à fournir la preuve qu'il était
ivoirien de sang à savoir que ses deux parents étaient
effectivement nés en Côte d'Ivoire. L'ivoirité devient
alors « une missile anti Ouattara19(*). Les gens du Nord se trouvent ainsi assignés
à une loi draconienne, à une moindre citoyenneté. Ces
considérations visaient à diviser arbitrairement les gens du
Nord, à ceux du Sud qui les désignaient comme des Dioulas
ressortissants des régions soudaniennes qu'ils fussent ivoiriens,
maliens voire burkinabés. Ainsi d'une volonté d'affirmation
nationale propre à mettre de l'ordre dans la citoyenneté,
l'ivoirité dès lors s'érigea en loi, en
ethno-nationalisme.
C'est sous cette forme que l'on retrouve plus largement une
telle notion sous l'aspect d'une création idéologique
émanant de Bédié devenu auteur à travers son
ouvrage « les chemins de ma vie» et d'un cercle d'intellectuels et
d'universitaires qui considèrent en effet que le bon ancrage de
l'voirité est celui d'un monde socio-culturel revêtu d'un
caractère d'exemplarité. Il s'agissait du monde Akan et plus
particulièrement de Baoulé implantés au Sud ivorien dans
ses parties orientales et centrales dont étaient originaires
Bédié et ses thuriféraires. Des idéologues
voulurent souligner « l'harmonieux» équilibre entre «gens
du pouvoir » et «gens des terres », ce que le Président
ivoirien n'hésitera
pas d'appeler une «aristocratie »
et « une plèbe ».
Les différents facteurs ont influencé l'action
des différents protagonistes de la crise.
CHAPITRE II : LES ACTEURS
DE LA CRISE
L'Etat de guerre de civile qui, depuis 1e19 Septembre mine le
tissu social ivoirien et saigne l'économie de ce que fut le pays phare
de l'Afrique de l'Ouest francophone trouve son fondement dans l'action de ses
acteurs. Par acteurs, il faut entendre les différents protagonistes dont
.le principal objectif reste le pouvoir. Car si pour les uns c'est la lutte
pour la conquête du pouvoir, pour les autres c'est son maintien.
C'est pourquoi, il est nécessaire de distinguer les
loyalistes d'une part, les opposants et les mouvements rebelles d'autres parts.
SECT I : LE CAMP DES
LOYALISTES
Par « loyalistes», il faut entendre ceux qui
légalement sont investis, autrement dit, ceux qui exercent la
légalité constitution elle et leur proche entourage.
Par I : La famille
présidentielle.
Il faut distinguer Président Laurent Gbagbo investi au
suffrage universel et son épouse qui joue un rôle non moins
important.
A- Le Président
Laurent Gbagbo
Laurent Koudou Gbagbo est né le 31 mai 1945
dans le village de Marna, près de Gagnoa (centre ouest). Il a
fréquenté le petit séminaire de Gagnao où on lui
enseigne le latin et le grec. Une fois son baccalauréat obtenu en 1965
au Lycée Classique d'Abidjan, il s'oriente vers une licence d'histoire
qu'il achève à l'université d'Abidjan. Il obtient une
maîtrise d'histoire à l'université Paris Sorbonne. En 1969,
un affrontement éclate avec le PDCI entraînant l'arrestation de
nombreux étudiants parmi lesquels Laurent Gbagbo. En 1970 jusqu' en mars
1971, il enseigne l'histoire et la géographie au lycée classique
d'Abidjan. Le 31 mars 1971, Laurent Gbagbo est amené aux fins de «
redressement» au camp militaire de Bouaké, ensuite de
Séguela pour y. effectuer un service militaire.
Libéré
en janvier, après une période d'accalmie en 1978, l'agitation
scolaire et
universitaire reprend. Elle aboutit à la crise de
1981-1982 qui met en première ligne Laurent Gbagbo qui dirigeait le
SYNARES (Syndicat Autonome
d'Enseignants pour le Supérieur). En
1982, il décide de partir en exil. Ce n'est
qu'en 1988 qu'il prend
la décision du retour plus précisément le 31 Septembre
1988. Le premier congrès clandestin du FPI se tint en 1990. Avec
l'avènement du multipartisme en 1990, contre l'avis de tous, il se
présente aux élections et obtient 18, 36 % des suffrages, 9
députés et 6 maires aux élections législatives et
municipales. Lorsque Houphouët meurt en décembre 1993, le F.P.I et
les autres
observent le deuil national dans le calme et la dignité.
En 1993, il fera cavalier
seul en boycottant les élections.
Après s'être détaché du RDR avec qui il forma une
coalition au sein de l'opposition dans le front républicain, il
s'opposera aux manipulations électorales de Robert Guei en octobre 2000.
Elu avec un fort taux d'obtention (62%), suite aux pressions internationales,
un forum de réconciliation nationale se tint d'octobre à
décembre 2001 dirigé par
Seydou Elimane Diarra, Premier
ministre d'alors de Robert Gueï. Le Forum réunit les
différents protagonistes à savoir Robert Gueï, Alassane
Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. A la suite de ce
forum, pour montrer un désir d'apaisement, un certificat de
nationalité fut délivré à Alassane Ouattara et un
gouvernement d'ouverture était mis en place. Mais la Constitution ne fut
point révisée. Gbabgo arrivé au pouvoir, avait
remplacé le général Chef d'Etat major des Armées
Dabakhaté, un officier du nord par Mathias Doué et
démobilisait les troupes Les mesures concrètes issues du Forum
n'avaient pas été appliquées. Et Seydou Diarra de
vérifier ses craintes confiait dès septembre 2001 à «
Jeune Afrique l'intelligent » à la veille de l'ouverture du Forum
« si le Forum échoue, s'il ne débouche pas sur un
véritable pacte républicain alors j'aurai peur pour mon
pays »20(*)
Propos prémonitoires qui ont débouché à la
mutinerie.
Mais dit-on en Afrique que « Derrière chaque grand
homme, il y a l'ombre d'une femme»
B- Simone Ehivet Gbagbo :
une militante dans l'âme
Depuis le début de la guerre, Simone Gbagbo est en
première ligne. Militante dans l'âme, la première dame
galvanise les foules sans s'éloigner des hautes sphères du
pouvoir où elle joue un rôle clé auprès du chef de
l'Etat. Depuis le début de la guerre, la première dame va d'une
caserne à l'autre pour porter la bonne parole et le réconfort aux
familles de soldats et des gendarmes massacrés au Nord. Elle organise
des séances de prières collectives pour le retour de la paix,
fait souvent entendre sa voix à la radio comme à la
télévision.
Simone Gbagbo est avant tout une militante, une
habituée des pugilats politiques, une amazone. Députée
d'Abobo, une agglomération de la banlieue d'Abidjan, Présidente
du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien, elle s'occupe
également des relations privées du chef de l'Etat. Elle
déclarait à la mi janvier « si nos hommes vont à
Paris pour prendre des décisions qui ne nous 0.satisfont pas, à
leur retour, ils ne retrouveront pas dans leurs lits »21(*) lors d'un rassemblement des
jeunes patriotes déclaration qui a porté par le rejet, par
l'armée et plusieurs grandes formations politiques d'attribuer au sein
du futur gouvernement de réconciliation nationale les portefeuilles de
la défense et de la sécurité aux insurgés du
Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI). Simone Ehivet Gbogbo a
connu très tôt les aléas de la vie et la souffrance. Elle
perd sa mère en venant au monde, le 20 juin 1949. En 1973
«ADELE» nom de code utilisé en filtrant avec le Marxisme,
épouse Laurent GBAGBO en seconde noce .De 1982 à1988, lorsque
Laurent Gbabgo était déclare persona non grata, elle
hérite du poste de Secrétaire Générale Adjointe du
F.P.I , alors qu'elle était secrétaire générale
adjointe du syndicat National de la Recherche et de l'Enseignement (SYNARES).
Elle poursuit une carrière d'universitaire à l'institut de
linguiste ; tout en étant tour à tour la secrétaire
chargée des finances et de la formation politique (1988-1990), puis
secrétaire générale adjointe chargée de la
formation politique.
En croire aujourd'hui, de l'avis générale,
Simone Gbabgo est à elle seule, une « République
autonome », qui a su batailler ferme pour se hisser à la place qui
est la sienne aujourd'hui à 54 ans.
C'est à cette famille présidentielle, qui est
relié le mouvement « des jeunes patriotes » le mouvement est
dirigé par Charles Blé Goudé considéré comme
un des plus fervents partisans du régime de Laurent Gbagbo.
Par II : Le proche entourage
présidentiel
Parmi les loyalistes, il est nécessaire de mettre
l'accent sur deux personnages savoir le Général Mathias
Doué et Laurent Donan Fologo.
A- Mathias Doué
Lorsque la crise se déclenchait, on le donnait pour
mort après que des éléments armés eurent pris
certains points stratégiques d'Abidjan. Après s'être
soustrait de son domicile, il réorganisa les troupes afin qu'Abidjan ne
subisse le sort de Bouaké et de Korogho.
A 57 ans c'est un officier formé en France
entre autres, à l'école de Saint Cyr-Goetquidan, à l'Ecole
d'Application des Blindés et de la Cavalerie, à Sammur, mais
aussi en Allemagne dans le Banwehr. Il fut nommé par le
Général Robert Guei au lendemain du coup d'Etat de
Décembre 1999. Ministre des sports, Instructeur militaire à ses
débuts, au cours de sa carrière, il a été
commandant du premier bataillon blindé et du premier bataillon
d'infanterie d'Akouédo puis juge d'instruction. Il a été
aussi attaché d'ambassade au Japon, puis en république.
Populaire de chine. Il parle couramment l'Allemand et
l'Anglais et a occupé plusieurs postes au Ministère de la
Défense.
B- Laurent Donan Fologo
Il fut longtemps le secrétaire
Général, plusieurs fois ministre sous Houphouët et
Bédié. Sénoufo de Péguekaha dans le nord, Donan
Fologo paraissait devoir ne `plus jamais se remettre du putsch de 1999.
Arrêté puis incarcéré au camp militaire Akouedo, il
sera relâché après avoir fait acte d'allégeance au
Général Gueï. A la fuite de Bédié, il assura
l'intérim du Parti (PDCI/RDA).
Après la défait
électorale de Gueï, il se rapproche de Gbagbo qui par son
intermédiaire s'efforce de rallier à sa cause les militants du
Conseil économique et social. Après avoir été battu
pour la direction du parti, au Congrès d'Avril 2002, il a dirigé
la délégation gouvernementale aux négociations de
Lomé.
Aux loyalistes, on met en face les opposants au régime
de Gbagbo.
SECT II : LES OPPOSANTS AU
RÉGIME DE GBAGBO
Il faut distinguer dans cette section les héritiers du
Président Houphouët et les mouvements rebelles.
Les héritiers de Houphouët se réclament
tous de son idéologie mais se caractérisent différemment
dans leurs démarches
Par I : Les héritiers de
la pensée d'Houphouët
On fait ici le départ entre « fils spirituels
» à qui il est imputé d'être en
grande partie à l'origine de la crise, et Robert Gueï qui mit.fin
à la première république.
A- Les « fils
spirituels d'Houphouët
Par « fils spirituels », il faut entendre Alassane
Ouattara et Henri Konan Bédié
Natif de Dimbokro au centre de
la côte d'Ivoire, Ouattara est nommé le 07 novembre 1990, Premier
Ministre pour conduire le redressement. Présenté par le
régime d'Abidjan comme le commanditaire de l'insurrection de septembre,
Alassane Ouattara, 60 ans fait figue de principal opposant politique au
Président Laurent Gbagbo Musulman, cet ancien directeur adjoint du Fonds
Monétaire International (FMI) est entré en politique en 1990
à la demande du Président Houphouët. Depuis près de
dix ans, la vie politique est dominée par la question de son
«ivoirité ».
Au cours de sa carrière de haut fonctionnaire, il a
occupé en effet plusieurs postes au titre de la haute Volta, actuel
Burkina Faso. Les Présidents successifs invoquant sa nationalité
douteuse, l'ont empêché de se présenter aux
élections de 1995 et de 2000. Pour assurer son accession au pouvoir, il
a fondé le Rassemblement des Républicains (RDR), le principal
parti d'opposition.
D'abord réfugié à l'ambassade de
France lors des affrontements de septembre, le Dioula cristallise sur son nom
les clivages religieux et ethniques du pays.
Henri Konan
Bédié quant à lui arrivé au pouvoir après 13
ans de dauphinat, s'est enfermé dans une suicidaire politique
d'ivoirité pour contrer son principal rival Alassane Ouattara. Le
concept a été monté par un groupe d'intellectuel et
d'experts pour définir l'ivoirité Akan. Son obsession anti
-Ouattara devient presque pathologique : le 28 septembre 1999, Alassane
Ouattara est poursuivi pour usage de faux. La surenchère ivoiritaire va
conduire à des excès à tous les stades de la
société ivoirienne. En 1994, il promulgue un nouveau code
électoral, selon lequel pour être éligible, tout candidat
à la présidence « doit être ivoirien, né de
parents ivoiriens eux-mêmes ». Un pan entier de la
société ivoirienne se retrouve «désivoirisé
». Aujourd'hui, si la situation n'était pas confuse, voire
légitimiste, Henri' Konan Bédié aurait probablement pu
trouver matière à satisfaction dans la crise qui secoue le
régime de Gbagbo car il prendrait ainsi sa revanche sur le putsch de
1999. Ce qui regroupe ces deux hommes c'est qu'à un moment donné
ils se sont tous réclamés de la pensée du
« vieux » mais l'ont peut- être vulgarisée
différemment.
A la lumière des mécontentements du
régime Bédié, Gueï s'infiltre et le régime de
Bédié tombe dans l'indifférence générale.
B- Robert Guei
Propulsé à la tête de l'Etat ivoirien, un
soir de Noël 1999, le Général Robert Gueï est
trouvé sans vie dans une rue d'Abidjan dans la journée du 19
septembre. Militaire de carrière, originaire de l'ouest, il est promu
chef major de l'armée en 1990. En 1995, il refuse de réprimer une
manifestation de l'opposition. Il est demis de son poste et nommé
d'abord ministre du service civique, ensuite celui de la jeunesse puis mis
à la retraite anticipée. Une villégiature où il
sera tiré par de jeunes mutins. Au début, le
Général est animé de bonnes intentions, il veut se battre
contre des « lois confectionnées sur mesure contre un seul homme
» et veut mettre fin à la «néfaste politique de
l'ivoirité ». Mais il finit par être dévoré par
sa propre ambition et celle de son entourage. Il crée une commission
consultative constitutionnelle et électorale qui ne tarde pas de
reprendre la thèse de l'ivoirité laquelle on ajoute la notion de
prévalence. Le texte est validé par le référendum
du 27 septembre 2000. Gueï tenta même de se faire investir par le
PDCI -RDR. Pour se prémunir de toute surprise, le PDCI et le RDR sont
écarté de la course électorale profitant ainsi à
Laurent Gbagbo.
Gueï pensant être élu, les urnes
décident autrement et c'est dans la confusion qu'il s'enfuit d'Abidjan
pour se réfugier dans la forêt de Guessoussou. Le
Général tournera le dos à Abidjan où finalement il
ne reviendra que pour mourir en civil.
Par II : Les Mouvements
Rebelles « Forces Nouvelles »
Il s'agit respectivement du Mouvement Patriotique de
Côte d'Ivoire (MPCI), premier mouvement, le Mouvement pour le Justice et
la Paix (MJP) et le Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO).
A- Le Mouvement Patriotique
de Côte d'Ivoire
C'est le premier mouvement rebelle, il a été
l'origine de la mutinerie du 19 septembre. Il est constitué d'une
branche politique et d'une branche militaire.
La branche politique est
dirigée par un Secrétaire Général en la personne de
Guillaume Kigbafari Soro. Soro est né le 08 Mai 1972 à
Ferkessedougou dans le
Nord, il est Sénéfou. Guillaume Soro
est l'une des têtes pensantes du
mouvement. De 1995 à
1998, il a été le secrétaire général de
la Fédération des
Etudiants et Scolaires de Côte
d'Ivoire. Il appartient à la génération des
conjoncturés », la génération du chômage, de la
crise économique, de l'ajustement structurel et des budgets
compressés. Il s'est présenté aux élections
législatives de Décembre comme collister d'Henriette
Diabaté. A Accra comme à Marcoùssis et à Dakar, il
a joué un grand rôle. Il y a aussi Dacoury Tabley qui a
quitté le FPI en 1999. A côté des civils, il y a les
militaires comme Tuo Fozie est le premier mutin à prendre la parole. Ce
militaire de 38 ans est originaire d'odiené dans l'extrême
Nord-Ouest. Porte parole de la zone militaire, c'est avec lui u nom de la
rébellion que Cheikh Tidiane Gadio a signé l'accord de
«cessation des hostilités ». Michel Gueu quant à lui
est le premier officier à s'être montré publiquement. Son
destin est lié à celui de Robert Gueï car étant
originaires de l'extrême ouest. Il a été membre de la
délégation de Lomé et de Marcoussis.
B- Les autres mouvements
rebelles
Il s'agit du Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest et
Mouvement pour le Justice et la Paix.
Le MPIGO est apparu en novembre. Tout comme le MPCI, il
réclame le départ du Président Gbagbo, mais il
prétend aussi venger l'ex-président Robert Gueï,
assassiné au lendemain de la mutinerie du 19 septembre. Le sergent
Félix Doh est le chef du MPIGO. Son véritable nom est Ndri
Guessan. Il trouva la mort lors d'une attaque de mercenaires à la
frontière libérienne. Le numéro deux n'est autre que le
métis italo-ivoirien Roger Banchi, un dandy fortuné.
Le MJP est apparu au même temps que le MPIGO en
revendiquant la prise de Mam, la capitale de la région des «dix
huit montagnes ».Limité au grand ouest du pays, le MJP revendique
250 combattants dont 50 dozas, chasseurs traditionnels. Le MJP est
dirigé par le commandant Gaspard Deli. Ces deux mouvements sont
accusés d'abriter dans leurs rangs des mercenaires libériens.
Longtemps considérée comme un modèle de
stabilité en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est dans la
tournante. Le concept d'ivoirité lancée par Henri Konan
Bédié avait fini de diviser le pays en deux : ceux du sud
considérés comme citoyen de pure souche, et ceux du nord
réduits à une moindre citoyenneté.
Avec la mutinerie
de Septembre 2002 déclenchée par une partie de l'armée, le
fallacieux concept d'ivoirité est revenu sur Laurent Gbogbo. Mais de
telles tensions n'auraient peut être jamais vu le jour sans les
difficultés structurelles auxquelles le pays devait faire face lors du
passage à la transition démocratique.
Pour sortir de la crise
différentes médiations sont intervenue,
DEUXIÈME PARTIE :
LES TENTATIVES DE SORTIE DE CRISE
Depuis le 19 septembre 2002, «l'ancienne vitrine de
l'Afrique de francophone » est plongée dans la tourmente.
Circonscrite le pays, la crise se joue à l'échelle
régionale. C'est pourquoi différentes médiations se sont
opérées. Elles se sont faites au plan sous régional et
régional. D'abord individuelle avec la médiation
sénégalaise, puis celle de Bamako, elles e se sont poursuivies
dans le cadre de la CEDEAO avec la création du groupe de contact. Enfin
au plan régional avec l'adoption d'une résolution de l'organe de
gestion et de règlement des conflits de l'Union Africaine.
Après avoir annoncé une «nouvelle politique
africaine22(*) interdisant
tout intervention militaire, la France a renforcé sa présence
militaire en Côte d'ivoire avec l'opération Licorne23(*). Après une position
attentiste, un huis clos s'est tenu à Marcoussis en France avec la
participation de tous les protagonistes. De cette table ronde est né un
gouvernement de réconciliation. La formation de ce gouvernement s'est
heurtée à des blocages dont le principal est lié à
la distribution de portefeuilles de la défense et de l'intérieur
avant de connaître une nouvelle donne avec le Sommet d'accra. Cependant
la situation reste précaire
CHAP. I : LES
MÉDIATIONS INTERVENUES
Géant aux pieds d'argile, la Côte d'Ivoire comme
d'autres pays limitrophes tels que le Libéria, la sierra Léone et
la Guinée Bissau, est obligée pour sortir de la crise de s'en
remettre à ses voisins. En effet, des médiations individuelles,
puis régionales sont intervenues.
Mais face à ces échecs, une table ronde
internationale sur la crise s'est tenue à Marcoussis.
SECT I : LES
MÉDIATIONS RÉGIONALES
Il faut distinguer les médiations individuelles, des
médiations faites dans un cadre institutionnel.
Par I: Les médiations
individuelles
Il s'agit principalement de la médiation
sénégalaise par le biais de son ministre des affaires
étrangères et de celle qui s'est tenue à Bamako sous
l'auspice du Président malien Amadou Toumani Touré.
A- La médiation
sénégalaise
Ecarté du groupe de contact, le Président Wade
avait décidé personnellement de s'impliquer pour la
résolution du conflit. Le Président Abdoulaye Wade
Président d'alors en exercice de la CEDEAO avait
dépêché son ministre des affaires étrangères
sur place.
Après moult discussions avec les parties en conflits,
ce dernier accompagné du secrétaire exécutif de la CEDEAO
Mohamed Ibn Ghabas réussit à obtenir une cessation des
hostilités le 17 octobre 2002, là où le groupe de contact
sous la direction du Togo n'a pas réussi. Cette action s'est
justifiée selon la partie sénégalaise par la
présidence en exercice de l'organisation sous régionale et la
présence de quelque 700 milles compatriotes résidant en
Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le Président Sénégalais
avant de s'impliquer directement a pris la peine de prendre possession du
rapport du groupe de contact.
Le cessez- le feu s'est avéré précaire
car la crise plonge ses racines dans une discrimination ethno régionale
profonde.
B- La réconciliation
de Bamako
Le 03 Décembre 2002, sous l'égide du
Président Malien Amadou Toumani Touré, s'est tenu à Bamako
un «oral de réconciliation » entre Laurent Gbagbo et Blaise
Compaoré. A la suite de cette intervention, un communiqué final
paraphé par les trois hommes a été adopté. De ce
communiqué final ressort différentes résolutions à
savoir la prise de mesures appropriées pour le renforcement de la
cessation des hostilités, notamment par l'accélération du
déploiement de la force de contrôle de la CEDEAO, exhorter les
parties à favoriser le retour de l'administration de l'Etat sur toute
l'étendue de la Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais,
engager une réflexion approfondie pour des réformes politiques et
institutionnelles.
De ce fait, Laurent Gbagbo se serait engagé à
assurer la sécurité des ressortissants étrangers et leurs
biens en Côte d'Ivoire et procéder à une ouverture
politique et Biaise Compaoré d'user de son influence pour ramener les
rebelles qui occupent la frange Nord de la Côte d'Ivoire à plus de
retenue.
Mais il revenait aussi à l'organisation
sous-régionale et régionale de trouver une sortie de crise.
Paragraphe II : Les
médiations institutionnelles
Elles se sont opérées dans le cadre de CEDEAO
avec la création du groupe de contact, mais aussi par le biais de
l'organe de gestion et de règlement des conflits de l'Union Africaine.
Mais ces tentatives sont restées timides.
A. La création du
groupe de contact
Le 29 Septembre, s'est tenu à Accra un sommet de la
communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest
convoqué par le président en exercice le Sénégalais
Abdoulaye Wade.
Un seul point était à l'ordre du jour : La
Côte d'Ivoire. Ce sommet a été rehaussé par la
présence du président en exercice de l'Union Africaine le
président Sud-Africain Thabo Mbeki et d'Amra Essy président
intérimaire de la commission de l'Union Africaine. A l'issue de ce
sommet, un groupe de contact a été mis en place.
Il est composé des présidents John Kuffor du
Ghana, Amadou Toumani Touré du Mali, Mamadou Tandja du Niger, Koumba
Yala de la Guinée Bissau et de Gnassimbé Eyadéa du Togo.
Le travail du groupe se fera en liaison avec le représentant
spécial de l'union Africaine en la personne de l'ancien président
de Sao-Tomé é Principé Miguel Travaodo.
Après l'adoption de la suggestion, une convocation
urgente de la commission Défense et Sécurité est
lancée pour l'entrée en jeu de 1'ECOMOG en cas d'échec de
la médiation. La France a assuré les chefs d'Etat de son soutien.
Les USA par le biais du département d'Etat s'implique dans la tentative
de mettre fin à la crise en évaluant les besoins de la CEDEAO et
l'apport militaire. Le 23 Octobre, Gnassimbé Eyadérna est
nommé président du groupe de contact.
Par ailleurs,
Convoqué en marge du sommet extraordinaire de l'Union Africaine à
Addis-Abeba le 3 Février 2003, l'organe central, mécanisme de
gestion et de règlement des conflits, s'est penché sur la crise
ivoirienne. Dans s on communiqué final, l'organe central s'est
félicité de la signature de l'accord et condamne les violations
des Droits de l'homme.
B- L'échec du sommet
de Lomé
C'est à la présidence de Lomé II le 30
Octobre 2002, que se sont ouverts les pourparlers entre la
délégation gouvernementale dirigée par Laurent Donan
Fologo et les mutins, sous les auspices du président Togolais
Gnassimbé Eyadéma.
La délégation gouvernementale pose comme
préalable aux négociations le désarmement des
insurgés. Les mutins par la voix de leur secrétaire
général Guillaume Soro, déclarait qu'il n'y aurait point
de désarmement pendant les négociations.
L'une des principales revendications des rebelles est
l'organisation des élections dans «les six mois à
venir». Dans un mémorandum rendu public, les rebelles
déclarent .que si la CEDEAO, la France, les Etats-Unis et l'Union
Européenne donnent la garantie ferme que des élections seront
organisées dans les six mois à venir avec la participation de
tous les candidats et de tous les ivoiriens, nous déposeront les
armes»24(*). D'une
mutinerie corporatiste, leur combat a été transformé en un
combat politique global. Les rebelles ont présenté un document de
14 pages mis sur internet. Ils revendiquent entre autres la fin de la
discrimination dans l'armée, l'amélioration de la vie des FANCI,
la création d'une commission d'enquête pour élucider la
mort de trois personnalités le Général Robert Gueï
tué le 19 Septembre, l'ancien ministre Balla Keita le 2 Août
à Ouagadougou et le ministre de l'intérieur Emile Boga Doudou
tué à son domicile le 19 Septembre à Abidjan.
De ce sommet seul le volet corporatiste des revendications de
la rébellion a été satisfait. Les autres plus politiques,
comme le départ de Gbagbo du pouvoir, la convocation de nouvelles
élections et une modification de la constitution n'ont trouvé de
solution, la délégation gouvernementale dirigée par
Laurent Donan Fologo refusant de les prendre en considération.
Après les blocages des médiations individuelles
et régionales, la France par le biais de son ministre des affaires
étrangères après la signature d'un cessez-le-feu le 3 et 4
Janvier, convoque la tenue d'une table ronde à Paris le 15 Janvier.
SECTION II : LES
MÉDIATIONS INTERNATIONALES
Après avoir renoncé à sa politique de
non-intervention (depuis le fiasco politico-militaire au Rwanda en 1994), la
France a envoyé 2500 soldats par le biais de l'opération
Licorne», pour sécuriser ses 25 000 ressortissants mais aussi
l'intérêt de ses entreprises. Elle propose maintenant une solution
politique en réunissant les différents protagonistes à
Paris afin de faire renaître l'espoir d'un retour de la paix dans le
pays.
Paragraphe I : La table ronde
de Linas-Marcoussis
Du 15 au 24 Janvier 2003, s'est tenue à Marcousssis une
table ronde sur la côte d'Ivoire, dont les résultats ont
été avalisés par la conférence des chefs d'Etats
réunis à Kieber le 25 et 26 Janvier 2003.
De cette table est né un processus de normalisation et
de réconciliation visant une réforme juridique.
A. La naissance d'un
processus de normalisation et de réconciliation
Après dix jours de conclave à
Linas-Marcoussis, les acteurs de la crise ivoirienne ont tous
apposé leur signature au bas d'un accord. Cette table ronde regroupait
les différentes sensibilités de la crise. Le MPCI est
représenté par Louis Dacoury-Tabley, Guillaume Soro, le FPI par
Oulaye Hubert, Pascal Affi Nguessan, le PIT par Francis Wodie, le RDR par
Alassane Ouattara et Henriette Diabaté, le MFA par Innocent Koberra
Anaky, le MPIGO par Félix Doh, le MJP par Gaspard Deli, le PCI par
Alassane S. Ndiaye, l'UAPCI par Paul Akotoyao, Théodore Mel Eg pour
1'UDCY, Alphonse Djédjé Mady et Henri K. Bédié pour
le PDCI.
Il y avait la présence des personnalités
qualifiées telles que Kéba Mbaye, Seydou Diarra, Mohamed Ibn
Chabbas et Cheikh T. Gadio de la CEDEAO, Miguel Travaodo, Ahmed Ouid Abdallah
de l'ONU. Les travaux étaient dirigés par Pierre Mazeaud.
Au terme de ces travaux, un accord de trois pages ainsi qu'un
programme de gouvernement de 10 pages ont été soumis au conseil
de sécurité des Nations Unies. L'accord réaffirme la
nécessité de préserver l'intégrité de la
Côte d'Ivoire, de respecter les institutions et de restaurer
l'autorité de l'Etat, l'accession au pouvoir par les urnes de
façon démocratique. Le chef de l'Etat restera en place jusqu'en
Octobre 2005, devant partager le pouvoir avec un Premier ministre de
consensus. Le gouvernement doit être composé de
représentants de chacune des délégations ivoiriennes ayant
participé à la table ronde avec attribution équitable des
ministères. Parmi les priorités du gouvernement, il y a la
restructuration des forces de défense et de sécurité,
l'amnistie de tous les militaires détenus, s'assurer aussi qu'aucun
mercenaire ne séjourne sur le territoire national.
Un comité international basé Abidjan est
chargé de veiller à l'application de cet accord, est
composé des représentants de l'Union Européenne, de la
commission de l'Union Africaine, du secrétariat exécutif de la
CEDEAO, de l'ONU, de l'organisation internationale de la francophonie, de la
Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, du G8 regroupant
les pays les plus riches.
L'accord issu de cette table ronde a
été avalisé par la conférence des chefs d'Etat
à Kieber.
C'est ainsi qu'est nommé un Premier ministre de
consensus en la personne de Seydou Elimane Diarra, un musulman né le 23
Novembre 1933 à Katiola. Les ministères de la défense et
de l'intérieur ont été attribués au MPCI, annonce
faite publiquement par Guillaume Soro.
Ont pris part à cette conférence le
sénégalais Abdoulaye Wade, l'Ivoirien
Laurent Gbagbo, le
Sud-africain Thabo Mbeki, président en exercice de l'Union
Africaine, le Français Jacques Chirac, le secrétaire
général de l'ONU Koffi
Anan.
Ces travaux ont été sanctionnés par la
résolution 1464 des Nations-Unies le 4 Février qui condamne les
violations des droits de l'homme, et appelle d'autre part les forces politiques
ivoiriennes à travailler avec le président et le premier ministre
à la mise en place d'un gouvernement stable.
Durant les discussions de Marcoussis, les différents
aspects du contentieux politique qui ont débouché le 19 Septembre
à une insurrection militaire, puis à une partition de Côte
d'Ivoire ont été longuement débattus.
Sur le plan militaire, il a été
déployé une force d'interposition sous l'égide du
général Fali, dénommée ECOFORCE, financée
par la France et les Etats -Unis.
B- Un accord de
réformes juridiques
La Côte d'ivoire va au devant d'un toilettage en
profondeur avec les accords de Linas-Marcoussis. Nationalité,
identité, statut des étrangers, code électoral, conditions
d'éligibilité à la république, régime du
foncier rural, droits et libertés de la personne, n'ont
été passés sous silence.
Le premier point du lifting institutionnel touche la
citoyenneté. La question de savoir qui est ivoirien et qui ne l'est pas
a été tranchée par le biais du dosage entre le jus-soli et
le jus-sanguini contenu dans la loi 61-415 du 14 décembre 1961 portant
code la nationalité, modifié par la loi 72-852 du 21
Décembre 1972. Qualifié de «texte libéral et bien
rédigé» par les différentes parties, la loi de 1961
va être largement retouchée en ajoutant par exemple à
l'article 12 que» l'étranger qui épouse une femme ivoirienne
acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la
célébration du mariage». Quant à la naturalisation,
elle doit faire l'objet dans les six mois, d'un projet de loi du gouvernement
de transition.
L'identification des personnes, autre clef de
dénonciation d'abus, dont l'option prise par le pouvoir d'identifier les
personnes à partir de leur village d'origine avait arbitrairement
laissé sur touche des milliers de personnes du fait de leur nom à
consonance musulmane. Sur cette question, le processus d'identification en
cours doit être arrêté en attendant la prise des
décrets d'application de la loi du 3 janvier 2002 relative à
l'identification des personnes et au séjour des, étrangers, et la
création d'une commission nationale d'identification dirigée par
un magistrat et composée de représentants de partis politiques
chargés de superviser l'office national d'identification.
Concernant les étrangers, l'accord recommande la
suppression immédiate de la carte de séjour pour les
ressortissants des pays membres de la CEDEAO et la cessation de toutes les
formes d'atteintes aux biens des étrangers. Concernant le foncier rural,
la loi 98-750 du 23 Décembre 1998 va être modifiée. Elle
était à l'origine de l'expropriation de 20 000 petits exploitants
installés à Tabou au sud ouest en 1999. Le litigieux article 26
va être expurgé de sa disposition qui réserve la
propriété aux seuls ivoiriens et exige des héritiers dans
un délai de 3 ans, qu'ils cèdent leur domine aux nationaux ou
qu'ils rétrocèdent à l'Etat.
Mais le conflit ivoirien
persistera tant que le désaccord autour des conditions
d'accession
à la magistrature suprême ne sera pas levé. Là,
entre en jeu le fameux article 35 en vertu duquel le leader du RDR
Alassane Ouattara a été interdit de candidature en Octobre 2000.
La nouvelle formulation du texte arrêtée se limite à dire
que le postulant à la fonction présidentielle «doit
être exclusivement de nationalité ivoirienne né de
père ou de mère ivoirien d'origine» et non plus de
«père et de mère ivoiriens d'origine». Qu'il se soit
prévalu d'une autre nationalité importe peu. Tous ces changements
annoncés sont toujours à l'état de projets de
propositions.
Afin de rendre consensuel le futur gouvernement, le premier
ministre Seydou
Diarra garderait lui-même le portefeuille de la
défense tout en nommant un
membre du MPCI ministre
délégué. Dans la foulée de l'accord inter-ivoirien
de Marcoussis, au cours d'une conférence des chefs d'Etat africains, le
président de
la commission européenne Romano Prodi a brandi
une enveloppe globale de 400 millions d'euros sur 5 ans dont 150
millions à très court terme. L'aide demeure toutefois soumise
à un strict respect des accords politiques.
Cependant, la mise en
oeuvre de ces résolutions reste difficiles car celles-ci
se heurtent
à des obstacles.
Paragraphe II: Les obstacles
à l'application des accords de Marcoussis et de Kléber
Les accords de Marcoussis et de Kiéber comportent de
nombreux points positifs voire salutaires. Cependant, ils contiennent de
nombreux facteurs de blocage à savoir particulièrement
l'attribution des ministères de la défense et de
l'intérieur aux mouvements rebelles. Ce point de discorde a
été à l'origine de nombreuses manifestations
anti-françaises entraînant du coup la naissance d'un nationalisme.
A- Les blocages relatifs
à l'attribution des portefeuilles de la défense et de
l'intérieur
En annonçant publiquement la répartition des
portefeuilles ministériels du gouvernement de réconciliation
nationale et plus particulièrement ceux de la défense et de
l'intérieur au MPCI, Guillaume Soro secrétaire
général dudit mouvement avait mis le feu aux poudres. En effet,
aussitôt est apparue une ligne d'affrontement entre les signataires de
l'accord en fonction d'une géographie d'un côté le MPCI et
le RDR qui s'adjugent la meilleure part avec les ministères de la
défense, de l'intérieur, de la justice et de l'agriculture ; et
de l'autre côté le FPI et le PDCI.
Une telle répartition ne saurait être
acceptée par «l'aile dure» de l'entourage présidentiel.
Les rebelles de leur part refusent de renégocier la composition du
gouvernement. Le président Gbagbo affirmait qu'il n'avait pas
gagné la guerre, pour dire qu'il devait par conséquent rester
plus humble tel. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que la rébellion
forte de trois mouvements unis (MPIGO, MJP, MPCI) dispose d'un armement
beaucoup plus important que celui détenu par l'armée
régulière. Preuve, il a fallu l'intervention de l'armée
française pour empêcher les rebelles d'atteindre leur objectif qui
était de marcher sur Abidjan.
Pendant ce temps, le 27 Janvier 2003,
l'Etat-major ivoirien était réuni autour du ministre de la
défense Bertin Kadet pour examiner les suites de l'accord dont certains
points se sont révélés de nature à humilier les
forces de sécurité et de la défense. Il s'agit
précisément du paragraphe relatif au désarmement des
forces en présence à savoir les forces nationales et les
mouvements rebelles. Que cherche Laurent Gbagbo en refusant de respecter la
lettre et l'esprit de Marcoussis ?
Selon le ministre des affaires étrangères de la
France, Dominique De Villepin l'octroi aux rebelles des portefeuilles de la
défense et de l'intérieur est tout à fait logique. Dans la
mesure où, il serait plus facile dans ce cas de figure de
désarmer la rébellion. Et le désarmement constitue
à ne pas en douter une étape importante dans le processus de
retour à une situation normale au pays d'Houphouët Boigny. Ainsi
donc, ce refus à peine voilé dans l'application des accords de
Marcoussis par Laurent Gbagbo parlant dans son dernier discours de respecter
l'esprit des accords est donc incompréhensible. L'échec de la
rencontre d'Accra entre Seydou Diarra le nouveau premier ministre et les
rebelles Itou. Ceci pourrait peut-être expliquer l'ultimatum que les
rebelles avaient fixé à Laurent Gbagbo le 24 Janvier, mais qu'ils
n'ont pas finalement exécuté. Les rebelles avaient attendu la fin
au 22ème Sommet France-Afrique qui s'est tenu du 19 au 21 Février
à Paris. En outre, ils ont en même temps entrepris une offensive
diplomatique dans les capitales de la sous région ouest africaine
où selon eux, lors de leurs différents entretiens avec les chefs
d'Etat, le maître mot était la patience. A présent, il
semble même que c'est la solution politique qui est adoptée du
côté du MPCI si on en croit les déclarations de Guillaume
Soro, le secrétaire Général du plus grand mouvement
rebelle. M. Soro a en effet déclaré : »Nous
considérons qu'aujourd'hui la voie militaire a atteint ses limites, il
faut coûte que coûte trouver une solution politique
négociée »25(*)
Les différents blocages liés à la
nomenclature gouvernementale ont donné naissance à un
nationalisme ivoirien.
B- La Naissance d'un
nationalisme ivoirien
Le rejet des accords par les populations ivoiriennes marque
aujourd'hui le retour d'un nationalisme. En effet, la Côte d'Ivoire est
restée dans les faits un « territoire français d'outre mer
» dans un régime d'indépendance associée avec Paris.
A défaut de détenir directement le pouvoir politique, la France a
contrôlé étroitement la monnaie et l'économie du
pays. L'ivoirien moyen a été longtemps entretenu dans la vision
primaire d'une spoliation de son pays par l'étranger africain.
Cela a justifié ses réactions xénophobes.
C'est pourquoi, les symboles de la France à savoir l'ambassade, le
centre culturel, le collège français Jean Mermoz ont
été les cibles privilégiées. Au delà de ces
symboles, c'est la politique étrangère de la France qui est
désavouée. En effet, la plus part des contrats de ses
sociétés arrivent à terme en 2004. L'idée du
gouvernement Gbagbo de lancer un appel d'offres international pour des
opérations jusque là conclues gré-à-gré
entre les entreprises de l'ex-puissance coloniale avait l'effet d'une bombe. Il
s'agit de rompre avec une politique officielle de corruption
institutionnalisée depuis l'indépendance. L'ancien
Président Henri Konan Bédié avait annoncé le bras
de fer du désengagement dès 1994 (sans consulter Paris) en
rétrocédant de confortables contrats d'exportation de Café
-cacao aux géants américain Cargill et Acher Danich Milland et
une Licence de prospection de pétrole Offshore à Venco
(entraînant un rapprochement avec les intérêts
anglo-saxons).
Avec cette crise la Côte d'Ivoire devient le seul pays
africain où les rassemblements anti-français se traduisent par
une démonstration d'allégeance à l'égard d'une
autre puissance occidentale et Abidjan la seule ville où de milliers de
manifestants réputés proches de la présidence se soient
retrouvés devant l'ambassade américaine pour en acclamer les
occupants et ovationner la bannière étoilée. Les
manifestants dirigés par Charles Blé Goudé et Richard
Dacoury réclament une intervention militaire américaine contre
les Paras français de Port Bouet. Ces manifestations
pro-américaines ne sont en effet que le prolongement spectaculaire d'une
politique de séduction menée par le gouvernement de Laurent
Gbagbo en direction des Etats -Unis.
Arrachés aux forceps à une classe politique mise
sous pression pendant dix jours, hors de la Côte d'Ivoire et dans un huis
clos contrôlé par la France, les accords de Marcoussis ont
plutôt été considérés par le « peuple
ivoirien comme une lutte contre l'étranger» comme un acte de
recolonisation, avalisé par le
«protectorat» défini
dans la résolution 1444 du Conseil de Sécurité de
l'Organisation des Nations Unis.
Face à ces blocages, il urgeait d'établir de
nouvelles conditions d'une paix durable.
CHAPITRE II : LA RECHERCHE
DES CONDITION D'UNE PAIX DURABLE
Pour établir les conditions d'une paix durable, les
différents protagonistes de la crise se sont réunis à
Accra sous l'égide du Président John Kuffuor, Président en
exercice de la CEDEAO. Cependant sur le terrain, la situation demeure
incertaine.
SECT I: LE SOMMET D'ACCRA
Longtemps constitué comme facteur de blocage à
la formation d'un gouvernement de réconciliation, l'attribution des
ministères (défenses et intérieur) a
débouché sur un compromis avec la création du Conseil de
Sécurité entraînant ainsi une nouvelle donne. C'est dans
cette perspective qu'a été dégagée la
nécessité d'une sécurisation complète du territoire
ivoirien.
Par I : La nouvelle donne issue
du sommet d'Accra
Réunis à Accra, les mouvements rebelles et les
entités politiques après avoir attribué deux ministres
clés aux rebelles (administration territoriale et communication)
décident de la création du Conseil National de
Sécurité. Conformément aux accords de Marcoussis, une
délégation de compétence est signée le 10 Mars.
A-- La création du
Conseil National de Sécurité
Convoqué sous l'égide du Président John
Kuffour du Ghana, Président en exercice de la CEDEAO, cet organe a
été créé leO7Mars 2003 d'un commun accord. Il est
chargé de désigner les deux personnalités appelées
à assumer les fonctions de Ministre de la défense et de la
sécurité dans la future équipe gouvernementale. En son
sein, outre le Président de la République et son premier
ministre, on retrouve le Général Mathias Doué, chef d'Etat
Major des Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire (FANCI), le
Général de Brigade Touvoly Bi Lobo, Commandant Supérieur
de la gendarmerie, le Contrôleur Général Adolphe Baby,
Directeur Général de la Police. Mais aussi un représentant
de chacun des partis politiques et mouvements armés présents
à Marcoussis et le 07 Mars à Accra. De ce fait, le Conseil
National de Sécurité sera constitué de 15 membres.
Dans la foulée de ce compromis, le Président
ivoirien signait une délégation de compétence le 10Mars.
B- La signature d'une
délégation de compétence
Comme prévu par les accords de Marcoussis, le
Président Laurent Gbagbo délègue ses pouvoirs au Premier
Ministre Seydou Diarra.
La délégation de compétence se
définit par le fait pour une autorité administrative, de se
dessaisir dans les limites légales d'un ou de plusieurs de ses pouvoirs
en faveur d'un agent qui les exécute26(*).
Le décret comporte 3 articles27(*):
Article I : En application des dispositions
53 de la Constitution, le Président délègue au
Premier Ministre, chef du gouvernement les compétences en ce qui
concerne l'initiative des actions, l'élaboration des avants projets, et
projets des textes réglementaires, législatifs et
constitutionnels à soumettre au Conseil des Ministres dans les
matières ci-après :le désarmement des forces rebelles, le
rétablissement de l'intégrité territoriale et de
l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire, la libération
des prisonniers de guerre, le rétablissement de la
sécurité de personnes et des bien sur l'ensemble du territoire
national ; l'amnistie des militaires détenus pour atteinte à
la sécurité de l'Etat ; le refondation et la restructuration des
forces de défense et de sécurité de l'Etat ; la
réhabilitation et l'indemnisation des victimes de guerre ;la
réinsertion des militaires démobilisés, les mesures de
redressement économique et la recherche du concours de la
communauté internationale au processus de redressement
économique.
Article II : La délégation
prend effet à compter de la signature du présent décret.
Elle est pour une duré de six mois renouvelable. Le Premier Ministre
rend compte régulièrement au Président de la
République des avancements réalisés dans
l'exécution de la mission qui lui est confiée au titre de
l'article premier du décret.
Article III: Le Premier Ministre, chef du
gouvernement est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République de Côte d'Ivoire.
Face à la recrudescence des hostilités dans
l'Ouest, et des points stratégiques détenus par les mouvements
rebelles, il a été dégagé une
nécessité sécurisation de 1' intégrité du
territoire.
Par II : La
nécessité d'une sécurisation de
l'intégralité territoriale
Sous l'égide du Président Togolais Eyadema s'est
à Kara un sommet entre Charles Taylor et Laurent Gbagbo pour
sécuriser le sud de la Côte d'Ivoire. En outre une cessation des
hostilités entre les FANCI (Forces Armées Nationale s de
Côte d'Ivoire) et les mouvements a été signée.
A- La rencontre de Kara
Longtemps considéré comme le pourvoyeur de
mercenaires tant du côté de l'armée Ivoirienne que celui
des rebelles, le Libéria s'est vu confié un rôle de garant
de la stabilité dans la crise avec la rencontre de Kara (nord du Togo).
A l'issue de l'entretien organisé sous les auspices du président
Togolais Eyadema, Gbagbo et Taylor sont convenus de la «
nécessité .du déploiement immédiat des forces
conjointes composées de troupes françaises de l'opération
Licorne, des troupes de la CEDEAO, des forces armées Ivoiriennes (FANCI)
et des forces armées libériennes28(*) : le long de la frontière commune entre les
deux pays. Ce déploiement concernait les 200 km de frontière au
sud de la Côte d `Ivoire, zone sous contrôle gouvernemental. La
réunion de Kara exhorte les agence humanitaires à renforcer les
mesures de recours « et d'assistance aux populations
déplacées, en raison des crises qui perdurent dans la
région «. le communiqué rappelle le protocole de non
agression de la CEDEAO de 1978 signé à Lagos par lequel chaque
Etat membre s'est engagé « à ne pas commettre, encourager ou
soutenir des actions de déstabilisation» contre un autre Etat
membre. A ce sommet étaient conviés les mouvements rebelles. Ces
derniers ont signé une cessation des hostilités avec les FANCI.
B- La signature de
cessation des hostilités entre les mouvements rebelles et l'armée
Ivoirienne (FRANCI).
Le Samedi 03 Mai, les forces nouvelles (regroupant les 03
mouvements rebelles) et les FANCI ont signé à Abidjan un accord
de cessez-le-feu sur» toute l'étendue du territoire
national29(*)
Cet accord portant sur cinq points a été
signé par le colonel Michel GUEU au nom des forces nouvelles et de
Mathias Doué au nom des FANCI.
L'accord de cessation des
hostilités « prend effet à compter du dimanche 4 Mai
2003» et prévoit la restauration de l'autorité de l'Etat
ainsi que l'administration sur toute l'étendue du territoire national.
Les FANCI et les Forces nouvelles se sont engagées à mettre fin
au recrutement des mercenaires et d'enfants soldats et acceptant le
déploiement des forces impartiales de la CEDEAO et de la force
licorne».
Cette signature sanctionne la décision prise lors de la
rencontre du 26 Mai à Kara (Togo) entre les présidents Gbagbo,
Taylor, de procéder au déploiement conjoint de leurs forces
appuyées par les militaires français de l'opération
licorne et les « casques blancs « de la CEDEAO le long de la
frontière entre les deux pays.
En outre le couvre feu décrété depuis le
début de la crise le 19 septembre a été levé par le
président Laurent Gbagbo. Mais la situation demeure précaire.
SECT I : UNE SITUATION
PRECAIRE
Après huit mois de crise qui déchire le tissu
politico -économique, la côte d'Ivoire paraît retrouver un
semblant de stabilité. Malgré les efforts déployés
tant du côté gouvernemental que des mouvements rebelles, la
situation demeure instable. Cette précarité se mesure sur le
front politico -social entraînant du coup une réalité
permanente des hostilités.
Par I : Un front
politico-économique instable
Cette situation s'explique par un environnement politique
marqué par des difficultés liées à la conduite
d'une politique gouvernementale. Cependant on assiste à un redynamisme
économique avec le déploiement des investissements.
A- Les difficultés
liées à la conduite d'une politique gouvernementale
L'une des illustrations de ces difficultés, est
l'étroitesse des marges de manoeuvre du Premier Ministre Seydou Diarra
avec la formation du gouvernement de réconciliation nationale le 20
Mars. La nomenclature a été dessinées par les accords de
Marcoussis et du document de Kiéber les 25 et 26 Janvier avant de
connaître un lifting à Accra.
En outre, la première réunion du conseil
national de Sécurité prévue le 11 mars s'est soldée
par un blocage. L'attribution des portefeuilles de la Défense et de la
Sécurité objet d'un accord entre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo
reviendra faute de solution par tous, à titre intérimaire au
ministre des Eaux et forêts Abdou Assao du FPI et son collègue de
l'enseignement supérieur Zameogo Fofana du RDR.
Pressenti pour prendre en charge les portefeuilles litigieux,
Seydou Diarra n'en héritera pas finalement, pas plus que le
président du groupe parlementaire du PDCI le général de
brigade Ouesséan Koné. La question n'est pas tranchée
malgré une deuxième rencontre du conseil national de
Sureté. A cela, le portefeuille du Ministère de la famille est
refusé à Kandia Kamara du RDR.
Sur le front social, les faits
et gestes du premier Ministre sont boycottés par les médias
publics notamment la radio et la télévision. Peu d'échos
sont donnés à ses audiences et déclarations. La
liberté de circulation et le fonctionnement ne sont pas totalement
rétablis dans un pays coupé virtuellement en deux et isolé
de ses voisins du Mali, de la Guinée et du Burkina même si on note
la reprise des
relations diplomatiques avec ce dernier.
Les modifications du régime électoral, des
conditions d'éligibilité à la
présidence de la
République et du code de la nationalité, la réforme du
foncier
rural, principales revendications de la rébellion au
début du conflit devront
probablement attendre. Mais aujourd'hui, on
assiste à un regain de l'activité
économique.
B-- Un timide redynamisme
économique
Le réaménagement puis la levée du couvre
feu a entraîné une reprise de l'activité économique
avec notamment le retour des investisseurs étrangers.
Le groupe
français Accor qui gère plusieurs établissements
hôteliers dans le
pays constate un retour progressif de la
clientèle. La compagnie Air France qui
assure le vol quotidien
affiche désormais complet. C'est dans ce contexte que la
compagnie
qui assure la disserte de la capitale économique a décidé
de remplacer l'air bus A 330 par un Boeing 777 d'une capacité plus
grande.
Quant à la compagnie nationale Air Ivoire dont
l'activité redémarre lentement
depuis fin Mars va
bientôt assurer des liaisons directes avec Paris.
En outre, le
Ministre d'Etat chargé de l'économie et des Finances Paul
Antoine Bahoum Bocrabré lors d'un bref passage le 14 mai a
multiplié les
contacts informels avec d'éventuels bailleurs
de fonds. C'est ainsi qu'il a
rencontré à deux reprises des
hommes d'affaires français. Mais l'aide de l'Union Européenne
reste conditionnée par l'application intégrale des Accords de
Marcoussis.
Le trafic ferroviaire a repris timidement ses droits.
En effet, un premier train de marchandises de la
société internationale de transport africain par rail (SITARAIL)
a quitté Abidjan le jeudi 23 mai pour Ouagadougou symbole d'une reprise
des activités économiques entre les deux Etats. Un train
marchandises de ce réseau ferré transporte environ 800 tonnes par
convoi. Un premier train d'exploitation à bord duquel voyageaient les
soldats français de la licorne, de la force de la CEDEAO, des FANCI et
des rebelles avait effectué avec succès un premier voyage sur la
partie ivoirienne du trajet.
Malgré un dynamisme économique naissant la
recrudescence des hostilités demeure.
Par II : Une
réalité permanente des hostilités
Malgré un cessez le feu entre les rebelles et
l'armée Ivoirienne la situation devient instable. En outre, la crise a
mis en exergue une violation flagrante du Droit humains.
A- - Un cessez-le-feu
fragile
Malgré la signature d'un cessez le feu entre les
mouvements rebelles et les FANCI par lequel ils « acceptent de cesser
immédiatement et définitivement les hostilités sur toute
l'étendue du territoire national et particulièrement dans le
grand Ouest Ivoirien». Les combats ont repris de plus belle. En effet, des
tirs à l'arme lourde ont opposé, les troupes gouvernementales aux
combattants rebelles au nord de Louan Houmien (ouest).Ainsi les troupes
loyalistes ont repris le contrôle de Louan Houmien une ville
située à une trentaine de kilomètres au sud de
Douané que les rebelles avaient évacué peu avant
l'entrée en vigueur du cessez le feu le dimanche.. Des combats se sont
poursuivis dans la région de Louan Houmien.
En outre, des soldats français de l'opération
« Licorne « ont riposté près de Guiglo (à 550 km
à l'ouest d'Abidjan) à l'attaque d'une bande d'individus
armés, faisant deux tués dans le camp des agresseurs. Ces
agresseurs sont présumés être membres d'un groupe
supplétif libérien des forces armées.
Cet incident est intervenu alors que les «force
nouvelles» structure politico - militaire regroupant les trois mouvements
mènent depuis une dizaine de jours une opération de ratissage
pour débarrasser l'ouest ivoirien de ses encombrants ex alliés
libériens.
B- Une flagrante violation
des droits humains
La crise en côte d'Ivoire a montré au grand jour
les différentes exactions et atteintes aux droits de l'homme commises
aussi bien du côté rebelle qu'à l'ombre du pouvoir.
La liste est déjà longue du
général Robert Guei (ainsi qu'une partie de sa famille et de ses
proches) tué le 19 septembre, aux premières heures de la crise,
au comédien Camara Yéféré, alias Camara H, membre
dirigeant du RDR d'Alassane Ouattara retrouvé mort le 1e février,
en passant par le Ministre d'Etat chargé de l'intérieur et de la
décentralisation Emile Boga Doudou, sans oublier Benoît
Dacoury-Tabley, le frère cadet de Louis, un des chefs de file du MPCI.
Le mouvement ivoirien des droits humains (MIDH), en attendant de voir les
responsabilités clairement établies, tient jour après jour
depuis le 19 septembre une macabre comptabilité des victimes et les
circonstances de leur mort. Amnesty International qui a déjà
mené une mission d'enquête en zone sous contrôle loyaliste
en octobre 2002, en a dépêché une autre le 3 mars à
Abidjan, une semaine après la publication de son rapport sur la
situation des droits humains dans les régions détenues par le
MPCI. Début février, c'est le rapport des nations Unis d'une
«mission d'établissement des faits » effectuée entre le
23 et 29 décembre dans la partie gouvernementale du pays, qui stigmatise
les crimes ciblés et n'exclut pas une implication du pouvoir. C'est
pourquoi le Président Jacques Chirac ne s'est embrassé de
formules diplomatiques pour évoquer ouvertement, devant ses pairs
réunis le 20 et 21 février au Sommet France/Afrique de
l'existence d'escadrons de la mort. De ce fait, depuis le début de la
crise, les assassinats, les exactions contre les libertés fondamentales
et le droit humanitaire dont se sont rendues coupables les « forces de
l'ordre » semblent indiquer que certains militaires ont
échappé en partie au contrôle de l'Etat pour former une
sorte de nébuleuse aux ramifications multiples. L'enquête
onusienne d' «établissement de faits» cite des noms dont celui
du capitaine Anselvé Séka yapo aide de camp de Simone Gbagbo et
celui de Patrice Bahi, un adepte des arts martiaux. Le premier est
soupçonné être le chef de l'aile militaire des escadrons et
le second d'être à la tête de la branche civile.
Les assassinats ciblés des personnalités
politiques ou des membres de leurs famille sont en revanche imputés
à celui qui est appelé familièrement Séka
Séka et à Patrice Bahi. De nombreux témoignages
relayés par les organisations des droits de l'homme et de la presse
désignent Séka Séka et ses compagnons comme les auteurs du
meurtre le 19 septembre de Robert Gueï, de sept membres de sa famille et
de sa garde rapprochée dont le capitaine Fabien. Ils sont
également mis à l'index dans la liquidation du docteur Benoit
Dacoury Tabley, de deux membres de la famille du secrétaire
général adjoint du RDR Amadou Gon Coulibaly et du lieutenant
Dosso, aide de camp de Ouattara .Patrice Bahi est celui qui a
arrêté le 04 décembre 2000, le porte parole du RDR Ah
Coulibaly avant de le déposer à la gendarmerie d'Agban.
Du coté de la rébellion, Amnesty Internationale
révèle qu'une soixantaine de personne ont été
massacrées, froidement par des éléments armés du
MPCI à la prison du IIIème bataillon d'infanterie
située au nord du pays. L'image savamment mise au point par le MPCI vole
en éclats. Les délégués d'Amnesty International ont
rencontré le Secrétaire général du MPCI Guillaume
Soro, le premier responsable militaire, l'adjudant Tuo Fozié et le
commandant en chef des opérations militaires, le Colonel Michel Gueu
à Paris. Ces derniers n'ont pas nié les faits tout n'étant
«pas impliqués personnellement »30(*) Pour comprendre ses
événements Amnesty International avance l'hypothèse d'un
engrenage de la violence qui prendrait sa source dans les
événements qui ont marqué la Côte d'ivoire depuis
2000 à savoir l'affaire dite « cheval bleu »31(*) ; «complot Mercedes noire
»32(*); «
charniers de Youpongon »33(*).
CONCLUSION
Lasse des souffrances et des traumatismes de la guerre, la
Côte d'Ivoire se débat
pour retrouver la paix. La mission des
Nations Unies du 15 au 18 Mai à Abidjan
constitue un pas dans cette
direction L'enjeu de cette visite est le passage du
niveau 3 au niveau
4.
Le Président Laurent Gbagbo veut faire
reconnaître que l'état de guerre est
fini et que les
conditions pour le retour des capitaux étrangers, des organismes
bailleurs de fond, et des investisseurs sont rétablis. Les
Président ivoirien est lui -
même monté au
créneau pour satisfaire les conditionnalités posées par la
communauté internationale. Avec la tenue du Conseil
ministériel à Bouaké, la
Côte d'Ivoire semble
renouer avec la paix.
Toutes ces initiatives si louables soient-elles ne vont pas au
fond de l'accord
de Marcoussis du 24 janvier dernier. La Côte
d'Ivoire ne pourra jubiler que si les réformes des conditions
d'éligibilité, du foncier rural et les procédures
d'identifications arrêtées à Marcoussis ne sont pas
effectivement mises en oeuvre. Ce qui n'est pas encore le cas.
Le gouvernement peine à être constitué. Le
chef de l'Etat continue de récuser
la candidature de Kandia Kamara
du RDR à la tête du Ministère de la famille et
de
l'enfance.
Mais le blocage le plus important réside dans les
difficultés des membres du
Conseil nationale de
Sécurité à pourvoir les ministères de la
Défense et de la sécurité. Le consensus qui réunit
le PDCI de l'ancien Président Bédié, le RDR, l'UDPCI du
défunt chef de la junte militaire, 1'UDCY de Théodore Mel EG et
des Forces nouvelles pour Gaston Ouesséan Koné,
général à la retraite et Président du groupe
parlementaire du PDCI à la défense hypothèque la paix.
Autre source d'inquiétude ; la prolifération des milices dans la
capitale qui fait craindre le spectre congolais. En outre, la paix demeure
fragile d'autant plus que certains observateurs doutent toujours de la
volonté du MPCI et de ses clones (MJP et MPIGO) d'abandonner le sentier
de la guerre et de désarmer.
Puisque le gouvernement devra durer
plus de deux ans, les leaders politiques devraient travailler à
retrouver puis à consolider la sécurité pour tous,
favoriser l'émergence d'une paix durable en évitant
d'instrumentaliser les appartenances ethniques et religieuses et enfin mettre
en place des principes et des règles de jeu garantissant pour tous et
toutes une vie harmonieuse sur l'ensemble du territoire. La guerre a
indéniablement laissé des traces et des plaies ouvertes qui
mettront du temps à se cicatriser.
La Côte d'Ivoire ne sera unie, ni solidaire ni
prospère en créant des ivoiriens de seconde zone.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrage Général
Encyclopédie juridique de l'Afrique Tome2. Droit
International et Relations Internationales
Ouvrages spécialisés
(Coulibaly) Alban Alexandre : Le Système politique
ivoirien - l'Harmattan
(Bédié) Konan Henri Les chemins de ma vie Ed. Plan
1999
(Laporte) Mireille La pensée sociale de Félix H.
Boigny Mars 1970
(Amin) Samir Le Développement du Capitalisme en Côte
d'ivoire-Paris Ed. Minuit 1967
(Rougerie) Gabriel La Côte d'Ivoire -- Paris PUF
Collection « Que sais-je »1967
Revues
Africa International N°358-3591 Novembre 2002
Jeune Afrique l'Intelligent N°2189 - 2190 - 21.93 - 2194 -
2195
Jeune Afrique l'Intelligent N°2200 - 2201 - 2204 - 22205
Le Nouvel Afrique Asie N°136 Janv. 2001
Jeune Afrique l'intelligent N°2206 - 2207 - 2208 - 2209 -
2210 - 2211
Jeune Afrique Economie N°346
Courrier International N°637
Nouvel Horizon N°347 - 356 - 376 - 357
Articles
Ismaila Koné : Coup d'Etat et refondation politique en
Afrique :le Cas de la Côte d'Ivoire RADIC 2000
Jean Pierre Dozon, (Directeur d'Etude à l'EHESS) : La
Côte d'Ivoire au péril de - l'ivoirité .Genèse d'un
coup d'Etat. Afrique Contemporaine N°193 Premier Trimestre L'Harmattan
« Points de vue concrets» - Paris 2002
Claude Hélène Perrot, Professeur Emérite de
l'Université de Paris I : Laurent Gbabgo : Portrait d'un opposant
historique -- Afrique Contemporaine N°196 4ème trimestre
2000
Professeur Abdoualye Bathily : Une crise, ses origines et ses
dimension sous-régionales. Contributions Walfadjri. Vendredi 28 Novembre
2002
Professeur Abdoualye Bathily : A quelle Côte d `Ivoire se
réfère l`ivoirité ? Contribution Walfadjri : Samedi 30
Novembre -- Dimanche 1er Déc. 2002
Tiémoko Coulibaly : Lente décomposition en
Côte d'Ivoire. Le Monde Diplomatique, Novembre 2002 P.24-25
Philippe Leymari, journaliste à Radio France
Internationale: L'Eternel retour des militaires français
Le Monde Diplomatique Novembre 2002 Page 24--25
Bernard DOZA: Naissance d'un nationalisme ivoirien. Le monde
diplomatique Avril 2003 p.13-14
Quotidiens
Spécial Côte d'Ivoire : Soleil Décembre 2002
Le « Soleil» du 29 Janvier
Le « Soleil» du 27 Janvier
Le « Soleil» du 13 Mars 2003
Le «Soleil» du 14 Avril
Le «Soleil» du 05 Mai 2003
Le «Quotidien» du 14 Avril 2003
Le «Quotidien » du 17 Mai 2003
LISTE DES
ABRÉVIATIONS
F.P.I Front Populaire Ivoirien
P.D.C.I Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire
R.D.R Rassemblement démocratique
P.I.T Parti Ivoirien du Travail
U.D.P.C.I Union pour le Démocratie et la
Paix en Côte d'Ivoire
U.D.P.C.Y Union pour la Démocratie
Citoyenne
M.P.C.I Mouvement Patriotique de Côte
d'ivoire
M.J.P Mouvement pour la Justice et la Paix
M.P.I.G.O Mouvement Populaire Ivoirien du Grand
Ouest
C.E.D.E.A.O Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
U.E.M.O.A Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
P.I.B Produit Intérieur Brut
FANCI : Forces Armées Nationales de
Côte d'Ivoire
ANNEXES
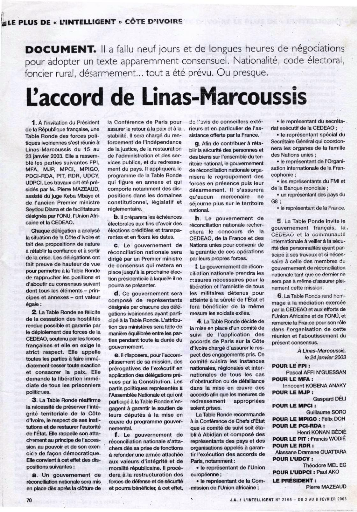
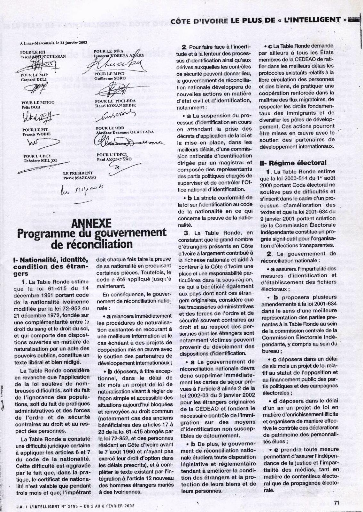
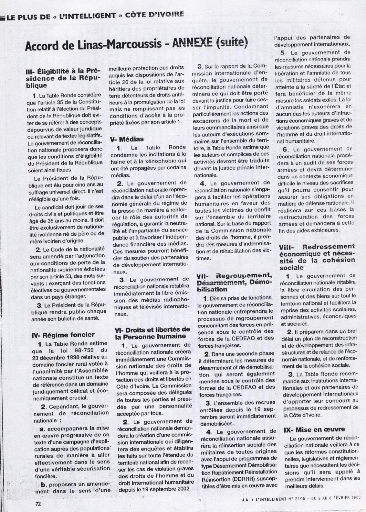
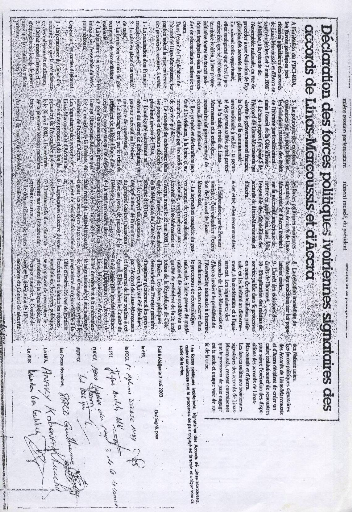
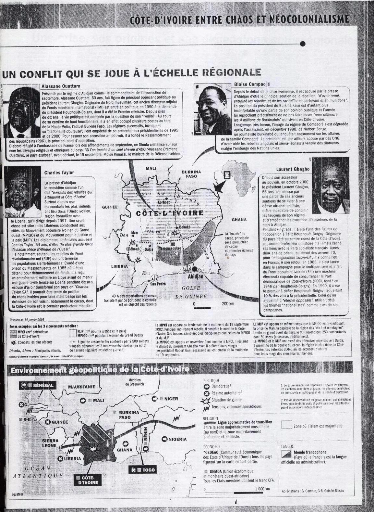
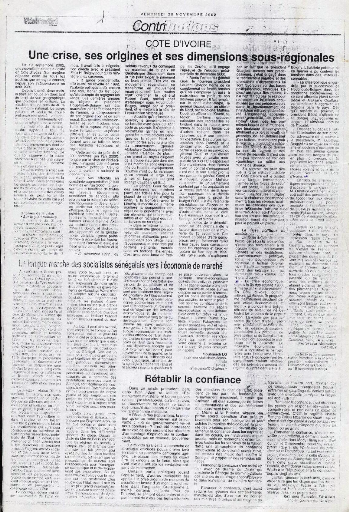
* 1 Coulibaly Alban Alexandre
: Le système politique ivoirien, l'Harmattan. « Points de vue
couverts » Paris 2002
* 2 qui stipule qu'en cas de
vacances de la présidence de la république par
décès, démission ou empêchement absolu
constaté par la cour suprêmes saisie par le gouvernement, les
fonctions de Président de la République sont dévolues de
plein droit au Président de l'Assemblée Nationale.
* 3 L'article 13 stipule
qu'en de vacances, le Premier Ministre doit expédier les affaires
* 4 Cela a été
à l'origine de son limogeage le 21 Octobre 1995
* 5 Cf :Ismaïla
Kocié :Coup d'Etat et Refondation :le cas de la Côte d'Ivoire!
Revue Africain de Droit International et Comparé Radic 200 N°
* 6 6 Cf
:Henri K.Bédié :Les Chemins de ma vie : Ed. Pion 1999
* 7 Cf :Ismaïia
Koné
* 8 Affaire Bouadou et Nasra
950 000 000 Affaire UE :Entre 18 et 23 Milliards
* 9 Douakou et Pepresson
* 10 10
Mireille Laporte : la pensée sociale de Feux H. Boigny,
chercheur au C:E.A.N Mars 1970
* 11 Samir Amin :Le
Développement du Capitalisme en Côte d'Ivoire -- paris Ed de
Minuit l967,p 333
* 12 Abdoulaye Bathily :A
Quelle Côte d'Ivoire se refère l'ivoirité :Contribution,
Walfradjri 1er et 2 Décembre 2002
* 13 Cf Mireille LA PORTE
* 14 Gabriel Rougerie : La
Côte d'Ivoire Paris PUF Collection « Que sais-je » 1967 Page
128
* 15 Cf :Mireille Laporte
Page 8
* 16 Lexifère des
termes juridiques l2eEd
* 17 H. Huevu: «La
Question de l'Etat et la Nation en Afrique »(Extraits) In Présence
Africaine N°127 -128
* 18 J.P Dozon :Af
Contemporaine :La Côte d'Ivoire au péril de l'ivoirité
N°193 1C Trimestre
* 19 Babacar Justin Ndiaye :
Journaliste et géopoliticien. Entretien
* 20 Afrique l'Intelligent
N°2195 page 73
* 21 Jeunes Afrique
l'intelligent N°2195
* 22 Courier International
N°637
* 23 Animal mythologique
grec avec une seule corne traduisant un retenue de la France contrairement au
Pélican qui symbolisait l'opération sur le Congo Brazzaville
* 24 Africa International
N°358-359 Page 32
* 25 N.H 362 page 15
* 26 Lexiques des termes
juridiques 12è Ed.
* 27 JAI N°2201
* 28 Walfadjri 28 Avril
2003
* 29 Walf: 05 Mai 2003
* 30 JM N°2200
* 31 C'est une attaque
contre le domicile du chef de 1'Etat Robert Gueï, en septembre 200 qui a
provoqué l'arrestation de nombreux hi1itaires. Certains tués,
d'autres torturés et d'autres partis en exil qui se trouvent aujourd'hui
dans les rangs du MPCI.
* 32 C'est une tentative de
coup d'Etat qui avait lieu en Janvier 2001. Elle a entraîné
l'arrestation de nombreux sympathisants du RDR.
* 33 Youpongon est le nom
d'une commune de la banlieue d'Abidjan où l'on a découvert le 27
octobre 2000, cinquante corps dans un terrain vaque.
| 


