|
UNIVERSITE DE ROUEN
UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT DE
GEOGRAPHIE
LABORATOIRE L. E. D. R. A
MEMOIRE DE MAÎTRISE
Thème :
CRISE AGRICOLE DANS UNE VALLEE DE CASAMANCE : LE
BASSIN DE GOUDOMP (SENEGAL)

Présenté par : Sous la direction de
:
Insa MANGA Michel LESOURD
Professeur
Année Universitaire 2002- 2003
DEDICACES
A la mémoire de mon
père
Puisse son âme reposer en
paix.
A ma mère, inlassable
éducatrice,
Femme qui a consenti à bien des
sacrifices
Sans se plaindre et m'a donné sans
réserve tout ce qu'elle a.
SOMMAIRE
SIGLES ET ACRONYMES
Avant-propos Introduction générale
Problématique Méthodologie
PREMIÈRE PARTIE : COMPLEXITÉ DU
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE BASSIN DE GOUDOMP
Chapitre I : Une vallée riche en
potentialités agropédologiques
Chapitre II : Contraintes du climat et
problématique de la maîtrise de l'eau
Chapitre III : Environnement démographique,
sociologique et socioéconomique
DEUXIÈME PARTIE : MAÎTRISE DE L'EAU ET
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : HISTORIQUE D'UNE ACTION ANCIENNE ET A
RÉSULTATS MITIGÉS
Chapitre I : La MAC : «un projet
d'assistance»
Chapitre II : Le PROGES ou l'histoire d'une intervention
inachevée
Chapitre III : Les facteurs explicatifs des contre-
performances post- opération de développement
TROISIÈME PARTIE : CRISE, STRATÉGIES
PAYSANNES ET NOUVELLES ORIENTATIONS AGRICOLES
Chapitre I : Analyse du contexte de la crise
Chapitre II : Pour une nouvelle approche du
développement local
Conclusion Générale
BIBLIOGRAPHIE ANNEXES
Table des matières
SIGLES ET ACRONYMES
AJAC : Association des Jeunes Agriculteurs de la
Casamance
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et
Minière
CAR : Centre d'Animation Rurale
CERP : Centre d'Expansion Rurale Polyvalent
CFA : Commission Financière
Africaine (monnaie des anciennes colonies françaises de
l'Afrique de l'ouest)
CIVGE : Conseil Inter Villageois de Gestion de
l'Eau
CNCAS : Caisse Nationale de Crédit
Agricole du Sénégal
CNCR : Conseil National de Concertation et de
Coopération des Ruraux
CRA : Centre de Recherche Agricole
CVGE : Conseil Villageois de Gestion de l'Eau
DAT : Direction de l'Aménagement du Territoire
DEH : Direction des Études Hydrologiques
DPS : Division de la Prévision et de la
Statistique
EDS : Enquêtes Démographie et
Santé
ENDA : Environnement et Développement au
Tiers- Monde
FADECBA : Fédération des
Associations de Développement Communautaire du
Balantacounda
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
IGN : Institut Géographique National
IRD : Institut de Recherche pour le
Développement
ISRA : Institut Sénégalais de
Recherche Agricole
MAC : Mission Agricole Chinoise
NPA : Nouvelle Politique Agricole
ONCAD : Office National de Coopération et
d'Assistance au Développement
ONG : Organisation Non Gouvernemental
ORSTOM : Office de Recherche Scientifique et
Technique d'Outre- Mer
PAS : Plan d'Ajustement Structurel
PASA : Plan d'Ajustement du Secteur Agricole
PIDAC : Programme Intégré de
Développement Agricole de la Casamance
PNAE : Plan National d'Action pour
l'Environnement PRIMOCA : Projet Rural Intégré
de la Moyenne Casamance PRS : Projet Rizicole Rural de
Sédhiou
PROGES : Projet de Gestion des Eaux du Sud
RGPH : Recensement Général de la
Population et de l'Habitat
SATEC : Société d'Aide Technique
et de Coopération
SOMIVAC : Société de Mise en
Valeur Agricole de la Casamance
SONACOS : Société Nationale de
Commercialisation des Oléagineux du Sénégal
UCAD : Université Cheikh Anta DIOP
UICN : Union Mondiale pour la Nature
USAID : Agence Américaine pour le
Développement International
AVANT - PROPOS
Depuis plusieurs décennies, de nombreuses
recherches ont mis en évidence la situation
socio-économique précaire du monde rural
sénégalais. La réduction de la pauvreté,
notamment en milieu rural par la relance du secteur agricole, est devenue
l'objectif prioritaire
de la politique de l'État.
L'une des manifestations majeures de la crise multiforme et
généralisée qui frappe actuellement le bassin de
Goudomp réside dans l'effondrement de son agriculture et,
subséquemment, son incapacité à s'auto suffire sur le plan
alimentaire. Or, au regard des enjeux actuellement en cause, notamment ceux
relatifs à la sécurité alimentaire et à la survie
économique de la région, il urge de revisiter
l'approche stratégique du type de développement mis en
oeuvre jusqu'à nos jours.
Dans cette perspective, l'agriculture, en l'état
actuel des structures et compte tenu des immenses potentialités
existantes, constitue assurément le secteur capable, s'il est
judicieusement valorisé, de tracter l'ensemble de
l'activité économique dans le cadre d'un développement
véritable, irréversible et équilibré du bassin.
Ce travail qui marque nos débuts dans la recherche est une
contribution à l'étude de
la géographie du développement. Il nous
paraît intéressant dans le contexte de la crise agricole
et dans le cadre de la recherche de solutions appropriées, de
formuler des problématiques et de proposer des stratégies pour
une meilleure mise en valeur des bas- fonds devenus aujourd'hui très
convoités par les paysans.
Notre objectif est de faire le point des informations
disponibles, détecter les mutations dans les domaines physiques,
humaines, sociologiques, culturales, technologiques..., mais surtout
d'apporter des éléments de réponse à quelques
questions clés que se posent aujourd'hui tant les pouvoirs publics
que les populations locales. Ce sont ces questions qui prendront la forme
d'hypothèses de travail qui ont guidé le choix de nos
informations et de nos enquêtes.
Ce présent mémoire est l'illustration de
l'intérêt particulier que nous portons à la question
du développement dans le monde rural en général et dans le
bassin de Goudomp
en particulier.
Cette étude ne s'est pas faite sans difficultés qui
s'expliquent notamment par la modicité des moyens mis à notre
disposition.
Au terme de ce travail, nous tenons à adresser nos
remerciements d'abord aux membres du jury qui nous font l'honneur de le juger.
Mention spéciale à M. LESOURD qui a
la lourde responsabilité d'encadrer ce mémoire et
qui en dépit de son emploi du temps chargé, l'a fait avec
conscience, rigueur et efficacité. Nous tenons à lui remercier
pour sa disponibilité permanente et ses critiques constructives si
nécessaires à la finalisation du
texte.
Nos remerciements iront ensuite a l'endroit de tous les
professeurs du département de Géographie de l'université
Cheikh Anta DIOP de Dakar qui ont initié et guidé nos premiers
pas dans la recherche ainsi qu'a tous les enseignants du
département de Géographie de l'Université de Rouen qui
ont assuré la continuité de leurs collègues de Dakar.
Que soient vivement remerciées toutes les personnes
qui nous ont aidés dans l'avancement du travail. Nous pensons
notamment a :
V M .Vaque NDIAYE, coordinateur de l'I.S.R.A
Djibélor
V M. Abdoulaye BADJI responsable du Centre de documentation
de l'I.S.R.A. Djibélor.
V M. Pierre TENDENG, ancien Directeur du PROGES
V M. Edouard SADIO, Directeur en retraite de l'école
Publique de Birkama et
Président du CIVGE
V M. MANSALY, Directeur de l'école publique de Goudomp
III.
V M. Augustin DIEME a L'IRD de Dakar
V M. Dominique BADIANE (Paix a son âme) et M. Djibril
DIEDHIOU a Goudomp.
V M. SEYDI Adjoint au Maire de Goudomp
V M. MANE Bacary, notable a Bacoundi
V M. AIDARA Chérif Daha, Doctorant a
l'Université de Rouen
Pour leur soutien moral permanent et pour leur esprit de
solidarité nous disons merci a :
M. BASSENE Antoine, M. BASSENE Arfang, Mlle BADJI Laure,
M. CAMARA Mamadou Lamine, M. CISSE Boubacar, Mlle Chantal SOBRINO TAFUNELL, M.
DIOP Mouhammadou El Amine, DIOP Moussa, M. GOMIS Michel, M. MANGA
Abdel Latif, M. MANGA Daouda, MANGA Christian Thierry, MBAYE Moussa, MBAYE
Ousmane, NDIAYE Mame Yacine, SADIO Yankhoba, M. SY Atoumane, M. TENDENG
Djitendeng et famille.
Nos pensées vont tout naturellement a nos frères
et soeurs dont le soutien dans tous les domaines durant ces longues
années ne saurait être évalué.
Enfin que tous ceux qui ont, de prés ou de loin,
contribué a la réalisation de ce
mémoire trouvent ici l'expression de notre profonde
gratitude.
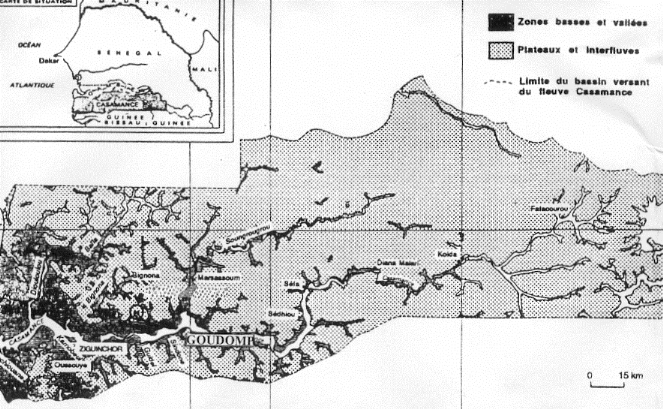
Carte 1 : Localisation du bassin de
Goudomp en Casamance (Sénégal). Source :
MONTOROI, J. P. 1996
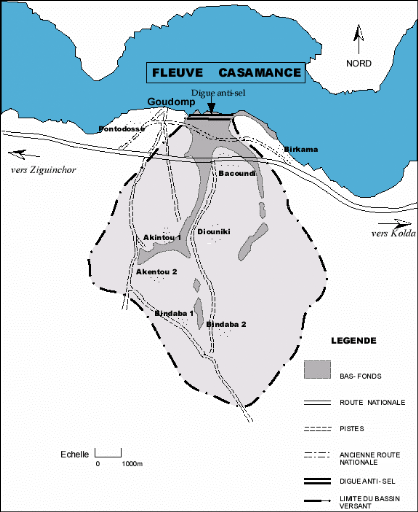
Carte 2 : Vue d'ensemble du bassin de
Goudomp. Source : MANGA I., 2003
INTRODUCTION GENERALE
La sécheresse persistante qui sévit depuis
1968 dans les pays du Sahel a eu pour conséquence outre le
déficit hydro pluviométrique et ses répercussions sur
l'agriculture et l'économie, la prise de conscience de la
nécessité de maîtriser et de gérer au mieux
les ressources en eaux existantes. Il en est résulté en
Casamance l'élaboration de multiples programmes de mise en valeur
agricole initiés par différents acteurs du
développement (USAID, PRIMOCA, SOMIVAC, PIDAC, DERBAC, ORSTOM, ISRA,
ENDA ...) avec des résultats plus ou moins mitigés.
La question de la maîtrise de l'eau reste de nos jours
pendante dans le bassin de Goudomp et les mesures prises par les
pouvoirs publics n'ont pas encore apporté des réponses aux
attentes de la population paysanne. C'est dans ce cadre que
s'inscrit ce
travail.
Le bassin de Goudomp, d'une superficie de 55 km2, se
situe a une cinquantaine de kilomètres a l'est de Ziguinchor sur la
rive gauche de fleuve Casamance dont il constitue
un sous bassin. Il s'étend entre 12° 27' et 12°
35' de latitude nord et entre 15°50' et 15° 55'
de longitude ouest. Il est essentiellement situé
dans l'arrondissement de Diattacounda, département administrative de
Sédhiou. (Carte 1)
Le bassin se présente en deux embranchements (le marigot
de Goudomp et celui
de Birkama) qui se rejoignent en aval dans une zone de
convergence renfermant en son sein un îlot de savane arborée
avant de se jeter dans le fleuve Casamance. A l'exutoire dans la partie
septentrionale du bassin, est aménagé un barrage anti-sel par le
PROGES a
la demande de la population locale. (Carte
2)
Il est peuplé d'une dizaine de villages a majorité
Balantes, Mandingues, Mandjaques
ou Mancagnes situés dans sa proximité. Ce
sont d'amont en aval : Bindaba 1, Bindaba 2, Akintou Mancagne I et II,
Diouniki, Bacoundi, Birkama et Goudomp. Il convient de noter que Goudomp et
Birkama détiennent la quasi-totalité des terres des bas- fonds
sous forme de tenure marquée par la prévalence du droit
coutumier sur celui relatif au Domaine National.
L'activité économique est essentiellement
polarisée par l'agriculture (riz, arachide, mil, fruits...) et la
pèche. Le contexte physique (climat et ressources disponibles) offre
des opportunités énormes. En effet, les bas- fonds de
Goudomp et de Birkama - avec des avantages liés a leur
situation topographique basse, la fertilité des sols, la
pluviométrie relativement importante et régulière, la
présence d'une vielle tradition rizicole au niveau des
populations- ont toujours été des zones naturellement favorables
a la riziculture.
A l'image du reste du pays, le bassin de Goudomp reste
caractérisé par un climat marqué par une alternance de
saisons sèche et humide, des températures élevées
et une chaleur persistante presque toute l'année. Le sol est
très sableux en profondeur et en surface, billonné sur la
plus grande surface du bassin. La végétation est
constituée de forêt
claire a la savane arborée.
Le bassin vit une double crise entretenue par des facteurs
aggravants: une crise de la production (déficit vivrier chronique,
allongement de la soudure) et une crise du modèle de
vie (lié aux comportements et a
l'interprétation des héritages socioculturels) Elles se
maintiennent et s'approfondissent davantage a cause de la pratique de
l'usure et de la déconnexion géographique ; l'enclavement
perturbe tous les systèmes de régulation de la crise et
participe a alourdir «l'impôt de l'éloignement» .
Toutes les denrées de grande consommation sont plus chères
dans la région. Les déplacements sont hypothétiques
a cause d'un système de transport globalement défectueux
(pistes, véhicules de transport, etc.)
PROBLEMATIQUE
Plusieurs raisons fondent notre choix pour le bassin de
Goudomp et pour le thème dont il est le support : Crise
agricole dans une vallée de la Casamance : le bassin de
Goudomp. Il s'agit d'une région en crise dont les
problèmes de développement sont nombreux. Les handicaps sont
de nature diverse : certains ont trait a l'écosystème ( climat
aléatoire, sols pauvres, apparition de sel en aval du bassin...)
tandis que d'autres sont directement socioéconomiques( poids
démographique, taille relative faible des exploitations,
faible niveau de vie de la population, manque de crédit,
système de production...)
La dégradation des conditions climatiques
observée a partir du début des années
1970 dans toute la zone soudano-sahélienne avec
une diminution de la pluviométrie, la faiblesse des crues des cours
d'eau et la forte remontée des biseaux salés a l'intérieur
des vallées a eu comme conséquence majeure la sursalure et
l'acidification des sols alluviaux. Les effets néfastes de cette
péjoration du climat sur les conditions de vie des populations, sur la
répartition des ressources en eau du milieu et globalement sur
l'économie locale, inquiètent les pouvoirs publics qui ont
entrepris des mesures visant a enrayer les processus
de dégradation et a favoriser l'intensification et la
sécurisation de la production agricole dans
les bas- fonds. En effet, zone de concentration des
écoulements de surface, les bas- fonds ont vite attiré
l'attention des acteurs de développement dans le cadre de leurs
recherches de solutions a la crise post- sécheresse du monde
rural. Il a été question d'orientations permettant une
bonne maîtrise et une gestion rationnelle des ressources
en eaux disponibles.
La valorisation des potentialités en eaux et en terres
de Goudomp était a l'ordre du jour dès 1968 et les
premières actions menées par la M.A.C (Mission Agricole Chinoise)
ont porté sur la riziculture inondée. L'objectif visé a
travers ce projet était l'augmentation de la productivité par la
maîtrise de l'eau (petite irrigation, aménagement de diguettes
anti-sel...) ; par l'introduction de nouvelles techniques culturales
(motoculture, culture attelée) et de variétés
améliorées. Mais l'espoir tant suscité par ce
projet n'a été que temporaire. Si
l'objectif de l'amélioration du rendement a
été atteint, il ne s'est pas inscrit dans la
continuité.
Les multiples contre- performances constatées
après leur départ s'expliquent- elles par
l'inadéquation et /ou l'obsolescence technique des infrastructures
et équipements découlant des déficiences dans le
système de gestion des aménagements ? En d'autres termes,
la crise que traversent les paysans du bassin de Goudomp est- elle
liée a leur incapacité a gérer l'héritage de ce
projet?
En 1994, fut mise en oeuvre, sous la houlette des ONG et des
projets tels que le PIDAC et le PROGES, une politique d'aménagement
des bas-fonds rizicoles de Casamance axée notamment sur la
construction de petits ouvrages a coût relativement modique dont celui de
Goudomp. L'objectif est d'empêcher les intrusions des biseaux
salés et de permettre la récupération progressive des
terres. Cette politique a vu l'adhésion totale des villageois qui
participent physiquement et financièrement aux travaux.
En dépit de ces diverses interventions,
aujourd'hui ce bassin, aux potentialités économiques
considérables, a vu la quasi - totalité de ses activités
ralenties, voire arrêtées. Les moyens de tous ordres ont
été réduits, une partie des populations se trouve
déplacée,
les terres continuent a se saliniser et les villages,
jadis prospères, se paupérisent. Cette situation
inquiète plus d'un et suscite beaucoup d'interrogations : faut-
il persister sur la monoculture pluviale du riz alors qu'il y a des
possibilités de diversification en optant pour les cultures de contre-
saison ? Les contraintes physiques ou naturelles constituent- elles le seul
handicap au développement du bassin ? Les difficultés pour le
monde rural de supporter les variations climatiques ne
révèlent- elles pas la fragilité permanente du
système de production ? Pourquoi les hommes ne s'impliquent-
ils pas dans les cultures des bas- fonds ? Sous quelle forme
exploiter les terres récupérées : agriculture
familiale ou villageoise ? L'essor d'une agriculture familiale peut -
elle entraîner dans l'avenir la réalisation des ambitions
de l'autosuffisance alimentaire ? Ces questions n'ont rien
d'exceptionnelle, mais ici elles se posent toutes en même temps et avec
la même acuité. Le problème est donc posé de
savoir s'il est possible de proposer des alternatives aux pratiques
paysannes actuelles, tant en ce qui concerne le choix des
spéculations que les techniques agricoles et l'organisation sociale de
la production.
Par ailleurs, il sera d'une utilité
certaine de savoir comment les populations paysannes
réagissent face aux contraintes qui ont pour nom :
démographie galopante avec comme corollaire la pression sur les
terres ; faible niveau d'investissement, régime foncier qui ne prend
pas en compte la femme principale actrice dans le bas-fond.
La crise agricole dans le bassin de Goudomp est aussi une crise
agraire provoquée par l'insécurité. En effet, la
radicalisation de la crise casamançaise a causé un grand
nombre
de victimes civiles, d'importants mouvements des populations, le
départ précipité de projets
de développement, la chute brutale de la
production et de l'économie locale ainsi que la
désintégration du tissu social. Un phénomène
d'abandon de la terre par les paysans et de marginalisation des migrants
dans les gros bourgs a l'image de Goudomp en sont la
conséquence. Cette concentration des populations
déplacées dans des zones dites
sécurisées provoque le
déséquilibre du binôme population/ressources et
entraîne la détérioration rapide des structures
agraires par le morcellement des exploitations et la diminution du nombre
des unités viables.
Les pouvoirs publics et les collectivités locales ont
dès lors un défi majeur a relever
en ce qui concerne le développement du bassin de
Goudomp. L'accent doit être mis sur le volet «recherche» car
une stratégie d'intervention efficace implique
nécessairement une bonne analyse permettant de connaître les
populations, les ressources du terroir, les systèmes de
fonctionnement de la société et les contraintes
auxquelles elles sont confrontées.
C'est dans cette optique que s'inscrit notre
étude dont le modeste objectif est de dégager sur la
base de données physiques et sociologiques, les
problèmes de développement de ce bassin a travers une mise en
évidence des potentialités et contraintes
du milieu, un diagnostic du système de production et
des structures sociales et une analyse critique de l'action des
différents projets. La place des facteurs physiques ne sera pas
minimisée, mais on cherchera a voir comment ceux- ci se conjuguent avec
un ensemble de facteurs économiques et socioculturels pour
expliquer la fragilisation des systèmes de production ayant aboutit
a une crise généralisée dans le bassin. Une telle
étude, qui n'a pas encore de nos jours été faite,
nous permettra certainement de comprendre pourquoi le bassin de Goudomp,
avec toutes ses potentialités n'arrive pas a assurer la couverture de
ses besoins alimentaires. Notre problématique géographique
ne saurait avoir un sens si nous n'apportions de réponses claires
aux différentes interrogations et proposer une issue palliative. C'est
fort de cela que nous tenterons de présenter, ou mieux de recommander un
ensemble de stratégies qui permettront a l'avenir un
développement agricole «réaliste» du
bassin.
Ce présent mémoire se veut une contribution a
la prise de décision des acteurs du développement. Puisse t-
il permettre d'attirer l'attention des pouvoirs publics, les
collectivités locales, les acteurs privés et partenaires au
développement sur les enjeux de la mise en valeur des bas fonds du
bassin de Goudomp qui exigent des mesures spécifiques
eu égard au niveau de vie précaire de la
population et des souffrances qu'elles endurent. On peut souhaiter
également que cette étude de cas présente un
intérêt pour toute personne qui, dans le cadre de programmes
et de projets, s'interroge sur la façon d'associer les paysans,
les moyens de valoriser leurs expériences et de répondre a leurs
priorités dans les processus de planifications du
développement.
Ce mémoire est divisé en trois parties.
La première étudie la complexité du
développement agricole dans le bassin de Goudomp. Le premier chapitre
de cette partie décrit les potentialités
agropédologiques. A ce titre, il met l'accent sur les atouts du milieu
physique a travers une étude systématique du relief, des bas-
fonds et des disponibilités en eau du sous-sol. Le second
chapitre étudie le climat
comme contrainte et met en évidence le contexte
déficitaire actuel par l'analyse statistique
des données pluviométriques. Dans le
troisième chapitre, il est question d'environnement
démographique, sociologique et socioéconomique. Il
étudie la population (structure, dynamique et
caractéristiques socioéconomiques) dans un premier temps et
insiste sur l'explosion démographique et ses corollaires. Afin de
proposer des solutions adaptées aux problèmes de
développement de la zone, ce chapitre s'intéresse dans un second
temps a une analyse des systèmes de productions existants. Cette
étude aura précisément pour objectifs : d'identifier
les techniques culturales ainsi que les systèmes de cultures
mis en oeuvre dans la vallée ; de repérer et de
hiérarchiser leurs principaux goulets d'étranglements
et d'apprécier ainsi les marges de progrès les plus
accessibles ; de comprendre la logique
de fonctionnement du système tant du point de vue des
contraintes agronomiques que de la finalité socioéconomique.
La deuxième partie :«Maîtrise de l'eau
et développement agricole» est une analyse critique des
projets de développement agricole intervenus dans la vallée. Elle
oppose l'action des projets MAC et PROGES dans la conception des ouvrages, leur
gestion, les moyens et
les résultats obtenus et dresse un bilan global. Le
dernier chapitre de cette partie présente les raisons qui expliquent
l'échec dans le transfert des technologies.
La troisième partie :«Crise, stratégies
paysannes et perspectives» dresse la situation qui prévaut
actuellement dans le bassin. Le premier chapitre analyse le contexte actuel de
la crise dans le bassin. A ce propos, il souligne les manifestations lisibles
de la crise a savoir le recul des cultures traditionnelles, la
paupérisation des ménages et l'émergence d'un secteur
nouveau : l'arboriculture fruitière ; sans perdre de vue les causes ou
facteurs aggravants et
les stratégies paysannes mises en oeuvre pour faire
face aux mutations qu'entraîne la crise. Cette partie se termine
par un chapitre intitulé «Pour une nouvelle approche
du développement local». Ce chapitre tire les leçons
retenues de l'expérience des différentes tentatives de mise
en valeur. Il se fonde sur un ensemble de recommandations de stratégies
pour entrevoir a l'avenir un développement local durable. Il a pour
ambition non seulement
de concevoir des voies et moyens pouvant permettre aux
producteurs d'atteindre leurs objectifs économiques a savoir
l'autosuffisance alimentaire, la minimisation des risques, la maximisation
des revenus par unité de surface ou a l'heure de travail et la
rentabilisation du capital- argent investi, mais aussi de fournir a l'ensemble
des acteurs un canevas pour une mise en valeur optimale du bassin.
METHODOLOGIE
La méthodologie mis en oeuvre pour mener a bien cette
étude peut se résumer en deux points : la collecte des
données et leur traitement.
A. Collecte des données
Pour réaliser une étude judicieuse du
bassin et de ses bas fonds, le recueil d'un certain nombre de
données a été nécessaire. Cela nous a permis de
cerner les contours de notre espace d'étude, tout en dégageant la
structure des caractéristiques des milieux physique et humain.
Les deux principales techniques utilisées pour la
collecte de l'information ont été: la recherche documentaire
et le travail de terrain.
A1 Recherche documentaire
La documentation s'est déroulée tout au long de
l'étude a travers les différentes sources de documentation de
l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Bibliothèque du
Département de Géographie, BRGM, Bibliothèque
Centrale), de l'Université de Rouen (Bibliothèque de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Bibliothèque Universitaire) et au niveau d'organismes
d'études et de recherche du Sénégal (IRD, UICN,
DPS, ISRA, IGN, DAT, DEH) Nous avons aussi visité les archives de
la défunte SOMIVAC, du PROGES et celles
de la SONACOS de Ziguinchor pour avoir les données
sur la production arachidière du
bassin.
Il s'agit d'une analyse globale de la zone a partir du
dépouillement de divers documents préexistants
réalisés par des étudiants ou chercheurs ou produits dans
le cadre
de l'exécution des projets SOMIVAC, MAC, PROGES
(rapports d'activités, études du milieu, documents
thématiques, rapports d'évaluation et de programmation) ou
dans le cadre du plan d'aménagement du territoire (cartes des sols,
recensement de la population...)
A2. Le travail de terrain
Il s'est déroulé dans l'ensemble du bassin et a
consisté en des visites et
observations, des
enquêtes et des entretiens
avec les personnes- ressources. Les objectif assignés
étaient entre autres de :
- déterminer les caractéristiques
socio-économiques et agro techniques du bassin ;
- sonder les progrès accomplis dans le domaine d'une
meilleure gestion de l'eau et de l'adoption de pratiques pour une agriculture
durable ;
- identifier les problèmes agricoles et de gestion des
eaux ;
- quantifier la population vivant dans le bassin ;
- cerner l'organisation sociale de la production ;
- identifier les systèmes de production ;
- établir les calendriers culturaux ;
- estimer les productions agricoles ;
- diagnostiquer et de hiérarchiser les principales
contraintes de production.
Les enquêtes ont eu pour base un échantillon de 150
ménages répartis dans les villages de
Goudomp (100) et Birkama (50) L'explication est simple.
D'abord, les autres villages du
bassin a l'exception de Bacoundi ont été, pour
des raisons de sécurité, désertés de leurs
populations qui se sont installées en majorité a Goudomp ou
Birkama. Ensuite, la commune
de Goudomp compte a elle seule plus des 2/3 de la population du
bassin.
Les difficultés d'ordre matériel et financier
ajoutées aux contraintes de temps, nous ont poussé a adopter le
sondage ponctuel a passage unique. Chaque ménage est
enquêté une seule fois. A ce propos, est
considéré comme ménage tout couple marié ou
adulte (marié ou célibataire) indépendant tant du point de
vue revenus que logement . Tout individu hébergé gratuitement
et/ ou assisté financièrement est en revanche
compté comme dépendant du ménage
d'accueil1.
La méthode d'échantillonnage probabiliste ou
aléatoire a l'avantage de donner a tous
les individus la même chance de faire partie de
l'échantillon. Aussi avons- nous opté pour cette technique
où le hasard va jouer dans la désignation des ménages a
enquêter.
Auprès des ménages enquêtés,
des informations relatives a la structure, la composition et le
revenu des ménages ; mais aussi aux exploitations ont
été recueillies. Ainsi, pour ce qui est de la population
présente sur l'exploitation, on distingua les personnes
a charge de la population active en précisant
notamment leur âge, leur sexe et leur qualification
professionnelle.
La question sur le foncier met l'accent sur le statut :
propriété, location ou emprunt. Quant a l'analyse fine du
système de production, on s'intéresse aux cultures
pratiquées, aux modes de labour et instruments arables, au rendement par
rizière et a la pratique de gestion des ressources naturelles. De ce
fait, on vérifia la logique socioéconomique et mis en
évidence les principales contraintes auxquelles sont confrontées
les paysans.
Dans l'ensemble, 97% des chefs de ménage sont des
hommes, mais on a rencontré des femmes (veuves ou divorcées)
qui ont ce statut. Les ménages sont de grande taille. Un
ménage compte en moyenne 8 a 9 personnes.
Les principales difficultés auxquelles nous nous sommes
confrontés sont diverses. Sur les questions relatives a la production
agricole ou au revenu mensuel, nombre d'enquêtés n'a
pu ou su apporter une réponse satisfaisante. Par
ailleurs, certains chefs de ménage craignaient que l'enquête
ne soit exploitée par le service des impôts. Aussi avons nous dans
plusieurs cas, fait usage de la ruse pour réussir a convaincre les plus
intransigeants.
La mise en valeur du terroir étant avant tout
l'affaire des paysans principaux bénéficiaires, nous avons
réalisé des enquêtes complémentaires
auprès de personnalités qui, du fait de leur âge ou
de leur position sociale ont pu voir évoluer les pratiques
paysannes. Cette enquête menée auprès des témoins
bien informés (notables des différents villages, vieux paysans,
vulgarisateurs agricoles, ex- employés de la MAC , maîtres
d'école, présidentes d'associations de femmes ...) se fit
sous forme d'entretiens très ouverts et
visaient a comprendre quelles ont été dans la
région les transformations récentes en ce qui
1 Définition de ménage par les
enquêtes EDS 1 et 2
concerne les cultures pratiquées (espèces et
variétés), les rotations de cultures, les techniques
employées ; mais aussi pour avoir leur idée sur la gestion des
rizières et recueillir leur point de vue dans la recherche de solutions
aux différentes contraintes.
Des visites, effectuées sur le
terrain nous ont permis d'observer le parcellaire, la morphologie des
champs et de mesurer les dimensions des rizières en vue d'une estimation
des rendements.
B. Le traitement des données
Il se résume au dépouillement des
résultats des enquêtes et entretiens, et leur traitement
informatique avec les logiciels WORD, EXCEL et ADOBE ILLUSTRATOR.
| 


