Liste des figures
Figure I.1 : Voies d'accumulation et de
transfert d'un toxique dans trois maillons de la chaine trophique (TARMOUL,
2010 ; modifié) : la posidonie, l'oursin 07 commun et
l'homme
Figure I.2 : Aspect général d'un
herbier à Posidonia oceanica 08
Figure I.3 :
Un rhizome plagiotrope de Posidonia oceanica portant des
racines ainsi que
des rhizomes orthotropes avec des faisceaux de feuilles à
leurs extrémités 09
Figure I.4 : Structure d'un faisceau de feuilles
de Posidonia oceanica .. 10
Figure I.5 : La matte de posidonie
10
Figure I.6 : Floraison de Posidonia oceanica
11
Figure I.7 : Distribution géographique de
Posidonia oceanica en méditerranée (GIS
Posidonie in BOUDOURESQUE, 2010) 11
Figure
I.8 : Schématisation des principaux rôles de l'herbier de
Posidonie dans
l'équilibre écologique des fonds littoraux
méditerranéens (GIS Posidonie, in
CHARBONNEL et al., 2000) 13
Figure II.1 : Situation géographique de
la baie d'Alger (Google Earth, 2011) 16
Figure II.2 : Nature du fond de la baie d'Alger
(d'après MAOUCHE, 1987 - modifiée) 17
Figure II.3 :
Schéma synthétique de la dynamique littoral dans la baie
d'Alger (d'après
BELKESSA, 2005 - modifiée) .. 18
Figure II.4 : Cimenterie de Rais Hamidou (Photo
: LAMOUTI) .. 19
Figure II.5 : Stratégie
d'échantillonnage et localisation des stations de
prélèvement des
deux zones étudiées 22
Figure II.6 :
(A) prélèvement de sédiment ;
(B) boite en plastique (pour le prélèvement)
; (C) piluliers en verre (pour la conservation
après lyophilisation 23
Figure II.7 : Récupération des
rhizomes 24
Figure II.8 : Récupération des
gonades d'oursins 24
Figure II.9 : (A) Lyophilisateur ; (B) Broyeur
centrifuge à billes 25
Figure II.10 : Procédure de digestion du
sédiment et du matériel biologique pour la détermination
du mercure total par CV-AAS 27
Figure II.11 :
Procédure de digestion du sédiment et du matériel
biologique pour la
détermination de Plomb et Zinc par AAS
29
Figure II.12 : Droite d'étalonnage du
Mercure 31
Figure II.13 : Droite d'étalonnage du
Plomb pour le biote .. 31
Figure II.14 : Droite d'étalonnage du
Plomb pour le sédiment .. 31
Figure II.15 : Droite d'étalonnage du
Zinc .. 31
Figure II.16 : Réactifs de GRIESS pour le
dosage de nitrite 34
Figure II.17 : Droite d'étalonnage de
l'Ammonium 35
Figure II.18 : Droite d'étalonnage de
Nitrite ... 35
Figure II.19 : Droite d'étalonnage de
Nitrate . 36
Figure II.20 : Droite d'étalonnage
d'Orthophosphate . 36
Figure II.21 : Droite d'étalonnage du
Silicium dissous 36
Figure II.22 : (A) Balance; (B) Filtre WHATMAN
GF/C 36
Figure II.23 : (A) four à moufle ; (B)
creuset en porcelaine 37
Figure III.1 : Histogramme comparant les
concentrations moyenne de Mercure (Hg) en ìg/g P.S dans les
sédiments des zones étudiées avec les zones de
référence non polluées : Corne d'Or (baie de Bou-Ismail,
Algérie in TARMOUL, 2010) ; Canari (Corse, France in
LAFABRIE, 2007) . 39
Figure III.2 : Histogramme
représentant les concentrations moyenne de Plomb (Pb) en ìg/g P.S
dans les sédiments des zones étudiées avec la zone de
référence : baie d'Alger (BOUDJELLAL et al., 1992),
Alger plage (SOUALILI et al., 2008) et frange littorale Nord-Ouest du
Golf de Tunis (RAIS et GUEDDARI, 1992) 40
Figure III.3 : Histogramme de comparaison des
concentrations moyennes de Zinc (Zn) en ìg/g P.S dans les
sédiments des zones étudiées avec la zone de
référence Corne d'Or (TARMOUL, 2010) et le seuil de contamination
(MOORE et RAMAMOORTHY, 1984 in ALZIEU et al., 1999) ..
41
Figure III.4 : Indice de Contamination en
Mercure (Hg) des sédiments des zones étudiées par rapport
aux zones de référence : Corne d'Or (baie de BouIsmail,
Algérie in TARMOUL, 2010) et Canari (Corse, France in
LAFABRIE, 2007) .. 42
Figure III.5 : Indice de Contamination en
Plomb (Pb) des sédiments des zones étudiées par rapport
aux zones de référence : Sidi Fredj et Tamentfoust (SOUALILI
et al., 2008) . 42
Figure III.6 : Indice de Contamination en
Zinc (Zn) des sédiments des zones d'étude par rapport à la
zone de référence Corne d'Or (TARMOUL, 2010) et le seuil de
contamination (MOORE et RAMAMOORTHY, 1984 in ALZIEU et al.,
1999) . 43
Figure III.7 : Histogramme décrivant
les concentrations en Mercure des rhizomes dans les zones
étudiées avec les zones de référence : Corne d'Or
(baie de BouIsmail, Algérie in TARMOUL, 2010) et Calvi (Corse,
France in LAFABRIE, 2007) .. 45
Figure III.8 : Histogramme comparant les
concentrations de plomb dans les rhizomes des zones étudiées avec
les zones de référence : Calvi, (France in WARNAU et
al., 1995 et LAFABRIE, 2007) 46
46
Figure. III.9 : Histogramme comparant les
concentrations de zinc dans les rhizomes dans nos zones étudiées
avec les zones de référence : Corne d'Or (baie de Bou-Ismail,
Algérie in TARMOUL, 2010) et Calvi, (France in WARNAU
et al., 1995) .
Figure III.10 : Histogramme comparant les
concentrations de mercure dans les gonades
d'oursin commun des zones étudiées avec celles des
zones de référence :
Corne d'Or (baie de Bou-Ismail, Algérie in
TARMOUL, 2010) et Calvi
(Corse, France in WARNAU et al., 1995)
48
Figure III.11 : Histogramme comparant entre les
concentrations en Plomb dans les
gonades d'oursin commun des zones étudiées avec
celles de la zone
de Calvi (Corse, France in WARNAU et al., 1995)
et port de cap de
l'eau (Maroc in DEMNATI et al., 2002) .
49
Figure III.12 : Histogramme comparant les
concentrations de zinc dans les gonades
d'oursin commun étudiées avec celles des zones de
référence :
Corne d'Or (baie de Bou-Ismail, Algérie in
TARMOUL, 2010) et,
Marseille (France in WARNAU et al., 1995) ..
50
Figure III.13 : Histogramme représentant
le facteur de biosédiment de Hg, Pb et Zn
chez la posidonie et l'oursin dans la zone d'Alger plage
51
Figure III.14 : Histogramme décrivant le
facteur de biosédiment de Hg, Pb et Zn chez
la posidonie et l'oursin dans la zone de Rais Hamidou
51
Figure III.15 : Variation de Nitrite, Nitrate et Orthophosphate
des eaux de surface
d'Alger plage 53
Figure III.16 : Variation d'Ammonium des eaux de
surface d'Alger plage . 53
Figure III.17 : Variation de silicate des eaux
de surface d'Alger plage 54
Figure III.18 : Variation de Nitrite, Nitrate et
Orthophosphate des eaux de surface de
Rais Hamidou 54
Figure III.19 : Variation d'Ammonium des eaux de
surface de Rais Hamidou . 54
Figure III.20 : Variation de Silicate des eaux
de surface de Rais Hamidou 55
Figure III.21 : Histogramme présentant
les concentrations en Ammonium (NH4 +) dans
les deux zones étudiées . 55
Figure
III.22 : Histogramme des concentrations en nitrite (NO2 -) dans les
deux zones
étudiées . 56
Figure III.23 :
Histogramme des concentrations en nitrate (NO3 -) dans les deux
zones
étudiées . 57
Figure III.24 :
Histogramme des concentrations en Orthophosphate (PO43-)
dans les
deux zones étudiées .. 57
Figure III.25 : Courbe de tendance entre le N et
P dans la zone d'Alger plage 58
Figure III.26 : Courbe de tendance entre le N et
P dans la zone de Rais Hamidou 58
Figure III.27 : Histogramme des concentrations
en silicium dissout (SiO2) dans les
deux zones étudiées .. 59 Figure III.28
: Courbe de tendance entre le PO43- et SiO2 dans la zone
d'Alger plage .... 59 Figure III.29 : Histogramme des
concentrations des MES (mg/l) dans les deux zones
étudiées 60
Figure III.30 :
Histogramme des concentrations de MO (mg/l) dans les deux zones
étudiées . 62
Figure III.31 :
Histogramme des rapports MO/MES en % dans les deux zones
étudiées 62
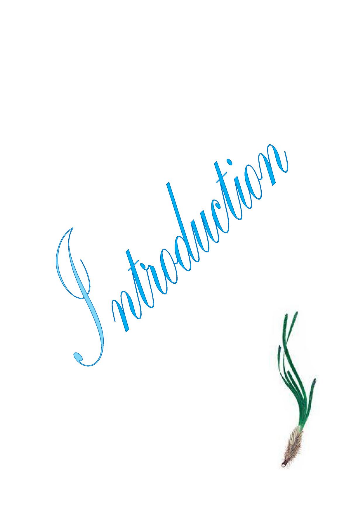
La pollution des écosystèmes marins et littoraux
est un problème environnemental majeur ; qui représente un
véritable danger pour la santé publique, les facteurs qui en sont
responsables ne cessent de s'accroître, surtout par l'action anthropique,
en raison principalement de la pression démographique et du
développement technologique des villes, plus accentuées sur les
zones côtières.
La zone méditerranéenne a été
classée par le PNUE comme l'une des cinq régions du monde
où les problèmes environnementaux sont les plus graves, alors que
la mer Méditerranée est classée parmi les sept mers les
plus menacées (BOUDOURESQUE, 1996).
Ces dernières décennies, les activités
anthropiques (la pollution du milieu marin, la pêche irresponsable,
l'urbanisation anarchique du littoral, etc.), ont rendu les
écosystèmes Méditerranéens dangereusement
vulnérables.
La côte algérienne est située dans le
bassin Algeroprovençal (Méditerranée occidentale), partie
intégrante de la Méditerranée qui est concernées
de facto par les préoccupations d'ordre environnementales de
l'ensemble de la région.
Le long de la côte algérienne (1622,8 km),
diverses sources de pollution ont des impacts non négligeables sur le
milieu marin. Les villes côtières les plus polluées sont
principalement Annaba, Alger et Oran.
La zone d'étude (Baie d'Alger) est une région
qui reçoit quotidiennement des flux de pollution de différents
types, essentiellement les rejets urbains et industriels (d'oued el Harrach et
el Hamiz, de port d'Alger, la cimenterie de Rais-Hamidou,...), les rejets
d'origine agricoles lors des lessivages des bassins versants sont aussi non
négligeables, ainsi que la pollution directe par l'homme (plage de
baignade, complexes touristiques, etc.)
La contamination métallique des
écosystèmes aquatiques a attiré l'attention de chercheurs
d'horizons très différents. Elle constitue en effet l'un des
aspects de la pollution le plus menaçant pour ces milieux. Par ses
effets toxiques, elle est capable d'engendrer des situations critiques voire
dangereuses. Contrairement à de nombreux toxiques organiques, les
éléments en traces métalliques ne sont pas totalement
éliminés par voie biologique et par conséquent sont sujets
à un effet cumulatif dans les diverses compartiments de
l'écosystème (eau, sédiment, faune et flore).
La biosurveillance de la qualité des eaux littorales
nécessite l'utilisation d`espèces bioindicatrices de la
qualité des écosystèmes, afin d'évaluer
l'état de pollution.
La magnoliophyte Posidonia oceanica est un
bioindicateur résistant à la contamination métallique
(FERRAT et al., 2002) présentant un fort pouvoir de
concentration en éléments traces, proportionnel aux teneurs
présentes dans le milieu (PERGENT-MARTINI et PERGENT, 2000).
L'échinides Paracentrotus lividus étant
un brouteur de posidonie, présentant un potentiel bioaccumulateur assez
considérable, pouvant fournir ainsi des renseignements précieux
sur les transferts trophiques des différents polluants
étudiés (WARNAU et al., 2006) .
Notre travail est une modeste contribution à
l'évaluation du degré de pollution chimique au sein de
l'écosystème à Posidonia oceanica de deux zones
d'études situées dans la baie d'Alger (Alger plage et
Rais-Hamidou), afin de permettre une meilleure connaissance de l'état de
santé des herbiers et du milieu où ils se trouvent, pour une
meilleure gestion et protection du littoral.
Pour cela nous avons procédé à :
l'estimation de la contamination métallique par la méthode de
spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA) dans trois compartiments
(La posidonie, l'oursin et le sédiment), la détermination
d'indice de contamination, facteur du bio-sédiment contribue à
l'évaluation d`une éventuelle pollution qui est susceptible de
menacer l'écosystème à posidonie au niveau des deux zones
d'étude.
Nous avons également analysé les teneurs en sels
nutritifs, la matière en suspension et la matière organique ;
afin de déterminer l'origine et la nature de la pollution causée
par ces derniers.
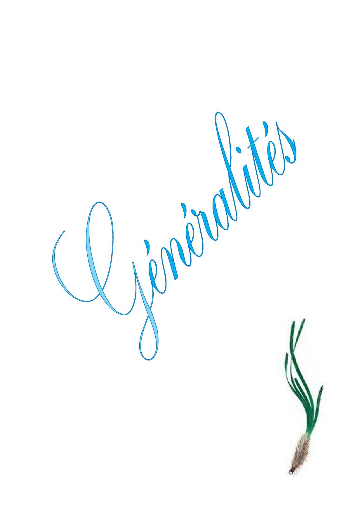
I.1. LA POLLUTION CHIMIQUE MARINE
I.1.1. LA POLLUTION MARINE
La pollution marine a été définie par la
Commission Océanographique Internationale de l'UNESCO comme étant
: « ... l'introduction par l'homme Dans le milieu marin (y compris les
estuaires), directement ou indirectement, de substances ou d'énergie
dans l'environnement marin pouvant entraîner des effets
délétères, tels que dommages aux ressources biologiques,
dangers pour la santé humaine, entraves aux activités maritimes,
y compris les pécheries, détérioration des qualités
de l'eau de mer pour son utilisation et réduction des
possibilités dans le domaine des loisirs » (UNESCO, 1973).
Il existe plusieurs types de la pollution marine : pollution
chimique, pollution physique, et pollution biologique.
| 


