UNIVERSITÉ DE
LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DE DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT PAR LES GROUPES ARMES A L'EST DE LA RDC
Mémoire présenté par Carlos
MUPILI KABYUMA
Sous la direction de Mme SEVERINE NADAUD, Maitre de
conférences en droit privé
Août 2012
UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE DROIT INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DE DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT PAR LES GROUPES ARMES A L'EST DE LA RDC
Mémoire présenté par Carlos
MUPILI KABYUMA
Sous la direction de Mme SEVERINE NADAUD, Maitre de
conférences en droit privé
Août 2012
REMERCIEMENTS
Nous remercions Madame SEVERINE NADAUD pour avoir
accepté d'encadrer avec professionnalisme notre travail alors que nous
étions à l'étranger, et Monsieur FRANCOIS PELISSON pour
sa disponibilité sans lasse à résoudre nos
problèmes tout au long de notre formation.
Nous remercions également notre mère AGATHE
TALUYAMINE et notre défunt père MARTIN KABUKA MUTIMA qui,
à travers leur éducation, nous avons appris le plaisir
d'apprendre sans cesse.
Nous remercions nos enfants Agathe Mupili, Saint esprit Mupili
et Martino Mupili pour leur soutien moral dans le moment difficile.
Que tous nos collègues aux souvenirs riches et
inexprimables trouvent ici l'expression de notre gratitude pour les
débats animés aux cours de notre formation.
ABREVIATIONS et SIGLES
AFDL : alliances de forces
démocratiques pour la libération du Congo
AMFI : Americal mineral field
incorporation
APs :Aires protégés
CICR: Comité International de la Croix
rouge
CPI: Cour pénale Internationale
CNDP: Congrès National pour la
défense du peuple
DSRP : Document spécial pour la
réduction de la pauvreté
EAD : Entité Administrative
Décentralisée
ECNEF : Environnement, Conservation de la
Nature, Eau et Forêt
FARDC :forces armées de
République démocratique du Congo
FDLR : Forces démocratiques pour
la libération du Rwanda
FPLC : les Forces Patriotique pour la
Libération du Congo
FC : Francs Congolais
EIE : Etudes d'Impact
Environnemental
HCR : Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés
FUSO : Marque d'un véhicule de
transport
GIC : Gilman Investiment company
GRIP : Groupe de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité
BICC : le Bonn International Center for
Conversion
ICCN : l'Institut Congolais pour la
Conservation de la conservation de la Nature
LRA: Lord's Resistance Army
ou armée de Resistance de Seigneur
UPC : Union des Patriotes
Congolais
USAID : United States Agency for
International Development (Agence des Etats-Unis pour le développement
international)
UNESCO : United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture)
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
M23 : (Rébellion de )mouvement
23
MLC : Mouvement de Libération du
Congo
MONUC: Mission d'observation des Nations
Unies au Congo
MONUSCO: Mission des Nations Unies pour la
stabilisation du Congo
ONU: Organisation des Nations Unies
OCDE : Organisation pour la
Coopération et le Développement en Europe
ONG : Organisation Non Gouvernementale
RDF: Forces Rwandaises de Défense
RCD: Rassemblement Congolais pour la
Démocratie
RCD-N: Rassemblement Congolais pour la
démocratie-Nationale
RCD-K-ML: Rassemblement congolais pour la
démocratie -Kisangani-Mouvement de Libération
PNG: Parc National de Garamba
PNVi: Parc National de Virunga
PNKB: Parc National de Kahuzi -Biega
PNUD : Programme des Nations Unies pour
le Développement
PNS: Parc National de Salonga
SPLA : Armée Populaire pour la
libération du Soudan
WWF: World Wildlife Fund ( Fonds
Mondial pour la nature)
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PARTIE PREMIERE : LES CONFLITS ARMES ET CONSEQUENCES
ENVIRONNEMENTALES EN RDC
Chapitre I : Les Conflits armés en RDC
Section I: Des raisons et l'évolution des conflits
armés en RDC
Section II : Les principaux acteurs des conflits
armés en RDC
Chapitre II : les Impacts et les Conséquences sur
l'environnement en RDC
Section I : Atteintes graves portées sur les Parcs
Nationaux et les Aires Protégées
Section II : Conséquences sur l'environnement
SECONDE PARTIE : DE L'APPLICATION DES INSTRUMENTS
JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN RDC
Chapitre I : Renforcer l'application des Instruments
juridiques internationaux pour la protection de l'environnement
Section I : Sources de DIE
Section II : De la réception des instruments
juridiques internationaux en vigueur au niveau national
Chapitre II : Des Poursuites judiciaires contre les
auteurs des violations de droit de l'environnement
Section I : Poursuites des auteurs devant les
juridictions nationales congolaises
Section II : Poursuites des auteurs devant les
juridictions internationales
CONCLUSION
INTRODUCTION
« Les conférences de Nations Unies sur
l'environnement tenues respectivement à Stockholm, en 1972, et à
Rio de Janeiro en 1992, avaient conduit la communauté Internationale
à accorder une attention plus accrue aux problèmes de
l'environnement, face aux dangers prévisibles de sa dégradation.
Parmi ces dommages causés à l'environnement figurent notamment la
diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air et
de l'eau, la destruction des couches d'ozone, la diminution de la
fertilité du sol, la désertification, l'épuisement des
ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine
naturel et culturel » 1(*)
Le sommet de la planète terre de la conférence
des Nations Unies à Rio de 1992 s'est engagé à promouvoir
et protéger le droit de l'environnement à travers la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
principes de gestion des forêts adhérée par les Etats
membres pour la promotion de développement durable.
Bien que la Déclaration de
Rio oblige moralement les Etats membres à observer ces principes
généraux , ces dernières décennies, les atteintes
à l'environnement ne font que persister voire s'agrandir dans nombreux
pays du sud.
Pourtant il est
demandé aux Etats de « promulguer des mesures
législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes
écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de
l'environnement devraient être adaptés à la situation en
matière d'environnement et de développement à laquelle ils
s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas
convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en
développement, et leur imposer un coût économique et social
injustifié. »2(*)Par environnement, il faut
entendre d'un« ensemble des éléments naturels ou
artificiels et bien équilibrés biologiquement et
géochimiques auquel ils participent, ainsi que les facteurs
écologiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la
transformation et développement du milieu, des organismes vivants et des
activités humaines. »3(*)
Les Etats ont donc l'obligation de prendre toutes les mesures
qui s'imposent allant de la prévention à la répression
pour lutter contre toute atteinte à l'environnement car ces obligations
résultent du devoir pour les Etats de prendre des dispositifs juridiques
afin de respecter, protéger, promouvoir et rendre effectif le droit de
l'environnement .Cela passe également par le renforcement de
l'appareil judiciaire pour poursuivre les auteurs à répondre
civilement et,ou pénalement de leurs actes.
Néanmoins, tel n'est souvent pas le cas lorsqu' un pays
traverse une période de guerre. Ainsi, importe-t-il de présenter
la problématique du sujet, son intérêt et sa
délimitation avant d'indiquer la démarche méthodologique
et son plan sommaire.
PROBLEMATIQUE
« La problématique signifie problème
à résoudre par des procédés scientifiques. Comme
substantif, elle désigne un ensemble des questions. »4(*)
La RDC est un grand pays situé géographiquement
au centre de l'Afrique et traversée par l'Equateur avec une superficie
de 2 345 410 km² et une population estimée environ à
67.757 577 d'habitants5(*).
Elle est entourée de neuf pays voisins .Elle dispose d'une ressource
environnementale très remarquable, ainsi que des richesses en sol et en
sous sol. Ses 120 millions d' ha de forêts denses humides constituent le
deuxième poumon du monde d'autant qu'elles recyclent le dioxyde de
carbone et libèrent l'oxygène dont la planète a besoin
pour survivre. En outre, la RDC regorge d'un potentiel aquatique
élevé en eau douce. La superficie des plans d'eau
représente 35% de la superficie du territoire national.
Cependant, cela fait 14 ans environ que la situation
écologique se dégrade de jour en jour à l'est de la RDC
suite aux successions de guerres avec aucun espoir de pacification
réelle malgré la présence des forces de la Monusco aux
côtés des FARDCS. La nature changeante de la guerre a connu de
multiples formes. En dehors de ces successions de conflits, il ya un conflit
armé permanant qui se vit à l'est du pays où les acteurs
sont des milices armées qui échappent au contrôle de
l'autorité de l'Etat par conséquent elles exercent leurs
pouvoirs sans observer ni le droit humanitaire et ni le droit de
l'environnement. Ils érigent leur quartier général et
cantonnent leurs combats dans les forêts où ils portent atteinte
à l'écosystème.
Sur le plan de la législation et des
réglementations, la gestion de l'environnement congolais est bien
fournie de textes juridiques. En outre, la RDC est signataire de plusieurs
conventions internationales, ce qui la dote des instruments juridiques pour la
protection de l'environnement. Plusieurs accords sous bénédiction
de la communauté internationale soutiennent la pacification du pays et
mettent en place des précautions dissuasives pour décourager les
auteurs de ces crimes internationaux et sauvegarder tout ce qui a trait
à la dignité de la vie humaine. Nous faisons allusion à la
signature de l'Etat Congolais aux statuts de Rome dont plusieurs chefs de
guerre répondent de leurs actes devant la Cour Pénale
Internationale(CPI).
Même si, la catastrophe humanitaire tient en
état celle de l'environnement, cette dernière ,après neuf
ans de la réunification et de la pacification relative du pays, semble
être traitée timidement et d'une manière sporadique par
les autorités du pays .Les groupes armés érigent leurs
sièges dans les aires protégés où ils vivent de la
chasse des animaux protégés dans les parcs, ils y abattent des
arbres pour leurs habitations et pour faire des bois de chauffage; exploitent
illicitement des mines sans une étude d'impact environnemental et
social dans les rivières et montagnes, et enfin la pollution des eaux ,
source de plusieurs maladies contagieuses et infectieuses entrainant des
épidémies mortelles.
Les conventions internationales constituant les instruments
juridiques internationaux pour la protection de l'environnement sont
signés et ratifiés par l'Etat congolais qui est timide à
les appliquer dans la lutte contre les violations de droit de l'environnement
par les groupes armés. Or, de multiples solutions peuvent être
envisagées mais la plus facile est celle qui a un lien avec droit
international de l'environnement où les responsabilités des
auteurs seraient établies devant les juridictions soit internes soit
internationales afin de décourager ces crimes odieux contre
l'environnement.
Vu l'état sombre sur l'environnement et la
tendance à s'habituer à l'impunité face aux violations de
droits de l'environnement malgré la volonté exprimée de
l'Etat congolais de se doter des instruments juridiques et des structures
organisationnelles de gestion de l'environnement, plusieurs interrogations ont
pu être posées afin de trouver une réponse dans cette
étude.
Pourquoi la violation de droit de l'environnement
continue environ une décennie alors que l'Etat Congolais a
ratifié plusieurs conventions internationales pour la protection de
l'environnement ?Quelles sont ces violations et qui en ont les acteurs
principaux dans les conflits armés actuels à l'Est du pays ?
Comment faire pour éradiquer ces atteintes à l'environnement et
le protéger ?
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Selon P.RONGERE, « l'hypothèse est la
proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos
de l'objet recherche, formulée en des termes tels que l'observation et
l'analyse puissent fournir une réponse, elle n'est rien d'autre que le
fil conducteur pour un chercheur engagé. »6(*)
« L'environnement ne peut pas être la
préoccupation principale quand des vies humaines sont en danger ou que
des valeurs humaines fondamentales doivent être
défendues. »7(*)Ce principe justifie la politique des autorités
du pays qui sont souvent contraintes de résoudre les problèmes
humanitaires dans la politique de la défense et sécurité
contre cette insécurité récurrente à l'est de la
RDC.L'urgence humanitaire pour l'Etat congolais pendant les conflits
armés serait au premier plan reléguant au second plan les
problèmes environnementaux.
En outre, en période de guerre l'effectivité du
droit international de l'environnement poserait problème dans sa mise en
application.
La société civile pour la protection de
l'environnement ne se comporte pas encore comme un groupe de pression suffisant
sur des décideurs politiques et judiciaires compétents pour agir
contre ce drame écologique.
L'absence d'une formation adéquate sur la convention de
Genève ou de droit international de la guerre par la CICR aux acteurs en
conflits armés serait à la base de tous ces crimes humanitaires
et environnementaux car ils ignorent les règles de la guerre.
Les principaux auteurs de violations de l'environnement
seraient d'abord les troupes étrangères à l'instar des
rwandais et ougandais qui auraient déporter certaines espèces
rares dans leurs pays et massacrent intentionnellement d'autres par sabotage,
mais aussi les milices armées à l'occurrence de FDLRS,LRA, et les
Mai Mai.
III.CHOIX ET INTERET DU SUJET
Quoi qu'il en soit la question environnementale est
renvoyée après la question
humanitaire ; « Cependant, après les conflits, c'est
sur l'environnement et ses ressources que devra se fonder la reconstruction.
On connaît à ces fins l'importance de l'eau, de la
biodiversité, de la forêt, des espaces agricoles. Les dommages
causés à ces ressources peuvent entraîner, bien
après les conflits, des effets néfastes, voire létaux, sur
les populations affectées. »8(*)Il est indispensable d'une part de démontrer
l'état critique où se situe l'environnement à cause des
ces hostilités récidivistes et d'autre part avertir ces auteurs
de violation de droit de l'environnement que ces actes sont désormais
condamnables et ils sont dans l'obligation d'observer le droit international de
l'environnement et d'autres textes juridiques pour qu'ils répondent
dans l'avenir devant la justice.
Cette étude a un apport théorique à tout
lecteur d'être informé sur le cadre juridique relatif à
la question environnementale et de l'interpeller devant ses
responsabilités à lutter contre la destruction de
l'écologie en dénonçant les auteurs auprès des
services compétents.
Sur le plan pratique, cette étude contribue à
relever le déficit opérationnel de cadre juridique en vigueur et
sert d'éveil de conscience pour arrêter les actes
précités.
IV. METHODES ET TECHNIQUES
A. METHODES
La réalisation d'un travail exige qu'il soit mis en
place une démarche scientifique ou mieux des méthodes et des
techniques.
Pour M. GRAWITZ, « la méthode est l'ensemble
des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie. »9(*)
Pour aborder scientifiquement notre recherche, le choix de la
méthode juridique nous permet à consulter les textes juridiques,
les conventions internationales en rapport avec la protection de
l'environnement.
Le choix de la méthode sociologique nous permet
d'interpréter d'une manière exégétique de ces
textes juridiques en s'inspirant des réalités sociales du
terrain.
B.TECHNIQUES
Les techniques10(*) sont des outils mis à la disposition de la
recherche et organisés par la méthode pour ce but.
La technique d'observation des situations
expérimentées nous permet d'entrer en contact avec plusieurs cas
de violation environnementale dans les aires protégées et des
espèces menacées de disparition ,visiter les eaux et cours d'eaux
pollués ,les atteintes aux ressources naturelles et l'exploitation
illicite des mines.
L'interview libre quant à elle nous a permis à
réaliser un face à face avec les différents acteurs en
conflits, les membres des ONG,les responsables de l'ICCN et du Ministère
de l'environnement sans oublier les personnes qui vivent à
côté de ces aires protégés.
L'internet devenant la bibliothèque virtuelle nous a
suffisamment fourni d'informations pour l'élaboration de ce travail
V. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Ce travail est déterminé dans le temps et dans
l'espace. Du point de vu spécial cette étude porte sur l'est de
la RDC.
Du point de vu temporel, nos investissements s'entendent de
la période allant de 1998 à 2012.
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail, hormis l'introduction et la conclusion, fera
l'objet deux parties dont chacune deux chapitres.
La première partie sera consacrée aux conflits
armés et ses conséquences environnementales en RDC. Elle
comprendra deux chapitres le premier traitera sur les conflits armés en
RDC .Le second quant à lui présentera les impacts et
conséquences des conflits armés face à l'environnement.
La seconde partie se penchera sur l'application des
instruments juridiques internationaux pour la protection de l'environnement en
RDC et comprendra deux chapitres. Le premier chapitre abordera comment
renforcer l'application des instruments juridiques internationaux pour la
protection de l'environnement. Le second portera sur les poursuites judiciaires
contre les auteurs de violations de droits de l'environnement.
VII. DIFFICULTES RENCONTREES
Cette étude ne s'est pas déroulée sans
difficultés. Les recherches sur terrains nous ont coûté
beaucoup d'argent, l'accession aux informations sur le sujet d'étude ne
nous a pas été facile. Quoi qu'il en soit, nous avons
utilisé quelques stratégies pour les contourner et pouvoir vous
présenter en ce jour ce travail.
Première partie : LES
CONFLITS ARMES ET SES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES EN RDC
« Au-delà des enjeux humanitaires
évidents, les conflits armés soulèvent d'importants et de
cruciaux enjeux environnementaux. Ces enjeux paraissent de plus en plus
évidents quand on songe aux effets immédiats que peuvent
engendrer les déplacements massifs de populations ou l'installation de
camps de réfugiés. En toutes autres circonstances, les
déplacements de populations, d'une ampleur beaucoup plus faible, font
l'objet de mille précautions sur le plan environnemental et constituent
en soi presque un champ entier de spécialisation des évaluations
environnementales. Par ailleurs, les situations de conflit anticipé ou
ouvert, ou les tensions qui les précèdent et les accompagnent,
mobilisent en général dans les pays impliqués des
ressources financières pour l'armement ou le déploiement et la
stratégie militaire, ressources qui ne sont plus disponibles pour le
bien-être et le développement économique des
populations. »11(*)Ainsi, à chaque début d'exécution
du programme de la reconstruction du Congo, une nouvelle guerre s'improvise et
amène la grande partie du budget national d'être affecté
dans la défense nationale pour une intervention sécuritaire
laissant la pauvreté s'accroitre.
« Les conflits armés s'accompagnent aussi
d'un effondrement de la gouvernance environnementale, qui engendre à son
tour une dégradation accélérée de l'environnement.
En quelques jours, ou en quelques semaines, peut être détruit le
long et patient travail de plusieurs années, voire le travail naturel de
plusieurs millénaires. Parfois la destruction provoque des
dégradations irréversibles dans les écosystèmes ;
c'est le cas lorsque des espèces peuvent être amenées
à l'extinction, ou que des écosystèmes fragiles peuvent
être irréversiblement dégradés, ou des ressources
irrémédiablement détruites ou contaminées. Tous les
systèmes de protection institutionnelle, telles les Aires
Protégées (A .P)ou les Parcs Nationaux (PN)deviennent des
zones d'appel de personnes déplacées ou de combattants, avec des
conséquences immédiates, et souvent irréversibles, sur la
qualité de ces écosystèmes. »12(*) La répétition de
conflits armés dans l'est de la RDC n'avance point les choses au
contraire l'intérêt supérieur national est confisqué
par une poignée de gens criminels où tout effort de bonne
gouvernance ne fait que tourner à rond.
Cette première partie abordera deux chapitres dont le
premier chapitre porte sur les conflits armés en RDC et le second
chapitre traitera sur les impacts et conséquences de l'environnement.
Chapitre premier : LES
CONFLITS ARMES EN RDC
Ce premier chapitre s'articule sur deux sections dont d'abord,
De confits armés à l'est de la RDC et ensuite les principaux
acteurs et forces en présence dans les conflits armés.
Section I : RAISONS ET
EVOLUTIONS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC
Des Raisons et l'évolution des conflits armés
en RDC peut être compris en deux axes d'abord, les raisons et enjeux des
conflits armés en RDC ensuite, l'évolution des conflits
armés en RDC.
§1.Raisons et Enjeux du
Conflit Armes En RDC
L'histoire sur les conflits armés en RDC fait couler
beaucoup de salives dans la recherche des vraies raisons et enjeux de cette
monotonie des guerres ; pour les populations rwandophones autrement dit
Banyamulenges13(*), ce
sont les guerres de la défense d'identité ethnique car il faut
se défendre lorsqu'on fait partie d'une minorité
discriminée , exposée à l'extermination. Mais, la
thèse ne convint personne car sur 450 tribus congolaises, aucune tribu
n'est ni minoritaire ni majoritaire. Cela laisse à penser que le
régime de Kigali manipule les tutsis congolais en les jetant dans une
guerre sans merci où tout le butin traverse au Rwanda qui a son tour
rend compte aux multinationales. Il est certain que les différentes
guerres ont fait périr de dizaines des milliers de banyamulenges
utilisés comme des chevaux de courses dans ces conflits. Ce qui est la
raison de révolte du Général tutsi Masunzu.14(*) Pour le Rwanda, sa version
est qu' il doit sécuriser ses frontières contre les attaques des
FDLR et interahamwes ex génocidaires. Cette hypothèse ne convint
aussi plus car le Rwanda sous label du RCD a contrôlé l'est du
pays pendant cinq ans mais il s'est plus préoccupé des pillages
de richesses au lieu de traquer des combattants hutus. 15(*) La société
civile congolaise par contre, elle est unanime que c'est la convoitise de
richesses par des firmes multinationales qui utilisent les pays voisins Rwanda
et l'Ouganda. En outre, l'insécurité permanente et
meurtrière, justifie le processus de la balkanisation16(*) du pays. Cette deuxième
version provoque une tension au sein de la population locale .La thèse
de la société civile semble proche de réalités de
plusieurs publications et témoignages susmentionnés des
personnalités officielles des Etats occidentaux17(*).Enfin, il convient à
dire que les raisons des ces guerres sont d'ordre holistique.
§2. Evolution des Conflits
Armes en RDC (1997-2012)
« Le 17 mai 1997, la République du
Zaïre devient, à la faveur de la chute du régime Mobutu et
de la victoire de l'Alliance des Forces démocratiques pour la
Libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré
Kabila, la République démocratique du Congo. Porteur des
innombrables attentes de son peuple, le président Kabila est
confronté à un défi de taille : redresser la barre d'un
pays ruiné par trente ans de corruption et de mauvaise gouvernance. Le
défi est d'autant plus gigantesque que le nouveau régime doit
à son tour faire face à partir du 2 août 1998 à
l'éclatement de plusieurs rébellions
armées »18(*).
A la faveur de l'éclatement du RCD en une multitude de
fractions rebelles concurrentes et de la querelle qui se fait jour entre Kigali
et Kampala, les forces gouvernementales après avoir formé
plusieurs brigades de jeunes volontaires parviennent avec l'aide des
armées zimbabwéenne, angolaise et namibienne à stabiliser
le front de bataille qui s'étend de Pweto au sud est à
Mbandaka-Libenge au nord ouest. La RDC est virtuellement morcelée en
plusieurs entités administrées de façon autonome par les
différents belligérants et leurs alliés locaux
(rébellions, groupes maï maï ). Au début,
l'armée rwandaise a tenté de capturer ceux qui étaient
responsables de génocide ; toute fois, elle a changé
de cap et commencé ouvertement à exploiter les ressources
naturelles de la région. Les diamants, l'or, les minerais, le gaz et le
coltan figuraient parmi les produits les plus recherchés. « On
estime qu'au cours d'une période de 18 mois, l'armée rwandaise a
récolté plus de 250 millions de dollars uniquement de la vente de
coltan. »19(*)Signalons que cette exploitation minière
était exécutée sans une étude d'impact
d'environnement et social. « Au fil des mois, les différents
belligérants vont développer des stratégies d'exploitation
illégale des richesses naturelles du Congo ; stratégies dont les
revenus permettent de financer les dépenses militaires et d'autofinancer
la guerre. Ainsi, tandis que le conflit s'enlise, les principaux affrontements
se déroulent désormais sur le front non officiel
concentré à l'intérieur des zones contrôlées
par les rebelles et leurs alliés, dans les zones d'importance
économique évidente, à proximité des gisements de
diamant à Mbuji Mayi et à Kisangani, des sites aurifères
ou des zones potentiellement riches en coltan du Kivu, des plantations de
café, de thé ou de papaïne »20(*).Et pour évacuer leurs
butins ,les lignes aériennes directes entre les villes minières
congolaises avec Kampala et Kigali étaient instituées par les
autorités des ces pays envahisseurs sous le regard impuissant de la
MONUC. Cet essor de l'économie de guerre dans l'Est du Congo contribue
considérablement à la dynamique de scissions en cascade, de
prolifération et de radicalisation des mouvements armés
présents au Congo. A cette nouvelle économie de guerre correspond
une forme d'organisation politique basée sur une extrême
dureté à l'encontre des populations civiles à l'instar de
la politique de terreur, recrutements forcés, utilisation d'enfants
soldats et les viols de femmes avec ses diversités : viol comme
arme de guerre , viol systématique, viol punition et viol collectif.
Ceci est à la base de taux élevé du sida
car « la prévalence du VIH/SIDA parmi les combattants de
la guerre au Congo étant de 60 pour cent. »21(*)
Aucun village du Kivu ne peut ainsi se prévaloir
d'être à l'abri de pillage, des massacres ou déplacements
de populations et de la dégradation environnementale. «
La guerre vient anéantir ce que plus de trente années de
mobutisme et neuf mois de guerre en 1996-97 n'avaient pas encore réussi
à détruire, plongeant ainsi le Congo dans un état de
délabrement jamais atteint auparavant22(*) ».
Les pourparlers de paix, entamés dès le
début de la guerre, se limitent pendant longtemps à de simples
catalogues de bonnes intentions. Il faut attendre la disparition de
Laurent-Désiré Kabila en Janvier 2001, et l'arrivée au
pouvoir de son fils Joseph Kabila, pour voir le processus de paix de Lusaka
reprendre aux pas géants. Finalement, en décembre 2002,
après bien des péripéties, la persévérance
de la médiation sud-africaine est récompensée par la
conclusion à Pretoria d'un accord global et inclusif aux termes duquel
le président Joseph Kabila est maintenu à son poste au cours des
deux années que durera la transition, assisté de quatre
vice-présidents représentant respectivement le gouvernement, le
RCD-Goma, le MLC et l'opposition non armée. Cet accord de paix ne
signifie malheureusement pas la fin du conflit des Grands Lacs. L'aboutissement
du Dialogue inter-congolais n'a en effet en rien résorbé les
risques de déstabilisation dans l'Est de la RDC, théâtre
d'affrontements interethniques entre microgroupes rebelles sur fond de
rivalité ougando-rwandaise. Début 2003, l'Est du Congo est en
proie à une recrudescence dramatique des violences ethniques. Le retrait
des troupes étrangères a en effet favorisé une reprise des
combats au Sud-Kivu (région d'Uvira) et surtout en Ituri où les
différentes milices congolaises soutenues par l'Ouganda (MLC &
RCD-national (RCD-N) contre RCD-K-ML) ou le Rwanda (l'Union des Patriotes
congolais (UPC) de Thomas Lubanga) se livrent à une lutte sans merci
sous l'oeil impassible des 700 casques bleus uruguayens de la Mission des
Nations unies au Congo (MONUC) déployés dans la Région.
Une sale guerre qui fait des dizaines de milliers de victimes, où les
violences sexuelles sont utilisées comme arme de guerre, et dans
laquelle aucun tabou, pas même celui de l'anthropophagie, ne semble
à même de fixer quelques limites aux violences
perpétrées par les belligérants.
L'opération Artémis menée
à Bunia (Ituri) par la Belgique en juillet 2003 permet cependant de
stabiliser quelque peu la situation.. La réforme de l'armée, qui
comporte la mise sur pied de programmes de désarmement, de
démobilisation et de réintégration des ex combattants
(DDR), de brassage des unités et de redéploiement des brigades
intégrées, doit cependant faire face à de nombreux
obstacles, comme la mauvaise gouvernance(absence d'informations fiables sur les
effectifs, détournement des soldes,...), et surtout les
réticences, vu l'incertitude de l'après élections, des
anciens rebelles à envoyer leurs ex combattants dans les centres de
brassage. La transition demeure cependant précaire comme en
témoignent les échauffourées survenues en Juin 2004 quand
Laurent Nkunda, un général tutsi du Nord-Kivu, soutenu par le
Rwanda, attaque la ville de Bukavu arguant d'un « génocide »
des Banyamulenge, Tutsi du Sud-Kivu. Ce succès militaire du CDNP restera
néanmoins sans lendemain en raison de la spectaculaire volteface
opérée en décembre 2008 par le régime de Kigali.
Soucieux de redorer quelque peu un blason terni par un rapport du Groupe
d'expert des Nations unies sur la RDC faisant état du soutien
apporté par le Rwanda au CDNP23(*), le président Kagame s'entend avec son
homologue congolais, Joseph Kabila, pour mettre hors-jeu le
général Nkunda (lequel sera arrêté en janvier et
assigné à résidence au Rwanda).
Dans la foulée, le 20 janvier 2009, deux jours
après que le chef d'état-major du CDNP, Bosco Ntaganda, ait
décidé de mettre fin à la rébellion et
d'intégrer ses forces au sein de l'armée congolaise, les Forces
rwandaises de défense (RDF) entrent au Congo pour participer, aux
côtés des FARDCs, à l'opération Umoja Wetu
destinée à traquer les FLDR, en prétendant
détruire leurs bases arrières et favoriser le retour au Rwanda de
leurs combattants et de leurs familles.
L'opération conjointe rwando-congolaise ne parvint
cependant pas à sécuriser durablement le Kivu. Notons que cette
opération n'était que de mascarade qui ne consister pas à
neutraliser les FDLR mais plutôt les pousser plus loin des
frontières du Rwanda en les envoyant dans les forêts denses
où habitent le peuple léga sacrifié à cette
cruauté génocide et viol systématique dont subi le
territoire de Shabunda24(*) laquelle est reconnue capitale mondiale de violences
sexuelles. En mars, quelques semaines à peine après le
départ des troupes rwandaises et le rapatriement au Rwanda de plus de
1.600 de leurs anciens membres (combattants et personnes à charge), les
FDLR ont retrouvé leurs capacités de nuisance et se livrent
à des opérations de représailles à l'encontre des
populations civiles, tuant des centaines de personnes et provoquant le
déplacement des dizaines de milliers de familles. Dans les mois qui
suivent, l'insécurité perdure, en dépit des
opérations Kimia II et Amani Leo menées
essentiellement au Sud-Kivu avec le soutien de la MONUC par l'armée
congolaise, cette dernière étant de plus en plus souvent
accusée d'être en partie responsable des crimes de guerre,
violences sexuelles et autres atteintes aux droits de l'homme dont sont
victimes les populations civiles dans l'Est du Congo25(*). « Tant et si bien
qu'en 2010, alors que la République démocratique du Congo
commémore le cinquantième anniversaire de son
indépendance, et tandis que certains évoquent l'hypothèse
d'un retrait progressif de la MONUC, les Congolais de l'Est ne voient toujours
pas venir la paix ».26(*)
A ce jour, une dissidence de la partie de CNDP qui a
intégré l'armée régulière vient de nouveau
créer une rébellion où les experts de l'ONU approuvent,
après les enquêtes que c'est le Rwanda qui apporte aux mutins M23
un soutien total et indispensable.
Section II : LES PRINCIPAUX
ACTEURS DES CONFLITS ARMES EN RDC
La guerre en RDC témoigne du réveil d'une
guerre qui couvait depuis des années. Au-delà des
réactions émotionnelles que suscitent les images, toujours
recommencées, des victimes civiles fuyant les zones de combat, les
pillages et les viols perpétrés par toutes les forces
armées impliquées dans le conflits ou celles du recrutement
forcé d'enfants soldats, se posent des questions de fond. Quels sont les
acteurs d'un conflit dont la durée et les rebondissements après
chaque phase d'accalmie signifient qu'il est l'expression de tensions
structurelles ? Enchâssé dans l'entité
géopolitique des Grands Lacs, le Kivu est partie prenante, d'un
système régional de conflits. La guerre qui s'y déroule
constitue une sérieuse entrave à la reconstruction de la RDC, et
une menace pour la stabilité de toute la région :
aujourd'hui plus que jamais le Kivu est la poudrière de l'Afrique
Centrale. Quelles sont les forces externes qui interfèrent dans un
conflit nourri de facteurs aggravants qui participent à la fois de la
dialectique ethnique, des intérêts économiques
contradictoires et d'une situation démographique
caractérisée par des densités élevées. Cette
section s'articule en sept paragraphes : le premier sur les acteurs
intérieurs dont le Congrès National pour la Défense du
Peuple(CNDP), les rebelles du mouvement M23,le Front Démocratique de
Libération du Rwanda(FDLR),les patriotes Mayi Mayi,l'armée de
libération de Seigneur(LRA),les Forces Armées de la
République Démocratique du Congo(FARDC),Mission de Nations Unies
pour la Stabilisation du Congo(MONUSCO) , les pays voisins(le Rwanda, l'Ouganda
et le Burundi)et les firmes multinationales
§1. Le Congres National pour
la Défense du Peuple,CNDP
Ce mouvement politico-militaire est issu au
départ de populations rwandophones, désignées sous
l'appellation générique de Banyarwanda et
plus précisément de leur composante tutsie Banyamulenge. Son
chef, le général Laurent Nkunda, a justifié sa
rébellion par la nécessité de protéger les Tutsis
du Congo, dont la sécurité et les intérêts
économiques apparaissent menacés depuis que la mise en oeuvre des
accords de Pretoria a modifié la configuration géopolitique de la
nouvelle République Démocratique du Congo. Il a
créé à cet effet l'Anti-Génocide Team (devenu par
la suite le Comité militaire pour la défense du peuple, CMDP) au
lendemain du massacre des Banyamulenge réfugiés dans le camp
burundais de Gatumba27(*).
Résultant de la fusion, en août 2005, entre le CMDP et l'ONG
Synergie Nationale pour la Paix et la Concorde (SNPC), le CNDP s'est
doté de statuts en juillet 2006, entérinant ainsi sa
création. Son siège politique était situé dans le
territoire de Masisi. Son aile militaire, dénommée
« Armée nationale congolaise (ANC) »28(*) est dirigée par le
général Bosco Ntaganda - ou était, car une
« guerre des chefs » vient de se déclarer en
janvier 2009, ce dernier contestant désormais l'autorité de
Nkunda qu'il accuse d'être un obstacle à la paix29(*).De profondes
affinités rapprochent les Tutsis congolais de ceux du Rwanda. Un certain
nombre de cadres militaires du CNDP, dont Laurent Nkunda lui-même,
s'étaient engagés au côté du Front Patriotique
Rwandais jusqu'à la prise du pouvoir à Kigali en juillet 1994.
Fortes enfin du soutien de Kigali, notamment en logistique et en
équipements, elles représentaient la composante armée la
mieux organisée et la plus déterminée de tous les
belligérants. Ses effectifs étaient évalués entre
4000 et 7000 hommes. Depuis ses premières victoires sur les FARDC, les
forces armées du CNDP n'ont cessé de monter en puissance ;
à l'automne 2008 elles se sont emparées d'une grande
quantité d'armes et de munition lors de la prise du camp militaire de
Rumangabo, situé au nord de Goma. Dans les zones qu'il contrôlait,
estimées au tiers des territoires de Rutshuru et de Masisi, le CNDP
s'organisait sur le modèle de l'Etat. Il prélevait divers
« impôts » : dîmes sur les productions
agricoles, taxes sur le charbon de bois, péages routiers, contributions
des commerçants ,et impôt douanier à Bunagana etc. La
diaspora tutsie participa en outre à son financement. L'hypothèse
d'annexer une partie du Kivu au Rwanda n'est jamais énoncée
officiellement, mais côté Congolais on attribue des intentions
expansionnistes au Rwanda qui de son côté ne se prive pas
d'évoquer la « spoliation » territoriale
consécutive au tracé frontalier colonial.
§2. La
rébellion du Mouvement 23,M23
C'est un groupe armé qui
est actif en cours de cette rédaction dont la prétention de
maitrise de ces objectifs serait fausse. Du moins à ces jours, il vient
de la branche de CNDP du Général Bosco Taganda et de Laurent
Kunda. Il reçoit le soutien total du Rwanda attesté par les
rapports des experts de Nations Unies et de la monusco. Le porte parole du
gouvernement congolais confirme aussi l`agression du Rwanda en qualifiant les
leaders de M23 des marionnettes. Pour revenir à la source de leur
aventure guerrière c'est à la« Fin mars 2012, le
général Bosco Ntaganda, commandant dans les Forces armées
de la République démocratique du Congo (FARDC), a mené une
mutinerie de 300 à 600 soldats, qui manifestaient ainsi leur
mécontentement face au non-paiement de leurs soldes et à leurs
mauvaises conditions de vie.
(...)M. Ntaganda (surnommé «
terminator ») avait été inculpé pour
crime de guerre par la Cour pénale internationale (CPI) en 2006. Le 3
mai 2012, le colonel Sultani Makenga a fomenté une révolte
apparemment distincte. Les deux hommes étaient pourtant membres du
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), une milice
créée en RDC par Laurent Nkunda avec le soutien du Rwanda voisin,
avant qu'elle ne soit intégrée aux FARDC dans le cadre de
l'accord de paix du 23 mars 2009.
M. Makenga aurait nié tout lien
entre les deux mouvements. Pourtant, selon les analystes, ces deux mutineries,
condamnées par le Conseil de sécurité des Nations Unies,
pourraient avoir été déclenchées en réaction
à des indications selon lesquelles le président de la RDC, Joseph
Kabila, était sur le point d'honorer ses obligations envers la CPI en
arrêtant M. Ntaganda. M. Colville a rapporté que de
sérieuses allégations d'atrocités pesaient sur
le haut commandement du M23, dont le nom fait référence à
la date de l'accord de paix de 2009. Selon lui, c'est pour cette raison que la
Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a
«mentionné le nom des responsables, contrairement à ses
habitudes (...) Elle a mis en garde contre les dangers du M23».30(*)
Cette rébellion qui
n'a même pas un trimestre vient de commettre plus crimes internationaux
et dirigé par les criminels redoutables. « Les
responsables mentionnés par Mme Pillay sont, entre autres : M. Makenga,
ancien commandant du CNDP impliqué dans le massacre de 67 civils
à Kiwandja en 2008 ; le colonel Baudouin Ngaruye,
soupçonné d'être mêlé au massacre de 139
civils à Shalio en 2009, alors qu'il était commandant des FARDC
et, précédemment, du CNDP ; le colonel Innocent Zimurinda,
accusé d'avoir « commandité les massacres de Kiwandja et de
Shalio » ; et le colonel Innocent Kaina, qui aurait été
impliqué dans une série de violations des droits de l'homme dans
le district d'Ituri, dans la province Orientale, en 2004, lorsqu'il
était membre - comme M. Ntaganda - de l'Union des Patriotes Congolais
(UPC) et de son aile militaire, à savoir les Forces Patriotique pour la
Libération du Congo (FPLC), dirigées par Thomas Lubanga
Dyilo. »31(*)
§3.
Le front démocratique de libération du Rwanda, FDLR
« C'est sous ce
label que les survivants des FAR (Forces Armées Rwandaises durant la
période où les Hutus exercèrent la pouvoir) et des
miliciens interahamwes, acteurs centraux du génocide de 1994,
ont cherché à se donner une respectabilité politique.
Depuis la destruction en 1996 des camps de réfugiés hutus
installés au Zaïre, une dizaine de milliers de rescapés ont
trouvé refuge dans les forêts du Kivu où ils ont fini par
s'installer durablement avec la bienveillance sinon le soutien actif de
Kinshasa. Pour Kigali, la présence de ces Hutus en RDC représente
une pomme de discorde interdisant toute relation durablement pacifiée
entre les deux pays, mais elle est aussi un alibi commode pour légitimer
diverses formes d'intervention rwandaises au Kivu. Le financement de la
composante armée de FDLR provient principalement de l'exploitation des
ressources minières dans les zones qu'il contrôle au Nord et au
Sud Kivu. Le communiqué commun signé par la RDC et le Rwanda le
9 novembre 2007 soulignait la priorité de s'attaquer au
problème du désarmement et du rapatriement des Forces
démocratiques de libération du Rwanda. La résolution 1856
du 22 décembre 2008 insiste à nouveau sur ce point, avec
raison car aucune sortie de crise n'est imaginable sans ce préalable.
Mais il y a plus de dix ans que l'on tient ce discours sans qu'aucune action
n'ait été entreprise...La présence des FDLR arrange bien
des acteurs en eau trouble. »32(*)La majorité de combattants FDLR ne sont
concernés aux dossiers de génocide car les uns étaient
enfants et les autres sont nés au Congo après le
génocide. L'attitude des Nations Unies pour avoir rejeté en bloc
tous ces refugiés rwandais hutus dont leur sort débrouiller une
survie dans la jungle comme des sauvages. Le HCR et le PAM ne se
préoccupent plus de leur hébergement et de leur famine alors que
les non combattants(les femmes et les enfants et civils)ayant les statuts de
refugiés devraient bénéficier de leurs droits en tant que
tels ,mais au contraire le HCR se préoccupe du processus
de« la clause de cessation des refugiés rwandais »
auquel soulève une inquiétude majeure surtout lorsque le
régime du Rwanda le soutient33(*) .Les crimes réguliers de FDLR soulève
des interrogations sur ses
motivations : « si les FDLR est un
mouvement politico-militaire pour libérer le Rwanda, pense-t-il en
occupant Shabunda, Mwenga, Lubutu, etc, territoires non
frontaliers du Rwanda qu'il va libérer ce dernier? A-t-on
appris un jour qu'il a occupé un village rwandais ? Si ses combattants
sont vraiment hutu, pourquoi ils n'arrivent pas à faire jonction
avec les hutu de l'intérieur, et c'est depuis 1994 ? Faut-il
les prendre pour des pirates ou des corsaires ou tout simplement ils sont
pirates et corsaires ? »34(*) La société civile du Kivu a
affirmé que les FDLR rapatriés au Rwanda sont recyclés et
envoyé par Kigali pour poser les crimes contre la population. Le
divorce de relation entre FDLR et l'Etat congolais a poussé ces
combattants FDLR d'accepter l'offre du régime du Rwanda. Les indices de
preuve sont observés à partir que les FDLR combattent dans les
rangs de CNDP et actuellement dans les troupes de mutins M23 ; enfin outre
les FDLR n'ont jamais marqué l'intention d'attaquer le Rwanda mais ne
font que multiplier les massacres, les viols et exploitation des mines loin
des frontières du Rwanda.
§4. Les Milices Mayi
Mayi
Ces milices, apparues lors de la rébellion de l'Est du
Congo en 1964, ont resurgi à la faveur de la situation chaotique du
Zaïre des années 199035(*). Elle constitue des groupes d'auto-défense des
communautés locales et présentent par suite une forte
identité ethnique36(*).A Shabunda, une dynamique de mayi mayi nommée
Raia Mutomboki37(*)
évolue avec sa particularité de mouvement spontané sans
une hiérarchie organisationnelle ni porte parole composé des
jeunes gens se comportant en anti corps dans l'organisme humain. Le Raia
Mutomboki a pris l'ampleur lors de sa résistance face aux FDLR qui
n'avait pas devant eux ni la police ni les FARDC pour les empêcher
à massacrer, à violer et à bruler des maisons. La Notion
de Mayi mayi sont bien implantés dans les communautés des
menaces étrangères et persiste
également face à l'envahisseur. Ils se perçoivent
essentiellement comme des personnes autochtones du Congo et héritiers
légitimes de terre. « En 2009 ,on estimait qu'ils
étaient plus de 22 groupes différents, avec un effectif total
évalué entre 8000 et 12000 combattants. » Les groupes
maï maï sont à la fois très autonomes et facilement
instrumentalisés par les leaders politiques et autres entrepreneurs de
guerre ; leurs alliances sont changeantes, le seul point commun
résidant dans le rejet des « étrangers », en
l'occurrence les Rwandais et par extension tous les originaires du Rwanda,
principalement les Tutsis. Dans le temps de Mzée Kabila et
jusqu'à 2004 ils combattaient au côté des FARDC suivant la
stratégie de la guerre longue et populaire. La guerre de leader
a compromis l'unité de mayi mayi surtout après la
réunification du pays ,où tous les postes n'ont profité
qu'à une tribu tembo du général Padiri Bulenda.
Les groupes repris sous l'appellation "Maï-Maï"
incluent des forces armées dirigées par des seigneurs de guerre,
des chefs tribaux traditionnels, des chefs de village, et des leaders
politiques locaux. Parce que les Maï-Maï manquaient de
cohésion et de visibilité à l'égard du monde
extérieur, les différents groupes se retrouvèrent
alliés à divers gouvernements réguliers ou forces
armées à différents moments. On trouve souvent les
formations de nouveaux mayi mayi dans les territoires où la population
est victime de crimes des étrangers tutsi ou hutu rwandais et se voit
abandonnée. C'est le cas de Walikale et Masisi au nord de Goma furent
les centres des activités des Maï-Maï au Nord Kivu. Au Sud
Kivu ils se concentraient dans les régions de Walungu et Bunyakiri au
sud du lac Kivu, aux environs d'Uvira et Mwenga à
l'extrémité septentrionale du lac Tanganyika, ainsi qu'à
Fizi, et à Shabunda.
§5. Armée de
Resistance du Seigneur(LRA)
« L'Armée de résistance du Seigneur
(LRA pour Lord's Resistance Army) est un mouvement en rébellion
contre le gouvernement de l'Ouganda, créé en
1988, deux ans
après le déclenchement de la
Guerre
civile ougandaise. La LRA, dont le chef est
Joseph Kony,
entend renverser le président ougandais,
Yoweri
Museveni, pour mettre en place un régime basé sur les
Dix
Commandements de la
Bible. L'organisation
est placée sur la
liste officielle des organisations
terroristes des
États-Unis
d'Amérique. Le
4
août
2006, après 18
ans de combats dans le nord du pays, elle annonce la cessation
unilatérale des hostilités.
Depuis, la LRA ne commet plus d'action en Ouganda, ses
éléments ayant été repoussés hors des
frontières. Mais ses membres attaquent les populations en
République Centrafrique, au
Soudan du Sud,
mais aussi en RDC où un massacre de 321 civils a été
perpétré mi-décembre 200938(*) dans la région de Makombo. L'
insurrection
de la LRA a débuté en 1986. Environ deux millions de
personnes sont déplacées par ce conflit, et environ
1,7 million d'entre elles vivent dans des camps où elles
dépendent de l'aide humanitaire. La LRA, qui sévit dans le nord
du pays depuis 20 ans, est connue pour ses atrocités sur les
civils. En octobre 2001, les États-Unis inscrivent la LRA sur la
liste des organisations terroristes. En septembre 2010, les exactions de
la LRA touchent le nord-est de la Centrafrique (région de Birao).
L'armée ougandaise est engagée depuis au moins 2009 dans une
guerre secrète dans le cadre de l'opération régionale
Rudia II contre LRA. Les enfants soldats constituent 80 %
des effectifs de la LRA. 30 à 40 % de ces enfants sont des
fillettes.
La LRA est accusée de nombreuses violences, notamment
de l'enlèvement d'environ 25 000 enfants contraints de devenir
enfants soldats, porteurs ou réduits à l'esclavage sexuel entre
1986 et 2005. Le 23 mai 2005 ,l'Unicef a publié un rapport
où il estime que 40 000 enfants sont contraints de quitter chaque
nuit leur village pour aller dormir dans les rues des villes du nord de
l'Ouganda, en raison des menaces de violences et d'enlèvements de la
part de l'Armée de résistance du Seigneur
].En
2006, un film documentaire canadien, Uganda Rising, est
consacré aux enfants intégrés de force dans les rangs de
l'Armée de résistance du seigneur (LRA). Les enfants
enlevés à leurs familles ou dans les salles de classe racontent
les tortures, mutilations et viols qu'ils ont subis au sein de la LRA, avant
d'être parqués dans des camps par l'armée du
président Yoweri Museveni.
Intervention des États-Unis
et l'Union Africaine en mai 2010, le Congrès des Etats
Unis votent la Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda
Recovery Act of 2009 relatif au désarmement de la LRA
Le 14 octobre 2011, le Président des États-Unis Barack
Obama annonce l'envoi d'une centaine de conseillers militaires en
Ouganda,République démocratique du Congo,Centrafrique et Soudan
du Sud afin d'aider les forces de la région qui luttent contre la
LRA. L'objectif de cette intervention est la capture du chef
de la LRA, Joseph Kony . L'Union Africaine à
décidé, le 24 mars 2012, de déployer contre la LRA une
force multinationale de 5 000 hommes. Composée de soldats
ougandais, sud-soudanais, congolais et centrafricains. Elle est basée
à Yambio, une localité du Soudan du Sud proche de la
frontière avec la République démocratique du
Congo. »39(*)La
LRA est accusé aussi pour atteinte à l'environnement dans les
parcs surtout de Garamba où elle installe des camps de ses hommes en se
livrant au braconnage des animaux protégés et provoquant des
batailles dans le parc comme objectif militaire.
§6. Les Forces Armées
de La République Démocratique du Congo, FARDC
« Les Forces
armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont
les forces armées officielles de la RDC anciennement appelés
Forces armées Zaïroises(FAZ).
Situation des Forces Armées
de la République Démocratique du Congo (FARDC) sont dans un
processus de reconstruction après la deuxième guerre du Congo
finie en 2003. Le gouvernement à Kinshasa, les Nations Unies (avec la
MONUC d'un effectif total de 22 000 personnels fin 2009), l'Union
européenne (avec sa mission militaire EUSEC RDC et sa mission en 2006
EUFOR RDC) et des partenaires bilatéraux comme l'Angola, l'Afrique du
Sud et la Belgique essaie de créer une force viable capable de
réaliser les missions qui lui sont confiées, la plus importante
étant la sécurité et stabilité pour la nation.
Cependant, la réussite de ce processus paraît
incertaine car on assiste à un retour de la corruption et le
gouvernement congolais éprouve énormément de
difficulté à gérer et contrôler ses forces
armées. On note également un manque de coordination entre les
donateurs internationaux. Enfin, il est très important de souligner que
les FARDC se constituent en partie sur base d'une tentative de regroupement et
d'intégration (le "brassage" et le "mixage") au sein d'une structure de
commandement unique des forces militaires tant du gouvernement légal de
Kinshasa que des anciens mouvements de rébellion qui ont divisé
le pays, en particulier depuis la seconde guerre d'août 2008. Il s'agit
en particulier des mouvements Maï Maï, des troupes du RCD Goma, du
MLC de Jean Pierre Bemba. De vieux antagonismes existent entre ces forces qui
sont néanmoins censées opérer en harmonie au sein de
l'armée. Les tentatives récentes d'intégrer des
éléments militaires sous l'obédience du
Général Laurent Nkunda au Nord Kivu ont montré la
difficulté et les limites de cette stratégie. Les conflits
internes dans l'armée sont de plus en plus fréquents.
En 2004, le budget de la défense est officiellement de
93,5 millions de dollars soit 1,5 % du produit national brut. En 2006, il
est estimé à 2,5 % du PNB. Fin 2006, l'armée
congolaise compte près de 350 000 hommes selon le lieutenant
général Kisempia Kisempia, alors chef d'état-major
général des FARDC, qui a reconnu l'existence de problèmes
d'hébergements des troupes. Les observateurs militaires étrangers
estimait alors les effectifs de cette armée, en pleine restructuration,
à environ 200 000 hommes, les milices ayant étaient
officiellement intégrées dans celle-ci. En avril 2009, le
ministère de la Défense et l'état-major des Forces
armées de la République démocratique du Congo recensent
129 000 hommes sous les armes. Mais le problème le plus important
ne se trouve pas là. En dépit de l'aide internationale, la
R.D.C., auparavant le Zaïre, au vu du profond sous-développement
dans laquelle elle s'est enfoncée, n'a pas les ressources suffisantes
pour se doter d'une armée régulière, bien
gérée, dont les forces sont casernées.
L'impossibilité de survivre dans ces conditions les amène
à vivre sur le dos de la population par le biais d'exactions et de
spoliations constantes, principalement en zones rurales. La paysannerie,
déjà la partie la plus pauvre de la population, paye le plus
lourd tribut alors qu'elle est celle qui devrait être
protégée par l'armée qui exerce en principe un rôle
de maintien de l'ordre public, aux côtés de la police nationale.
On assiste donc à un retour à la situation que le pays a connu
à la fin de l'ère mobutiste où les militaires
étaient devenus la crainte majeure de la population. La MONUC se voit
donc obligée dans certains cas de protéger les populations
civiles des violences qui sont le fait des forces armées. Cette
dramatique évolution s'est encore aggravée par le nombre
croissant de violences sexuelles perpétrées par les militaires
dans les campagnes dans un contexte de relative impunité, les poursuites
engagées contre les auteurs de ces sévices par la juridiction
militaire étant très limitées au regard de
l'étendue du phénomène. »40(*)
§7.Mission des Nations Unies
pour la Stabilisation au Congo MONUC/MONUSCO
Cette mission onusienne a connu deux étapes importantes
d'abord celle de Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) ensuite l'actuelle
la Mission de Nations Unies pour la stabilisation au Congo
(MONUSCO) « Le mandat de la Mission de l'Organisation des
Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), qui a
succédé à la MONUC en juillet 2010, illustre parfaitement
le dilemme que pose le compromis potentiel entre la protection des civils et le
renforcement des capacités de l'État. En conséquence, le
terme de stabilisation est devenu ambivalent. »41(*)
« Créée officiellement par le conseil
de sécurité que le 10 novembre1999 (résolution
1279) »42(*),
« elle est la plus importante et la plus coûteuse des missions
actuelles des Nations Unies. Elle compte actuellement quelque 17 000
soldats dont plus de 5 000 au Nord Kivu. En dépit de cet
engagement dont le coût annuel se chiffre à plus d'un
milliard de dollars US (par comparaison le budget prévisionnel de
la RDC pour 2007 dépassait à peine 2 milliards de dollars),
il n'est ni exagéré ni provocateur de dire qu'elle a surtout
servi à verser de confortables salaires à ses
militaires-fonctionnaires. Il est vrai qu'ils sont originaires de pays en
développement et que par conséquent la guerre au Kivu participe
d'une certaine manière à l'aide internationale en faveur des pays
du Sud... »43(*). Les populations du Kivu, en dehors des
prostituées, de quelques chauffeurs recrutés localement, et
d'intermédiaires avisés savent quant à elles qu'elles
n'ont pas profité de leur présence : l'essentiel des
approvisionnements de la MONUC est importé ; surtout, la protection
des populations civiles n'a pas été assurée. Le nombre de
victimes depuis le début de la guerre civile, établi notamment
à partir d'enquêtes de Rescue Commitee, s'élèverait
à 4 millions de morts, sinon plus. Les chiffres résultent
d'extrapolations qui ne sont pas scientifiquement incontestables ; ils
donnent cependant une idée de l'ampleur des souffrances du peuple
congolais. Des millions de victimes d'un côté, une dizaine de
milliards de dollars dépensés depuis la création de la
Monuc de l'autre, la guerre qui repart de plus belle : le bilan est
atterrant. Les Nations Unies envisagent pourtant d'augmenter de quelque
3 000 hommes les effectifs de la MONUC : mais quels résultats
peut-on en attendre s'il n'y a pas de réelle volonté politique
qui permettrait aux casques bleus de s'engager militairement au-delà de
leur propre protection ou d'opérations d'interposition sans
lendemain ? La préoccupation principale de l'ONU étant qu'il
n'y ait aucune victime dans les rangs de ses « soldats »,
comment pourrait-elle pacifier le Kivu, c'est-à-dire désarmer les
FDLR, les Maï-Maï, les LRA et les troupes du CNDP aujourd'hui
les M23 . Les programmes pourtant très modestes dits DDRRR
(Désarmement, Démobilisation, Rapatriement,
Réinstallation, et Réinsertion) ou, encore plus modestes DDR
(Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) qu'elle a mis
en place donnent surtout du grain à moudre aux humoristes congolais.
L'inefficacité de l'ONU n'est toutefois pas le seul fruit de sa lourdeur
bureaucratique : on peut supposer qu'elle traduit aussi l'absence d'une
concordance de vues entre les membres permanents du Conseil de
Sécurité, notamment entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
d'une part, la France de l'autre. »44(*)L'escalade d'un conflit qui menace la paix et la
sécurité internationale dans la région a fini par
convaincre le Conseil de Sécurité de muscler son action en RDC en
la concentrant dans l'est de la RDC. Outre ses missions actuelles (protection
des civiles, désarmement et démobilisation des groupes
armés illégaux...) la MONUC est désormais clairement
mandatée pour « Utiliser ses moyens de surveillance et
d'inspection pour empêcher les groupes armés illégaux de
bénéficier d'un appui provenant du trafic des ressources
naturelles ». La résolution 1856 « engage tous les
Etats, en particulier ceux de la région, à prendre les mesures
voulues pour mettre fin au commerce illicite de ressources
naturelles ». Dans la foulée, la résolution 1857
élargit l'arsenal des sanctions qui incluent désormais
« les personnes ou entités appuyant les groupes armés
illégaux... au moyen du commerce illicite de ressources
naturelles ». Des tableaux sont prévus avec détails
à l'index de travail mais« afin de mieux comprendre cette
évolution riche en soubresauts et en revirements, nous avons
distingué quatre phases principales :
-2000-2003 : Négociations et retrait des troupes
étrangères
-2003-2006 : Transition et élections
-2006-2008 : Paralysie et affrontements
-2009-2011 : Pacification forcée et
stratégie de sortie »45(*)
L'impuissance de la monusco de stabiliser le pays nuit
sérieusement à sa réputation, certaines voix
s'élèvent en l'accusant de complice, c'est le cas de diplomate
Charles Mbelo qui affirme : « Tous ces des beaux textes et
des beaux discours officiels, c'est pour distraire et tromper l'opinion. Si
officiellement l'ONU l'a chargé d'une mission aux contours
angéliques mais la nuit la CIA lui a confié une mission
diabolique contre le Congo et le peuple congolais(...)Ces deux
questions n'ont jamais trouvé de réponse et donc il s'agit d'un
plan bien ordonné que la CIA a préparé à
l'intention des multinationales pour faire main basse sur les richesses du
Congo. »46(*) Face à l'impuissance militaire de
l'ONU, B. Boutros-Ghali, - secrétaire général de l'ONU de
1990 à 1995 - réclama la création d'une force d'imposition
de la paix, qui serait le véritable bras armé de l'ONU en ce
terme :« Lorsque les moyens pacifiques et les sanctions ont
échoué, reste l'emploi de la force militaire. (...) Ce recours
est essentiel à la crédibilité de l'Organisation des
Nations unies en tant que garante de la sécurité collective.
(...)La possibilité de dépêcher sur le terrain des forces
militaires immédiatement disponibles pourrait dissuader un agresseur
potentiel de se lancer dans une aventure guerrière. (...) Ces forces
auraient pour mission d'intervenir en cas d'agression
caractérisée, en cours ou imminente. (...) je suis favorable
à l'envoi d'unités d'« imposition de la paix ».Ces
forces d'imposition de la paix devraient être dotées d'un
équipement plus lourd que celui dont disposent actuellement les forces
de maintien de la paix, les casques bleus. »47(*)
§8.Les Pays Voisins( LE
RWANDA,L'OUGANDA ET LE BURUNDI)
« Le Rwanda est un acteur essentiel de la guerre du
Kivu. Non seulement parce que la déstabilisation de l'Est de la RDC est
la conséquence directe de ses problèmes internes (surpeuplement
et exportation de ses violences intercommunautaires), mais aussi parce que
Kigali essaye d'exercer un contrôle sur l'Est du Kivu, tant pour sa
sécurité que pour s'approprier des terres et des ressources
minières. L'Ouganda a aussi des visées économiques sur le
nord de la province, mais il est surtout concerné par le conflit,
à certains égards comparable, de l'Ituri. La question de
l'implication du Rwanda dans la guerre du Kivu fait toujours problème
car elle pose in fine celle du périmètre de l'Etat. Le
chevauchement d'identités ethniques transfrontalières et
d'appartenances nationales dessine des configurations complexes et des statuts
ambigus. Pour les adversaires de Nkunda, qui lui-même se revendique
Congolais à part entière, il ne fait aucun doute qu'il est
à la solde de Kagame. L'engagement au début des années
1990 d'un grand nombre de Tutsis du Congo auprès du FPR et
l'étroite collaboration entre le Rwanda et le RCD Goma entre1998-2002
ont créé des solidarités actives, au point qu'il est
difficile de faire le partage entre ce qui est
« congolais » et « rwandais » - une
ambivalence qui alimente l'hostilité des autres groupes ethniques du
Kivu. En s'appuyant sur des réseaux transfrontaliers, familiaux,
culturels, ou d'affaires, le Rwanda reste en tout cas un acteur
omniprésent sur la scène économique, politique et
militaire du Kivu. Son appui au CNDP, sans être inconditionnel pour des
raisons de stratégie politique propre à Kagame, s'exerce sans
doute moins dans le domaine militaire sauf peut-être dans la zone
frontalière, que dans celui des services,
télécommunication, système bancaire, facilités
commerciales etc. « Il se pourrait que le CNDP soit en train de se
substituer au RCD-Goma comme acteur privilégié des relations avec
le Rwanda. »48(*)Après une paix éphémère
suite à cette négociation de Amani leo entre le gouvernement et
les groupes armés, en avril 2012 ;une nouvelle dissidence de
Général Bosco Taganda réclama l'application des accords du
23 mai 2009 où au début la main noire du Rwanda En outre d'autres
preuves éloquentes ont été complétées par
la monusco comme les témoignages de 13 prisonniers de guerre venus du
rang de M23 qui attestent qu'ils étaient recrutés et
formés par le Rwanda .A part ces témoignages, la nature des
uniformes et des armes sont d'origines de l'armée rwandaise.49(*)Mais l'alliance de pays
voisins(Rwanda, Burundi et Ouganda)avec les multinationales pour la
déstabilisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui, Pourtier explique
que« De nombreuses entreprises industrielles américaines ayant
participé à la création de l l'American Mineral Fields
Incorporated (AMFI) en 1995. L'entente entre les dirigeants de l'AMFI, et
MM. Museveni, Kagame, Buyoya et Kabila remontait à une période
antérieure à 1995, année de la création d'AMFI. La
coopération entre l'un des dirigeants de cette entreprise (Jean Raymond
BOULLE) et le tandem Museveni-Kagame, pourrait même avoir
précédé le double assassinat des Présidents
rwandais Habyarimana et burundais Ntaryamira, abattus, dans le jet
présidentiel dans la nuit du 6 avril 1994. Cette entente a
continué pendant la guerre de libération jusqu'en mai 1997.
Museveni et Kagamé connaissent parfaitement les
véritables desseins que nourrit l'AMFI pour le Congo et la Région
des Grands Lacs, ils savent également la place qui leur est
assignée, la nature de la cause qu'ils défendent ainsi que le
rôle qui a été attribué à Kabila. Les
objectifs convergents poursuivis par la société américaine
et ses partenaires rwando-ougando-burundais, s'opposent aux
intérêts de Kabila, de la RDC et du peuple
congolais. »50(*)
§9.Les Firmes
Multinationales
« L'indignation des Nations Unies et de la presse
internationale face à l'exploitation meurtrière du coltan en RDC
n'a jamais permis d'assainir la situation. Et pour cause, les coupables
désignés ne sont pas ceux situés en amont du
problème. Leurs activités, téléguidées,
s'insèrent dans l'architecture d'une guerre géostratégique
menée par des acteurs de marchés de coltan. Y distinguer, les
points névralgiques revient à identifier les leviers par lesquels
les Etats gouvernent le marché de l'or gris dans les circuits
internationaux : HC Starck(Allemagne),Cabot. Corp., Kemet Corp., et Vishay
Intertechnology (USA),ainsi que Sons of Gwalia (Australia) »51(*) En recherchant les causes
latentes, il est découvert que cet appétit de pillage de
richesses de la RDC par certaines firmes multinationales sans tenir compte de
la morale date de longtemps. BARACYESTE explique brièvement
que« La guerre du Zaïre (comme celle du Rwanda en 1990) fut
présentée comme une guerre interne de libération politique
pour destituer le Maréchal Mobutu. L'AMFI apporta un appui financier,
militaire et logistique déterminant aux organisations coalisées
au sein de l'AFDL. Aujourd'hui, les armes, les munitions, les
équipements militaires sophistiqués qui ont permis à
l'AFDL de remporter la victoire sur les Forces Armées Zaïroises,
continuent d'être mis à la disposition du Rwanda, de l'Ouganda et
du Burundi par la même société AMFI, dans la guerre que ces
trois pays mènent au Congo(...)D'après les termes du pacte
conclu, la révision du tracé des frontières en faveur du
Rwanda et de l'Ouganda devait satisfaire simultanément ces deux pays,
mais également les desseins géostratégiques de l'AMFI en
plein accord avec les ambitions territoriales des régimes
mono-éthniques et minoritaires en place à Kigali, Kampala et
Bujumbura. D'où l'éclatement de la crise lorsque L.D.Kabila
renvoie brutalement le contingent militaire rwandais présent au
Congo-Kinshasa(...)L'étincelle qui a mis le feu aux poudres entre les
rwandais et Kabila n'est pas due uniquement au comportement
barbare des militaires rwandais du FPR mais aussi à la remise en cause
des contrats signés avec le consortium Americano-canadien AMFI au profit
de l'AAC d'Afrique du Sud. L'autre élément qui a contrarié
les projets de l'AMFI en RDC serait due à la dénonciation du
contrat de privatisation de la Gécamines que la société
avait négocié en avril 1997 avec les nouvelles autorités
congolaises de l'AFDL. (...)Cet accord de cession du géant de
l'économie congolaise permettait à l'AMFI
d'accélérer l'exécution de l'un de ses objectifs: le
démembrement du pays et sa partition en de micros états
antagonistes, démunis de moyens financiers et d'infrastructures
économiques (sorte de balkanisation). Le plan de l'American Mineral
Fields Incorporated (AMFI) ne s'est pas déroulé
conformément à ses prévisions. »52(*)
Certes, rien ne fait plus l'ombre d'un doute sur la part
active des multinationales dans les guerres récurrentes à l'est
de la RDC. Plusieurs études, enquêtes et rapports des
organisations officielles comme personnalités indépendantes
à l'instar de GRAMA53(*), des Nations Unies54(*), Didier FAILLY55(*) et Emmanuel DEBELLEX 56(*)qui ont abouti à des conclusions allant au
même sens que ce sont les firmes multinationales susdites qui se
constituent en réseau maffieux en utilisant les pays voisins(le Rwanda,
l'Ouganda et le Burundi) pour cueillir les mines et autres ressources en
contre partie du sang et des viols de la population congolaise. Ainsi, la RDC
est donc confrontée à une remise en cause globale de son
existence même: dans son intégrité territoriale, par toutes
les forces "visibles et invisibles" qui l'ont agressé depuis 1996,
à partir du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda, et qui remettent en
cause les frontières héritées de la colonisation, par la
destruction des infrastructures économiques et environnementales et
en tant que membre de l'ONU, parce que cette Organisation Mondiale ne condamne
pas fermement les trois pays agresseurs, et ne prend aucune sanction contre ces
multinationales dont d'ailleurs les adresses de leurs sièges
administratifs se trouvent dans les pays qui sont des exemples de la
démocratie et du respect de droit de l'homme .
Chapitre deuxième :
LES IMPACTS ET LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
Ce deuxième chapitre portera sur deux sections dont la
première sera consacrée sur les atteintes graves portées
sur les Parcs Nationaux et sur les Aires Protégées et la seconde
section sur les impacts et conséquences sur l'environnement.
Section I : ATTEINTES GRAVES
SUR LES PARCS NATIONAUX et AIRES PROTEGEES
Située de part et d'autre de l'équateur, la RDC
possède une des plus riches biodiversités de la planète en
raison de sa position géographique. Selon l'Institut Congolais pour la
conservation de la nature, «la biodiversité de la RDC est
caractérisée par 11.000 espèces de plantes,409
espèces de mammifères, 1086 espèces d'oiseaux, 1069
espèces de poissons, 152 espèces de serpents. La faune renferme
des espèces uniques et rares, par exemple le chimpanzé nain ou
bonobo, le gorille des montagnes, le rhinocéros blanc du nord,
l'okapi. » 57(*)
Les APs (Aires Protégées) de la RDC comprennent
sept Parcs Nationaux (les Parcs Nationaux des Virunga, de la Garamba,de
Kahuzi-Biega, de la Salonga, de l'Upemba, de Kundelungu et de la Maiko), la
Réserve de Faune à Okapi, le Parc marin des Mangroves et environ
57 Domaines et Réserves de Chasse. Cinq de ces AP sont inscrites au
statut des Sites du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Il s'agit des Parcs
Nationaux des Virunga (PNVi), de la Garamba (PNG), de Kahuzi-Biega (PNKB) et de
la Salonga (PNS) ainsi que de la Réserve de Faune à Okapis
(RFO)58(*).
Malheureusement, l'étendue des dégâts écologiques
résultant du conflit armé et de l'exploitation illégale
des ressources est considérable sur cet environnement exceptionnel.
Les menaces qui s'exercent sur ces Aires
Protégées et leurs ZT (zone tampon) respectives sont nombreuses.
Les plus importantes sont: le braconnage, l'occupation des terres à
l'intérieur des Aires Protégées par les populations et les
bandes armées, l'exploitation illégale des minerais et
l'exploitation forestière. A cela s'ajoutent d'autres menaces telles que
la pauvreté grandissante, l'explosion démographique, les effets
des guerres et de l'instabilité politique aussi bien dans la RDC que
dans certains pays voisins. Toutes ces menaces ont eu des conséquences
néfastes sur le statut des Aires Protégées.
« S'agissant de la faune, il a été
enregistré de considérables réductions des populations
animales au point que certaines espèces sont présumées
disparues (éléphants au PNKB) et, d'autres, se font rares
(zèbre au PNU). Les grands troupeaux des populations animales de jadis
n'existent pratiquement plus. La flore n'a pas été non plus
épargnée. De vastes étendues de végétations
ont été détruites et, avec elles, plusieurs espèces
floristiques. Nonobstant ce sombre tableau, les espoirs restent permis. En
effet, les Aires Protégées possèdent encore des noyaux de
différentes espèces animales et de colonies
représentatives de la flore à partir desquels le repeuplement est
tout à fait possible. »59(*) Les ressources humaines dans les Aires
Protégées sont insuffisantes tant quantitativement que
qualitativement. Actuellement, certaines Aires Protégées n'en
disposent même plus.
« En ce qui concerne les infrastructures, d'une
façon générale, seule les Aires Protégées
créées à l'époque coloniale ( PNVi, PNG et PNU, les
Domaines de chasse de Gangala-na-Bodio et de Maika-Penge) ont été
dotées d'infrastructures immobilières et de surveillance. Celles
qui n'ont pas été détruites par les guerres, sont
aujourd'hui vétustes. Les Aires Protégées établies
après l'indépendance, n'ont jamais été
dotées de ce type d'infrastructures, exception faite de la
Réserve de Faune à Okapis et du Parc National de
Kahuzi-Biega. Dans l'ensemble des Aires Protégées,
l'équipement de brousse, les matériels roulants et ceux
d'ordonnancement ont été pillés et font cruellement
défaut. »60(*)
§1. Parc National de la
GARAMBA et réserves avoisinantes.
« Le Parc national de la Garamba est un parc
national de la
République
démocratique du Congo, situé dans la province
Orientale,
à proximité de la frontière avec le
Soudan. Le parc
national est connu pour abriter une population de
rhinocéros
blancs (Ceratotherium simum cottoni). Cette population est
restreinte et ne compte plus qu'une dizaine d'individus dans le parc et neuf en
captivité. Trois autres grands mammifères peuplent
également la réserve : l'
éléphant,
la
girafe du nord
(Giraffa camelopardalis congoensis) et l'
hippopotame. Les
paysages du parc comprennent d'immenses savanes, herbeuses ou boisées,
entrecoupées de forêts-galeries le long des rivières et de
dépressions marécageuses. Depuis octobre
2005, l'Institut
congolais pour la conservation de la nature a transféré la
gestion du parc à l'African Parks Conservation. Le site fait partie de
la
liste du
patrimoine mondial de l'
UNESCO
depuis
1980.Le parc a
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril de
1984 à 1992. Suite à la
Deuxième
guerre du Congo, le site y a de nouveau été inscrit en
1996. »61(*)
D'après le Ministère de l'environnement
congolais et l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en sigle
ICCN, un nombre d'éléments de la SPLA (Armée Populaire de
la Libération du Soudan) utilisés par l'Ouganda, le Burundi et le
Rwanda dans la conquête de la ville de DUNGU, aux postes de patrouilles
ou poste de Gardes Parc, de BAGBELE et TEKADJE et dans les localités
voisines du Parc étaient encore là. Ils avaient rouvert leur
campement de Braconnage dénommés AFRICA MOTO et OKUMA MAFI
pourtant détruit en 1997 par les forces Armées
Congolaises.62(*)
Les éléments de la SPLA et les forces
régulières des Armées rwandaises, ougandaises et
burundaises ont exercé donc une pression sans précédent
sur la faune du parc de Garamba. La population de l'espèce phare de ce
parc, en l'occurrence le Rhinocéros blanc du Nord, qui avait
augmenté jusqu'à 31 individus, et maintenant en danger. Des
Rhinocéros venaient d'être tués par les braconniers par
contre l'ICCN annonce une apparition nouvelle de race de Rhinocéros
blanc. 63(*)
S'agissant, avant de la faune de ce parc de Garamba, on a
signalé que l'Etat Congolais est victime de l'abattage de
Rhinocéros blanc du Nord. De 31 individus indiqués ci haut,
répertoriés lors du recensement aérien effectué en
juin 1997, il ne reste que 24, soit une perte criminelle de 7 individus
tués par les agresseurs rwando-burundo-ougandais.
Quant aux éléphants, le dénombrement de
juin 1997 montre que depuis la suspension des patrouilles du fait de la
guerre,30 éléphants ont été tués, leurs
défenses étant très recherchées dans le commerce
international de la faune sauvage.64(*)
On a signalé aussi le massacre des hippopotames, des
buffles, des girafes et antilopes etc. Ce parc légalement reconnu
patrimoine commun de l'Unesco et actuellement le théâtre des
affrontements armés « la situation sécuritaire en
province orientale a été caractérisée la semaine
dernière par une diminution significative des activités de LRA et
celles d'autres groupes armés, par ailleurs ;les opérations
unilatérales conduites par la force de la Monusco et celles
spéciales menées par les FARDC, ont contribué à
rassurer les populations civiles et à restaurer la
sécurité dans le district de Haut Uélé. Les FARDC
ont mené du 24Juin au 24Juillet des opérations spéciales
contre la LRA autour et à l'intérieur du Parc National de la
Garamba, et à ce titre ont déclaré avoir
libéré quatre mineurs et détruit deux camps appartenant
à ce groupe armé le long de la rivière
Nangume. »65(*)
§2. Parc National de VIRUNGA
et domaine de chasse de RUTSHURU.
« Le Parc national des Virunga, jadis Parc Albert,
est le plus ancien
parc national
de la
République
démocratique du Congo et d'Afrique. Créé en 1925,
il est très riche par sa faune et sa flore. Des traces d'
okapis y ont par
ailleurs été récemment observées Le parc est
situé dans l'est de la République démocratique du Congo et
couvre en partie les
montagnes des
Virunga, près du
Rwanda et de l'
Ouganda. Il
présente l'une des densités de population les plus
élevées d'Afrique, avec plus de 400
hab./km². »66(*)
La station de la Rwindi, qui est le siège
d'administration du secteur centre du Parc et où était
érigé un hôtel de haut standing, a été de
nouveau détruite. Cela va à l'encontre de l'article 33 de
quatrième Convention de Genève qui interdit à la puissance
occupante de détruire des biens mobiliers et immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'Etat ou à des collectivités publiques. En outre, des
attaques régulières ont obligé la plupart des gardes
à abandonner leurs postes de travail. Les quelques gardes qui
étaient restés avec le conservateur y vivaient seuls sans leurs
familles.
Au mois de janvier 1999, trois gardes qui venaient de
marché avaient trouvé la mort dans une embuscade tendue par les
agresseurs. En plus de cela, 15 personnes avaient obtenu illégalement
des titres fonciers pour l'exploitation de plus de 170ha du Parc dont certaines
avaient inclus dans leurs concessions anarchiques les postes patrouille de
KASIRUSIRU et de MULUME-MUNENE. Ces faits constituent respectivement des
violations de l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, de l'article 32 de la IVè Convention de Genève sur la
protection de la population civile, ainsi que de l'esprit et de la lettre de la
Résolution 1803 sur la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, votée par l'Assemblée Générale de l'ONU
en date du 14 décembre 1962.67(*)
S'agissant du déboisement, l'Union Européenne,
le Haut Commissariat aux Réfugiés et le Dian Fossey Gorilla Fund
avaient contribué à l'étude de la déforestation du
parc. Un déboisement moyen de 290 hectares rasés pendant 28 mois.
La production moyenne de la forêt étant de plus ou moins 210
stères par hectares. Ce qui donne 1.705.200 stères x
20$/stère= 24.000$.68(*)
Quant à l'abattage de la faune, les occupants
s'étaient livrés quotidiennement à l'abattage de la faune
et à la commercialisation des espèces animales
protégées, menacées d'extinction. Dans le même
parc, trois éléphants ont été tués ainsi que
plusieurs des antilopes Bongo, des singes, chimpanzés, babouins
massacrés. Le Gouvernement Congolais estime cette destruction de la
faune à 34.104.000$US.69(*)
En ce qui concerne les Gorilles, il convient de signaler que
le nombre des gorilles tués est de plus ou moins 11
actuellement.70(*) Parmi
ces gorilles, il y a quatre éléments des Silverback. Une famille
des gorilles ne peut être totalement stable que si elle est
dirigée par un Silverback.71(*) L'exploitation forestière atteint son
apogée. Par ailleurs, certaines taxes sont perçues sans
quittance. Aussi l'exploitation de la braise dans les deux territoires
revêt un caractère illicite car la plus grande quantité
provient des aires protégées (PNVi, Domaine de Chasse de
Rutshuru). De surcroît, ceux qui exploitent des forêts vierges
n'ont pas souvent des titres dûment prescrits. L'illégalité
c'est aussi l'existence des personnes intermédiaires de diverses
services de l'Etat, (agents de divers services, militaires de Forces
Armées de la République Démocratique du Congo,...) et des
groupes armées qui encouragent la carbonisation dans le PNVi en contre
partie des Pourboires ainsi que le fait d'exploiter les bois sans en reboiser
les champs. »72(*)
§3. Parc National de MAIKO
et domaine de chasse de BILI-UERE, MAIKAPENGE,
RUBITELE, LUAMA et Reserve des Okapis
« Le Parc national de la
Maïko
est un
parc national
de la
République
démocratique du Congo, situé dans les provinces
Orientale
et du
Nord Kivu. Il
appartient à l'une des régions forestières les plus
isolées du pays, et abrite trois des plus spectaculaires espèces
animales endémiques du pays : le
gorille des plaines
de l'est (Gorilla gorilla graueri), l'
okapi (Okapia
johnstoni), et le
paon du Congo
(Afropavo congoensis). »73(*)
D'après le Gouvernement de la RDC et l'Institut
congolais pour la Conservation de la Nature, jusqu'en avril 1999, ils ne
disposaient d'aucune information fiable compte tenu de l'état de guerre
persistant. Néanmoins au regard de leur valeur biologique
exceptionnelle, des ONG internationales de conservation de la nature
continuaient à apporter à distance, leur appui logistique
(ration, médicaments) et financer (prime de motivation) aux personnes
travaillant dans les aires protégées sous occupation. Il s'agit
de : WWF (Fonds Mondial pour la Nature, et IRF (International Rhino Fondation)
pour le parc de la Garamba, WSC (Wildlife Conservation Society) et GIC (Gilman
investiment Company) pour la réserve de la faune à
Okapi.74(*)
La guerre est susceptible d'avoir des effets plus graves et
durables sur les secteurs protégés qui comptent des
espèces en voie d'extinction, ainsi que les écosystèmes
lents à récupérer. Même dans les environnements les
plus fragiles, la relation entre la nature et l'humanité peut nous
surprendre, écrit DeWeerdit : Mais en regardant dans une direction
différente nous sommes susceptibles de voir les cicatrices durables de
la guerre. »75(*)
SECTION 2 : IMPACTS ET
CONSEQUENCES DE LA GUERRE SUR L'ENVIRONNEMENT EN RDC.
Une société armée et anarchique peut
posséder des effets dévastateurs sur l'environnement pendant et
après un conflit armé. Les dommages causés par la guerre
peuvent être directs ou indirects. Des motifs stratégiques,
commerciaux ou simplement de subsistance, tous issus du contexte politique,
social et économique, peuvent être à l'origine de ces
effets néfastes. Ces impacts peuvent être répartis comme
suit: destruction de l'habitat et perte d'animaux sauvages, surexploitation et
dégradation des ressources naturelles et pollution. Chacune de ces
catégories est décrite brièvement ci dessous.
§1. Destruction de l'habitat
et perte d'animaux sauvages
« La destruction de l'habitat et la disparition
d'animaux sauvages qui en découle sont parmi les effets les plus
répandus et les plus graves des conflits armés sur
l'environnement et se produisent pour des raisons stratégiques,
commerciales ou de subsistance. À titre d'exemple, la
végétation peut être coupée, brûlée ou
défoliée pour accroître la mobilité et la
visibilité des troupes... . Lorsque des personnes
déplacées sont réinstallées provisoirement, elles
coupent souvent la végétation à des fins agricoles ou pour
obtenir du bois à brûler. De telles pratiques mènent
rapidement à la déforestation et à l'érosion. Les
réfugiés et les personnes déplacées étant
souvent réinstallés dans des zones écologiques marginales
et vulnérables, la capacité subséquente pour la
récupération de l'environnement est limitée. Des aires
protégées pourraient être affectées si des personnes
déplacées s'y installent ou s'installent en bordure de ces zones
comme cela s'est produit dans et aux alentours du parc national des Virunga en
1994 .La végétation peut elle aussi être détruite en
temps de conflit et au cours de la période qui suit immédiatement
un conflit, notamment en raison de l'extraction de minéraux
précieux, comme les diamants et l'or, en l'absence de tout
contrôle environnemental. »76(*)
En RDC, le combat a résulté surtout des
déplacements massifs des populations qui coupaient souvent la
végétation à des fins agricoles ou pour obtenir du bois
chauffage et de cuisine. L'installation de près de deux millions de
réfugiés Rwandais à côtés des parcs nationaux
de Kahuzi Biega et de Virunga, a influencé une forte
déforestation et une augmentation rapide du braconnage. Selon Bernard
Lyomi Lyathi, Conservateur en chef de Bukavu, 3500 ha des forêts du parc
national de Kahuzi Biega ont été détruits et vendus par
certains services étatiques à des particuliers.
L'exploitation illicite du coltan et autres mines dans le
même parc a aussi provoqué d'importants dégâts
écologiques, notamment le braconnage et l'érosion. Plus de 12.000
creuseurs autochtones et étrangers étaient installés
irrégulièrement dans le parc national. Cela a ainsi
occasionné la mort du très célèbre gorille
Silverback Maheshe lâchement tué par les braconniers.
« Le rapport du Groupe d'experts de l'ONU sur
l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de
la RDC indique près de 4.000 éléphants sur une population
de 12.000 ont été tués dans le parc national de la
Garamba. A la suite de cette destruction du couvert végétal et on
peut s'en suivre à moyen ou long terme une réduction de la couche
ozone, des changements climatiques sur le territoire national que sur celui des
pays voisins. »77(*)
La disparition d'animaux sauvages a été
considérable durant les guerres qui ont déchiré la RDC. On
note par exemple le communiqué de l'UNESCO de décembre 2007 qui
fait état de massacre des gorilles. En effet, le 3 décembre
2007,l'UNESCO a déclaré qu'il y a eu des violents combats entre
l'armée congolaise et les forces rebelles du général
Nkunda dans le Nord Kivu, au nord de la ville de Goma. Ces combats
s'étaient déroulés à proximité
immédiate du coeur du secteur gorille du Parc national et bien du
patrimoine mondial des Virunga avec des fusillades et des tirs d'artillerie
lourde.
La reprise des combats était une nouvelle menace pour
la survie du gorille de montagne, espèce emblématique de ce site
du patrimoine mondial, dont la population vivant encore dans la nature
était estimé à 700 individus. Depuis le début de
l'année 2007, 10 gorilles ont été tués aux Virunga
et 2 étaient porté disparu. Depuis maintenant plus de 3 mois, les
autorités du parc étaient dans l'incapacité d'entrer dans
le secteur gorille et d'y assurer le suivi et la protection des familles de
gorilles78(*).
En effet, les guerres ont augmenté
considérablement la souffrance des communautés locales qui vivent
autour du site du patrimoine mondial. La crise humanitaire qui en
découle commençait à prendre des proportions
catalographiques. On estimait déjà à 425 000 (dont 70
gardes du parc), le nombre de personnes déplacées à cause
des combats. Des camps improvisés ont surgi juste à
côté du parc, ajoutant une pression supplémentaire sur ses
ressources naturelles par des populations désespéramment à
la recherche de nourriture, de bois de chauffage et matériaux de
construction pour les abris de fortune.
Cette nouvelle aggravation de la situation sécuritaire
et la persistance des menaces sur les cinq sites du patrimoine mondial avait
conduit le Comité du patrimoine mondial à demander au Directeur
Général de l'UNESCO et à la présidente du
Comité du patrimoine mondial d'organiser une réunion de haut
niveau avec les autorités congolaises pour traiter des menaces
imminentes qui pesaient sur les sites. Le récent drame est celle de
massacre de 14 Okapis dans le réserve d'Epulu par le braconnier Morgan.
Une armée pour de raison tactique, peut faucher une bande de 50 à
100 mètres de largeur à travers la forêt de bambous
attenante aux aires protégés dans le but de réduire les
risques d'embuscade le long d'une piste importante.
Enfin, nous disons qu'à la suite de la destruction de
leur habitat, certaines espèces de la faune et de la flore peuvent
être menacées d'extinction au niveau local, voir même
disparaître.
§2. Surexploitation des
Ressources Naturelles.
La surexploitation des ressources naturelles est souvent
reliée directement au conflit armé pour des motifs aussi bien de
subsistance qu'à des fins
commerciales. Une« étude de
cas se penche sur les événements qui se sont produits entre 1990
et 2000 dans la région des volcans des Virunga qui chevauche le Rwanda,
l'Ouganda et la RDC ainsi que sur l'impact de ces événements sur
la biodiversité de la région. Les forêts alpestres des
trois aires protégées du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC
servent d'habitat au gorille de montagne, une espèce menacée, qui
franchit librement les frontières des trois pays. Cette étude
relate et analyse les interventions effectuées lors des crises
recensées au cours des différentes phases de cette période
décennale et souligne l'importance de la collaboration entre les
secteurs de la conservation, des secours d'urgence et du
développement »79(*).Certes,« l'instabilité politique qui
règne en temps de guerre a souvent comme conséquence
immédiate l'impossibilité pour les résidents de se
consacrer aux cultures. Pour survivre, ils sont progressivement contraints de
se retourner vers les aliments sauvages tels que la viande et les plantes
alimentaires sauvages. Parallèlement, les personnes
déplacées ramassent du bois à chauffer, des plantes
alimentaires et d'autres ressources naturelles locales là où
elles se sont installées. Même à court terme, une telle
exploitation à grande échelle ne saurait durer. La
méconnaissance que pourraient avoir ces gens des pratiques de la gestion
optimale des ressources naturelles ne ferait qu'empirer la situation. De plus,
lorsque ces personnes regagnent leur pays natal, elles dépendent
involontairement et dans une grande mesure des ressources naturelles, du moins
jusqu'à ce qu'elles aient pu rétablir leur mode de subsistance
habituel, y compris l'agriculture. De plus, même les organisations
humanitaires utilisent une quantité outrancière de bois à
des fins de construction. Tous ces facteurs peuvent se traduire par une
pénurie ou par la dégradation des ressources et ils peuvent avoir
une incidence considérable à long terme sur les modes de
subsistance des résidents indigènes. »80(*)Le conflit armé
lorsqu'il provoque le déplacement massif de la population, celle-ci est
contrainte de vivre par la cueillette en dégradant l'environnement.
«Par rapport à la carbonisation, les réalités
semblent être les mêmes qu'en territoire de Rutshuru à la
seule différence que dans cet espace plus de 10.000 ménages
retournés -envahisseurs du PNVi- sont les principaux carbonisateurs dans
le parc. L'insécurité règne dans les localités
où l'on produit la braise à cause des campements des groupes
armés dans le PNVi qui y opèrent comme carbonisateurs en
collaboration avec les populations. Si ce n'est pas le cas, ils s'y replient
après avoir perpétré des actes de pillage sur la route
(cas de Tongo, Rumangabo, Rubare, Kahunga, Ngwenda, Kisharo, Nyakakoma).
Nonobstant, les militaires, sous prétexte d'aller mettre hors
d'état de nuire les groupes armés abrités dans les
forêts du PNVi, travaillent en connivence avec les exploitants qui leur
payent 5 $ de pourboire (chacun par mois). Les militaires prétendent
positionner les villageois dans le PNVi pour récolter les informations
au sujet des groupes armés (FDLR,Maï-Maï). Selon diverses
informations, les exploitants ne dénoncent l'existence des inciviques
parce que ces derniers constituent une main-d'oeuvre moins chère. Notons
que les braises provenant du PNVi restent un produit de convoitise. Tout reste
complexe pour l'exploitation et la commercialisation de ce produit forestier
quand il faut ajouter les menaces et les pressions faites par les exploitants.
Population qui se considère non bénéficiaire de ce parc le
détruit. Les exploitants de la braise dans le PNVi font leur besogne
sans inquiétude malgré l'interdiction de l'ICCN car ils ont le
soutien de certaines autorités militaires.
Quelques chiffres relatifs aux taxes :
· 5 $/mois par exploitant : payés aux
militaires
· 5 $/mois par exploitant : payés à
certains gardes parc.
· 15 $ par chargement de véhicule payés
aux militaires
· 30 $ par chargement de véhicule
perçus par les taxateurs du Mwami de la chefferie
· 10 $ par chargement pour payer le bordereau
d'expédition de l'ECNEF.» 81(*)Ce phénomène si dangereux pour
l'environnement s'installe progressivement en complicité de ceux qui
sont appelés à le boycotter. « Dans tous les cas,
l'effondrement du maintien de l'ordre et des mécanismes de
contrôle locaux et traditionnels ne fait que compliquer la gestion des
ressources durables. Il importe de comprendre que les facteurs qui peuvent
inciter les communautés locales à préserver les ressources
et les espèces perdent de leur intérêt lorsque les
avantages économiques sont moindres. Cela reste vrai même dans les
régions qui ne sont pas directement touchées par le conflit
armé. À titre d'exemple, l'instabilité politique
récente au Zimbabwe a considérablement réduit la valeur
des revenus touristiques et favorisé le braconnage à grande
échelle sur certaines terres communautaires qu'exploitait auparavant la
population dans le cadre du Communal Areas Management Programme
for Indigenous Resources. Les endroits où les membres des
populations locales sont invités à participer à la
planification et à la gestion des aires protégées
comportent davantage d'incitatifs à la conservation des ressources
naturelles. L'incertitude liée aux futurs droits d'accès aux
ressources naturelles favorise une exploitation non durable de ces ressources
à des fins de profits à court terme. »82(*)Dans les régions
où se déroulent des combats, les combattants chassent
régulièrement un nombre important de grands mammifères
protégés ou pas pour se nourrir et vendre aux habitants. Cette
pratique cause des conséquences désastreuses sur le nombre
d'animaux sauvages surtout si les activités militaires se poursuivent
sur une longue période dans la région. Les grandes espèces
dont le rythme de reproduction est lent sont particulièrement
vulnérables et sont souvent les premières à
disparaître. Un des effets secondaires de la guerre dans le territoire de
Shabunda fut l'exploitation massive de la faune des forêts de Mikelo et
de Makanga qui, autant faisaient parti par l'autorité administrative des
réserves protégés. Ainsi,« les grandes
espèces dont le rythme de reproduction est lent sont
particulièrement vulnérables et sont souvent les premières
à disparaître. Un des effets secondaires de la guerre au Soudan
fut l'exploitation massive de la faune du parc national Garamba de la RDC,
situé tout juste au-delà de la frontière, par des
braconniers en maraude qui massacrèrent plusieurs animaux du parc pour
leur viande »83(*). Plus de 70 pourcent des incidents qui se sont
produits chaque année impliquaient des déserteurs de
l'Armée populaire de la libération du Soudan (APLS) qui avait
établi leur camp de base de l'autre côté de la
frontière du Soudan.
« Lorsque les gardiens du parc de Garamba furent
désarmés au cours de la première guerre qui eut lieu en
RDC, entre 1996 et 1997, le braconnage prit de l'ampleur pendant une
brève période au cours de laquelle le nombre des
éléphants fut réduit de moitié, celle des bisons
des deux tiers et celle des hippopotames des trois quarts. Cette recrudescence
du braconnage n'était pas attribuable à une exploitation directe
des animaux par les troupes congolaises mais plutôt à la
suspension forcée des activités de conservation et à
l'effondrement généralisé de l'ordre public. Il est aussi
démontré qu'en temps de conflits armés, ceux qui
détiennent le pouvoir éprouvent souvent un urgent besoin de
revenus. Afin de financer leurs activités militaires, ils peuvent alors
se tourner vers l'extraction de ressources naturelles telles que le bois
d'oeuvre, l'ivoire et les diamants à des fins commerciales. On estime
que d'ici 2050, la déforestation en République
Démocratique du Congo pourrait libérer jusqu'à 34,4
milliards de tonnes de CO2, soit à peu près l'équivalent
des émissions de CO2 du Royaume-Uni au cours des soixante
dernières années. La RDC risque de perdre plus de 40% de ses
forêts. »84(*)
§3. Pollutions
Environnementales
« La pollution est un autre des effets graves des
conflits armés. La pollution peut sévir sous différentes
formes. Elle peut découler directement d'opérations militaires ou
d'interventions d'autres groupes armés ou indirectement de crises
humanitaires et économiques imputables au conflit. Au cours des
récents conflits qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne, la pollution
a le plus souvent été problématique en temps de crise
humanitaire. Les réfugiés et les personnes
déplacées vivent tellement souvent dans des conditions de
surpopulation qu'ils deviennent une source indéniable de pollution
potentielle. Les personnes déplacées peuvent polluer les eaux de
surface en luttant pour leur survie et elles peuvent propager des maladies
infectieuses lors de leur fuite. Cette dernière réalité ne
menace pas uniquement la santé publique des populations humaines mais
également la santé de la faune indigène. Les organismes
humanitaires qui travaillent sur le terrain en période de crise
humanitaire peuvent aussi exacerber la pollution. L'objectif premier des
opérations humanitaires étant d'améliorer le
bien-être des réfugiés ou des populations
déplacées, les préoccupations environnementales sont vite
mises de côté. Il en résulte souvent que les installations
et les infrastructures de certains camps de réfugiés ne sont pas
conformes aux critères de protection à long terme de
l'environnement. À titre d'exemple, un emplacement mal choisi ou une
conception inadéquate des latrines ou des installations médicales
pourront contaminer le sol ou l'eau. Parfois, les effets néfastes ne
seront constatés qu'après le démantèlement des
camps »85(*)
« La pollution de l'atmosphère, la
contamination des cours d'eaux et des sols découle directement
d'opérations militaires ou l'indirectement des crises humanitaires et
économiques imputables au conflit. La population des rivières et
des lacs est imputée aux corps qui y sont déposés et qui
finissent par se décomposer. Elle résulte aussi de l'absence des
latrines et autres infrastructures dans les camps de réfugiés.
Les particules solides, les gaz, les incendies issus de cette guerre, sont,
entre autres, des agents principaux qui provoquent le réchauffement de
l'atmosphère ainsi que les pluies acides.»86(*)Les rivières Elila et
Ulindi qui traversent plusieurs territoires avant de se jeter au fleuve Congo
ne sont pas épargnées pourtant la majorité de la
population riveraine se sert de cette eau pour boire faute des infrastructures
hydrauliques dans le milieu rural malheureusement l'épidémie de
choléra se propage le long du fleuve allant même de Kisangani,
Equateur jusqu'à Kinshasa où de juin à juillet
2011 ,1783 personnes atteintes et cause le décès de 116
victimes87(*) .Les
organisations humanitaires qui travaillent sur le terrain en période de
crise humanitaire ont exacerbé la pollution. L'objectif premier des
opérations humanitaires étant d'améliorer le
bien-être des réfugiés ou des personnes
déplacées, les préoccupations environnementales
étaient vite mises de côté. Il en résulte souvent
que les installations et les infrastructures de certains camps de
réfugiés n'étaient pas conformes aux critères de
protection à long terme de l'environnement. A titre d'exemple, un
emplacement mal choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des
installations médicales pourront contaminer le sol ou l'eau. Parfois,
les effets néfastes ne seront constatés qu'après le
démantèlement des camps surtout lorsque les organismes sont
débordés par les déplacés comme au mois de juin au
Nord Kivu avec les déplacés qui fiaient les M23. Il s'en suit que
la violence armée en République Démocratique laisse un
bilan très lourd à surmonter, depuis août 1998 à
Juin 2002,plus de 5,4 millions de personnes ont péri des effets directs
ou indirects de la violence armée ;actuellement le bilan accroit
à 6,9 Millions de morts88(*). Avec ses 3,000 morts par jour, le conflit congolais
reste le plus meurtrier de la planète depuis la dernière guerre
mondiale.
L'importante quantité d'armes légères en
circulation après le conflit armé en RDC risque de compromettre
les efforts de reconstruction post conflit dans d'autres coins du pays. Le
commerce illicite des armes légères enregistré en RDC a un
impact négatif sur l'environnement notamment quant à la faune et
la flore. C'est avec les armes que les groupes armés opèrent dans
les parcs nationaux de Kahuzi Biega, de Virunga et tuent les animaux sauvages
protégés en utilisant les techniques ou méthodes
illégales et illicites de braconnage. Les armes légères
constituent une véritable source de menace et d'insécurité
pour les aires protégées et d'autres forêts riches en
biodiversité à Shabunda et à Mwenga dans le Sud Kivu
où le braconnage des éléphants de la forêt de
Kyanama et de Mikelo par les FDLR. Ces derniers utilisent des explosifs de
guerre pour faire la pêche des poissons en entrainant la perte
considérable des alvins par ces matières toxiques d'où la
pollution des rivières comme Ndima,Mugoma et Lisala.
« La présence des mines et engins non
explosifs constitue un obstacle majeur à la pacification de la
région et à la normalisation de la situation des populations
locales. Elle entrave les activités socio-économiques des
populations qui ont été contraintes d'abandonner des terres,
points d'eau, sentiers, habitations etc, freine le retour et la
réinsertion des déplacés de guerre et expose les
populations et l'environnement à un danger
permanent ».89(*)
3.1. Conséquence pour le
secteur de la conservation et des ressources naturelles.
« Les conflits armés peuvent avoir des
conséquences désastreuses pour les activités
reliées à la conservation comme cela s'est produit en RDC. Les
bâtiments, véhicules et équipement peuvent devenir la cible
aussi bien des unités armées que des populations locales. Les
bâtiments de l'administration centrale des parcs, les postes
avancés de patrouille, le matériel mobile et les véhicules
des gardes forestiers ont été pillés ou
systématiquement détruits pendant les conflits en RDC. Cette
destruction a contribué à affaiblir les institutions tout en
nuisant considérablement aux programmes d'entretien et de surveillance
des aires protégées. Les activités de conservation dans
certaines aires protégées étaient interrompues quand la
situation devenait trop instable. Le personnel de niveau supérieur
était le premier à quitter les lieux lorsque cela devenait
nécessaire. Les cadres supérieurs pouvaient avoir accès
à des fonds destinés au projet ou à des véhicules
et devenir la cible de voleurs. Car le personnel de niveau supérieur
pourra appartenir à un groupe ethnique ou religieux ciblés par
des ennemis politiques. L'évacuation du personnel de niveau
supérieur signifie qu'un personnel local inexpérimenté ou
subalterne laissé sur place peut se retrouver dans des situations
extrêmement délicates et devoir assumer de lourdes
responsabilités pour lesquelles il n'a pas été
suffisamment formé. Les conflits armés ont aussi
entraîné un « exode des cerveaux » lorsque les natifs
d'un pays ayant fait des études supérieures dans les domaines
associés à l'environnement avaient décidé de
quitter le pays et de ne plus y revenir. Il n'est resté alors qu'un
nombre limité de personnes érudites dans le secteur de
l'environnement, ce qui a nuit aux initiatives de reconstruction et de
conservation d'après -conflit.90(*)
Dans des conditions précaires, plusieurs organisations
de conservation avaient choisi de quitter le terrain lorsque les conflits
éclataient. Cela a eu souvent des conséquences
désastreuses pour les activités de conservation. En quittant les
lieux, les organisations ont perdu leur capacité de protéger les
investissements en place, de maintenir leur rôle, d'entretenir leurs
relations, de conserver le respect de leurs partenaires et d'influencer la
gestion future des ressources naturelles dans l'après-guerre.
La déforestation a été l'un des impacts
les plus visibles dans la crise des réfugiés. Les agences
humanitaires fournissaient abri et nourriture aux réfugiés, mais
ceux-ci devaient se débrouiller pour cuisiner. La collecte et la coupe
de bois à brûler sont rapidement devenues une menace importante
à l'environnement. En moyenne 40.000 personnes entraient dans le parc
chaque jour à la recherche de bois.
D'un point de vue qualitatif, au moins deux tiers du
déboisement se sont produits dans les forêts des plaines de lave,
des zones relativement pauvres en matière de biodiversité. De
plus, au moins 50 pour cent des zones rasées ou sévèrement
touchées par les réfugiés et déplacés
appartenaient à des forêts jeunes composées
d'espèces pionnières, au premier stade de la recolonisation sur
des coulées de lave. Les dégâts les plus
irréversibles ont été observés dans le secteur
Mikeno, dans la zone d'influence du camp de kibumba, où d'importantes
zones ont été déboisées. Le Podocarpus milanjianus,
dans la forêt de montagne, a été particulièrement
touchés.
Tableau 21. Répartition de la quantité de
charbon de bois (Nombre de sacs): Barrière de Munigi 91(*)
|
Lieu
|
Répartition de la quantité de
Charbon de bois(Nombre de sacs) :Barrière de
Munigi
|
%
|
|
Village le long du parc de Virunga
|
21 272
|
79%
|
|
Autres villages
|
5 680
|
21 %
|
|
Ensemble
|
26 952
|
100%
|
Source :Enquête sur le charbon de bois : Africa
Conservation Fund (UK), ACF(UK) réalisée par Jean-Claude
BALOLEBWAMI
Tous ces facteurs contribuent à réduire la
capacité du secteur de conservation en temps de conflit armé et
au cours de la période qui suit. Outre ces conséquences et
impacts directs, les conflits armés peuvent également avoir des
conséquences plus générales qui ont à leur tour un
impact considérable sur l'environnement et sur ceux qui en
dépendent. »92(*)
3.2. De la dégradation de
l'environnement et de la pauvreté.
« L'épuisement de la biodiversité et
des ressources naturelles de base par le conflit armé en RDC pourra
nuire au potentiel de paix et de subsistance durables des résidents de
longue date des régions touchées par la guerre. Bien que les
conflits aient été déclenchés pour des motifs tout
à fait différents, l'épuisement des ressources et la
dégradation de l'environnement a entraîné les
régions touchées dans un cercle vicieux tel que la
pauvreté, l'instabilité politique accrue, l'intensification des
conflits armés au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans la province Orientale,
la dégradation accrue de l'environnement et la pauvreté accrue
dans ces provinces. Même si certaines organisations de conservation
étaient parvenues à demeurer sur place en temps de conflit, leur
efficacité a été souvent restreinte par un environnement
politique et décisionnel qui relègue la conservation à
l'arrière plan.
L'utilisation durable des ressources, l'accès
adéquat des communautés rurales aux terres et aux ressources et
la conservation de la biodiversité ont été
négligés dans la précipitation à développer
des politiques axées sur la promotion du prompt développement
d'après-guerre.
Bien que les reformes politiques puissent susciter
l'enthousiasme dans certains secteurs, la capacité de formuler et de
mettre en oeuvre de telles réformes à ce moment précis, y
compris d'assurer une couverture environnementale appropriée, est
souvent défaillante. Cette phase d'après guerres est
accompagnée d'une certaine confusion et de piètres communications
entre les différents ministères du gouvernement et les secteurs
techniques. »93(*)
Partie seconde : DE
L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT EN RDC
L'effectivité des accords internationaux sur
l'environnement demeure un des principaux défis de la gouvernance
mondiale pour ces siècles dominés par le technicisme et
l'accroissement démographique mondiale à 7Milliards d'habitants.
S'ils se conformaient aux processus classiques de régulation,
fondés sur la somme des intérêts particuliers d'Etats
souverains, les accords internationaux sur l'environnement seraient moins
nombreux et surtout très peu efficaces. Or, il existe un nombre
considérable de traités, avec des régimes complexes
impliquant un grand nombre d'acteurs. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), souvent considère comme puissante et efficace, cherche
à clarifier ses liens avec les accords multilatéraux
d'environnement(AME), traduisant ainsi une partie du divorce qui existe dans la
littérature scientifique à propos de ces accords et des moyens de
les rendre efficaces. Certes, il est indispensable de proposer un excellent
éventail de l'état actuel des connaissances sur
l'effectivité et l'efficacité des AME. En confrontant d'une
manière tout à fait nouvelle les instruments juridiques aux
résultats de la recherche sur les relations internationales, cette
seconde partie montre le cycle des influences qui s'opère entre le
droit, le comportement des Etats et des individus et leur effet cumulé
sur l'environnement. Il identifie le rôle joué par les nombreux
acteurs impliqués dans ces régimes et souligne le grand
caractère innovant du droit environnemental international tenant compte
des obstacles liés à l'effectivité et
l'efficacité.
La seconde partie porte sur deux chapitres dont le premier
abordera la manière de renforcer des instruments juridiques
internationaux pour la protection de l'environnement, le second chapitre quant
à lui portera sur les poursuites judiciaires contre des auteurs de la
violation de droit de l'environnement.
Chapitre premier : RENFORCER
L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Evidement la RDC possède un important arsenal juridique
en matière environnementale auquel son application pose problème
pour défendre efficacement l'environnement. Par ailleurs, de structures
publiques de gestion de l'environnement et les organismes internationaux en la
matière sont visibles dans le pays. Il reste la question de savoir
où loge alors le problème d'inefficacité de DIE lorsqu'
on dispose du droit et de l'organisation en place.
SECTION I : SOURCES DE DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
§1. Conventions
Internationales
Les conventions internationales ou traités constituent
à ce jour l'outil le plus opérant de coopération
interétatique, notamment parce que leur contenu est obligatoire en vertu
du principe Pacta sunt servanda rappelé à l'article 26
de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Ces
dernières années, l'activisme diplomatique a encore
régulièrement nourri le droit international de l'environnement de
nouvelles conventions. Le DIE comprend plus de 300 conventions ou
traités multilatéraux sans compter les accords
bilatéraux.
Mais, au regard de la modestie des résultats, cette
prolifération normative en DIE a pris des allures de fuite en avant. La
convention fatigue et explique aussi qu'aucune nouvelle convention n'ait
été adoptée à Johannesburg. Le Sommet de la terre
pour le développement durable (SMDD) marque ainsi un rejet, au moins
temporaire, de la voie conventionnelle pour traiter certaines questions
conflictuelles appelant des engagements contraignants, telles que la
responsabilité des entreprises et notamment des sociétés
transnationales, voire l'agriculture durable dans ses différents
aspects. Le plan d'application affirme au contraire qu'il est nécessaire
de consacrer moins de temps à la négociation des textes à
adopter et davantage à l'examen des questions concrètes
d'application. Par ailleurs, il insiste à de multiples repris sur la
nécessité de ratifier et d'appliquer les différentes
conventions existantes. Les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les États en litige. La
RDC a montré cette volonté de ratifier plusieurs conventions
internationales parmi les quelles celles portant protection de l'environnement.
§2. La Coutume
La coutume internationale comme
preuve d'une pratique générale, acceptée comme
étant le droit. Elle est une source non écrite
de DIE. Les éléments constitutifs de la coutume sont la pratique
générale, le consuetudo, c'est-à-dire l'ensemble
d'actes divers non équivoque, accompli de manière analogue,
répété par les membres de la société
internationale et l'opino juris qui est l'élément
psychologique, c'est-à-dire avoir la conviction d'observer une
règle de droit. Pour Dionisio Anzilotti, « dans les relations
internationales, il y a une coutume juridique lorsque les États se
comportent en fait d'une certaine manière, en ayant la conviction qu'ils
sont obligatoirement tenus de le faire »94(*).Le fait que la coutume soit
une source de droit non écrite pose la question de son
opposabilité. Autrement dit, comment prouver qu'une coutume existe
bien ? Les moyens de démontrer la règle coutumière
sont divers : documents diplomatiques (recueils,
correspondances, etc.), décisions judiciaires ou arbitrales
(CIJ, 20 février 1969, Affaires du plateau continental de la Mer du
Nord : le principe de l'équidistance n'est pas une
règle coutumière pour les États).
§3. Les principes
Généraux de Droit
De façon générale en droit
international« Les principes généraux sont aussi de
sources de droit non écrites et reconnus par les nations
civilisées. Principes Généraux du Droit ( PGD), sont des
règles de droit que le juge ou l'arbitre international applique mais
sans toutefois les créer. Les auteurs de la doctrine sont divisés
quant à la question de savoir si les PGD sont des sources autonomes soit
directes du droit international. En DIE , un Principe est utilisé ici
en tant que base ou fondement du Droit. Selon l'enseigne Gomes CANOTILHO,
« les principes sont des normes juridiques d'imposition d'une
optimisation, compatibles avec les différents degrés de
concrétisation, selon les conditionnalités de fait et de droit.
Ils rendent possible le balance de valeurs et d'intérêts (ils
n'obéissent pas, comme les règles, à la logique du tout ou
rien), selon leur poids et la pondération d'autres conflits
éventuellement conflictuels . Ce sont des standards juridiquement
contraignants, axés dans les exigences de `justice' ou dans
l'idée de droit'.Certains des principes que l'on expose ici trouvent
leur support dans des déclarations internationales, un fait qui, selon
souligne Maurice KAMTO, renforce la potentialité de que ses principes
deviennent des normes coutumières, dans l'impossibilité de
devenir des normes juridiques originaires de conventions. Les principes que
l'on aborde sont en train de former et d'orienter la génération
et la mise en oeuvre du droit de l'environnement. »95(*) Le PG de DIE égorge en
son sein un nombre si important des principes il ne sera pas question de les
citer tous où d'expliquer les quelques qui ont retenu notre attention,
il s'agit de : principe de précaution, principe de
prévention, principe de pollueur payeur, principe d'information,
principe de participation, principe de l'environnement sain, principe de
développement durable. » Exemple de prévention et
l'introduction du principe de précaution dans le droit de
l'environnement laisse à constater que la prévention
d'une dégradation de l'environnement au plan national et international
est une conception qui a passé à être
acceptée dans le monde juridique spécialement dans les
trois dernières décennies. On n'a pas inventé toutes les
règles de protection de l'environnement humain et naturel dans
cette période.
En outre, les principes et les concepts du droit international
de l'environnement sont : la Souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, le Développement durable, l'intégration et
interdépendance, l' Équité inter et intra
générationnelle, le Préjudice transfrontalier ,la
Coopération et responsabilités communes mais
différenciées, la Précaution ,la Prévention, le
Pollueur-payeur, l'Accès et partage des bénéfices
concernant les ressources naturelles, l' Héritage commun de
l'humanité, la Bonne gouvernance et l'étude d'impact
environnemental et social.
Section II : DE LA RECEPTION
DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL
En vertu du principe de droit international selon lequel tous
les Etats de la communauté internationale sont souverains et
égaux, la RDC dispose d'une juridiction prima facie exclusive sur son
territoire ainsi que sur la population vivant dans les limites de ce dernier.
En conséquence, l'Etat congolais est le seul compétent pour
définir les législations et politiques relatives à son
environnement, à ses ressources naturelles et aux individus
présents sur son territoire. Cette compétence doit toutefois
s'exercer dans le respect des obligations juridiques internationales
découlant, soit de l'application des règles du droit
international coutumier, soit du consentement de l'Etat congolais à
être lié par les dispositions d'un traité qui revêt,
conformément à l'article 215 de la Constitution de la RDC, une
autorité supérieure à celle des lois, dès sa
publication dans le système juridique interne. Cela fait de la RDC un
pays moniste.
§1. Les Difficultés
de Mise en OEuvre du droit international de l'environnement en Période
des Conflits Armés
La nature changeante de la guerre à l'est de la RDC
pousse à nous fixer sur la compréhension du concept conflit
armé et c'est le droit international humanitaire qui offre la
définition car «Les États parties aux
Conventions de Genève de 1949 ont chargé le CICR, par le biais
des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
de travailler à la compréhension et à la diffusion du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et
d'en préparer les développements éventuels . C'est en
vertu de ce mandat que la CICR saisit cette occasion pour présenter
l'avis de droit prédominant sur la définition du conflit
armé international et du conflit armé non international en
droit international humanitaire, la branche du droit international qui
régit les conflits armés. Le droit
international humanitaire distingue deux types de conflits armés :
le conflit armé international, qui oppose deux
États ou plus, et le conflit armé non international, qui oppose
les forces gouvernementales à des groupes armés non
gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Les traités de
droit international humanitaire font également une distinction entre le
conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la
définition figurant à l'article 1 du Protocole additionnel II. Du
point de vue juridique, il n'existe aucun autre type de conflit armé.
Néanmoins, il convient de souligner qu'une situation peut évoluer
et passer d'un type de conflit armé à un autre, selon les faits
prévalant à un certain moment. »96(*)Retenons qu'aucune
déclaration officielle de la guerre même si la RDC est victime
d'une insécurité causée par l'intervention
étrangère de ses voisins(le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi).Nous
pouvons admettre qu'il s'agit de conflit non international.
En examinant les difficultés de mise en oeuvre de DIE
en période de conflit armé, nous vous présentons d'abord,
le contexte général de la difficulté de
l'applicabilité pendant le conflit armé ensuite, le contexte
spécifique de la RDC où les réalités sont presque
les mêmes à par une particularité.
A. Le contexte
général
Certes, l'application de droit international de
d'environnement en période de conflits armés explore les
déficiences structurelles et le manque de clarté du cadre
juridique international en vigueur qui sont le droit international humanitaire
(DIH) et le droit international de l'environnement (DIE) visant à
limiter les effets des conflits armés sur l'environnement.
« Directes ou indirectes, les protections de
l'environnement en période de conflit armé prévues par le
DIH ont une valeur incertaine ; les dispositions du DIH qui traitent
explicitement de la protection de l'environnement dans les conflits
armés sont peu nombreuses et inadéquates. Pour sa part, le DIE
est un vaste corpus de règles juridiques protégeant
l'environnement ; il contient un ensemble de normes et de mécanismes
toujours plus nombreux qui visent à lutter contre les atteintes à
l'environnement en temps de paix et qui s'orientent toujours davantage sur les
questions de responsabilité. Le débat est ouvert quant à
savoir si, et dans quelle mesure, le DIE continue de s'appliquer et d'offrir
une protection en période de conflit armé.97(*)»
Certaines lacunes et déficiences essentielles du DIH
sont ressorties, puis examinent les opportunités qui existent à
l'intersection de ces deux branches du droit international par M.BOTHE et
consort. Ces derniers débutent par une analyse des trois
faiblesses essentielles du corpus de DIH aujourd'hui en vigueur. Tout d'abord,
le Protocole additionnel I (PA I) définit le seuil des atteintes
inadmissibles à l'environnement (les dommages causés doivent
être « étendus, durables et graves ») d'une
manière qui est à la fois excessivement restrictive et peu
claire. « Ensuite, les dispositions du DIH relatives à la
protection des biens de caractère civil ne prévoient pas de
protection suffisante des éléments de l'environnement contre les
dommages causés en période de conflit armé. Enfin, la
proportionnalité est difficile à déterminer dans le cas
d'une atteinte à l'environnement qualifiée de dommage incident
(collatéral). Des opportunités spécifiques de
remédier au problème sont présentées à
propos de ces différentes lacunes. L'article examine ensuite les
façons dont le DIE pourrait pallier à certaines
défaillances du DIH en ce qui concerne la protection de l'environnement
en temps de conflit armé. Des questions demeurent cependant quant
à l'applicabilité générale du DIE durant les
hostilités et également quant à l'application de types
particuliers de dispositions du DIE. Certains traités stipulent
expressément s'ils restent ou non applicables en période de
conflit armé (voir, par exemple, certaines dispositions de la Convention
sur le patrimoine mondial) ; d'autres ne font allusion que de manière
indirecte à la question (Convention de Ramsar, par exemple) ; enfin,
d'autres traités (Convention sur la diversité biologique,
notamment) restent muets sur ce point. Par ailleurs, plusieurs théories
s'affrontent au sujet de la méthode la plus appropriée pour
déterminer si, d'une part, le DIE continue ou non de s'appliquer en
période de conflit armé et si, d'autre part, la réponse
à cette question varie selon ce dont on parle, à savoir les
accords multilatéraux sur l'environnement (AME), les principes de DIE
ou, enfin ,le droit international coutumier de l'environnement. Bien que
variées, ces approches mettent en évidence que des
opportunités existent bel et bien. Elles permettraient, d'une part, de
compléter les dispositions existantes du DIH relatives à la
protection de l'environnement dans les conflits armés et, d'autre part,
de répondre à la question de savoir si, et dans quelle mesure,
les normes, standards, approches et mécanismes du DIE peuvent être
appliqués pour prévenir, engager ou évaluer la
responsabilité en matière de dommages causés à
l'environnement en période de conflit armé. »98(*)
Le corpus de droit international humanitaire (DIH) relatif
à la protection de l'environnement dans les conflits armés
souffre de trois déficiences essentielles. Tout d'abord, la
définition de ce qui constitue une atteinte inadmissible à
l'environnement apparaît à la fois trop restrictive et peu claire
; ensuite, des incertitudes juridiques demeurent quant à la protection
des éléments de l'environnement en tant que biens de
caractère civil ; enfin, l'application du principe de
proportionnalité lorsque l'atteinte à l'environnement constitue
un dommage incident est également problématique. Toutefois,
à ces diverses lacunes correspondent des opportunités
spécifiques de clarifier et développer le cadre juridique
existant. L'application du droit international de l'environnement (DIE) en
période de conflit armé pourrait constituer l'une des
façons de parer à certaines défaillances du DIH. Les
normes, standards, approches et mécanismes détaillés
figurant dans le DIE pourraient également contribuer à clarifier
et à développer les principes de base du DIH afin de
prévenir, actionner ou évaluer la responsabilité en
matière de dommages causés à l'environnement lors d'un
conflit armé.« Ensuite, les normes doivent être
effectives, car l'efficacité d'un instrument international ne
préjuge pas de son effectivité. Toujours selon de Visscher, on
peut tenir pour effectives les dispositions d'un traité selon
qu'elles se sont révélées capables ou non de
déterminer chez les intéressés les comportements
recherchés. Or, la remarque générale de cet auteur
selon laquelle trop (de traités) dotés d'une
efficacité certaine et pourvus d'adhésions nominales nombreuses
restent démunis d'effectivité s'applique bien au droit
international de l'environnement. Si les progrès de la
coopération internationale sont notables, l'application nationale,
notamment par la transcription des normes internationales dans les droits
internes, demeure insuffisante. La plupart des obligations ne sont pas
auto-exécutoires ; en outre, les mécanismes classiques de
réaction à la violation substantielle d'une obligation
conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un
engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Cela
contribue à rendre difficile la mise en oeuvre des règles
posées. À priori, si ces deux conditions d'efficacité et
d'effectivité sont remplies, in fine la qualité de
l'environnement sera améliorée grâce au régime ou
traité (problem-solving). Le régime ou traité est
alors effective au sens anglais ; l'effectiveness couvrant
ces deux aspects. »99(*)
B. Le contexte
spécifique
La particularité sur les difficultés de
l'application de DIE dans la protection de l'environnement en temps de guerre
s'appuie sur deux armatures qui sont l'égoïsme et
l'irresponsabilité morale des auteurs reprochés ainsi que
d'autres causes sont aussi importantes que leur énumération
s'avère judicieuse :
- De l'égoïsme, on entend de tout comportement
tourné vers soi même sans tenir compte des intérêts
des autres, l'exemple des agents commis aux parcs et des habitants de
cités environnantes avertis des règles de DIE mais pour
satisfaire leur cupidité, ils se lancent dans cette entreprise
malhonnête.
- L'irresponsabilité morale quant à elle anime
plusieurs auteurs mis en cause qui, par omission de condamner soit par
commission en détruisant l'environnement, ignorent la gravité des
actes posés ; l'exemple d'un braconnier qui selon lui un parc est
simplement une forêt aussi un patrimoine clanique c'est-à-dire un
héritage des ancêtres or, ce qui fait l'objet de l'héritage
des ancêtres ne peut culturellement pas être bradé voire
confisqué par l'étranger.100(*)En outre, Les troupes
rwandaises qui considèrent que les APs reflètent les attributs de
l'Etat congolais, d'où en s'attaquant de ces patrimoines naturels, on
efface les traces du pouvoir adverse.
-la méconnaissance de traités ratifiés
par la majorité de la population car la publicité d'un
traité se limite seulement au journal officiel dont sa communication
n'est pas massive ;
-les groupes armés sont composés des commandants
et des troupes sans formation régulière, ils sont des maquisards
et ignorent les règles de la guerre .Ils avaient appris que la
guérilla et sont drogués pour accomplir une tâche
criminelle. Leur recrutement vise une grande partie des jeunes villageois qui
ont raté les études adéquates ;
-le pays trop vaste et n'est pas suffisamment couvert par les
tribunaux faute de l'effectif moindre de magistrats. En outre, faut-il se
demander si ces derniers sont suffisamment formés en DIE ;
-le droit de l'environnement demeure une nouveauté
même dans le monde des juristes congolais. L'introduction de cours du
droit de l'environnement est encore timide mais elle fait rêver
l'espoir ;
-les victimes de la guerre qui sont des populations
déplacées ou refugiées se servent abusé ment de
l`environnement sous prétexte de cas de
nécessité ;
-la désertion de postes clés de services
compétents de l'Etat par son personnel qui souvent est plus visé
comme cible à abattre par conséquent, laisse la structure
déficitaire. L'exemple de massacre des okapis par la bande armée
de braconnier Morgan101(*). Ce dernier arrêté et torturé
auparavant par le garde de réserve d'Okapis du nom d'Amisi et
transféré au parquet. Relâché, il a repris sa
revanche contre Amisi en violant puis bruler son épouse vive avec un
autre garde du parc. Donc, il tue les okapis pour régler de compte
à Amisi comme si ce dernier serait propriétaire des okapis. Les
images à l'annexe VI;
-enfin l'urgence humanitaire relègue toujours le
problème environnemental au second plan.
§2. Renforcer
l'opérationnalisation des conventions internationales à
l'échelon national
La RDC a ratifié plusieurs conventions internationales
dans le but de préserver son environnement plus viable et parmi elles,
il est prévu un nombre d'outils juridiques de prévention
relevant du DIE. La question est de savoir si cette quantité
répond à l'efficacité ou elle n'est qu'une
prolifération de soft law. Le DIE comprend une série de
conventions qui s'appliquent effectivement en paix, on s'en doute, en cas de
menaces à l'environnement liées conséquences de la guerre.
La mise en oeuvre de ces conventions aurait pu limiter les dégradations
subies par l'environnement suite aux différents acteurs des conflits
armés à l'est de la RDC. Envisageons-nous de faire dans
les développements qui suivent un tour d'horizon des ces instruments
juridiques internationaux pour la protection de l'environnement dont leur
violation est récurrente en situation de conflits armés. Ce
survol nous permettra de comprendre les faiblesses du cadre normatif
actuellement en vigueur. Ce paragraphe regroupe ce cadre normatif en
deux : d'abord, les conventions internationales relatives au DIE ensuite,
les conventions internationales relatives au DIH.
A. LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES RELATIVES AU DIE
1.- La
Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992
Il est disposé à
l'article 8 de la conservation in situ«(d) de favoriser la protection des
écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de
populations viables d'espèces dans leur milieu naturel ; (k)
formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres
dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les
espèces et populations menacées.»102(*)Quelque soit la convention ne
prévoit pas in expressis verbis son application dans le conflit
armé mais d'une manière autre elle répond à la
préoccupation de réglementer et de restaurer pour la conservation
ex situ à travers les alinéa c et d de l'article
9 : «chaque partie contractante, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures
de conservation in situ :(c)adopter les mesures en vue d'assurer la
reconstitution et la régénération des espèces
menacées et la réintroduction des espèces menacées
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions.(d)Réglemente et
gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels
aux fins de la conservation ex situ de manière à
éviter que soient menacés les écosystèmes et les
populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex
situ particulières sont temporairement nécessaires,
conformément à l'alinéa(c)
ci-dessus. »103(*)
Cette Convention Diversité Biologique
ratifiée par la RDC en 1994 dont l'objectif premier est la conservation
de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments constitutifs. La diversité biologique des
forêts constituant un aspect de cette diversité biologique globale
adressée par la Convention Diversité Biologique, l'Etat congolais
doit respecter les dispositions de la Convention lorsqu'il
légifère ou conçoit sa politique en matière de
gestion des ressources forestières du pays.
C'est ainsi que les articles 2 et 3 du Nouveau Code
Forestier(NCF) de la RDC prévoient que le nouveau texte
législatif vise, entre autres objectifs, à la préservation
de ses « écosystèmes forestiers et de la biodiversité
forestière au profit des générations futures », et
régit en conséquence « la conservation [...] des
forêts et des terres forestières » et « contribue
également à la valorisation de la biodiversité, et
à la protection de l'habitat naturel de la faune sauvage ».
Cette formulation semble donc confirmer la réalisation
par le Nouveau Code Forestier de l'harmonisation du régime forestier
congolais par rapport aux obligations internationales incombant à la RDC
en matière d'environnement, et plus spécialement en ce qui
concerne la diversité biologique.
Concernant la pertinence des conventions relatives aux droits
de l'Homme le Nouveau Code Forestier ne soulèvent pas seulement des
questions purement environnementales. La préservation et la gestion des
écosystèmes forestiers supposent la prise en compte de tout
facteur ayant un impact ou étant susceptible d'en avoir un sur ces
mêmes écosystèmes. L'exploitation du bois, pour ne citer
que cet exemple, implique d'évidentes problématiques humaines
liées aux populations riveraines des forêts et au
développement économique et social du pays.
Il est donc nécessaire d'adopter une approche
compréhensive de l'écosystème forestier qui intègre
des facteurs environnementaux mais aussi toutes les activités humaines,
bénéfiques ou néfastes, à caractère
économique, social, culturel ou autres, afin de permettre une gestion
efficace des ressources forestières qui prend en compte les
communautés et économies qui en dépendent.
L'étude des dispositions du nouveau code nous
amènera ainsi à mettre en avant la pertinence des droits et
obligations découlant de plusieurs conventions internationales relatives
à la protection des droits de l'Homme, et plus particulièrement
des droits dont bénéficient les populations et individus vivant
à l'intérieur ou à proximité des forêts de la
RDC.
Cependant, nous constatons, dans la partie Est du pays fiefs
de conflits armés récurrents, que cette convention CDB
répercutée dans ce NCF n'est pas effective pour des raisons de
dommages environnementaux causés par les groupes armés soit
aussi la population déplacée ou des refugiés compte tenue
des contraintes de survie dégrade aussi la flore. En cela nous
rejoignons le Représentant du Ministre Congolais de l'Environnement qui
affirme ces dommages environnementaux en déclarant que
le« Point n'est besoin de vous rappeler que les conflits armés
ont suscités un déplacement massif des personnes et à cela
s'est ajouté le problème des réfugiés et des
populations migrantes. En plus de cela, ils ont causé les
problèmes ci-dessus :
- Endommagement de la biodiversité ;
- Destruction des aires protégées ;
- La contamination des sols et des nappes phréatiques
;
- La déstabilisation d'une paix durable ;
- La haine, l'ethnicisme et le tribalisme, et j'en passe car
la liste n'est pas exhaustive.»104(*)
2.-La Convention de Washington
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction entrée en vigueur le 17 septembre
1973(CITES)
Les textes relatifs à la préservation de la
faune se sont trouvés, dès l'époque coloniale,
(décret du 21 avril 1937 portant régime de la chasse et de la
pêche) appartenir à l'ensemble des textes relatifs à la
gestion de la forêt et à la chasse.
Un rapport SOFRECO de juin 2004 destiné à la
Banque Mondiale et que nous citerons dans d'autres occasions analyse ainsi le
cadre institutionnel de la législation de la R.D.C. en matière
environnementale: Les textes définissant le cadre institutionnel et
réglementaire représentent 25% de l'ensemble des textes
législatifs en matière environnementale pendant la période
coloniale et 45 % des textes émis depuis l'indépendance. Ils
concernent essentiellement la création, depuis 1989, de multiples
commissions, comités, instituts, départements, directions,
services, offices, cellules, centres et réseaux dont la pertinence en
2003 reste à démontrer. On dirait que la
législation de la RDC en matière d'environnement, est le reflet
de son histoire, chaotique et sans orientation définie au regard des
intérêts du pays faute des influences des experts
étrangers.
La loi du 28 mai 1982 porte réglementation de la
chasse. La législation est axée sur les modalités
d'exploitation de la faune plutôt que sur sa protection en cas de
réalisation d'infrastructure la mettant en danger. La
nécessité d'études d'impact n'est pas relevée.
Les contraintes environnementales dans les réserves de
faune se réduisent à des interdictions de principe. Interdiction
de détériorer d'une manière irrégulière
l'habitat de la faune sauf autorisation de l'autorité locale ou bien de
modifier les activités humaines au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
L'application de ces textes est donc soumise à
l'interprétation arbitraire de l'autorité locale et des parties
en présence. Mais, ce n'est pas à confondre à la chasse
destructrice des espèces rares et protégées par les
groupes armés. Ces derniers feignent l'ordre juridique sur le plan du
DIE et du DIH.
C'est le cas de parcs susdits qui ont été envahi
surtout pendant la guerre d'agression où plusieurs espèces
menacées d'extinction et autres protégées ont fait l'objet
du commerce des troupes rwandaises et ougandaises en prenant la destination
dans leurs parcs en violant les dispositions de l'article 2
alinéa : « l'Annexe I comprend toutes les
espèces menacées d'extension qui sont ou pourraient être
affectées par le commerce des spécimens de ces espèces
doit être soumis à une réglementation
particulièrement stricte afin de ne pas mettre d'avantage leur survie en
danger, et ne doit être autorisé que dans les conditions
exceptionnelles .105(*)»Et aller loin jusqu'à ce que
« les parties prennent les mesures appropriées en vue de la
mise en application des dispositions de la présente convention ainsi que
pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses
dispositions. Ces mesures comprennent :a)des sanctions pénales
frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens ou
les deux.
b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation
de tels spécimens. »106(*)Le commerce des espèces
protégées est soumis à certaines restrictions
prévues par des textes nationaux particuliers notamment :
-l'Arrêté Ministériel de 2000
réglementant le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction met en application les dispositions
de la CITES ;
-l'Arrêté Ministériel n°
CAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars fixant les périodes de
prélèvement des perroquets gris en RDC ;
-le Protocole d'accord signé en 2000 fixant les
modalités de collaboration administrative entre l'Organe de Gestion
CITES, l'OFIDA et l'Office Congolais de Contrôle pour la lutte contre le
commerce illicite des espèces CITES.
Prise en compte des Conventions Internationales dans la
législation, est démontré à travers d'autres
adhésions.
La RDC a adhéré à la convention (Londres
14.01.1936) relative à la conservation de la faune et de la flore
à l'état naturel.
La RDC a adhéré le 15.09.1994 à la
convention relative aux zones humides comme habitat de la sauvagine (Ou
Convention de Ramsar)
La RDC a adhéré le 05 mars 1994 la convention
sur les espèces migratrices .
Nous lisons toutefois dans le rapport SOFRECO : Le lien entre
espèces menacées et habitats n'est pas établi. Aucun texte
législatif ne permet l'application de cette convention sur le terrain
notamment pour prendre en compte les risques liés au trafic routier sur
les principaux axes de circulation. Aussi, ne sont pas prévues les
études d'impact qui permettraient de retenir des mesures
d'atténuation.
Cette convention n'est pas respectée pendant la guerre
en RDC car, à par les rhinocéros blancs, d'autres cas sont
illustrés notamment la tuerie des 13 Okapis aux réserves d'Okapi
d'Epulu.107(*) Le
conservateur chef de parc, Guy Mboma Ngwedi affirme que :
« L'okapi, l'éléphant de forêt, le gorille, le
chimpanzé à face claire et le buffle sont menacés
d'extinction au parc de la Maïko, situé à cheval entre la
province Orientale (nord-est) et celle de Maniema(est), en République
démocratique du Congo (RDC). Ces espèces animales subissent des
menaces telles que le braconnage, des incursions des inciviques, des
carrières minières dans le parc, des feux de brousse et la
déforestation. Selon M. NGwedi, le départ du sol congolais des
éléments du groupe armé "Simba" pourrait faire retourner
la paix dans ce parc. Les éléments de "Simba" abattent des
espèces protégées et y creusent de l'or pendant presque
deux générations. Les espèces clés de ce parc sont
le paon congolais, l'éléphant de forêt, l'Okapi et le
chimpanzé à face claire. »108(*)
3. -Charte Mondiale de la
Nature
Mais, les principes généraux pour la Charte
Mondiale de la Nature adoptée et solennellement proclamée par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 22 octobre 1982
interdisent clairement toute violation en faisant allusion même à
la guerre. « (1) La nature sera respectée et ses processus
essentiels ne seront pas altérés. (5) La nature sera
préservée des déprédations causées par la
guerre ou d'autres actes d'hostilité »109(*)Cette disposition vient
clairement d'enlever toute confusion allant de doute sur son application en
période de guerre ou de paix pourtant, ces différents acteurs en
conflit n'arrêtent pas à se distinguer en violation de cette
disposition en détruisant la faune et la flore dans les APs. Donc, nous
affirmons que cette convention n'est pas applicable du fait que les services
compétents de l'Etat sont soit impuissants devant les hommes
armés soit complices en monnayant ces dommages avec ceux qui commercent
les charbons soit débordés par la présence d'une masse de
la population déplacée par la guerre. Face à ce constat,
il est indispensable de savoir la législation en vigueur et
procéder à son évaluation.
3.1. Législation en
vigueur
Les Aires Protégées de la RDC sont actuellement
régies par les textes légaux suivants :
1° L'Ordonnance-loi n° 69/041 du 22 aout 1969
relative à la conservation de la nature,
2° La Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant
règlementation de la chasse en République Démocratique du
Congo,
3° Le décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant
les statuts de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
(ICCN),
4° Les Conventions et Accords internationaux sur la
conservation de la Biodiversité et l'Environnement ratifiés par
la RDC
3.2. Evaluation de la
législation nationale
1° Ordonnance-loi n° 69/041 du 22 aout 1969 relative
à la conservation de la nature :
Elle est en cours de révision car :
- inadaptée aux principes modernes de gestion de la
biodiversité et des aires protégées et aux exigences de la
mise en oeuvre des conventions internationales ratifiées par la RDC ;
- n'a pas de mesures d'application, ce qui rend son
exécution parfois difficile ;
- ne prend pas en compte les nouveaux défis du
développement durable, de changement climatique et de la lutte contre la
pauvreté des populations riveraines
La législation interne est influencée par cette
convention et est en voie de modification.
Faut-il ajouter que cette modification envisagée ne
serait véritablement efficace qu'en tenant en compte de l'aspect de
conflits armés.
4- .Déclaration de
Rio sur l'environnement et le Développement de 1992
Principe 24« La guerre exerce une action
intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les
Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la
protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer
à son développement selon que de besoin. »Principe
25 : « La paix, le développement et la protection de
l'environnement sont interdépendants et
indissociables. »Malheureusement, cette déclaration ne fourni
que des recommandations et non des obligations .Ses principes ne sont pas
juridiquement contraignants, sauf s'ils s'élèvent au niveau du
DIE coutumier. À titre d'exemple, on mentionnera les arguments cherchant
à établir si le principe de précaution et le droit
à un environnement sain constituent déjà ou
s'apprêtent à devenir du DIE coutumier.
Mais, la législation interne est suffisamment
influencée par cette Charte qui lui donne une inspiration.
5.- La Convention africaine sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968,
dite Convention d'Alger
Elle traite à son article 10 de l'établissement
et du maintien des aires de conservation stipule: « Les Parties
s'engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui
sont les causes de l'appauvrissement des espèces animales et
végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le
devenir, et à accorder une protection spéciale à ces
espèces, qu'elles soient terrestres, d'eau douce ou marines, ainsi
qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas
où l'une de ces espèces ne serait représentée que
sur le territoire d'une seule Partie, une responsabilité toute
particulière pour sa protection incombe à cette
Partie. »Cette convention est transversale d'autant qu'elle touche
plusieurs domaines de l'environnement.
B. LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES RELATIVES AU DIH
Le DIH est la branche du droit international public qui
réglemente la conduite des hostilités en période de
conflits armés ; elle tend aussi à protéger les
victimes de conflits armés, qu'elles soient civiles ou non.
En effet, des instruments juridiques réglementaires
existent au niveau international pour la protection de l'environnement en
période de conflits armés et sont constitués de
règles du droit de la guerre ainsi que règles du droit de la paix
qui prévoient des dispositions de protection ; et ce tant dans le
domaine du droit conventionnel que dans celui du droit coutumier.
Vu l'importance majeure et des enjeux des conflits
armés qui ne respectant pas les règles et coutumes de la guerre
occasionnent lourdement des conséquences humanitaires
qu'environnementales à grande échelle, nous traitons sur trois
grands instruments juridiques qui retiennent notre attention.
1.- La
Convention ENMOD
« La Convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles ou Convention ENMOD est un traité
international visant à interdire l'utilisation de techniques de
modification de l'environnement, et ce à des fins militaires ou
hostiles. Cette convention a été adoptée le10
Décembre par l'Assemblée générale de l'ONU, elle
fut ouverte à la signature le 18 mai 1977 à Genève. Elle
est entrée en vigueur le 5 octobre 1978: 74 pays en sont actuellement
parties ou signataires. »110(*)Malheureusement, la RDC n'a pas à ce jour
ratifié mais elle demeure seulement signataire. La Convention stipule en
son article premier que : « Chaque Etat partie à la
présente Convention s'engage à ne pas utiliser à des fins
militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification ayant
des effets étendus , durables ou graves, en tant que moyens de causer
des destruction, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat
partie ».
Selon ENMOD, le bouleversement de l'équilibre d'une
région notamment, ne doivent pas être provoqués par
l'utilisation des techniques de modification de l'environnement. Cependant, une
interrogation mérite d'être : depuis la toxicité des
produits utilisés en zones de combat, aux manipulations
environnementales testées comme éléments de
stratégie militaire et les déplacements massifs de populations
provoqués par les conflits armés ,et qui ont un impact
négatif certain sur l'environnement, rentrent-ils dans le champ
d'application de cette convention ?
La réponse ne peut qu'être négative dans
la mesure évidente où ce texte, si important, soit-il,
soulève de nombreuses questions dont certaines ne trouvent pas encore de
réponses à ce jour. La mise à feu des forêts, des
maisons et abandon de corps de cadavres et explosifs a soulevé de
façon très spectaculaire la question de la contamination
atmosphérique ainsi que la pollution à plus long terme de plans
d'eau qui peuvent résulter de tactiques militaires, et dont les effets
irréversibles peuvent se faire sentir bien après les combats.
En effet, la Convention continue de souffrir de ses faiblesses
surtout dues au manque de précision dans la définition des termes
étendu, durable et grave et sa limitation aux
seules armes de guerre relevant parfois de la science-fiction, alors même qu'il a été
démontré qu'un flux migratoire incontrôlé peut en
seule constituer une arme redoutable pouvant occasionner
la destruction de l'environnement »111(*)
2.- Le
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I)
Adopté
à Genève le 8 Juin 1977 dont le paragraphe 1èr
stipule : « Proclamant leur désir ardent de voir la
paix régner entre les peuples,(...)»car la guerre est destructrice
pas seulement des hommes mais de la nature. Si ENMOD interdit
la « guerre géophysique », le texte additionnel
des Conventions de Genève de 1949, connu sous le nom de Protocole
Additionnel I, interdit le recours à la « guerre
écologique ». L'article 55 alinéa 1er
stipule que : « La guerre sera conduite en veillant
à protéger l'environnement naturel contre des dommages
étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction
d'utiliser des méthodes et moyens de guerre conçus pour causer ou
dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement
naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la
population ». L'alinéa 2 est plus formel :
« Les attaques contre l'environnement naturel à titre de
représailles sont interdites ».
Mais il se pose un problème de pertinence de ces
règles par rapport aux effets sur l'environnement dus aux mouvements de
populations et les dommages environnementaux susdits pendant la guerre à
l'est de la RDC. Bien qu'utiles, il appert que ces règles sont
difficiles à appliquer en période de conflit. La
difficulté de mise en oeuvre de ces instruments est l'une des causes
principales de l'exacerbation et de la persistance des impacts environnementaux
des conflits. Au demeurant, l'espèce sous examen présente une
telle particularité que l'avènement d'une approche nouvelle et
d'un cadre innovant parait plus qu'opportun. Toutefois, nous pensons que cette
espèce de « vide juridique » ne doit pas pour autant
légitimer le phénomène de destruction de l'environnement
par les groupes armés et par des populations en détresse pour
cause de guerre.
3.- Les
Directives du CICR de 1996
Il s'agit des manuels d'instruction militaire sur la
protection de l'environnement en période de conflit et sont
constitués des règles du droit coutumier. En effet, En se basant
sur les recommandations d'un groupe d'experts intergouvernemental dans le cadre
de la Déclaration de la Conférence Internationale pour la
protection des victimes de guerre (Genève, 1993), le CICR ne reconnait
que « le droit existant offre une protection suffisante pour autant
qu'il soit correctement mis en oeuvre et respecté ». En
réalité, ces Directives ne constituent pas une nouvelle
codification, cependant un outil pratique et efficace pour :
« - Amener les Etats et les forces armés
à protéger l'environnement naturel en période de conflit
armé en prenant des mesures adéquates ;
- Faciliter l'instruction de la formation des forces
armées dans un domaine souvent négligé du droit
international humanitaire, celui de la protection de l'environnement
naturel ;
- Interdire l'usage des méthodes et moyens dommageables
à l'environnement naturel lors des conflits armés eu cours
desquels seuls les objectifs militaires sont attaqués, mais pas
l'environnement. »112(*)
Le but des règles du DIH ci-dessus exposées
relatives à la protection de l'environnement ne consiste donc pas
à exclure totalement les atteintes à l'environnement mais bien
plutôt à les limiter à un niveau jugé
tolérable. Mais nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le
contenu, les limites et les lacunes éventuelles des normes du DIH
relatives à la protection de l'environnement en période de
conflit armé, ainsi que sur les moyens d'améliorer cette
protection .En effet, malgré le progrès
réalisé, la matière d'environnement passe pour le
parent pauvre du droit international des conflits armés. Les atteintes
inacceptables portées à la faune et à la flore pendant les
conflits armés qui ont sévi dans la région des Grands-lacs
africains, dont les personnes déplacées de l'est de la
RDC sont comptables, montrent, si besoin en était encore, que la
protection reconnue à l'ensemble de la population civile par les
règles du DIH n'est qu'une illusion. Au-delà, la protection
proclamée de l'environnement par les règles régissant les
conflits armés, nous parait à la limite comme un voeu simplement
pieux.
Afin de combler les manquements de la loi de guerre et du
droit international de l'environnement, l'UICN a récemment
proposé dans une perspective de lege ferenda, un Projet de
convention qui offrirait en temps de conflit armé une protection
spéciale aux aires protégées naturelles ou
culturelles d'importance internationale désignées par le
Conseil de sécurité des NU. Mais dans l'entre-temps, force est de
reconnaitre que là où la primauté du droit n'existe plus,
les conventions internationales resteront toujours des outils de persuasion
morale et de sensibilisation pour l'obtention d'un soutien financier et
technique.
Chapitre
Second : DES POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES AUTEURS DES VIOLATIONS DE
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Ce second chapitre sur des poursuites judiciaires contre les auteurs des
violations de droit de l'environnement s'articule sur deux sections dont la
première sur les poursuites des auteurs devant les juridictions
nationales congolaises et la seconde section sur les poursuites des auteurs
devant les juridictions internationales.
SECTION I : LES POURSUITES
DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES CONGOLAISES
« Mus de la volonté de faire face aux
multiples défis susvisés et de contribuer à
l'atténuation des dommages environnementaux constatés, les Etas
ont adopté des accords multilatéraux sur
l'environnement ».113(*) L'Etat congolais pour corriger et adapter la
législation en vigueur anachronique et définir les grandes
orientations en matière de protection de l'environnement s'est
doté d'une nouvelle loi qu'il qualifie de prometteuse. La
responsabilité civile est prévue à l'instar de l' article
68 qui dispose : « Sans préjudice des peines
applicables pour les infractions à la présente loi et ses mesures
d'exécution, est responsable toute personne qui, par l'exercice de ses
activités a causé un dommage à l'environnement et à
la santé en violation de la présente loi »114(*) ,et l'article 69
ajoute :« toute personne physique ou morale est, non seulement
civilement responsable des condamnations pour les infractions commises en
violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution par
ses préposés dans les limites de ses activités, mais aussi
solidairement responsable du payement des amendes et frais résultats des
mêmes condamnations, à moins de prouver qu'elle était dans
l'impossibilité d'empêcher la commission de
l'infraction. »115(*)
En dehors de la responsabilité civile, la loi a
prévu la responsabilité pénale en créant un
terrain vaste de recherche des infractions relatives au droit de
l'environnement en précisant que : « sans
préjudice de prérogatives reconnues à l'officier de
Ministère Public et Officier de police judiciaire à
compétence générale, les infractions à la
présente loi et ses mesures d'exécutions sont recherchées
et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de
l'administration de l'environnement. » 116(*)La loi rejoint notre
préoccupation en période de conflit armé mais elle n'a pas
résolu le problème de la compréhension de concepts
tirés de l'article 55 de Protocole I de la Convention de Genève
de 1949 dont des définitions claires et plus appropriées sont
donc requises en libellant que : « quiconque dirige
intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement qui,
seraient excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire
concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions
pertinentes du code pénal militaire congolais. »117(*)Même si la Loi a
prétendu répondre aux réalités récentes
néanmoins, d'autres très importantes sont oubliées
comme :
· Les comportements dangereux contre l'environnement en
période de guerre ne sont pas sanctionnés car, souvent de chefs
rebelles qui sont souvent récompensés après
négociation politique avec le pouvoir pour accéder à des
hautes fonctions politiques ou militaires en bénéficiant de
régimes des immunités et des privilèges juridictionnels
soit disant au nom de la paix;
· Les eaux de rivières et l'air sont
pollués sous l'air impuissant des services compétents et
judiciaires,
· Les peines d'emprisonnement et le niveau des amendes
doivent être dissuasifs ;
· Comme la plus part des infracteurs finissent à
bénéficier des privilégiées et des immunités
juridictionnelles suite aux postes prestigieux qu'ils occupent, les dommages
graves demandent l'imprescriptibilité dans la législation
nationale.
· La nécessité d'une responsabilité
pénale sans faute des personnes morales privées ou publiques doit
être prévue, avec des sanctions appropriées ;
· aucune poursuite n'a lieu contre des agents publics de
contrôle de l'environnement alors qu'ils doivent être rendus
responsables pour leur carence ou omission dans leurs fonctions de
contrôle, lorsqu'il y a de graves dangers ou des dommages pour
l'environnement ;
· Le Parquet militaire n'a pas une totale
indépendance pour engager la poursuite pénale des infractions
environnementales. Tout en gardant son indépendance, le Parquet doit
coopérer étroitement avec les administrations de l'environnement.
Une formation du Parquet spécialisée dans le domaine de
l'environnement est indispensable.
· nécessité de la création d'un
système de police - semblable à l'Interpol - chargée de
rechercher et rassembler les éléments de preuves des infractions
environnementales pour la Ministère Public des Etats ou pour les
Tribunaux nationaux.
Il sied à préciser qu'un projet de loi de mise
en oeuvre des mesures d'application tarde encore au parlement alors que, c'est
un instrument juridique indispensable pour accompagner la loi portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
SECTION II : LES POURSUITES
DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES
Si les deux choses sont liées, la réparation du
dommage étant l'objectif visé par le demandeur, le fait que le
dommage puisse être, en cette matière,
«extérieur» au demandeur oblige à distinguer.
Les demandeurs sont notamment la République
Démocratique du Congo et les organisations de protection de
l'environnement. Toutefois, il importe de s'interroger sur la
possibilité de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour
l'environnement de la Cour Internationale de Justice, aussi auprès de la
Cour Pénale Internationale et s'ils pourront ou ils ont une autre
possibilité comme l'arbitrage international au cas où les deux
solutions précitées n'aboutiraient pas.
§1. De la Possibilité
de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la
Cour Internationale de Justice.
La Chambre Spéciale pour l'environnement de la C.I.J
constituée en 1993 ne peut exercer ses attributions dans le cadre des
violations du droit international de l'environnement pendant les guerres en
République Démocratique du Congo que quand elle est saisie par
cet Etat. Curieusement, à ce jour, il n'existe pas une telle demande au
niveau de cette chambre.
Cependant, cet état de chose ne doit pas nous interdire
de voir comment l'action du demandeur pourra être recevable au niveau de
cette chambre. Mais avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le
règlement judiciaire de la Cour d'une manière
générale.
A. De règlement
judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ
Le règlement judiciaire de la Cour se manifeste
à travers ses décisions. Ces dernières se repartissent en
ordonnances et arrêts. Les ordonnances sont les actes de
procédures pris par la Cour à la demande d'une partie ou des
parties à un différend. Elles ont comme objectif l'indication des
mesures conservatoires en vue d'empêcher la situation de s'aggraver ou de
s'étendre. Les arrêts sont des décisions rendues par la
Cour au fond dans un différend. Contrairement aux ordonnances, ils sont
couverts par l'autorité de la chose jugée. C'est l'arrêt
qui réalise le règlement judiciaire de la Cour en fixant les
droits et obligations des parties . »118(*)Le règlement
judiciaire de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ face
aux violations du droit international de l'environnement implique la mise en
jeu de la responsabilité internationale du Rwanda, du Burundi et de
l'Ouganda. Ce règlement devrait ainsi s'analyser comme étant une
sanction infligée à ces trois pays. L'absence des requêtes
introductives d'instance au sein de la chambre témoigne combien la RDC
est loin d'obtenir ce règlement. Voyons tout de même la question
de la recevabilité de l'action.
B. De la recevabilité de
l'action par la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ
La Chambre Spéciale pour l'environnement applique le
statut de la Cour. Les dommages liés aux différends peuvent
résulter soit du comportement des personnes, soit au litige opposant
directement les Etats comme le cas sous examen.
Seulement dans le cadre du droit positif, lorsqu'on parle de
règlement des différends, il s'agit essentiellement des
différends inter-étatiques. L'Etat représente actuellement
le principal acteur des relations internationales. Il est le centre de
convergence et d'impulsion de la vie internationale à titre principal.
La question de la recevabilité doit alors s'analyser comme telle. Il n'y
a que l'Etat souverain qui peut saisir la Cour. La conséquence est que
la recevabilité de l'action des demandeurs pour violation du droit de
l'environnement en RDC ne pourra être opératoire que si la Chambre
Spéciale pour l'environnement de la CIJ est saisie par un Etat en
l'occurrence l'Etat Congolais.
Mais avant d'en arriver à cela, il sied de rappeler que
les mécanismes classiques opèrent une distinction fondamentale
reposant sur la différence qu'il y a lieu d'établir entre les
solutions aboutissant à des résultats facultatifs et à des
mécanismes aboutissant à des décisions obligatoires.
« En droit de l'environnement, tant qu'une convention
particulière sur le règlement des différends n'est pas
adoptée, les règles classiques restent valables.
C'est-à-dire solution diplomatique à caractère facultatif,
solution diplomatique avec système d'arbitrage ou système
juridictionnel judiciaire. »119(*)Comme tout litige, la RDC pourrait alors
suggérer de commencer d'abord par la procédure diplomatique comme
la plupart des conventions internationales en matière de l'environnement
le prévoient. Au cas où elle ne trouve pas satisfaction, on
pourra saisir l'organe judicaire dont la CIJ, qui représente le sommet
de juridiction dans le monde contemporain et dispose d'une chambre
Spéciale pour traiter les questions d'environnement. Cette chambre
représente une formation au sein de cette institution. «
Elle a vocation à régir les différends que les Etats en
litige ou les parties litigantes présentent à la Cour pour examen
et pour décision. Elle bénéficie de l'ensemble de la
jurisprudence de la CIJ en droit en général. Toutefois, du point
de vue du droit international de l'environnement les décisions ne sont
pas nombreuses à ce jour mais elles sont importantes.120(*) »
Ce qu'il convient de signaler, c'est le caractère
consensuel de la base de compétence de la Cour et sa soumission aux
règles statutaires. Il faut que l'Etat accepte de comparaître
devant la Cour. Le cas contraire l'action ne sera pas mis en mouvement.
Il nous apparaît opportun de s'interroger sur les bases
auxquelles la RDC pourra fonder la compétence de la Cour pour que son
action soit déclarée recevable. En effet, la Cour a la
plénitude de la compétence ratione materiae pour trancher toutes
les questions de droit international dont relève indubitablement le
droit international de l'environnement; l'intérêt
que présente pour les questions de l'environnement
l'article 94 de la Charte des Nations Unies, l'article 27 point 3 lettre b de
la Convention sur la diversité biologique de 1992 reconnaît la
soumission du différend à la Cour Internationale de Justice et
cela bien entendu après que les autres modes de règlement
prévus aient échoué.
Notons par ailleurs que la Chambre Spéciale pour
l'environnement n'est pas connue par les membres de la communauté
internationale et n'a enregistré aucun procès à ce jour.
Il restera alors dans les anales de l'histoire au cas où la RDC pourra
saisir cette Chambre pour violation de l'environnement comme elle a fait pour
la Cour Pénale Internationale avec le procès Thomas LUBANGA
où elle était le premier Etat à envoyer son citoyen et
celui est le premier condamné par la CPI. Le monde sait bien que c'est
la République Démocratique du Congo qui a permis à la CPI
de fonctionner à travers sa soixantième ratification de statut de
Rome. Il sera alors important pour la Chambre Spéciale pour
l'environnement de la CIJ d'être saisie pour ce cas afin de lui permettre
d'enregistrer au moins un procès.
Enfin, comme nous venons d'évoquer la question sur la
CPI: est-ce que la Cour Pénale Internationale pourra-t-elle exercer ses
attributions dans le cas présent?
§.2. Possibilité
devant la Cour Pénale Internationale face pour les dommages
environnementaux?
Les infractions dont la Cour est compétente sont
connues de tous et sont bien définies dans les statuts de Rome. En sus
notre sujet porte sur les violations du droit international de l'environnement
commis en RDC entre 1998 à 2012. Voilà pourquoi nous pouvons nous
permettre d'affirmer que la CPI ne peut se saisir que des violations
liées au droit international de l'environnement commises en RDC entre
2002 à 2012 parce qu'elles entrent non seulement dans ses
compétences exclusives mais aussi, elles sont compris dans le cadre
légal auquel la Cour exerce sa compétence temporis. Pour ce qui
est de compétence matérielle le statut de Rome prévoit que
sera poursuivi pour un crime de guerre que :« Le fait de diriger
intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes
civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu. »121(*). Concernant la
compétence personnelle, la Cour ne poursuit pas des organisations
criminelles ou des groupes armés mais plutôt le chef
hiérarchique selon l'article 28 de statut soit la personne reconnue de
chef de la responsabilité pénale individuelle selon l'article 25
qui stipule : « 3. Aux termes du présent Statut, une
personne est pénalement responsable et peut être punie pour un
crime relevant de la compétence de la Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable
;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel
crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce
crime ;
c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la
commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en
fournissant les moyens de cette commission ;
d) Elle contribue de toute autre manière à la
commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe
de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être
intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le
dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte
l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la
Cour »
Enfin, il convient de dire que toutes les
opportunités sont présentes et reste à l'Etat congolais et
les ONGs de demander une action devant la CPI.
Par ailleurs, nous espérons que le droit pénale
internationale évoluera afin d'intégrer les atteintes graves
portées à l'environnement dans son corpus juridiques dans la
mesure où l'environnement constitue pour l'humanité quelque chose
d'intérêt général et doit donc être
défendu, préservé et protégé afin de
permettre aux générations présentes et futures d'en tirer
profit. Mais, pour la RDC disons que les faits sont là car la
destruction d'un groupe ou la réalisation de crimes contre
l'humanité peut passer par des atteintes à l'environnement. Le
cas par exemples de l'utilisation des armes bactériologiques polluant
l'atmosphère avec ses conséquences néfastes, de
l'empoisonnement de l'eau provoquant une épidémie
meurtrière, destruction des milieux comme forêts pour certaines
ethnies.
§.3. Possibilité de
recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine
Nous constatons que les conventions internationales en
matière environnementale ont prévu plusieurs modes de
règlement de différends en cas de non respect de l'une de ses
dispositions donnant ainsi aux victimes les possibilités et chances de
faire aboutir leur action. C'est notamment le cas de l'arbitrage et de la
possibilité de la saisine de la Cour de l'Union africaine. Nous dirons
même que la plupart des conventions ont la préférence
à l'arbitrage et cela après que la médiation et la
conciliation aient échoué.
Ainsi par exemple, la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
en son article 28 disposent que: « Tout différend survenant entre
deux ou plusieurs Parties à la Convention relativement à
l'interprétation ou à l'application des dispositions de ladite
Convention fera l'objet de négociation entre les parties
concernées. Si ce différend ne peut être
réglé de la façon prévue au paragraphe 1
ci-dessous, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le
différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour
Permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le
différend seront liées par la décision arbitrale fin de
citation. La Convention consacre pour ce faire l'arbitrage comme second mode de
règlement de différend après la négociation. Il est
alors possible de recourir à l'arbitrage de la Cour Permanente de la
Haye pour violation des règles liées au droit de l'environnement
pendant la guerre en RDC.
La Convention sur la diversité biologique quant
à elle prévoit en son article 27 les mécanismes de
règlement des différends. Cet article déclare ce qui suit:
«1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les
Parties concernées recherchent une solution par voie de
négociation; 2. si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir
à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement
faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce
Partie; 3. au moment de ratifier, d'accepter, ou d'approuver la Convention ou
d'y adhérer et à tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation régionale d'intégration économique peut
déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans
le cas d'un différend qui n'a pas été réglé
conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de
considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de
règlement ci-après, ou les deux: a) l'arbitrage,
conformément à la procédure énoncée à
la première partie de l'annexe II; b) la soumission du différend
à la Cour Internationale de Justice etc.
Nous voyons encore ici la préférence des parties
à la solution arbitrale chaque fois qu'une convention est violée
et la saisine de la Cour Internationale de Justice que lorsque toutes les voies
ont échoué. Il y avait et il y a toujours espoir de recourir
à l'arbitrage pour évaluer les dégâts
environnementaux causés par les conflits armés en RDC.
Cependant, il sied de signaler que la Convention de l'UNESCO
sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n'avait pas
prévu les mécanismes de règlement des différends.
Nous déplorons cela car cette convention est d'importance mondiale et ne
pouvait pas ne pas prévoir les modes de règlement des
différends chaque fois qu'un site du patrimoine est menacé.
L'action des demandeurs pour violations de droit de l'environnement pendant les
guerres en RDC peut aussi être reçue au niveau de la Cour de
l'Union africaine. En effet, La Convention africaine pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles signée à Maputo en 2003
prévoit les mécanismes de règlement des différends
en son article 30 et dispose que: « 1. Tout différend entre les
Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de
la présente Convention est réglé à l'amiable par
voie d'accord direct entre les parties au différend ou grâce aux
bons offices d'une tierce partie. Si les Parties concernées ne
parviennent pas à régler le différend, chacune d'entre
elle peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la
Cour de l'Union africaine. 2. Les décisions de la Cour de justice sont
définitives et sans appel.»
Par ailleurs, nous remarquons que la Convention africaine pour
la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968
n'avait pas prévu la saisine d'un différend auprès d'une
cour de justice, simplement à l'adoption de cette convention en Alger en
1968, l'OUA semble-t-il ne disposait pas d'un organe judiciaire. Mais Quand
même il était prévu à son article 28 les
mécanismes de règlement des différends. Et disposait que:
« Tout différend entre les parties relatif à
l'interprétation ou à l'application de la présente
Convention qui ne peut être réglé par voie de
négociation sera, à la requête de l'une des parties, soumis
à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'arbitrage de
l'Organisation de l'Unité Africaine».
La République Démocratique du Congo dispose
à cet effet des plusieurs possibilités pour se faire
dédommager comme nous venons de le montrer dans les pages
précédentes. Ce que nous constatons qu'à ce jour aucun de
mode de règlement précité n'a été
emprunté par la RDC pour valoir ses droits et parvenir une
réparation juste.
§4 . La
réparation des dommages.
La réparation des dommages due à la guerre en
RDC paraît digne d'intérêt parce qu'elle en appelle à
la remise en état effective et de son coût auquel il faut ajouter
celui des mesures de sauvegarde, ou à titre subsidiaire des frais
engagés pour obtenir une compensation en nature. Mais avant d'arriver
aux solutions précitées, il importe de s'interroger sur les
critères d'appréciation.
Après ce large tour d'horizon, que faut il
conclure ?
CONCLUSION
Nous nous trouvons au terme de notre travail où nous
sommes amenés à retracer les grandes lignes du
développement et d'y donner notre point de vue. Tout au long de ces
pages nous avons traité de la problématique de l'application
de droit international de l'environnement dans la lutte contre les violations
de droit de l'environnement par les groupes armés à l'est de la
RDC. Nous avons jugé bon d'aborder ce sujet en deux parties.
La première partie a été
consacrée aux conflits armés et les conséquences sur
l'environnement .En effet, le contexte général de la RDC
marqué par une succession de conflits armés a sérieusement
causé des conséquences humanitaires et environnementales. Aussi
les rebellions menées depuis 1998, de CNDP et par le M23 se sont-elles
succédées chacune avec un objectif particulier.
La rébellion du 02 août 1998 dirigée par
le Rassemblement congolais pour la Démocratie avait pour justification
le mécontentement exprimé par la population tutsi qui se sentait
en insécurité du fait de l'ordre de retrait de troupes
Ougando-Burundo-Rwandaises donné par le Président Laurent Kabila,
pourtant la raison latente n'était qu'une agression
rwando-ougando-burundaise visant le pillage des richesses de la RDC. La
deuxième quant à elle éclata suite au fait que les soldats
tutsi se sentaient de nouveau dans l'insécurité dans la nouvelle
armée et poursuivait l'objectif de défendre les populations tutsi
que le général Laurent Kunda disait être en danger. La
troisième quant à elle revendique l'application des accords du
23mars 2009 entre le CNDP et l'Etat congolais d'où l'appellation
même du M23 .En dehors de la chronologie de rebellions, les
affrontements récurrents entre les groupes armés (de mai mai, de
FDLR,LRA), opérant sur le sol congolais et les FARDCs conjointement avec
la Monusco.
Après avoir analysé les raisons et les enjeux
de la succession de conflits, nous avons compris que les acteurs
extérieurs agissent inter dépendamment avec certains qui sont au
niveau national, ce qui fait que chercher à s'attaquer uniquement aux
acteurs visibles ou directs, c'est vouloir changer l'image dans le miroir car
il est bon de s'attaquer d'avantage aux causes qu'aux effets. Parmi les neuf
acteurs, on a identifié : le Congrès National pour la
Défense du Peuple (CNDP, Mouvement 23, Les Forces d'autodéfense
surnommées « MAI MAI », Armée de
Resistance de Seigneur(LRA), Les forces armées de RDC (FARDCS), les
pays voisins (le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi), les Forces de la MONUSCO et
les Firmes Multinationales.
Au cours de ces conflits successifs, plusieurs
conséquences sur l'environnement ont été
épinglées dont les atteintes graves portées dans parcs
nationaux et aires protégés à l'instar du parc national de
Virunga, le parc national de Garamba et le parc national de Maïko ont
causé des Conséquences sur l'environnement
notamment primo, la Destruction de l'habitat et perte des animaux qui
sont parmi les effets les plus répandus et les plus graves des conflits
armés sur l'environnement qui se produisent pour des raisons
stratégiques, commerciales ou de subsistance. À titre d'exemple,
la végétation peut être coupée, brûlée
ou défoliée pour accroître la mobilité et la
visibilité des troupes, la survie lorsque des personnes
déplacées sont réinstallées
provisoirement .Secundo, les Pollutions affectent l'air et surtout les
cours d'eau où plusieurs sont affectées après la
décomposition des cadavres jetés dans les rivières et par
l'exploitation artisanale et illicite des mines sans aucune étude
d'impact d'environnement et social .Tercio, la Surexploitation de ressources
naturelles provoquant directement la dégradation des ressources
naturelles et la dégradation de l'environnement ,l'exemple de
l'exploitation abondante des forêts et de faune dans les APs se
répercute sur l'épuisement de la biodiversité et des
ressources naturelles de base et impose la population à vivre dans la
pauvreté. Signalons la menace réelle des certaines espèces
à disparaitre comme le cas de rhinocéros blanc, des gorilles de
montagnes et des okapis.
La seconde partie s'est évertuée à
traiter de l'application des instruments juridiques internationaux pour la
protection de l'environnement en RDC. Nous avons relevé au cours de
cette seconde partie qu'il y a une nécessité de renforcer
l'application des instruments juridiques internationaux pour la protection de
l'environnement d'où le survol des sources de droit international de
l'environnement a été évoqué. De plus, de la
réception des instruments juridiques internationaux en vigueur au niveau
national nous avons reconnu que conformément à l'article 215 de
la Constitution de la RDC, il existe une autorité supérieure des
conventions internationales à celle des lois nationales dès sa
publication dans l'ordre juridique interne. Maintenant, si cela est ainsi
qu'est ce qui bloque son application effective ?
Les difficultés de mise en application de droit
international nous l'avons abordé en deux contextes dont l'un
général et l'autre spécifique. Le premier a relevé
que l'application de droit international de d'environnement en période
de conflits armés explore les déficiences structurelles et le
manque de clarté du cadre juridique international en vigueur que sont le
droit international humanitaire (DIH) et le droit international de
l'environnement (DIE) visant à limiter les effets des conflits
armés sur l'environnement. Quant au second, nous avons retenu primo,
l'égoïsme caractérisé par la volonté de
s'enrichir en détruisant l'environnement sans compte à
l'intérêt collectif et aux générations
futures ; et secundo, par l'irresponsabilité morale où
plusieurs cas nous avons démontré que l'ignorance dominée
plusieurs infracteurs sans qu'ils aient de la culpabilité. En outre, le
déficit organisationnel causé par la fuite de combat des agents
de l'Etat, l'inefficacité de services compétents, l'absence de
loi sur des mesures de mise en application de traité de DIE, enfin la
légèreté avec laquelle est abordée la question
relative à l'environnement si elle est conjointe avec la question
humanitaire.
Nous nous sommes efforcés de relever des
possibilités de poursuites des auteurs en violation de DIE au niveau
national en épinglant le cadre juridique tout en reconnaissant que le
travail est encore à faire. Concernant les poursuites devant les
juridictions internationales, nous avons parlé primo, de la
possibilité devant la Chambre spéciale de la Cour International
de la Justice où nous avons expliqué que cela est possible mais
avant d'y arriver, il convient d'abord d'envisager le règlement
judiciaire de la Cour d'une manière générale.
Secundo, de la possibilité devant la CPI en se
référant de l'article 8 de statut de Rome et à la
compétence temporelle allant de 2002 à 2012. Tertio, nous avons
abordé aussi sur la possibilité de recourir à l'arbitrage
international et la Cour de l'union africaine.
« D'importants efforts visant à
protéger l'environnement en temps de conflit armé ont
commencé à être déployés dans les
années 1970, principalement en réaction à certains
événements survenus pendant la guerre du Viet Nam. En 1990-1991,
les marées noires et les incendies de puits de pétrole
provoqués délibérément pendant la deuxième
guerre du Golfe ont suscité un regain d'attention au niveau
international. Le cadre normatif qui s'est développé au fil des
dernières décennies contient néanmoins de nombreuses
lacunes et ambiguïtés »122(*)
Or, La lutte contre les violations de droit de
l'environnement par les groupes armés et dans La période de
guerre avance la problématique de DIE face aux dommages environnementaux
découlant des conflits armés. Car, la cohorte des conventions
internationales en droit de l'environnement donnent davantage des solutions
liées aux dommages environnementaux dus à l'industrialisation et
ne posent pas clairement une solution efficace caractérisant les pays
du sud, c'est-à-dire les conflits armés et la pauvreté.
Qu'à cela ne tienne, nous recommandons à l'Etat congolais de
faciliter rapidement la proposition de loi de mise en oeuvre de statut de Rome
et le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de
la Cour spécialisée de la répression des crimes de
génocide, crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cette
Juridiction aura une compétence temporaire allant de 1990 à nos
jours. Il est indéniable que la succession de conflits armés en
RDC ont causé des conséquences graves sur l'humanité
à travers la destruction de l'environnement. Le droit
international de l'environnement a été violé et doit
être interpelé. Les responsables doivent répondre de leurs
actes .Car, selon le principe de droit international, « la
violation d'une règle juridique internationale entraine la
responsabilité du sujet du droit international à qui cette
violation est imputable »123(*)
Enfin, il sied à souligner qu'en s'empreignant des
raisons économiques des conflits armés à l'est de la RDC
et des crimes internationaux qui les accompagnent, on peut parler de deux vases
communicants où l'un contient des conséquences environnementales
et l'autre les intérêts économiques. Alors, plus on veut
augmenter les chiffres d'affaires, on augmenter aussi des drames
environnementaux. Or, l'environnement est un patrimoine de l'humanité
que tout habitant vivant sur la planète terre est appelé à
protéger .Face à cette catastrophe qui nous guette, pourquoi
ne pourrons pas faire appel à la solidarité de la
communauté internationale pour sauver notre patrimoine commun que
nous sommes obligés de préserver pour les
générations futures?
BIBLIOGRAPHIE
I.LES OUVRAGES
A.KISS et J.P.BERIER, Droit
international de l'environnement, Paris, Pedone,(3è
édition),2004,p.427
B.KIYUNZA et K. SHOMBA,;
Initiation aux méthodes de travail scientifique en
sciences sociales, Kinshasa, PUZ,1996 ;p42
J.M. LAVIELLE, Droit International de
l'environnement, Paris, 2èm éd., 2004, p.65.
M. GRAWITZ, Méthodes des
sciences, Paris, Dalloz, 1974, pp. 331 -333
M. DUBISSON, La Cour Internationale de
Justice, Paris, LGDJ, 1964, p.100.
O. LANOTTE, Guerres sans
frontières en République démocratique du Congo,
Bruxelles, GRIP Complexe,2003, pp. 67-95
P.BARACYETSE, L'enjeu géopolitique
des sociétés minières internationales en
RDC,1999,Buzet, Belgique
P.RONGERE, Méthodes des
sciences, Paris, Dalloz, 1971, p.20
S. MALJEAN-DUBOIS, la mise en oeuvre du
droit international de l'environnement, Centre
d'études et de recherches internationales et communautaires,
Aix-en-Provence. Téléphone : 01 53 70 22 35 - iddri@iddri.org
www.iddri.org2003 France
II. ARTICLES(en support papier et
électronique)
AL - HAMNDOU DORSOUMA and
MICHEL-ANDRE BOUCHARD, « Conflits armés et
Environnement : Cadre, modalités, méthodes et rôle de
l'Évaluation Environnementale », Développement
durable et territoires [Online], Dossier 8 : Méthodologies et
pratiques territoriales de l'évaluation en matière de
développement durable, Online since 09 November 2010, connection on 28
June 2012. URL :
http://developpementdurable.revues.org/3365(Consulté
le 10 mai 2012)
CICR, Opinion paper sur la notion de
CI.pdf,mars 2008
C . MBELO ,temps de chien en
RDC, in Politique Voir le site
http://www.grandslacs.net/doc/3862.(Consulté le 02/08/2012)
D.FAILLY., Coltan :
pour comprendre in l'annuaire des Grands lacs.
Paris : Harmattan, 2001.p.3à 27
E.DEBELLEX, « Du sang sur
les portables ».Terra economica .Septembre 2006.24.p.6-8
J.KALPERS.,Volcans
assiégés :impact d'une décennie de conflits
armés dans le massif des
Virunga,www.BSPoline.org/publications(Consulté le 05/06/2012)
J. KIPPENBERG, et alii, Les
soldats violent, les commandants ferment les yeux. Violences sexuelles et
réforme militaire en République démocratique du
Congo, New York : Human M.BOTHE, C.BRUCH, J.DIAMON et
D.JENNEN, Droit international protégeant l'environnement en
période de conflit armé : lacunes et
opportunité Voir le site :
www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté
le 21/05/2012)
United states Institute for
Peace,»Special Report: AIDS and Violent Conflict in
Africa» October 2001.p.5
R . POURTIER,
« Le Kivu dans la guerre : acteurs et
enjeux », Echo Géo [En ligne], Sur le vif 2009,
mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 19 avril 2012. URL :
http://echogeo.revues.org/10793
III. RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
A MALONGA MULENDA, De la
responsabilité international des acteurs impliqués dans les
guerres de 1996et 1998 en RDC au regard des violations liées au droit
international de l'environnement,. inédit, mémoire
master2DICE, Limoges-2007,p.5
Banque Mondiale,
www.google.cd.publidata(Consulté le 27 Juillet 2012
Dépêche n°
001/focdp/2012, les fdlr réalisent le génocide continue dans
le territoire de Shabunda au sud- Kivu en RDC ,Bukavu ,2011
DSRP .état des lieux
de l'environnement en RDC, op cit,p1.
Ecole de guerre économique, la
guerre du coltan en RDC, mémoire de préparation en
stratégie d'Intelligence Economique,2008
Etude de AIDE ET ACTION POUR LA PAIX sur
la commercialisation de braise dans les territoires de Masisi, de Rutshuru
et dans la ville de Goma,2007p.7
G.CANOTILHO, Droit de l'environnement
brésilien, cours de Master2 DICE,2011-2012,Limoges. p3
GRAMA Groupe de Recherche sur les activités
minières en Afrique, la route commerciale du coltan
congolais :une enquête.
Montréal :Université du Quebec,mai2003
Handicap International dans son programme de
déminage/dépollution dans la province de
Kisangani,2001-2003,p.2
Histoire des Nations-Unies, ONU correction.
p.3,Voir le site http://www.un.org/french/
Human Rights
Watch(HRW), « Vous êtes
punis » : Attaques contre les civils dans l'est du
Congo,13 décembre2009
J.C. BALOLEBWAMI AMULI , Etude
sur le charbon de bois en RDC et à Gisenyi au Rwanda,
Goma,2008
Jeuneafrique.com :
RDC: cinq espèces animales menacées
d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site
d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site
http :www.jeuneafrique.com/article/
J.SEMEKI NGABSZEKE., Impact des conflits
armés dans la gestion des ressources naturelles en RDC,in Atelier
sur l'évaluation et les conflits armés,Kinshasa,2007,pp2-3
Les dommages sur l'environnement dus aux
guerres modernes sont sans précédents, in
http://www.notre-plantete.info/actalités/actualités/act-1531;php
NATIONS UNIES, nouveau rapport
du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources
naturelles et autres richesses de la RDC. New
York ;23 octobre 2003
N . SHUKU ONEMBA, les impacts et
les enjeux environnementaux des conflits armés en RDC in
Atelier Association Nationale pour l'Evaluation
Environnementale de la RDC, ANEE,2004
PNUD, Étude sur la
prolifération des armes légères en RDC
(avril 2010) GRIP - BICC ,p17
Rapport de l'atelier d'experts,
Dynamiques des conflits et de la migration forcée en
RDC,30 novembre - 1er décembre 2010, Oxford
RAPPORT ICCN, Stratégie Nationale
de la Conservation, décembre 2004.p.
Rights Watch, 2009 ; Human Rights 2009
Report : Democratic Republic of the Congo, Washington :
U.S. Department of State, 11 mars 2009
R. RANJEVA, le règlement des
différends, cours vidéo sur la responsabilité
internationale face aux dommages environnementaux, Master2 DICE,
Université de Limoges, inédit, 2007-2008.
IV. LES CONVENTIONS, LES LOIS ET LES TEXTES
LEGAUX
Déclaration de Rio sur l'environnement
et le Développement principes de Gestion des forêts, principe
n°11
Charte Mondiale de la Nature in Recueil des
textes juridiques en matière environnementale en RDC 2è
édition, p.519
Convention des Nations Unies sur la
Diversité Biologique in Avocats Verts, Recueil des textes juridiques en
matière environnementale en RDC,2è édition .
pp.524-525
Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, in
Avocats verts ,Recueil des textes juridiques en matière environnementale
en RDC,2è édition, pp.510
Convention ENMOD
Convention africaine sur la Conservation de
la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968, dite Convention
d'Alger
Convention de Genève de
1949(Protocole additionnel I)
Constitution de la RDC de 2006
Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, Journal Officiel, Numéro spécial 16
Juillet 2011,p5
Loi n°11/009 du 09 Juillet 2011 portant
principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, J.O.
Numéro
Spécial-16Juillet2011 .p.5. « exposé de
motif»
Statut de Rome de la CPI
V. AUTRES SOURCES WEB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27interdiction_d%27utiliser_des_techniques_de_modification_de_l%27environnement_%C3%A0_des_fins_militaires_ou_toutes_autres_fins_hostiles
http://developpementdurable.revues.org/3365
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2012/06/un-human-rights-chief-fears-more-rapes-killings-in-congo-by-m23/
(consulté le 23/07/2012)
http://wilkipedia/wiki/,armée_de_resistance_du_seigneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/armée_de_resistance_du_seigneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/forces_armées_de_république_démocraique_du_congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Garamba
http://enviedailleurs.forumpro.fr/t8003-terreur-a-epulu-les-gardes
VI. SOURCES MEDIATIQUES
Coltan and blood (documentaire)
Conférence de presse de la Monusco du
27Juillet 2011.Kinshasa
Communique de Presse conjoint OMS et UNICEF
du 13juillet 2012 Kinshasa ; RDC
Le Sang dans nos portales (documentaire
vidéo)
Radio Okapi, conférence de presse
monusco du mercredi 11-O7-2012
ANNEXES
ANNEXE I :
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ENVIRONNEMENTALES RATIFIEES PAR LA
RDC
1. Convention phytosanitaire pour
l'Afrique au Sud du SAHARA.
2. Accord de coopération concernant la quarantaine et
la protection des plantes contre les parasites et les maladies
3. Convention Africaine sur la Conservation de la nature et
des ressources naturelles.
4. Convention relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine ou
(Ramsar)
5. Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel
6. Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonne)
7. Convention de Vienne sur la protection de la couche
d'ozone; protocole de Londres et de Montréal
8. Convention de Nations-Unies sur les changements
climatiques
9. Convention sur la Diversité Biologique
10. Convention sur les transports transfrontaliers des
déchets dangereux et leur gestion (Convention de Bamako)
11. Accord international sur les bois tropicaux
12. Convention des Nations Unies sur les droits de la mer
13. Convention sur le transport transfrontalier des
déchets dangereux et leur traitement (convention de Bâle)
14. Convention relative à la conservation de la faune
et de la flore à l'état naturel
15. Convention phytosanitaire pour l'Afrique
16. Convention internationale pour la protection des
végétaux
17. Convention sur l'interdiction de la mise au point de la
fabrication et du stockage des Armes
18. Bactériologiques (Biologiques) et à Toxines
et sur leur destruction
19. Convention concernant la protection de fabrication du
patrimoine mondiale culturel et naturel Convention sur la prévention de
la pollution de la mer résultat de l'inversion de déchets
20. Convention sur la conservation des espèces sauvage
de flore et de faune menacées d'extinction ou (CITES).
21. Convention sur la convention des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
22. Convention sur le criquet migrateur africain, Kano, Mali,
23 mai 1962
23. Traité interdisant les essais d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra
atmosphérique et sous l'eau, Moscou, URSS, 5 Août 1963
24. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles, Genève, Suisse, 18 mai 1977
25. Traité instituant la communauté
économique africaine, Abuja, 3 juin 1991
26. Convention sur la gestion du Lac Tanganyika, Dar-es-Salam,
12 juin 2003
27. Protocole de Kyoto 11 décembre 1997
28. Charte de la Terre
Dessus de page
ANNEXE II : EXTRAIT DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE
INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES
D'EXTINCTION
Signée à Washington, le 3 mars 1973
Amendée à Bonn, le 22 juin 1979
Les Etats contractants
Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de
par leur beauté et leur variété un
élément irremplaçable des systèmes naturels, qui
doit être protégé par les générations
présentes et futures;
Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue
esthétique, scientifique, culturel, récréatif et
économique, de la faune et de la flore sauvages;
Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient
être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore
sauvages;
Reconnaissant en outre que la coopération
internationale est essentielle à la protection de certaines
espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation
par suite du commerce international;
Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence
à cet effet;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 : Définitions
Aux fins de la présente Convention et, sauf si le
contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:
a) Espèces: toute espèce, sous-espèce, ou
une de leurs populations géographiquement isolée;
b) Spécimen:
i) tout animal où toute
plante, vivants ou morts;
Ii) dans le cas d'un animal: pour les
espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit
obtenu à partir
de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
à l'Annexe III, toute
partie ou tout produit
obtenu à partie de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont
mentionnés à
ladite Annexe;
Iii) dans le cas d'une plante: pour
les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit
obtenu à partir
de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites
aux Annexes II et III, toute
partie ou tout produit
obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont
mentionnés
auxdites Annexes;
c) Commerce: l'exportation, la réexportation,
l'importation et l'introduction en provenance de la mer;
d) Réexportation: l'exportation de tout spécimen
précédemment importé;
e) Introduction en provenance de la mer: le transport, dans un
Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans
l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;
f) Autorité scientifique: une autorité
scientifique nationale désignée conformément à
l'Article IX;
g) Organe de gestion: une autorité administrative
nationale désignée conformément à l'Article IX;
h) Partie: un Etat à l'égard duquel la
présente Convention est entrée en vigueur.
Article 2 : Principes fondamentaux
1. L'Annexe I comprend toutes les espèces
menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées
par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit
être soumis à une réglementation particulièrement
stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit
être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
2. L'Annexe II comprend:
toutes les espèces qui, bien que n'étant pas
nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le
devenir si le commerce des spécimens de ces espèces
n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour
but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;
certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une
réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce
des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en
application de l'alinéa a).
3. L'Annexe III comprend toutes les
espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa
compétence, à une réglementation ayant pour but
d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la
coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.
4. Les Parties ne permettent le
commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et
III qu'en conformité avec les dispositions de la présente
Convention.
Article 3 : Réglementation du commerce des
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I
1.
Tout
commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I
doit être conforme aux dispositions
du présent Article.
2. L'exportation
d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I
nécessite la délivrance et la présentation
préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux
conditions suivantes:
une
autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que
cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce
intéressée;
un organe de
gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas
été obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;
ANNEXE III : CONVENTION DE 1976 SUR L'INTERDICTION
D'UTILISER DES
TECHNIQUES DE MODIFICATION DE
L'ENVIRONNEMENT
La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles (Convention ENMOD) est un instrument de droit international du
désarmement s'attachant spécifiquement à la protection de
l'environnement en situation d'hostilités. Elle interdit l'utilisation
hostile de l'environnement à titre de moyen de combat. Ses dispositions
trouvent un complément essentiel dans celles du Protocole additionnel I
de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 qui interdisent directement de
porter atteinte à l'environnement en situation de conflit armé.
D'autres règles et principes du droit international humanitaire assurent
également à l'environnement, sans toutefois le mentionner
expressément, une protection en cas de conflit armé. Il s'agit
notamment des principes généraux coutumiers relatifs à la
conduite des hostilités, tel le principe de distinction qui limite les
attaques aux objectifs militaires et le principe de proportionnalité qui
interdit l'emploi de moyens et méthodes de combat provoquant des
dommages excessifs. Négociée dans le cadre de la
Conférence du Comité du désarmement, puis adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10
décembre 1976, la Convention ENMOD a été ouverte à
la signature à Genève le 18 mai 1977 et est entrée en
vigueur le 5 octobre 1978.
Convention ENMOD : interdire l'utilisation de
l'environnement comme moyen de combat
La Convention ENMOD vise précisément à
prévenir l'utilisation de l'environnement comme instrument de guerre,
soit en interdisant la manipulation délibérée de processus
naturels pouvant conduire à des phénomènes tels que des
ouragans, des raz-de-marée ou des modifications des conditions
climatiques.
Interdictions
D'une part, un Etat partie à la Convention
«s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou autres
fins hostiles des techniques de modification de l'environnement ayant des
effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des
destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat
partie» (art. 1, par. 1).
D'autre part, chaque Etat partie s'engage à ne pas
«aider, encourager ou inciter» tout Etat, groupe d'Etats ou
organisation internationale à mener de telles activités (art. 1,
par.
2).
Les techniques de modification de l'environnement
visées sont celles «ayant pour objet de
modifier - grâce à une manipulation
délibérée de processus naturels - la
dynamique, la composition ou la structure de la
Terre» (art. 2).
Pour être interdite aux termes de l'article 1,
l'utilisation des techniques prohibées doit donc cumulativement :
_ l'être à des fins hostiles;
_ causer la destruction, des dommages ou des préjudices
à un autre Etat partie; et
_ entraîner des effets qui sont
étendus, durables ou graves.
Bien que non intégrés dans la Convention ENMOD,
les Accords interprétatifs élaborés avec celle-ci
précisent la portée des conditions d'étendue, de
durée ou de gravité prévues par l'article 1, chacune
d'elles étant suffisante pour entraîner l'application de la
Convention. Ainsi, des effets :
_ étendus couvrent une superficie de
plusieurs centaines de kilomètres carrés;
_ durables se prolongent sur une
période de plusieurs mois ou environ une saison;
_ g r a v e s provoquent une perturbation ou
un dommage sérieux ou marqué pour la vie humaine, les ressources
naturelles et économiques ou d'autres richesses.
Les Accords interprétatifs illustrent, en outre, par
une série d'exemples non exhaustifs les phénomènes pouvant
résulter de l'utilisation de techniques de modification de
l'environnement : tremblements de terre, tsunamis, bouleversement de
l'équilibre écologique d'une région, modifications des
conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones et
tornades), modification des conditions climatiques, des courants
océaniques, de l'état de la couche d'ozone ou de
l'ionosphère.
Protocole additionnel I : interdire les moyens et
méthodes de combat portant atteinte à l'environnement
Le Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de
Genève de 1949
(PA I), applicable en cas de conflit armé
international, contient deux dispositions spécifiques à la
protection de l'environnement. Ces dispositions présentent des liens
évidents de complémentarité avec la Convention ENMOD en
cas de conflit armé : alors que cette dernière interdit la
manipulation délibérée de l'environnement comme moyen de
combat, le PA I interdit d'attaquer l'environnement naturel en tant que tel,
peu importe l'arme utilisée.
ANNEXE IV : PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT
1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX
(PROTOCOLE I), 8 JUIN 1977
CHAPITRE III BIENS DE CARACTERE CIVIL
Article 52 -
Protection générale des biens de caractère civil
1.
Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques
ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens
qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.
2. Les
attaques doivent être strictement limitées aux objectifs
militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont
limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur
destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à
l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la
neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire
précis.
3. En cas de doute, un bien qui est normalement
affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un
autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas
être utilisé en
vue d'apporter une contribution effective
à l'action militaire.
Article 53 - Protection des biens
culturels et des lieux de culte
Sans préjudice des dispositions
de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux
pertinents, il est interdit :
a) de commettre tout acte
d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres
d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel
des peuples ;
b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort
militaire ;
c) de faire de ces biens l'objet de
représailles.
Article 54 - Protection des biens
indispensables à la survie de la population civile
1. Il est
interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de
guerre.
2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou
de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la
population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones
agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les
installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en
vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population
civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce
soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou
pour toute autre raison.
3. Les interdictions prévues au
paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés
sont utilisés par une Partie adverse :
a) pour la subsistance des
seuls membres de ses forces armées ;
b) à d'autres fins
que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire,
à condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des
actions dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population
civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la
famine ou forcée de se déplacer.
4. Ces biens ne devront
pas être l'objet de représailles.
5. Compte tenu des
exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son
territoire national contre l'invasion, des dérogations aux interdictions
prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur
un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des
nécessités militaires impérieuses
l'exigent.
Article 55 - Protection de l'environnement
naturel
1. La guerre sera conduite en veillant à protéger
l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves.
Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens
de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de
tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la
santé ou la survie de la population.
2. Les attaques contre
l'environnement naturel à titre de représailles sont
interdites.
Article 56 - Protection des ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses
1. Les ouvrages d'art ou installations
contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et
les centrales nucléaires de production d'énergie
électrique ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils
constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent
provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer
des pertes sévères dans la population civile. Les autres
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou
à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque
de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses
et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la
population civile.
2. La protection spéciale contre les attaques
prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :
a) pour les barrages ou
les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leur
fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct
d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen
pratique de faire cesser cet appui ;
b) pour les centrales
nucléaires de production d'énergie électrique, que si
elles fournissent du courant électrique pour l'appui régulier,
important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques
sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;
c) pour les
autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou
à proximité, que s'ils sont utilisés pour l'appui
régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de
telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet
appui.
3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes
civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui
leur sont conférées par le droit international, y compris des
mesures de précaution prévues par l'article 57. Si la protection
cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un des objectifs
militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les
précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour
éviter que les forces dangereuses soient
libérées.
4. Il est interdit de faire de l'un des
ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifs militaires
mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.
5. Les
Parties au conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires
à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au
paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à
seule fin de défendre les ouvrages ou installations
protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent
pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition
qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour
les actions défensives nécessaires afin de répondre aux
attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que
leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à
repousser une action ennemie contre le ouvrages ou installations
protégés.
6. Les Hautes Parties contractantes et les
Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre
elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des
biens contenant des forces dangereuses.
7. Pour faciliter
l'identification des biens protégés par le présent
article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d'un signe
spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif
disposés sur un même axe comme il est spécifié
à l'article 16 de l'Annexe I au présent Protocole [à
l'article 17 de l'Annexe révisée]. L'absence d'une telle
signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations
découlant du présent article.
ANNEXE V : BRACONNAGE DES
ESPECES TOTALEMENT PROTEGEES OU MENACEES D'EXTINCTION
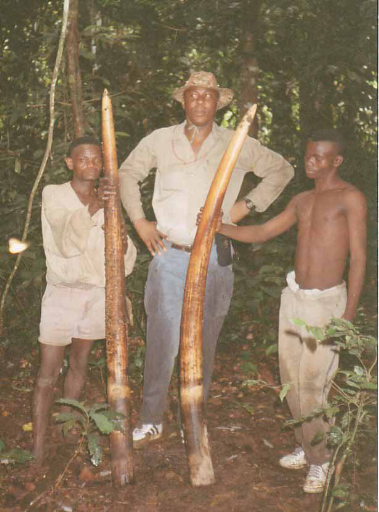

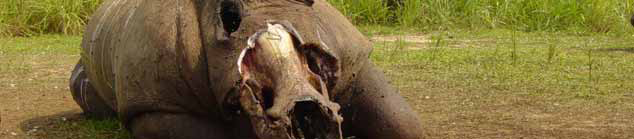

Rhinocéros abattu et ses ivoires
arrachées

Okapi tué au Reserve d'Epulu par la
bande armée de Paul SADALA alias Morgan

Commerce de la viande de chasse d'éléphant de
PNG
ANNEXE VI : DEUX PERSONNES TUEES AVEC 13 OKAPIS PAR
MORGAN SADALA
 Figure : Personnes brulées vivantes Mme ANASTASIE
(à gauche) et Mr MOPERO (à droite). Photo du 25 juin 2012.
Source FOCDP
Figure : Personnes brulées vivantes Mme ANASTASIE
(à gauche) et Mr MOPERO (à droite). Photo du 25 juin 2012.
Source FOCDP
ANNEXE VII : COMMERCIALISATION DE CHARBON VENANT DE LA
FORET DE PNVi

TABLE DES MATIERES
2
3
REMERCIEMENTS
4
ABREVIATIONS ET SIGLES
5
7
SOMMAIRE
8
INTRODUCTION 9
PROBLEMATIQUE
10
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL
10
III.CHOIX ET INTERET DU
SUJET 11
IV. METHODES ET TECHNIQUES
11
A. METHODES 11
B.TECHNIQUES 11
V. DELIMITATION DU
TRAVAIL 12
VII. DIFFICULTES
RENCONTREES 12
PREMIÈRE
PARTIE : LES CONFLITS ARMES ET SES CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES EN RDC
13
CHAPITRE PREMIER : LES
CONFLITS ARMES EN RDC 13
SECTION I : RAISONS ET
EVOLUTIONS DES CONFLITS ARMES A L'EST DE LA RDC 13
§1.Raisons et Enjeux du
Conflit Armes En RDC 13
§2. Evolution des Conflits
Armes en RDC (1997-2012) 13
SECTION II : LES PRINCIPAUX
ACTEURS DES CONFLITS ARMES EN RDC 14
§1. Le Congres National pour
la Défense du Peuple,CNDP 14
§2. La rébellion du
Mouvement 23,M23 14
§4. Les Milices Mayi Mayi
14
§5. Armée de
Resistance du Seigneur(LRA) 15
§6. Les Forces Armées
de La République Démocratique du Congo, FARDC 15
§7.Mission des Nations Unies
pour la Stabilisation au Congo MONUC/MONUSCO 15
§8.Les Pays Voisins( LE
RWANDA,L'OUGANDA ET LE BURUNDI) 15
§9.Les Firmes Multinationales
16
CHAPITRE
DEUXIÈME : LES IMPACTS ET LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT
16
SECTION I : ATTEINTES GRAVES
SUR LES PARCS NATIONAUX ET AIRES PROTEGEES 16
§1. Parc National de la
GARAMBA et réserves avoisinantes. 17
§2. Parc National de VIRUNGA
et domaine de chasse de RUTSHURU. 17
§3. Parc National de MAIKO et
domaine de chasse de BILI-UERE, MAIKAPENGE, 17
RUBITELE, LUAMA et Reserve des
Okapis 17
SECTION 2 : IMPACTS ET CONSEQUENCES
DE LA GUERRE SUR L'ENVIRONNEMENT EN RDC. 18
§1. Destruction de l'habitat
et perte d'animaux sauvages 18
§2. Surexploitation des
Ressources Naturelles. 18
§3. Pollutions
Environnementales 19
3.1. Conséquence pour le
secteur de la conservation et des ressources naturelles. 19
3.2. De la dégradation de
l'environnement et de la pauvreté. 20
PARTIE SECONDE : DE
L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT EN RDC 21
CHAPITRE PREMIER :
RENFORCER L'APPLICATION DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 21
SECTION I : SOURCES DE DROIT
INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 21
§1. Conventions
Internationales 21
§2. La Coutume 22
§3. Les principes
Généraux de Droit 22
SECTION II : DE LA RECEPTION
DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX EN VIGUEUR AU NIVEAU NATIONAL
22
§1. Les Difficultés de
Mise en OEuvre du droit international de l'environnement en Période des
Conflits Armés 22
A. Le contexte
général 22
B. Le contexte spécifique
23
§2. Renforcer
l'opérationnalisation des conventions internationales à
l'échelon national 23
A. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
RELATIVES AU DIE 23
1.- La Convention sur la
diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992 23
2.-La Convention de Washington sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction entrée en vigueur le 17 septembre
1973(CITES) 24
3. -Charte Mondiale de la
Nature 25
3.1. Législation en vigueur
25
3.2. Evaluation de la
législation nationale 25
4- .Déclaration de Rio
sur l'environnement et le Développement de 1992 26
5.- La Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968,
dite Convention d'Alger 26
B. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
RELATIVES AU DIH 26
1.- La Convention ENMOD
26
2.- Le Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
26
3.- Les Directives du CICR de 1996
27
CHAPITRE SECOND : DES
POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES AUTEURS DES VIOLATIONS DE DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT 27
SECTION I : LES POURSUITES DES
AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES CONGOLAISES 27
SECTION II : LES POURSUITES
DES AUTEURS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES 28
§1. De la Possibilité
de l'action au niveau de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la
Cour Internationale de Justice. 28
A. De règlement judiciaire
de la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ 29
B. De la recevabilité de
l'action par la Chambre Spéciale pour l'environnement de la CIJ
29
§.2. Possibilité devant
la Cour Pénale Internationale face pour les dommages environnementaux?
29
§.3. Possibilité de
recourir à l'arbitrage international et la Cour de l'union africaine
30
§4 . La
réparation des dommages. 30
CONCLUSION
31
32
BIBLIOGRAPHIE
33
ANNEXES
39
ANNEXE I : LISTE DES
CONVENTIONS INTERNATIONALES ENVIRONNEMENTALES RATIFIEES PAR LA RDC
39
ANNEXE II : EXTRAIT DE
LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET
DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 41
ANNEXE III :
CONVENTION DE 1976 SUR L'INTERDICTION D'UTILISER DES 43
TECHNIQUES DE MODIFICATION
DE L'ENVIRONNEMENT 43
ANNEXE IV : PROTOCOLE
ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION
DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I), 8 JUIN 1977
44
ANNEXE V : BRACONNAGE
DES ESPECES TOTALEMENT PROTEGEES OU MENACEES D'EXTINCTION
45
ANNEXE VI : DEUX
PERSONNES TUEES AVEC 13 OKAPIS PAR MORGAN SADALA 49
ANNEXE VII :
COMMERCIALISATION DE CHARBON VENANT DE LA FORET DE PNVI
50
* 1 Loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement, Journal Officiel,
Numéro spécial 16 Juillet 2011,p5.
* 2
Déclaration de Rio sur l'environnement
et le Développement principes de Gestion des
forêts ,principe n°11
* 3
Ibidem,p,7.
* 4 KIYUNZA,B. et
SHOMBA,K. ;Initiation aux méthodes de travail
scientifique en sciences sociales, Kinshasa
,PUZ,1996 ;p42
* 5
La source est de la Banque
Mondiale ,www.google.cd.publidata(Consulté le 27 Juillet
2012)
* 6
RONGERE ,P. ,Méthodes des sciences,
Paris, Dalloz,1971,p.20
* 7 AL - HAMNDOU
DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD,
« Conflits armés et Environnement : Cadre,
modalités, méthodes et rôle de l'Évaluation
Environnementale », Développement durable et
territoires [Online], Dossier 8 : Méthodologies et pratiques
territoriales de l'évaluation en matière de développement
durable, Online since 09 November 2010, connection on 28 June 2012. URL :
http://developpementdurable.revues.org/3365(Consulté
le 10 mai 2012)
* 8 AL -
HAMNDOU DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD,
idem,(Consulté le 10mai2012)
* 9 GRAWITZ,M.,
Méthodes des sciences, Paris,
Dalloz,1974,pp. 331 -333
* 10 GRAWITZ,M.,
idem p.289
* 11 AL - HAMNDOU
DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD., Op
cit.
* 12 AL - HAMNDOU
DORSOUMA and MICHEL-ANDRE BOUCHARD., Op
cit
* 13
Banyarwanda signifie « les gens du
Rwanda », Banyamulenge « les gens de Mulenge » du
nom d'un village du massif de l'Itombwé, à l'ouest du lac
Tanganyika, habité par des pasteurs tutsis. Avec l'ethnicisassions
croissante des rapports sociétaux, le terme de Banyamulenge a tendance
à englober l'ensemble des Tutsis du Congo. Les tutsis congolais qui
vivent au sud Kivu dans les montagnes d'Uvira ,ils sont aux frontières
comme la plupart des tribus congolais qui par le découpage des
frontières de la colonisation des clans, des tribus étaient
repartis l'un dans un Etat et l'autre dans l'Etat voisin. Exemple de lunda, de
batshokwe ,banzande ,les bakongos et
* 14 02 Général
MASUNZU Cmd Adjoint 10ème Région militaire/Bukavu et parmi le
rare élite tutsi à comprendre la ruse de Kagame ;et
déclare privilégier la nationalité congolaise que son
origine historique tutsi. Il mène un sérieux combat
idéologique et militaire contre selon lui les catalyseurs de
l'envahisseur. Il est le général tutsi le plus admiré par
beaucoup des congolais
* 15 Les affrontements de sept
jours entre les troupes rwandaises et ougandaises à Kisangani pour avoir
le contrôle de ville diamantaire est une preuve de guerre d'invasion de
convoitise et de pillage de richesses de RDC.
* 16 La conférence des
évêques catholiques du Congo ont organisent le mercredi le
02/08/2012 une marché de chrétiens sur tout étendu de
territoire pour dire non à la balkanisation, aux pillages des
richesses, aux violences sexuelles et à la guerre .
* 17 Voir les
documentaires :le sang dans nos portales et coltan and blood
* 18
Voir à ce propos O. LANOTTE cité
par GRIP-BICC, Guerres sans frontières en République
démocratique du Congo, Bruxelles, GRIP Complexe,2003, pp.
67-95.
* 19 Rapport du
DSRP .état des lieux de l'environnement en
RDC, op cit,p1.
* 20
GRIP, Ibidem, pp. 123-128.
* 21 United states Institute
for Peace,»Special Report: AIDS and Violent Conflict in
Africa» October 2001.p.5.
* 22 O.LANOTE, Op
cit,pp128-130
* 23 S/2008/773. A la suite de
la publication de ce rapport, plusieurs bailleurs importants du Rwanda, dont
les Pays-Bas, la
Suède, le Canada et la Grande-Bretagne, ont mis fin,
suspendu ou envisagé de suspendre, en tout ou en partie, leur aide
financière au Rwanda.
* 24 Territoire de Shabunda a
la superficie de27000 km environ celle du Rwanda. Il est potentiellement
très riche en sol, sous- sol, faune et flore. Il est habité
entièrement par le peuple léga qui s'organise en
autodéfense populaire pour assurer sa légitime défense
contre les FDLR.
* 25 Voir à ce propos
J. KIPPENBERG, et alii, Les soldats violent, les
commandants ferment les yeux. Violences sexuelles et
réforme militaire en République démocratique du
Congo, New York : Human Rights Watch, 2009 ; Human Rights 2009 Report
: Democratic Republic of the Congo, Washington : U.S. Department of State,
11 mars 2009.
* 26 Étude
sur la prolifération des armes légères en RDC (avril 2010)
GRIP - BICC ,p17
* 27
Massacres perpétrés dans ce
camp de réfugiés proche de la frontière congolaise par des
FDLR et leurs alliés Maï Maï dans la nuit du 13 au 14
août 2004.
* 28 A ne pas à
confondre avec l'ANC de la première législature après
l'indépendance du Congo
* 29
Conclus en 2002 ces accords ont mis un terme
à la guerre civile congolaise (1998-2002). Dans le cadre de ces accords,
les militaires rwandais et angolais ont quitté l'est du Congo en 2003,
sans pour autant que ce retrait règle les problèmes de ces
régions frontalières sous tension comme en témoignent les
conflits en Ituri et au Kivu.
* 30
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2012/06/un-human-rights-chief-fears-more-rapes-killings-in-congo-by-m23/
(consulté le 23/07/2012
* 31 Idem
* 32 R .
POURTIER, « Le Kivu dans la guerre : acteurs et
enjeux », Echo Géo [En ligne], Sur le
vif 2009, mis en ligne le 21 janvier 2009, consulté le 19 avril 2012.
URL : http://echogeo.revues.org/10793
* 33 A travers la clause de
cessation ,KIGALI veut que tous les refugiés rwandais qui refusent le
rapatriement, perdront la nationalité rwandaise et vont
s'intégrer dans la communauté congolaise
* 34
Dépêche n° 001/focdp/2012,les fdlr
réalisent le génocide continue dans le territoire de Shabunda au
sud- Kivu en RDC ,Bukavu ,2011
* 35
Le mot maï maï (ou Mayi Mayi)
fait référence à l'eau (maï), les balles des ennemies
étant censées se vaporiser au contact du corps rendu invincible
par des pratiques magiques. Les combattants ont vite compris qu'un grigri ne
dispensait pas de recourir aux armes modernes.
* 36 Human Rights
Watch(HRW), « Vous êtes
punis » :Attaques contre les civils dans l'est du
Congo,13décembre2009
* 37 Raia Mutomboki en swahili
veut dire la population se révolte
* 38
http://wilkipedia/wiki/,armée_de_resistance_du_seigneur
* 39
http://fr.wikipedia.org/wiki/armée_de_resistance_du_seigneur
* 40
http://fr.wikipedia.org/wiki/forces_armées_de_république_démocraique_du_congo
* 41 Rapport de
l'atelier d'experts, Dynamiques des conflits et de la
migration forcée en RDC,30 novembre - 1er
décembre 2010, Oxford
* 42 Rapport du Groupe de
Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité(GRIP),la
mission des nations unies
* 43
http://echogeo.revues.org/10793
* 44 POURTIER ,Op
cit, ( consulté le 19 avril 2012). URL :
http://echogeo.revues.org/10793)
* 45 Rapport GRIL 2011
* 46 C.MBELO ,temps
de chien en RDC,in Politique Voir le site
http://www.grandslacs.net/doc/3862.(Consulté le 02/08/é/2012)
* 47 Histoire des
Nations-Unies, ONU correction. p.3,Voir le site
http://www.un.org/french/
* 48
R.POURTIER. ;Op cit,
http://echogeo.revues .org.
(consulté le 23/07/2012)
* 49 Radio Okapi,
conférence de presse hebdomadaire de la monusco du mercredi
11-O7-2012
* 50
P.BARACYETSE,L'enjeu géopolitique des
sociétés minières internationales en
RDC,1999,Buzet, Belgique
* 51 Ecole de guerre
économique, la guerre du coltan en RDC,
mémoire de préparation en stratégie d'Intelligence
Economique,2008
* 52
P.BARACYETSE,L'enjeu géopolitique des sociétés
minières internationales en RDC,1999,Buzet, Belgique
* 53 GRAMA Groupe de Recherche
sur les activités minières en Afrique, la route commerciale du
coltan congolais :une enquête.
Montréal :Université du Quebec,mai2003
* 54 Nations
Unies, nouveau rapport du groupe d'experts sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.
New York ;23octobre 2003
* 55
D.FAILLY .,Coltan :pour comprendre
in l'annuaire des Grands lacs.
Paris :Harmattan,2001.p.3à 27
* 56
E.DEBELLEX, « Du sang sur les
portables ».Terra economica .Septembre 2006.24.p.6-8
* 57 Groupes d'experts
mandatés par le Conseil de Sécurité de l'ONU, rapport
intérimaire sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
et des autres richesses de la RDC,22 mai 2002
* 58 ICCN, Stratégie
Nationale de la Conservation, décembre 2004.p.
* 59 ICCN ,op. cit ,p.7
* 60
A MALONGA MULENDA, De la
responsabilité international des acteurs impliqués dans les
guerres de 1996et 1998 en RDC au regard des violations liées au droit
international de l'environnement,. inédit, mémoire
master2DICE, Limoges-2007,p.5.
* 61
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Garamba
* 62 Ministère des
Droits Humains ;op.cit.,p.62
* 63 Nations Unies op.
cit.p.62
* 64 Op cit.p.63
* 65 Conférence de
presse hebdomadaire de la Monusco du 27Juillet 2011.Kinshasa
* 66
http://fr.wikipedia.org./wiki/Parc_national_des_Virunga
* 67 Op.cit.p.20
* 68 Op cit.p.60
* 69 Op cit.p.61
* 70 Op cit.p.61
* 71 Op cit.p.61
* 72 Etude de AIDE ET ACTION
POUR LA PAIX sur la commercialisation de braise dans les
territoires deMasisi, de Rutshuru et dans la ville de
Goma2007p.7
* 73
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_la_Maiko
* 74 Op cit.p.21
* 75 Les dommages sur
l'environnement dus aux guerres modernes sont sans précédents,
cité par A.MALONGA, in
http://www.notre-plantete.info/actalités/actualités/act-1531;php
* 76 Nations
Unies,op.cit.p.5
* 77
J.SEMEKI NGABSZEKE., Impact des
conflits armés dans la gestion des ressources naturelles en
RDC,in Atelier sur l'évaluation et les conflits
armés,Kinshasa,2007,pp2-3
* 78 Voir Monuc,in
http://www.monuc.org
* 79 J.KALPERS.,Volcans
assiégés :impact d'une décennie de conflits
armés dans le massif des
Virunga,www.BSPoline.org/publications(Consulté le 05/06/2012)
* 80 Nations
Unies, op cit.p.7
* 81 Etude de l'ONG AIDE ET
ACTION POUR LA PAIX, op ;cit .p.13
* 82 Nations Unies,
op.cit.p.7
* 83 Nations Unies,
op.cit.,p.8
* 84 A.MALONGA
MULENDA,op.cit.p.10
* 85 Nations Unies,
op cit . p.9
* 86 J.SEMEKI
NGABSZEKE, impact des conflits armés dans la gestion des
ressources naturelles en RDC ,in Atelier sur l'évaluation
de l'environnement et les conflits armés, Kinshasa,2007 ;p4
* 87 Communique de Presse
conjoint OMS et UNICEF du 13juillet 2012 Kinshasa ;RDC
* 88 http://
wwwdigitalcongo.net/article/65639 ,Bilan de 6,9Millions de morts
victimes de la guerre en RDC nécessite que le TPI en poursuivre les
auteurs !,Kinshasa ,le 27 Mars 2010
* 89 Handicap International
dans son programme de déminage/dépollution dans la province de
Kisangani,2001-2003,p.2
* 90 Nations Unies,
op.cit.p.11
* 91 J.C.
BALOLEBWAMI AMULI , Etude sur le charbon de bois en RDC et
à Gisenyi au Rwanda, Goma,2008
* 92 A.MALONGA MULENDA.,op
cit,p.13
* 93 A.MALONGA
MULENDA ,op.cit.p.14
* 94 Wikipedia,op cit
* 95 Gomes CANOTILHO,
Droit de l'environnement brésilien, cours de Master2
DICE,2011-2012,Limoges. p3
* 96
CICR, Opinion paper sur la notion de CI.pdf,mars2008
* 97 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON
et D.JENNEN, Droit international protégeant l'environnement
en période de conflit armé :lacunes et opportunité
Voir le site :
www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté
le 21/05/2012)
* 98 M.BOTHE,C.BRUCH,J.DIAMON
et D.JENNEN, Idem,Voir le site :
www.icrc.org/fre/.../irrc-879-bothe-bruch-diamond-jensen-fre.pdf(consulté
le 21/05/2012)
* 99 S.
MALJEAN-DUBOIS, la mise en oeuvre du droit international
de l'environnement, Centre d'études et de recherches
internationales et communautaires, Aix-en-Provence. Téléphone :
01 53 70 22 35 - iddri@iddri.org www.iddri.org2003 France voir
* 100 L'absence de
l'information et de participation de la question environnementale laisse la
population paysanne en ignorance où on croit la visite des touristes ou
partenaires blancs et des gardes de parc comme une extorsion de leur
héritage soit ils s'accusent leur chef coutumier de traitre.
* 101 SADALA alias Morgan est
parmi le braconnier redoutable pour la chasse des éléphants et le
trafic des ivoires
* 102 Article 8 d et k ;
La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique in
Avocats Verts, Recueil des textes juridiques en matière environnementale
en RDC,2è édition . pp.524-525
* 103 Idem, pp.525
* 104 N . SHUKU
ONEMBA, les impacts et les enjeux environnementaux des conflits
armés en RDC in Atelier Association
Nationale pour l'Evaluation Environnementale de la RDC, ANEE,2004
* 105 Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction, in Avocats verts ,Recueil des textes juridiques
en matière environnementale en RDC,2è édition, pp.510
* 106 Idem, pp.512
* 107
http://enviedailleurs.forumpro.fr/t8003-terreur-a-epulu-les-gardes
* 108 Lire l'article sur
Jeuneafrique.com :
RDC: cinq espèces animales menacées
d'extinction au parc de la Maiko | Jeuneafrique.com - le premier site
d'information et d'actualité sur l'Afrique Voir le site
http :www.jeuneafrique.com/article/
* 109 Charte Mondiale de la
Nature in Recueil des textes juridiques en matière environnementale en
RDC 2è édition, p.519
* 110
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27interdiction_d%27utiliser_des_techniques_de_modification_de_l%27environnement_%C3%A0_des_fins_militaires_ou_toutes_autres_fins_hostiles
* 111
Source :http://developpementdurable.revues.org/3365
* 112 Source :
http://developpementdurable.revues.org/3365
* 113 Loi n°11/009 du 09
Juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement, J.O.Numéro
Spécial-16Juillet2011 .p.5. « exposé de
motif»
* 114 Article 68,idem
* 115 Article 69,idem
* 116 Article 71 de la Loi
n°11/009 du09Juillet2011,Op cit
* 117 Article 83 de la Loi
n°11/009 du 09 Juillet 2011 ,Op cit
* 118 . M. DUBISSON, La
Cour Internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964, p.100.
* 119 R. RANJEVA, le
règlement des différends, cours vidéo sur la
responsabilité internationale face aux
dommages environnementaux, Master2 DICE,
Université de Limoges, inédit, 2007-2008.
* 120 J.M. LAVIELLE,
Droit International de l'environnement, Paris, 2èm éd.,2004,
p.65.
* 121 Article 8
alinéa2,b, iv de Statut de Rome de la CPI
* 122 M.BOTHE,
C.BRUCH,J.DIAMON et D.JENNEN, Op cit,p22
* 123 A.KISS et J.P.BERIER,
Droit international de l'environnement, Paris,Pedone,(3è
édition),2004,p.427



