La population de la commune de Zè utilise les ressources
en eau à de diverses fins.
· Usage des eaux
atmosphériques
L'eau de pluie est utilisée dans les activités
ménagères à savoir : la lessive, la toilette, la cuisine
et la lessive.
Sur les 207 ménages enquetés, 89 disposent
d'une citerne et recueillent l'eau de pluie. Tous les 50 agriculteurs
interviewés utilisent les eaux de pluies conservés dans des
citernes.
Il n'existe pas d'industries dans la commune de Zè.
Les unités de transformations disponibles sont pour la plupart, des
associations de femmes qui s'occupent de la transformation du manioc en gari et
tapioca, de l'ananas en jus d'ananas et de la noix de palme en huile rouge.
Elles utilisent donc de l'eau de citerne pour laver et mettre au propre le
manioc ou la noix de palme. Certains particuliers vendent l'eau pour
alléger les peines de la population, rapprocher les points d'eau dans
leur village et pour augmenter également leur revenu financier en
construisant des citernes dans leur maison pour alimenter les habitants qui
sont éloignés des Bornes Fontaines.
· Usages des eaux superficielles
Le paysan africain est impuissant de retenir, de
préserver, d'utiliser avec précaution l'eau de pluie
tombée sur sa terre au bénéfice des plantes, des cultures,
de la mettre en réserve pour en disposer durant les périodes
sèches (Chleq et al, 1997).
Les cultures au Bénin sont exposées aux
aléas climatiques (MEPN, 2008). Le paysan attend le début de la
saison pluvieuse pour commencer à cultiver ; s'il n'y a pas de pluie,
les cultures sont exposées à la sécheresse. La frange de
la population interviewée constituée d'agriculteurs estime
qu'elle souffre énormément du manque d'eau en saison
sèche. Ils puisent dans les marigots ou les cours d'eau qu'ils utilisent
pour arroser leurs champs d'ananas ou de manioc.
Sur les 207 ménages enquêtés, 15,46 %
utilisent les eaux superficielles, soit un total de 32 ménages. Parmi
ces ménages, certains utilisent les eaux superficielles pour leur besoin
domestique.
Par contre, d'autres irriguent leur champ en se servant des
sillons et des billons. Dans les régions d'Awokpa, Djigbé,
Houedota, Sèdjè-Dénou et
SèdjèHouègoudo, la production rizicole et le
maraîchage se font dans les bas-fonds. Mais la non maîtrise de
l'eau dans les casiers emporte très souvent les cultures. La photo 9
montre un champ irrigué.

Photo 9 : Vue d'un champ irrigué
à Adjan
Prise de vue : KANHONOU, juillet
2011
La plupart des paysans de l'arrondissement d'Adjan
installé à côté des cours d'eau irriguent leur champ
pour mieux faire face aux intempéries climatiques.
La pisciculture est aussi pratiquée dans des trous
à poisson non encore aménagés à Houéhounta.
Deux Organisations Non Gouvernementale telles que l'Association Huma-Nature et
l'Association pour la Santé et l'Education installées à
Zè, font à part la vente de l'eau, le jardinage et aussi la
culture du manioc à proximité de leur point d'eau.
· Usage des eaux souterraines
Sur les 207 ménages enquêtés, 147
utilisent les sources d'eau non aménagées (les citernes et les
puits traditionnels) pour satisfaire les besoins tels que : la boisson, la
cuisine, la toilette et la lessive, soit un pourcentage de 71 %.
Par contre, les 60 restants, soit 29 % de
l'échantillon utilisent les sources d'eau aménagées (les
PEA, les AEV, les Forages, les Puits Modernes et les Bornes Fontaines) pour la
boisson et la cuisine. La plupart d'entre eux exprime des doutes sur la
qualité de l'eau qu'elle boive car la majorité de ces
ressources
telles que les puits traditionnels n'est pas
protégée. La figure 4 présente la fréquence
d'utilisation des sources d'eau aménagées et celle des sources
d'eau non aménagées.
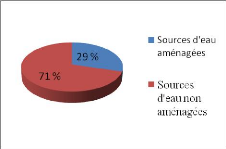
Figure 4: fréquence d'utilisation des
eaux souterraines pour les usages
domestiques
Source :
Enquête de terrain, 2011
L'analyse de la figure 4 révèle que parmi les
enquêtés, 71 % continuent d'utiliser l'eau des sources non
aménagées pour les usages domestiques pendant que 29 % utilisent
les sources aménagées pour ces mêmes usages. Ceci peut
être à la base de maladies hydriques liées aux microbes
contenus dans ces eaux qui ne sont pas couvert pour la plupart. La mauvaise
gestion des ressources en eau de la part des sages de la localité et le
non respect des règles par la population sont aussi à la base de
l'abandon des ouvrages et des pannes fréquentes. L'entretien des points
d'eau et des ouvrages est nécessaire pour limiter ces risques.
Le commerce de l'eau est assuré par des particuliers,
des associations et des fermiers qui se portent volontaires ou sont
désignés pour la vente. La plupart de ces particuliers vendent
l'eau à un prix beaucoup plus inférieur qu'à celui des
fontainiers (prix fixé par la commune). Pour les particuliers, le prix
de vente du bidon d'eau de 25 litres est soit à 15 FCFA ou à 20
FCFA alors que la même quantité d'eau est vendue par le fontainier
à 25 FCFA. La photo 10 présente des châteaux d'eau
privés à Goulo et Havikpa.
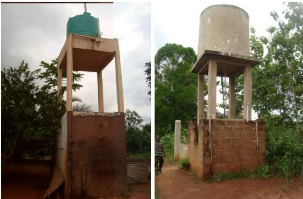
(a) (b)
Photo 10: Châteaux d'eau privés
à Goulo et Havikpa
Prise de vue : KANHONOU,
2011
Les châteaux d'eau ci-dessus sont en matériau
précaire (plastique), photo 10(a) et définitif
(béton), photo 10(b). Ils servent à alimenter le
propriétaire et la population en eau potable. Ils sont munis d'un
réservoir dans lequel l'eau est stockée et vendu selon le prix
fixé par le vendeur.



