2. Euroméditerranée : un projet urbain
pour une nouvelle centralité métropolitaine
Après avoir vu les similitudes et les points communs
entre les projets urbains dits de « régénérence
» urbaine des espaces arrière-portuaires des villes
européennes méditerranéennes, intéressons nous au
cas de Marseille.
La cité phocéenne dispose elle aussi d'une
grande opération de renouvellement socio-économique et urbain de
l'espace situé à proximité du port :
Euroméditerranée. Né aux croisements des volontés
de l'État et des pouvoirs locaux, ce projet urbain réinvente les
relations entre la ville et son port, mais cherche aussi à faire
basculer Marseille dans le rang des métropoles modernes.
Pensé comme une vitrine urbaine, le nouveau quartier
poursuit divers buts et objectifs, parmi lesquels on compte des buts
économiques, mais aussi des objectifs d'organisation territoriale. En
effet Euroméditerranée doit permettre à Marseille de
devenir une métropole méditerranéenne gouvernant une large
aire urbaine. Je chercherai donc à savoir si
Euroméditerranée est un projet de dimension métropolitaine
et si celui-ci favorise la construction métropolitaine.
Avant de nous intéresser plus en détail à
ceci, il convient cependant de rappeler les liens existant entre la ville et
son port. L'histoire de la ville est très liée à son port
; nous verrons donc par la suite comment Euroméditerranée,
à travers sa programmation, réinvente l'interface entre ces deux
ensembles.
Par la suite nous analyserons le rôle du projet urbain
pour la ville et le territoire métropolitain. Nous nous pencherons
ensuite sur l'image que celui-ci produit et les effets qui en découlent.
Enfin nous analyserons la gouvernance du projet et de la structure en charge de
celui-ci : l'EPAEM.
40
A. Une volonté de rapprocher la ville de sa mer
et de son port
Marseille est une ville méditerranéenne, mais
aussi portuaire. En effet les liens entre la ville et son port ont
marqué le territoire et l'histoire de la cité phocéenne.
Nous ferons donc dans un premier temps un rappel de l'histoire de la ville et
du port. Nous verrons comment les liens entre eux ont été
bénéfiques pour le territoire, et comment ceux-ci se sont
détériorés au fil des années, entrainant une
volonté de l'État de reconquérir les abords du port.
A. Histoire du port, de la ville de Marseille et des
liens existant
Marseille est une ancienne cité phocéenne,
chacun le sait et l'histoire est connue, mais il est bon de la rappeler pour
mieux comprendre et analyser les liens avec la mer et le rôle du port
dans le développement de la ville.
En 600 avant J.C, des colons venus de Phocée, ville
grecque d'Asie mineure, débarquent dans la calanque du Lacydon. Au vu de
la morphologie du site (le Lacydon est une darse naturelle de près d'un
kilomètre de long et de 300 mètres de large), l'emplacement est
idéal pour y implanter un comptoir. La cité phocéenne se
développe alors sur les hauteurs à proximité ; Massalia
est née.
Très vite le port va devenir une place
stratégique pour le commerce entre Orient et Occident, une porte
d'entrée sur la Gaule au niveau commercial, et un point de départ
pour des expéditions maritimes en direction de l'Afrique et de la
péninsule ibérique. Jusqu'à l'invasion romaine en l'an -
49 av. J.C, Massalia va se développer ; l'invasion romaine glorifiera la
voisine Arles. La fin de l'empire romain et les invasions barbares qui ont
suivi marqueront une période d'instabilité pour l'Europe, dont
Marseille n'est pas épargnée.
Sous Charlemagne (768-814) et son successeur Louis
Ier (814 -840) un calme relatif s'installe à Marseille ;
celle-ci est incorporée au royaume de Provence. Au temps des
Mérovingiens, Marseille redevient le principal port en liaison avec
l'Italie, Byzance et le monde oriental. Les huiles, les vins, les épices
et les céréales forment l'essentiel des marchandises
échangées. La dimension commerciale de la ville s'affirme au fil
des ans. Les activités du port retrouvent leur élan avec le
développement des royaumes « francs ». Ceux-ci ont besoin du
soutien de l'Occident, fourni le plus souvent par des villes marchandes. Le
commerce est également très actif avec l'Afrique du Nord,
l'Italie, la Sicile et l'Espagne. Ce développement est alimenté
par l'extension du marché intérieur. Arles, Avignon, Lyon
constituent des entrepôts et des relais vers les grandes foires. Cet
essor remarquable s'étend jusqu'au XIV ème
siècle. Marseille va alors se développer et rayonner sur la
Méditerranée.
Au XV ème siècle, l'attaque des
Aragon va décimer la ville, son port et sa flotte. Les relations avec
l'Espagne et l'Afrique du Nord sont rompues, et la fin du siècle sera
marquée par l'édification sous le règne du roi René
de la tour St-Jean en l'an 1447. Le négoce maritime va par la suite
reprendre de l'ampleur essentiellement grâce au développement de
marchés intérieurs.
41
Entre 1481 et 1494, Marseille et la Provence sont unies au
royaume de France. Véritable fleuron économique du pays,
rayonnant à nouveau sur la Méditerranée, le port devient
également arsenal militaire et chantier naval des flottes royales. Le
port connait alors un développement et des aménagements
successifs sous les différents rois, lui conférant des avantages
et renforçant son rôle de place commerciale. La création
d'un Bureau du Commerce en 1599, chargé d'informer les autorités
des améliorations jugées utiles, renforce la dimension
commerciale de la ville. Ce bureau deviendra par la suite la première
Chambre de Commerce et de l'Industrie.
Au début du règne de Louis XIV, la ville se
développe dans une quasi-autonomie jusqu'en 1660, où une
occupation militaire est décidée pour calmer ses
velléités d'indépendance. Le pouvoir central impose alors
une politique de sévérité. Une garnison permanente de 3
000 hommes est installée et la construction des forts Saint-Jean et
Saint-Nicolas décidée. L'action de Louis XIV s'avère
cependant efficace et bienfaisante pour la prospérité de
Marseille. Il ordonne l'agrandissement de la ville qui voit sa superficie
tripler.
En 1669, l'édit de Mars renforce le poids
économique de la ville en taxant de 20% les marchandises « d'Orient
et de Barbarie » venant d'autres ports du royaume. Marseille devient la
porte d'entrée commerciale du royaume pour tout le pourtour de la
Méditerranée. Ceci est accentué en 1703, avec une
exonération totale pour certaines marchandises ; par ailleurs les
aménagements du port sont poursuivis permettant d'accueillir des navires
toujours plus grands. La peste et le transfert du port militaire à
Toulon en 1748 ne ralentiront pas l'essor du port et de la ville. Au contraire,
des disponibilités foncières sont abandonnées pour des
constructions immobilières où se développent de nombreuses
activités en lien avec la mer.
La révolution française et les guerres
successives de l'empire vont mettre la ville en état de faillite ;
émeutes et manifestations se succèdent, des disettes vont
même menacer la ville suite au blocage maritime et continental de la
ville.
A partir de 1825, l'activité économique reprend
une fois encore ; les industries se développent ; le port connaît
un nouvel élan. Sur décision de Napoléon III, un canal
d'Arles à Bouc est creusé et concrétise la liaison
Rhône-Mer. Durant le Second Empire, Marseille reste le grand port
méditerranéen. L'aménagement de voies ferrées
(Avignon-Marseille en 1849, Marseille-Toulon en 1859) constitue un
élément de liaison efficace avec l'intérieur. Avec le
développement de la navigation mécanique, le nombre et la
régularité des bateaux augmentent, ainsi que le volume de leur
cargaison. Commodités d'accostages et rapidité des
opérations doivent être en place pour répondre aux besoins
du commerce.
Après de nombreux projets tant au Nord qu'au fond du
Lacydon, un port auxiliaire est creusé à la Joliette. Le port de
Marseille trouve là son véritable levier d'extension. Les
études prospectives se basant sur les futurs besoins étendent le
port dans des proportions gigantesques pour l'époque. Sous le
régime de Napoléon III, deux môles contigus, Lazaret et
Arenc, vont être aménagés. D'autres travaux d'extension se
poursuivent jusqu'à la fin du siècle. La révolution
engagée avec le développement des échanges induit de
véritables mutations des infrastructures. Les quais et les espaces de
réception des marchandises s'étendent pour répondre
à l'augmentation des tonnages et au progrès de la manutention. Le
dépôt des cargaisons, à proximité des navires
accostés, devient une nécessité.
42
L'État concède la création et
l'exploitation de vastes docks à une compagnie privée ; ceux-ci
ouvrent en 1863 et vont prendre une part très importante dans la vie du
port. Vaste lieu de stockage, les docks vont permettent de répondre
à l'agrandissement des bassins, qui couvrent à l'époque
une surface de 72 hectares. Ils sont aussi conçus pour améliorer
la fluidité des marchandises et réduire le temps de rupture de
charge. Ils permettent de rationaliser l'espace portuaire, mais ils
rationalisent aussi l'espace urbain car ils se détachent du reste de la
ville au niveau architectural : la création des Docks et entrepôts
apparait comme un moment important de la dissociation entre ville et port.
Figure 7 : Évolution de la façade maritime
marseillaise

1. Marseille, vue prise au dessus des Catalans, par Alfred
Guesdon en 1848.
2. Vue perspective du port de Marseille, par
Frédéric Hugo d'Alésé en 1888.
Source : Marseille Euroméditerranée,
accélérateur de métropole.
La dynamique industrielle et l'ouverture de nouveaux
marchés par les possessions d'outre-mer et les colonies viennent
compléter le développement du port. L'ouverture du canal de Suez
en 1869, facilite les échanges commerciaux et maritimes ; l'image d'une
« porte de l'Orient » est alors attribuée à Marseille,
qui est en 1872 le quatrième port mondial. Le mouvement maritime
colonial représente, en 1896, plus du quart de la navigation totale. Le
port de Marseille, même s'il emploie de nombreux habitants des quartiers
voisins est moderne, il dispose de grues et d'ascenseurs à pression
d'eau et à vapeur, ainsi que d'une grue flottante de 20 tonnes. La
montée en puissance du chemin de fer est aussi un fait notable qui va
fortement marquer le port : le rail va même jusqu'à imposer sa
géométrie, comme en témoignent les môles et
traverses obliques du bassin du Président Wilson, qu'adopteront beaucoup
de ports. L'industrie de la réparation navale connaît un essor
fulgurant et les ateliers se multiplient pour donner une nouvelle fonction au
port.
Le port de Marseille s'afÞrme donc comme l'un des plus
rapides d'Europe. Cependant l'essor des ports des villes nord
européennes va rapidement venir réduire l'influence et
l'importance de Marseille. La nécessité et l'urgence
d'étendre les bassins se font à
43
nouveau sentir pour que Marseille reste dans la
compétition mondiale que les ports se livrent. La compression physique
de la ville sur le port contraint celui-ci de se renouveler sur lui même
pour se développer, contrairement à d'autres ports du Nord de
l'Europe ou des États-Unis. Cependant ceci caractérise de
nombreux ports Méditerranéens.
Au cours des premières décennies du
XXème siècle, les bassins occupent le littoral
marseillais jusqu'à la chaîne de l'Estaque. Ceux de la
Pinède et de la Madrague sont construits, ainsi qu'un dépôt
pétrolier marquant les débuts d'une nouvelle histoire
industrielle. A partir de 1911, les études sur l'extension portuaire
atteignent les limites géographiques de la commune. Une nouvelle
génération de projets voit le jour : le pôle
industrialo-portuaire extérieur au territoire de Marseille.
Figure 8 : Aménagement du littoral Nord de Marseille
au XX° siècle
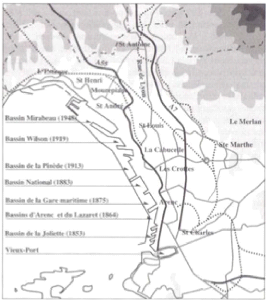
Source : Donzel, 1998
La première guerre mondiale va troubler le
développement du port, mais à la sortie du conflit international
les pouvoirs publics vont appuyer une politique de développement de
l'industrie pétrochimique. L'étang de Berre offre alors les
conditions idéales pour stocker et raffiner l'or noir et dès 1930
des raffineries vont s'installer à Berre. Différentes annexes
seront créées et rattachées au port de Marseille dans les
années qui vont suivre.
La deuxième guerre mondiale va aussi fortement marquer
l'histoire du port et de la ville : jusqu'en 1942 Marseille est une ville
où l'on embarque pour la liberté. Cependant le régime de
Vichy va tout de même orchestrer la destruction d'une partie des
quartiers jouxtant le vieux-port afin de nettoyer le sol urbain. En 1944 les
Allemands détruisent quais, môles, grues, hangars et navires pour
gêner l'arrivée des Alliés. La libération sera donc
suivie d'une période de reconstruction du port. Un travail d'adaptation
va accompagner cette reconstruction ; ceci permet à Marseille de rester
une grande place maritime.
Mais les années 1960 et la fin de l'empire colonial
français va porter un coup fatal au port de Marseille et à
l'ensemble de la ville. Les échanges commerciaux avec les anciennes
colonies sont alors fortement limités ce qui à pour effet de
réduire l'importance du port ; les industries qui utilisaient les
matières premières venant d'Afrique, Orient ou
Extrême-Orient vont aussi être touchées et disparaissent peu
à peu. Une reconversion industrielle tournée vers le
pétrole et la métallurgie est envisagée par les pouvoirs
publics ; celle-ci doit être localisée dans le golfe de Fos.
| 


