|
GROUPE BK - UNIVERSITE CHAMBRE ECONOMIQUE
EUROPEENNE
Institut International de Management Fondation
Universitaire Mercure
Cotonou - BENIN Bruxelles - BELGIQUE

MEMOIRE DE
MASTER EN COMMUNICATION MARKETING
THEME

ANALYSE DE LA POLITIQUE DE
COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU
COMMERCE,
DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
(MICPME) DU BENIN.
Rédigé par :
Jean Eudes B. HONFOGA
Sous la direction de :
Dr. Francine H. TOKPO
Enseignant-chercheur, Responsable Filières Gestion
(Entrepreneuriat et Gestion des
Exploitations Agricoles, Financement des
PME), FASEG/Savè (Bénin)
Février 2015
Promotion 2012 - 2013
AVERTISSEMENT
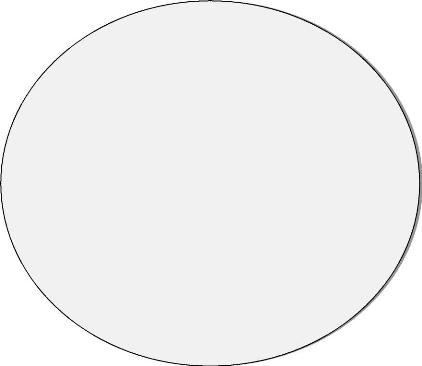
Le présent mémoire vise à
susciter des réflexions et débats sur les politiques qui existent
en matière de communication. Les données ont été
rassemblées et les analyses et diagnostics ont été faits
par l'auteur sur la base de la documentation obtenue de diverses sources et des
interviews. Toutefois, les opinions émises dans ce document n'engagent
que l'auteur et ne représentent pas nécessairement les positions
du Groupe BK-Université et ses Institutions.
Tous droits réservés à l'auteur
en vertu du copyright de l'Université et contre le plagiat.
|
|
|
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
|
DEDICACE
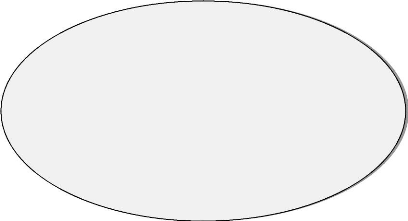
A mes parents
Barthélémy G. HONFOGA
&
Akou Amélie ABOTSI
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
II
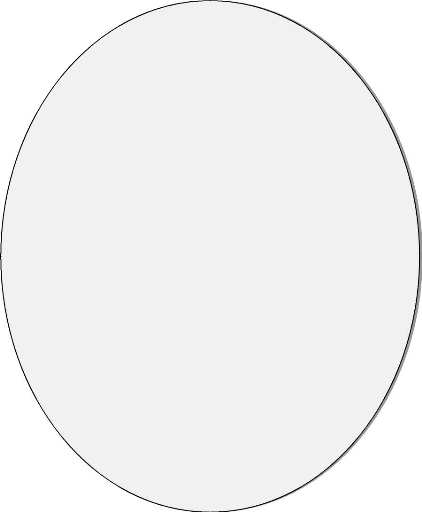
Je n'oublie pas non plus le soutien et l'aide de mes
frères Roland et Achille HONFOGA, la famille AHOKPE
et mes amis, en particulier Anifath LAWANI, Pascal NONDICHAO,
Matthias Ovenu DOGBO, Afi MESSANVI-EDOH, Erika BAGLO, et Anne
ETONAM pour leurs précieux conseils. Sans oublier M.
Pierre MATCHOUDO, Chef Cellule Communication MICPME, pour sa
disponibilité et son implication tout au long de cette recherche.
Avec toute ma considération et tous mes respects, je
remercie mon directeur de mémoire, Dr. Francine H. TOKPO,
pour avoir accepté encadrer ce travail. Je lui suis
également reconnaissant pour sa disponibilité et sa confiance.
Je tiens à remercier l'ensemble des membres du
jury qui ont accepté évaluer ce travail ;
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
III
REMERCIEMENTS
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
iv
ABREVIATIONS
ABeNOR Agence Béninoise de
Normalisation et de Gestion de la Qualité
ABePEC Agence Béninoise de Promotion
des Echanges Commerciaux
ABMCQ Agence Béninoise de la
Métrologie et du Contrôle de la Qualité
ANaPI Agence Nationale de la
Propriété Industrielle
ANPME Agence Nationale des Petites et
Moyennes Entreprises
BRMN Bureau de Restructuration et de Mise
à Niveau des Entreprises
CAT Cellule d'Appui Technique
CBT Compagnie Béninoise des
Textiles
CCIB Chambre de Commerce et d'Industrie du
Bénin
CCOM Cellule de Communication
CEPAG Centre de Perfectionnement et
d'Assistance en Gestion
CJ Cellule Juridique
COTEB Complexe Textile du Bénin
CPMP Commission de Passation des
Marchés Publics
CS PRAI Cellule Sectorielle de Pilotage des
Reformes Administratives et
Institutionnelle
CSS Complexe Sucrier de Savè
DCLF Direction de la Concurrence et de la
Lutte contre la Fraude
DESI Direction des Etudes et des
Stratégies Industrielles
DGCE Direction Générale du
Commerce Extérieur
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
V
DGCI Direction Générale du
Commerce Intérieur
DGDI Direction Générale du
Développement Industriel
DGPME Direction Générale de
Petites et Moyennes Entreprises et du secteur
privé
DIP Direction de l'Information et du
Pré-Archivage
DPCI Direction de la Promotion du Commerce
Intérieur
DPI Direction de la Promotion Industrielle
DPME Direction des Petites et Moyennes
Entreprises
DPP Direction de la Programmation et de la
Prospective
DPSP Direction de la Promotion du Secteur
Privé
DRFM Direction des Ressources
Financières et du Matériel
DRH Direction des Ressources Humaines
FIDI Fonds d'Investissement et de
Développement Industriel
GUFE Guichet Unique pour Formalisation des
Entreprises
MICPME Ministère du Commerce, de
l'Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises
SITEX Société des Industries
Textiles du Bénin
SONACOP-SA Société Nationale
pour la Commercialisation des Produits Pétroliers
SP Service Protocole PME/PMI
SPMSCN Secrétariat Permanent de la
Mission de Suivi de la Charte Nationale
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
vi
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX
Figure 1 : Eléments de la communication
Figure 2 : Modèle d'évaluation adopté
pour la présente étude
Tableau N°1 : Missions et réalisations de la
cellule de communication
Tableau N°2 : Analyse SWOT de la Cellule de Communication
du MICPME
Tableau N°3 : Variables et indicateurs de
l'hypothèse N°1
Tableau N°4 : Variables et indicateurs de
l'hypothèse N°2
Tableau N°5 : Variables et indicateurs de
l'hypothèse N°3
Tableau N°6 : Synthèse relationnelle des
objectifs, hypothèses et résultats attendus
de la recherche
Tableau N°7 : Critères et indicateurs
d'évaluation de la pertinence des actions de
communication au regard des attentes des cibles
Tableau N°8 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H1
Tableau N°9 : Représentation des données
d'enquête relatives à l'hypothèse H2
Tableau N°10 : Représentation des données
d'enquête relatives à l'hypothèse H3
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
VII
RESUME
L'analyse d'une politique de communication est faite dans le
but d'améliorer l'efficacité à l'interne ou à
l'externe des actions de communication menées par une organisation. La
présente étude est une analyse de la politique de communication
institutionnelle du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Petites
et Moyennes Entreprises (MICPME). En effet, l'objectif principal de notre
recherche est de rendre visible les activités du MICPME en proposant un
plan de communication adapté aux attentes des cibles (PMEs, industriels,
entrepreneurs...).
Nous avons donc constitué un échantillon auquel
nous avons administré un questionnaire en vue de tester nos
différentes hypothèses. Les résultats de notre
enquête montrent que les actions de communication ne correspondent pas
aux attentes réelles des cibles. Ce diagnostic nous a ainsi permis
d'identifier les problèmes à résoudre afin d'atteindre les
objectifs de notoriété et d'image que s'est fixé le
ministère. Dans les limites de la présente analyse, on peut
retenir que l'impact des actions de communication est positif et les objectifs
fixés au départ sont atteints si la Cellule de Communication
dispose de tous les moyens nécessaires à la réussite d'un
plan de communication institutionnelle. Le ministère devra
établir une structure pour gérer stratégiquement la
communication et servir de relais d'informations pour mieux atteindre les
cibles et prévoir et rendre disponible les fonds nécessaires pour
la réalisation des plans de communication. Quelques recommandations ont
donc été formulées pour contribuer au succès des
actions de communications initiées par le ministère. Ces actions
doivent donc être harmonisées avec les objectifs
spécifiques du MICPME, conformément aux grands axes du plan de
communication proposé pour rendre visibles ses activités, afin de
répondre aux attentes des cibles.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
VIII
SUMMARY
The analysis of a communication policy is made in order to
improve efficiency in internal or external communication actions undertaken by
an organization. This study is an analysis of institutional communication
policy of the Ministry of Industry, Trade and Small and Medium Enterprises
(MICPME). Indeed, the main objective of our research is to make visible the
MICPME activities by providing a communication plan adapted to the
expectations of the target (SMEs, industrialists,
entrepreneurs...).
So we selected a sample which we administered a questionnaire
to test our various assumptions.
The results of our survey show that communication actions do
not correspond to the actual expectations of the target. This analysis has
enabled us to identify the problems to be solved to achieve the objectives
reputation and image that has set the ministry. Within the limits of this
analysis, we can say that the impact of communication actions is positive and
the initial objectives are achieved if the Communication Unit has all the means
necessary for the success of a corporate communications plan.
The Department will establish a framework to strategically
manage communication and serve as conduits of information to better meet the
targets and provide and make available the necessary funds for the
implementation of communication plans. Some recommendations were made to
contribute to the success of communication actions initiated by the Ministry.
These actions need to be harmonized with the specific objectives of MICPME,
according to the major axes of the proposed communications plan to make visible
its activities to meet the expectations of the target.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
ix
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE I : PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET
OBSERVATIONS DU STAGE. 4
1.1. Présentation générale du MICPME 5
1.2. Présentation de la Cellule de Communication. 10
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE.
20
2.1. CADRE THEORIQUE 21
2.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 43
CHAPITRE 3 : RESULTATS DE L'ETUDE 51
3.1. PRESENTATION DES RESULTATS 52
3.2. LIMITES ET SUGGESTIONS 57
CONCLUSION 67
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
1
INTRODUCTION
Pour influencer les attitudes et les comportements des
différents publics (clients, prospects, prescripteurs, distributeurs,
etc.) auxquels elle s'intéresse, une entreprise doit communiquer avec
eux1. Par communication d'une entreprise, on entend l'ensemble de
toutes les informations, messages et signaux de toute nature que l'entreprise
émet, volontairement ou non, en direction de tous les
publics2.
La mission du Ministère de l'Industrie, du Commerce et
des Petites et Moyennes Entreprises (MICPME) du Bénin est double. Elle
consiste d'une part à concevoir et mettre en oeuvre la politique du
gouvernement dans les domaines de l'Industrie et du commerce. De l'autre, il
est chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. Pour y
arriver, il dispose de plusieurs directions centrales, générales,
techniques et départementales et quatre services supports dont la «
Cellule de Communication »3. Cette structure organisationnelle
complexe nécessite la mise en place d'une politique de communication
globale. Elle vise à rendre visible les actions du ministère et
de ses structures décentralisées et d'informer les cibles
nationales et internationales. En effet, pour Meryem Le May (2008), « la
communication est l'ensemble des actions permettant de faire connaître
les produits/services et de véhiculer l'image que l'entreprise veut
donner d'elle-même »4. Le MICPME a donc compris que pour
bien impacter ses usagers, il faut bien communiquer avec eux afin de sortir de
se consolider et se développer5. Ceci passe par la mise
à disposition des publics, des informations, messages et signaux
pertinents (Lendrevie et al, 2009).
Dans le cadre d'une institution telle que le MICPME, la
communication est gérée par la cellule de communication en
collaboration avec les différentes structures sous tutelle. Elle porte
notamment sur les actions de promotion du commerce, de l'industrie et des PME
au niveau national, régional et international. Deux types de publics
sont identifiés comme cibles. Il s'agit des cibles relais et des cibles
d'utilisation. Une cible relais est toute personne appelée à
servir de relais d'informations auprès du grand public, de
1 Lendrevie, Levy et Lindon, Mercator, Théories et
nouvelles pratiques du marketing, 9è édition, p.459, 2009
2 Lendrevie, Levy et Lindon, Mercator, Théories et
nouvelles pratiques du marketing, 9è édition, p.459, 2009
3 Voir organigramme en Annexe 1
4 Myriem Le May, « La politique de communication »,
2008
5
http://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Communication/Cours-La-politique-de-communication-362.html.
Consulté le 13/09/2014
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
2
l'international et autres. La cible d'utilisation est
l'ensemble des personnes ayant besoin de l'information sur les missions et
actions du ministère pour des raisons professionnelles ou
non6.
Dans une économie libérale, les Gouvernements
font la promotion des initiatives privées, en mettant en place les
mécanismes nécessaires pour faciliter aux opérateurs
économiques l'accès aux marchés intérieur et
extérieur. Pour mieux le faire, les autorités doivent
suffisamment communiquer avec les opérateurs économiques. Cela
permet de réduire les goulots d'étranglement à la
création d'un environnement favorable au développement du secteur
privé7. La promotion des PME s'impose aujourd'hui comme une
priorité de la politique économique du Bénin. C'est pour
cette raison que, l'Etat Béninois en intervenant dans la vie
économique, doit favoriser et soutenir les initiatives privées
chez les nationaux qui mènent des activités économiques
dans le cadre de petites et moyennes entreprises.
En ce qui concerne la communication interne orientée
vers les publics relais, l'objectif est d'éviter d'éventuels
dysfonctionnements et contribue à améliorer les conditions
d'exécution du plan de communication institutionnelle. La
réalisation conjuguée de ces deux objectifs distincts,
permettrait au Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Petites et
Moyennes Entreprises (MICPME) d'atteindre ses objectifs et ainsi de promouvoir
son image auprès des partenaires commerciaux, clients/usagers,
institutions et organismes sous tutelle. À cette fin, le MICPME a
initié plusieurs actions de communication interne et externe
développées à l'endroit des cibles. La question qui se
pose est de savoir si elles sont visibles par les publics visés.
Sont-t-elles adaptées à leurs attentes ?
Une politique de communication est une stratégie qui
s'attache à définir pour une entreprise la combinaison optimale
entre tous les moyens de communication existants en fonction de son budget. Il
englobe par conséquent les actions de publicité, de marketing
direct et de promotion des ventes8. Elle analyse les enjeux, les
cibles et les moyens mis en oeuvre pour une action plus efficace en faveur des
entreprises (petites et moyennes, publiques comme privées). Une
enquête a révélé les insuffisances (manque de
moyens financiers en vue de négocier des partenariats avec les organes
de presse ; inexistence de lignes budgétaires pour financer les
initiatives et les activités de la Cellule de
6 Stratégie de communication triennale 2013-2016 du
MICPME, réalisée par ATL S.A, Cotonou, Mai 2013.
7 MICPME, « Enquête de satisfaction du personnel et
des usagers/clients du ministère », septembre 2013.
8
http://www.Communication et
politique de communication.htm, consulté le 29 septembre 2014.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
3
Communication, notamment la mise en oeuvre du Plan
Triennal de Communication ; existence de plusieurs cellules de communication au
sein du ministère (ce qui constitue un risque pour la cohérence
de la politique de communication) de la politique de communication
actuelle menée par le MICPME. Ce qui nous amène à nous
poser la question « Comment rendre visibles les activités du MICPME
auprès des différents acteurs concernés (la Cellule de
communication du MICPME, les directeurs départementaux du
ministère, les responsables de communication des structures sous
tutelle, les agents du ministère, le monde des affaires et de
l'industrie, les jeunes créateurs d'entreprises, les associations de
consommateurs, les petites et moyennes entreprises) ? ». Pour
répondre à ces préoccupations, nous avons choisi
d'orienter notre recherche sur le thème « Analyse de la
politique de communication institutionnelle du Ministère du Commerce, de
l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (MICPME) ».
Pour atteindre cet objectif, ce travail s'articule autour de
trois (03) chapitres. D'abord, dans le premier, nous abordons la
présentation du cadre institutionnel et observations du stage. Ensuite,
dans le deuxième chapitre, nous présentons le cadre
théorique et la méthodologie de l'étude. Enfin dans le
dernier chapitre nous faisons ressortir les limites et résultats obtenus
de la vérification des hypothèses émises. Ceci conduit
à formuler des suggestions pour un plan de communication adapté
aux attentes des cibles.
|
CHAPITRE I : PRESENTATION DU CADRE
INSTITUTIONNEL ET
OBSERVATIONS DU STAGE.
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
4
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
5
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
1.1. Présentation générale du MICPME et
de la Cellule de Communication 1.1.1. Présentation
générale du MICPME
Les sous-secteurs Industrie et commerce ont toujours
cohabité. Déjà en 1967, ils étaient annexés
au Ministère des Finances, des Affaires Economiques et du Plan (MAEP).
Au fil du temps, le volet commerce a été écarté de
celui de l'Industrie pour donner naissance au Ministère de l'Industrie,
de l'Energie et des Mines (MIEM). Par la suite, ce département est
devenu successivement Ministère de l'Industrie, des Petites et Moyennes
Entreprises (MIPME) puis Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du
Tourisme (MCAT).
Dans les années 2000, il est devenu Ministère de
l'Industrie et du Commerce et de la Promotion de l'Emploi (MICPE). Il a
été amputé du volet « Promotion de l'Emploi » et
est devenu Ministère de l'Industrie et du Commerce conformément
au décret n°2006-178 du 08 février 2006 portant composition
du gouvernement. A partir du 27 octobre 2008, les volets « Commerce »
et « Industrie » sont de nouveau séparés. Le
Ministère a changé encore de dénomination pour devenir
Ministère de l'Industrie, du Commerce, des Petites et Moyennes
Entreprises. Le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Petites et
Moyennes Entreprises a pour mission de concevoir et de mettre en oeuvre la
politique du Gouvernement dans les domaines de l'industrie, du commerce, et de
la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et du secteur privé. Il
a, entre autres, pour attributions9 de :
? définir, en liaison avec les autres ministères
et sous son contrôle, la politique commerciale ;
? contribuer à l'amélioration continue de
l'environnement réglementaire, institutionnel et économique des
entreprises et de l'investissement dans le domaine du commerce en relation avec
les autres ministères concernés ;
? contribuer à l'adoption d'une fiscalité et/ou
parafiscalité favorable au développement des entreprises
commerciales ;
? appuyer le développement du secteur privé
commercial, en relation avec le ministère en charge du
développement (promotion du développement des filières
9DECRET N° 2009-179 du 05 Mai 2009 portant
attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de
l'Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
6
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
d'exportation porteuses notamment le Karité, l'Anacarde
et l'Ananas. Ces actions sont entreprises par l'Agence Béninoise de
Promotion des Echanges Commerciaux, en vue de booster les exportations,
dynamiser les échanges commerciaux et contribuer à la croissance
économique et à la réduction de la pauvreté);
? contribuer à éliminer les obstacles d'ordre
administratif, technique et logistique qui entravent le développement
des entreprises commerciales. (La loi 90-005 du 15 mai 1990 fixant les
conditions d'exercice des activités du commerce en République du
Bénin). Cette loi a marqué le libéralisme
économique est toujours en vigueur. Elle affirme la non-discrimination
entre les opérateurs économiques publics et privés et ceux
nationaux et étrangers en matière de conditions d'installation et
d'exercice des activités de commerce. Cette loi a permis aussi de lever
de nombreuses contraintes qui pesaient sur les activités commerciales)
;
? contribuer à la suppression des obstacles politiques
et réglementaires qui entravent les initiatives locales dans les
domaines du Commerce. (Une série de formations est organisée au
profit des promoteurs des petites et moyennes entreprises. Ces formations
initiées par l'ANPME permettent d'outiller les chefs d'entreprises et
leur personnel en vue de l'amélioration de la gouvernance de leurs
entreprises. Elles amènent aussi les dirigeants d'entreprises à
améliorer la qualité de leurs produits et contribuer à
l'accroissement du chiffre d'affaires des PMEs) ;
? contribuer à assurer la cohérence des
politiques notamment de communication qui sont menées dans les autres
secteurs avec celles qui relèvent du MICPME;
? contribuer à la prise des mesures les plus idoines
par le gouvernement dans le cadre de la promotion des produits béninois
à l'extérieur (L'Agence Béninoise pour la promotion des
échanges commerciaux (ABePEC) est chargée de promouvoir les
échanges commerciaux entre le Bénin et le reste du monde.
L'Agence a également pour objectif de contribuer à faire des
activités commerciales le moteur de la croissance. Et dans ce cadre,
plusieurs activités ont été menées pour favoriser
l'accroissement du volume d'exportation de nos produits. Aujourd'hui, ce sont
les filières, anacarde, ananas, et beurre de karité qui sont
valorisées à l'extérieur et qui ont surtout attiré
les investisseurs des pays tels que le Vietnam et la Malaisie).
L'interprétation simultanée de ces dispositions
de mission et d'attribution, au regard de l'importance des besoins, a
poussé le MICPME à entreprendre des actions de communication
nécessitant un appui extérieur aux initiatives et actions de la
Cellule de
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
7
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
communication. Ces actions ont abouti, d'une part à la
réalisation d'un site Internet du Ministère et d'autre part
à un appel d'offre pour la conception et la réalisation d'une
stratégie de communication globale au regard des nouveaux défis
du ministère.
Le ministère du commerce dispose de :
· quatre (04) services qui lui sont directement
rattachés. Il s'agit de : le Cabinet du Ministre, le Secrétariat
Particulier, la Cellule de Communication, et l'Inspection
Générale du ministère ;
· un Secrétariat General. Le Secrétariat
Général du Ministère est l'organe exécutif de la
mission de transformation de la vision du Gouvernement en résultats pour
les citoyens. Il assure la continuité de l'Administration et des
Organismes sous tutelle du Ministère;
· quatre Directions Centrales : Direction des Ressources
Humaines (DRH), Direction des Ressources Financières et du
Matériel (DRFM), Direction de la Programmation et de la Prospective
(DPP), la Direction de l'Informatique et du Pré-archivage (DIP) ;
· quatre Directions Générales (la
Direction Générale du Commerce Intérieur (DGCI), la
Direction Générale du Commerce Extérieur (DGCE), la
Direction Générale du Développement Industriel (DGDI), la
Direction Générale des Petites et Moyennes Entreprises et du
Secteur Privé (DGPME/SP). Placées sous l'autorité directe
du Secrétaire Général, les Directions
Générales assurent l'exécution d'une ou de plusieurs
missions essentielles connexes dont l'accomplissement nécessite un
regroupement administratif et organique. A ce titre, elles coordonnent les
activités des Directions Techniques qui relèvent de leur domaine
de compétence
· cinq Directions Techniques (DPCI, DCLF, DPCE, DRCRI,
SP/ACP- UE)
· des Directions Départementales (douze au total)
du Commerce et de l'Industrie. Le Ministère de l'Industrie, du Commerce
et des Petites et Moyennes Entreprises dispose dans chaque département
territorial d'une structure déconcentrée appelée Direction
Départementale de l'Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes
Entreprises. Elles sont chargées, au niveau départemental de ;
- coordonner, de contrôler et de suivre toutes les
actions de promotion des industries, du commerce et des petites et moyennes
entreprises ;
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
8
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
- suivre l'évolution du tissu industriel de
manière à orienter l'investissement en faveur de la valorisation
des matières premières locales et du développement
intégré des filières porteuses ;
- veiller au respect des textes législatifs et
réglementaires relatifs à l'exercice des activités
industrielles et commerciales ;
- informer, au niveau départemental, les promoteurs
sur les opportunités d'investissements et d'assistance technique et
financier ;
- assister les promoteurs et les collectivités locales
dans la recherche de partenariat et de sources de financement pour la
réalisation de leurs projets ;
- suivre, au plan départemental, les activités
des structures de promotion des petites et moyennes entreprises pour une
synergie des actions ;
- appuyer les entreprises en voie de constitution ou
d'installation au niveau départemental ;
- encourager la création des associations de
consommateurs et de les assister dans leur mission de défense des
intérêts des consommateurs ;
? des Organismes sous tutelle et des Organes consultatifs et
délibératifs nationaux.
Ces différentes directions veillent à assurer
une cohérence entre les objectifs à atteindre et les missions du
MICPME en déterminant les réelles attentes des cibles
visées. Faisons remarquer que le rattachement direct de la Cellule de
communication au sommet du ministère lui confère une position
stratégique en matière de prise de décisions sur la mise
en oeuvre de la politique commerciale du gouvernement.
Le MICPME initie plusieurs actions ayant pour objectifs de
promouvoir les PME, les secteurs de l'industrie et du commerce d'une part, de
défendre les intérêts des différents acteurs du
secteur et régulariser les activités commerciales d'utre part.
Nous retenons :
- l'établissement des cartes professionnelles aux
commerçants ;
- le contrôle de la qualité des produits mis sur
le marché. Le gouvernement s'est rendu compte que plusieurs produits
sont déversés sur nos marchés sans aucun respect des
normes. Mieux, certains commerçants indélicats livrent une
concurrence déloyale à leurs pairs. Ainsi pour mettre un terme
à ce désordre, il a été institué en
septembre 2006 et par un arrêté interministériel n°
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
9
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
93/MICPE/MDEF/MDN/DC/DGDDI/DGID/DGGN/SA la Brigade de lutte
contre la fraude commerciale et la conccurence déloyale ;
- les opérations de vulgarisation des textes par la
sensibilisation et les communiqués ; - le suivi de la vente des produits
pétroliers et du ciment ;
- le contrôle des dépôts clandestins de
ciment ;
- formation des opérateurs ;
- rencontre d'échange avec les commerçants, les
ONG, les groupements de femmes ;
- du 25 au 31 mars 2009, une délégation
d'exposants béninois a été conduite à Niamey par le
ministre du commerce dans le cadre de l'orgnisation des journées
commerciales béninoises au Niger. Cette foire a permis de vendre les
produits « Made in Bénin » aux populations du Niger et des
autres pays voisins ; l'édition 2013 de la Foire internationale de
l'indépendance, qui s'est déroulée du 19 au 4 août
2013 à Cotonou a aussi permis aux visiteurs d'apprécier la
qualité et la diversité des produits « Made in Benin
»
- Dans la mise en oeuvre du programme de relance du secteur
privé pour la promotion des produits tissés à la main et
de folklore sous la loi AGOA, le gouvernement béninois à travers
le Ministère du commerce a mené des actions (mise à
disposition des artisans des équipement et des matières
premières, conseils en vue d'accroitre leur potentiel à
l'exportation par la promotion de l'industrie artisanale béninoise) en
direction des artisans. Des appuis qui permettent aujourd'hui aux artisans
béninois d'être techniquement et qualittivement compétitifs
sur le marché américain ;
- Validation du plan de developpement du secteur privé
2014-2020. Trois orientations stratégiques et planifiées se
dégagent de ce document : l'amélioration de l'environnement des
affaires, l'accroissement des capacités d'auto-développement des
activités privée et la dynamisation de l'appui au secteur
privé.
L'organigramme du MICPME présente bien les liens entre
ces différents services. (Cf. Annexe N°2). Parmi l'ensemble de ces
services, la cellule de communication nous intéresse le plus. En effet,
nous avons effectué notre stage dans ce service qui constitue l'un des
piliers de la promotion des activités du ministère.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
10
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
1.1.2. Présentation de la Cellule de Communication.
La Cellule de Communication représente l'une des
unités principales du MICPME. Elle est chargée de concevoir, de
mettre en place et de gérer la communication au sein du Ministère
du Commerce sous l'autorité du ministre. Il s'agit de :
· la définition de la stratégie de
communication ;
· valoriser les actions du ministère, tant à
l'interne qu'à l'externe ;
· concevoir/piloter ou coordonner les outils et actions au
service de cette stratégie ;
· accompagner la politique événementielle du
ministère ;
· conseiller et accompagner les composantes du
ministère dans l'élaboration de leurs actions de communication
;
· travailler en réseaux avec les partenaires
privilégiés du ministère ;
· assurer les relations avec les medias
(communiqués et dossiers de presse, conférences de presse,
réponses aux demandes des journalistes) ;
· participer à l'animation éditoriale du
site web, et à la diffusion des informations via divers medias
numériques (réseaux sociaux, blog et newsletters,
télévisions) ;
· gérer les commandes et la diffusion à
l'effigie du ministère.
Les actions de communication sont initiées par les
directions et structures concernées. La cellule de communication
suggère un plan de communication pour l'action définie et
s'occupe de la couverture médiatique. Au cours d'un entretien avec le
Chef de Cellule de Communication M. Pierre MATCHOUDO, nous
avons subdivisé ces actions en plusieurs axes décrites ci-dessous
:
Premier axe : développement d'une identité
visuelle
L'identité visuelle est l'ensemble des signes qui
permettent de reconnaître du premier coup d'oeil une organisation.
Celle-ci comprend, outre le logo qui en est la partie la plus visible, un
ensemble de caractéristiques graphiques, déclinées de
façon cohérente et systématique sur tous les supports. La
Charte graphique vient d'être réalisée. Il reste à
présent à amener l'ensemble des structures du ministère
à l'intérioriser et à mettre en application les
recommandations qui y sont contenus. Il s'agit, pour ce faire, de:
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
11
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
· adopter et utiliser la charte graphique pour tout
document à usage interne et externe ;
· amener les structures sous tutelle et les directions
centrales à positionner le logo du ministère avant le leur sur
les affiches, roll-up, dossiers de presse, etc. de sorte à ce que le
public puisse établir, au premier coup d'oeil, le lien de filiation
entre la structure et le ministère ;
· multiplier les bâches institutionnelles en vue
de leur utilisation lors de tous les événements publics
organisés par le ministère et ses démembrements ;
· changer le panneau d'identification à
l'entrée du ministère ;
· changer les panneaux d'identification des structures
sous tutelle ;
· réaliser des autocollants à apposer sur
les véhicules du ministère ;
· réaliser de gadgets à l'effigie du
MICPME : stylos, sacs, T-Shirts, etc. ;
· réaliser des chemises dossiers ;
· réaliser des dépliants (à
utiliser lors des déplacements à l'extérieur du
Bénin et dans les points d'entrée du pays).
Deuxième axe : communication en direction des
institutions
Cette activité consiste en l'édition et la
distribution d'un magazine sur papier glacé. La Cellule de Communication
conçoit et publie périodiquement un magazine d'informations nomme
« L'univers des Echanges ». Le public visé à travers
cette activité est constitué de l'ensemble des institutions de la
République, notamment l'Assemblée Nationale d'une part, et de
l'autre, les partenaires techniques et financiers ainsi que les
investisseurs.
Troisième axe : couvertures
médiatiques
Le mode de communication ici est l'utilisation abondante des
mass médias, notamment la télévision, la radio et la
presse écrite. Hormis la Radio Nationale qui, de temps à autre,
adjoint un de ses journalistes à l'équipe de la
télévision, le ministère est absent sur les antennes des
autres médias audio si ce n'est pour la grogne et la revue de presse. Il
convient de corriger cette situation en entrant en partenariat avec des
radiodiffusions de la place. Ces radios sont sélectionnées sur la
base de leur audience et de leur grille de programmes. Pour ce qui concerne les
activités menées à l'intérieur du pays, la Cellule
de Communication a souvent sollicité les radios locales. En ce qui
concerne les télévisions, la
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
12
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
signature d'un nouveau contrat a eu lieu le 1er
Avril 2014. Quant à la presse écrite, 4 journaux ont
été sélectionnés pour des contrats de partenariat
et 10 pour de simples abonnements.
Quatrième axe : veille
médiatique
La veille médiatique consiste en une gestion proactive
des relations avec la presse. Elle vise à dissuader les médias
à publier des informations pouvant porter atteinte à l'image du
ministère. La veille médiatique observée par la Cellule de
communication a déjà porté des fruits car, à
l'exception de quatre (04) articles publiés par des organes de faible
audience, toutes les autres publications faites en six (06) mois par les
médias, notamment écrits, sont plutôt allés dans le
sens de la mise en exergue des actions de l'Autorité à la
tête du MICPME. Il en est également de même en ce qui
concerne les émissions de grande écoute au niveau des
médias audiovisuels. Pour ce faire, la cellule de communication doit :
rester proactive ; prêter une attention aux besoins en information des
journalistes et organiser des déjeuners informels avec les acteurs de
médias ciblés.
Au nombre des réalisations de la cellule de
communication, on peut citer :
· Les contrats de partenariat avec la presse écrite
privée ;
· La couverture médiatique des activités
prévues au PTA du Ministère ;
· La mise à disposition des informations à
travers des interviews demandées par la presse écrite et
audiovisuelle ;
· La réalisation de la charte graphique du
ministère ;
· La confection de stands MICPME ;
· La confection de bâches institutionnelles ;
· L'élaboration de plans de communication
spécifiques aux activités sectorielles des directions et
structures.
La réalisation de ces actions n'est pas sans
difficultés. La cellule n'a pas pu signer un nombre important de
contrats de partenariats avec les médias. Elle est en partenariat avec
deux télévisions, une radio et quatre presses écrites, ce
qui est insuffisant. La mise en oeuvre de la charte graphique n'a pas connu une
réussite totale et l'impression des éléments
d'identification visuelle s'est fait en nombre insuffisant.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
13
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
Le budget de la Cellule de Communication n'est pas du tout
conséquent (24 millions au lieu de 200 millions prévus pour faire
fonctionner la Cellule de Communication, soit près d'un dixième
du budget total, ce qui ne permet pas d'assurer une communication efficace
pendant la mise en oeuvre du pan de communication, ce qui ne favorise pas
l'exploitation de tous les moyens disponibles en vue d'un résultat
positif).
La Cellule de Communication est composée de :
? un secrétariat qui s'occupe du
courrier de la cellule, de ses communications téléphoniques, de
la rédaction des comptes rendus de réunions et de la gestion de
son emploi de temps;
? le bureau du Chef de la Cellule de
Communication; le chef de la cellule de communication occupe une
fonction essentielle au sein de la cellule de communication. A la fois
stratège et manager, pour faire passer les messages, il bâtit un
plan de communication annuel qui fixe à la fois les objectifs, les
cibles, les messages, et les discours à tenir mais aussi les actions
à mener et ceci dans des champs d'activités très
variés ;
? le bureau de l'attaché de presse.
Ici, l'attaché de presse du ministre et son collaborateur ont pour
rôle de promouvoir les activités du ministère auprès
des medias. Il (attaché de presse) est en constante relation avec les
acteurs majeurs du ministère afin d'avoir les dernières
informations en continu. Grâce à cette mise à jour, il
pourra répondre à toutes les questions des journalistes. Il
évalue l'impact des médias et les retombées
médiatiques grâce à un recueil des parutions dans la presse
écrite et audiovisuelle. Le bureau de l'attaché de presse
épluche quotidiennement la presse écrite et numérique pour
se tenir au courant des nouveautés susceptibles de se rapprocher ou
ayant trait au MICPME. Il élabore une revue de presse quotidienne pour
montrer l'impact qu'a eu son travail auprès des journalistes. Cette
revue est constituée de tous les articles dans lesquels figure le
ministère et qui par conséquent touchent le mode de gestion du
ministre.
L'attaché de presse organise de façon pratique
l'interaction entre les médias et le MICPME en tenant compte de la
politique de communication définie par le chef de la cellule. Il veille
à entretenir l'image de la personne du ministre. Ensemble avec le chef
de la cellule de communication, il mène une politique de veille
stratégique afin de prévenir et de contrer
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
14
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
toute action qui pourrait avoir un impact négatif sur
l'image du MICPME. Les agents de la presse (presse en général)
n'ont donc pas le droit de donner l'interprétation qu'ils veulent des
faits et formuler le message comme ils le veulent sans obtenir l'accord de leur
chef. Leur rôle est de faire passer le message que le ministère
désire faire adresser à sa cible selon les résultats
visés. Ces résultats ont pour objectif principal de donner une
meilleure image du ministère. Le MICPME se doit donc de fournir des
efforts notables dans ce sens.
? Un Photojournaliste : Il est chargé
de couvrir les tournées du Ministre en prenant des photos qu'il transmet
à l'AP et/ou au CCOM pour être à son tour transmises aux
organes de presse écrite en l'espace de 24 heures ou 48 heures au
maximum pour servir à la rédaction quotidienne. Ces mêmes
photos servent d'archives pour le Ministère.
? Un Cadreur : Il travaille en association
avec le photojournaliste. Mais parallèlement au photojournaliste, le
cadreur filme les tournées du Ministre et met le film à la
disposition de l'AP ou du CCOM pour être traité et envoyé
à aux organes de la presse audio-visuelle pour être diffusé
dans les différentes éditions de journal
télévisé.
Les missions de la cellule de communication doivent
être en cohérence avec les missions du MICPME afin d'obtenir un
impact significatif dans la mise en oeuvre de la politique de communication.
Dans le tableau ci-dessous, nous présentons les missions et
réalisations de
la cellule de communication.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
15
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU STAGE
Tableau N°1 : Missions et réalisations de la
cellule de communication.
Missions de la Cellule de Communication
|
Réalisations de la cellule de
Communication
|
- participer à la définition de la
stratégie de
|
- L'élaboration de plans de communication
spécifiques
|
communication ; valoriser les actions du ministère,
|
aux activités sectorielles des directions et
structures.
|
tant à l'interne qu'à l'externe ;
|
|
|
- Signature de contrats de partenariat avec la presse
écrite
|
- concevoir/piloter ou coordonner les outils et actions au
|
privée ;
|
service de cette stratégie ; accompagner la politique
|
|
événementielle du ministère ;
|
- La couverture médiatique des activités
prévues au PTA
du Ministère ;
|
- conseiller et accompagner les composantes et les
|
|
usagers du ministère dans l'élaboration de leurs
actions
|
- La mise à disposition des informations à travers
des
|
de communication ; travailler en réseaux avec les
|
interviews demandées par la presse écrite et
|
partenaires privilégiés du ministère ;
assurer les relations avec les medias ;
|
audiovisuelle ;
|
- gérer la photothèque et assurer des
reportages
|
- La réalisation de la charte graphique du
ministère ;
|
photographiques ;
|
|
|
- La confection de stands MICPME ;
|
- participer à l'animation éditoriale du site
web, et à la
|
|
diffusion des informations via divers medias
|
|
numériques (réseaux sociaux, blog et
newsletter,
|
- La confection de bâches institutionnelles ;
|
télévision) ;
|
|
|
Source : Notre étude.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
16
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
Les missions de la cellule de communication ne peuvent
être concrétisées que si les environnements interne et
externe sont favorables à l'atteinte des objectifs.
1.2. Observations du stage et Analyse SWOT 1.2.1.
Observations du stage
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la cellule de
communication et sa contribution à l'atteinte des missions du MICPME,
nous y avons effectué un stage de trois (03) mois du 05 janvier 2014 au
05 mai 2014.
Certaines missions nous sont confiées à savoir
entre autres : le classement des courriers ; la saisie des documents
administratifs ; l'élaboration de la revue de presse et la distribution
des journaux ; l'épluchage quotidien de la presse écrite afin de
rédiger des brèves sur les articles ayant trait au
Ministère. Pendant ce temps, nous avons relevé les informations
requises pour analyser le microenvironnement et le macro-environnement du
MICPME.
1.2.2. Analyse SWOT
L'Analyse SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities,
Threats), en français FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces) est une approche dichotomique du diagnostic stratégique. Elle
permet d'identifier d'une part dans le cadre d'une analyse interne (du
microenvironnement) les facteurs constituant des forces ou des faiblesses. De
l'autre, à partir d'une analyse externe (macro-environnement), elle sert
à détecter les opportunités ou les
menaces10.
1.3.2.1. Le macro-environnement
Le macro-environnement désigne l'environnement
général au sein duquel l'entreprise évolue. Il s'agit des
caractéristiques générales de l'économie et de la
société qui peuvent influencer l'entreprise, ici l'institution
MICPME.
10 LEHU Jean-Marc, L'Encyclopédie du Marketing ; Ed.
d'Organisation, Paris, 2014.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
17
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
Pour effectuer un diagnostic en vue d'élaborer une
stratégie de communication efficace, sont analysées les
composantes internes, puis les variables externes. L'analyse externe ou
l'analyse des opportunités et menaces issues du macro-environnement se
base sur l'utilisation du modèle PESTEL (Politique, Economique, Social,
Technologique, Environnemental, Ecologique et Législatif). Son
application au MICPME révèle les opportunités et menaces
suivants, présentés dans le tableau N°2.
L'objectif de ce modèle est d'évaluer
l'influence des facteurs externes sur le MICPME. Les domaines visés sont
:
· La politique : le MICPME ayant pour
mission entre autres la contribution à l'amélioration de
l'environnement politique et réglementaire dans le commerce, plusieurs
actions ont été menées. Les fréquents remaniements
ministériels que connait cette structure affectent également son
fonctionnement et ne concourent pas forcément à la
réalisation de ces objectifs de communication parce qu'ils ne permettent
pas d'assurer la continuité dans la mise en oeuvre de celle-ci ; chaque
nouveau bureau ayant des objectifs spécifiques.
· L'économie : le commerce
contribue en moyenne pour près de 18% à la formation du PIB du
Bénin. Mais les activités se déroulent en grande partie
dans l'informel. Le secteur informel représente environ 90% des acteurs,
généralement ambulants ou semi sédentaires.
· Le social : le comité
sectoriel de dialogue social du MICPME examine les préoccupations
liées aux conditions de vie et de travail des agents du
ministère, recherche des solutions aux différents
problèmes afin de prévenir les tensions sociales souvent à
l'origine des contre-performances voire de la paralysie au sein de
l'administration.
· La technologie : le MICPME a
adopté dans sa stratégie de communication, les technologies de
l'information et de la communication telles que l'internet en animant son site
web.
· L'écologie : Les journaux
achetés, les magazines et autres supports sont archivés mais
constituent un facteur d'influence négative puisqu'ils ne sont pas
recyclés.
· La législation : le cadre
législatif, juridique et réglementaire du commerce a subi de
profondes mutations depuis 1989. Il a été allégé de
façon significative en vue de permettre non seulement le
développement du secteur privé mais également
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
18
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
l'élimination des distorsions et entraves au commerce
existant entre nationaux et étrangers. Signalons aussi le
problème du relâchement de la régulation sur le
contrôle de qualité des marchandises importées et la
contrefaçon qui alimente la concurrence déloyale et l'exclusion
des entreprises nationales de la compétition sur le marché
national.
Il ressort de cette analyse que la principale menace qui peut
affecter les activités du MICPME notamment sa communication est le
facteur politique. Heureusement qu'il existe des opportunités à
exploiter pour atteindre ses objectifs à savoir : les accords de
partenariats économiques/commerciaux, la volonté du gouvernement
de promouvoir le secteur du commerce.
1.3.2.2. Le microenvironnement
L'analyse interne permet de recenser les forces et faiblesses
de l'entreprise dans les différents domaines de son activité.
Elle porte sur l'influence des clients, du personnel, des
partenaires et fournisseurs.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
19
PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET OBSERVATIONS DU
STAGE
Tableau N°2 : Analyse SWOT de la Cellule de
Communication du MICPME
|
FORCES/ OPPORTUNITES
|
FAIBLESSES/ MENACES
|
|
- Diffusion de l'information économique et
|
- Défectuosité des moyens roulant mis à la
disposition de la cellule de
|
|
commerciale et les opportunités d'affaires au
|
Communication
|
|
profit des opérateurs économiques
|
- L'existence de plusieurs cellules de communication au sein du
ministère
|
|
- Point régulier des activités menées par
le
|
(ce qui constitue un risque pour la cohérence de la
politique de
|
|
ministère
|
communication
|
|
- Évaluation et mise en oeuvre de la politique de
|
- La sous-estimation de l'importance de la communication par
certains
|
|
l'Etat en matière de commerce
|
responsables des directions centrales et des structures sous
tutelle (ce sont
|
|
- Promotion des filières nationales d'exportation
|
eux qui ont virtuellement les budgets de communication et tant
qu'ils ne
|
|
- Promotion des produits made in Benin
|
débloquent pas les fonds, il n'y a pas de
communication).
|
|
- Les accords de partenariats
|
- Nombre très limité de journaux ayant le contrat
d'abonnement avec le
|
|
économiques/commerciaux signés par le
Bénin
|
ministère
|
|
avec d'autres pays (Chine, ...) et l'UE (ex.
|
- L'inexistence de lignes budgétaires pour financer les
initiatives et les
|
|
accord ACP-UE, AGOA, etc.)
|
activités de la Cellule de Communication, notamment la
mise en oeuvre
|
|
- Programme d'appui des artisans aux opportunités
|
du Plan Triennal de Communication
|
|
de la loi AGOA
|
- L'insuffisance des moyens financiers en vue de négocier
des partenariats
avec les organes de presse
|
Source : Notre étude.
|
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIE DE
RECHERCHE.
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
20
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
21
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1. CADRE THEORIQUE
2.1.1. Problématique de la recherche
De nos jours, les questions de notoriété et
d'image sont devenues un problème très crucial pour les
institutions ou les organisations modernes. D'une part, à cause du
développement de l'économie libérale et de
l'élargissement des marchés et d'autre part des dimensions
inimaginables qu'atteint la concurrence. Cela étant, de nombreuses
institutions ont tendance à construire leur identité propre afin
de se distinguer des autres à travers un dispositif communicationnel qui
sous-entend la manière de communiquer sur l'entreprise elle-même
et sur ses valeurs. L'insuffisance de moyens financiers permettant de mettre en
oeuvre un plan de communication, l'inexistence de lignes budgétaires
pour financer les activités de la cellule de communication ainsi que
l'existence de plusieurs cellules de communication au sein du MICPME sont
autant de difficultés que rencontre le ministère. Ce qui nous
conduit à nous poser la question « comment rendre visibles les
activités du MICPME auprès de ses différents publics
cibles ? »
Parmi toutes les problématiques posées au MICPME
notamment concernant les missions de la cellule de communication, celle
relative à la visibilité des actions/activités nous
intéresse. En effet, toute entreprise qui se veut dynamique,
compétitive et au service du développement doit disposer d'une
bonne stratégie de communication, un atout majeur qui prend en compte la
bonne circulation des informations aussi bien à l'interne qu'à
l'externe, de manière efficace et efficiente en vue de réaliser
ses objectifs. Un service de communication est destiné en
priorité aux salariés de l'entreprise, ce qui n'est
contradictoire qu'en apparence avec l'orientation commerciale donnée
à la fonction. Un des principes clés de la communication
institutionnelle est celui de la synergie entre l'interne et l'externe.
Dans le cas du MICPME, les stratégies de communication
élaborées ont pour objectifs de :
? Appuyer les actions du ministère par :
- la promotion des entreprises du secteur de l'industrie, les
importateurs, les entreprises de transformation de matières
premières, les PME ;
- le développement de relations avec les responsables
des organes de presse et associations des professionnels des media.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
22
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
? Rendre visibles les actions du ministère pour
accompagner la politique gouvernementale d'émergence du Bénin
dans les domaines concernés.
Dans la présente étude, nous envisageons de
montrer l'impact de la communication sur les activités du
ministère et de faire des suggestions pour une amélioration de
cette communication afin de rendre visibles les activités dudit
ministère. Les questions auxquelles les réponses sont
recherchées sont : Quelles sont les étapes que le MICPME doit
suivre pour améliorer sa communication institutionnelle ? Quels sont les
outils que le MICPME peut utiliser pour rendre sa communication
institutionnelle efficace ? Quel plan de communication le MICPME peut-il
adopter pour rendre sa communication institutionnelle efficace ?
2.1.2. Objectifs et hypothèses de la recherche
2.1.2.1. Objectifs de recherche
L'objectif général de la présente
recherche est de formuler des suggestions pour un plan de communication
institutionnelle adapté aux attentes des cibles du MICPME.
De façon spécifique, il s'agit de :
1. Enumérer les différentes étapes que
doit franchir le MICPME pour améliorer sa communication institutionnelle
;
2. Identifier les outils qui permettent au MICPME
d'améliorer sa communication institutionnelle ;
3. Proposer un plan de communication institutionnelle que
peut suivre le MICPME pour améliorer la visibilité de ses
actions.
2.1.2.2. Hypothèses
Conformément à l'objectif général,
l'hypothèse suivante a été retenue :
Hypothèse générale : « L'impact des
actions de communications du MICPME sur les attentes des cibles est positif
».
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
23
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Pour OS1 :
Hypothèse 1 : L'amélioration de la
qualité de l'image et de l'identité visuelle du MICPME justifie
la performance de sa communication institutionnelle.
Tableau N°3 : variables et indicateurs de
l'hypothèse N°1
|
Hypothèse n°1
|
Variables
|
Indicateurs
|
|
L'amélioration de la qualité de l'image et de
l'identité
visuelle du MICPME
justifie la performance de
sa communication
institutionnelle
|
Image
|
- Diagnostic sur
l'image
- Regard du public
|
|
Identité visuelle
|
- Etude du problème
visuel
- Elaboration du
système visuel
|
Pour OS2 :
Hypothèse 2: La réussite de la communication
institutionnelle du MICPME est déterminée par la pertinence des
outils de communication mis en oeuvre.
Tableau N°4 : variables et indicateurs de
l'hypothèse N°2
|
Hypothèse n°2
|
Variables
|
Indicateurs
|
|
La réussite de la
communication
institutionnelle du
MICPME est déterminée par
la pertinence des outils de communication mis en oeuvre
|
Discours institutionnel
|
- Présentation de
l'institution
- Réalisation et
ressources
|
|
Relations publiques
|
- Rapports de
confiance
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
24
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Pour OS3 :
Hypothèse 3: La performance de la communication
institutionnelle du MICPME dépend de l'efficacité de son plan de
communication.
Tableau N°5 : variables et indicateurs de
l'hypothèse N°3
|
Hypothèse n°3
|
Variables
|
Indicateurs
|
|
La performance de la
communication
institutionnelle du
MICPME dépend de
l'efficacité de son plan de
communication
|
Objectifs
|
- Cohérence des
actions
- Suivi, contrôle,
évaluation
|
|
Moyens
|
- Médias
- Hors médias
|
2.1.2.3. Synthèse des objectifs et des
hypothèses de recherche
Le tableau N°3 fait la synthèse relationnelle des
objectifs, les hypothèses, et résultats attendus de la recherche.
Elle précise aussi les variables nécessaires pour les
différentes analyses.
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Tableau N°6 : Synthèse relationnelle des
objectifs, hypothèses et résultats attendus de la recherche
|
N°
|
Objectifs
|
Hypothèses
|
Résultats attendus
|
Variables
|
|
GENERAL
|
L'objectif général de la présente
recherche est de formuler des
suggestions pour un plan de
communication institutionnelle
adapté aux attentes des
cibles du MICPME.
|
L'impact des actions de
communications du MICPME sur les attentes des cibles est
positif
|
Un plan de
communication adapté
aux attentes des cibles
|
- Observation
- Pilotage
|
|
SPECIFIQUES
|
1
|
Enumérer les différentes étapes que doit
franchir le MICPME pour
améliorer sa communication
institutionnelle
|
L'amélioration de la qualité de
l'image et de l'identité visuelle du MICPME justifie la
performance de sa communication institutionnelle
|
Les étapes de la
communication
institutionnelle sont
présentées
|
- Image
- Identité
visuelle
|
|
2
|
Identifier les outils qui permettent
au MICPME d'améliorer sa
communication
institutionnelle
|
La réussite de la communication institutionnelle du
MICPME est déterminée par la pertinence des outils de
communication mis en oeuvre
|
Les outils de la
communication
institutionnelle sont
présentés
|
- Discours
institutionnel
- Relations
publique
|
|
3
|
Proposer un plan de communication institutionnelle que peut
suivre le
MICPME pour améliorer la
visibilité de ses
actions
|
La performance de la
communication institutionnelle du MICPME dépend de
l'efficacité de son plan de communication
|
Un plan de
communication adapté
aux attentes des cibles est
proposé
|
- Objectifs
- Moyens
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
25
Source : Notre étude.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
26
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
L'identification des objectifs et la formulation
d'hypothèses conformément à ces objectifs nous permettent
d'orienter notre recherche. Pour cela, il importe d'abord de clarifier les
concepts tels que « stratégie de communication », «
communication », « communication institutionnelle », «
politique de communication », « plan de communication » et
« stratégie de communication ». Il importe également de
faire le point des travaux antérieurs pour situer la présente
recherche par rapport à l'évolution dans le domaine.
2.1.3. Revue de littérature
2.1.3.1. Concept de « communication institutionnelle
»
Une institution est une organisation, c'est-à-dire un
ensemble structuré ou un système de personnes ayant des objectifs
personnels mais travaillant ensemble en vue d'atteindre des finalités
collectives et cela grâce à une division du travail, une
hiérarchisation des responsabilités et du pouvoir, l'existence
d'un centre de contrôle, de mécanismes de coordination et de
fonctionnement et la mobilisation de ressources et de techniques. Elle a une
personnalité morale. Exemples : organisation politique,
économique, administrative, religieuse, non gouvernementale,
collectivité locale, association formelle, programme ou projet. D'un
point de vue fonctionnel, une institution comprend généralement
une direction ou sommet (orientation stratégique), une ligne
hiérarchique plus ou moins longue (encadrement) et une base
opérationnelle (opérations), avec, en appui, des fonctions
d'ordre logistique et technique.
Toute institution a besoin de communiquer aussi bien en
interne (ce sont les échanges avec ses membres et entre ceux-ci) qu'en
externe (c'est-à-dire avec son environnement). La communication (ou
l'information transmise) au niveau d'une institution peut être :
- formelle (officielle) ou informelle (non officielle) selon la
source et/ou le circuit ; - ascendante, descendante, horizontale ou diagonale
selon le sens ;
- opérationnelle (destinée à
l'exécution des tâches), motivationnelle (elle favorise
l'intégration de l'individu et sa motivation au travail), du personnel
(liée à la carrière et l'évolution professionnelle)
et générale (information générale).
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
27
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
On désigne par communication institutionnelle toute
action de communication qu'entreprend une institution en direction d'un public
interne ou externe et visant à atteindre des buts qui lui sont
favorables : son image, sa mission, ses valeurs, ses activités, ses
produits ou réalisations, etc. Autrement appelée communication
d'entreprise ou communication corporate, la communication institutionnelle tend
son approche à l'institution de par sa notion d'autorité. Cette
entité sous-entend les pouvoirs publics, nationaux, locaux...
Selon Lucien SFEZ (1993, p.1477) la communication
institutionnelle est par contre non marchande. L'entreprise se contente avant
tout de parler d'elle -même. Ce qui revient à dire, sur sa nature
spécifique, sur sa légitimité, ses principes, sa
personnalité, son projet, son choix, ses objectifs, ses actes, ses
performances. Sur le plan externe, son souci primordial est de faire connaitre
l'organisation, identifier ses activités et donner une bonne image
d'elle à ses publics (clients potentiels, fournisseurs, banquiers,
futurs actionnaires). Par contre, en interne, elle tient à exprimer de
la sorte sa légitimité économique sociale ; affirme
Bernard LAMIZET (1997, p.131).
De manière un peu plus détaillée, elle vise
entre autres :
- à bâtir un capital confiance et un capital
sympathie. Cela est particulièrement déterminant pour les
institutions intervenant dans des domaines concurrentiels, où les
adversaires sont actifs et puissants (santé reproductive et sexuelle des
adolescents, promotion de l'égalité entre les sexes par exemple)
; à ce niveau, elle aide l'institution à se bâtir une image
forte qui permet de faire face à ses adversaires et de se positionner
comme partenaire crédible des décideurs et des bailleurs de fonds
;
- à faire en sorte que l'institution soit comprise,
soutenue et défendue en cas de crise ;
- à favoriser l'esprit de corps, la cohésion
interne, le partage de valeurs communes aux membres de l'institution (voire une
culture commune), la motivation des membres, leur accès à
l'information et leur participation à la circulation de l'information
dans l'institution ;
- à contribuer à la mobilisation de fonds et de
ressources auprès des autorités, des bailleurs de fonds ou du
public.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
28
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Une institution au service du public doit veiller à son
image non seulement à travers ses actes et prises de position mais
également en communiquant : en effet, comme ne cessait de le
répéter aux chefs d'entreprise un pionnier de la communication
institutionnelle, Michel FROIS (2000, p.3)"si vous ne dites pas ce qu'est votre
entreprise, d'autres diront ce qu'elle n'est pas".
Plusieurs stratégies peuvent être utilisées
à ce niveau. C'est le cas des :
- stratégies de puissance (l'institution est
positionnée comme particulièrement significative dans son domaine
et dans son environnement) : "le numéro 1 des grandes écoles"
;
- stratégies d'efficience (insistance faite sur les
performances et l'utilité de l'institution) : "l'établissement de
référence" ;
- stratégies de confiance (crédibilité,
fiabilité, rigueur, équité, bonne gouvernance...) : "la
maison de verre".
Pour bâtir une communication institutionnelle efficace
d'une institution, il convient de faire au préalable une bonne analyse
de la situation ou un audit.
2.1.3.1.1. Etapes de la communication institutionnelle
Pour faire la communication institutionnelle, il faut au
préalable étudier la situation de l'entreprise partout sur les
points suivants: l'image de l'entreprise, l'audit et l'identité
visuelle. Après cette étude, on élaborera une
stratégie en trois phases: la phase d'investigation, de réflexion
et d'action.
a. L'image de l'entreprise
L'image de l'entreprise est l'une de deux dimensions de la
notoriété d'une entreprise. La notoriété est
composée de l'identité et l'image. A défaut de
connaître une entreprise ou une institution, on en a une perception plus
ou moins nette, plus ou moins complète. C'est ça l'image. Elle
comporte deux éléments selon Hervé Collet, « le
degré de connaissance que l'on a l'identité de l'entreprise
». Ce sont souvent des bribes, correspondant plus ou moins à la
réalité...»
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
29
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
L'image est la représentation qu'a le public de
l'entreprise à travers les différents « signes » que
celle-ci émet, c'est à la fois l'élément le plus
tangible. C'est celui qui a la plus forte persistance. Cette image de
l'entreprise comporte quatre connotations :
- Institutionnelle - Professionnelle - Relationnelle -
Affective.
L'image institutionnelle s'envisage à l'échelle
du pays d'une part et d'autre part, du grand public et de diverses
catégories d'individus qui le composent. L'image professionnelle est un
métier de l'entreprise et à l'esprit dans lequel elle l'exerce.
L'image relationnelle se développe à travers les contacts qu'elle
entretient avec ses diverses catégories d'interlocuteurs. Et l'image
affective correspond à la qualité des liens qui attachent les
publics à l'entreprise, c'est le capital sympathie que cette
dernière saura susciter ou accumuler. Cette image on l'étudie
sous deux facettes : la première est l'image que les dirigeants ont de
leur institution. Ceci leur permet de dire que la perception qu'en ont les
autres est fausse, déformée, incomplète ou correcte et
faut être conscient que cette image, même si elle est certainement
plus proche de la réalité que celle qu'en a le public moyen,
n'est pas pour autant entièrement assimilable à l'identité
réelle de l'entreprise.
b. L'audit
La collecte des informations sur l'entreprise doit être
précédée d'un audit de la situation communicationnelle de
l'entreprise ou de l'institution. Une image perçue de manière
plus ou moins cohérente peut naître spontanément, en
particulier en interne. Sauf pour une entreprise à un audit en interne
et en externe pour vérifier s'il existe une image, et se demander
laquelle, si elle est justifiée et sur quels éléments elle
repose. Après savoir aussi par quels moyens ou canaux elle a
circulée. Après avoir fait ce diagnostic sur l'image de
l'entreprise ou de l'institution grâce à l'audit, après
avoir récolté tous les éléments sur l'image, on
passe dans le point suivant qui étudie l'identité visuelle.
c. Identité visuelle
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
30
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
La première identité de l'entreprise est celle
qui est d'abord perçue par le public et l'identité visuelle,
parfois avant même de se donner une identité tout court.
Pour créer cette identité visuelle, trois
étapes sont importantes :
- L'étude du problème visuel, de l'entreprise ou de
choix d'une ligne directive - La recherche et la conception d'une loge
- L'élaboration du système visuel.
Etudier le problème visuel de l'entreprise c'est
énumérer les facteurs qui interviennent dans l'élaboration
de l'identité visuelle pour cela, il faut prendre en compte
l'activité de l'entreprise, ses valeurs et son historique. Dès ce
moment, il est possible d'interroger des membres du personnel, des prospects
spontanés à l'évacuation de l'entreprise. Les
résultats d'une telle enquête peuvent déjà donner
des indications sur la façon dont l'entreprise est perçue, ce
qu'elle évoque pour les interviewés, les réponses
constituent les premières bases de l'image.
A partir des donnés précédentes et avec
l'aide des prestations on peut se lancer dans la recherche du logo. Dans
l'élaboration du système visuel, on dote l'entreprise d'une ligne
graphique à laquelle se conforme tout le document interne ou externe.
Pour ce faire, on élabore ce qu'on appelle une charte graphique
c'est-à-dire un document dans lequel on traite du logo, des couleurs de
l'entreprise, de la typographie de la marque. La manière
d'élaborer les entêtes ou de d peindre les véhicules de
l'entreprise doit s'y inscrire. C'est ce qu'on appelle la signature de
l'entreprise. D'autres types de supports doivent aussi être pris en
compte tels que les véhicule de la société, les badges
visiteurs, les insignes des agences, la personnalisation des tenues
vestimentaires etc. ce sont là les occasions de mettre en avant
l'identité visuelle de l'entreprise e de faire en sorte qu'elle soit de
plus en plus mémorisée par un public très large. A travers
cette identité on peut commencer à se développer la
notoriété de l'entreprise.
Plus le nombre d'individus ayant l'occasion de voir le logo et
la marque sera grand, plus la société sera connue. Inventorier
tout ce qui peut constituer un support d'identité dans l'entreprise ne
suffit pas parce que cette notoriété n'apporte aucune importance
véritable.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
31
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Cette notoriété ne sera que normative, mais sans
contenu réel. Il faut donc aller beaucoup plus loin dans la connaissance
de l'entreprise pour lui donner une véritable identité
complète, indispensable à la communication institutionnelle.
2.1.3.1.2. Les outils de la communication
institutionnelle
a. Les outils relatifs à la signature de l'institution
Ils permettent de reconnaître l'institution parmi les
autres acteurs dans son environnement. On peut citer le logotype et le
générique.
* Le logotype ou logo est un dessin unique et
spécifique qui sert de signe d'identification visuelle de l'institution.
Une fois adopté, on le retrouve sur tous les supports produits par
l'institution (papier à lettre, cartes professionnelles, emballages de
produits, publications, messages, etc.). Un bon logo est prégnant
(perçu comme un tout et bien distinct des autres
références visuelles), facilement compréhensible
(signification claire) et mémorisable, congruent (en relation logique
avec l'institution) et durable (assez stable dans le temps). Sa conception est
le fait du graphiste ou du designer qui devra prendre le temps de
connaître et comprendre l'institution.
* Le générique, jingle ou bande-annonce
personnalisée est un signe sonore (un bref morceau musical) qui annonce
l'institution. Il est utilisé systématiquement pour introduire et
conclure les productions sonores ou audiovisuelles de l'institution. Il est
très utile pour fidéliser les audiences, notamment à
l'occasion des campagnes.
b. Le discours institutionnel
Il s'agit des outils qui parlent de l'institution, la
racontent ou la font parler. C'est notamment le cas de la vidéo
institutionnelle qui est une carte de visite en images : elle présente
l'institution, ses objectifs, ses activités, ses réalisations et
ses ressources. Elle peut être utilisée comme un support de
communication dans le cadre de manifestations telles qu'une conférence
de presse, une conférence internationale ou une exposition. Une bonne
vidéo institutionnelle doit informer (le contenu doit apporter quelque
chose de nouveau à la cible visée et être exact), raconter
(le récit doit être bien construit, le contenu peut être
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
32
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
scénarisé), attrayante (esthétique,
humour, excellente qualité technique) et viser un but précis
(exemple : mobilisation de fonds, présentation des activités de
l'institution à des leaders d'opinion, etc.). A côté ou
à la place de la vidéo, on peut développer un
dépliant, une brochure, une page Web, un document de PréAO.
c. Le bulletin institutionnel
Un bulletin institutionnel peut avoir une mission :
- d'information (stratégie de l'institution,
évolution du secteur d'invention, problèmes rencontrés,
résultats atteints, nouveaux partenariats, perspectives...) ;
- d'ouverture (actualité, thèmes
généraux, nouveaux domaines) ;
- de décloisonnement interne (vie des subdivisions,
activités parallèles, carnet du personnel) ;
- de dialogue et d'échange (libre expression,
débats, échange d'expérience, leçons apprises) ;
- de reconnaissance (mise en lumière d'acteurs, de
services, etc.).
Il peut avoir une vocation interne (membres de
l'institution), externe (public externe et partenaires) ou mixte.
d. Le parrainage
Le parrainage est le terme générique qui
recouvre les actions de sponsoring et de mécénat. On parle de
sponsoring lorsque l'institution parrainante attend des retombées
d'ordre commercial grâce au lien établi entre son image et l'objet
sponsorisé (fréquent en sport) et de mécénat
lorsque l'acte est gratuit (cas des activités culturelles ou
humanitaires). L'institution peut en tirer les bénéfices suivants
: renforcer sa notoriété, susciter de la sympathie, rajeunir son
image, etc. Pour cela, il faut que l'appui de l'institution soit connu et
clairement inscrit sur les banderoles, les panneaux, le catalogue de
présentation ou programme de l'événement par exemple.
Le parrainage peut se faire sous la forme d'un soutien
logistique (fourniture de tout ou partie du matériel nécessaire
à la manifestation), financier et technique (fourniture d'un
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
33
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
savoir-faire). Il peut se faire en association
(co-parrainage). Le parrainage efficace va de pair avec de bonnes relations
presse (les médias devant s'en faire l'écho).
e. La communication événementielle
Elle consiste à organiser un événement
ou à profiter d'un événement existant pour faire de la
communication institutionnelle. On peut citer les journées « portes
ouvertes », les expositions, les visites guidées, les galas et les
manifestations sportives et culturelles d'une part, les journées et
autres manifestations internationales d'autre part. Un dossier de presse
mettant en relief la situation actuelle, le bilan des activités
réalisées, les défis relevés, les progrès
accomplis et les perspectives devrait être systématiquement
réalisés à l'occasion de chaque événement.
C'est une bonne opportunité pour les réseaux et alliances de
mettre en évidence leur travail commun. La communication
événementielle impose de travailler avec les mass-média
et, en milieu péri- urbain, rural et traditionnel, avec les
communicateurs locaux qui peuvent jouer un rôle similaire à celui
des médias modernes, mutatis mutandis, et mobiliser la communauté
et ses leaders. Il existe des agences spécialisées en
organisation d'événements.
f. Les relations avec la presse
Les médias sont des partenaires incontournables des
communicateurs institutionnels. La collaboration avec les médias peut
prendre plusieurs formes. En effet, on peut :
- les organiser : réseau, syndication (groupe de
médias collaborant dans la production et/ou la diffusion de contenus)
;
- les renforcer : formation des professionnels,
équipement, fongibles, collaboration, sponsoring d'émissions,
documentation, appui à la création, prix, etc.
- établir des rapports de confiance
privilégiés ;
- utiliser les outils appropriés : communiqué de
presse, conférence ou point de presse, interview, dossier de presse,
publi-rédactionnel, prêt-à-diffuser, voyage d'information,
briefing, article...
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
34
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1.3.2. Concept de « Politique de communication
»
On appellera politique un ensemble de décisions et de
règles de conduite adoptées à l'avance, pour une certaine
période de temps, en vue d'atteindre certains objectifs
généraux. C'est dans ce sens, par exemple que l'on parle
habituellement de « politique de l'emploi ou de « politique de
formation », et dans le domaine du marketing, de « politique de
produit », de « politique de prix », de « politique de
communication » ou de « politique de distribution ».
Par politique de communication d'une entreprise (Lendrevie et
al., 2009, p.459), on entend les informations, les messages et autres signaux
que l'entreprise décide d'émettre volontairement en direction des
publics choisis ou publics cibles. La politique de communication des
entreprises met en oeuvre de multiples moyens ; la publicité par mass
media, à laquelle on pense d'abord, en est un, mais il en existe
beaucoup d'autres, tels que le packaging des produits, les visites des
vendeurs, les opérations promotionnelles, le merchandising, les
relations publiques, les sites Web, le sponsoring, etc. En fait, toutes les
actions et manifestations visibles de l'entreprise sont potentiellement des
outils de sa communication avec le monde extérieur. Chacun de ces outils
est plus ou moins efficace selon le type de produit à promouvoir, la
nature de la cible visée, le contenu des messages à transmettre
et le budget dont on dispose.
Il est donc important, pour une entreprise :
- d'établir des priorités dans le choix des
cibles, des messages et des moyens de communication.
- d'avoir une vision globale de sa politique de communication,
afin d'assurer la cohérence et l'efficacité maximum des
différents messages et moyens de communication qu'elle utilise.
La politique de communication est un élément du
marketing mix ou marchéage (les 4P - Produit, Place, Prix, Promotion).
Elle se rapporte plus spécifiquement au 4ème P
(promotion). Mais dans le sens large des 4P, elle regroupe principalement les
actions de publicité, de marketing direct et de promotion des ventes.
Dans certains contextes, la politique de communication peut prendre un sens
plus restreint et ne désigner que la
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
35
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
politique de communication publicitaire, voire même la
communication institutionnelle (Bathelot, 2014). Une politique de communication
consiste à définir la meilleure combinaison entre tous les moyens
de communication qui sont à la disposition de l'entreprise :
information-promotion, publicité, promotion des ventes, marketing direct
(Libaert, 2005).
La communication est indispensable pour un créateur
d'entreprise afin de se faire connaître et attirer ses futurs clients.
Cette politique de communication doit prendre en compte au minimum 2
éléments :
- être adaptée à sa cible
clientèle, tant au niveau du support que du contenu. On ne communique
pas de la même manière auprès de seniors et auprès
de mères au foyer.
- elle doit véhiculer le bon message, notamment ce
« + produit » ou « + service ».
Les outils de communication sur lesquels un créateur
d'entreprise doit travailler sont :
- le nom de l'entreprise
- le logo
- la « Baseline », phrase d'accroche
- les cartes de visite
- le site Internet
Ensuite, d'autres outils peuvent être mis en place pour
communiquer :
- des plaquettes
- des flyers
- insertion dans des annuaires professionnels (pages jaunes,
annuaires spécialisés...)
- insertion dans des revues ou magazines
- une enseigne (pour les commerces)
- des mailings papiers ou des e-mailings, etc...
Il est important pour un créateur de se définir
sa politique de communication tout en se fixant un budget incompressible. Sans
communication, pas de clients. Donc si des
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
36
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
difficultés apparaissent lors des premiers mois
d'activité, il ne faut pas se laisser tenter par faire des
économies sur la communication. Trop de créateurs font ce choix,
se coupant l'herbe sous les pieds car moins de communication signifie moins de
clients, moins de chiffres d'affaires et donc plus de difficultés.
Ces trois notions que sont la stratégie de
communication, le plan de communication et la politique de communication sont
intimement liées les unes aux autres. La stratégie de
communication consiste à coordonner les actions en pour atteindre un
objectif. Le plan de communication quant à lui concrétise la
stratégie, il indique les objectifs à atteindre par la
stratégie, définit les cibles, les messages, sélectionne
et délimite les moyens en vue d'atteindre cet objectif. La politique de
communication pour finir est la mise en oeuvre de ces moyens pour atteindre
l'objectif fixé.
2.1.3.3. Concept de « Stratégie de
Communication »
Une stratégie un ensemble de moyens utilisés
conjointement en vue d'atteindre certains objectifs contre certains
adversaires. Le mot stratégie a une origine et une connotation
militaires : c'est dans le domaine de la guerre qu'il a tout d'abord
été employé par les Grecs pour désigner l'action
des « stratèges », c'est-à-dire des
généraux. Dans le champ d'action du marketing, les adversaires
d'une entreprise sont ses concurrents directs ou indirects ; dès lors
que, pour atteindre ses propres objectifs, une entreprise se trouve en
compétition ou en opposition avec des concurrents, ses décisions
politiques qui sont dirigées contre eux, au moins en partie, peuvent
à juste titre être appelées stratégiques.
La stratégie de communication est l'art de diriger et
de coordonner les actions nécessaires pour atteindre ses objectifs de
communication. Elle consiste à :
- déterminer les cibles auxquelles va s'adresser la
communication
- définir le message qui va leur être transmis
- définir les objectifs de communication de
l'entreprise
- choisir des supports et canaux de communication
adaptés
- réaliser un plan de communication
- établir un budget de communication
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
37
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Elle revêt généralement la forme d'un
document écrit, simple et court (quelques pages), répondant de
manière factuelle à la question : comment atteindre (message,
médias, période active, budget) un objectif
déterminé, pour un public ciblé. Définir une
stratégie de communication est indispensable. Cela permet d'avoir une
vision globale des actions que l'on déploie (presse, publicité,
site internet, campagnes e-mailing, événementiel...) sur toute
l'année et d'en maîtriser la périodicité. Cette
démarche permet aussi d'optimiser et de contrôler ses
dépenses de communication.
Elle se déroule en trois phases.
a. La phase d'investigation
On s'efforce de collecter le maximum d'information sur
l'entreprise, sa situation commerciale, financière, sociale. On
vérifie sa position sur le marché, la nature et l'étendue
de son environnement, la perception de son image en interne et en externe et
l'importance de sa notoriété. On fait le tri des informations
positives et des informations négatives, de celles qui peuvent
être négatives pour devenir positives, de ce qui pourra être
exploité et de ce qui ne pourra pas l'être, on établit un
bilan.
b. La phase de réflexion
Après avoir vérifié si la situation
était plutôt négative ou positive, on établit un
diagnostic précis permettant d'affirmer que la situation est
récupérable ou non, que le problème relève
plutôt du domaine institutionnel ou plutôt du domaine publicitaire,
que le problème de l'intérieur ou plutôt de
l'extérieur. Après ce diagnostic, on définit les objectifs
et on détermine les cibles. Concrètement on se demande ce qu'on
doit faire à qui, comment et quand ?
c. La phase d'action
Dans cette phase on détermine l'axe de communication
qui peut se reposer soit sur la qualité de vie sur la politique ou soit
sur la culture. Après la détermination de l'axe de communication,
on élabore des thèmes des messages puis on fait le choix des
moyens
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
38
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
c'est-à-dire on choisit soit les relations presse, la
communication interne, les relations publiques, le mécénat
etc.
Après toutes ces phases, on passe au plan d'action,
c'est-à-dire on met en cohérence dans un même plan toutes
les phases et stratégies de la communication institutionnelle. La
communication institutionnelle et autre forme de communication.
Au sein de l'organisation, l'activité de la
communication institutionnelle est étroitement liée à
plusieurs autres formes de la communication:
- Le lobbying est la sensibilisation qui vise à
convaincre les responsables du gouvernement et les parlementaires de la
nécessité de modifier certaines dispositions légales ou
à mobiliser l'opinion publique à propos d'un sujet.
- Le marketing et la publicité qui visent à
convaincre le public d'acheter des produits ou des services de
l'organisation
- La communication interne qui informe le personnel sur la vie
de l'organisation et implique dans la prise de décision
- La communication scientifique et technique qui consiste
à transmettre les résultats de la recherche aux scientifiques et
d'autres acteurs
A la différence des formes de communication reprises
ci-dessus, la communication institutionnelle s'appuie essentiellement, pas
exclusivement toutefois, sur les mass médias et vise à promouvoir
l'organisation dans son ensemble. Cependant, elle est liée à
toutes ces formes de communication ais elle en dépend, les soutient et
travaille de concert avec elles.
La mise en place d'une stratégie de communication exige
des ressources et du temps. Elle peut être soigneusement planifiée
et budgétisée.
2.1.3.4. Concept de « plan de communication »
Quant au terme plan, on lui donnera ici un sens plus
précis et plus opérationnel : on appellera plan une liste
d'actions précises, assorties de leurs dates, de leurs coûts, de
la description des moyens qu'elles exigent, souvent aussi de la
désignation de leurs responsables. En d'autres termes, au sens où
nous l'entendons, un plan est, par rapport une
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
39
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
politique ou à une stratégie, ce que
l'instrumentation est par rapport à la mélodie dans la
composition musicale.
Le plan concrétise la stratégie de communication
de l'entreprise. Il en indique les objectifs, définit les messages
(promesse de la communication, formulation la plus simple possible),
sélectionne les cibles (prescripteurs, coeur de cible, cible
elle-même), délimite les moyens (presse, télévision,
affichage, radio, internet, relations publiques, marketing direct). Dans le
contexte contemporain de changement : mondialisation,
accélération des échanges, phénomènes de
crise, le plan de communication évolue. Cependant, il reste le pivot
central de toute communication d'entreprise digne de ce nom (Libaert, 2013).
Selon le même auteur, le plan de communication est le
document le plus ambitieux et le plus stratégique. Il comporte
généralement trois parties : l'étude de la situation,
l'objectif stratégique et les modalités de l'action qui
s'inscrivent dans cet objectif. Il s'agit d'un document opérationnel,
qui ne vise pas la mobilisation ou la sensibilisation mais la fixation d'un
cadre de référence pour l'ensemble des actions de communications.
Dévoilant une stratégie et visant l'exhaustivité,
comportant des références précises sur des actions
concrètes, il est de nature confidentielle et ne sera pas diffusé
en externe.
Pourquoi planifier la communication ? Plusieurs raisons
militent en ce sens (Libaert, 2013):
- elle fournit le cadre de cohérence des actions ;
- elle valorise la place de la communication dans le management
;
- elle clarifie le rôle de la communication dans
l'activité de l'entreprise ;
- elle fournit l'occasion d'un débat interne et peut
remettre en cause des choix
obsolètes ;
- elle combat l'idée d'une communication conçue
comme un outil ;
- elle permet le suivi, le contrôle et l'évaluation
;
- elle autorise l'anticipation et l'approche non réactive
;
- elle facilite la hiérarchisation des priorités
dans les actions à mener ;
- elle préserve des remises en cause ponctuelles ;
- elle légitime les allocations budgétaires lors de
nouvelles orientations ;
- elle renforce la vision à long terme ;
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
40
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
- elle évite la fragilisation du message ;
- elle contribue à valoriser le capital
réputationnel ;
- elle permet de faire gagner du temps dans les réponses
aux sollicitations externes ;
- elle permet d'éviter les conflits internes
liés aux intérêts divergents d'autres directions ;
- et enfin elle réduit le risque de crises par son
rôle dans la consolidation de l'image globale.
La communication d'entreprise recouvre un ensemble de
méthodes et d'expertises qui permettent d'atteindre les objectifs. Elle
s'organise à partir du plan de communication. Le plan de communication
se décompose en 7 phases:
- Le diagnostic: où en est la communication de mon
entreprise ?
- Les objectifs : qu'attendons-nous de la communication ?
- Les cibles et le message: à qui voulons nous parler et
de quoi?
- Les axes créatifs : comment le dire pour faire agir ?
- Les outils : quel dispositif sera le plus pertinent ?
- Le planning: comment communiquer au bon moment?
- Le budget: comment évaluer l'investissement ?
Pour Anne Gregory, l'intérêt essentiel
réside dans la proactivité rendue possible par une vision
à long terme : « Bien sûr, le travail de communication est de
répondre aux demandes médiatiques ou de réagir rapidement
face aux crises : mais il s'agit également de décider ce que vous
voulez faire, quelles actions vous voulez engager, quels messages vous voulez
mettre en avant. Planifier un programme clair et cohérent vous aidera
à accomplir cela. » (Gregory, 1996, p.50).
« L'important n'est donc pas nécessairement
d'avoir formulé un plan de communication, mais d'avoir construit une
politique de communication qui présente des principes et des
orientations générales et puisse éventuellement se
décliner en des plans spécifiques, autour de telle ou telle
facette de la communication (communication sur un projet industriel de
l'entreprise, information sur les événements personnels dans le
journal interne, instauration de groupes de résolution de
problèmes, etc.).» (Bartoli, 1990, p.131)
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1.3.5. Concept de « Communication »
Alors qu'informer vient du latin informare, donner forme,
façonner l'esprit, communiquer, du latin communicare signifie mettre en
commun, être en contact avec. La communication suppose alors des
implications subjectives nécessitant de se préoccuper des modes
de réception, d'appropriation du message. Pour Erik (2001), «
Informer est surtout du ressort de la technique, communiquer est un
problème de relations humaines »11.
Au niveau de l'organisation stricto sensu, malgré
l'infinité des définitions, nous retiendrons celle de Miege
(2001) qui nous semble la plus complète au regard de nos objectifs
d'étude. On peut en effet admettre avec cet auteur que la communication
dans les entreprises poursuit trois (03) objectifs: forger une identité
forte et valorisée de l'entreprise, aider à l'émergence
d'un nouveau management du travail et participer à la modernisation de
la production, des conditions et des structures de production.
Dans le domaine des entreprises, communiquer revient à
transmettre des informations dans le but d'obtenir de la part du prospect une
modification du comportement. Des stratégies de communication sont alors
mises en place afin de susciter un besoin au client12.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
41
11 Neveu Erik (2001), Une société de communication
? Edition Montchrestien, Collection clefs, 3è
édition, P.76
12
http://www.publika.fr/comprendre-la-communication-globale/dossier/politique-de-communication;
consulté le
19/03/2014
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
42
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Figure 1 : Les éléments de la
communication

BRUIT
EMETTEUR
CODAGE
MESSAGE
DECODAGE
RECEPTEUR
FEEDBACK
Source : Kotler et Dubois, «
Marketing Management » ; 9éme édition, p.558, 2008.
2.1.3.6. Approche théorique retenue : l'approche
systémique
Face à la diversité des discours et des
appellations, il convient de définir précisément la
communication globale afin de percevoir toute la richesse de la notion et de la
démarche qu'elle suscite. L'affirmation du rôle fondamental de la
communication d'entreprise au niveau le plus élevé conduit
ensuite à rechercher les raisons qui justifient une approche
différente de la gestion de la communication, loin de la structuration
habituelle (communication interne, communication externe...).
À l'origine, la communication globale a
été définie comme la mise en oeuvre harmonieuse de
l'ensemble des moyens (relations publiques, publicité produits,
publicité institutionnelle, information, communication interne...) pour
créer et développer une image institutionnelle. Désormais,
les auteurs s'accordent pour la considérer comme une approche
cohérente de l'ensemble des communications : institutionnelle, marketing
et interne. Elle est présentée comme une nouvelle démarche
qui repose sur trois éléments : une stratégie de
constitution et de capitalisation d'un territoire exclusif de marque ; une
politique de cohérence et de synergie des moyens ; une gestion
permanente de l'ensemble.
La présentation précédente est cependant
source de confusion dans la mesure où elle tend à
considérer l'entreprise comme une marque ; c'est pourquoi il semble
préférable d'indiquer
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
43
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
que la communication globale veille à développer
: quelques messages forts, de manière cohérente reflétant
l'identité et le positionnement de l'entreprise ; une harmonisation des
signes de l'entreprise dans le but de faciliter la reconnaissance de
l'entreprise et permettre la valorisation des communications ; une
cohérence entre les trois axes fondamentaux que sont le produit, la
marque et l'entreprise.
À travers cette définition, la communication
globale a vocation à lutter contre le désordre éventuel
des politiques, des messages et des investissements. Elle conduit alors
à gouverner l'image de l'entreprise comme une variable
stratégique de développement. Il ne doit plus y avoir de
dichotomie contradictoire entre les différentes communications, ni entre
la réalité de l'entreprise et les informations qu'elle diffuse.
L'objectif est que chaque cible comprenne la légitimité de
l'entreprise, apprécie sa raison d'être et lui trouve un
intérêt à travers un bénéfice personnel.
2.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Dans le but de disposer des informations nécessaires
à la réalisation de notre travail, nous avons adopté une
démarche méthodologique adaptée au thème de notre
étude et aux objectifs visés. Cette démarche a
été de procéder à la collecte et au traitement des
informations à travers des études documentaires. Il s'agit de
proposer un plan de communication global (média et hors média) et
d'information qui tienne compte à la fois des besoins de chacun de ces
types d'entités et des acteurs sans qu'il y ait confusion dans l'esprit
de la cible et des entités. Une enquête a été
menée suite à un échantillonnage, en prenant en compte les
résultats de l'enquête de satisfaction réalisée par
le MICPME.
2.2.1. Le modèle empirique
Le champ d'application de la politique de communication est
non seulement de faire connaître les actions du ministère et de
ses structures, mais aussi d'inscrire la mission de promotion au coeur desdites
actions, par la réalisation d'une politique d'information
destinée aux cibles nationales et internationales. Par ailleurs, face
aux types d'actions correspondant à la nature des structures et acteurs
dont il a la charge, le MICPME a des exigences particulières, notamment
en vue d'anticiper les besoins pour un meilleur
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
44
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
accompagnement. Dans ce sens, nous retenons un modèle
d'analyse des actions de communication qui synthétise les niveaux
d'évaluation du modèle systémique.
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
|
EXPERIENCE
Elaboration d'un plan de communication
institutionnelle
|
|
|
CONSTATS
|
ACTIONS CORRECTIVES
|
- Objectifs poursuivis
- Résultats effectifs
- Stratégies et moyens utilisés

- Information
- Sensibilisation
- Contrôle et régulation
REGULATEUR
- Objectifs
- Informations
- Pertinence des moyens de communication

REFERENTIELS
- Objectifs prescrits - Résultats attendus
- Stratégies et moyens prévus
|
COMPARATEUR
- Identification des attentes des cibles et des outils de
communication
- Mise en place des stratégies
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
45
Figure 2 : Modèle d'évaluation adopté
pour la présente étude
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
46
Le principe de cette boucle comparaison / régulation
est de reconstituer l'ensemble dynamique de l'activité, à travers
son analyse, et l'interdépendance avec les tâches prescrites, mais
aussi les opérations de comparaison à finalité
d'évaluation des compétences acquises et la source des actions
correctrices, c'est-à-dire les actions de communication en direction des
cibles.
Cette boucle est composée de trois processus
articulés les uns aux autres. Le premier processus de comparaison traite
les informations issues des opérations d'évaluation des
compétences : réussir de nombreuses actions différentes et
avec la bonne manière, disposer de stratégies mobilisables face
aux problèmes connus ou imprévus. La comparaison s'établit
entre des référentiels externes et des constats portant sur les
performances et les modes de réalisation des actions. L'écart
constaté entre ce qui est attendu et ce qui observé est
traité par le second processus, celui de la régulation des
apprentissages par la construction de milieux d'apprentissage et une
ingénierie de la compétence prenant appui sur des
régulations. Les actions correctrices sont mises en oeuvre. S'enclenche
alors le troisième processus de construction de compétence.
Celui-ci est conditionné par le développement d'invariants
opératoires et par la conceptualisation dans et pour l'action pour
s'adapter à la diversité des situations.
2.2.2. La méthodologie de recueil des
données
L'étude s'est appuyée sur une série
d'entretiens sur les cibles du MICPME. Chaque type de cible a été
interviewé en face à face : par questionnaires (entretien
d'environ vingt minutes). L'objet est de connaître la
notoriété du ministère, la visibilité de ses
actions et l'adéquation de la politique de communication quant aux
attentes des cibles. Les informations recueillies ont été
présentées dans des tableaux, traduits ensuite en pourcentage en
vue d'une interprétation et d'une analyse. Cette étape de la
recherche a consisté à mettre sous forme exploitable les
données recueillies sur l'échantillon afin d'effectuer une
synthèse générale et de tirer les conclusions qui
ressortent de la vérification des hypothèses. Cette étude
a été réalisée grâce au concours des
différents agents responsables des directions visitées ainsi que
des usagers du ministère. L'accès facile aux documents que nous
avons jugés utiles nous a permis la collecte de l'essentiel des
informations.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
47
Il existe trois grands indicateurs pour mesurer l'impact de la
communication à savoir13 :
- Indicateurs d'observation : ils permettent d'anticiper les
évolutions probables des comportements des différents acteurs ou
consommateurs.
- Indicateurs de pilotage : ils permettent de piloter le plan
de communication, vérifier la pertinence des actions, anticiper les
décisions et valider la conformité avec la stratégie.
- Indicateurs de rentabilité : ils permettent
d'évaluer l'efficacité et la rentabilité des outils et des
moyens de communication. Ils permettent de mesurer le ratio d'efficacité
: coût/résultat. Il s'agit de rechercher une adéquation
entre les objectifs du MICPME en termes de communication et les besoins des
cibles. Les données collectées sont qualitatives et
quantitatives, et découlent des indicateurs consignés dans le
tableau 4 ci-dessous.
Tableau N°7 : Critères et indicateurs
d'évaluation de la pertinence des actions de communication au regard des
attentes des cibles
|
Objectif
d'analyse
|
Critères
|
Indicateurs
|
|
Evaluation de
l'efficacité des
actions
de
communication
|
Pertinence : actions de communication
|
- Adéquation du plan de communication
- Adéquation entre attentes des cibles et
objectifs du MICPME
- Cohérence de la politique de communication
|
|
Efficacité :
|
- Existence des méthodes d'évaluation des
actions
- Pourcentage de satisfaction
- Atteinte des objectifs suite aux évaluations
- Adéquation des outils utilisés
|
|
Compétences mises en oeuvre
|
- Suivi effectif des cibles pour déterminer leurs
besoins
- Existence d'indicateurs permettant de vérifier
la
mise en oeuvre de la politique de communication
|
Source : Notre étude.
13
http://www.nobilito.fr/index.php/2009/03/
Comment mesurer la performance de la communication ?, livre blanc sur la
mesure de la performance de la communication, consulté le 02/10/2014.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
48
2.2.2.1. Revue documentaire
Elle consiste en l'exploitation des documents qui portent sur
la présentation et le fonctionnement du MICPME ; il s'agit plus
précisément des archives et recueils récents de la cellule
de communication et d'anciens mémoires portant sur la politique de
communication. Cette recherche nous a permis d'orienter davantage notre
travail.
2.2.2.2. Enquête
2.2.2.2.1. Phase exploratoire
Elle a duré une semaine (du 04 au 11 août 2014)
et a permis de prendre contact avec les autorités administratives, les
personnes ressources et quelques structures afin d'expliquer les motifs de la
recherche et de tester le questionnaire en vue de son réajustement.
2.2.2.2.2. L'échantillonnage
Pour mener à bien cette recherche et compte tenu de sa
spécificité, le choix des enquêtés est
aléatoire. L'enquête est effectuée dans les
différentes directions du MICPME, auprès de vingt (20) agents et
trente-cinq (35) entreprises. Le total s'élève à 55
personnes. Lors de la mise en oeuvre, nous n'avons pas connu de
difficultés majeures pour prendre contact avec les responsables. Chaque
type de cible a été interviewé en face à face :
entretien d'environ trente minutes. La collecte sur le terrain a couvert la
période du 25 août 2014 au 06 septembre 2014. D'une façon
générale, les réponses ouvertes et qualitatives ont fait
l'objet d'un tri croisé. Par contre, les données quantitatives
sont saisies, traitées et analysées à l'aide du logiciel
MS-Excel pour en déduire des tableaux. Les informations recueillies sont
traduits ensuite en pourcentage en vue d'une interprétation. Cette
étape de la recherche consiste à mettre sous forme exploitable
les données recueillies sur l'échantillon afin d'effectuer une
synthèse générale et de tirer les conclusions qui
ressortent de la vérification des hypothèses.
2.2.2.2.3. Mode de conduite des interviews
L'objet est de connaître la notoriété du
ministère, la visibilité de ses actions et l'adéquation de
la politique de communication quant aux attentes des cibles. Les entretiens
sont réalisés sur la base d'un guide d'entretien (adressé
aux responsables des structures et directions
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
49
sous tutelle) et d'un questionnaire (adressé aux
entreprises). Ces entretiens nous ont permis d'avoir des informations relatives
à la satisfaction ou non des cibles du MICPME, quant aux actions
menées.
2.2.2.3. Méthode de vérification des
hypothèses
L'hypothèse générale de recherche
énoncée selon laquelle « L'impact des actions de
communications du MICPME sur les attentes des cibles est positif » est
vérifiée à travers les hypothèses qui en
découlent.
2.2.2.3.1. Méthode de vérification de
l'hypothèse H1
L'hypothèse H1 stipule que « L'amélioration
de la qualité de l'image et de l'identité visuelle du MICPME
justifie la performance de sa communication institutionnelle ».
Dans cette hypothèse, la performance de la
communication institutionnelle est la variable expliquée. La
qualité de l'image et de l'identité visuelle sont les variables
explicatives.
A l'aide des données de l'enquête, nous avons
calculé les fréquences relatives à divers indicateurs de
ces variables.
Les questions relatives à l'efficacité des
actions entreprises par le MICPME traduisent la qualité de l'image et de
l'identité visuelle. Leur adéquation ou leur réponse aux
attentes des cibles correspond à la performance de la communication
institutionnelle. Les fréquences y afférentes seront
comparées entre les deux types de variables, en termes de
concordance.
Règle de décision
A une fréquence élevée de la
modalité « bon » ou « positif » d'une variable
explicative, correspond une fréquence élevée de la
modalité « bonne » de la variable expliquée. Une
fréquence est jugée élevée lorsqu'elle est de 30%
ou plus pour une variable à 3 modalités et de 50% ou plus pour
une variable à deux modalités. Concrètement,
l'hypothèse H1 est validée lorsqu'une perception positive de
chaque variable explicative correspond aussi à une même perception
de la variable expliquée. L'hypothèse est aussi validée
lorsqu'une fréquence faible des variables explicatives correspond
à une fréquence faible de la variable expliquée. Dans tous
les autres cas, l'hypothèse est rejetée.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
50
2.2.2.3.2. Méthode de vérification de
l'hypothèse 112
L'hypothèse 112 stipule que « La réussite
de la communication institutionnelle du MICPME est déterminée par
la pertinence des outils de communication mis en oeuvre ».
Dans cette hypothèse, la réussite de la
communication institutionnelle est la variable expliquée. La pertinence
des outils de communication est la variable explicative.
A l'aide des données de l'enquête, nous avons
calculé les fréquences relatives à divers indicateurs de
ces variables.
Les questions relatives aux outils de communication mis en
oeuvre par le MICPME traduisent la réussite de la communication
institutionnelle. Leur adéquation ou leur réponse aux attentes
des cibles correspond à la réussite de la communication
institutionnelle. Les fréquences y afférentes seront
comparées entre les variables, en termes de concordance.
2.2.2.3.3. Méthode de vérification de
l'hypothèse 113
L'hypothèse 113 stipule que « La performance de la
communication institutionnelle du MICPME dépend de l'efficacité
de son plan de communication ».
Dans cette hypothèse, la performance de la
communication institutionnelle est la variable expliquée.
L'efficacité du plan de communication est la variable explicative.
A l'aide des données de l'enquête, nous avons
calculé les fréquences relatives à divers indicateurs de
ces variables.
Les questions relatives à la cohérence des
actions entreprises par le MICPME avec ses objectifs et aux moyens mis en
oeuvre traduisent l'efficacité du plan de communication. Leur
adéquation ou leur réponse aux attentes des cibles correspond
à la performance institutionnelle. Les fréquences y
afférentes seront comparées entre les deux types de variables, en
termes de concordance.
|
CHAPITRE 3 : RESULTATS DE L'ETUDE
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME.
51
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
52
RESULTATS DE L'ETUDE
3.1. PRESENTATION DES RESULTATS
3.1.1. Synthèse des résultats de
l'enquête menée par le cabinet ATL
· L'existence du ministère est connue par un grand
nombre de citoyens ;
· Plus généralement, le volet commerce est
attribué au ministère ; les autres volets sont ignorés par
la majorité ;
· L'information sur les actions du ministère
n'est pas perçue ou, motive peu l'intérêt ;
· La plupart des citoyens ignorent la mission
véritable du ministère ;
· Certaines structures sous tutelle sont bien visibles,
même si leurs actions sont diversement appréciées ;
· Le relais de l'information est peu ou mal
assuré par les structures décentralisées au sein du grand
public
· La localisation géographique du
ministère et de ses structures décentralisées est peu
connue.
· Chaque bureau du ministère dispose d'un
ordinateur mais il n'y a pas de réseau intranet ;
· Grâce à un contrat du gouvernement avec
les médias, les relations des responsables à la communication
dans le milieu ou la contribution des structures sous tutelles les actions
dirigées par le ministre sont relayées sur les chaînes de
télévision et certaines radios ;
· Les réunions hebdomadaires de cabinet et celles
des directions respectives permettent la circulation de l'information en
interne, mais celle-ci n'est pas systématique ;
· Le ministère dispose d'un site Internet mais
son usage et sa notoriété sont bas ;
· Le grand public n'a pas le réflexe de
s'interroger sur la nécessité de consulter le ministère ou
ses structures pour des renseignements sur les projets ou des besoins en
matière de conseil ;
· Malgré des campagnes ponctuelles sur les
produits avariés, le grand public est résigné face au
phénomène ; l'aide à la création au
développement et au renforcement des associations de consommateur n'est
pas perçue ; d'ailleurs les actions desdites associations ne sont pas
jugées convaincantes
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
53
RESULTATS DE L'ETUDE
? Le grand public n'est pas sensible à la
nécessité de soutenir la transformation locale des produits. Le
grand public ignore massivement les efforts du ministère pour la
promotion des échanges commerciaux ;
De l'analyse des résultats de cette enquête, il
apparaît globalement que les professionnels des médias locaux et
le grand public (le monde des affaires et de l'industrie, les jeunes
créateurs d'entreprises, les associations de consommateurs, les petites
et moyennes entreprises) ne perçoivent pas les activités
mises en oeuvre par le ministère. Il urge donc, au regard de ces
résultats, de mieux impliquer les médias en tant que relais dans
la visibilité des actions du ministère et de ses structures sous
tutelle. Il faut envisager des rencontres périodiques avec les
médias locaux et initier des séminaires de formation et des
rencontres avec les acteurs des domaines de l'industrie et du commerce.
3.1.2. Notre enquête
Les tableaux ci-après présentent les
résultats de notre enquête, suivis de leur interprétation.
Dans ces tableaux, les effectifs représentent les nombre de personnes
ayant répondu aux différentes questions, de telle sorte que
l'effectif total par question peut être inférieur à 55 qui
est la taille de l'échantillon des personnes enquêtées
Tableau N°8 : Représentation des
données relatives à l'hypothèse H1
Modalités
|
Réponses
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
Accès facile aux informations
|
Oui
|
30
|
75
|
|
10
|
25
|
|
40
|
100
|
Performance de la communication institutionnelle
|
Bonne
|
12
|
24
|
|
08
|
16
|
|
30
|
60
|
|
50
|
100
|
Image du MICPME
|
Positive
|
15
|
37.5
|
|
25
|
62.5
|
|
40
|
100
|
Système visuel
|
Efficace
|
08
|
20
|
|
32
|
80
|
|
40
|
100
|
|
Source : Notre étude.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
54
RESULTATS DE L'ETUDE
Dans le tableau no. 8, il apparaît que douze
enquêtés sur 50, soit 24%, jugent bonne la communication
institutionnelle du MICPME tandis que trente soit 60% évoquent cette
communication inefficace. Cela est dû à l'inexistence de lignes
budgétaires pour financer les initiatives et les activités afin
de mettre en place un plan de communication efficace répondant aux
attentes des cibles. De même, vingt-cinq autres personnes soit 62,5%
pensent que le MICPME ne jouit pas d'une bonne image et d'une bonne
notoriété auprès de ses cibles à cause du manque de
célérité dans le traitement des dossiers des usagers et la
corruption au sein de l'administration alors que quinze soit 37,5% pensent le
contraire. Enfin trente-deux personnes soit 80% jugent inefficace le
système visuel du ministère parce que sa localisation est peu
connue et les moyens d'identification ne sont pas assez déployés.
Comparativement à huit autres personnes soit 20% qui jugent le
système visuel adéquat.
Tableau N°9 : Représentation des
données relatives à l'hypothèse H2
Modalités
|
Réponses
|
Effectifs
|
Fréquences
(%)
|
Impact des activités du MICPME
|
Positif
|
10
|
22,22
|
|
35
|
77,78
|
|
45
|
100
|
Implication dans la promotion des PME
|
Fort
|
25
|
62,5
|
|
10
|
25
|
|
05
|
12,5
|
|
40
|
100
|
Satisfaction des attentes des cibles
|
Oui
|
15
|
42,86
|
|
20
|
57,14
|
|
35
|
100
|
Pertinence des outils de communication
|
Efficace
|
15
|
33,33
|
|
30
|
66,67
|
|
45
|
100
|
|
Source : Notre étude.
Le tableau no. 9 montre que trente-cinq personnes
interrogées sur 45, soit 77,78%, jugent négatifs les actions du
MICPME en direction des entreprises du point de vue de l'impact des
activités, quand bien même et vingt-cinq autres sur 40, soit
62,5%, pense que l'implication du ministère dans la promotion des PME
est forte. De même vingt (20) sur 35, soit 57,14%, se disent insatisfaits
quant à leurs attentes et trente autres sur 45, soit 66,67%,
considèrent inefficaces les outils de communication MICPME à
l'endroit des
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
55
RESULTATS DE L'ETUDE
cibles. Seulement quinze personnes soit 33,33% jugent
pertinents les outils de communication utilisés par le MICPME.
Tableau N°10 : Représentation des
données relatives à l'hypothèse H3
Modalités
|
Réponses
|
Effectifs
|
Fréquences (%)
|
Cohérence des actions de communication
|
Oui
|
15
|
37,5
|
|
25
|
62,5
|
|
40
|
100
|
Efficacité du plan de communication
|
Bonne
|
10
|
22,22
|
|
10
|
22,22
|
|
25
|
55,56
|
|
45
|
100
|
Efficacité des moyens mis en oeuvre
|
Efficace
|
10
|
25
|
|
30
|
75
|
|
40
|
100
|
|
Source : Notre étude.
Dans le tableau no. 10, on note que seulement dix
enquêtés sur 45, soit 22,22%, considèrent efficace le plan
de communication institutionnelle du MICPME à l'endroit des cibles
tandis que vingt-cinq autres (55,56%) la juge médiocre, donc
inadaptée aux attentes des cibles. Vingt-cinq enquêtés sur
40, (62,5%), affirment que c'est dû à l'incohérence des
actions de communication avec les objectifs prédéfinis.
3.1.3. Vérification des hypothèses de
recherche 3.1.3.1. Vérification de l'hypothèse 1
Enoncé de l'hypothèse : «
L'amélioration de la qualité de l'image et de l'identité
visuelle du MICPME justifie la performance de sa communication
institutionnelle. »
Dans le chapitre méthodologique nous avons dit
qu'à une fréquence élevée (30% ou plus pour une
variable à 3 modalités et de 50% ou plus pour une variable
à deux modalités) de la modalité « bon » ou
« positif » d'une variable explicative, correspond une
fréquence élevée de la modalité « bonne »
de la variable expliquée. C'est-à-dire que l'hypothèse est
validée lorsqu'une perception positive de chaque variable explicative
correspond aussi à une même perception de la variable
expliquée. Elle est aussi validée lorsqu'une fréquence
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
56
RESULTATS DE L'ETUDE
faible de la variable explicative correspond à une
fréquence faible de la variable expliquée. Dans tous les autres
cas, l'hypothèse est rejetée.
La fréquence de la modalité « bonne »
de la variable « performance de la communication institutionnelle
» est faible (24%), pendant que 62,5% ont une perception
négative pour l'image et 80% pensent que le système visuel n'est
pas efficace. Il y a donc concordance, c'est-à-dire qu'une mauvaise
image implique une faible performance de la communication institutionnelle.
Cette observation rencontre bien l'hypothèse avancée, car selon
une déduction par analogie, une bonne image correspondra à une
performance élevée. Cela confirme effectivement que la
communication institutionnelle est performante si l'image et l'identité
visuelle de l'institution sont valorisées. C'est-à-dire que si le
MICPME se dote de moyens et/ou outils nécessaires à la gestion de
son image et de son identité visuelle, sa communication serait
adéquate et adaptée aux attentes des cibles visées. On
peut conclure que l'hypothèse H1 est vérifiée.
3.1.3.2. Vérification de l'hypothèse 2
Enoncé de l'hypothèse : « La
réussite de la communication institutionnelle du MICPME dépend
des outils de communication mis en oeuvre. »
La même approche de vérification sera
adoptée, tel que déjà indiquée dans le chapitre
méthodologique.
Les résultats ont montré que 66,67% des
enquêté ont jugé que la « pertinence des outils de
communication » n'est pas efficace, pendant que plus de la moitié
(57,14%) disent que les attentes des cibles n'est pas satisfaite et 77,78%
estiment que l'impact des activités du MICPME est négatif. Dans
la même logique de vérification que pour l'hypothèse 1, on
note ici que la concordance est aussi établie selon la déduction
par analogie. Ainsi, la pertinence des outils de communication,
détermine la valeur de la réussite de la communication
institutionnelle. En effet, le choix des outils de communication constitue une
étape importante dans l'élaboration d'un plan de communication.
Le MICPME doit adapter les outils aux besoins ou attentes des cibles en termes
de communication, pour s'assurer la réussite de sa communication
institutionnelle. Des outils de communication
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
57
RESULTATS DE L'ETUDE
pertinents garantissent une communication institutionnelle
efficace. L'hypothèse 112 est donc vérifiée.
3.1.3.3. Vérification de l'hypothèse 3
Enoncé de l'hypothèse : « La
performance de la communication institutionnelle du MICPME dépend de
l'élaboration d'un plan de communication efficace. »
Les résultats ont montré que seulement 22,22%
des enquêtés considèrent efficace le plan de communication
institutionnelle du MICPME à l'endroit des cibles tandis que 55,56% la
juge médiocre donc inadaptée aux attentes des cibles. Vingt-cinq
enquêtés (62,5%) affirment que cela est dû à
l'incohérence des actions de communication avec les objectifs
prédéfinis. L'hypothèse 113 est donc elle aussi
vérifiée.
3.2. LIMITES ET SUGGESTIONS 3.2.1. Limites
Les budgets alloués respectivement à la Cellule
de Communication du ministère et aux responsables de la communication de
certaines de ses structures sont déjà dévolus à des
missions spécifiques. Le ministère doit donc dégager les
fonds nécessaires pour la réalisation des plans de
communications. Par ailleurs, les directions et structures sous tutelle doivent
se mettre d'accord pour harmoniser leurs campagnes spécifiques avec les
grandes lignes de la politique de communication du MICPME afin de
répondre effectivement aux attentes des cibles visées et par la
même occasion atteindre les objectifs fixés.
Les structures du ministère, bien
qu'hiérarchiquement liées à l'autorité du ministre
sont autonomes et mènent des activités bien distinctes. Elles
peuvent souhaiter conserver leur propre mode de fonctionnement. Les
défis à relever consisteront à éviter une
incohérence dans les messages et par conséquent une confusion
dans l'esprit des cibles.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
58
RESULTATS DE L'ETUDE
3.2.2. Suggestions
3.2.2.1. Préconisations générales
Nous proposons à la Cellule de communication
d'orienter son action vers les axes principaux suivants:
- Etablir une structure pour gérer stratégiquement
la communication ;
- Rendre la communication bidirectionnelle par l'écoute
des publics ;
- Opérer un transfert de charge en impliquant les
partenaires dans les efforts de
communication ;
- Mettre en place un système d'identité
éditoriale et graphique efficace, c'est-à-dire
lisible, cohérent et évocateur ;
- Recadrer les relations avec la presse ;
- Publier mensuellement un périodique de qualité
;
- Recentrer les activités d'édition (productions
écrites, audiovisuelles et multimédia)
pour mieux atteindre les cibles ;
- Coordonner le Web et amplifier son développement
à l'avenir ;
- La communication en direction des institutions ;
- Les couvertures médiatiques des
événements ;
- Conception et publication de publi-reportages sur les
activités du ministère ;
- Le sponsoring ;
- Organisation des journées portes-ouvertes à
l'endroit des écoles (Universités,
collèges, etc.) ;
- Organiser en collaboration, avec les écoles et
universités, des sorties pédagogiques
dans des unités de production industrielle.
En vue de maximiser l'impact de ces efforts de communication
: les activités seront organisées au moment opportun et les
informations utilisées seront précises. Les activités
seront menées en étroite coordination avec les différentes
structures et directions sous tutelle. Il convient donc de cibler le(s) bon(s)
public(s). Les messages doivent présenter un réel
intérêt pour le(s) public(s) cible(s). Les activités seront
calibrées en tenant compte des ressources mobilisées, de la
planification et de l'impact escompté.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
59
RESULTATS DE L'ETUDE
3.2.2.2. Proposition d'un plan de communication
Le plan de communication doit mettre en avant les
activités de communication interne et externe qui doivent être
organisées à des moments clés. Le degré de
précision du plan doit être proportionné à la
nature, à l'importance et au coût des activités de
communication envisagées. La communication doit mettre en avant les
attentes des cibles ainsi que les réalisations et l'impact de l'action
prévue.
3.2.2.2.1. Contexte et Objectifs
Quatre types de missions sont dévolus au MICPME:
promouvoir, défendre, moderniser et réglementer. Le premier de
ces types de mission consiste en un accompagnement des entreprises existantes,
un appui au secteur privé, une incitation et un encouragement aux
activités de transformation ainsi qu'à toutes actions
entrepreneuriales dans les domaines du commerce et de l'industrie, un
positionnement efficient du Bénin dans l'environnement régional
et international du commerce. D'où le besoin d'une communication
permanente à la fois vis-à-vis des acteurs, mais aussi à
l'endroit des consommateurs du Bénin et de l'extérieur. Le champ
d'application de la future stratégie est non seulement de faire
connaître les actions du ministère et de ses structures, mais
pareillement d'inscrire la mission de promotion au coeur desdites actions, par
la réalisation d'une politique d'information adaptée aux attentes
des cibles.
L'objectif général de la présente
recherche est de formuler des suggestions pour un plan de communication
institutionnelle adapté aux attentes des cibles du MICPME.
Plus spécifiquement il s'agit de:
- Enumérer les différentes étapes que
doit franchir le MICPME pour améliorer sa communication institutionnelle
;
- Identifier les outils qui permettent au MICPME
d'améliorer sa communication institutionnelle ;
- Proposer un plan de communication institutionnelle que peut
suivre le MICPME pour améliorer la visibilité de ses actions
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
60
RESULTATS DE L'ETUDE
3.2.2.2.2. Public(s) cible (s)
Pour communiquer efficacement, il convient d'identifier
clairement les publics cibles dans les plans de communication. Ces publics
peuvent inclure les formateurs d'opinion et les personnalités
influentes, ainsi que les personnes qui, bien que n'étant pas issues des
milieux gouvernementaux ou du monde des médias, sont parties prenantes
à l'action ou sont concernées par celle-ci.
Nous retenons comme publics pour une action de communication
efficace :
· La population dans son ensemble
· Les acteurs publics et privés du secteur de
l'industrie et du commerce
· Les Partenaires techniques et financiers
· Les investisseurs nationaux et étrangers
3.2.2.2.3. Moyens de communication
Les outils en présence : publicité, promotion,
relations publiques, marketing. De tous ces outils, la relation publique sera
privilégiée. La relation publique est en effet, l'outil le mieux
adapté pour ce type de structure. Nous privilégions beaucoup plus
le hors média pour permettre au MICPME de rendre ses actions plus
visibles. Les déclinaisons seront : les plaquettes, les
communiqués de presse, le site Internet, l'accueil.
Supports médias
· La télévision
Assurer les couvertures médiatiques et occuper les
espaces à travers des émissions et diverses productions
valorisantes (documentaires et petits reportages).
· La radio Idem que la TV
· Productions audiovisuelles
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
61
RESULTATS DE L'ETUDE
Il peut être intéressant de produire du
matériel audiovisuel, mais vu les coûts que cela implique, un tel
matériel ne sera préparé que lorsqu'il a
véritablement une chance d'être diffusé par les
médias. De petits vidéos clips pourront toutefois être
produits très facilement à titre de matériel publicitaire.
Comme avec tout autre matériel, les productions audiovisuelles doivent
faire état du soutien du MICPME, en faisant apparaître le logo
dans la séquence d'ouverture et/ou le générique de fin.
? Sites internet
Les sites Internet sont de plus en plus un
élément de base indispensable à la communication. Il n'est
toutefois pas toujours nécessaire de créer un site pour chaque
action étant donné que les informations peuvent être
rendues accessibles via le site Internet du MICPME ou celui des structures ou
directions sous tutelle.
Si l'action est appelée à durer et à
générer un matériel important susceptible d'être
diffusé via un site Internet (photographies de l'évolution de
l'action, brèves interviews, matériel pour la presse, etc.), le
plan de communication peut stipuler qu'un site Internet dédié
sera mis en place. Ce site sera conçu en étroite
coopération avec les responsables des directions qui en assureront la
cohérence et créeront les liens vers les sites utiles du
ministère.
Au terme de l'action, le contenu du site Internet sera
copié sur CD-ROM et remis à la Cellule de Communication en vue
d'une éventuelle utilisation future dans ses activités
générales de communication et à des fins d'archivage.
Supports hors-médias
? Communiqués de presse
Les communiqués de presse sont des
éléments clés pour les activités d'information
autour d'une action. Le communiqué de presse doit être
publié au début de toute action. Il doit contenir : un
en-tête, un premier paragraphe percutant qui résume les faits
essentiels, le développement, des citations, quelques informations de
base et l'indication de personnes de contacts pour de plus amples informations.
Après le mot «fin», le communiqué de presse doit donner
le nom d'au moins une personne à laquelle le journaliste peut s'adresser
pour obtenir de plus amples informations. Chaque fois que possible, il y a lieu
d'indiquer un numéro de téléphone de contact.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
62
RESULTATS DE L'ETUDE
? Conférences de presse
Les conférences de presse tenues dans le cadre du plan
de communication doivent toujours être organisées en
coopération avec les directions et structures sous tutelle. Les
invitations doivent porter le logo du MICPME.
? visites de presse
Les visites de groupe de journalistes sur des sites de projet
permettent également d'accroître la visibilité. Il y aura
lieu de les organiser à un moment approprié, en mettant alors
l'accent sur des résultats tangibles.
? Dépliants, brochures et lettres d'information
Les publications, comme les dépliants, les brochures
et les lettres d'information peuvent être utiles pour communiquer les
résultats d'une action à des publics spécifiques.
- Les dépliants peuvent fournir des informations de
base et l'adresse (comme l'adresse électronique ou un site Internet)
où trouver un complément d'information.
- Les brochures peuvent être plus
détaillées, et mettre en exergue le contexte. Elles pourront par
exemple inclure des interviews de parties prenantes, de
bénéficiaires, etc.
- Les lettres d'information se caractérisent par le
fait qu'elles sont diffusées à intervalles réguliers.
Elles peuvent être publiées pour informer les publics cibles de
l'évolution d'une action. Cela peut s'avérer utile, par exemple
pour des projets d'infrastructures, des programmes de formation, etc. pour
lesquels l'impact d'une action peut être évalué au fil des
mois.
Les publications doivent toujours être adaptées
au public cible, et se concentrer sur les résultats escomptés de
l'action, et non sur des détails financiers et administratifs. Les
textes seront courts et simples. Ils seront dans la mesure du possible
illustrés de photos permettant de mieux situer l'action dans son
contexte. Ces photos montreront si possible, des participants à
l'action, plutôt que les responsables de la gestion.
D'une manière générale, le
matériel produit sur format papier doit également être
publié sous forme électronique, afin de pouvoir être
envoyé par courrier électronique et posté sur un site
Internet. En ce qui concerne le matériel imprimé, la
capacité de distribution (listes
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
63
RESULTATS DE L'ETUDE
d'envoi) devra être prise en compte. Les
dépliants et brochures porteront toujours les éléments de
base de l'identité visuelle, c'est-à-dire l'emblème du
MICPME.
? Panneaux d'affichage
Les projets d'infrastructure financés par le MICPME
peuvent être identifiés comme tels au moyen de panneaux
d'affichage explicatifs. Les panneaux d'affichage doivent être clairement
visibles de façon à ce que les passants puissent les lire et
comprendre la nature du projet.
? Plaques commémoratives
Les plaques commémoratives permanentes sont un moyen
efficace de rendre compte de la participation du MICPME à la
construction ou à la planification de structures permanentes telles que
des logements, des hôpitaux, des usines, des institutions, des centres de
formation, des routes, des ponts, etc.
? Bannières
Des bannières en plastique ou en textile doivent
être produites si le plan de communication de l'action le
spécifie. Ces bannières servent de décor pour certains
événements particuliers tels que des inaugurations et
conférences.
? Véhicules, matériel et équipements
Tous les véhicules utilisés dans le cadre d'une
activité financée par le MICPME doivent être clairement
identifiés et porter visiblement le logo du ministère.
? Articles promotionnels
Des articles promotionnels doivent être
distribués lorsque le plan de communication d'une action le
spécifie. Tous les types d'articles promotionnels (comme les T-shirts,
casquettes et stylos à bille) peuvent être produits par les
partenaires d'exécution comme moyen de support pour leurs
activités d'information et de communication dans le cadre de leur
action. Les articles promotionnels sont clairement identifiés par le
logo du MICPME, et porteront si possible l'abrégé « MICPME
» ainsi que des messages clés ou des phrases clés. Lorsqu'il
n'est pas possible d'inclure des messages clés dans leur
totalité, comme c'est le cas sur certains articles promotionnels (stylos
à bille et bannières, par exemple), il faut au moins
qu'apparaisse le logo.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
64
RESULTATS DE L'ETUDE
? Photographies
Lorsque les circonstances s'y prêtent, des photos
seront prises pour illustrer l'avancement des activités et les
événements liés à ceux-ci (lancement, visites,
etc.). Ces photos seront utilisées dans le matériel de
communication.
Le plan de communication doit contenir si possible des
dispositions relatives au recours, sur une base régulière,
à un photographe professionnel en vue d'illustrer l'évolution
d'une action. Les photos choisies doivent être celles qui illustreront le
mieux les résultats et l'impact de l'action. Elles seront aussi en
accord avec une éventuelle information écrite relative à
l'action. En règle générale, la photographie
numérique sera utilisée de façon à faciliter la
reproduction sur des sites Internet et d'autres matériels
d'information.
? Événements publics et visites
L'organisation d'un événement public (ou la
participation à un événement organisé
indépendamment de l'action, par exemple par la délégation
du MICPME) peut offrir une excellente occasion de susciter un
intérêt pour les réalisations particulières d'un
projet. Ces événements sont notamment les conférences,
ateliers, séminaires, salons et expositions. Les personnes qui
participent à des cours de formation, conférences,
séminaires, foires, expositions et ateliers financés par le
MICPME doivent être informées que cette dernière finance
l'événement. Le logo du ministère doit figurer sur tout
matériel écrit.
? Campagnes d'information
Les actions de grande envergure peuvent assumer
l'organisation d'une campagne d'information pendant la durée de vie du
projet. De telles campagnes peuvent rehausser la visibilité du projet et
de l'UE en encourageant les discussions des thèmes autour desquels le
projet s'articule, comme la santé publique, la sécurité
routière, l'environnement, etc. Une telle campagne exige des ressources
appropriées en termes de gestion et sera toujours coordonnée par
la Cellule de Communication.
3.2.2.2.4. Mise en oeuvre des moyens de communication
La mise en oeuvre connaitra la production de tous les
supports de visibilité. En fonction des conclusions obtenues, les
ajustements utiles seront faits avant une mise en oeuvre du plan tel qu'il est
prévu. En fonction des conclusions obtenues, les ajustements utiles
seront faits
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
65
RESULTATS DE L'ETUDE
avant une mise en oeuvre du plan tel qu'il est prévu.
Lors de la mise au point des activités de communication les responsables
doivent tenir compte des aspects suivants :
? Les méthodes de communication
sélectionnées et les messages diffusés doivent être
en cohérence avec les objectifs fixés.
? Les activités doivent respecter l'environnement
local.
? Dans la mesure du possible, la ou les langues locales
doivent être utilisées dans toutes les activités de
communication.
Dans tous les cas, les ressources (humaines,
financières, etc.) nécessaires à la mise en oeuvre
d'activités de communication spécifiques devront faire l'objet
d'une évaluation attentive au moment de la mise au point du plan de
communication et de visibilité.
? Les moyens humains
Il s'agit de définir la composition de la cellule de
communication du ministère qui va coordonner les actions au sein du
ministère et en relation avec les structures sous tutelle. Il faut
retenir la nécessité pour chacune des structures de se doter d'un
attaché de presse ou un directeur ou chef service de la communication.
Pour ce qui est de la cellule de communication nous proposons qu'elle soit
composée de :
- Un chargé de communication (communiquant professionnel)
chef de la cellule
- Un chargé de l'audiovisuel (Journaliste Reporter
d'Images)
- Un attaché de presse (contact presse et relation avec
la presse en ligne)
- Un assistant spécialiste du web et des réseaux
sociaux qui sera chargé d'animer le
site web du ministère
En dehors de la cellule de communication, le ministère
doit établir une structure pour gérer stratégiquement la
communication pour toutes les questions nécessitant une rencontre avec
les médias.
? Les moyens matériels
Pour son pragmatisme et son efficacité, la cellule de
communication doit se dote d'un matériel de qualité qui servira
essentiellement à couvrir les activités de tout le
ministère et à en assurer l'archivage. Il servira à
produire de petits sujets pour les émissions par exemple.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
66
RESULTATS DE L'ETUDE
· Les moyens financiers
Le budget de communication doit être revu à la
hausse pour permettre à la cellule de communication de réaliser
toutes les actions prévues dans la politique de communication.
3.2.2.2.5. Evaluation
Il porte sur les éléments suivants :
· le choix des moyens d'action ;
· la pertinence des messages ;
· les cibles de communication ;
· l'effet produit sur les comportements des publics cibles
;
· les résultats attendus et l'impact obtenu.
Pour un meilleur suivi évaluation, des rapports
d'évaluation des plans de communication (à mi-parcours et
à la fin de l'année) peuvent servir d'outils pour mesurer
l'efficacité des
actions de communication.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATIONI NSTITUTIONNELLE DU
MICPME
67
CONCLUSION
La communication contribue à résoudre les
problèmes de mal-compréhension car il implique la mise en place
des réseaux favorisant la circulation de l'information et favorise les
échanges pour une implication active dans l'amélioration des
relations et dans son développement. C'est aussi un moyen
d'intégrer les autres acteurs qui constituent un instrument
privilégié pour entretenir un bon climat dans les relations.
L'existence d'un bon réflexe de communication et la capacité
d'exploiter des opportunités inattendues au bénéfice de
l'action ont souvent autant d'impact que des efforts plus formels. Il convient
donc d'exploiter de telles opportunités.
Dans la recherche d'efficacité et de cohérence,
l'entreprise doit gérer sa communication en terme global. Ainsi,
à partir des trois concepts "identité, positionnement et
système d'offre", elle peut réussir à se constituer un
avantage concurrentiel défendable. Cette méthodologie
développée doit ainsi permettre à toute organisation de se
constituer des images claires d'entreprise, de marque et de produit
c'est-à-dire des images à travers lesquelles les
différents publics de l'entreprise perçoivent une
réalité entre les discours et les actes.
Notre étude porte sur l'analyse de la politique de
communication institutionnelle du MICPME et a pour objectif de faire des
suggestions pour rendre visibles les activités du ministère en
proposant un plan de communication adapté aux attentes des cibles.
L'analyse de la politique de communication du MICPME dans la
présente recherche a permis de mettre en exergue les difficultés
liées à la mise en oeuvre du plan de communication. Ces
difficultés, dont notamment le manque de volonté des instances
dirigeantes du MICPME et l'inexistence de ligne budgétaires pour
financer les activités de la cellule de communication empêchent le
ministère de répondre aux attentes (sensibilisation,
information, régulation) des cibles visées. En effet, la
grande majorité des publics visés par le ministère n'est
pas encore informée des activités menées par le MICPME en
vue de promouvoir les secteurs de l'industrie et du commerce. Pire, elle ne
trouve aucun intérêt à se rapprocher du ministère
pour plus d'informations parce que cette dernière ne communique pas
assez en direction de ses publics. C'est pour pallier ces insuffisances de la
politique de communication du MICPME que notre étude a fait des
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATIONI NSTITUTIONNELLE DU
MICPME
68
suggestions en vue concevoir un plan de communication efficace
adapté aux attentes des cibles.
Nos résultats ont montré que des actions
insuffisantes ou peu pertinentes de communication du MICPME ont
résulté en une faible satisfaction des attentes des cibles et un
impact généralement négatif de la politique de
communication de ce ministère. Par déduction, la concordance
entre les actions de communication institutionnelle du MICPME et le niveau de
performance de cette politique de communication est été
établie. En conséquence, quelle que soit l'action, le plan de
communication doit viser à maximiser les synergies avec la
stratégie de globale du ministère.
Pour améliorer l'impact des actions de communication
afin de rendre visibles les activités du ministère, nous avons
formulé quelques suggestions à l'endroit des dirigeants pour les
aider à corriger les dysfonctionnements constatés, et
esquissé une proposition de plan de communication en trois axes,
à savoir : une bonne définition des objectifs de communication,
l'identification des publics cibles et la planification de la mise en oeuvre
(stratégie d'approche des cibles ; moyens financiers, matériels
et humains à déployer ; timing des actions).
Toutefois, ce travail ne prétend pas avoir
répertorié tous les dysfonctionnements auxquels est
confronté le MICPME en matière de mise en oeuvre de sa politique
de communication. Il constitue plutôt une modeste contribution à
la compréhension de la situation de cette politique, avec quelques
propositions d'approches de solutions que nous souhaitons utiles
pour les dirigeants.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
69
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
ABREVIATIONS iv
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX vi
RESUME vii
SUMMARY viii
SOMMAIRE ix
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : PRESENTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET
OBSERVATIONS
DU STAGE. 4
1.1. Présentation générale du MICPME
et de la Cellule de Communication 5
1.1.1. Présentation générale du MICPME 5
1.1.2. Présentation de la Cellule de Communication. 10
Tableau N°1 : Missions et réalisations de la cellule
de communication. 15
1.2. Observations du stage et Analyse SWOT 16
1.2.1. Observations du stage 16
1.2.2. Analyse SWOT 16
1.3.2.1. Le macro-environnement 16
1.3.2.2. Le microenvironnement 18
Tableau N°2 : Analyse SWOT de la Cellule de Communication du
MICPME 19
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE
RECHERCHE. 20
2.1. CADRE THEORIQUE 21
2.1.1. Problématique de la recherche
21
2.1.2. Objectifs et hypothèses de la recherche
22
2.1.2.1. Objectifs de recherche 22
2.1.2.2. Hypothèses 22
Tableau N°3 : variables et indicateurs de l'hypothèse
N°1 23
Tableau N°4 : variables et indicateurs de l'hypothèse
N°2 23
Tableau N°5 : variables et indicateurs de l'hypothèse
N°3 24
2.1.2.3. Synthèse des objectifs et des
hypothèses de recherche 24
Tableau N°6 : Synthèse
relationnelle des objectifs, hypothèses et résultats attendus de
la recherche
25
2.1.3. Revue de littérature 26
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
70
2.1.3.1. Concept de « communication institutionnelle
» 26
2.1.3.1.1. Etapes de la communication institutionnelle 28
2.1.3.1.2. Les outils de la communication institutionnelle 31
2.1.3.2. Concept de « Politique de communication
» 34
2.1.3.3. Concept de « Stratégie de
Communication » 36
2.1.3.4. Concept de « plan de communication »
38
2.1.3.5. Concept de « Communication »
41
Figure 1 : Les éléments de la communication 42
2.1.3.6. Approche théorique retenue : l'approche
systémique 42
2.2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 43
2.2.1. Le modèle empirique 43
Figure 2 : Modèle d'évaluation adopté pour
la présente étude 45
2.2.2. La méthodologie de recueil des données
46
Tableau N°7 : Critères et indicateurs d'évaluation de
la pertinence des actions de communication
au regard des attentes des cibles 47
2.2.2.1. Revue documentaire 48
2.2.2.2. Enquête 48
2.2.2.2.1. Phase exploratoire 48
2.2.2.2.2. L'échantillonnage 48
2.2.2.2.3. Mode de conduite des interviews 48
2.2.2.3. Méthode de vérification des
hypothèses 49
2.2.2.3.1. Méthode de vérification de
l'hypothèse H1 49
2.2.2.3.2. Méthode de vérification de
l'hypothèse H2 50
2.2.2.3.3. Méthode de vérification de
l'hypothèse H3 50
CHAPITRE 3 : RESULTATS DE L'ETUDE 51
3.1. PRESENTATION DES RESULTATS 52
3.1.1. Synthèse des résultats de l'enquête
menée par le cabinet ATL 52
3.1.2. Notre enquête 53
Tableau N°8 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H1 53
Tableau N°9 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H2 54
Tableau N°10 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H3 55
3.1.3. Vérification des hypothèses de recherche
55
3.1.3.1. Vérification de l'hypothèse 1 55
3.1.3.2. Vérification de l'hypothèse 2 56
3.1.3.3. Vérification de l'hypothèse 3 57
3.2. LIMITES ET SUGGESTIONS 57
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
71
3.2.1. Limites 57
3.2.2. Suggestions 58
3.2.2.1. Préconisations générales 58
3.2.2.2. Proposition d'un plan de communication 59
3.2.2.2.1. Contexte et Objectifs 59
3.2.2.2.2. Public(s) cible (s) 60
3.2.2.2.3. Moyens de communication 60
3.2.2.2.4. Mise en oeuvre des moyens de communication 64
3.2.2.2.5. Evaluation 66
CONCLUSION 67
TABLE DES MATIERES 69
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 72
ANNEXES 74
Annexe 1 : Résumé de l'historique du MICPME
75
Annexe 2 : Organigramme du Ministère de l'Industrie du
Commerce, des Petites et Moyennes
Entreprises 76
Annexe 3 : Organigramme de la cellule communication du MICPME
77
Annexe 4 : Charte graphique du MICPME 78
Annexe 5 : Questionnaires 79
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
72
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
BATHELOT Bertrand,
http://www.definitions-marketing.com/Definition-Politique-de
communication; consulté le 19/03/2014.
BONNEVILLE Luc, GROSJEAN Sylvie, Communication des
organisations, Ed. L'Harmattan, Paris, 2007.
DECRET N° 2009-179 du 05 Mai 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement du Ministère de l'Industrie, du Commerce
et des Petites et Moyennes Entreprises.
DUTERME Claude, La communication interne en entreprise:
l'Approche de Palo Alto et l'analyse des organisations, Editions De Boeck
Université, 2002.
ERIK Neveu, Une société de communication ?
Edition Montchrestien, Collection clefs, 3è édition, 2001.
FROIS Michel, Techniques et outils de la communication
institutionnelle, paris, 2000.
LAMIZET Bernard, Dictionnaire encyclopédique des
sciences de l'information et de la communication, Paris, Ellipses/Ed.
Marketing, 1997.
LEHU Jean-Marc, L'Encyclopédie du Marketing ; Ed.
d'Organisation, Paris, 2014. LEMAY Myriem, « La politique de
communication », Comeit, Paris, 2008.
LENDREVIE J., LEVY J. et LINDON D., Mercator, Théories
et nouvelles pratiques du marketing, 9è édition, 2009.
LIBAERT Thierry, Collection: Fonctions de l'entreprise,
4è édition, Dunod, 2013. LIBAERT Thierry, La communication de
crise, 2è édition, Dunod, 2005.
MICPME, « Enquête de satisfaction du personnel et des
usagers/clients du ministère », septembre 2013.
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
73
PASCAL Blaise, « Traité de la roulette
», Ed. La pleiade, Paris, 1659.
SAY Jean-Baptiste, « Traité d'économie
politique », Ed. Economica, Paris, 1832. SFEZ Lucien,
Dictionnaire critique de la communication, Tome 2, Paris, PUF,
1993.
Stratégie de communication triennale 2013-2016 du MICPME,
réalisée par ATL S.A, Cotonou, Mai 2013.
WIENERT Norbert, Cybernetics or control and communication
in animal and machine, 1948.
http://www.Communication et
politique de communication.htm, consulté le 29 septembre 2014.
http://www.doc-etudiant.fr/Commerce/Communication/Cours-La-politique-de-communication-362.html.
Consulté le 13/09/2014
http://www.nobilito.fr/index.php/2009/03/Comment
mesurer la performance de la communication, livre blanc sur la mesure de la
performance de la communication, consulté le 02/10/2014.
http://www.publika.fr/comprendre-la-communication-globale/dossier/politique-de
communication; consulté le 19/03/2014
ANNEXES
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
74
Annexe 1 : Résumé de l'historique du
MICPME
|
DENOMINATION DU MINISTERE
|
PERIODE
|
|
Ministère du Commerce et de l'Industrie
|
28/05/1957 au 18/02/1958
|
|
Ministère du Commerce, de l'Economie et du Tourisme
|
29/12/1960 au 11/09/1963
|
|
Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme
|
30/01/1974 au 30/01/1976
|
|
Ministère du Commerce et du Tourisme
|
30/01/1976 au 12/02/1980
|
|
Ministère du Commerce
|
02/02/1980 au 03/08/1984
|
|
Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme
|
03/08/1984 au 29/07/1991
|
|
Ministère du Commerce et du Tourisme
|
29/07/1991 au 15/05/1998
|
|
Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme
|
15/05/1998 au 07/05/2001
|
|
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la
Promotion de l'Emploi
|
07/05/2001 au 08/04/2006
|
|
Ministère de l'Industrie et du Commerce
|
08/04/2006 au 27/10/2008
|
|
Ministère du Commerce
|
27/10/2008 à 2009
|
|
Ministère de l'Industrie, du Commerce, des Petites et
Moyennes Entreprises
|
2009 à nos jours
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
75
Source: Archives du MICPME, décembre 2009.
Annexe 2 : Organigramme du Ministère de l'Industrie
du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises
MINISTRE

|
|
|
|
Assistant
|
Directeur de Cabinet
|
Secrétaire Général du Assistant
|
|
|
|
Ministre
|
|
|
|
|
|
Directeur Adjoint de
cabinet
|
|
|
|
|
Secrétaire Général
|
|
|
Adjoint
|
|
|
Chargé de Mission
Assistant
Attaché de Cabinet
Inspection Général du Ministère
Secrétariat Particulier
Cellule de Communication
Cellule de Contrôle des Marchés Publics
Chargé de Protocole
Conseillers Techniques
DIP
DRH
DRFM
DPP
SA
CI
PRMP
SP
CPMP
CSPRAI

SNPCI
DGPMES
SPMSCN
PME/PMI
DESI
DPI
DPCI
DCLF
DPCE
DRCRI
SP/ACP-UE
DPME
DPSP
DDICPME
|
ANAPI
|
|
CEPAG
|
ABMCQ
|
ABENOR
|
ABePEC
|
ANPME
|
CAT
|
BRVM
|
CCIB
|
CSS
|
SITEX
|
CBT
|
CTEB
|
SONACOP-SA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DGDI
DGC...
DGCE
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
76
Source : Archives MICPME, 2009
Annexe 3 : Organigramme de la cellule communication du
MICPME
Chef. Cellule Communication
M. Pierre MATCHOUDO
Attaché de Presse
M. Ospisse METOLI
Cadreur
Mme. Erice
HOUNNOUGA
Photojournaliste
M. Jeannot
HOUENOU
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
77
Secrétariat
Mme. KINNOU
|
Agent de Liaison
M. Sylvestre
BADOU
|
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
78
Annexe 4 : Charte graphique du MICPME

ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
79
Annexe 5 : Questionnaires
Dans le cadre de nos recherches en vue de la rédaction
de notre mémoire de Master in Business Administration, option
Communication Marketing, à l'Institut International de Management
(IIM-Cotonou), nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions
ci-dessous et vous remercions pour le temps que vous voudrez bien nous
consacrer.
1. Performance de la communication 1.1. Image
Q1 : quelle est la qualité de vos relations avec le MICPME
?
? Bonne
? Moyenne ? Médiocre
Q2 : avez-vous le sentiment que le MICPME jouit d'une bonne image
?
? Oui
? Non
1.2. Identité visuelle
Q1 : quelle appréciation avez-vous du système
visuel élaboré par le MICPME?
? Efficace
? Pas du tout efficace
2. Outils de la communication institutionnelle
2.1. Signature de l'institution
Q1 : pensez-vous que les éléments d'identification
du MICPME sont efficaces?
? Oui ? Non
2.2. Discours institutionnel
Q1 : quel est l'impact des activités du MICPME sur les
activités des entreprises ?
? Positif ? Négatif
Q2 : quel est le degré d'implication du MICPME dans la
promotion des entreprises ? ? Forte
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
80
? Moyenne ? Faible
Q3 : qu'attendez-vous des dirigeants du MICPME ? 2.3. Bulletin
institutionnel
Q1 : avez-vous facilement accès aux informations aux
MICPME ?
? Oui ? Non
Q2 : quelle est l'appréciation des usagers du MICPME par
rapports aux services demandés ?
? Très satisfait
? Satisfait
? Peu satisfait
? Pas du tout satisfait
2.4. Parrainage
Q1 : quel est le taux d'implication du MICPME dans les
activités de sponsoring et de mécénat ? ? Fort
? Moyen ? Faible
Q2 : le MICPME à travers des différentes
activités a-t-il développé une bonne
notoriété et une image valorisées auprès du public
?
? Oui
? Non
2.5. Relations avec la presse
Q1 : le MICPME organise-t-il souvent des rencontres avec les
professionnels des médias ?
? Très souvent ? Rarement ? Pas du tout
Q2 : quels sont les outils de communication institutionnelle
utilisés par le MICPME ?
ANALYSE DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
MICPME
81
3. Plan de communication
3.1. Objectifs
Q1 : les actions définies par le MICPME sont-elles en
cohérence avec les objectifs poursuivis ?
3.2. Messages
Q1 : les messages émis par le MICPME incitent ils les
cibles visées à se rapprocher de
l'institution ?
3.3. Cibles
Q1 : le plan de communication permet-il d'atteindre les cibles
?
? Oui
? Non
3.4. Moyens
Q1 : les moyens de communications mis en oeuvre par le MICPME
sont-ils efficaces ?
? Efficace
? Pas du tout efficace
| 


