1.2.2 Les mécanismes de défenses de la
personnalité limite
« Les mécanismes de défense sont des
stratégies inconscientes mises en place afin de protéger le Moi
contre l'envahissement par l'angoisse et/ou la souffrance dépressive.
» (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de
défense)
Si ces stratégies adaptatives ont pu être utiles
à un moment donné, elles peuvent parfois persister même
lorsque le contexte qui les a suscitées n'est plus présent. Cela
peut conduire à une rigidification de la
personnalité.
En ce qui concerne les troubles limites, identifier ces
mécanismes revêt une grande importance à la fois pour le
thérapeute et pour le patient. Alors que cela fournit au
thérapeute des informations diagnostiques précieuses, un travail
dynamique visant à explorer consciemment ces modes de fonctionnement
peut aider le patient à éviter les pièges posés par
ces mécanismes rigides devenus incapacitants. (Estellon, V. (2011).
Les mécanismes de défense.
Dans : Vincent Estellon éd., Les états limites
(pp. 55-63))
Dans son ouvrage, l'auteur Estellon
évoque plusieurs mécanismes de défense : 1. Le
clivage
Le clivage est l'opération défensive essentielle
utilisée par les états limites. Son but principal est
d'éviter la confrontation du sujet face à son ambivalence
affective et à la souffrance dépressive. Heinz Kohut, dans ses
travaux sur les pathologies narcissiques, distingue le clivage
horizontal et le clivage vertical. (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
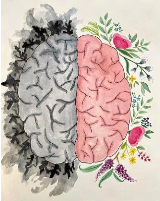
J'aimerais porter une attention particulière au clivage
horizontale, qui expose la particularité de la pathologie limite. Ayant
un narcissisme défaillant, lui aussi, poreux, ce dernier blessé,
provoque une diminution de l'énergie narcissique qui a comme effets
directs une faible estime de soi, une tendance à la honte, et aux
inhibitions. Ce clivage de type qualitatif amènera cette propension
pathologique aux pensées et affects manichéens.
Ce clivage opère avec la même force sur le Moi qui va tantôt
être idéalisé, tout-puissant, omnipotent, puis tout
à coup assimilé au déchet, au rien, au vide, proche de
l'idée de ruine mélancolique. (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
13
2. Le Déni
|
En complément du clivage et étayé par
lui, le déni permet de retirer de la conscience et de maintenir
isolés certaines pensées ou émotions qui ne correspondent
pas à la position affective, thymique dans laquelle le sujet
préfère se situer. Tout ce qui pourrait fragiliser
l'équilibre psychique par son caractère contradictoire ou ambigu
est écarté de la conscience. Le sujet refuse de reconnaître
une dimension traumatisante de la réalité. (Estellon, V.
(2011). Les mécanismes de défense)
|
|
3. L'identification projective
|
Cette défense est très utilisée par les
pathologies limites, elle s'exprime par des fantasmes inconscients permettant
au sujet d'introduire des parties de sa propre personne dans l'autre dans le
but de le contrôler, le posséder ou le détruire.
(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)
|
|
14
Il s'agirait de pouvoir faire de l'autre un double imaginaire
garant de l'identité de soi.
L'association de l'identification et de la projection peut
sembler complexe car ces mécanismes impliquent
généralement des mouvements opposés. En effet,
l'identification permet au sujet d'adopter certaines qualités de
personnalité de l'autre (comme le système de valeurs par exemple,
au hasard...) tandis que la projection consiste à rejeter et à
expulser certaines qualités personnelles sur autrui : tout ce que je
considère comme négatif et dont je veux me débarrasser est
projeté sur quelqu'un d'autre.
· Ces deux mécanismes participent au
développement psychique normal de l'individu : faire
sien ce qui apparaît bon et attrayant et jeter à
l'extérieur ce qui semble menaçant et dangereux.
(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)
15
Melanie Klein met en évidence l'importance de la
projection des aspects "bons" pour favoriser le développement de
relations d'objets saines et l'intégration du Moi, facilitant ainsi
l'empathie. (Klein, M. (1984). Love, guilt, and reparation, and other
works)
De même, W. R. Bion a mis en lumière que ces
mécanismes sont fondamentaux pour la structuration de la psyché,
car ils permettent à la pensée d'accéder à la
symbolisation et de se détacher de l'objet. (Bion, W. R. (1989).
Elements of psycho-analysis.)
L'identification projective devient pathologique
lorsqu'elle cesse d'être transitoire, lorsqu'elle devient un
moyen de dénier la réalité. Le sujet, en
s'identifiant aux parties de l'objet contenant ses propres parties
clivées/projetées, se perd dans une perception confuse où
l'autre c'est lui. (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de
défense)
4. L'idéalisation primitive, l'omnipotence et la
dévalorisation

Le mécanisme d'idéalisation, fonctionne aussi de
manière complémentaire avec le clivage. L'objet, est fortement
idéalisé, idolâtré. Ne présentant aucune
faille, ne pouvant décevoir, paré de toutes les qualités,
cet objet est présenté comme « parfait ». Ce « bon
objet » idéalisé est censé protéger le sujet
contre les « mauvais objets ». (Estellon,2011)
L'idéalisation peut s'envi-sager comme le pendant du rejet :
tandis que celui-ci s'ap-plique à tout ce qui est exclu, celle-là
aspire à la prise de puissance et à la jouissance.
Kernberg la qualifie de « primitive » pour l'opposer
aux formes plus tardives d'idéalisation telles qu'on les rencontre chez
les dépressifs qui idéalisent les objets pour se protéger
du sentiment de culpabilité
Pierre Auguste Cot (French, 1837-1883) Spring
étroitement lié à leur agissement envers l'objet.

16
Dans l'idéalisation primitive, bien que le bon objet
soit sollicité pour protéger le Moi des objets mauvais dans le
monde environnant, il n'y a pas de véritable considération pour
l'objet idéal lui-même. Cet objet rêvé, protecteur,
doit donc lui-même être préservé des lacunes et des
fluctuations inhérentes à la condition humaine. L'identification
omnipotente contribuera à maintenir cette magnificence de l'objet.
(Estellon, 2011)
Le clivage permettra, lorsque des déceptions ou des
frustrations auront entaché la perfection de cet objet, de le
dénigrer, de le mépriser et de le désinvestir « aussi
facilement que les doigts de la main sont capables en un clin d'oeil de zapper
à l'aide de la télécommande un programme ennuyeux à
la télévision. » (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
Vincent Estellon a connu une patiente qui
changeait ainsi régulièrement d'amis et d'amants : dès
qu'ils devenaient frustrants, ils étaient « gommés »
selon son expression. C'est le phénomène de
dévalorisation.
= Résultat direct de l'omnipotence, le sentiment de
toute puissance, cela offre la possibilité de se détacher de
l'objet sans ressentir de souffrance lorsque celui-ci ne procure pas la
satisfaction attendue.
Le clivage garantit qu'une partie du Moi demeure
idéalisée (le Soi grandiose), de sorte que les
sentiments de souffrance, de frustration, de déception, de désir
ou de haine, lorsqu'ils sont éprouvés, sont toujours
attribués à l'action d'un autre malveillant. Ces réactions
exagérées permettent au Moi, dont les frontières sont
floues, de ne pas s'effondrer.
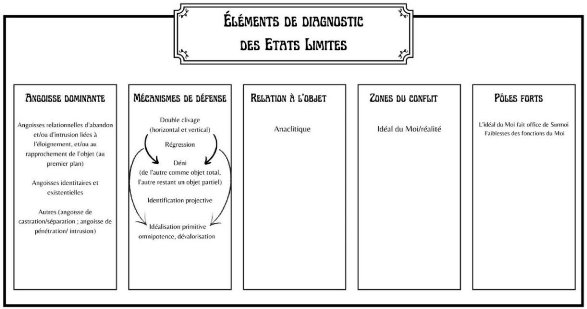
17
Tableau réalisé grâce
aux données du chapitre IV « Les mécanismes de
défenses » de Vincent Estellon (2019) Dans :
Vincent Estellon éd., Les états limites (pp.
54-62). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.
L'histoire du trouble de la personnalité borderline
est complexe et peut être considéré comme chaotique,
inclassable, un fourre-tout inépuisable...
Néanmoins, de grandes lignes se dessinent. En effet,
il s'agit initialement d'une pathologie ou de symptômes n'entrant pas
dans les cadres classiques de la typologie freudienne, répartissant les
structures de la personnalité entre les structures psychotique,
névrotique et perverse.
A partir des travaux psychanalytiques vu plus haut,
au-delà de sa simple définition en psychopathologie, la question
des limites offre un domaine d'étude large mais riche en analyse.
Pour terminer cette revue clinique intense autour de cette
pathologie, nous allons exposer la définition qu'en donne l'organisation
mondiale de la santé, dans sa version la plus récente, avec le
DSM-V, selon son modèle alternatif des troubles de la
personnalité.
18
1.3 Le modèle alternatif de la personnalité
(MATP)
Cette partie provient entièrement du Manuel de
Diagnostique et statistique des troubles mentaux. (American Psychiatric
Association et American Psychiatric Association, éditeurs.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,
American Psychiatric Association, 2013)
|
|
|
L'approche actuelle des troubles de la personnalité
figure dans la
section II du DSM-5 et un modèle alternatif
développé pour le DSM-5 est présenté ici dans la
section III. L'inclusion de ces deux modèles dans le DSM-5 correspond
à la décision du Conseil d'administration de l'Association
américaine de psychiatrie (APA Board of Trustees) d'assurer la
continuité avec la pratique clinique actuelle tout en introduisant une
nouvelle approche destinée à pallier les nombreux défauts
de l'approche traditionnelle des troubles de la personnalité. (American
Psychiatric Association et American Psychiatric Association, éditeurs.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,
American Psychiatric Association, 2013)
Dans le modèle alternatif du DSM-5 qui suit, les
troubles de la personnalité sont caractérisés par des
altérations du fonctionnement de la personnalité et par des
traits de personnalité pathologique. Les diagnostics spécifiques
de troubles de la personnalité qui peuvent ressortir de ce modèle
sont les personnalités antisociale, évitante, borderline,
narcissique, obsessionnelle-compulsive et schizotypique. (American Psychiatric
Association et American Psychiatric Association, éditeurs.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,
American Psychiatric Association, 2013)
Les altérations du fonctionnement de la
personnalité et l'expression des traits de personnalité ne sont
pas mieux comprises comme faisant partie d'un stade normal du
développement ou d'un environnement socioculturel normal. Un diagnostic
de trouble de la personnalité nécessite deux conditions :
1) une évaluation de l'altération du niveau de
fonctionnement de la personnalité, nécessaire pour le
critère A
19
2) une évaluation des traits de personnalité
pathologique, nécessaire pour le critère B
· Critère A : niveau de
fonctionnement de la personnalité Le noyau de la
psychopathologie de la personnalité réside dans
les perturbations du fonctionnement de la personnalité au niveau du soi
(Bender et al., 2011) et de la sphère interpersonnelle
évaluées dans ce modèle alternatif sur un continuum. Le
fonctionnement du soi comprend l'identité et l'autodétermination
; le fonctionnement interpersonnel comprend l'empathie et l'intimité.
L'altération du fonctionnement de la
personnalité est un élément de prédiction de
l'existence d'un trouble de la personnalité et la
sévérité de l'altération prédit si
l'individu a plus d'un trouble de la personnalité ou l'une des formes
typiquement graves de troubles de la personnalité (Morey et al., 2011).
Un niveau d'altération du fonctionnement de la personnalité
d'intensité au minimum moyenne est requis pour le diagnostic de trouble
de la personnalité. Ce seuil diagnostique repose sur des bases
empiriques ; c'est en effet ce niveau qui correspond de façon optimale
à la capacité du clinicien à identifier de façon
adéquate et efficace une pathologie de la personnalité (Morey et
al., submitted for publication). (American Psychiatric Association et American
Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual
of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association,
2013)
· Critère B : Les traits
pathologiques de personnalité appartiennent à cinq grands
domaines : l'affectivité négative, le détachement,
l'antagonisme, la désinhibition et le psychoticisme. Vingt-cinq facettes
de traits sont réparties dans ces cinq grands domaines. Ces facettes
proviennent initialement d'une revue des modèles de traits de
personnalité existants et des recherches répétées
effectuées chez des patients faisant appel à des services de
santé mentale (Krueger et al. 2011a ; Krueger et al. 2011b ; Krueger et
al. 2012). Les critères B pour les différents troubles de la
personnalité comprennent des sous-ensembles de ces 25 facettes de traits
issus de revues avec méta-analyses (Samuel et Widiger 2008 ; Saulsman et
Page 2004) et de données empiriques sur les relations entre les traits
de personnalité et les diagnostics de troubles de la personnalité
selon le DSM-IV.
20
1.3.1 Le trouble de la personnalité borderline selon
le MATP
Selon le DSM-V, les caractéristiques typiques de la
personnalité borderline sont l'instabilité de l'image de soi, des
objectifs personnels, des relations interpersonnelles et des affects,
associée à l'impulsivité, à la prise de risque
et/ou à l'hostilité. . (American Psychiatric Association et
American Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and
statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American
Psychiatric Association, 2013)
Les difficultés caractéristiques
sont apparentes au niveau de l'identité, de l'autodétermination,
de l'empathie et/ou de l'intimité, comme cela est décrit
ci-après, avec des traits mal adaptés spécifiques dans le
domaine de l'affectivité négative, de l'antagonisme et/ou de la
désinhibition.
| 


