« La société occidentale se fonde sur les
principes de l'individualisme, conception structurante dans laquelle la
liberté individuelle est considérée comme un droit que les
institutions doivent protéger. » (Blaha Stephen, 2002 The
rhythms of history: a universal theory of civilizations, Pingree-Hill
Publishing)
Après les guerres, la révolution, il y a eu un
réel désir d'émancipation à l'égard de ce
passé intolérable. Passant par la dénonciation des abus de
pouvoir de l'Etat et de la religion, l'écriture des droits de l'homme et
du citoyen... la liberté est plus qu'une valeur, elle devient l'essence
même de l'Homme. (Rosanvallon P., Le modèle politique
français. La société civile contre le jacobinisme de 1789
à nos jours, Le Seuil, 2004.)
En France, la révolution de 1789 a marqué
l'avènement d'un « individualisme citoyen » (Ro-sanvallon P.,
Le modèle politique français. La société civile
contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004) qui a
refondé les relations traditionnelles entre l'autorité publique
et ses administrés.
Pierre Le Coz dirige notre attention sur la liberté qui
est la première valeur citée dans la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen. Mieux qu'une valeur, la liberté devient
l'essence même de l'homme : « Tous les hommes naissent libres
(...) ».
Avec l'octroi de ses nouveaux droits, le citoyen
français devient le fondement de la légitimité politique,
en choisissant ses dirigeants et en dictant les lois par le biais de ses
représentants.
· Si cet idéal d'indépendance et
d'autosuffisance deviennent la norme sociale, alors il entre en conflit avec
les difficultés rencontrés par les personnes souffrant de trouble
de la personnalité borderline. En effet, leur fonctionnement
étant centré sur un Idéal du moi fort ces sujets pourront
avoir tendance à fortement intériorisé cette norme et donc
être en quête d'indépendance et d'autosuffisance de
manière extrême ou du moins déconnectés de la
réalité. Cependant, leurs instabilités
émotionnelles, relationnelles et identi-taires, ainsi que leur peur de
l'abandon, rendent cet objectif difficile à atteindre. La tension entre
le désir d'indépendance et la dépendance
émotionnelle et psychique, caractéristique des personnes
borderline, est perceptible en raison du besoin de combler tous ces
manquements. Cette tension reflète les efforts constants des personnes
borderline pour concilier leurs besoins d'autonomie avec leurs besoins
affectifs et relationnels.
Cette ère contemporaine abolie l'autorité du
passé, les individus, avide de nouveauté, se donne le droit
d'innover, d'inventer. Les valeurs telles que l'autonomie, la
créativité, l'indépendance, le droit à
l'intimité ainsi que le droit au pouvoir, ou du moins son
accessibilité étaient promues.
De plus, cette dynamique individualiste pris une tournure
qualifiée d'hédoniste, c'est-à-dire dans la valorisation
du plaisir, la promotion des loisirs et du divertissement.
Les années 60 résonne avec cette période
d'émancipation des corps, de la libération des moeurs, du sexe et
des affects avec mai 68. C'est aussi à cette période où
une extension du consumérisme s'opère, augmentant toujours plus
le choix du matériel, on bascule dans le cycle de la production et des
échanges marchands. Parallèlement au désir de vivre pour
soi qui n'a cessé de s'affirmer et de se déculpabiliser.
(Lipovetsky G., Les temps hypermodernes, Paris, Grasset,
2004.)
30
Pierre Le Coz attire notre attention un changement dans les
stratégies de mobilisation pour le don de sang, passant d'un appel
basé sur le devoir à un message mettant en avant le pouvoir de
chacun et la reconnaissance personnelle. Il cite le cas de l'Etablissement
français du sang qui fait appel à des professionnels de la
communication et de la psychologie sociale.
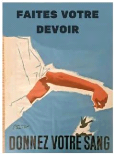
Le slogan incitatif tel que « Faites votre devoir, donnez
votre sang ! » n'éveille plus d'écho. Il a fait place
à un nouveau message plus gratifiant : « partagez votre pouvoir,
donnez votre sang ! »

(Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de
l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)
Traditionnellement fondée sur le devoir
désintéressé, la pratique du don de sang évolue
pour répondre à une sensibilité dominante axée sur
la gratification personnelle et la reconnaissance individuelle.
Cela ne signifie pas la disparition de toute éthique,
mais plutôt un déplacement vers une éthique plus
axée sur les sentiments et la spontanéité, où les
individus sont motivés par la compassion et le coup de coeur
plutôt que par un sens du devoir. En résumé, la
générosité persiste comme une valeur sociale, mais elle
est désormais influencée par des motivations plus personnelles et
émotionnelles, reflétant un changement vers un individualisme
ambiant.
« L'homme de l'hypermodernité individualiste est
en quête de reconnaissance de ses mérites et de gratifications
narcissiques. Il ne va plus de soi de donner de soi, de consacrer son
énergie et son temps à une cause universelle, impersonnelle et
collective. » (Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de
l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)
Evidemment l'auteur souligne que l'évolution vers
l'individualisme ne conduit pas nécessairement au nihilisme ou à
la perte totale des normes éthiques. Il est erroné de penser que
le cynisme prévaut et que les relations interpersonnelles deviennent de
plus en plus déshumanisées. La générosité
reste une valeur essentielle dans la société.
L'éthique n'a pas disparu, mais elle est moins
sacrificielle et plus affective.
31
3.2 Le concept d'individualisme d'un point de vue
sociologique : Réflexion et liens
L'individualisme est une conception philosophique, politique,
morale et sociologique où l'individu occupe la place centrale. Il s'agit
donc d'une primauté de l'identité personnelle par rapport
à l'identité collective. Cette notion peut être
étudié sous plusieurs perspectives distinctes, ici nous
l'analyserons principalement en tant que phénomène
sociologique.
Norbert Elias, sociologue, analyse l'individualisme comme
coexistant à une intensification des interdépendances sociales
entre individus, qui pousserait l'individu à se construire un «
refuge intérieur. » L'auteur dit que l'individu garde ses pulsions
et ses émotions dans la sphère privée et évite de
les dévoiler à autrui. Il les contient et les transforme,
accentuant ainsi les différences de comportements, de sensations, de
pensées, d'objectifs et d'apparence physique entre les individus.
(Elias, N. (2018). La société des individus. Pocket)
Dans une conférence de Xavier Coton, psychiatre, et
Raphaël Gazon, psychologue et psychothérapeute, ces professionnels
explicitent que dans notre société occidentale, le mouvement
individualiste valorise plutôt le contrôle des émotions et
la maîtrise comme critères de succès. Les comportements des
personnes matures sont supposés être contrôlés par
des forces internes. Si la personne se définit par ses relations aux
autres, elle est considérée comme immature et donc se retrouve en
marge de la norme, rejeté et jugé négativement (les
valeurs sociales étant des jugements sur ce qui est juste et injuste
dans les relations sociales). (Conférence : Mieux comprendre le
trouble de la personnalité « borderline » (état limite)
de mon proche. Quand les émotions perturbent la vie, 2012)
Paradoxalement, le sociologue français Ehrenberg
explique dans son article « La société du malaise : Une
présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie. »
(2011) que tout ce qui concerne les émotions, les affects, les
sentiments moraux, la subjectivité individuelle, est passé au
coeur de la vie sociale des sociétés dites
développées. Ce déplacement s'explique par la valeur
grandissante accordée à la santé mentale et à la
souffrance psychique.
Ce changement a accompagné les transformations des
manières de « faire société », que rassemble la
notion d'autonomie. Celle-ci désigne de prime abord deux types de
valeurs intriquées de l'individualisme : le choix personnel et
l'initiative individuelle. Elles se donnent dans trois aspects de la
compétition, de la coopération et de l'indépendance. Le
point crucial est alors la place de la responsabilité personnelle dans
la vie sociale. Selon cet auteur, ces trois éléments, choix,
initiative et responsabilité, forment le tournant personnel de
l'individualisme.
32
(Ehrenberg, A. (2011). La société du malaise
: Une présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie.
Adolescence, 293, 553-570)
· Nous pouvons remarquer que les valeurs qu'engagent le
processus de l'individualisme pose une certaine ambivalence avec le fait de
vivre en communauté : l'autonomie (quête d'indépendance),
l'individu au centre d'intérêt plutôt que le collectif, les
affects et émotions, pris en compte mais seulement individuellement et
la coopération elle, pour arriver à des fins individuelles.
Et c'est que souligne les auteurs Nisbet & Azuelos, qu'en
effet, l'individualisme montre le processus de distanciation de l'individu par
rapport à ses groupes d'appartenance, au sein d'une
société où s'établit progressivement la
primauté de l'individu sur le collectif ; c'est en ce sens que
l'individualisme est souvent assimilé à un égoïsme
croissant, dans un rapprochement péjoratif. (Nisbet, R. A., &
Azuelos, M. (2011). La tradition sociologique (5e éd). Presses
universitaires de France.)
Ehrenberg va dans ce sens également que d'après
lui, on ne peut pas avoir de société individualiste,
c'est-à-dire de société qui donne la même valeur
à tout être humain, si on ne brise pas les liens de
dépendance entre les gens. (Ehrenberg, A. (2011). La
société du malaise : Une présentation pour un dialogue
entre clinique et sociologie. Adolescence, 293, 553-570.)
Borderline, une dissonance de la personnalité
?
· Finalement, ce qu'il ressort de l'individualisme dans
la société occidentale, c'est que la dépendance aux
autres, aux groupes n'est pas acceptée (acceptable ?...) Comme l'a dit
le philosophe Aristote, repris par la suite dans le champ de la psychologie
sociale, nous sommes des animaux sociaux vivant en société donc
en collectif, un système de valeurs prônant des
intérêts individuels et non collectifs, pourrait provoquer des
dissonances dans les comportements et donc dans la personnalité, comme
vu précédemment avec Bilsky & Schwartz, (1994) qui constatent
que les valeurs et la personnalité peuvent s'influencer mutuellement.
Or, les valeurs sont conçues comme consensuelles et
éminemment prosociales : provenant d'un consensus, elles
régulent les rapports sociaux (Moscovici et Doise, 1992).
En effet, d'après Morchain, l'organisation du
système de valeurs est en lien direct avec les groupes sociaux. L'auteur
explique que les valeurs s'inscrivent dans un processus de comparaison sociale
: les personnes comparent leurs perceptions, sensations, croyances, à
celles
33
des autres personnes. Une des conséquences de la
comparaison est un clivage net entre les groupes (« Ils n'ont pas les
mêmes valeurs que nous ! »). Toutefois ce clivage n'est pas
forcément le produit biaisé des évaluations :
l'organisation des valeurs est bien sûr différente d'un groupe
social à un autre. (Morchain, P. (2009). Chapitre 1. Que sont les
valeurs ? Tentative de définition(s). Dans :, P. Morchain,
Psychologie sociale des valeurs (pp. 7-27). Paris : Dunod.)
· Un système de valeurs qui prônent des
comportements individualistes pourrait donc être un non-sens
entraînant des mouvements dissonants chez les individus
par rapport aux groupes. Mais si les rapports sociaux régulent les
comportements des individus afin de créer un corps social
coordonné, ces valeurs peuvent être « antisociales » et
tout de même partagées dans un groupe.
3.3 Lien entre la personnalité borderline et
l'individualisme
Comme vu précédemment, les personnalités
borderline sont des individus qui éprouve une forte dépendance
à l'autre, et qui ont de grande difficulté à gérer
leurs émotions. Le système de valeurs de l'individualisme,
valeurs majoritairement présentent dans la société,
prônant l'inverse de ces comportements, les rejetant donc, pourrait
accentuer l'insécurité générale qu'éprouve
un sujet autour de la question identitaire, de l'estime de soi, de la peur de
l'abandon, du rejet ... principales critères diagnostiques de cette
pathologie.
Avec un Idéal du Moi au centre du
conflit avec la réalité, maîtrisant avec force, ses
comportements, en remplaçant le Surmoi, le sujet borderline va avoir
tendance a fortement intériorisés les normes, et donc les valeurs
de son environnement. Comme vu précédemment, quête vaine
dû à sa forte dépendance à l'autre.
Pour reprendre ce nous disions plus haut, nous pouvons voir
cette ambivalence avec l'apport du sociologue Norbert Élias. La
primauté de l'individuel donne à une personne un « refuge
intérieur » amenant à contenir ses émotions et
pulsions, ce qui est l'inverse du sujet borderline qui lui, ne peut contenir
ses émotions, au contraire il les dévoile, il se « vide
», comme vu précédemment avec la notion d'hémorragie
psychique explicité par Adolph Stern.
Nous nous demandons donc quels valeurs les
personnalités borderlines intériorisent, et ce que nous pouvons
en conclure avec l'individualisme.
C'est ce nous allons explorer et découvrir...



