CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE
? pH: Pour le pH, la plupart des
actinomycètes se comportent comme des bactéries neutrophiles, et
font une croissance optimale dans un intervalle de pH compris entre 7 et 8.
Mais on peut observer une croissance à des valeurs de pH
inférieurs à 4 (R.E.McKinney,2004), telle est le
cas pour les souches acidophiles comme le genre Streptacidiphilus
(L.Wang et al.2006).
? Température: La température
optimale de croissance est entre 25 à 30°C, mais les espèces
thermophiles peuvent croitre à des températures entre 55 et
65°C (G.Rangaswami et al.,2004).
? Tolérance en NaCl: Selon leurs
exigences en NaCl, les microorganismes sont divisés en deux groupes :
? Les halophiles : Ce sont ceux qui ont besoin de sel (NaCl)
pour leurs croissances, cette concentration peut varier de 1 à 6 %
(Poids/Volume) pour les faiblement halophiles, jusque 15 à 30 % pour les
bactéries halophiles extrêmes.
? Les halotolérants : Acceptent des concentrations
modérées de sels mais non obligatoires pour leurs croissances. On
distingue, ceux qui sont : légèrement tolérants
(tolère de 6 à 8 % de NaCl (Poids/Volume) ; les
modérément tolérants (tolère de 18 à 20 % de
NaCl (P/V) ; et les extrêmement tolérants (se développe de
0 % jusqu'à saturation en NaCl) (H.Merizig,2015).
1.1.4. Matériel génétique des
actinomycètes
Le matériel génétique des
actinomycètes est constitué d'ADN (Acide
désoxyribonucléique) chromosomique ainsi que chez certaines
souches par l'ADN plasmidique ou de l'ADN phagique. La plus part des
actinomycètes sont caractérisées par une proportion
élevée en (G/C) environ 70 %.
Elles possèdent un remarquable degré de
variabilité génétique due à des
réarrangements du
génome à cause de plusieurs types de mutations
essentiellement chromosomiques, les plasmides peuvent aussi être sujets
à des réarrangements. (H.Merizig, 2015).
8
CHAPITRE 1 : ETUDES BIBLIOGRAPHIQUE 1.1.5. Cycle de
développement des Actinomycètes
Le cycle de vie de nombreux actinomycètes commence par
la germination des spores (Figure 2). Ce processus
nécessite la présence des ions de calcium. Cette germination
donne naissance à un mycélium primaire ramifié
(R.O'Gara et al., 2008). Un mycélium
aérien vient s'installer au-dessus du mycélium de substrat. Ce
dernier s'autolyse et les produits de la lyse sont utilisés par le
mycélium aérien. C'est généralement, à ce
moment-là que les composés dit métabolites secondaires
sont synthétisés (S.Smaoui, 2010). A
l'extrémité du mycélium aérien se forme des spores
asexuées à paroi fine appelées conidies ou conidiospores.
Ces spores naissent par séptation du mycélium primaire
habituellement en réponse à un stresse environnemental comme le
manque de nutriment par exemple. Si les spores sont enveloppées dans un
sac, on les appelle des sporongiospores.
Généralement ces spores ne sont pas
résistantes à la chaleur, mais résistent bien à la
dessiccation et sont donc doués de capacités adaptatives
importantes. Les actinomycètes sont immobiles, excepté pour les
spores de certains genres (Actinoplan, Spirillospora....etc.)
(L.M.Prescott et al,2010).
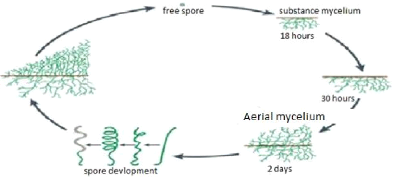
Figure 2: Cycle de développement des
actinomycètes sur milieu solide (A. Breton et al
.,1989).
1.1.6. Ecologie des Actinomycètes
Historiquement, les actinobactéries étaient
largement considérées comme des bactéries du
sol, mais sont maintenant reconnues comme étant
cosmopolites. On les trouve dans pratiquement tous les
écosystèmes, avec une distribution couvrant la plus grande partie
de la
9
| 


