PARTIE I
_____
APPORTS
THEORIQUES
INTRODUCTION.
On attribue à Hans Berger la découverte du
rythme alpha en 1924. Les ondes reconnues par Berger sur l'enregistrement EEG
étaient des ondes d'environ 10 cycles par seconde, dominantes, stables
et synchrones qui étaient produites lors de la fermeture des yeux et
durant les états de relaxation. Berger note également que les
ondes alpha sont remplacées par des ondes bêta à
l'ouverture des yeux ou lorsque les sujets étaient engagés dans
une activité mentale telle que des calculs arithmétiques. Pour
Berger les ondes alpha représentent une forme de fonctionnement
automatique, un état de préparation à l'action qui existe
quand le sujet est éveillé et conscient mais inattentif.
Les sons binauraux d'une différence de fréquence
de 8 à 13 Hz induisent la production d'ondes alpha par le cerveau
(Foster, 1990), lesquels sont mis en évidence par enregistrement EEG,
les yeux restant ouverts. De nombreuses recherches associent les ondes alpha
à un état de détente, à l'augmentation de certaines
performances et à l'amélioration de l'humeur et de
l'anxiété. Ces effets seraient expliqués par la
synchronisation hémisphérique induite par les ondes alpha
(Hoovey, 1972).
Les sons binauraux d'une différence de fréquence
de 16 à 24 Hz induisent la production d'ondes Bêta. En
conséquence, ils tendent à augmenter la concentration et
l'état d'alerte (Monroe, 1985). Ils améliorent également
les performances mnésiques (Kennerly, 1994). L'entraînement
cérébral augmentant les ondes bêta est couramment
utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement du trouble
de déficit de l'attention ainsi que dans la remédiation de
l'attention chez les traumatisés crâniens. Ces protocoles ont fait
l'objet de nombreuses publications dont nous parlerons plus en détail
lors de nos recherches ultérieures.
Les sons binauraux dont la différence de
fréquence est de 4 à 8 Hz induisent des ondes thêta dont
Schacter (1977) a dressé la liste des effets dans une méta
analyse. Elles sont associées à des états subjectifs de
relaxation profonde, de méditation et de créativité (Hiew,
1995). Les ondes thêta favorisent l'apprentissage en améliorant la
concentration et la focalisation détendue sur une tâche (Pawelek,
1985).
Les sons binauraux d'une différence de fréquence
de 1 à 4 Hz provoquent l'apparition d'ondes delta qui induisent le
sommeil ainsi que des phénomènes de rêve
éveillé (Davis, 1938).
II. SONS BINAURAUX ET
ATTENTION.
1. Définitions :
attention et mémoire de travail.
L'attention comporte différentes composantes, que l'on
peut décrire selon un continuum de durée et d'intensité.
À une extrémité de ce continuum, nous pouvons
décrire l'alerte tonique comme l'état d'éveil d'un sujet
tandis que la vigilance est un « un état de préparation
à détecter et à réagir à certains
changements discrets apparaissant à des intervalles de temps variables
au sein de l'environnement » (Mackworth, 1957, cité par Seron et
Van der Linden, 2004, p. 99).
L'attention sélective est « la
capacité du sujet à investir les ressources de traitement dont il
dispose sur les éléments pertinents de la situation ou de la
tâche, tout en inhibant les éléments distracteurs. Le
mécanisme qui la sous-tend est double : d'une part, l'activation de
processus de centrations sur l'objet de l'attention et, d'autre part,
l'inhibition active d'éléments distracteurs potentiellement
perturbateurs et pouvant interférer avec la localisation (Seron et Van
Der Linden, 2004, p. 101).
La flexibilité cognitive est la capacité de
passer d'une tâche à l'autre alternativement, et donc de garder
à l'esprit les consignes des deux tâches ainsi que d'inhiber la
tâche non en cours. Il s'agit de déplacer le foyer de
l'attention.
L'attention soutenue enfin, à l'extrémité
du continuum, nécessite la part du sujet un traitement actif
ininterrompu ; « il s'agit pour le sujet de maintenir un niveau
d'efficience adéquat et stable au cours d'une activité d'une
certaine durée sollicitant un contrôle attentionnel
continu » (Seron et Van Der Linden, 2004, p. 98) ; en vie
quotidienne, une attention soutenue de bonne qualité permet la conduite
automobile, le travail intellectuel ou manuel et toutes les tâches qui
nécessitent un coût attentionnel important durant une
période de temps relativement longue.
La mémoire à court terme ou mémoire
immédiate est une mémoire de capacité limitée
englobant l'analyse de l'information sensorielle au niveau des aires
cérébrales spécifiques et sa reproduction immédiate
pendant un temps de rémanence très brève de l'ordre d'une
à deux minutes (Gil, 2004). On distingue l'empan auditif et l'empan
visuel (nombre d'items retenus), mesurée par les subtests des
échelles de Wechsler (WAIS, MEM III).
Baddeley (1993) a introduit le concept de mémoire de
travail : il s'agit d'un système de capacité limitée,
une mémoire tampon, qui permet de stocker et de manipuler des
informations au cours de résolution de tâches. Dans les
modèles actuels, la mémoire de travail fait partie des fonctions
attentionnelles. Le modèle de Baddeley décrit un administrateur
central qui coordonne des systèmes esclaves, dont la boucle phonologique
(stockage des informations verbales) et le calepin-visuo spatial (informations
visuelle, le « quoi » et le
« où »).
2. Revue de la
littérature.
Diana S. Woodruff (1975) a recherché les relations
entre fréquences alpha, temps de réaction et âge des
sujets. Elle a montré chez cinq sujets jeunes et cinq sujets
âgés une diminution du temps de réaction auditif lorsque
les sujets augmentaient leur production d'ondes alpha par une technique de
biofeedback.
Lane (1998) a comparé les effets de l'application de
sons binauraux induisant des ondes bêta, delta et thêta sur
l'attention : la vigilance, le contrôle de l'attention et l'humeur
étaient améliorée par les sons binauraux dont la
différence de fréquence correspondait au rythme bêta que
tandis que vigilance et attention diminuaient lorsque les sons binauraux se
trouvaient dans la gamme des ondes delta et thêta, avec des temps de
réaction plus longs et davantage de fausses alertes. Ces effets sont
confirmés par les travaux d'Atwater (2001) montrant une
corrélation entre l'augmentation de la vigilance et l'application de
sons binauraux de différence de fréquence bêta.
Plus récemment, en 2005, Butnik a montré
l'intérêt du neurofeedback dans le traitement du trouble de
déficit de l'attention avec hyperactivité chez des adultes et des
adolescents. À l'EEG, ce trouble est caractérisé par un
excès d'activité des ondes lentes (ondes thêta) ainsi que
par une réduction de l'activité des ondes rapides (ondes
bêta).
Oubré (2002) a également démontré
par une méta analyse l'efficacité du neurofeedback comme
traitement non médicamenteux du TDAH, pouvant remplacer les
psychostimulants et montrant un effet qui tient dans le temps.
3. Tests et taches
neuropsychologiques utilisés.
Les tests neuropsychologiques que nous avons
sélectionnés sont ceux habituellement présentés au
cours d'un bilan neuropsychologique, de façon à pouvoir comparer
plus facilement dans un deuxième temps les effets sur des populations
cliniques. Les tâches informatisées dont nous nous sommes servies
sont tirées d'un logiciel d'entraînement cognitif,
« HappyNeuron », édité par la
société SBT France sous la direction du Dr Bernard Croisile. Ces
mêmes logiciels sont fréquemment utilisés en
remédiation neuropsychologique.
Tests neuropsychologiques utilisés pour les
fonctions attentionnelles :
Le Trail Making Test, formes A et B (Reitan,
1971) est une épreuve papier/crayon comportant deux feuilles ; sur
la première (forme A), le sujet doit relier les chiffres de 1 à
25 dans l'ordre chronologique le plus rapidement possible ; sur la
deuxième (forme B), le sujet doit relier alternativement un chiffre et
une lettre, les chiffres dans l'ordre croissant (1 à 13) et les lettres
dans l'ordre alphabétique (A à L). La forme A de cette
épreuve permet d'évaluer la rapidité de traitement de
l'information tandis que la forme B évalue les fonctions
exécutives. La comparaison des deux temps de réalisation permet
d'évaluer la flexibilité attentionnelle du sujet.
Le test de Stroop (1935) : cette épreuve
comporte quatre tâches successives : lecture durant 45 secondes du
maximum de noms de couleurs écrits en noir et blanc, puis mêmes
consignes, les noms de couleurs étant écrits de
différentes couleurs. La troisième épreuve consiste en une
dénomination de carrés de couleurs : le sujet doit nommer un
maximum de couleurs eu 45 secondes ; au cours de la quatrième
épreuve, dite d'interférence, le sujet doit reprendre la planche
des noms de couleurs colorés, et donner la couleur d'impression de
chaque mot, en ignorant le mot écrit. Il doit donc inhiber
l'activité automatique de lecture. Nous avons conservé les
performances de la quatrième épreuve ainsi que le score
d'interférence calculé en soustrayant le score de la
quatrième épreuve au score de la troisième
épreuve.
Le test D2 de Brickenkamp (1966) : il s'agit d'une
épreuve de barrages constituée d'une feuille de 14 lignes dans
laquelle le sujet doit cocher le plus rapidement possible durant 20 secondes
pour chaque ligne la lettre « d » associée à
deux apostrophes tout en ignorant les distracteurs ( « d »
avec 1 ou 3 apostrophes et « p »). Le profil obtenu permet
d'évaluer la fatigabilité, la vitesse et l'efficacité du
traitement de l'information, l'attention sélective et l'attention
soutenue ; nous en conserverons le score global de performance (nombre
d'items traités - erreurs) et le score de concentration (performance -
omissions).
Tâches informatisées utilisées
pour les fonctions attentionnelles.
Alerte tonique : exercice « Haute
tension »
Dans cette tâche, une croix noire est
présentée très rapidement, suivie d'un point rouge. Il
s'agit d'indiquer le plus rapidement possible à l'aide des
flèches du clavier si le point rouge se trouvait situé au-dessus
ou en dessous de la croix noire. Le temps de réaction est mesuré
en millisecondes. Il y a trois niveaux de difficultés
(présentations de plus en plus rapides). Nous avons utilisé le
niveau moyen. Le score correspond au temps de réaction du
sujet.
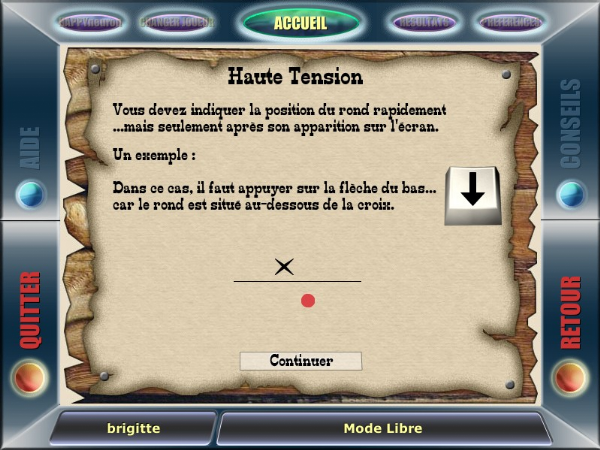
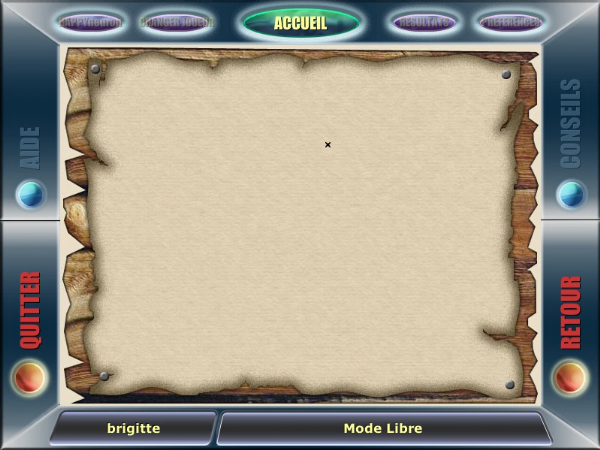
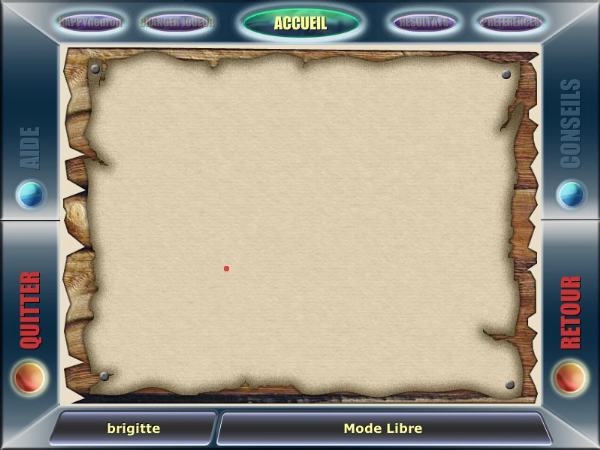
![]()
Résistance à l'interférence :
exercice « Ne vous laissez pas tenter » (tâche de
type Stroop)
Cet exercice est une version informatisée du test
de Stroop. Il existe deux niveaux de difficultés : au premier niveau, la
couleur demandée reste affichée à l'écran ; au
second niveau elle disparaît après une présentation d'une
seconde. Nous avons utilisé le premier niveau. Le score tient compte du
temps de réalisation de l'exercice et des erreurs commises.
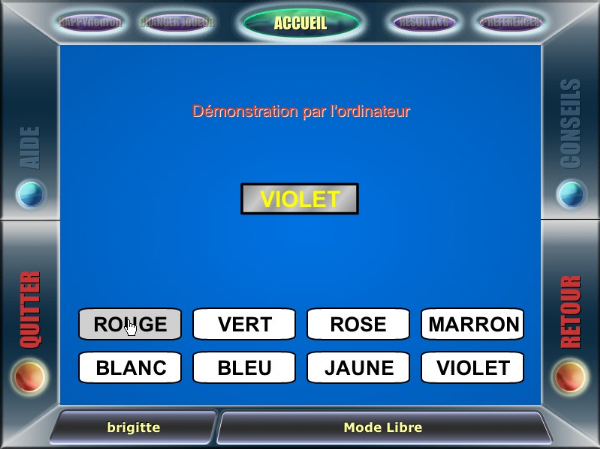
![]()
Attention sélective : exercice
« Cherchez l'intrus »
Dans cette tâche, le sujet doit détecter
l'intrus dans une grille (en vert sur l'écran), intrus qui lui a
été présenté au préalable, en ignorant la
présence d'un item perturbateur (en jaune). L'exercice est
chronométré et permet de mesurer la vitesse de traitement de
l'information. Trois niveaux sont disponibles, ainsi que différents
types de grilles (chiffres et lettres, signes, formes
géométriques). Le niveau sélectionné est le niveau
moyen avec perturbateur, les grilles sont composées de chiffres et de
lettres.

![]()
Attention sélective et attention soutenue :
« Comparaison de caractères d'écriture »
Dans cet exercice, il s'agit de comparer items par item
deux lignes de caractères d'écriture ou de symboles, le plus
rapidement possible. Les deux lignes à comparer peuvent être
disposées l'une en dessous de l'autre, ou décalées, ou
encore perpendiculaires. Il existe deux niveaux de difficulté, selon le
nombre de caractères à comparer ; nous avons choisi le plus
difficile, huit caractères.
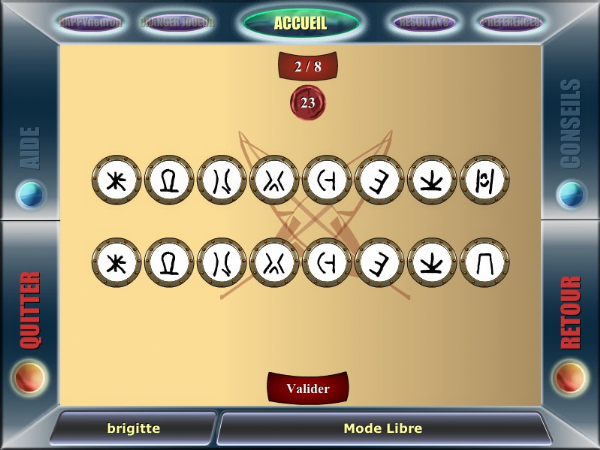
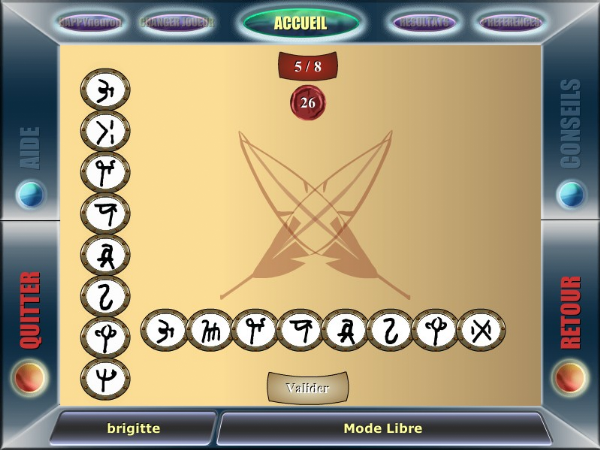
![]()
Tests neuropsychologiques utilisés pour la
mémoire immédiate et pour la mémoire de travail.
Les épreuves standardisées utilisées pour
évaluer la mémoire auditive et la mémoire
visuelle immédiates (dépendant respectivement globalement de
l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit)
donnent des indications à la fois sur l'attention, la mémoire
immédiate et la mémoire de travail, ces trois systèmes
étant intimement liés ; d'ailleurs l'empan,
c'est-à-dire le nombre de chiffres répétés
correctement ou le nombre de blocs correctement pointés, est
également nommé « empan attentionnel » (Seron
et Van Der Linden, 2004, p. 107).
Les subtests de l'échelle de mémoire de
Wechsler, version III (MEM III).
Les subtests suivants ont été retenus :
- Mémoire des chiffres : il s'agit d'un
rappel immédiat de chiffres, permettant d'obtenir un empan verbal,
identique au subtest du même nom de la WAIS-R
- Mémoire spatiale : dérivée
du test des blocs de Corsi, cette épreuve consiste à
désigner une succession de blocs immédiatement après
l'examinateur, dans le même ordre. Elle permet d'obtenir un empan
visuo-spatial.
- Mémoire logique I : il s'agit du rappel
immédiat d'une histoire courte lue par l'examinateur.
- Reconnaissance des visages I : pour cette
épreuve, le sujet doit observer une série de 24 visages, puis
désigner parmi 48 visages ceux qu'il a vus auparavant.
- Mémoire des chiffres, ordre inverse : une
série de chiffres est lue au sujet qui doit les redonner en sens
inversé, en commençant par le dernier.
- Mémoire spatiale, ordre inverse : le sujet
doit désigner la succession de blocs montrés par l'examinateur,
mais en ordre inverse, en commençant par le dernier pointé.
| 
