CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL
1.1.COMPRENDRE LE CAFE ET LA CEFEICULTURE
a. Etymologie, Historique et Expansion du
café
Le mot café vient du mot arabe « Cahouah »
ou « Qahwah » qui signifie « ravigorant » et désigne
à la fois les graines et cerises du caféier, mais aussi la
boisson obtenue à partir de ces graines et le lieu de consommation de
cette boisson (Penilleau, 1864 ; Michelle et al., 2003). Nombreux
auteurs soutiennent que le café arabica a fait son apparition dans le
Sud-Ouest de l'Ethiopie, en Afrique (Allred et al., 2009). A partir de
son berceau d'origine, le café et la caféiculture se sont
étendus dans toutes les régions du monde et aujourd'hui, il est
possible de trouver le bon café dans toutes les grandes villes du monde
(Boulo, 2013). Le café robusta est quant à lui originaire du
bassin du Congo (Fomer, 2017). Précisons que l'expansion de la
caféiculture émane des colonisateurs (Epon Eboa et al.,
2019).
b. Classification botanique et description de la
plante
Les scientifiques ont dénombré plus de 124
espèces dans le genre Coffee (Davis et al.,2019) Cependant,
Adepoju (2017) précise que seules deux espèces sont
intéressantes pour la production et commercialisation :
- Coffee arabica (Linné) qui donne le café
arabica et - Coffee canephora (Pierre) qui donne le café
robusta.
La classification botanique du café arabica est
présentée par Bouden et Kadri (2019) : Règne : Plantae,
Division : Angiosperme, Classe : Dicotyledonae, Sous classe
: Euasterids, Ordre : Gentianales, Famille : Rubiaceae,
Sous Famille : Ixoroideae, Genre : Coffee L., Espèce
: Coffee arabica.
Le caféier est un arbuste tropical pouvant atteindre 10
à 12 mètres de hauteur. Les racines sont pivotantes et selon les
espèces, le tronc est soit unicaule ou multicaule. Les branches sont
horizontalement opposées 2 à 2, aussi longues et grêles.
Les feuilles sont brillantes, verte-foncées, aux formes ovales, aux
bords ondulés, à phyllotaxie opposée, et à
pétiole très court (Champéraux, 1991). Les fleurs sont
blanches, petites, groupées en glomérules de 15 à 30.
Chaque fleur fécondée donne un fruit appelé « cerise
» et les graines qui y résultent sont les « fèves
», de couleur grise et à surface lisse (Benmedjahed, 2017)
7
c. Principales différences entre les
variétés arabica et robusta
La distinction entre ces deux variétés est
principalement génétique. C'est l'expression
génétique qui engendre les différences morphologiques et
agronomiques. Le tableau 1 ci-dessous résume les principales
différences entre ces variétés.
Tableau 1. Principales différences entre les
variétés robusta et arabica
|
N°
|
Paramètre
|
Variété Arabica
|
Variété Robusta
|
|
01
|
Origine
|
Hauts plateaux éthiopiens
|
Cote d'Ivoire, Foret congolaise, Ouganda
|
|
02
|
Date de description
|
1753
|
1895
|
|
03
|
Nombre de
chromosomes (2n)
|
44
|
22
|
|
04
|
Température moyenne
annuelle optimale
|
15-24°C
|
24-30°C
|
|
05
|
Altitudes optimales
|
500-2000m
|
2000-3000m
|
|
06
|
Précipitations optimales
|
1500-2000mm
|
2000-3000mm
|
|
07
|
Resistance
|
Fragile, frileux et délicat
|
Robuste face aux maladies,
insectes
|
|
08
|
Teneur en caféine
|
1,2- 1,5%
|
3%
|
|
09
|
Forme et couleur des
grains
|
Forme Ovale, allongée et
couleur rouge, jaune
ou
violette
|
Forme ronde, petite dimension
et de couleur jaune à
brun
|
|
10
|
Goût
|
Aromatique, plus subtil et
fruité
|
Corsé et amer
|
|
11
|
Production
|
60% de la production
mondiale
|
40% de la production mondiale
|
|
12
|
Prix
|
20-25 % plus cher que
Robusta
|
20-25 % moins cher qu'Arabica
|
Source : (Piccino, 2011)
Le tableau 1 ci-dessus montre que la caféiculture
demeure et demeurera toujours une propriété du monde tropical
humide. Un hectare de caféier Arabica ou Robusta, conduit dans de bonnes
conditions avec du matériel sélectionné, produit entre 6
et 7 tonnes de cerises, qui donneront 1,2 à 1,3 tonnes de café
marchand après transformation. Dans les périodes où les
cours du café sont très bas, les caféiculteurs
investissent peu dans leurs plantations. Ils laissent l'ombrage se
développer et se contentent de désherber. Dans ces conditions, un
hectare fournit entre 600 kg et 1 tonne de cerises, soit 100 à 200 kg de
café marchand. Dans des conditions de culture intensive au soleil, une
grande plantation peut produire correctement pendant 30 ans. Les
caféières sous ombrage, peu productives, peu entretenues, durent
souvent 50, 70, voire 100 ans (Lécolier, 2006).
8
d. Traitement post récolte de
café
Après le premier traitement post récolte (voie
sèche ou humide), s'en suivent la torréfaction
et la moulure. La torréfaction consiste à griller le café
afin de lui conférer ses qualités : forme, volume, couleur,
poids, ... (Pittia et al., 2001 ; José Alfredo, 2012). En
effet, sous l'effet de la chaleur, les sucres et l'eau donnent des caramels et
quand il n'y a plus d'eau, les sucres et les acides développent les
arômes (c'est la réaction de Maillard ou caramélisation).
En plus la réaction de Strecker intervient pour le changement de
pigmentation jusqu'au chocolat (Michelle et al., 2003). La moulure,
effectuée selon divers procédés, permet alors de
réduire le café torréfié en poudre qui est alors
vendu.
e. Producteurs et consommateurs du
café
La majorité du café consommé dans le
monde est produit dans la zone intertropicale. Depuis des années, le
Brésil est le premier producteur mondial, suivi des deux autres poids
lourds dont le Vietnam et la Colombie (Khalid, 2010).
La RDC partage le même climat que ces grands producteurs
du café, malheureusement qu'elle n'a pas encore réussi à
valoriser ce grand potentiel géostratégique.
Le café produit est consommé sous diverses
formes : en boisson, produits esthétiques, ou encore produit
diététique. Les grands producteurs sont aussi les grands
consommateurs. En Europe, la consommation est plus modeste,
modérée en Asie et très modérée en Afrique
et en Océanie (Turquie et Japon) mais très élevée
aux Etats-Unis (I.C.O, 2011). La figure 1 ci-dessous illustre les grands
producteurs du café dans le monde.
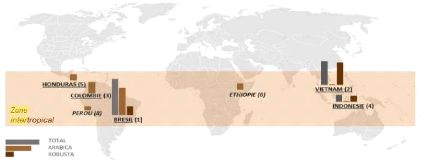
Figure 1 : Les grands producteurs du café et
leurs géo positions Source : (Khalid 2010 ; Basic,
2018)
9
1.2.COMMERCE DU CAFE ET SON PARADOXE
a. Poids du café « Or vert » et de
la caféiculture dans le monde
Le paradoxe est que le café n'est pas une
matière première vitale dans le sens où on peut vivre sans
le consommer. Il est différent du blé, du coton, du cacao ou
autres matières premières vitales pour le bien-être des
personnes. Toutefois, fort est de noter que, le café est la
matière première agricole la plus échangée au monde
après le pétrole (I.C.O, 2011).
b. Grande crise du café dans le monde
(1997-2003)
L'un des défis majeurs du commerce du café est
la volatilité des prix aux producteurs (AFD, 2008). En 1962, le premier
accord international sur le café (AIC) est conclu. Ses signataires sont
à la fois les pays producteurs en demande d'une régulation et les
pays consommateurs soucieux d'assurer un approvisionnement régulier en
qualité stable (Basic, 2018). Comme pierre de touche, l'accord a
instauré la fourchette d'évolution des prix et des quotas
à l'exportation pour chaque pays producteur. Cet accord, très
fructueux sera annulé en 1989, à la suite de nombreux
dysfonctionnements internes (Tulet, 2007). Le démantèlement de
cet accord régulateur a désorganisé l'économie
mondiale du café. A cette désorganisation s'est ajoutée la
montée en puissance de la production en Amérique Latine et en
Asie. Ces éléments ont convergé à la surabondance
de l'offre et parallèlement la baisse brutale et dramatique des cours
mondiaux aux producteurs, c'était la crise du café la plus grave
(Basic, 2018). La figure 2 ci-dessous illustre le dynamisme offre-demande du
marché pendant cette crise.
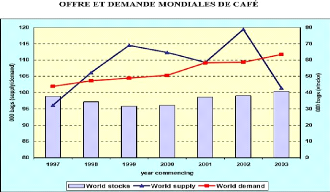
Figure 2 : Le déséquilibre du
marché mondial du café de 1998/99 à 2002/03 Source
: (O.I.C, 2004).
10
c. Période post crise de la
caféiculture
Depuis Novembre 2004, le prix mondial du café est en
pleine hausse. Les principales raisons qui justifiant des prix soutenus sont :
la demande croissante dans les pays consommateurs, des stocks faibles entre les
mains des producteurs, l'augmentation des revenus moyens de la population dans
les pays consommateurs (émergents), des coûts de production en
augmentation dans tous les pays producteurs et la nécessité du
respect à l'environnement (Tegera et al., 2014). Cependant,
Laderach et al.,(2008) prédisent que la répartition
géographique des productions du café va changer sous l'impact du
marché et du climat. Les zones favorables l'arabicaculture vont se
restreindre, occasionnant l'augmentation des prix du café de bonne
qualité. Les hausses marginales des températures seront plus
bénéfiques au Coffee robusta.
1.3.FILIERES AGRICOLES
a. Survol sur les filières et chaines de valeur
agricoles
La distinction reste peu tranchée entre ces deux
vocabulaires à tel niveau que le terme filière est traduit en
« value chain » (Chaine de valeur) en anglais.
L'approche filière est d'origine française et la
chaine de valeur est anglaise (Bockel &Tallec, 2005 ; Porter, 1986).
L'approche filière dégage les relations de cheminement et de
complémentarité le long de la chaine de production alors que la
chaine de valeur consiste à la décomposition des étapes de
production de façon à identifier les avantages compétitifs
possibles aux différents maillons du processus de production.
En d'autres mots, la chaine de valeur décrit les
nombreux niveaux depuis la conception, le bord du champ jusqu'à la tasse
du consommateur et destruction après utilisation. C'est donc une analyse
séquentielle ou éclatée des différents maillons de
la chaine de production (FAO,1997 ; Kaplinsky & Morris, 2000). En revanche,
la filière renvoie à une analyse systémique, à une
notion d'ensemble de la chaine de production.
Les principales dimensions d'une filière sont les
intrants, la production, la transformation et la commercialisation. D'un niveau
à l'autre, le degré des flux est fonction des signaux ou
incitants (le prix, crédit, ...) que reçoivent les
opérateurs économiques (CSA, 2013).
11
b. L'analyse financière d'une filière
agricole : Principes de calcul
Pour Lescuyer (2020), l'analyse financière d'une
filière permet d'estimer ses impacts sur le bien-être des parties
prenantes. Dans notre cas, il a été question de reconstituer les
comptes production-exploitation de chaque agent de la filière. Ces
comptes individuels des acteurs ont ensuite été consolidés
et interprétés.
Les recettes totales (RT) et les charges totales (CT) sont les
grandeurs fondamentales déterminées. Les charges englobent les
Consommations Intermédiaires (CI), les Autres Charges (AC) et les
Amortissements (Am). Le terme Autres charges regroupe les frais financiers
(FF), les Impôts et taxes (IT) et la rémunération du
personnel (S).
Avec les deux grandeurs fondamentales, des grandeurs
dérivées qui sont des outils standards d'analyse
financière peuvent être déterminées. Ce sont les VA,
RBE, RNE, ...
2. Détermination de la valeur ajoutée
(VA)
La valeur ajoutée représente la richesse
créée dans le processus de production-destruction. En effet, si
RT et CI sont respectivement la valeur des recettes totales et les
consommations intermédiaires. Alors la valeur ajoutée est
définie par l'équation : VA = RT-CI
Le calcul de la valeur ajoutée passe par
l'élaboration du compte de Production CP illustré par
le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2. Compte de Production
|
Désignation
|
Sigle
|
Quantité
|
Prix Unitaire (PU)
|
Annuité
d'amortissement (A.a)
|
Total
|
|
1. Les charges
|
C
|
|
|
|
CI
|
|
Les consommations intermédiaires
|
CI
|
|
|
|
?A, TFS, TG et Tr
|
a. Les achats
|
A
|
|
|
|
|
b. Travaux, fournitures et
services
|
TFS
|
|
|
|
|
c. Frais divers de gestion
|
TG
|
|
|
|
|
d. Transport
|
|
Tr
|
|
|
|
|
|
|
2. Les recettes totales
|
R
|
|
|
|
?VP, VD et SE
|
a. Vente de la Production
|
VP
|
|
|
|
|
b. Vente des déchets et sous-
produits
|
VD
|
|
|
|
|
c. Subventions d'exploitation
|
|
SE
|
|
|
|
|
|
|
Valeur Ajoutée Intérieure Brute
|
VA
|
|
|
|
RT-CI
|
Source : (Bockel & Tallec, 2005 ;
Lescuyer, 2020)
12
1. Détermination du Résultat Brut et
Net d'Exploitation (RBE et RNE)
Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) est obtenu en
déduisant des recettes totales les consommations Intermédiaires
et les autres charges. A l'opposé du RBE, le Résultat Net
d'Exploitation (RNE) exprime le gain (ou la perte) économique de l'agent
une fois acquitté de toutes les charges d'exploitation courantes. Le RNE
intègre un autre type de facteur qui a contribué à la
production : les Investissements. On considère que la production a
contribué à « l'usure » des investissements. Ainsi,
RBE = VA - AC RNE = RBE - Am
= RT - CI - AC = RT - CI - AC- Am
Source : (Bockel &Tallec, 2005 ;
Lescuyer, 2020)
Le calcul des RBE et RNE passe par l'élaboration du compte
d'Exploitation, CE illustré par tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3. Compte d'Exploitation
|
Désignation
|
Sigle
|
Quantité
|
Prix Unitaire (PU)
|
Annuité
d'amortissement (A.a)
|
Total
|
|
Autres charges et Amortissement
|
|
|
|
|
? S, FF, IT et Am
|
|
1. Autres charges
|
AC
|
|
|
|
? S, FF, IT
|
a. Rémunération du personnel
|
S
|
|
|
|
|
b. Frais Financiers
|
FF
|
|
|
|
|
c. Impôts et Taxes
|
IT
|
|
|
|
|
2.Amortissement
|
Am
|
|
|
|
|
Valeur Ajoutée Intérieure
Brute
|
VA
|
|
|
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
RBE
|
|
|
|
VA-AC
|
Résultat Net d'exploitation
|
RNE
|
|
|
|
RBE-Am
|
Test de Rentabilité
|
TR
|
|
|
|
(R/C) *100
|
|
Source :(Bockel&Tallec, 2005 ;
Lescuyer, 2020).
Le CP et le CE peuvent être regroupés dans un
compte unique, c'est le Compte de Production Exploitation (CPE).
d. Les Limites de l'approche filière
Il est à préciser que cette approche doit
être utilisée en complémentarité avec d'autres
outils de décisions prenant en compte les dynamiques agricoles et
territoriales. Etant bornée sur un produit spécifique, la
filière permet très difficilement d'intégrer les enjeux
transversaux indissociables aux activités agricoles et au
développement inclusif (CSA, 2013).
13
| 


