CHAPITRE II. MILIEU ET METHODE
2.1.MILIEU D'ETUDE
Notre zone d'étude a couvert les territoires de
Bafwasende et Ubundu, dans la Province de la Tshopo, la plus vaste du pays avec
199 567 km2, soit 8,5% de l'étendue nationale. Située
au Nord-est du pays, la province de la Tshopo comprend la ville de Kisangani et
sept territoires : Bafwasende, Banalia ; Ubundu,Basoko, Isangi, Opala etYahuma
(ADRASS, 2020)
La province est occupée à 87% par la forêt
dense humide. Celle-ci est favorisée par le climat correspondant au type
Af de la classification de Köppen qui y prévaut. Les sols sont dans
une large majorité ferralitique, à texture sablo argileuse.
L'hydrographie de la province s'articule autour du Fleuve Congo et la
rivière Tshopo (Bolakonga, 2013).
L'économie de la Province est centrée sur
l'agriculture et l'élevage traditionnels. Les principales cultures
exploitées sont le manioc, la banane plantain, la patate douce et le
riz. Les cultures pérennes en pleines régression concernent le
café, le cacao, l'hévéa, et le palmier à huile.
L'élevage concerne les vaches, poulets de chair et pondeuses (UNICEF,
2021).
La figure 3 présente la carte de la Province de la
Tshopo et ses territoires.
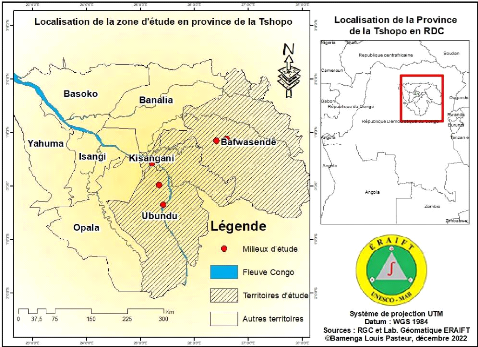
Figure 3 : Carte de la Province de la Tshopo et ses
territoires
14
Le territoire de Bafwasende (chef-lieu Bafwasende, à
262 Km de Kisangani) est le plus vaste du pays. Il s'étend sur
près du quart de la Tshopo (48 482 km2). En revanche, il est
le territoire le moins peuplé de la province (Annuaire de statistique,
2020). Ce territoire loge quatre peuples autochtones notamment : Mbuti
(Pygmées), Babali, Komo et Lombi (ADRASS, 2020). Il est limité
:
- Au Nord : Territoires de Poko (dans la
province de Bas Uele), Rungu et wamba (dans la province du Haut Uele) ;
- Au Sud : Territoires de Walikale (dans la
province du Nord-kivu) et Lubutu (dans la province du Manièma)
- A l'Est : Territoires de Mambasa (dans la
province de l'Ituri) et Lubero (dans la province du Nord-Kivu)
- A l'Ouest : Ubundu, Banalia et la ville de
Kisangani
Le territoire de Ubundu (chef-lieu la cité de Ubundu,
à 126 Km de Kisangani) est le deuxième plus grand territoire de
la province et s'étend sur 41306 km2 (Annuaire, 2020). Il
comprend neuf secteurs, une chefferie (Kirundu), des groupements et villages
(Adrass, 2020). Il partage ses limites avec les territoires de :
- Bafwasende et la ville de kisangani au Nord-ouest
;
- Kailo (Province du Manièma) au Sud ;
- Lubutu et Punia (dans la province du Manièma) à
L'Est ;
- Opalaàl'Ouest.
Source : (Omasombo et al.,
2017)
2.2.MATERIELS
Les matériels suivants ont été
utilisés :
- Un téléphone avec l'application
Kobocollect pour la collecte des données ; -
La balance et le gobelet pour la triangulation des valeurs
fournies par les acteurs ; - Un GPS 64s Garmin pour
l'enregistrement des coordonnées des acteurs ; - Un Ordinateur
portable pour l'analyse et rédaction du travail.
15
2.3.METHODE
L'objectif global de cette étude a imposé le
recours à la méthode appliquée dans le
développement stratégique. Outre l'identification des questions,
la méthode comprend la récolte et l'analyse des données,
la discussion des résultats, l'analyse AFOM et enfin
l'élaboration du plan de développement. Pour cette
dernière étape, il a été question de formuler des
actions stratégiques pour relancer la culture du café dans les
territoires sous examen et non d'un plan de développement au sens
strict. Les objectifs de Développement Durable (ODD) nous ont servi de
fil rouge dans les formulations des actions stratégiques. La figure 4
ci-dessous illustre le cadre méthodologique suivi.
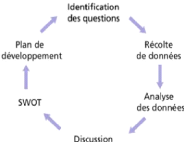
Figure 4 : Cadre méthodologique Source
: (UNIL, 2018)
La méthode probabiliste d'échantillonnage par
grappe a été appliquée dans la récolte des
données. Il était question de recenser et interroger les acteurs
par maillons et sous maillons (producteurs, transformateurs
torréfacteurs et mouleurs, commerçants grossistes et
revendeurs).
2.3.1. Techniques de récolte de
données
En plus de l'analyse documentaire qui nous a permis
d'établir le diagnostic de base et l'organisation de la recherche. C'est
la technique d'enquête à travers un questionnaire d'enquête
qui a été utilisée pour la collecte des données.
Afin de mieux aborder notre troisième et quatrième objectif, les
enquêtes ont été plus semi-indirectes, laissant les acteurs
fournir plus d'informations possibles. Pour cette même fin, nous avons
contacté des personnes ressources et initié le focus group pour
échanger sur les défis de la filière et les solutions
à envisager. Précisons qu'à chaque niveau, nous faisions
preuve d'observation et d'analyse explicative qui sont des outils
nécessaires dans la formulation des actions stratégiques.
16
2.3.2. Méthode de récolte des
données
a. Pré-enquête
Effectuée au début du mois de Juin, cette phase
nous a permis de réunir les informations nécessaires sur les
territoires sous examen et les acteurs de la filière. En plus, cette
phase nous a permis de compléter notre matériel de travail, de
tester et de nous familiariser au questionnaire d'enquêtes, de mesurer
les difficultés auxquelles nous ferons face et d'estimer le budget
nécessaire pour atteindre les objectifs assignés.
b. Enquête proprement dite
L'enquête proprement dite a débuté au mois de
Juillet pour s'achever au mois de Novembre :
b.1. A l'aide d'un questionnaire d'enquête, des
échanges ont été organisés avec les principaux
acteurs de la filière.
- Douze producteurs exploitant au moins vingt pieds de
café ont été recensés et dix ont été
interrogés ;
- Huit grossistes ont été recensés parmi
lesquels sept ont été interrogés ;
- Quarante revendeurs ont été recensés
et vingt-huit ont été interrogés aléatoirement
jusqu'au moment où il n'y avait que des redites d'informations ;
- Dix transformateurs ont été recensés
parmi lesquels sept ont été interrogés.
b.2. Le recours à l'approche participative a permis
d'organiser le focus group. Celui-ci a permis d'appréhender les
problèmes communs à la filière et de rassembler les
propositions des acteurs, les concernés directs. Les aspects
sécuritaires, d'accès au marché, d'écoulement, de
transformation, de tracasserie et de répartition de travail en fonction
du genre ont fait l'objet d'une attention particulière.
b.3. Le recours à l'approche boule de neige a permis
d'identifier des personnes ressources pour notre étude. Celles-ci sont
des banques d'informations, fruits d'une longue expérience dans les
milieux d'étude ou dans la filière café. Parmi ces
personnes ressources, y avait certains acteurs encore actifs et d'autres qui
n'exercent plus.
b.4. Des échanges très ouverts ont
été organisés avec les institutions publiques
impliquées dans la filière. Cas de l'ONAPAC et de la SNCC.
b.5. A chaque étape de la récolte des
données, l'observation et l'analyse participative avaient une place de
choix.
Comme Bolakonga, (2013), nous avons soutenu les
enquêtés dans leurs réflexions internes tout en essayant de
lever toute contrainte qui empêcherait leur libre expression. Nous avons
adopté une attitude empathique incitant les acteurs à fournir
plus d'informations utiles que possible.
17
c. La spécification des variables
Les variables qualitatives et quantitatives ont
été collectées pour atteindre les objectifs fixés.
Les principales variables quantitatives ont concerné : les
quantités produites, transformées et commercialisées ; les
charges globales de producteurs, des transformateurs et des commerçants.
Les prix aux producteurs, aux transformateurs et aux commerçants. La
taille des exploitations, le nombre des plants, l'âge et
ancienneté des acteurs, ...
Les principales variables qualitatives ont concerné :
l'état matrimonial, le niveau d'étude et la motivation des
acteurs, le mode d'accès au capital naturel, les systèmes et
stratégies de production, de transformation et de commercialisation, le
mode d'approvisionnement en intrants, les infrastructures de transport, les
contraintes à la production, les opportunités offertes.
L'ensemble de ces données a permis de saisir l'état actuel de la
filière, de juger l'impact de la filière sur les acteurs,
d'estimer les perspectives de développement de la filière et de
formuler les actions stratégiques de relance de la filière.
d. Les Méthodes d'analyse des
données
1. Analyse fonctionnelle de la
filière
Cette section a permis de saisir le fonctionnement de la
filière étudiée. Les acteurs et leurs techniques de
production ont été+ décrits, le graphe de la
filière a été présenté. La formation de
prix, la stratégie des acteurs, la coordination et le cadre
réglementaire ont également été abordés.
Plusieurs méthodes d'analyses très complémentaires ont
été utilisées. D'une part, les logiciels Excel et SPSS ont
permis de produire les tendances centrales et de positions. D'autre part,
certaines données qualitatives n'ont nécessité aucun
traitement ; elles sont reportées dans la partie des
résultats.
2. Analyse financière de la filière
Deux objectifs ont été poursuivis :
déterminer la viabilité financière de la filière
sur les acteurs et déterminer la valeur ajoutée globale de la
filière dans l'économie. Pour atteindre le premier objectif, nous
avons dressé les comptes Production Exploitation (CPE) d'un acteur type
pour chaque maillon. La viabilité financière de la filière
a été évalué grâce aux indicateurs standards
de performance financière. Ceux retenus dans cette recherche sont : la
Valeur Ajoutée, le Résultat Brut et Net d'exploitation et enfin
le rapport Recettes- Coûts ou test de rentabilité. Pour le second
objectif, nous avons agrégé tous les CPE dans un même
compte, le compte consolidé. Le tableau 4 ci-dessous est un prototype
d'un CPE.
18
Tableau 4 : Prototype d'un CPE
|
Désignation
|
Abréviation
|
Quantité
|
Prix Unitaire (PU)
|
Annuité
d'amortissement (A.a)
|
Total
|
|
1. Les charges
|
C
|
|
|
|
? CI, AC et Am
|
|
a. Les consommations intermédiaires
|
CI
|
|
|
|
?A, TFS, TG et Tr
|
|
Les Achats
|
A
|
|
|
|
|
|
Travaux, fournitures et services
|
TFS
|
|
|
|
|
|
Frais divers de gestion
|
TG
|
|
|
|
|
|
Transport
|
Tr
|
|
|
|
|
b. Autres charges
|
AC
|
|
|
|
?FF, TI et RP
|
Frais Financiers
|
FF
|
|
|
|
|
Impôts et Taxes
|
IT
|
|
|
|
|
Rémunération du personnel
|
S
|
|
|
|
|
c. Les amortissements
|
|
Am
|
|
|
|
? Aa VI
|
|
|
Les valeurs immobilisées
|
VI
|
|
|
|
|
|
2. Les recettes totales
|
RT
|
|
|
|
?VP, VD et SE
|
a. Vente de la Production
|
VP
|
|
|
|
|
b. Vente des déchets et sous-produits
|
|
VD
|
|
|
|
|
|
|
b. Subventions d'exploitation
|
SE
|
|
|
|
|
|
Valeur Ajoutée
|
VA
|
|
|
|
RT-CI
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
RBE
|
|
|
|
VA-AC
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
RNE
|
|
|
|
RBE-?A.a VI
|
|
Test de Rentabilité
|
TR
|
|
|
|
(R/C) *100
|
Source : (Bockel&Tallec, 2005)
A ce niveau, il convient de préciser les bases du
processus :
1. Les calculs ont été réalisé avec
les prix du marché de Novembre 2022 ;
2. Les calculs ont considéré qu'une année a
300 jours ouvrables ;
3. L'unité monétaire utilisée est le CDF
(1$ = 2000 CDF) et les quantités sont en Kg (qui équivaut
à 2 ou 3 gobelets de café marchand ou moulu).
4. Les comptes Production-exploitation des producteurs,
transformateurs et commerçants ont été
élaborés sur base des quantités moyennes (annuelles)
produites, transformées et commercées ;
- La plupart des producteurs, transformateurs et
commerçants ont été interrogés, du moins les plus
importants en termes de quantités,
- Le CPE d'un producteur a considéré la moyenne
annuelle des producteurs de la zone d'étude : Ubundu et de Bafwasende
- Les CPE d'un transformateur et d'un commerçant ont
considéré la moyenne des transformateurs et des
commerçants exerçant dans la ville de Kisangani, au marché
central.

19
5. Pour les amortissements :
- Les producteurs utilisent leurs outils (houes, machettes,
panier de récolte et bâche) pour toutes leurs cultures et non
seulement pour le café. L'amortissement a été
appliqué après avoir divisé la valeur d'acquisition de
l'outil par 3, nombre moyen de culture d'un producteur.
- La même logique a été appliquée
pour les charges des transformateurs et des commerçants,
- Les calculs détaillés sont
présentés à l'annexe 2.
3. L'analyse AFOM
Après compréhension du stade actuel de la
filière café par analyse fonctionnelle et financière, nous
avons dressé la matrice AFOM. En effet, dresser cette dernière
après l'analyse fonctionnelle s'explique par le souci de ne pas fonder
le développement stratégique sur des impressions ou de croyances
non vérifiées (UNIL, 2018).
Cette analyse, utilisée dans nombreux contextes,
s'étend du diagnostic interne (atouts et faiblesses) au diagnostic
externe (opportunités et menaces) et pose le fondement pour
l'élaboration des axes stratégiques (Abdellaoui, 2011). La figure
5 ci-dessous illustre le prototype d'une matrice AFOM (SWOT en anglais).
|
Les quadrants seront complétés après une
analyse en trois phases :
a. Identification de tous les facteurs impactant la
filière café
b. Classement en facteurs internes et en facteurs externes
c. Sélection et priorisation de ces facteurs
d. Affectation des facteurs aux quadrants
|
Figure 5 : Analyse par matrice AFOM Source
:(Absil, 2011)
20
4. La formulation des actions stratégiques
a. Couplage de la matrice AFOM
La formulation des actions stratégiques a
consisté à l'exploitation de la matrice AFOM en mode focus group.
Fondamentalement, nous avons procédé au couplage de la matrice
qui consistait à confronter les acteurs internes et externes. La figure
6 ci-dessous illustre le couplage de base de la matrice AFOM.
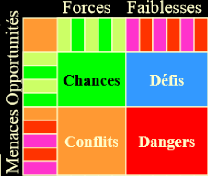
Figure 6 : Analyse croisée de la matrice
AFOM Source : (Vuillod Frederic & Vuillod Serge, 2005)
|
- Forces X Opportunités = Chances -
Faiblesses X Opportunités = défi -
Forces X Menace = Conflit
- Faiblesses X Menace = Danger
|
b. Formulation proprement-dite des options
stratégiques
Les options stratégiques ont été
formulées pour des objectifs définis et une vision
prédéfinie. Toute stratégie visant la relance de la
filière café doit corroborer avec la stratégie nationale
de relance de la caféiculture lancée en 2011.
La vision nationale dans laquelle s'inscrit celle de la
relance du café à Ubundu et à Bafwasende est :
améliorer les performances de la filière café sur
toute la chaine de valeur et créer des richesses en milieu rural
à travers une caféiculture professionnalisée et
compétitive.
Les principaux objectifs y afférents sont : (1)
Améliorer la productivité et la qualité de la
récolte, (2) Améliorer les processus de traitement, retraitement
et de torréfaction et (3) Améliorer les circuits de
commercialisation
Pour optimiser les possibilités offertes par l'analyse
AFOM, et son couplage de base, les axes stratégiques ont
été des réponses aux questions reprises dans la figure 7
ci-dessous.
21
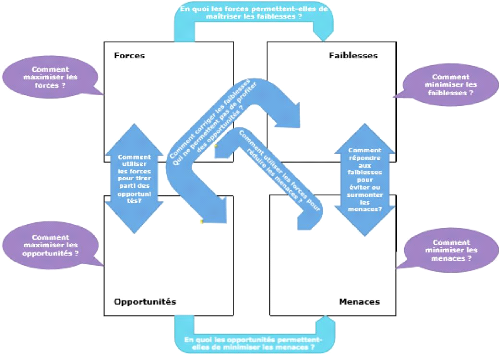
Figure 7. Brainstorming pour la formulation des axes
stratégiques (UNIL, 2018). Source : (UNIL, 2018)
e. Les obstacles à
l'étude
Outre les contraintes techniques liées aux zones
rurales, nombreux autres obstacles ont entravé la bonne
réalisation de cette étude. Il s'agit principalement de
l'accès aux informations et le biais de désirabilité
sociale.
L'accès limité aux informations s'est
observé à différents niveaux. Premièrement, le
nombre très limité des acteurs dans la filière
café. Par exemple dans la route Kisangani- Ubundu, c'est après
plus de 70 km que nous retrouvions 1 petit planteur de café.
Deuxièmement, la méfiance de certains acteurs y compris
mêmes les institutions publiques qui ne se laissaient interroger qu'en
contrepartie d'une motivation financière non prévue dans notre
budget.
Le biais de la désirabilité sociale a
été observé. Pour Crowne & Marlowe (1960) c'est
l'envie des sujets enquêtés de ne pas reporter des informations
qui le feraient mal perçus. Par certaines questions jugées «
personnelles », l'étude n'a pas certainement échappé
à ce biais.
22
Enfin, les informations fournies par les acteurs ne semblent
pas toujours fiables. Ils pouvaient donner des valeurs contradictoires au sein
d'une même interview. Cette incapacité à fournir des
chiffres précis est due au non tenu des comptes.
Face à ces défis, diverses techniques ont
été mises en place de l'amont en aval pour atteindre des
résultats plus fiables. Ces techniques consistaient à placer
l'unité déclarante dans la meilleure aisance possible,
l'agrandissement de la taille de l'échantillon et la triangulation des
données.
23
| 


