CHAPITRE III. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
3.1.Analyse fonctionnelle de la filière
café
3.1.1. Description des acteurs de la
filière
Les principaux acteurs de la filière café dans
la zone d'étude peuvent être groupés en producteurs,
commerçants et transformateurs. Le groupe de commerçants comprend
les grossistes et les revendeurs selon qu'ils s'approvisionnent auprès
des producteurs ou grossistes. Il sied de préciser que le groupe de
consommateurs n'est pas concerné par cette étude. Le tableau 5
ci-dessous donne des éléments de profil de ces acteurs.
Tableau 5. Profil sommaire des principaux acteurs
de la filière café
|
Acteurs/ Variables
|
Producteurs
|
Commerçants
|
Transformateurs
|
|
Grossistes
|
Revendeurs
|
Torréfacteur s et
Mouleurs
|
|
Age (années)
|
60,3 #177; 14,2
|
54,5 #177; 10,1
|
45,3 #177; 10,3
|
50#177;8,91
|
|
Ancienneté (années)
|
19,6 #177; 16,2
|
21,2 #177; 11,4
|
14,4 #177; 9,6
|
16,8 #177; 7,52
|
|
Niveau d'étude (%)
|
|
|
|
|
· Primaire
|
50
|
14,3
|
21,4
|
60
|
· Secondaire
|
50
|
71,4
|
67,9
|
20
|
· Universitaire
|
-
|
14,3
|
10,7
|
20
|
Etat Matrimonial (%)
|
|
|
|
|
· Veuf
|
50
|
-
|
21,4
|
-
|
· Marié
|
50
|
100
|
71,4
|
80
|
· Divorcé
|
-
|
-
|
-
|
20
|
· Célibataire
|
-
|
-
|
7,1
|
-
|
Peuples (%)
|
|
|
|
|
· Autochtone
|
75
|
71,4
|
53,6
|
60
|
· Allochtone
|
25
|
28,6
|
46,4
|
40
|
Genre (%)
|
|
|
|
|
· Féminin
|
-
|
28,6
|
60,7
|
20
|
· Masculin
|
100
|
71,4
|
39,3
|
80
|
Motivation
|
|
|
|
|
· Choix délibéré
|
87,5
|
71,4
|
78,6
|
85,71
|
· Activité héritée
|
12,5
|
28,5
|
10,7
|
-
|
· Faute de mieux
|
|
-
|
-
|
10,7
|
14,3
|
|
3.1.1.1.Producteurs
Dans la zone sous examen, la production du café est une
activité des hommes (100%) majoritairement autochtone du milieu (75%) et
d'âges variant entre 74 et 46 ans. Ils sont équitablement
répartis entre veufs et mariés, entre le niveau d'étude
primaire et secondaire. Le
24
moins expérimenté a exploité le
caféier pendant 4 ans et le plus expérimenté en a fait
pendant 36 ans. C'est par choix délibéré qu'ils exercent
la production du café, sauf 12,5% qui ont hérité
l'activité (tableau 5).
a. Facteurs de production et entretien
La figure 8 ci-dessous présente des
éléments liés aux facteurs de production
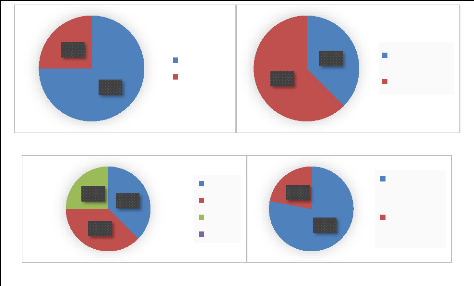
A : Mode d'acquisition foncière des producteurs B
: Taille des exploitations
C : Nombre des plants D : Utilisation de la main
d'oeuvre
25%
25%
38%
75%
37%
Ayant droit Emphytéose
35-50
450-550
980
63%
22%
78%
37%
Main
d'oeuvreFamili ale
Main d'oeuvre Exterieure
Superficie ? 0,5
Superdficie 0,5-1
Figure 8 : Eléments liés aux facteurs de
production
b. Travail d'entretien
La figure 9 ci-dessous repartit les producteurs selon le nombre
de passage d'entretien par an
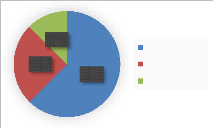
25%
13%
62%
Deux passages Un passage Aucun passaage
Figure 9 : Répartition des producteurs selon la
fréquence annuelle d'entretien
La figure 8 ci-dessus illustre le mode d'acquisition
foncière des producteurs, la taille des exploitations, le nombre des
plants et l'utilisation de la main d'oeuvre. Il en ressort que 75% des
producteurs sont des ayants-droits et 25% ont acquis la terre par
emphytéose. La taille des
25
exploitations est faible, elle est inférieure à
0,5 ha pour 37% des producteurs. Les autres producteurs emblavent une
superficie supérieure à 0,5 ha et inférieure à 1
ha. Par contre, le nombre des plants est fort diversifié, et varie entre
35 à 980. La main d'oeuvre extérieure est seulement
utilisée par 22 % de producteurs et les restes utilisent la main
d'oeuvre familiale, les femmes et les enfants, surtout en période de
récolte.
La figure 9 divise les producteurs en trois groupes. Ceux qui
entretiennent leurs exploitations deux fois l'an 62%, une fois 25% et ceux qui
n'entretiennent pas 13%.
c. Production et vente
La figure 10 ci-dessous illustre des éléments
liés à la vente des cafés par les producteurs
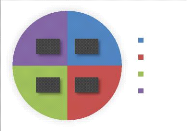
25%
25%
25%
25%
< 0,5
5,1 - 10
20,1 - 30 30
A : Répartitions des producteurs selon la
production en café rouge en Karai
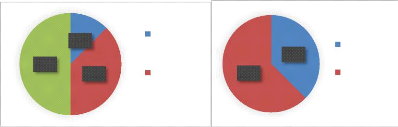
50%
12%
38%
Vente café coque
Vente café marchand
63%
37%
Vente locale
vente à Kisanganide
B : Produits livrés par les producteurs C : Lieu
de vente
Figure 10 : Eléments liés à la
Production et Vente
Cette figure 10 illustre la production en Karai (1 Karai = 17
gobelets) par saison culturale, les produits livrés et le marché
d'échange. Il en ressort que la production en café rouge varie
autour de 0,5 à 30 karai par saison culturale par producteur. Les
producteurs se répartissent en trois groupes selon les produits qu'ils
livrent au marché. La moitié livre à la fois le
café marchand et le café coque. Une autre moitié livre
soit le café marchand (38%), soit le café coque (12%). Plus de la
moitié des producteurs acheminent leurs productions au marché
urbain alors que 37,5 % des producteurs vendent localement leurs
productions.
26
3.1.1.2. Commerçants
a. Grossistes
L'activité des grossistes est partagée entre
hommes (71,4 %) et femmes (28,6 %) mariés. Les acteurs sont d'âges
variant entre 44 et 64 ans. Les trois niveaux d'étude sont
représentés : primaire (14,6 %), secondaire (71,4 %) et
universitaire (14,3 %). Ils sont majoritairement autochtones (71,4%) et d'une
grande ancienneté dans le domaine, entre 10 à 32 ans. Ils
exercent l'activité par choix délibéré (71,4%) ou
par héritage (28,4%) (tableau 5).
Les grossistes s'approvisionnent auprès des
producteurs. Les quantités sont mesurées à la balance et
aux gobelets. Il y a deux types de gobelets, l'un qui vaut 500 g et l'autre
appelé Munoko ya Tshaku vaut 750 g.
Selon leurs fonctions, les grossistes ont été
répartis en trois types : les grossistes Type 1, Type 2 et Type 3. La
figure 11 en illustre la répartition.
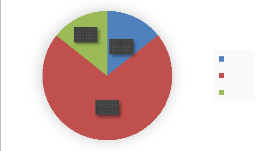
14%
72%
14%
Type 1
Type 2
Type 3
Figure 11 : Répartition des commerçants
grossistes
Le tableau 6 ci-dessous associe chaque type de grossiste à
sa principale caractéristique.
Tableau 6. Types de commerçants grossistes
|
N°
|
Typologie des grossistes
|
Abréviation
|
|
1
|
Grossistes Type 1
|
GT.1
|
|
2
|
Grossistes Type 2
|
GT.2
|
|
3
|
Grossistes Type 3
|
GT.3
|
Fonction
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et le vendre aux revendeurs
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et vendre le café marchand, coque ou moulu aux
consommateurs
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et vendre le café moulu aux revendeurs
Le tableau 6 et la figure 11 ci-dessus montrent que le travail
de grossiste consiste majoritairement à acheter le café marchand
et/ou coque auprès des producteurs et vendre le café marchand
et/ou coque ou moulu aux consommateurs.
27
b. Revendeurs
Les revendeurs sont plus des femmes (60,7%) que des hommes
(39,3%) et sont d'une ancienneté entre 5 et 23 ans. Certains sont veufs
(21,4 %), mariés (71,4 %) ou célibataires (7,1 %) avec un
âge variant entre 35 à 55 ans. Ils sont majoritairement
autochtones (53,6%) et d'un niveau d'étude primaire (21,4%), secondaire
(67,9%) ou universitaire (10,7%). Ils exercent cette activité par choix
délibéré (78,6%) ou par héritage (10,7%) ou encore
par faute de mieux (10,7%) (tableau 5). Les revendeurs s'approvisionnent
majoritairement auprès des grossistes en utilisant des gobelets. Ils
sont méfiants des balances supposées être truquées.
A leur tour, ils revendent en gobelets (de volume différent que celui
des grossistes) et en boites de tomates. Comme les grossistes, les revendeurs
peuvent aussi être catégorisés selon les fonctions
accomplies. La figure 12 illustre la répartition des revendeurs : Type
1, 2, 3 et 4.
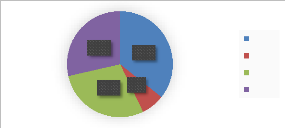
29%
28%
7%
36%
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Figure 12 : Répartition des commerçants
revendeurs
Le tableau 7 ci-dessous associe chaque type de revendeurs
à sa principale caractéristique.
Tableau 7. Types de commerçants Revendeurs
|
N°
|
Typologie des
revendeurs
|
Abréviation
|
|
1
|
Revendeurs Type 1
|
RT.1
|
|
2
|
Revendeurs Type 2
|
RT.2
|
|
3
|
Revendeurs Type 3
|
RT.3
|
|
4
|
Revendeurs Type 4
|
RT.4
|
Description
Acheter le café moulu auprès des grossistes et
le vendre aux consommateurs ;
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
grossistes et vendre le café moulu (après torréfaction
à la maison et mouture à l'usine torréfaction et mouture
à l'usine) ;
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
grossistes et vendre le café moulu (après torréfaction et
mouture à l'usine) ;
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et vendre le café moulu aux consommateurs (après
torréfaction à l'usine ou domicile)
Le tableau 7 et la figure 12 ci-dessus montrent que les
revendeurs sont de quatre types. La majorité achète le
café moulu auprès des grossistes et le vend aux consommateurs.
28
3.1.1.3. Les transformateurs
L'activité de transformation rassemble plus d'hommes
(80%) que les femmes (20%). Les transformateurs interrogés sont
d'âges variant entre 41 et 58 ans, avec une ancienneté entre 9 et
24 ans. Ils sont mariés (80%) ou divorcés (20%) et ont à
majorité le niveau d'étude primaire (60%). Les 40% restants sont
équitablement partagés entre les niveaux secondaire et
universitaire. Ils sont majoritairement autochtones (60%) et minoritairement
(40%) allochtones. C'est par choix délibéré qu'ils
exercent la transformation du café, sauf 14,3 % qui l'exerce par faute
de mieux.
Les données recueillies nous ont permis de repartir les
transformateurs selon leurs fonctions. La figure 13 ci-dessous illustre la
répartition de transformateurs : Type 1, 2 et 3.
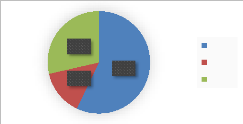
29%
14%
57%
Type 1
Type 2
Type 3
Figure 13 : Répartition des transformateurs
Le tableau 8 ci-dessous associe chaque type de transformateurs
à sa principale caractéristique.
Tableau 8. Types de transformateurs
|
N°
|
Typologie des
transformateurs
|
Abréviation
|
Description
|
|
1
|
Transformateurs Type 1
|
TT.1
|
La torréfaction : transformation du café marchand
ou coque en café torréfié
|
|
2
|
Transformateurs Type 2
|
TT.2
|
La mouture : transformation du café torréfié
en café moulu
|
|
3
|
Transformateurs Type 3
|
TT.3
|
Torréfaction et Mouture
|
La figure 13 et le tableau 8 ci-dessus illustrent que le
maillon de transformation est dominé par les torréfacteurs, TT.1.
Pour parfaire la transformation, ils sont complétés par les
mouleurs. D'autres agents assument les deux opérations.
Considérant leurs rythmes de travail, nous distinguons
les petits des grands transformateurs. Les grands transformateurs sont
installés au centre de la ville, à proximité des
dépôts des GT.1 et GT.2 où ils bénéficient
d'externalités positives. Ces transformateurs sont très peu
nombreux et ont un rythme intense de travail. A l'opposé, les petits
transformateurs sont dispersés dans tous les quartiers de la ville et
travaillent par occasion. Ce sont à majorité des revendeurs et
grossistes, possédant le matériel de torréfaction à
leurs domiciles.
Figure 14 : Etapes de transformation du café :
Opération, moyens, produits et perte
29
- Résultat sur le processus de transformation
du café dans la zone d'étude
Le système de transformation comprend le
décorticage, la torréfaction et la mouture. Il est à
préciser que juste après la récolte les baies rouges sont
séchées au soleil pendant 2 à 3 semaines et deviennent des
cafés coques ou cafés en bains prêts à être
décortiqués. Dans les zones rurales, ces cafés sont
ensuite pilés pour leur débarrasser de l'écorce externe
appelée parche ou coque. Cette opération est le
décorticage et permet d'obtenir les cafés marchands. Dans la
ville de Kisangani, le décorticage est réalisé par des
moulins mécaniques. S'ensuit alors la torréfaction,
réalisée manuellement avec le torréfacteur (vulgairement
appelé bambone). Le temps de torréfaction dépend
de la qualité recherchée. Nombreux arrêtent la
torréfaction quand le café atteint la couleur chocolat et qu'une
fumée bleue sort du torréfacteur, entre 45 à 60 minutes.
Les grains sont ensuite dégagés du torréfacteur pour le
refroidissement suivi de la mouture dans des moulins électriques. Ces
derniers sont les mêmes moulins utilisés pour la mouture de
maïs et soja, mais dont les tamis sont adaptés au diamètre
des grains de café.
D'une étape à une autre, le café perd de
poids. La figure 14 ci-dessous reprend le processus de transformation du
café et les pertes liées à chaque opération.
Café Rouge (250kg)

Séchage au soleil, perte de 55%
Café Coq ou Parche (112,5 kg)
Décorticage au mortier, pilon ou moulin
électrique, perte de 40 %
Torréfaction au torréfacteur, perte de
20,5 %
Parche, 45kg
Café Marchand (67,5kg)
Café Torréfié (53,6 kg)

Mouture au moulin électrique, perte 0%
Café Moulu, (53,6kg)
30
3.1.1.4.ONAPAC et SNCC
Anciennement appelé ONC (Office Nationale de
Café), l'ONAPAC (Office National de Produits Agricole du Congo) a pour
mission de vulgariser et d'encadrer les agriculteurs dans 21 produits
agricoles, y compris le café. De par la mission lui confiée,
l'ONAPAC serait un moteur du développent agricole dans la zone
d'étude et en RDC en général. Dans les faits, l'ONAPAC
affiche des faibles capacités à tous les niveaux. Cette structure
qui devrait accompagner les acteurs est devenue un frein majeur à cause
des taxes qu'elle prélève.
De son côté, la SNCC (Société
Nationale de Chemin de fer du Congo) est un acteur de transport. Il permet
l'évacuation de café issu de Ubundu vers la ville de Kisangani.
Les conditions de voyage sont précaires et risquées.
3.1.2. Délimitation des contours de la
filière.
Le tableau 9 ci-dessous présente les contours de la
filière café dans la zone sous examen. Tableau 9 :
Délimitation des contours de la filière
|
Activité Acteurs Fonctions Principales
Produit
Principal
|
Lieu
d'activité
|
Café marchand et coque
Café coque, marchand ou moulu
Café marchand, coque ou moulu
Bafwasende et Ubundu
Centre de Kisangani
Centre de Kisangani
Production Producteurs de
Bafwasende et Ubundu
Transformation Torréfacteurs
et mouleurs
Production
Transformation du café rouge en café moulu
Grossistes Commerce : Acheter le
café marchand et/ou coque auprès des producteurs
Commercialisation
|
Revendeurs Commerce : Acheter le
café moulu auprès des grossistes ;
|
Café moulu Centre de
Kisangani
|
Consommation Consommateurs Consommation
Café moulu La Tshopo
Le tableau 9 ci-dessus fait ressortir les différents
maillons de la filière sous examen, les acteurs, les fonctions et les
produits y afférents. Les zones des productions sont les territoires de
Bafwasende et Ubundu. La zone de transformation et de distribution est le
centre de Kisangani. La consommation est généralisée dans
toute la province de la Tshopo.
31
3.1.3. Graphe de la filière
café
La figure 15 ci-dessous illustre les flux de la filière
café depuis les lieux de production (Ubundu ou Bafwasende) jusqu'au lieu
de distribution du café moulu (Kisangani). Les lettres P, C et T sont
les différents maillons de la filière et les acteurs y
afférents. Dans les maillons C, les lettres R et G sont respectivement
les revendeurs et les grossistes. Les abrégés T.1,2, 3 et 4 sont
liés à la typologie des acteurs.

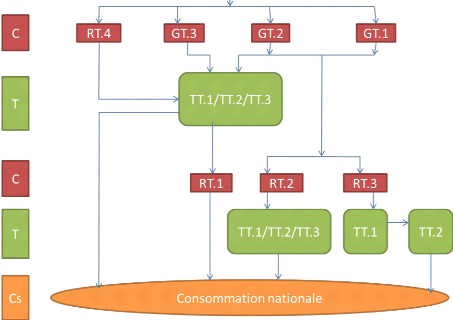
Figure 15 : Description de la filière
café en territoires de Bafwasende et Ubundu et dans la ville de
Kisangani.
32
3.1.4. Formation des prix et stratégie des
acteurs a. Formation des prix
Il est connu que dans une économie de marchés,
ce sont les dynamismes de l'offre et de la demande qui déterminent le
prix aux consommateurs. Et pour un marché approvisionné par
diverses sources, le prix est proportionnel aux variations à la hausse
ou à la baisse de l'offre du grand producteur. Les informations
récoltées auprès des acteurs et les statistiques de
l'ONAPAC et de la SNCC nous ont permis de ranger par ordre décroissant
les grands producteurs du café consommé à Kisangani. Il
s'agit de la province de l'Equateur, les territoires d'Opala, de Basoko, Kindu
et Bandundu. Dans le marché de Kisangani, les cafés des
territoires de Bafwasende et Ubundu sont très faiblement
représentés.
La faible représentation, le besoin immédiat de
liquidité et le manque d'organisation ravissent à tous les
acteurs de la filière café Bafwasende et Ubundu le pouvoir de
formation des prix. Ils sont price takers. Sur les marchés
locaux de Ubundu et de Bafwasende, le café transformé localement
est en compétition avec le café transformé à
Kisangani. Cette coexistence ne permet pas aux acteurs locaux d'être
price makers aux lieux de productions. Dans le tableau 10 ci-dessous, sont
mentionnées les variations de Prix de Vente (PV) de café en
Francs Congolais (FC) dans la Province de la Tshopo, ville de Kisangani.
Tableau 10. Variation annuelle des prix de
café
|
Période PV d'un kg du
producteur au grossiste
|
PV d'un Kg du grossiste au revendeur
|
PV d'un gobelet de café au consommateur
|
Coque Marchand Coque Marchand Moulu Moulu
Novembre-
Avril 1700 2500 2200 3000 3500 1500
|
Mai - Juillet Août-Octobre
|
2200 3000 2700 3500 4000 1800
3200 4000 3700 4500 5500 2500
|
Le tableau 10 ci-dessus montre que la crise et l'abondance de
café correspondent respectivement aux périodes
d'Août-Octobre et Novembre- Avril. La période de fortes
récoltes, appelée campagne par les acteurs, commence en Novembre
et s'étend jusqu'en Mars. La période Mai-Juillet est
alimentée par les stocks emmagasinés par les acteurs producteurs
et commerçants. La carence commence à la fin Juillet avec un pic
au mois d'Août et Septembre puis l'amélioration de la tendance
s'amorce en Octobre.
33
b. Stratégie des acteurs
Les acteurs de la filière café montent diverses
stratégies pour acquérir des meilleurs prix et/ou anticiper les
risques liés aux chutes des cours.
1. La diversification du portefeuille
Sur l'ensemble d'acteurs interrogés, 73,4% pratiquent
une autre activité régénératrice des revenus au
côté du café. Dans le maillon de la production, les acteurs
associent le café au palmier à huile. Dans le maillon de la
commercialisation, seulement 30% d'acteurs commercialisent uniquement le
café. Ce dernier est souvent accompagné du sucre, du sel, du soja
ou d'autres nombreux produits. C'est ce que les revendeurs appellent la
complémentarité des produits dans le commerce. Dans le maillon
transformation, l'équipement utilisé permet aux acteurs de se
convertir, sans efforts, en transformateurs de soja ou de maïs.
2. Le stockage de café à l'attente des
périodes de crise
La période d'offre excédentaire s'étend
de Novembre en Avril et nombreux commerçants profitent pour accumuler
des réserves à revendre dans la crise d'Août-Octobre.
Malheureusement ; la pression de la demande, le besoin immédiat de
liquidité, la défaillance des systèmes de conservation
font que rares tiennent jusqu'aux mois prévus.
3. Les achats groupés
C'est la stratégie des grossistes auprès des
producteurs obligeant ces derniers à une remise.
4. La chimie, ...très bonne mauvaise
stratégie
Les acteurs chimistes sont ceux qui trompent la vigilance des
consommateurs. En effet, c'est à l'insu des consommateurs que deux types
de cafés moulus coexistent sur le marché : le café sec et
non sec. Le café sec (le bon café) est issu du café
marchand, torréfié et moulu. Le café non sec (le mauvais
café) est issu de ce que les acteurs appellent la chimie. Plus souvent,
c'est le café coque qui est torréfié et grillé.
Pourtant 100% d'acteurs affirment être au courant des méfaits des
parches sur la santé des consommateurs et qu'il est strictement interdit
de torréfier ou moudre le café coque. Un autre cas de chimie
c'est le mélange du café coque et d'autres corps, cas du
maïs, soja et/ou noyaux de l'avocat, très bien grillés,
torréfiés et moulus.
Le service public au travers de l'ONAPAC dit être au
courant de cette mafia et ne se limite qu'à la sensibilisation des
méfaits de la parche. La répression est difficile à cause
de certains acteurs qui traitent le café à leurs domiciles. L'OCC
qui devrait mobiliser son service de police pour traquer ces cas, ne se limite
qu'à prélever les taxes.
34
3.1.5. Coordination des acteurs et cadre
réglementaire.
a. Coordination des acteurs
De façon verticale ou horizontale, il n'y a pas de
coordination proprement-dite entre les acteurs de la filière café
dans les zones sous-examen. Les données de terrain ont
révélé certains rassemblements ou mini organisations qui
ne fonctionnent que pour des besoins sociaux et non pour la structuration de la
filière. Ces regroupements sont battus sur les relations d'appartenance,
d'ancienneté et/ou de confiance. Il en résulte que chaque acteur
connait ses potentiels et réels offreurs et/ou acheteurs. Cependant,
tout acteur reste à la quête de l'offreur qui propose le plus bas
prix.
Tous les acteurs se connaissent, si pas de noms, alors de
visages. Les données récoltées ont
révélé une forme de solidarité auprès des
commerçants et transformateurs. En effet, chaque rangée de vente
ou chaque atelier de transformation a un représentant, et en cas
d'événements malheureux (deuils), la rangée ou l'atelier
se cotise pour une visite de consolation au concerné. Les
commerçants grossistes donnent des avances aux producteurs pour des
travaux pour le transport de la production et les commerçants revendeurs
achètent à crédits auprès des grossistes et
remboursent après la vente.
b. Cadre réglementaire et
politique
L'OCC, ONAPAC et DGRPT sont les organes qui font payer des
taxes, des droits et/ou des redevances.
L'ONAPAC dont les fonctions se résument en
vulgarisation de meilleures pratiques agricoles et encadrement des acteurs
(dans tous les maillons) est amorphe sur le terrain. De même pour l'OCC.
Toutes ces institutions sont rigoureuses dans le prélèvement des
taxes, que 80% de commerçants considèrent comme un frein majeur
à leur autonomisation. Par exemple, l'ONAPAC prélève par
an 65 $ par commerçant grossiste et 10$ par revendeur.
A ces institutions, ajoutons la SNCC qui est un
suppléant dans le transport. Cette institution permet aux producteurs de
dégager par voie ferrée leurs productions jusqu'en milieu urbain.
Les trains utilisés datent de l'époque coloniale et la voie
ferrée est en détérioration très avancée.
Les risques sont énormes.
35
3.2.Analyse financière de la
filière
Cette section a procédé à une analyse de
la viabilité financière des acteurs impliqués dans la
filière café robusta dans deux territoires de la Tshopo à
savoir Bafwasende et Ubundu y compris la ville de Kisangani. Les comptes
Production Exploitation (CPE) ont été présentés
puis consolidés pour dégager la valeur ajoutée
créée le long de la filière.
3.2.1. Analyse de la viabilité
financière de la filière sur les acteurs
Les outils standards d'analyse financière
dégagés par les CPE (en annexe) ont démontré que la
filière est rentable pour tous les acteurs. Le test de
rentabilité a montré que 1$ investi produit 2,5$ aux producteurs,
0,71$ aux mouleurs, 0,58 $ aux torréfacteurs et 0,2 $ aux grossistes.
3.2.2. La consolidation des CPE
L'ensemble de CPE a été agrégé
pour constituer le compte consolidé de la filière. Ce dernier a
dégagé la valeur ajoutée créée le long de la
filière. Les valeurs ajoutées moyennes et l'ensemble des acteurs
pour chaque maillon ont été considérés dans cette
consolidation. Le tableau 11 ci-dessous présente le compte
consolidé de la filière café dans la zone
d'étude
Tableau 11 : Compte Consolidé de la
filière café
|
Eléments
|
Moyenne par
acteur
|
Nombre d'acteurs
identifiés
|
Valeur Monétaire
|
|
CI Producteur
|
393000
|
10
|
3930000
|
|
CI Grossiste
|
225000000
|
8
|
1800000000
|
|
CI Revendeur
|
9728000
|
40
|
389120000
|
|
CI Torréfacteur
|
5310000
|
7
|
37170000
|
|
CI Mouleur
|
12060000
|
3
|
36180000
|
|
CI totales estimées
|
|
|
2266400000
|
|
R Producteurs
|
1400000
|
10
|
14000000
|
|
R Grossistes
|
270000000
|
8
|
2160000000
|
|
R Revendeurs
|
12600000
|
40
|
504000000
|
|
R Torréfacteurs
|
9000000
|
7
|
63000000
|
|
R Mouleurs
|
22500000
|
3
|
67500000
|
|
R totales estimées
|
315500000
|
|
2808500000
|
|
VA Producteur
|
1007000
|
10
|
10070000
|
|
VA Grossiste
|
45000000
|
8
|
360000000
|
|
VA Revendeur
|
2872000
|
40
|
114880000
|
|
VA Torréfacteur
|
3690000
|
7
|
25830000
|
|
VA Mouleur
|
10440000
|
3
|
31320000
|
|
VA Ajoutée Estimée
|
|
|
542100000
|
Le tableau 11 ci-dessus illustre les consommations
intermédiaires et les recettes pour chaque maillon de la filière.
Les différences entre ces deux grandeurs fondamentales ont permis de
36
déterminer les VA respectives. Plus de valeurs sont
créées par le maillon commercialisation, notamment les
commerçants grossistes et les revendeurs. Ensuite le maillon
transformation, respectivement les mouleurs et les torréfacteurs. Au bas
de l'échelle, les producteurs.
La figure 16 ci-dessous illustre la répartition de la VA
entre les acteurs de la filière.
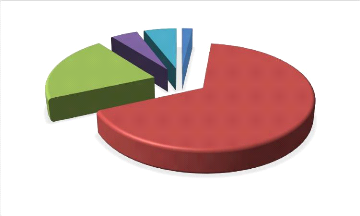
Revendeur
21%
Torréfacteur
5%
Mouleur
6%
Producteur
2%
Grossiste
66%
Figure 16 : Répartition de la valeur
ajoutée entre les acteurs
La figure 16 ci-dessus vient compléter les
résultats présentés dans le tableau 11. Il montre que 66%
de la richesse créée est l'oeuvre des commerçants
grossistes. Les autres acteurs de la filière se répartissent 34%
respectivement 21, 6, 5 et 2 % pour les revendeurs, les mouleurs, les
torréfacteurs et enfin les producteurs. Les gros investissements des
grossistes expliquent cette grande création de richesse. Le nombre
élevé des revendeurs par rapport aux autres acteurs explique la
valeur élevée de la richesse créée.
L'arriération des producteurs et de leurs techniques expliquent leur
faible contribution à la création des valeurs dans la
filière.
37
3.3.Présentation de la matrice AFOM
Le tableau 12 ci -dessous présente le diagnostic interne
et externe de la filière café dans la zone sous examen.
Tableau 12 : Présentation de la matrice
AFOM
|
|
LES POSITIFS
|
LES NEGATIFS
|
|
|
|
|
LES ATOUTS
|
LES FAIBLESSES
|
|
DIAGNOSTIC INTERNE
|
1.
|
Conditions agroécologiques favorables à la
culture de café robusta ;
|
1. Abandon des anciennes plantations, faible
production,
vieillissement des producteurs et défectuosité
des
|
2.
3.
|
Demande locale et extérieure en croissance,
disponibilité des terres et de la main d'oeuvre; Position
stratégique de Bafwasende à la
|
routes ;
2. Pénurie électrique,
tracasseries administratives,
inexistence des microcrédits,
microfinances et des
|
|
Nationale n°04, la présence de la SNCC dans
|
financements ;
|
|
Ubundu, de l'ONAPAC et des anciennes
|
3. Faible marketing pour le produit, manque
des
|
|
plantations nécessitant des faibles coûts de
|
coordinations entre les acteurs de la filière et la
vente
|
|
relance et sans déforestation ;
|
du café mélangés aux impuretés ;
|
|
4.
|
Possibilités de l'association culturale et de
l'agroforesterie ;
|
4. Existence des acteurs aux double ou triple
fonctions,
c'est le cas des grossistes - revendeurs, des
|
|
5.
|
Le caractère pérenne du café et sa
facilité de
|
revendeurs-transformateurs et des grossistes-
|
|
conservation. La pérennité est un
élément de
|
transformateurs-revendeurs ;
|
|
sédentarisation des agriculteurs et assure des
|
5. Très faible capacité technique
des producteurs, de
|
|
retours financiers réguliers. La facilité de
|
l'ONAPAC, de la SNCC et de tous les autres acteurs
|
|
stockage est un des éléments régulateurs
de
|
de la chaine. Inexistence des dépôts stabilisateurs
ou
|
|
l'offre et de la demande.
|
des usines modernes de transformation du café et de son
conditionnement.
|
|
|
LES OPPORTUNITES
|
LES MENACES
|
|
DIAGNOSTIC EXTERNE
|
1.
|
Situation sécuritaire stable et mise au point de
|
1. Fluctuations des cours internationaux,
instabilité de la
|
|
variétés résistantes à la
tracheomychose ;
|
monnaie nationale, développement des bioagresseurs
|
|
2.
|
La majoration du budget national, la bonne
|
et faible capacité de gestion des risques ;
|
|
volonté du pouvoir et des investisseurs privés
|
2. Très faible allocation du budget national au
secteur
|
|
à relancer la culture du café ;
|
agricole, faible capacité de l'INERA et ONAPAC
|
|
|
Reprise de la conscience des agriculteurs, L'ouverture au
marché extérieur où il y a une
|
dans la production des semences et dans le formation et
encadrement des paysans ;
|
|
|
grande demande croissante du café, surtout le
café Bio ;
|
3. Défectuosité de la route
Ubundu-Kisangani,
tracasseries administratives et multiplicité des taxes
|
|
4.
|
La résistance du café robusta aux effets du
|
non réglementaires ;
|
|
changement climatique et la recherche des
|
4. Guerre commerciale basée sur la
qualité des produits
|
|
puits de dioxyde de carbone ;
|
sur le marché mondial ;
|
|
5.
|
Possibilité d'accompagnement par l'INERA
|
5. Réticence de la population aux
activités caféières et
|
|
Yangambi et ONAPAC dans la ville de
|
son accoutumance au café importé.
|
|
Kisangani.
|
|
38
3.4.Formulation des actions stratégiques
3.4.1. Couplage de la matrice AFOM
Le tableau 13 ci-dessous confronte les diagnostics internes et
externe de la matrice AFOM Tableau 13 : Couplage de base de la
matrice AFOM
|
LES CHANCES
|
LES DEFITS
|
|
Comment exploiter les atouts pour saisir les
|
Comment combler les faiblesses en profitant
des
|
|
opportunités ?
|
opportunités ?
|
|
|
|
1. Structuration dans des coopératives et renforcement
des partenariats d'appui avec les
structures
compétentes (IFA et INERA Yangambi, ONAPAC, SNCC et des
partenaires de la RDC) ;
2. Intensification de l'agriculture sur l'unité de terre
;
3. Revitalisation des anciennes plantations ;
4. Mobilisation des jeunes à intégrer la
filière ;
5. Se faire de l'auto marketing pour se positionner en une
bonne affaire à la fois pour le secteur privé que le secteur
public : informer des avantages d'investir dans le café et ses effets
d'entrainements.
|
1. Investissement dans le capital humain : former
et
renforcer les compétences des producteurs et des transformateurs
sur leurs tâches respectives ;
2. Aménagement de la route Ubundu-Kisangani et
appui
technique à la SNCC, ONAPAC, IFA et INERA Yangambi ;
3. Amélioration des rendements et de la qualité de
la
récolte ;
- Installation et restauration des plantations de
café
avec des semences à hauts rendements et résistantes ;
- Adoption des innovations culturales et
d'équipements
récents ;
- Accès aux financements, aux microcrédits
ou
microfinances
4. Amélioration des processus de
traitement,
retraitement de torréfaction et de mouture ;
- Adoption des innovations et
d'équipements
récents ;
- Réduire la dépendance vis-à-vis de la
SNEL
5. Amélioration des circuits de commercialisation ;
- Inciter à la consommation locale du café
- Ouverture au marché extérieur ;
6. Attirer l'attention des investisseurs et se positionner
en
axes majeur pour le développement et réduction de la
pauvreté ;
Dans le strict respect des principes écologiques
|
|
|
LES CONFLITS
Comment utiliser les atouts pour combattre
les
menaces ?
|
LES DANGERS
Comment protéger les faiblesses des menaces
?
|
|
1. Structuration et mise en place d'un système
d'autofinancement ;
2. Mobilisation de la demande locale ;
3. Mobilisation pour la production du café bio,
très compétitif ;
4. Diffusion des effets économiques, sociaux
et
environnementaux du café et la nécessité de la
relance ;
5. Appui à la SNCC comme voie alternative aux Routes
;
|
1. Maintien de la filière à l'état non
structuré ;
2. Promotion du chacun pour soi et méfiance
vis-à-vis
des institutions publiques ;
3. Maintien des pratiques et les outils rudimentaires ;
4. Promotion de l'autarcie (limitation à
l'ouverture
extérieure et réfraction des innovations) ;
Limitation de l'auto-marketing.
|
39
3.4.2. Formulation des axes stratégiques
Les axes stratégiques pour la relance de la filière
café sont repris dans le tableau 14 ci-dessous
Tableau 14 : Axes stratégiques pour la relance
de la filière café
|
Gouvernance et Cadre
politique
|
1.
2.
3.
|
Reconnaissance du potentiel du café dans la
résolution des défis sociaux, économiques et
environnementaux ;
Appuis techniques aux institutions publiques, acteurs directs ou
indirects, de la filière café : ONAPAC, SNCC, IFA et INERA
Yangambi :
- Production et diffusion des semences améliorées,
productives et adaptées ;
- Vulgarisation des techniques efficientes ;
- Instaurer un système de control minutieux auprès
des commerçants pour limiter la
fraude (vente des cafés impurs sur le marché de
Kisangani) ; Amélioration du climat des affaires et mobilisation des
investisseurs privés :
|
|
- Résoudre les défis liés à
l'électricité et au réseau routier Kisangani-Ubundu ;
|
|
- Limiter le prélèvement fiscal à un minimum
acceptable ;
|
|
- Favoriser l'accès aux financements, microcrédits
et microfinances ;
|
|
- Faciliter l'accès au foncier
|
|
Commercialisation et Consommation
|
1.
|
Organisation des commerçants pour faire face à la
volatilité des prix ;
|
|
Promotion de la consommation du café local. Ceci se fera
par marketing, information sur le café et amélioration de la
visibilité et attractivité du produit.
|
|
Certification et labellisation du café produit localement
pour plus de crédit au niveau local et international ;
|
|
Mise en place de la technique commerciale : Pour chaque prix,
une quantité. Cette quantité doit demeurer le café pur,
non mélangé.
|
|
|
Instaurer des points de vente dans les zones reculées ;
|
|
|
Transformation
|
1.
|
Investissement dans la ressource humaine et dans
l'équipement ;
|
|
- Utilisation des équipements récents permettant
des transformations et conditionnement
conformes aux normes internationales. Ceci pourra
améliorer la qualité du café transformé et sa
compétitivité sur le marché locale et international ;
|
|
Rajeunissement des acteurs,
|
|
Création de nouveaux produits dérivés du
café ;
|
|
- Valorisation des déchets de chaque étape
|
|
- Stratification des qualités en raison de la
stratification des revenus des acheteurs,
Promouvoir une transformation bio
|
Production
|
5.
|
Investissement dans la ressource humaine et dans
l'équipement
|
|
- Formation des producteurs de café aux bonnes pratiques
agricoles (taille, sarclage,
récolte sélective, amélioration du
séchage et du stockage) ;
|
|
Structuration des producteurs par création des
associations, des coopératives.
|
|
- Renforcement de la coordination entre les producteurs ;
|
|
- Revitalisation des anciennes plantations dans un
système agroforestier ;
|
|
- Installation des champs collectifs en plus des champs
individuels ;
|
|
- Création des points de collecte, entreposage et de
vente des cafés en price makers ;
|
|
- Accompagnement par les services publics : ONAPAC, SNCC, IFA,
INERA/Ybi ;
|
|
- Mettre en place un système d'autofinancement
|
|
|
Promouvoir l'agriculture bio
|
|
40
| 


