I.2.2 Classification
De manière générale, on peut admettre une
classification selon la nature chimique, le mode et le type d'action, la nature
de l'espèce à combattre, l'effet obtenu, la toxicité, le
moment d'application ou bien même le lieu d'application (El Bakouri,
2006). On classe ainsi les produits phytosanitaires d'après la nature de
l'espèce nuisible que l'on veut contrôler en herbicides,
insecticides, fongicides, molluscides (limaces), nématicides (contre les
vers), rodenticides (contre les petits rongeurs), acaricides, taupicides,
corvicides, etc. (Zacharia & Tano, 2011). En considérant seulement
les herbicides (contre les mauvaises herbes), les fongicides (contre les
champignons) et les insecticides (contre les insectes), on se trouve devant une
extraordinaire diversité de familles chimiques, et dans chaque groupe on
distingue deux sous-groupes qui sont : les produits inorganiques et les
produits organiques. Le tableau I.2 ci-dessous donne quelques familles
chimiques de pesticides et leurs cibles principales.
Tableau I.2: Quelques familles
chimiques de pesticides et leurs cibles principales (Chouteau, 2004)
|
Familles chimiques
|
Exemples de substances
actives
|
Classement selon cible
|
|
Organochlorés
|
DDT, Chlordane, Lindane,
Dieldrine, Heptachlore
|
Insecticides
|
|
Organophosphorés
|
Malathion, Parathion,
Chlorpyrifos, Diazinon
|
Insecticides
|
|
Carbamates
|
Aldicarbe, Carbaryl,
Carbofuran, Méthomyl
|
Insecticides
|
|
Dithiocarbamates
|
Mancozèbe, Manèbe,
Thirame, Zinèbe
|
Fongicides
|
|
Phtalimides
|
Folpel, Captane, Captafol
|
Fongicides
|
|
Triazines
|
Atrazine, Simazine,
Terbutylazine
|
Herbicides
|
|
Pyridines-bipyridiliums
|
Paraquat, Diquat
|
Herbicides
|
|
Aminophosphonates glycine
|
Glyphosate
|
Herbicides
|
Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 21
I.2.3 Mode de pollution des pesticides
L'utilisation des pesticides facilite l'introduction d'un
certain nombre de substances chimiques dans la composition de l'air, de l'eau
et du sol. Ces substances entraînent ainsi la perturbation ou la
dégradation de ces milieux et provoquent la pollution de
l'environnement. Le traitement des plantes par les pesticides est suivi par le
phénomène de dissipation de ces derniers. Deux processus
fondamentaux contribuent à cette dissipation à savoir, la
dispersion et la dégradation (Schéma 1). La dispersion des
pesticides est assurée par de différents modes de transfert
(volatilisation, lixiviation, absorption par la plante) qui entraînent le
produit et, éventuellement ses dérivés, hors du site
d'application (Chevreuil et al., 1993 et 1996 ; Aderhold &
Nordmeyer, 1995 ; Miller et al., 1997). La dégradation des
pesticides fait intervenir des réactions chimiques (photolyse,
hydrolyse) ou biochimiques (impliquant l'intervention des micro-organismes du
sol) qui assure la transformation de la molécule initiale (Ristori &
Fusi, 1995 ; Soulas, 1999). Le schéma ci-après explique la
dissipation des pesticides dans l'environnement.
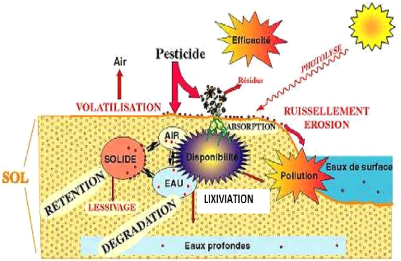
Schéma I-1 : Processus
impliqués dans le devenir des pesticides dans les sols (Barriuso et al.,
1996).
Ce schéma confirme bien que les pesticides
destinés à la protection des plantes se retrouvent dans les
différents compartiments environnementaux et représentent une
menace réelle pour l'homme et l'environnement. Quel que soit le mode
d'utilisation, ces pesticides
Thèse de" Master of Science " de TAGNE TIEGAM RUFIS 22
finissent toujours par atteindre le sol durant ou après
le traitement et leur devenir va donc dépendre des
caractéristiques du sol. De tous les polluants recensés
jusque-là, les pesticides sont l'une des classes fréquemment
rencontrées dans le milieu naturel et plus précisément
dans l'eau (Aubertot et al., 2005). La forte toxicité des
pesticides a conduit les organismes internationaux à fixer des
concentrations limites permises, très strictes. Ainsi, la norme
européenne (directive 98/83/CE) relative à la qualité de
l'eau fixe à 0,1 ug/L la teneur en chaque pesticide et à 0,5 ug/L
pour l'eau potable (Carter, 2000).
|
|



