|
LES FLUX DE TRANSPORTS
DANS L'OUEST LYONNAIS
(EXAMEN DE LA SITUATION ANTERIEURE
A LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A89
DE BALBIGNY A LYON)
Sous la direction de S. Héritier

14vant de commencer ('étude des f(ux de transports dans
('ouest (yonnais, je sou/laiterais remercier toutes (es personnes qui m 'ont
aidé a mener a 6ien ce projet.
iMes premiers remerciements vont a mon directeur de
mémoire, iMonsieur Stép/lane .7-féritier, qui a toujours
su se rendre disponi6(e pour me prodiguer de nom6reux et précieux
consei(s.
Je tiens aussi a remercier iMonsieur Jean )ar(et, directeur de
('O6servatoire de ('1489, qui m'afourni gratuitement de mu(tip(es documents et
ouvrages et qui a organisé, en Juin 2007, un rassem6(ement des
c/lerc/leurs de ('O6servatoire de ('1489, ric/le d'enseignements.
(Durant mes rec/lerc/les, des organismes m'ont ouvert (eurs
portes. I( s'agit des (Divisions (Départementa(es et de (a (Division
cRégiona(e de ('cEquipement, du Consei( cRégiona( de
cR/lône-14(pes et de (a Communauté de Communes de cBa(6igny. Sans
eux, je n 'aurais pu conduire convena6(ement mon étude.
cEnfin, je voudrais adresser mes derniers remerciements a toute
ma fami((e, surtout Sandra, qui m 'a soutenu tout au (ong de ('avancée
de mon étude.
Pt~ffL4 ~~~t4%~L+
INTRODUCTION
Ce mémoire de Master 1 réalisé à
l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne a pour objet les flux de
transports dans l'ouest lyonnais avant la construction de l'autoroute A89 de
Balbigny à Lyon. L'autoroute A89 est une liaison transversale qui
reliera à terme Bordeaux à Lyon. L'étude qui suit ne prend
pas une si petite échelle. Il convient de définir notre secteur
d'étude. Lorsque nous parlons d'ouest lyonnais, nous ne parlons pas de
tout ce qui se trouve à l'ouest de Lyon. Les limites de notre
étude sont constituées par un triangle Roanne - Saint-Etienne -
Lyon. Certes, nous serons amenés à évoquer les
échanges avec le « Grand-Ouest lyonnais » : Massif Central
(Clermont-Ferrand), voire Bordeaux, mais la majeure partie de la
réflexion s'intéresse au triangle Roanne - Saint-Etienne - Lyon.
A l'intérieur de ce triangle, nous observerons tout
particulièrement les territoires directement concernés par la
mise en place future de l'A89. Il existe un Schéma de Cohérence
Territoriale de l'ouest lyonnais mais il ne s'étend pas plus loin que le
département du Rhône. Se caler sur ses limites ne permettait pas
de prendre en compte tous les flux en provenance de l'ouest en direction de
Lyon ou de l'Est. De plus, il a semblé intéressant de se projeter
de temps à autres hors de la zone d'étude à l'Est afin de
d'établir une comparaison. La carte ci-dessous présente la zone
d'étude.
Figure 1 : Localisation de la zone
d'étude
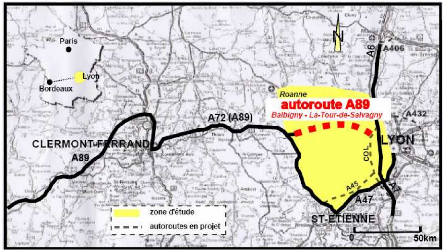
Source : Dossier d'enquête. Réalisation :
Pailler.S (2007)
La démarche retenue pour cette étude est
une démarche empirique. Elle consiste à
recueillir dans un
premier de temps des données qui seront ensuite exploitées et
mises en
comparaison avec des propos théoriques. Ainsi,
l'étude de terrain est privilégiée pour
permettre de faire une analyse spatiale. Les données de
comptages routiers ont été récoltées auprès
des Divisions Départementales de l'Equipement du Rhône et de la
Loire (DDE 69 et 42) ainsi qu'auprès de la Division Régionale de
l'Equipement de Rhône-Alpes. La DRE a élaboré le Dossier
d'enquête préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique en 2001. Ce document était une
référence tout au long de l'étude. Les informations
concernant le transport ferroviaire ont été fournies par le
Conseil Régional de Rhône-Alpes qui a la charge du transport
ferroviaire de voyageurs. Les informations thématiques, telles que
l'accessibilité, les motifs de déplacements, les coûts de
déplacements... ont été recueillies auprès de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne et du Syndicat mixte des
Transports de l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL). Les recherches ne
furent toutefois pas aisées pour principalement deux raisons. La
première est que la zone d'étude choisie ne correspond pas
strictement à des limites administratives et chevauche deux
départements. Chaque département réalise les études
qui le concernent. Ces études ne concordent pas forcément avec
celles réalisées par le département voisin (elles n'ont
pas le même thème, la même échelle, n'ont pas
été effectuées à la même date...). De plus,
les études mises à disposition par la région
Rhône-Alpes sont élaborées à une échelle trop
petite, et donc pas assez précise pour étudier l'ouest lyonnais.
L'étude proposée ici essaie de coordonner les diverses
informations récoltées pour construire une réflexion
cohérente à l'échelle du territoire concerné. La
seconde raison était le refus d'Autoroutes du Sud de la France (ASF) de
permettre l'accès à des comptages récents de trafic pour
des raisons de confidentialité liées à la stratégie
d'entreprise. De novembre à février, outre le temps
consacré à la lecture de nombreux ouvrages, les recherches de
données se sont perdues dans une recherche de chiffres récents.
Ainsi, pendant ces 4 mois, les recherches n'ont guère avancé. Ce
fut une des plus grosses erreurs dans la méthodologie car la quête
de données récentes a constitué l'unique recherche durant
cette période et n'a pas favorisé l'accès à
d'autres documents. Finalement, la mise en ligne d'informations sur les sites
des DDE et la rencontre des bonnes personnes ont permis d'avoir accès
à ces comptages. C'est à partir de là que la
découverte de nombreuses autres sources a débuté et que le
mémoire a pris forme.
La pratique du traitement de texte, la gestion des
données, l'élaboration de graphiques ne furent pas des
contraintes à la construction du mémoire. En revanche, la
réalisation de cartes s'est avérée plus difficile. Les
logiciels de cartographie n'étant pas connus, il fut nécessaire
de les découvrir et d'en apprendre les rudiments. Le principal outil
utilisé pour la réalisation de carte est Adobe Illustrator.
Les difficultés rencontrées pour l'usage des logiciels de
cartographie est la cause de la qualité graphique moyenne
des cartes réalisées malgré les nombreuses heures
passées à l'appréhension du logiciel.
Une réflexion sur les flux de transports
nécessite l'utilisation de concepts qu'il convient au préalable
de définir. Ces définitions sont extraites de différents
ouvrages. Elles permettent de cadrer épistémologiquement la
recherche et de ne pas confondre les termes employés. Parmi les concepts
abordés, les concepts de circulation, de flux et de mobilités
sont les plus importants. La définition du transport doit elle aussi
être clarifiée. Les définitions permettent de faire un tour
d'horizon des travaux sur les transports réalisés ces
dernières années.
Le terme de flux désigne une circulation entre lieux
sur une infrastructure. Il consiste en un déplacement qui à une
origine, une destination et un trajet. Il faut distinguer les flux en un point
et les flux entre deux points. En matière de trafic routier, un comptage
indique le nombre de véhicules par heure alors qu'une enquête
« origine-destination » permet de connaître les
déplacements entre deux zones, soit sur une voie donnée, soit
sans précision d'itinéraire. Törsten Hägerstrand (l'un
des pionniers de « la nouvelle géographie »), dans les
années cinquante/soixante, développant la Time Geography
(la seule focalisation sur l'espace n'est pas suffisante, les
phénomènes sociaux possèdent aussi une dimension
temporelle), met les flux au coeur de l'ambition géographique. Il
démontre que les individus sont pris dans des flux, des
interrelations... qui dépassent largement l'échelle locale. Les
flux entre deux zones sont fonction de leur « masse » respective
(population, commerces, emplois...) et fonction inverse de la distance qui les
sépare. Aujourd'hui, l'observation des déplacements sert à
penser le passage de la ville à l'urbain, les trajets domicile-travail
participant d'ailleurs directement en France à la construction
statistique des aires urbaines par l'INSEE. Les flux supposent des tuyaux de
toute sorte, dont les caractéristiques technico-économiques
pèsent lourd en termes d'enjeux territoriaux et politiques. Elaborer une
géo-socio-économie-politique des flux et des réseaux sur
lesquels ils circulent constitue d'ailleurs un objet scientifique de
première importance. La revue Flux, Cahiers scientifiques internationaux
Réseaux et Territoires créée par le CNRS se consacre
à cet objet (Lévy et Lussault, 2003, pp 367-3 68). Cette
revue est dirigé par Jean-Marc Offner qui a rédigé en 1993
un article dans la revue L'Espace Géographique :
« Les « effets structurants » du transport
: mythe politique, mystification scientifique » dans lequel il critique
l'absence conceptuelle en matière d'effet des transports, absence qui
conduit à considérer comme « mécaniques », et
donc prévisibles les effets d'un axe de transport. Auparavant, Plassard
évoquait cette idée en 1977 dans un
livre de référence qui a fait date : Les
autoroutes et le développement économique régional,
dans lequel il affirme que « la vision simpliste de
mécanismes de cause à effets ne peut être
conservée... la notion de potentialité semble être une des
voies efficaces qui permette ce changement de conception ». Ainsi,
lorsque notre étude abordera les effets prévus et/ou
espérés, nous préférerons le conditionnel et des
verbes exprimant la possibilité à un futur trop
déterministe.
La circulation est un principe de fonctionnement de tout
système car elle permet les échanges et les transferts sans
lesquels aucune interaction ni aucun dynamique ne seraient possibles. Par le
biais des distances, des temps de déplacements et des coûts de
transport, la circulation est un des facteurs essentiels pris en compte dans
l'élaboration de tous les modèles d'organisation de l'espace.
Elle est aussi productrice d'espace par les infrastructures qu'elle
nécessite et, parce qu'elle participe à la hiérarchisation
des lieux qu'elle relie, elle joue un rôle clé dans les
différenciations spatiales. Les espaces mis en liaison
génèrent des flux ou sont des relais du circuit (Lévy
et Lussault, 2003, pp 158-159).
La mobilité est l'ensemble des manifestations
liées au mouvement des hommes et des objets dans l'espace. C'est un
concept englobant dont il convient de décliner toutes les notions qui en
découlent (déplacement, transport, migration...) et qui sont
souvent confondues avec lui. Les groupes humains sont confrontés
à la maîtrise de la distance par la mobilité. Celle-ci ne
se limite pas au déplacement physique effectif et ses techniques (le
transport), mais embrasse les idéologies et les technologies du
mouvement en cours dans une société. Elle rassemble donc à
la fois un ensemble de valeurs sociales, une série de conditions
géographiques, économiques et sociales, un dispositif technique.
Les coûts (économiques, sociaux et temporels) de la
mobilité ont tendance à s'alourdir car la mobilité
augmente (Lévy et Lussault, 2003, pp 622 - 624). La
mobilité peut être déclinée en deux types : la
migration (changement définitif du lieu de résidence) et
circulation (changement temporaire de lieu) (Zelinsky, 1971, pp 219-249).
La migration implique donc un abandon de longue durée du lieu de
départ. Il conviendrait alors de préférer l'expression de
mouvement pendulaire à l'expression « migrations pendulaires
». Toutefois, la substitution d'une migration résidentielle par une
circulation domicile-travail remet en cause cette opposition
migration-circulation. Il est préférable de s'intéresser
à la visée de la mobilité : déplacements
touristiques, voyages d'affaires, migration résidentielle, circulation
pendulaire, shopping...
Les transports sont les dispositifs, modes et moyens,
permettant l'acheminement de personnes ou de biens matériels d'un lieu
vers un autre. Par extension, ensemble des moyens de la mobilité. Les
transports sont un outil dont disposent les sociétés pour
produire et gérer
leur espace, c'est-à-dire organiser la mise à
disposition des lieux les uns des autres. Ils permettent le franchissement
physique de la distance qui sépare les lieux. Les différents
modes de transports (routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien...)
sont choisis et sélectionnés par les individus non seulement pour
leurs qualités pratiques en terme de déplacement, mais aussi pour
ce qu'ils autorisent et ce qu'ils représentent. Les transports routiers
ne peuvent se passer de réseaux d'infrastructures dont les coûts
de construction et d'entretien sont supportés par la collectivité
(par les impôts si l'autoroute est gérée par l'Etat et par
un droit de péage si celle-ci est concédée à une
société privée). Les transports sont inscrits dans le
territoire, dont leurs réseaux en constituent l'armature. Les
réseaux de transports reflètent, entretiennent et amplifient les
anisotropies (lignes de force) du territoire. Ainsi, ils contribuent à
ses changements et imposent son aménagement. La vitesse des transports
définit un certain nombre d'échelles pertinentes pour
l'organisation du territoire, le nombre de ces échelles augmente avec la
création de modes de transports aux vitesses différentes.
L'intermodalité, est la mise en correspondance de plusieurs modes de
transports, elle combine donc plusieurs vitesses et échelles lors d'un
déplacement. L'intermodalité tend à se développer
car les déplacements font de plus à plus appel à divers
modes de transports. Le territoire s'en trouve recomposé à deux
niveaux : par l'inégal accès aux réseaux de transport et
par la mise en place d'un système qui brise la continuité
territoriale. Les réseaux de transports inversent l'ordre des
proximités. Ainsi, la connexion des grandes villes saute les espaces
intermédiaires, qui ne disposent alors d'aucun point d'accès
à un réseau dont l'échelle de référence les
dépasse. Il s'agit de « l'effet tunnel ». L'infrastructure
constitue alors une barrière pour les espaces intermédiaires qui
se voient infliger les nuisances de l'infrastructure. La création d'une
infrastructure à petite échelle peut alors se voir
confrontée à un refus de la part des habitants de l'espace
traversé. Ceux-ci perçoivent l'intérêt de la mise en
place de l'axe de transport mais ne souhaite pas le voir passer chez eux ou
à proximité. Il s'agit de l'effet NIMBY (not in my backyard)
(Lévy et Lussault, 2003, pp 93 7-938).
Une citation d'Emile Mérenne résume les
éléments que nous venons d'évoquer : « Les
déplacements de personnes, de biens, d 'informations... à travers
l 'espace caractérisent la circulation (ensemble des
déplacements), dont l 'intensité dans le temps et dans l 'espace
détermine le trafic (importance et fréquence de la circulation)
et les flux (déplacements massifs de personnes, de biens ou
d'informations). Ces déplacements font appel à des moyens
techniques ou moyens de transports (ensemble des techniques utilisées
pour effectuer les déplacements) qui s 'inscrivent dans les territoires
grâce aux voies de communication
(installations permettant la circulation des personnes et
des biens), à savoir la route, la voie d'eau, le rail, les conduites...
» (Mérenne, 2003).
Pour aller plus loin, Philippe Pinchemel précise que
les flux sont les éléments qui servent de base à
l'activité humaine : « Toute la vie humaine peut se lire
à travers les flux. Ils relient les hommes entre eux ou les hommes aux
lieux. Avant, les flux dans les régions concernaient uniquement de
faibles quantités de produits et d'hommes. Très rapidement, les
espaces régionaux, nationaux sont entrés dans un réseau
dense d'échanges intégrés au commerce mondial. Les voies
et modes de transports associés sont la réponse au
problème de la maîtrise de la distance. Avant la voie, l 'espace
est isotrope. Avec la voie, la dualité
proximitééloignement constatée pour le pôle joue
tout au long du tracé, créant une anisotropie spatiale forte
» (Pinchemel, 1997, p.97).
La littérature géographique fourmille donc
d'ouvrages abordant les flux de transports. Les études
réalisées par les observatoires autoroutiers enrichissent cette
littérature par leurs exemples concrets. Jusqu'à présent,
l 'Observatoire de l 'A89, dirigé par Jean Varlet, ne s'est pas
penché très précisément sur les flux de transports
dans l'ouest lyonnais. Ce mémoire constituera une des ressources
disponibles à l'étude des effets de l'A89 après sa mise en
place dans l'ouest lyonnais. En effet, lors d'une étude future de
l'organisation des flux de transports, et plus généralement, de
l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais avec l'A89, il s'avèrera
très utile de pouvoir établir une comparaison avec l'état
de l'ouest lyonnais avant la mise en service de l'autoroute.
La section que nous nous proposons d'étudier correspond
au dernier tronçon de l'autoroute A89, le tronçon permettant
d'achever la liaison autoroutière directe entre Lyon et Bordeaux.
L'ouest lyonnais est un espace soumis en grande partie à l'influence de
l'agglomération lyonnaise qui joue son rôle de métropole
régionale. Cette influence s'exprime notamment par de nombreux
échanges entre l'ouest lyonnais et son agglomération, elle est le
facteur principal de mobilité. La mobilité dans l'ouest lyonnais
se traduit pas des flux que l'on peut localiser et quantifier. Quel est
l'intérêt de connaître les flux qui circulent sur des axes,
sur des réseaux ? Y'a-t-il un lien entre les flux et les organisations
de l'espace ? L'organisation spatiale crée-t-elle les réseaux ?
Les réseaux créent-ils l'organisation spatiale ? Quelle est
l'influence d'une agglomération de la taille de l'agglomération
lyonnaise sur les mobilités au sein de sa périphérie ?
Quels peuvent être les modifications, les améliorations,
les perturbations de l'organisation spatiale de l'ouest
lyonnais engendrées par la mise en service de l'autoroute A89 ?
Pour tenter d'apporter des réponses à ces
questions, nous établirons un diagnostic des problèmes dont
souffre l'ouest lyonnais et observerons les enjeux liés à l'A89.
Une fois ce portrait de l'ouest lyonnais dressé, nous analyserons les
caractéristiques des flux de transports, qu'ils soient routiers ou
ferroviaires, ainsi que les motifs qui sont à la base des
déplacements. Enfin, nous discuterons des effets attendus de l'A89 dans
l'ouest lyonnais.
-1-
PRESENTATION
DE L'OUEST LYONNAIS
ET DES ENJEUX DE L'A89
|
L'étude géographique des flux de transports dans
l'ouest lyonnais se doit de considérer les transports comme faisant
partie intégrante d'un espace, d'un système géographique.
On ne peut extraire les flux de transports de l'espace dans lequel ils
s'exercent, avec lequel ils entretiennent des interactions. Une étude
purement sectorielle des transports n'en présente pas les enjeux
géographiques. Il est donc nécessaire de dresser un portrait
géographique de l'ouest lyonnais. Le dossier d'enquête publique
contient une présentation très précise de l'ouest
lyonnais. Parmi les éléments suivants, certains en sont extraits
pour comprendre les liens entre les réseaux de transport et leur milieu,
pour comprendre l'organisation spatiale de l'ouest lyonnais. Lorsque la source
n'est pas indiquée, les données proviennent de ce document.
L'ouest lyonnais est un espace qui ne favorise pas les
déplacements, dont le dynamisme est faible. Ce territoire sera, d'ici
2012, traversé par le dernier tronçon de l'autoroute A89 dont les
caractéristiques seront observées.
I- L'ouest lyonnais, un espace qui ne favorise pas
| 

