CHAPITRE III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION D'IDE AU
BENIN
La stratégie générale de toute entreprise
repose pour l'essentiel sur l'analyse de l'environnement. C'est ainsi que la
conduite d'un projet nécessite des enquêtes dans plusieurs
domaines : marché' technologie'
financement' gestion et collaboration de différentes
personnes physique et morales (promoteurs ; organisme de promotion et
d'assistance ; établissements financiers ; services administratifs).
Nous développerons dans ce chapitre les causes pouvant
expliquer la faible pénétration des IDE au Bénin. Nous
retenons les entraves structurelles et socioculturelles.
Section I : FACTEURS DE BLOCAGE DES IDE AU BENIN
Nous nous servirons de l'arbre à problèmes comme
outil d'analyse.
Ensuite il sera question dans cette section d'analyser les
facteurs économiques et les facteurs socioculturels.
Elaboration de l'arbre des problèmes

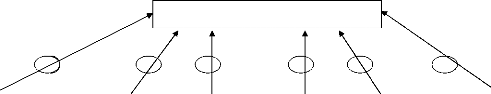
Faible pénétration des flux d'IED au
Bénin
1 2 3 4 5 6
|
Cadre
|
Inadéquation des
|
Méconnaissance
|
Coût total élevé
|
Faiblesse d
|
Environnement socio-
|
|
d'investissement
|
infrastructures de
|
des atouts
|
des facteurs de
|
tissu
|
politique de la sous région
|
|
peu favorable
|
base
|
naturels du Bénin
|
production
|
industriel
|
peu favorable
|

- Procédure d'octroi d'agrément lourde ;
- Difficultés d'accès au foncier ;
- Multiplicité des
organismes d'assistance et de promotion des IDE ;
- Système juridictionnel peu fiable ;
- Mauvaise gouvernance.
|
Non développe-
|
- Développement
|
- Peu d'unités de
|
|
- Guerre ;
|
|
ment des
centres de
|
du secteur informel ;
|
transformation ; - Dépendance de
|
|
- Crises politiques .
|
|
recherche
|
- Quasi-absence de
|
monoculture :
|
|
|
|
matières premières ;
|
le coton.
|
|
|
|
|
|
-Non développement du secteur transport
|
|




Faiblesse
d'investissements
publics

Diagramme 1 : Arbre des problèmes Source
:Réalisé par l'auteur
Paragraphe 1 : Facteurs économiques
A- Coût des facteurs de production
La création ou la délocalisation d'entreprises ou
filiales est motivée par la recherche de coûts de production
faibles.
Dans les pays de l'UEMOA en général et en
particulier le Bénin' il s'avère que les coûts
de production sont plus élevés qu'en Europe et en
Asie' Abbo K.B.(1994)' et cela est dû à
plusieurs facteurs qui lorsqu'ils sont regroupés' produisent
un coût total élevé. Ces facteurs sont très
diversifiés :
- les transports ;
- les équipements et matières premières ;
- les services d'utilité publique ;
- la faible productivité de la main d'oeuvre.
1. Les équipements et matières
premières
L'économie béninoise est tributaire d'un seul
produit d'exportation : le coton. Le coton occupe 80 % dans l'exportation
totale. Moins de 10% du coton béninois est transformé au
Bénin. A la lumière de ces considérations les
investisseurs étrangers dans le secteur de transformation sont
obligés de recourir au marché international pour acquérir
des matières premières. Ce qui induit un coût
supplémentaire dans l'acquisition des facteurs de production. Le
Bénin importe pratiquement tout l'équipement
industriel' agricole et informatique.
2. Faible productivité de la main d'oeuvre
La comparaison salariale d'un ouvrier français par
rapport à un ouvrier béninois montre que le salaire d'un ouvrier
français vaut les salaires de six ingénieurs' de dix
techniciens' de quatorze ouvriers qualifiés et trente sept
ouvriers béninois.
Si l'on considère que le salaire est fixé par la
productivité marginale du travail on est amené à dire que
la main d'oeuvre étrangère est plus qualifiée que celle
du
Bénin. L'investisseur privé importera donc la main
d'oeuvre étrangère. Ce qui augmente le coût des facteurs de
production.
B- La faiblesse du tissu industriel
Le niveau industriel est une composante dans la
captivité des IDE. Le secteur agricole est essentiellement dominé
par le coton qui est à l'origine de presque 80% de la valeur totale des
exportations. Seulement 20 % est transformé. Dans la politique de
diversification' d'autres produits ont été promus : le
riz' le manioc' le mais et la noix de cajou.
Cependant' plusieurs obstacles limitent la
production et la transformation de ces cultures. Il s'agit principalement de
difficultés liées au manque d'installation industrielle. Par
ailleurs la faiblesse du tissu industriel est liée à la
pauvreté du pays en ressources géologiques (mine'
pétrole) et à la taille réduite du marché local.
Quand à l'industrie légère de transformation'
son développement est annihilé par la taille réduite du
marché local et par la surproduction observée au Nigeria.
C- L'accès au marché
La population béninoise est d'environ 7 millions
d'habitants. La faiblesse du pouvoir d'achat rend le marché
béninois étroit. De plus' le secteur informel
dominé par le commerce de réexportation' rend peu
compétitive une entreprise installée en toute
légalité. Les acteurs du secteur informel échappent
à la fiscalité. Pour maintenir les niveaux du revenu tout en
respectant les obligations fiscales et salariales en vigueur' la
seule possibilité qui s'offre aux petites entreprises est d'augmenter
les prix du même montant que les charges fiscales (soient 30 % en
moyenne). Ces limites structurelles constituent une barrière à
l'accessibilité du marché Béninois.
Toutefois' le Bénin est signataire de
plusieurs accords régionaux et multinationaux dans le cadre commercial :
Accord de régime préférentiel des échanges au sein
de l'UEMOA' les accords de l'OMC' l'accord de partenariat
ACPUE' et l'AGOA. Le marché de l'UEMOA devrait être
stimulant à l'IDE. Or la sous-
région est caractérisée par des crises
politiques qui influencent négativement le risque pays.3 La
Côte d'Ivoire a un risque pays très élevée ; alors
qu'elle contribue pour 40 % du PIB de l'UEMOA. Par l'effet de tâche
d'huile la crise pourrait influencer négativement le climat des affaires
au Bénin.
En somme' la taille réduite du marché
Béninois' la faiblesse du pouvoir d'achat' le
secteur informel et la crise politique en Côte d'Ivoire constituent des
obstacles l'entrée massives des IDE.
Tableau 4 : Niveau du risque pays dans certains Etats
africains
|
A
Risque faible
|
B
Risque modéré
|
C
Risque important
|
D
Risque élevé
|
|
Afrique du sud
Botswana
Tunisie
|
Algérie
Bénin
Sénégal
|
Angola
Mozambique
Tanzanie
|
Nigeria
Côte d'Ivoire
Zimbabwe
|
Source : Coface 2002

D- Les infrastructures
Le niveau de développement des infrastructures de
transport et de communication influence significativement les choix des
opérateurs privés internationaux qui souhaitent mettre en place
de nouveaux projets d'investissement. Ainsi' les retards qui
caractérisent le Bénin en matière
d'infrastructures' surtout en matière de fourniture de
services d'utilité publique' pouvaient être un frein
à l'investissement privé.
1. Routes et chemins de fer
En ce qui concerne les infrastructures de
transport' le Bénin enregistre des retards
considérables par rapport aux pays de la région'
notamment le Niger' la Côte d'Ivoire et le Togo (tableau 5).
En effet' une étude réalisée par le CNUCED en
2005
3
Le risque pays est composé du risque politique et du
risque systémique lié au marché. L'appréciation est
faite par les agents de notation tels que la COFACE et EUROMONEY.
montre que les routes sont médiocres et le
réseau ferroviaire est vétuste. Le réseau routier
béninois est médiocre' 20 % des routes sont
goudronnées sur 6787 km de réseau routier. Les services de
transports sont organisés à 90 % par des sociétés
individuelles avec de petits véhicules dans des circonstances non
confortables. La durée moyenne pour relier deux grandes villes du Nord
au Sud (Cotonou- Parakou) distantes de 430 km est de cinq heures. Le faible
niveau de développement des transports augmente un coût
supplémentaire aux sociétés transnationales dans leurs
transactions à distance.
Par ailleurs ' le réseau ferroviaire ne répond
plus aux besoins actuels de
l'économie nationale' en
raison notamment de la vétusté de la voie ferrée de 438
km
qui relie les deux villes du pôle Sud et du pôle Nord que
sont Cotonou et Parakou.
Tableau 5 : Comparaison de l'infrastructure de transport
dans certains pays de l'Afrique
de l'Ouest (2004)
7
Facteurs
|
Bénin
|
Togo
|
Nigeria
|
Burkina
Faso
|
Côte
d'Ivoire
|
|
Longueur du réseau
ferroviaire en km
|
578
|
525
|
3557
|
622
|
660
|
|
Chemin de fer en km au
km2
|
0.005
|
0.009
|
0.004
|
0.002
|
0.002
|
|
Longueur du réseau
routier en km
|
6787
|
7520
|
194394
|
12506
|
50400
|
|
Routes en km au km2
|
0.006
|
0.13
|
0.21
|
0.05
|
0.16
|
|
Routes goudronnées en %
|
20
|
32
|
31
|
16
|
10
|
|
Nombre d'aéroports
goudronnés
|
1
|
2
|
36
|
2
|
|
Source : Central Investigation Agency' 2004.
2. Télécommunications
En matière d'infrastructures de
télécommunications' le Bénin se classe au
dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest. En effet' par rapport au
nombre de lignes téléphoniques fixes' de
téléphones portables' de fournisseurs de services
Internet et d'utilisateurs de l'Internet' seule la Côte
d'Ivoire a un taux de pénétration plus élevé.
Cependant' les opérateurs dénoncent les
difficultés et les lenteurs dans l'activation de lignes
téléphoniques fixes. Le coût de la communication reste
encore cher au Bénin comparativement aux coûts pratiqués
dans les autres pays de la sous région. Le coût
élevé de la communication augmente le coût de production
total. Ce coût élevé a ainsi un impact négatif sur
la pénétration des IDE.
3. Les services d'utilité publique
La distribution des services d'utilité publique (eau
et électricité) est médiocre dans l'ensemble du pays. Le
coût de l'électricité est élevé (95fcfa/kWh)
et les fortes variations du courant électrique entraînent des
dommages aux installations des opérateurs privés. L'addition des
coûts de ces facteurs entraîne un coût total
élevé des facteurs de productions.
4. Port et aéroport
Le port de Cotonou est l'une des principales sources de
revenus de l'économie béninoise. Cependant' le port
souffre de problèmes de corruption et d'insécurité.
En outre' en observant les indicateurs de
productivité de la manutention au port sur la période
2000-2002' on constate que le nombre de conteneurs sortis par heure
est de 19 en moyenne. La durée de stationnement est de 17 jours en
moyenne. La baisse de la productivité de la manutention au port retarde
les opérations de transactions des sociétés
transnationales. Ainsi' la mauvaise organisation de l'infrastructure
portuaire est un obstacle majeur à l'entrée des IDE.
Tableau 6 : Indicateurs de productivité de la
manutention au port de Cotonou.
|
2000
|
2001
|
2002
|
|
1. Conteneur par heure
|
|
|
|
|
SOBEMAP
|
23
|
18
|
16
|
|
Maersk (COMAN)
|
22
|
18
|
17
|
|
Bolloré (SMTC)
|
20
|
20
|
16
|
|
2. Durée moyenne de stationnement
|
|
|
|
|
SOBEMAP
|
15 jours
|
18 jours
|
18 jours
|
|
Maersk (COMAN)
|
12 jours
|
20jours
|
22 jours
|
|
Bolloré (SMTC)
|
12 jours
|
21 jours
|
18 jours
|

Source : Port autonome de Cotonou' 2002.
Notons aussi le manque de fluidité des corridors de
transit.
Par ailleurs' les formalités de passage des
marchandises sont les plus lourdes dans la Sous-région et constituent un
handicap pour la compétitivité du corridor béninois .4
| 


