UNIVERSITE DE KAMINA
« UNIKAM »
B.P 279
KAMINA
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE
GESTION
Département de gestion
financière
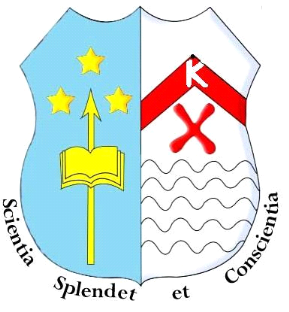
« IMPACT DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES SUR LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES AGRO-PASTORALES « Cas de
la compagnie pastorale du haut-Lomami »
Par BANZA WA BANZAGloire
Gradué en Sciences Économiques
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences
Économiques et de Gestion
OPTION: GESTION FINANCIERE
NOVEMBRE 2023
UNIVERSITE DE KAMINA
« UNIKAM »
B.P 279
KAMINA
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE
GESTION
Département de gestion
financière
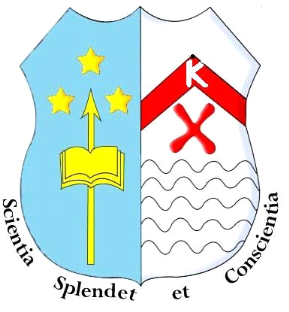
« IMPACT DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES SUR LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES AGRO-PASTORALES « Cas de
la compagnie pastorale du haut-Lomami »
Par BANZA WA BANZAGloire
Gradué en Sciences Économiques
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du grade de licencié en Sciences
Économiques et de Gestion
OPTION: GESTION FINANCIERE
Directeur : Pr. Dr. Fulbert MUKALAY MUTOMBO
Co-directeur : Ass. KALENGA MWENZE Vallery
NOVEMBRE 2023
EPIGRAPHE
« Pour conquérir le marché, vous devez
d'abord conquérir votre environnement de travail. »
DOUG Conant
DEDICACE
À tous les gestionnaires ainsi qu'à tous les
économistes du monde entier, dédions ce travail.
GLOIRE BANZA
REMERCIEMENTS
Étant arrivé au terme de notre deuxième
cycle d'études universitaires, qu'il nous soit permis de remercier des
personnes qui ont contribué, de loin ou de près, à la
réalisation de ce présent travail.
Notre gratitude va en premier lieu à notre Dieu
seigneur Jésus-Christ, sans qui nous ne saurions vivre et en arriver
là ; à nos parents MWEHU MUSUYU OLIVIER et LENGE MWENZE
CLAUDINE pour leurs sacrifices, encouragement, conseil et grand amour
éprouvé à notre égard.
À nos frères et soeurs : NARCISSE NKONGA,
LYDIA MWEHU, JUSTIN MWEHU, MARCIA MWEHU, DEBORAH MWEHU, EMILIE BANZA, STEPHANIE
MBUYA, RIPHIN. Pour leur amour fraternel.
À notre directeur le Professeur. Docteur MUKALAY
MUTOMBO FULBERT et son assistant Mr KALENGA MWENZE VALLERY pour la bonne
direction du présent travail.
À toi PRAISE KIMBAYA ET DEMAMAN
KISHIKO, sans vous je ne pouvais pas en arriver jusque-là. Je
vous suis redevable à jamais et Les mots me manquent pour vous exprimer
ma reconnaissance.
À vous mes chers amis REAGAN KALUMBA, PRINCY SANGWA,
BIENVENU MBAYO, WARTIN KABONGO, JR MPOYO pour votre soutien moral.
À tous ceux qui, de loin ou de près nous ont
aidé d'une manière ou d'une autre tout au long de notre parcours
académique, disons merci.
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE
La gestion des ressources humaines (GRH) est devenue, au cours
des dernières années, une activité stratégique
créant un avantage concurrentiel essentiel à la firme(Guy, 2006).
En effet, le travailleur n'est plus qu'un engrenage remplaçable pour
l'entreprise, mais plutôt un actif intangible que l'on veut attirer,
former, motiver, engager, orienter, développer, mais surtout retenir
dans notre entreprise. De ce fait, on réalise que les entreprises
investissent de plus en plus dans leur capital humain.
Bien gérer l'être humain devient un enjeu
tellement important qu'il fait partie intégrante des grandes
orientations stratégiques des entreprises innovantes. Par ailleurs, on
sait maintenant que l'innovation constante est un enjeu essentiel à la
survie d'une entreprise. De ce fait, celle-ci passe inévitablement par
la création d'un environnement permettant l'émancipation
d'idées innovantes. Mais comment mettre en place un climat de travail
propice à cette éclosion? Inévitablement, cet
environnement de travail doit être calqué sur des pratiques de
gestion des ressources humaines (GRH) qui permettent aux individus d'être
des créateurs et des innovateurs. De plus, ces pratiques doivent
maintenant intégrer l'ensemble des ressources humaines. En effet, chacun
des employés de la firme a un potentiel d'innovation que l'entreprise se
doit de profiter pour demeurer concurrentielle. C'est par la
concrétisation d'idées innovantes quotidiennes et par la
motivation intrinsèque que procure une gestion des ressources humaines
(GRH) efficace que la firme obtient un retour sur son investissement.
En effet l'instabilité économique des
dernières décennies et la compétitivité accrue dans
la plupart des secteurs d'activité forcent les entreprises à
reconsidérer, sinon à considérer, la place du personnel
dans leur organisation. Longtemps définie comme une activité de
support aux autres fonctions de l'organisation, la gestion des ressources
humaines représente maintenant la fonction qui permet à une
entreprise de se démarquer de ses concurrents (Becker B. M., 1997). Pour
améliorer leur performance et leur position concurrentielle, les
entreprises n'ont d'autres choix que de réviser leurs façons de
faire dans les activités traditionnelles de gestion des ressources
humaines telles que la planification de la main-d'oeuvre, la dotation ou encore
la gestion des carrières, mais surtout d'innover en développant
des pratiques de gestion des ressources humaines efficaces qui auront pour
résultats d'attirer et de conserver dans l'entreprise une main-d'oeuvre
compétente.
Une entreprise qui se respecte et qui veux être
respecté, pour arriver à atteindre ses objectifs ultimes, fera ou
doit faire appel aux différentes procédures pour la
détermination et la réalisation de ses objectifs.La compagnie
pastorale du Haut-lomami(KIABUKWA) étant une entreprise, est
appelée à s'inscrire dans la logique du paragraphe ci-dessus pour
l'amélioration des performances et des résultats à court,
moyen et le long terme qui dépendent essentiellement du niveau
d'activités progrès ; étant donné qu'elle n'a
pas était créée pour disparaître, mais chercher
à se maintenir. (prévisions, planifications et
contrôle).
La compagnie pastorale du haut-lomami doit ainsi être
plus productive financièrement, économiquement et socialement. De
plus, elle a comme mandat d'offrir plus de qualité, plus rapidement et
pour moins cher, tout en demeurant un bon citoyen corporatif.
La compagnie pastorale du haut-lomami est appelée
maintenant à se questionner sur les façons de demeurer
concurrentielle afin de conserver et d'accroître son marché
maisnous constatons depuis un temps quela compagnie pastorale du haut-lomami ne
fournit pas aux consommateurs potentiels de nouveaux produits en terme
d'innovation et de la croissance de son activité étant
donné qu'elle doit faire sa place dans cette concurrence plus globale si
elle veut tirer profit du plus grand nombre de consommateurs.
Ce phénomènea suscité une
curiosité scientifique en nous de chercher à savoir comment cette
entreprise arrive à se démarquerde ses concurrents étant
donné que l'entreprise est appelée à vivre dans un
environnementqui lui impose certaines barrières ou contraintes provenant
de son environnement organisationnel, culturel ou social.
Suite à toutes ces considérations, il y a lieu
donc de consacrer une attention particulière à l'impact de la
gestion des ressources sur la performance de ladite entité.
2. ETAT DE LA QUESTION
Notre travail n'est pas le seul qui se soit
intéressé à l'impact de la gestion des ressources humaines
sur la performance des entreprises agro-pastorale. Il n'en est pas le dernier
non plus. Plusieurs de nos prédécesseurs s'y sont
déjà penchés. À titre exemplatif, nous pouvons
citer les travaux ci-après :
Ø Ntamusimwa (2010), dans son mémoire de fin
d'étude intitule « l'impact de la gestion des ressources
humaines et la performance des PME à Bukavu », sa
préoccupation majeure était de vérifier la
corrélation entre les pratiques de la gestion des ressources humaines
auxquelles font recours les PME à Bukavu et leur performance.
Son étude a été faite sur 127 PME avec
comme objectif de ressortir l'effet pratique de gestion des ressources humaines
sur la performance par la méthode de l'analyse factorielle, l'analyse de
corrélation et de la régression multiple. Ceci lui permet
d'éclaircir ses résultats des études empiriques ainsi les
résultats ont conduit à une échelle purifiée de six
composantes incluant 18 items avec une fiabilité Alpha de Cronbach
très élevé (=O,80) traduisant une forte cohérence
interne de l'outil de mesure utilisé. Une corrélation
significative entre les pratiques de la gestion des ressources humaines et la
performance organisationnelle, sociale, économique des PME.
Ces résultats montrent que les deux dimensions de
pratiques de gestion des ressources humaines déterminent positivement la
performance de PME à Bukavu.
Ø Lise Chrétien , Guy Arcand , Geneviève
Tellier et Michel Arcand tous professeurs d'universités (Lise
Chrétien, 2015)dans leur revue internationale sur le travail et la
société, ils ont analysés l'impact des pratiques de
gestion des ressources humaines sur la performance organisationnelle des
entreprises de gestion de projets, ces auteurs cherchaient à
vérifier si les pratiques de gestion des ressources humaines ont un
impact sur la performance sociale, économique et financière
d'entreprises de gestion de projets.
Pour y arriver, ils ont formulé la question de
recherche en ces termes, comment mesurer le degré d'implantation des
pratiques ressources humaines dans une entreprise ?
À cette question principale, les auteurs avaient
posé l'hypothèse suivante qui avait constitué l'assise de
leur recherche : Le niveau d'implantation des pratiques de gestion des
ressources humaines telles que l'analyse des emplois, la planification des
ressources humaines, la planification des carrières, la
sélection, l'accueil, l'évaluation du rendement, la
rémunération incitative et la formation est positivement
relié à la performance des entreprises.
Ils ont utilisé les indicateurs de performance pour
bien mesurer le niveau d'implantation des pratiques de gestion des ressources
humainesdont l'analyse de 5 variables. Trois de ces variables servent à
mesurer la performance sociale de l'entreprise, à savoir la satisfaction
du personnel, le taux de roulement et l'absentéisme, alors que les deux
autres visent à mesurer la performance économique et
financière à l'aide respectivement des délais de livraison
et du taux de rendement moyen d'un projet. Par exemple, les personnes
interrogées doivent préciser si « les délais de
livraison du projet sont respectés dans une » faible mesure
à une très grande mesure sur une échelle de 7. On s'attend
à une relation positive entre le niveau d'implantation de la pratique et
la performance de l'entreprise, c'est-à-dire plus une pratique RH est
fortement implantée, plus la performance de l'entreprise
devraitêtre élevée.
La performance sociale quant à elle, ils
ontobservé une relation positive entre le niveau d'implantation des
pratiques de gestion des ressources humaine et la satisfaction du personnel
négative avec le taux de roulement et l'absentéisme. En effet, si
les pratiques de gestion des ressources humaines ont un impact positif sur les
conditions de travail, le climat de travail et l'attachement envers
l'organisation, un niveau élevé d'implantation des pratiques de
gestion des ressources humaines devrait améliorer la satisfaction du
personnel et par conséquent réduire le roulement et
l'absentéisme.
La performance économique est définie par les
délais de livraison, c'est-à-dire le respect des délais
pour éviter les coûts de production en sus. Le respect des
délais dépendant de plusieurs services, les entreprises qui
investissent plus dans leurs pratiques RH devrait être plus performantes
que les autres. Il devrait donc y avoir une relation positive entre le
degré d'implantation des pratiques RH et la performance
économique des entreprises. Le taux de rendement d'un projet
défini par « le rapport en pourcentage du résultat net de
l'exercice et du montant des capitaux » traduit fidèlement la
performance financière d'un projet et par conséquent de
l'entreprise. On s'attend donc à une relation positive entre le
degré d'implantation des pratiques de gestion des ressources humaines et
la performance financière de l'entreprise.
Pour aboutir aux résultats, ils ont utilisé une
analyse de régression à partir d'un modèle linéaire
représenté par l'équation suivante : PERFORMANCE =
á + ?= 8 k 1 âk PRATIQUES RH k+ å
Leur résultat montre que seule l'évaluation du
rendement ne présente pas de résultats significatifs. Chacune des
pratiques étudiées montre dans l'une ou l'autre cas des analyses,
au moins une relation significative allant dans le sens d'une
amélioration de la performance des entreprises en gestion de projets.
Ø RABEARY Dimbiniaina Hantamalala dans son travail de
mémoire intitulé « ressources humaines : un des
facteurs de performance de l'entreprise », Cette étude qui
s'inscrit dans le management des ressources humaines lui a conduit à la
formulation d'un objectif global qui est d'améliorer la performance de
l'entreprise à travers les ressources humaines. Cet objectif global lui
a permis d'énoncer deux objectifs spécifiques dont
l'accroissement de la motivation des salariés d'une part et l'incitation
au renforcement de la formation des ressources humaines, d'autre part.
Pour bien avancer, l'auteur avait résumé sa
problématique de la manière suivante : quelles mesures les
entreprises peuvent-elles prendre pour motiver et satisfaire leurs
salariés afin qu'ils puissent activement participer au
développement des entités et les maintenir ou les conduire
à la réussite ?
Pour répondre à cette préoccupation,
l'auteur avait formulé les propositions suivantes comme
hypothèses de sa recherche :
Hypothèse 1 : la satisfaction au travail a un impact
sur la performance de l'entreprise.
Hypothèse 2 : l'implication organisationnelle
influence la réussite de l'entreprise.
Par l'intermédiaire de l'analyse SWOT ou Strengh
Weakness Opportunity and Threates. L'auteur est parvenu à la conclusion
qui stipule qu'Afin d'optimiser leurs résultats dans un environnement
toujours plus incertain, les entreprises doivent aussi développer les
compétences de leurs salariés à travers une bonne gestion
de carrière et des offres de formations. La gestion de carrière
est une source d'épanouissement professionnel qui permet de reconnaitre
et développer les talents des collaborateurs, de capitaliser un
savoir-faire et une culture d'entreprise.
La formation quant à elle est, est un ensemble de
mesures qui permettent soit la formation à un premier emploi, la
conservation à un nouvel emploi, la promotion ou encore l'acquisition,
l'entretien ou le perfectionnement des connaissances et dont la prise en charge
financière est prise en charge par l'Etat ou l'employeur. Elle permet de
favoriser l'évolution professionnelle.
Quant à nous, notre travail s'inscrivant à
l'ordre des travaux qui analysent l'impact de la gestion des ressources
humaines sur la performance des entreprises, utilisera la méthode
analytique. Malgré le passage par la structure financière
à travers les indicateurs de l'équilibre financier et par
quelques ratios, nos hypothèses seront infirmées ou
confirmées à partir des résultats que nous fourniraient
ces analyses. En suite cette analyse sera faite sur la compagnie pastorale du
haut-lomami, une société oeuvrant dans le secteur
agropastoral.
3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
3.1. PROBLEMATIQUE
La problématique est un ensemble de questions que l'on
pose pour traiter un sujet particulier(benveniste).
Selon le dictionnaire la problématique est un ensemble
des questions, des problèmes concernant un domaine de connaissances ou
qui sont posés par une situation.(LAROUSSE, 2007).
Selon nous, la problématique c'est l'art de poser des
questions.
Ainsi, une recherche scientifique est inévitablement
caractérisée par un écart ou un manque à combler
dans le domaine d'une connaissance entre ce que nous savons et ce que nous
désirons savoir sur le réel. Ceci, s'exprime par un sentiment
d'ignorance et par le désire de connaitre, par la volonté d'en
savoir plus en ce qui concerne le réel observable, par un
questionnement.
Une entreprise telle qu'elle soit, son objectif principal est
d'atteindre une bonne performance. Quel que soit le degré
d'intelligence, d'aptitude, ou de dextérité d'une personne, sa
compétence ne suffit pas à lui permettre d'atteindre une
forte productivité. Pour y parvenir l'entreprise doit répondre
aux besoins de la personne et mettre à sa disposition les ressources
nécessaires pour la bonne exécution des taches. Les motifs
spécifiques auxquels obéissent les employés dans le
travail affectent leur productivité.
Rares sont les processus de gestion qui permettent d'influer
sur le comportement des hommes et sur les performances de l'entreprise avec
autant d'efficacité que la gestion des ressources humaines. Pour toute
entreprise la meilleure stratégie pour améliorer la performance
managériale est d'être convaincue que les hommes sont leur
principal atout.
La réussite des entreprises en général,
dépend de la façon dont le personnel est géré, car
celui-ci est le moteur dans la gestion d'une entreprise. La gestion des
ressources humaines est un facteur indispensable à la performance des
entreprises ; un facteur que les managers des entreprises doivent prendre
en considération.
Ainsi, pour effectuer cette étude, nous avons choisi la
compagnie pastorale du Haut-lomami. Pour cela, nous formulons notre question de
recherche en ces termes :
Ø De quelle manière la gestion des ressources
humaines peut-elle influencer la performance de l'entreprise ?
Ø Comment une bonne gestion des ressources humaines
pourrait-elle contribuer au développement harmonisé de
l'entreprise ?
Tels sont les questions qui serviront de fils conducteurs de
notre recherche.
3.2. HYPOTHESE DE TRAVAIL
Une idée anticipée, est le point de
départ nécessaire de tout raisonnement expérimental. Cette
idée dirige la recherche scientifique et prépare les
découvertes. Un chercheur sans idée directrice pour observer les
phénomènes et les expérimenter, procède au hasard
et n'est pas capable d'identifier des faits pertinents.
D'après (MACE, 1988), l'hypothèse est une
réponse anticipée que le chercheur formule à la question
spécifique de recherche. Nous avons pris les hypothèses suivantes
qui pourront être infirmées ou confirmées à la fin
de notre recherche :
Ø La gestion des ressources humaines influence la
performance d'une entreprise dans le sens où l'homme serait
considéré comme une ressource qui conditionne les plus le devenir
de l'entreprise parmi les autres ressources.
Ø À travers nos suggestions et observations
faites, la gestion de ressources humaines pourrait contribuer au
développement harmonisé de l'entreprise si les conditions
relatives à la bonne gestion et à l'organisation de ces
ressources sont d'application en entreprise.
4. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES
1. METHODE
La méthode est l'ensemble des règles et des
démarches adoptées par un chercheur pendant son travail de
recherche pour parvenir à une ou plusieurs conclusions.(al, 2015).
Selon le dictionnaire le Larousse, la méthode est une
marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou
à la démonstration d'une vérité.(LAROUSSE,
2007).
Selon nous la méthode est l'ensemble de
démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la
vérité.
Ainsi, L'effectivité de ce travail fera appel à
la méthode inductive, étant une méthode de travail qui
part de faits, de données brutes réelles et observables, pour
aller vers l'explication de celles-ci. Ici, à partir des
phénomènes particuliers observés sur le terrain, le
chercheur peut comprendre un phénomène général
(LAUBET, 2000). Cette méthode sera soutenue par la démarche
analytique pour découvrir si les ressources humaines de la compagnie
pastorale du haut-lomami sont capables de générer des profits et
des avantages pour ses différentes parties prenantes et faciliter
l'appréciation du degré de cette capacité.
2. TECHNIQUES
Les techniques sont, en ce sens, des moyens dont on se sert
pour couvrir des étapes d'opérations limitées (alors que
la méthode est plus de l'ordre de la conception globale coordonnant
plusieurs techniques) ce sont des outils momentanés, conjoncturels et
limités dans le processus de recherche : sondage, interview,
sociogramme, jeu de rôle, tests,... (Aktouf, 1978).
De notre part, la technique est l'ensemble des
stratégies qui doivent sous-tendre la méthode pour parvenir
à l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire l'ensemble des petites
politiques devant soutenir la méthode (politique générale)
dans la collecte, l'analyse et le traitement des données.
Les techniques facilitent le processus de la recherche des
données et leur traitement. La récolte des données pour
l'élaboration du présent travail, nécessitera
l'utilisation des techniques documentaire et d'interview libre. Consistant
à collecter les documents nécessaires pour en tirer des
informations que l'on a besoin, la technique documentaire nous permettra de
consulter quelques documents nécessaires qui ont trait avec notre sujet
de travail, et des auteurs ayant parlé de la gestion des ressources
humaines et de la performance. Celle d'interview à son tour, dans son
but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes,
l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre à
l'enquêteur de recueillir certaines informations sur un objet
précis ; nous permettra d'être en contact avec les gestionnaires
de la compagnie pastorale du Haut-lomami pour des informations non
retrouvées dans leurs archives.
5. CHOIX, INTERET ET OBJECTIF DU SUJET
5.1 CHOIX DU SUJET
En général, c'est en fonction de la gestion
rationnelle des ressources humaines qu'une entreprise arrive à atteindre
ses objectifs. L'atteinte de la performance est un élément
essentiel visé par toute entreprise sérieuse. Alors c'est une
tâche lourde pour un manager de gérer les ressources humaines car
elles constituent un moteur principal pour l'entreprise.
Voilà pourquoi nous nous sommes dit de faire une
analyse sur l'impact de la gestion des ressources humaines sur la performance
des entreprises agropastorales. Ceci nous permettra d'expliquer ce que nous
avons observé en matière de la gestion des ressources humaines
(G.R.H).
5.2 INTERET DU SUJET
Dans les conditions économiques actuelles, la
performance se présente comme une notion fondamentale pour
établir la compétitivité des firmes. Et sa mesure devient
incontournable
Ainsi, l'analyse de la gestion des ressources humaines sur la
performance dans ce travail trouve l'intérêt à trois
niveaux :
Ø Niveau pratique :
L'intérêtréside dans le fait de faire savoir, comprendre
aux managers comment les ressources humaines impactent la performance de
l'entreprise, qu'ils soient capables d'analyser, d'évaluer et d'utiliser
la notion de gestion des ressources en vue d'améliorer la façon
dont ils gèrent ces ressources au sein de leurs entreprises.
Ø Niveau scientifique : la notion de ressources
humaines et de la performance restant complexe et multidimensionnelle, ce
travail aidera aux futurs chercheurs sur base de notre démarche, les
théories sélectionnées et modèle utilisé de
l'aborder avec un peu de précision étant donné qu'elle
attire l'attention de beaucoup des chercheurs et responsables.
Ø Niveau personnel : analyser la gestion des ressources
humaines et son impact sur la performance des entreprises, représente
pour nous un moyen de perfectionnement dans le domaine de gestion des
entreprises en générale. Il présente un
intérêt très capital pour nous, car l'achever normalement
sera une façon de nous rendre davantage performants en cette
matière.
5.3 OBJECTIF DU TRAVAIL
L'objectif de ce travail est de faire connaitre la
manière dont les entreprises gèrent leurs ressources humaines
pour qu'elles soient satisfaites au travail par les conditions agréables
en vue de réaliser les objectifs fixés par l'entreprise.
6. DELIMITATION DU TRAVAIL
Délimiter une étude, c'est en préciser le
champ d'investigation ainsi que sa
Temporalité, au besoin même la matière
à traiter serait nécessaire. Cette délimitation permet la
validité et la fiabilité d'une recherche. Pour le comprendre, ce
travail est circonscrit de la manière suivante :
Ø Du point de vue spatial :
la compagnie pastorale du Haut-lomami constitue notre champ d'investigation ;
Ø Du point de vue temporel :
la présente analyse s'étend sur la période allant de 2019
en 2022. Donc, une période de quatre ans.
7. PRESENTATION SOMMAIRE DU
TRAVAIL
Cette partie vise à donner une vision
synthétique d'un travail scientifique. Notre travail intitulé
impact de la gestion des ressources humaines sur la performance des entreprises
agro-pastorales comprend trois chapitres hormis l'introduction et la conclusion
:
Ø Le premier est dédié au cadre
général, et il comprend deux sections dont la clarification
conceptuelle et la présentation de la compagnie pastorale du
Haut-lomami ; première et deuxième section respectivement ;
Ø Le deuxième parle des fondements
théoriques de la recherche, dans lequel nous donnons les théories
sur la gestion des ressources humaines et sur la performance dans la
première et la deuxième section respectivement ;
Ø Le troisième chapitre porte sur l'analyse et
interprétation des résultats. Ici nous présentons les
données dans la première section, analyse de la performance par
la structure financière de la compagnie pastorale du Haut-lomami,
analyse de la performance par l'optiques ratios deuxième et
troisième section, analyse de la performance par le modèle de
COLLONGUES, quatrième section.
CHAPITRE PREMIER
CONSIDERATIONS GENERALES
Ce présent chapitre comprend deux sections, dont la
première traite sur les définitions conceptuelles et la seconde
sur la présentation de la compagnie pastorale du haut-lomami.
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE
Dans cette section, nous allons présenter les
différentes définitions des concepts clés de notre sujet
afin de donner à tout lecteur de ce travail une vision claire.
I.1.1. IMPACT
C'est l'influence de quelqu'un ou de quelque chose sur le
déroulement de l'histoire, des évènements. C'est l'effet
produit par quelque chose ; l'influence qui en résulte. (LAROUSSE,
2007).
L'impact se défini autrement comme un effet produit ou
une action exercée (THOMAS. S, 1962).
Selon le dictionnaire économique, l'impact est
défini comme une conséquence ou un effet induit d'une
décision ou d'une activité économique sur les agents et
les structures économiques. (Dalloz, 2010).
Quant à nous, l'impact c'est l'effet, l'influence ou le
changement observable opéré par un bien ou un
phénomène.
I.1.2. GESTION
Selon (Bergeron, 2001), la gestion est définie comme
étant un processus par lequel on planifie, organise, dirige et
contrôle les ressources d'une organisation afin d'atteindre les buts
visés.
Pour (George R. Terry, 1985)la gestion comme un processus
considérant dans les activités de planifier, d'organiser, motiver
et contrôler.
Pour nous, la gestion c'est l'action de s'occuper de ses
propres intérêts ou des intérêts d'un autre. Elle
comprend un ensemble des techniques et de procédures pour utiliser les
ressources disponibles afin d'atteindre les objectifs fixés.
I.1.3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Ressources
Selon (GRANT, 1991) les ressources sont des inputs entrant
dans le processus productif de base, celui de transformation des
matières premières en produits finis. Ces ressources peuvent
inclure le capital physique, les ressources financières et physiques,
celles technologiques, humaines et organisationnelles. Il continue en disant
que les ressources sont des inputs du processus de production, il
suggère six majeurs catégories des ressources à
savoir : les ressources humaines, matérielles, financières,
technologiques, de marque et réputation et celles organisationnelles.
Selon(GIRAUD, 2004) les ressources recouvrent les moyens
affectés à une organisation ou une entité :
ressources financières, mais aussi ressources humaines comme les loyers,
les équipements ou les consommations et, le cas échéant,
les ressources immatérielles comme le savoir-faire et les brevets.
Pour (CADIN, 1997), la gestion des ressources humaines comme
« une discipline des sciences sociales consistant à créer et
à mobiliser des savoirs variés utiles aux acteurs et
nécessaires pour appréhender, négocier et tenter de
résoudre les problèmes liés à la régulation
du travail dans une organisation ».
D'après (DOLAN Shimon L., 2000), la gestion des
ressources humaines d'une organisation est l'ensemble des activités qui
visent la gestion des talents et des énergies des individus dans le but
de contribuer à la réalisation de la mission, de la vision, de la
stratégie et des objectifs organisationnels.
Selon(VALLEMONT, 1999), la gestion des ressources humaines est
une fonction qui comporte plusieurs activités dominantes à
savoir : la gestion des salaires, la gestion des carrières, la
gestion de formation, les relations humaines, l'application du droit au
travail.
Ces définitions nous font comprendre la gestion des
ressources humaines comme l'ensemble des décisions tactiques et
professionnelles, concernant des hommes exerçant une activité,
généralement professionnelle, dans une entreprise à but
lucratif ou non par l'utilisation de certaines règles.
I.1.4. LA PERFORMANCE
Le concept de performance recouvre un vaste corpus de
définitions et de pratiques diverses, dans différents champs de
l'activité socioéconomique
Selon CHANDLER, la performance est une association entre
l'efficacité fonctionnelle et l'efficacité stratégique.
L'efficacité fonctionnelle consiste à améliorer les
produits, les achats, les processus de production, la fonction marketing et les
relations humaines au sein de l'entreprise. L'efficacité
stratégique consiste à devancer les concurrents en se
positionnant sur un marché en croissance ou en se retirant d'un
marché en phase de déclin. (Chandler, 1992)
Maurel l'a défini comme le degré
d'accomplissement des objectifs, des buts, des plans ou programmes que s'est
donnés une organisation. (Maurel, 2009). Pour cet auteur, la performance
traduit le niveau de réalisation des assignations d'une entreprise ;
l'entreprise est performante, quand elle réalise des résultats
remarquables.
Autrement, la performance est la capacité de
l'entreprise à concrétiser ses objectifs stratégiques en
adoptant les meilleures façons de faire. (Charreaux, 1998)
Ces définitions nous font comprendre la performance
comme la capacité de l'entreprise d'être bénéfique
aux différentes parties prenantes, en concevant des produits ou des
services qui puissent satisfaire les clients. L'entreprise doit être
avantageuse à tous les partenaires (actionnaires, clients, gestionnaires
et l'entreprise elle-même) pour qu'elle soit jugée performante.
I.1.5. ENTREPRISE AGRO-PASTORALE
Une entreprise agro-pastorale est donc une entreprise du
secteur agro-pastoral qui fait ou qui s'occupe de la production de masse. Cela
veut dire qu'on n'investit pas pour obtenir à la fin les réserves
de nourritures de la famille, mais quelque de bien au-delà.
Une entreprise agro-pastorale est orientée vers la
qualité et la plus importante est la taille, plus l'est non seulement la
rentabilité économique mais la rentabilité sociale.
(BLANCHE, 1965)
SECTION IL. PRESENTATION DU CHAMP
D'INVESTIGATION
I.2.1. APERÇU HISTORIQUE
I.2.1.1. DE LA CREATION
Son histoire trouve son origine au milieu des années
1920, alors que l'administration coloniale belge souhaite renforcer
l'alimentation carnée des travailleurs employés dans les mines et
les plantations du Katanga.
Par convention du 26 septembre 1924, monsieur Victor Jacobs
obtient une concession de 40.000 hectares au nord de Kamina, le long de la voie
ferrée qui monte vers le Kasaï, entre la rivière Lwembe et
la Lubilanji; il y construit une ferme qu'il dénomma< Saint Walburgis
hoef >.
Le 07 juin 1928, il constitua à Lubumbashi la compagnie
du haut-lomami.
Le 02 août 1934 fut réalisée la fusion de
la pastorale avec la société Lovoï au haut-lomami des Haes
et Hybrechts.
En 1952, toute la concession avait 300.000 hectares
répartis de la sorte :
v Le bloc Kiabukwa (secteurLovoï) avec 60.000
hectares.
v Le bloc saint Walburgis hoef (secteurMitshia) avec 70.000
hectares.
v Le bloc Makanza - Kindele (secteurkileka) avec 84.000
hectares.
v Le bloc Nord (secteurLwembe) avec 86.000 hectares.
Vers les années 1960, le bloc Nord fut
abandonné et la société passe sous le contrôle de la
société générale de la Belgique. Le 27 novembre
1961, la société change de dénomination et devient < la
compagnie pastorale du haut-lomami >.
En 1973, la compagnie fut Zaïrianisée et
cédée à l'O.N.D.E. En 1989, la pastorale du haut-lomami
fut achetée par Monsieur James Blatther et fait partie de plusieurs
sociétés du groupe Agro-pastoral < GAP>. En 2006 Monsieur
Thierry Jungers rachète les actions avec 3 secteurs : Kileka,
Lovoï, Mitshia et six secteurs dont kelambwe, Makanza, Kindele, Mushindji,
Kankundwe, et Tshiongwe avec un total de 18.100 bêtes.
I.2.1.2. DE LA FORME JURIDIQUE
Basée en République démocratique du Congo
dans la province du haut-lomami, territoire de Kamina ; la pastorale du
haut-lomami est une société par actions à
responsabilité limitée dont l'un de principaux actionnaires est
Monsieur Thierry Jungers.
I.2.1.3. DE L'OBJECTIF SOCIETAL
La pastorale du haut-lomami a pour objectif principal,
l'élevage des bovidés. Elle est inscrite au registre de commerce
sous le N°0097 identifiée au niveau national sous
N°A04466E.
Elle est une entreprise privée dont le haut est
d'approvisionner les marchés en production animale (viande).
Le secteur MISTSHA approvisionne les marchés de
Kaniama, MWENE DITU MBUJI-MAYI et KINSHASA alors que les secteurs KILEKA et
LOVOI ravitaillent les marches de Kamina, LIKASI, KOLWEZI ET LIBUMBASHI.
I.2.1.4. DES ORGANES
Les origines de la pastorale du haut-lomami sont :
Ø Le conseil d'administration
Ø L'administrateur délégué
Ø Le directeur général
I.2.1.5. DU PERSONNEL
Au 31 décembre 2011, l'effectif du personnel
était de 517 personnes dont un cadre de direction, deux cadres
supérieurs, sept cadres moyens, dix-sept maîtrises et 490
classifiés.
I.2.1.6. DE LA POLITIQUE SOCIETAL
La société dispose de deux centres de
santé (Kiabukwa et Tshiongo) et quatre postes de santé
(Kankundwe, Makanza, Kindele et Mushindji) qui assurent la couverture sanitaire
des aires leur dévolue par la zone de santé de Kamina et Kaniama,
deux salles d'opération sont fonctionnelles à Kiabukwa et
à Tshiongo.
La pastorale du haut-lomami appuie les activités de la
zone de santé de Kamina notamment pour assurer la mobilité des
superviseurs lors de J.N.V, distribution des moustiquaires
imprégnées d'insecticides à longue durée d'action,
vaccination de routine, etc...
La société entretient plus de 400 Km des routes
et pistes indispensables à la circulation des personnes et des biens.
Les villages au nombre de 31 ayant cédé des
terres reçoivent chacun une bête de don à la fin de chaque
année. Leurs chefs de terre peuvent faire louer les pâtures
extérieures suivant les nécessités de l'exploitation
contre le paiement d'une bête. Ils peuvent se faire soigner gratuitement
dans les structures médicales de la société et
reçoivent du sel et une aide ponctuelle multiforme (collation,
bêtes). La société intervient aussi lors des intronisations
et des deuils.
TABLEAU N°1. DETERMINANT LES SECTEURS, SECTIONS,
SPECIALITES ET RACES EXPLOITEES
|
SECTEURS
|
SECTIONS
|
SPÉCIALITÉS
|
RACES EXPLOITÉES
|
|
MITSHIA
|
Mushindji
|
Reproduction
|
Zébus95%+ Afrikanders 5%
|
|
Tshiongwe
|
Engraissement
|
Zébus afrikanders
|
|
KILEKA
|
Makanza
|
Engraissement
|
Afrikanders 95%
|
|
Kindele
|
Reproduction
|
Zébus 5%
|
|
LOVOÎ
|
Kankundwe
|
Engraissement
|
Afrikanders plus de 90%
|
|
Kelambwe
|
Reproduction
|
Afrikanders plus de 10%
|
Source : recueil de gestion du personnel à la
PHL/Kiabukwa.
I.2.2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET
FONCTIONNELLE
L'organisation fonctionnelle se donne comme objectif, la
représentation ; elle prend souvent la forme pyramidale avec un sommet
chapeauté par un chef qui reçoit et donne des instructions et en
suite une base composée de plusieurs personnes qui exécutent les
ordres. C'est grâce à elle que l'information peut librement
circuler au sein de l'organisation.
Or la structure détermine les tâches, les moyens
pour mieux coordonnées les activités au sein d'une organisation
et pour aboutir à des réalisations efficaces des tâches
à effectuer.
I.2.2.1. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Donne son rapport au responsable de la société.
Il dirige, organise coordonne, et décide de la bonne marche des projets
de l'entreprise.
Après la direction viennent les 3 services :
v Service d'exploitation
v Service administratif
v Service comptable
L'organisation administrative correspond au travail des
cadres, des agents de maîtrise qui organisent des processus réels
de la société et la réalisation de l'entreprise. En plus
de cela, ils sont des charnières entre la direction et les agents
d'exécution.
I.2.2.1.2. LE SERVICE D'EXPLOITATION
C'est le plus important de la pastorale du haut-lomami, c'est
dans ce service qu'on fournir des produits destinés à la vente.
Ce service production des bêtes (bovins) d'embauche.
Les animaux engraissés, exemple les mâles
castrés sont mis en vente sur pied ou débités en viande
à la boucherie. Il est représenté par le chef
d'exploitation ou de production qui est le chef de secteur composé de
deux sections. Ses dérivés sont :
v Le chef de section : gère les bétails de sa
section et leur donne des soins spécifiques.
v Agent d'élevage : contrôle la manière
dont les bétails se nourrissent et aussi les couplements pour assurer la
bonne qualité de production des bétails.
v Capita général : reçoit et fait
exécuter les ordres de ses chefs hiérarchiques ; il gère
plus ou moins 3.500 bêtes.
v Infirmier vétérinaire : garde les
bétails, les surveilles chaque fois dans les enclos pendant la nuit pour
qu'ils ne puissent plus s'échapper et contrôler les bouviers de
son Kral, il garde plus ou moins 460 bêtes.
v Bouviers : gardent le bétail de son troupeau, fait
paître des troupeaux et garde au moins 150 bêtes.
I.2.2.1.3. SERVICE COMPTABLE
Il s'occupe des activités financières et
commerciales, et est chargé de passer les écritures, dresser les
bilans, vérifier les mouvements de chaque compte de travailleur, des
clients et des fournisseurs et trouver les soldes, effectuer des
dépenses, etc...
Il est composé de :
v La caisse : s'occupe du mouvement de l'entrée et
sortie de l'argent.
v Le commis comptable : qui est chargé de la
facturation des prix des bétails et des achats des produits.
v Le magasin : qui s'occupe de la gestion de tous les produits
achetés pour le fonctionnement de l'entreprise tels que le carburant, le
sel les phosphates, les papiers, etc.
I.2.2.1.4. SERVICE DU PERSONNEL
Ce service s'occupe de l'organisation et de la coordination du
personnel, de la planification, de la gestion des ressources humaines,
c'est-à-dire il s'occupe de la paie, des congés des travailleurs,
et l'octroi de prime et de gratification.
Nous y trouvons des composants tels que :
v Le secrétariat de la direction : gère les
correspondances, tient les notes des correspondances, notes de service et
d'instruction générale.
v L'enseignement : est pour assurer l'instruction des enfants
des agents pour leur épanouissement.
v Le service médical : pour assurer les soins de
santé des travailleurs et leurs familles.
v La menuiserie : s'occupe de la réparation des
meubles, des équipements de menuiserie, la fabrication des meubles
utiles pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
v Les gardes industriels : s'occupent de la
sécurité de l'entreprise, des installations, des bureaux, et
garage. Certains sont utilisés à monter la garde de nuit aux
différents enclos.
v Le service d'entretien : s'occupe de l'entretien et du
nettoyage des installations.
I.2.2.2. ORGANISATION STRUCTURELLE
Pour bien comprendre le fonctionnement de la pastorale
Kiabukwa, il serait meilleur de nous référer aux informations de
la figure ou organigramme ci-dessous :
PATRONAT = GAP
COORDINATION GROUPE VIANDE
COORDINATION FINACIERE
DIRECTION PHL
CHEF DE SERVICE ADMINISTRATION
CHEF COMPTABLE
CHEF DE PRODUCTION
ASSISTANT COMPTABLE
CHEF DE SECTEUR
COMIS PERSONNEL
SECRETAIRE
KAPITA CHEF D'ELEVAGE GENERAL
CHEF DE SECTION
AGENT D'ELEVAGE
CAISSIER
COMIS COMPTABLE
ORGANIGRAMME
CHAPITRE DEUXIEME.
REVUE DE LA LITTERATURE
SECTION 1. THEORIES EXPLICATIVES SUR LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET SUR LA PERFORMANCE D'UNE ENTREPRISE
Le présent chapitre est consacré au dressement
d'un portrait de l'apport des recherches précédentes sur la
performance des entreprises. Nous allons dans une première section
parlée du concept de la performance et le concept des modèles de
score dans la seconde section
II.1.1. THEORIES EXPLICATIVES SUR LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
II.1.1.1. NOTION SUR LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Par rapport à ses objectifs et finalités, la
gestion de ressources est définie comme un ensemble des pratiques, de
managements ayant pour objectif de mobiliser et de développer les
ressources humaines pour une plus grande efficacité et efficience de
l'organisation.
Gérer renvoi à l'idée de faire un choix.
La gestion de ressources humaines suppose la prise des décisions
relevant d'autres parties de l'organisation : les contraintes
financières, comptables, techniques, juridiques...
La gestion des ressources humaines, ne signifie pas que les
hommes sont des ressources mais que les hommes ont des ressources. La mission
du directeur des ressources humaines est donc de développer ses
ressources (talents, compétences, dispositions particulières...)
de toutes les personnes qui s'investissent au service de l'entreprise et de
mobiliser à atteindre les objectifs définis dans le cadre du
projet d'entreprise.
Afin de faire face à des nouveaux défis,
l'entreprise n'a pas d'autres options que de maintenir en permanence une
adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs d'une part et
les ressources humaines d'autre part. Cette stratégie implique une
approche dynamique de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, une incitation à mobilité et un
développement de l'employabilité des collaborateurs, une
procédure de recrutement exigeante, une ingénierie de formation,
un système de gestion interne performant, une concertation et une
négociation performante.
La gestion de ressources humaines telle qu'elle est connue
aujourd'hui, s'est construite de façon empirique et progressive suivant
de très près, la structuration des grandes entreprises
industrielles. Les directions des ressources humaines ont dû
répondre à différentes questions qui se posaient
concrètement aux dirigeants. Il est en effet possible de mettre en
évidence un lien étroit entre le processus de
développement de la gestion des ressources humaines et les circonstances
historiques et économiques qui ont fourni le cadre dans lequel les
entreprises évoluent.(PERETTI, 2003-2004).
II.1.1.2. LES DOMAINES DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Selon Jean-Marie PERRETI, les managements des ressources
humaines ont pour ambition de développer les ressources de tous ce qui
travaillent pour l'entreprise et les mobiliser dans le cadre de ses
projets.(PERETTI, 2003-2004).
Ainsi présentée, la gestion des ressources
humaines poursuit trois séries d'objectifs.
1. Les objectifs explicites
v Attirer
v Retenir
v Motiver
v Fermer
2. Les objectifs implicites
v La productivité
v La qualité de la vie au travail
v Le respect des lois et conventions collectives
3. Les objectifs à long terme
v La survie de l'entreprise
v Le profit
v La compétitivité
Ces principaux objectifs ainsi déclinés,
dessinent les grands domaines de la fonction des ressources humaines qui
peuvent être regroupés en onze rubriques.
A. Analyse de l'emploi
Elle constitue le point de départ de toute
activité des ressources humaines. En effet avant même de savoir de
quelle compétence a-t-on besoins. Il est indispensable de connaitre les
emplois disponibles. L'analyse de l'emploi consiste donc à
repérer et répertorier les emplois disponibles dans une
organisation.
B. La planification des ressources
humaines
La planification des ressources humaines est un processus
d'élaboration et de mise en application de plan et de programme visant
à assurer à une entreprise, le nombre d'employés et le
type de main d'oeuvre nécessaire et ceci au moment opportun.
C. Le recrutement
Qu'il soit interne ou externe, le recrutement commence par
l'expression du besoin, la description du poste, l'appel à candidature,
la présélection, la sélection et se termine par l'accueil
et l'intégration du nouveau salarié au bureau.
II.1.1.3. LIEN ENTRE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES ET LA PERFORMANCE
L'adjonction du terme performance à celui de ressources
humaines selon Gilbert et Charpentier peut paraître surprenante. Alors
que le premier renvoie à des idées de mesure, de quantification
et d'évaluation, le second est généralement associé
à l'Homme et à sa complexité (LOUART, 1991).
Admettons cependant que le rapprochement de ces deux termes
n'est plus si surprenant. Depuis les travaux de l'école des relations
humaines, et plus récemment le développement d'une approche
stratégique des ressources humaines avec la RBV (resource based view of
the firm), la contribution des ressources humaines à la performance des
entreprises est généralement admis.(GILBERT P., 1996)
Les évolutions des modes de production, ainsi que
celles de l'environnement concurrentiel ont également contribué
à renforcer cette idée. D'un côté, les
transformations des configurations productives ont rendu centrale la place des
hommes sur la chaîne de valeur ; elles ont fait passer l'individu du
statut de simple exécutant dans le modèle taylorien à
celui de « coordinateur » et de « développeur » dans
les systèmes hommes-machines-clients. (GILBERT P., 1996).
De l'autre, l'agressivité et l'instabilité de
l'environnement concurrentiel renforcent l'impératif de performance.
Face à l'imprévisibilité des changements et des
discontinuités de l'activité, la fonction RH, au même titre
que les autres fonctions de l'entreprise, se trouve confrontée à
une exigence de plus en plus forte : celle de contribuer davantage -- et de
montrer cette contribution -- à la performance de l'entreprise. (GILBERT
P., 1996).
Par ailleurs, s'il existe un consensus sur l'objectif ultime
de pérennité de l'entreprise (JEAN-YVES LE LOUARN, 01/08/2001),
les moyens d'y parvenir peuvent être, quant à eux, très
différents. Comme nous l'indique Louart, les repérages de la
performance bougent avec les représentations managériales dans un
contexte donné, et l'idée d'un lien entre ressources humaines et
performance est elle-même soumise à ces représentations. On
peut penser que les bonnes performances d'une entreprise permettent «
d'investir dans le social » et dans la mise en place de GRH
élaborées. Mais on peut également émettre
l'hypothèse d'une causalité inverse, à savoir celle d'une
contribution des ressources humaines à la performance économique,
financière, et à la pérennité de l'entreprise.
II.1.2. THEORIES EXPLICATIVES SUR LA
PERFORMANCE
La performance a toujours constitué un thème de
recherche récurrent en science de gestion, guidé par les
préoccupations continues des managers soumis à l'obligation de
performance des unités qu'ils dirigent. Mais étant un concept
multidimensionnel qui peut prendre plusieurs aspects en fonction de la
période de référence adoptée ou des types de
critères retenus, la performance suscite des nombreuses discussions sur
la manière de bien le définir, ses méthodes de mesure et
sur les facteurs à mesurer.
Pour ce qui concerne sa définition, les points de vue
sont divergents. Charreaux concentre son attention sur la capacité de
l'entreprise à concrétiser ses objectifs (CHARREAUX, 1997). Alors
que d'autres, comme Chandler le définit comme une association entre
l'efficacité fonctionnelle et l'efficacité stratégique.
L'efficacité fonctionnelle consistant à améliorer les
produits, les achats, les processus de production, la fonction marketing et les
relations humaines au sein de l'entreprise. L'efficacité
stratégique consiste à devancer les concurrents en se
positionnant sur un marché en croissance ou en se retirant d'un
marché en phase de déclin (Chandler, 1992).
Pour nous, la performance est la capacité de
l'entreprise d'être bénéfique aux différents
partenaires en concevant des produits ou des services qui puissent satisfaire
ses clients.
Cette façon de voir les choses s'accorde à
l'aspect financier, dont la performance est définie par Guerard comme la
réalisation d'une bonne rentabilité, d'une croissance
satisfaisante, et de création de valeurs pour l'actionnaire, visant
à assurer la stabilité du financement de l'entreprise afin de
recourir le moins possible à des crédits (Guerard, 2006).
Outre la problématique de la définition, les
méthodes de mesure et les facteurs à mesurer pour
appréhender la performance de l'entreprise font également
débat. Certains chercheurs comme Atkinson, A. A., Waterhouse, J. H., et
Ali, ont évalué la performance de l'entreprise en
présentant un modèle de performance qui met l'accent sur les
parties prenantes (ou parties intéressées) et leurs rôles
dans la performance de l'entreprise (actionnaires, clients, employés, la
communauté) Https://doi.org/10.2307/3587975
Papa Yankhoba à son tour a fondé son analyse sur
la structure financière, la croissance de l'entreprise en analysant
(l'évolution du chiffre d'affaires, la valeur ajoutée,
excédent brut d'exploitation, etc.) et la rentabilité pour
déterminer la performance de la firme (Ndiaye, 2015).
Ghozlène Oubya elle aussi s'est
intéressée à la création de la valeur pour le
client, domaine très peu étudié dans la réflexion
sur la performance de l'entreprise malgré son importance, car selon lui
: « ce qui crée de la valeur pour le client crée de la
valeur pour l'entreprise ». Il considère la création de
valeur pour le client comme un indicateur standard de la performance de la
firme et permettant de ce fait d'évaluer l'efficacité des
décisions stratégiques prises par l'entreprise en question
(Oubya, 2016).
II.1.2.1 TYPES DE PERFORMANCE
II.1.2.1.1. LA PERFORMANCE FINANCIERE
La performance financière pourrait être
définie comme étant la réalisation d'une bonne
rentabilité, d'une croissance satisfaisante, et de création de
valeurs pour l'actionnaire. Elle vise à assurer la stabilité du
financement de l'entreprise afin de recourir le moins possible à des
crédits. Elle dépend de la gestion des ressources
financières à la disposition de l'entreprise. (Guerard, 2006)
Soulignons comme le dit Miloud que la performance
financière de l'entreprise est corrélée avec la
gouvernance de l'entreprise(MILOUD, 2003). Une mauvaise gouvernance de
l'entreprise peut impacter négativement sur la performance
financière de l'entreprise par le fait que, une gestion
caractérisée par les détournements des fonds par exemple,
la mauvaise gestion de marchés, le non-paiement du personnel agent, etc.
conduit à tout prix à une défaillance. Car les fonds non
capitalisés, la fraude fruit de non-paiement du personnel ne
permettraient en aucun cas la réalisation des rentabilités ou des
chiffres d'affaires ou même la création de la valeur
nécessaire à l'entreprise, ceux-ci étant des
déterminants de taille de la performance de l'entreprise. Et la bonne
gouvernance se traduisant par une gestion orthodoxe des ressources, voir aussi
la meilleure gestion des marchés booste la performance de l'entreprise.
II.1.2.1.1.1. LES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE
FINANCIERE
Il existe plusieurs indicateurs financiers de la performance
dont les plus représentatifs sont : l'Economic Value Added (EVA),
Cash-Flow Return On Investment (CFROI), le Return On Equity (ROE) ou taux de
rentabilité financière, le Free Cash-Flows, la croissance des
Cashflows, le Return On Assets (ROA) et les ROI (Oubya, 2016). Sont ces
différents indicateurs qui vont être présentés dans
cette partie de notre travail.
A.ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)
L'EVA est utilisée pour mesurer la valeur
ajoutée par l'entreprise après rémunération de tous
les capitaux employés. Elle s'obtient par la rentabilité
économique réduit de coût du capital multiplié par
les capitaux investis. Sur base des fonds propres elle s'obtient en
déduisant le coût des capitaux propres dans le rendement des
capitaux propres multiplié par le montant des capitaux propres investis.
Quand l'EVA des fonds propres est positive, l'entreprise crée de la
valeur pour ses actionnaires. Quand elle est négative, l'entreprise
détruit de la valeur pour ses actionnaires (VENANZI, 2012).
Cet indicateur permet donc à l'entreprise de
déterminer si la somme investie pour lancer un projet est
supérieur à celle obtenue à l'issue de l'opération.
Elle permet entre autre de prendre des décisions correctes concernant
l'investissement de l'entreprise(VENANZI, 2012). Mais, elle a été
critiquée par la forte influence de la méthode comptable
utilisée. D'autre part, l'EVA montre une grande instabilité quand
il s'agit de faire des ajustements au fil du temps. Voilà pourquoi elle
est considérée par certains managers comme étant un outil
dépassé par le temps. Par conséquent, son pilotage devrait
toujours se faire avec d'autres indicateurs plus avancés (VENANZI,
2012).
B.LE CASH-FLOW RETURN ON INVESTISSEMENT (CFROI)
Le Cash-Flow Return On Investment (CFROI) correspond à
la moyenne des taux de rentabilité interne des investissements actuels
de l'entreprise. Il est le taux de rentabilité interne qui
égalise l'actif économique de l'entreprise, pris en montant brut,
c'est-à-dire avant dotations aux amortissements et
réévalué du taux d'inflation, et la série des
excédents bruts d'exploitation après impôt, calculée
sur la durée de vie des actifs immobilisés en place.
Cette dernière s'estime en divisant la valeur brute des
immobilisations par la dotation aux amortissements de l'année. Le CFROI
est alors comparé au coût moyen pondéré du capital
(VENANZI, 2012). Il peut être également comparé au
coût du capital à évaluer si l'investissement de
l'entreprise est bon, neutre ou pauvre. Pour améliorer la valeur de
l'entreprise, celle-ci donc augmente la différence entre le coût
de son capital et son CFROI (VENANZI, 2012).
C.LE RETURN ON EQUITY (ROE)
Le Return On Equity (ROE) est un indicateur qui donne une
information concernant la profitabilité de la société et
sa capacité à donner du bénéfice partant des
investissements des actionnaires. Il permet aussi de définir les
différents leviers de la performance, de mesurer les capitaux investis
ainsi que le résultat économique par objet
d'étude(BERLAND, 2010). Il mesure l'efficacité des
investissements réalisés en prenant en compte uniquement les
fonds apportés par les associés, donc en ignorant les dettes
(Journaldunet).
Le ROE se calcule en divisant le résultat net d'une
entreprise par la valeur moyenne de ses fonds propres (equity) de
l'année. Un ROE de 10 % signifie que 1000 CDF apportés par les
associés ou actionnaires permettent de générer 100 CDF de
bénéfice net. Plus l'entreprise est efficace, plus son ROE est
élevé et elle attire davantage des investisseurs. Cependant il
convient de comparer le ROE d'une entreprise avec le ROE moyen de son secteur.
D.LE RETURN ON INVESTISSEMENT (ROI)
Le ROI est le pourcentage du retour des capitaux investis. Il
mesure l'utilisation des actifs de l'entreprise pour générer des
profits. Dans cette optique, il est principalement exploité pour
connaître si les investissements consacrés au lancement d'un
projet sont bien justifiés par les résultats obtenus (PONSARD,
2005). Cet indicateur a été depuis toujours
considéré comme étant une mesure complète et
synthétique de la performance de l'entreprise. De cette façon, il
permet de mettre à jour les différents éléments qui
affectent les états financiers de l'entreprise. C'est un indicateur
facile à calculer et à comprendre par l'utilisateur. D'autre
part, il peut être appliqué à toute organisation et permet
par conséquent, de déterminer les différents centres de
profit de l'entreprise voire même, de l'organisation. Il correspond au
rapport entre les coûts et les bénéfices(PONSARD, 2005).
Avec le ROI, la création de valeur par l'entreprise
repose sur l'augmentation des ventes, la réduction des coûts, la
réduction du capital investi. Il pourrait donc conduire plus à
une gestion des chiffres et du ratio plutôt qu'une gestion de
l'organisation et des processus lancés par cette dernière. Or,
cette focalisation sur le chiffre pourrait fausser la vision concernant
l'entreprise surtout, à long terme (PONSARD, 2005).
E.LE RETURN ON ASSETS (ROA)
Le ROA ou Return On Assets, désigne une notion
économique d'origine anglo-saxonne de plus en plus utilisée par
les économistes et les chefs d'entreprise. Il mesure le rapport entre le
résultat net et le total des actifs nets d'une société.
Grâce au résultat obtenu, les analystes financiers sont en mesure
d'estimer le taux de rendement de l'actif investi (et de vérifier ainsi
si la rentabilité d'une entreprise est suffisante par rapport à
ses ressources) (Journaldunet).
Si le return on Assets peut s'avérer pratique pour
s'assurer de la performance financière d'une entreprise, quelques
bémols sont néanmoins à prendre en considération :
il ne fait pas de distinction entre les différents actifs de
l'entreprise et prend peu en considération les engagements hors bilan.
Le ROA reste néanmoins un outil précieux et un indicateur de la
performance financière de la société (Journaldunet).
En dehors de ces indicateurs cités, la performance
financière peut aussi se traduire par le rendement sur ventes, le
rendement sur capital investi, le bénéfice par action ou le
rendement boursier (SIMON RICHOZ, 2010). Il est par exemple communément
admis que les entreprises les plus capitalisées sont celles qui sont les
plus rentables.
II.1.2.1.2. INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE
FINANCIERE
La fiabilité, objectivité et la vision
synthétique de la performance constituent l'avantage de la performance
financière mesurée sur base des données comptables (Oubya,
2016). Mais en dehors des avantages de ces indicateurs, des nombreuses limites
sont présentées également par ceux-ci (indicateurs) telles
que : les données financières tiennent compte des actionnaires de
l'entreprise et négligent de ce fait, les autres parties prenantes.
D'autre part, ces données pourraient pousser le gestionnaire à
fonder ses analyses sur le court terme, en oubliant les investissements en
termes de recherche et développement, ou en marketing.
Il a été constaté entre autre, que les
données comptables et financières donnent des indications
concernant la performance de l'entreprise dans le passé, ce qui fait que
les dirigeants ne peuvent pas se fier à ces données pour prendre
une décision. Certes, les résultats comptables des entreprises
dans le passé leurs permettent de connaître la rentabilité
de leurs activités et de leurs actifs. Cependant, cette connaissance n'a
pas toujours permis aux entreprises de faire des évaluations permettant
d'anticiper leur performance financière dans le futur. Ceci est dû
au fait que les besoins et les attentes des clients changent au fil du temps.
Ainsi, il est bien probable qu'une activité dont la
rentabilité a été éprouvée depuis plusieurs
années ne puisse plus afficher une meilleure performance maintenant
(Oubya, 2016).
Pour ce qui concerne la performance à long terme de
l'entreprise ne tient pas uniquement compte de la situation financière
passée de l'entreprise, mais également, de sa situation actuelle
et une anticipation de sa situation dans le futur. De ce fait, et comme le
disent Cumby et Conrod, la performance financière ne peut pas être
évaluée en tenant compte des seuls indicateurs financiers, mais
aussi, des indicateurs non financiers tels que la fidélité des
clients, les processus internes et le degré d'innovation de
l'entreprise. La satisfaction des clients peut par exemple constituer, un
indicateur de performance économique et de performance boursière
de l'entreprise (Conrod, 2001). Dans ce cadre, la performance financière
de l'entreprise seule ne constitue donc pas une approche unique pour
appréhender la performance de l'entreprise. D'autres types de
performance méritent d'être analysés.
II.1.2.1.2. LA PERFORMANCE COMMERCIALE
La performance commerciale d'une entreprise peut se traduire
par l'atteinte des objectifs commerciaux de façon relative aux moyens
engagés pour les atteindre. Elle est définie par Ouattara comme
étant « la capacité de l'entreprise à satisfaire sa
clientèle en lui proposant des biens et des services de bonne
qualité, et qui sont aptes à répondre aux attentes de ses
clients » (Ouattara, 11 janvier 2008). Plauchu et Taïrou, la
définissent quant à eux comme : « l'art d'être
présent chez le bon interlocuteur au bon moment, avec une offre
pertinente, qui permette d'établir des relations d'affaires durables et
profitables pour l'entreprise dans un contexte de recherche permanente de
l'excellence de la prestation » (PLAUCHU, juillet 2008).
Les recherches menées autour de ce concept portent dans
la grande majorité des cas, sur les différentes étapes qui
permettent d'améliorer la performance commerciale de l'entreprise. Cette
dernière est appréhendée en se basant sur le
fonctionnement réel de l'entreprise et sur l'identification des
indicateurs clés de la performance de celle-ci ainsi que des facteurs
qui pourraient constituer un obstacle à son accomplissement (Oubya,
2016).
La performance commerciale de l'entreprise vise donc, à
atteindre les objectifs initialement fixés par l'entreprise et plus
particulièrement, à satisfaire les clients et à les
fidéliser. Ceci nécessite, la détermination des
différents leviers qui pourraient être exploités dans le
but d'augmenter la performance commerciale de l'entreprise et qui seront
représentés sur la figure 2 suivante :
FIGURE N°1 : LES PRINCIPAUX LEVIERS DE LA PERFORMANCE
COMMERCIALE
STRATEGIE COMMERCIALE
Positionnement
de
l
'
entreprise
sur
son marché
Plan
d
'
action
commercial
e
collectif
Plan
d
'
action
commercial
e
individuel
Pilotage du
processus
de
vente
RESULTATS
Objectifs stratégiques
Pilotage
Organisation
Compétences
individuelles
Niveau Direction
Niveau
M
ANAGE
M
ENT
Niveau
COLLABORATEUR






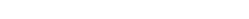






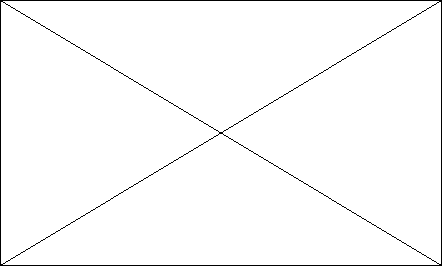
Source : reproduit sur base de la
conception de Ghozlène Oubya (Oubya, 2016)
Sur cette figure, nous pouvons constater que la
stratégie commerciale constitue le premier levier de la performance
commerciale de l'entreprise. Elle permet de connaitre les différentes
stratégies pouvant améliorer la performance de la firme. La
stratégie commerciale va déterminer le positionnement de
l'entreprise sur son marché.
Par la suite, les différents acteurs élaborent
un plan d'action commerciale collectif. Ces deux éléments sont
déterminés au niveau management. Le positionnement de
l'entreprise sur le marché est important dans la mesure, où ce
dernier lui permet d'obtenir une place dominante. Après
l'élaboration d'un plan d'action commercial collectif, les
collaborateurs passent à l'établissement d'un plan d'action
commerciale individuel et au pilotage du processus de vente. Ces plans
d'actions peuvent concerner les actions commerciales uniquement ou la
force de vente de l'entreprise (Oubya, 2016).
Le processus de vente pour sa part, se passe par
l'initialisation du processus. Si la satisfaction du client final constitue le
but ultime de la performance commerciale, il existe d'autres leviers qui
pourraient être considérés. La satisfaction des clients
est liée à la capacité de l'entreprise à innover ou
à créer de nouveaux produits. Cette aptitude permet en effet
à l'entreprise d'augmenter sa part du marché sur le long terme.
Et dans cecas defigure, nous pouvons noter quela performance commerciale de
l'entreprise est aussi corrélée à la performance
financière (Oubya, 2016).
La performance commerciale de l'entreprise se joint à
l'expérience de l'entreprise. Les années d'existence permettent
en effet de réduire les coûts de production en fonction des
unités fabriquées. Par conséquent, l'entreprise peut
proposer des prix inférieurs à ceux des concurrents et augmenter
sa marge unitaire. Par ailleurs, les clients tiennent toujours compte des
expériences de l'entreprise par différentes marques.
L'ancienneté de l'entreprise dans le domaine lui permet d'accéder
aux canaux de distribution les plus performants et d'acquérir par la
même occasion, une image positive auprès de la clientèle
(GOTTELAND, 2005)
II.1.2.2.1. LES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE
COMMERCIALE
La performance commerciale se traduit en général
par l'augmentation des ventes et des marges de l'entreprise. Elle est
appréciée selon le nombre de clients recrutés et
fidélisés. Pour la mesurer, il est possible de faire une
étude de la progression du nombre de clients, du taux de transformation,
de l'évolution du chiffre d'affaires, de la progression des parts de
marchés.
La performance commerciale pourrait être
évaluée aussi sur base de l'excédent brut d'exploitation.
Cette valeur informe sur la capacité de l'entreprise à vendre sur
le marché un produit donné et à accumuler des profits dans
cette vente. Cette valeur permet entre autre d'évaluer l'aspect
industriel, productif, commercial et financier de l'entreprise, ainsi que
toutes les politiques rattachées à ces différents
aspects(GOTTELAND, 2005).
La performance commerciale peut également être
évaluée sur base de la marge commerciale qui donne un
aperçu concernant la capacité de l'entreprise à
contrôler les contraintes du marché. La marge commerciale pourrait
aussi traduire la stratégie commerciale de l'entreprise et plus
particulièrement, sa politique de prix et de vente (Genaivre, Août
2006)Elle peut être appréciée en fonction de son aptitude
à garder et à augmenter son chiffre d'affaires dans des
conditions de profitabilité (PLAUCHU, juillet 2008)
II.1.12.2 INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE
COMMERCIALE
La performance commerciale permet de connaître la
capacité de l'entreprise à répondre aux besoins des
clients et à anticiper leurs attentes. Dans la société
actuelle, les entreprises sont bien conscientes de l'importance des clients
pour leur pérennité et leur développement. Les actions et
les stratégies choisies devraient donc tourner autour de la satisfaction
des clients. La performance commerciale de l'entreprise devient de ce fait une
notion indispensable dans la mesure où elle lui permet de
connaître sa notoriété, sa place au sein du marché,
son positionnement, les différents produits que les clients ont
appréciés, etc. (Oubya, 2016).
La performance commerciale permet aussi aux différents
acteurs de l'entreprise de connaître les principaux leviers de leur
performance et de la satisfaction des clients. Ceci est très important
dans la mesure où les objectifs de toute entreprise sont d'attirer le
plus de clientèle et de faire la meilleure vente possible. Dans sa
démarche de fidélisation des clients, la performance commerciale
tient compte de l'importance du client pour la pérennité de
l'entreprise.
La performance commerciale assure entre autre, des
différentes démarches liées à la vente, telles que
le marketing, la communication et la publicité voire même les
règles qui régissent le management de la force de vente et les
positions juridiques qui permettent derégulariser la vente
effectuée au sein de l'entreprise (Oubya, 2016).
Toutes ces démarches s'inscrivent dans la
détermination des rôles des différents acteurs dans la
réussite du processus de vente, mais elles ne permettent pas de
connaitre de façon très précise, les comportements
d'achat, les spécificités, les attentes du client, etc. Pourtant,
ces différentes données peuvent être importantes pour
l'entreprise si elle souhaite vraiment augmenter le volume de vente. Les
gestionnaires peuvent se focaliser dans l'analyse des données
quantitatives en ce qui concerne le taux de vente, le nombre de clients
fidélisés, mais ils ne tiennent pas compte des données
qualitatives permettant de connaître les différents points qui
ontparticulièrement attirés l'attention du client. (Oubya,
2016).
II.1.2.3. LA PERFORMANCE DE PRODUCTION
Comme son intitulé l'indique, c'est une performance
ayant pour objectif d'améliorer la production. Pour ce faire, il est
nécessaire de mobiliser des ressources productives humaines,
matérielles, financières, pour la création des biens et
des services. La performance dans le domaine de la production de l'entreprise
renvoie selon Corhay, A et Mbangala, M. à « la capacité de
l'entreprise à combiner de manière efficace les facteurs de
production et les moyens qui permettent de produire ». Ceci implique que
l'entreprise soit apte à générer de la richesse ou des
profits tout en utilisant le moins de ressources possibles. Mais elle peut
également impliquer la capacité del'entreprise à
augmenter son volume de production avec les ressources dont elle
dispose(Albert Corhay, 2008).
Peu de recherches se sont intéressées comme le
confirme Corhay à la performance de production de l'entreprise. Dans la
grande majorité des cas, les auteurs s'intéressent plus à
connaitre les différentes démarches développées
dans le cadre de l'amélioration de la production de l'entreprise. C'est
dans cette optique que s'est créé le « Lean management de
Michel Ballé » qui permet aux différents acteurs au sein de
l'entreprise de participer à la performance de cette production dans le
but de réduire les gaspillages dans les unités de production
(Albert Corhay, 2008).
Le double objectif du Lean Management est la satisfaction
complète des clients de l'entreprise (ce qui se traduit en chiffre
d'affaires) et le succès de chacun des employés (ce qui se
traduit en motivation et engagement). Pour ce faire, la tradition Lean insiste
sur quatre principes fondamentaux (Ballé, 2009) :
a. Comprendre ce qui plait au client pour
spécifier la valeur du service ou du produit :
Les marchés sont concurrentiels et évolutifs,
les goûts et usages changent sans cesse. Le premier enjeu du Lean est de
développer l'écoute des clients par la résolution des
réclamations et l'expérimentation d'offres nouvelles afin de
construire la qualité dans le produit, en résolvant les
problèmes des clients de manière totalement fiable et durable
(Ballé, 2009).
b. Augmenter le niveau de Juste-à-temps,
c'est à dire réduire le délai entre la commande client et
la livraison du produit ou de l'offre :
Pour y parvenir sans augmenter les stocks, l'enjeu est de ne
produire que ce qui est demandé, quand c'est demandé et dans la
quantité juste nécessaire. Le Lean s'attache à
réduire le lead-time de fabrication par un ensemble de techniques qui
permettent de tirer les flux. Ce flux tiré crée une architecture
du progrès continu sans laquelle les améliorations ponctuelles
sont rarement pérennes(Ballé, 2009).
c. S'arrêter à chaque défaut
et résoudre le problème plutôt que le contourner :
Mettre un problème de côté sans le traiter
pour pouvoir continuer à avancer va d'une part, générer
bien d'autres difficultés en aval et d'autre part ne permet pas de voir
les faits précis des conditions qui ont généré le
problème - et donc de le résoudre et de progresser. Le Lean a
développé plusieurs techniques pour identifier, signaler et
traiter les problèmes là où ils se posent, quand ils se
posent avec les opérateurs eux-mêmes afin de chercher des causes
racines et résoudre fondamentalement les sujets. Ces pratiques
permettent de garantir la qualité des produits et des services par la
formation des agents dans leur travail(Ballé, 2009).
d. Impliquer les opérateurs dans
l'amélioration et la conception de leurs environnements de travail :
Par la formation continue aux standards (accords sur la
façon de travailler qui génère le moins de gaspillages) et
l'animation du kaizen (progrès par petits pas), les opérateurs
sont encouragés à s'engager dans l'amélioration de leurs
propres postes de travail pour éliminer les soucis d'ergonomie et
trouver des astuces permettant de travailler plus efficacement. Le rôle
du management est de soutenir cette action d'amélioration au quotidien
afin que chacun dans l'entreprise puisse d'une part, partager le sens de la
qualité offerte au client et, de l'autre, ait l'occasion de
réaliser sa part de créativité dans le travail de
production (Ballé, 2009).
Les études se sont également
intéressées aux démarches permettant à l'entreprise
d'augmenter sa production dans le cadre de l'optimisation de sa performance.
Aussi, les chercheurs se sont plus penchés sur les différentes
démarches permettant à l'entreprise d'augmenter sa production.
Cette dernière est reliée à la notion d'efficacité.
L'entreprise performante va vouloir augmenter sa production et pour atteindre
ce but, il faut encore considérer les moyens requis. L'entreprise vise
à augmenter la production tout en réduisant les coûts. Ceci
peut se traduire par une utilisation à bon escient des ressources
(Albert Corhay, 2008).
II.1.2.3.1. LES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE DE
PRODUCTION
La performance de production de l'entreprise pourrait
être évaluée sur la base de l'amélioration du taux
de rendement synthétique (TRS) qui est un indicateur permettant de
mesurer la performance de production industrielle, manufacturière, de
service ou de processus et qui correspond au rapport entre la quantité
ayant pu être produite à la vitesse nominale, et la
quantité réellement produite par l'entreprise (Albert Corhay,
2008).
La performance de production pourrait également
être évaluée sur la base de l'évolution des
produits, des processus d'exécution et des mesures de
sécurité mises en place par l'entreprise mais aussi sur la base
du volume de production, le niveau de la qualité de production, le
niveau de stock. Celle-ci pourrait aussi être évaluée sur
la capacité de l'entreprise à respecter les délais
fixés par son client. Les retards dans ce cas donnent des informations
concernant les risques encourus par l'entreprise dans le cadre de son
activité à cause de la rupture de l'approvisionnement (Oubya,
2016).
II.1.2.3.2. INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE DE
PRODUCTION
La performance de production de l'entreprise permet de
manière plus efficace de montrer les différentes failles au
niveau de la production de l'entreprise. Elle permet entre autre de discerner
les causes de ces différents arrêts et faciliter la
détermination de la dimension à considérer dans le
cadre de l'amélioration de la production et de la
productivité de l'entreprise (Albert Corhay, 2008).
Néanmoins, les fluctuations au niveau de la demande des
clients ne permettent pas de garantir par la simple considération de la
performance de production, la pérennité et la survie de
l'entreprise. En effetil ne s'agit pas uniquement de produire un
volume conséquent de produits ou de services, encore faut-il que les
offres proposées répondent bien aux attentes des clients et
donnent une valeur à ces derniers (Albert Corhay, 2008).
La performance de production permet de connaître la
situation dans l'entreprise, mais elle ne permet pas de faire une étude
de la possible tendance ou évolution de cette performance. D'autre part,
en tentant d'améliorer la production, les entreprises pourraient
être amenées à faire une sous exploitation des ressources
dont elle dispose.
Par ailleurs, cette performance dépend beaucoup de la
technologie et de l'utilisation d'appareils sophistiqués permettant
d'augmenter le volume produit tout en faisant une économie de temps et
d'énergie(Albert Corhay, 2008). Mais de tels changements ne sont pas
toujours bénéfiques pour les entreprises qui n'ont pas beaucoup
de moyens. Par conséquent, ces dernières vont être
éliminées petit à petit au profit de celles qui peuvent se
permettre de s'approprier les nouvelles technologies, voire même, celles
qui sont aptes à aménager complétement leurs locaux dans
le but de pouvoir accueillir ces technologies de pointe. Vu sous cet angle, la
performance de production pourrait encourager le renforcement de la pression
concurrentielle sur le marché, rendant encore plus difficile
l'acquisition de nouvelles parts de marché pour celles qui sont
particulièrement vulnérables(Oubya, 2016).
II.1.2.4. LA PERFORMANCE HUMAINE
La littérature relative à la performance humaine
se réfère plus particulièrement à la performance
biologique de l'être humain. Dans notre recherche nous nous
intéressons à la notion de capital humain et à la prise de
conscience par l'entreprise de la nécessité et de l'importance de
cette ressource qu'est l'homme. En effet, le développement de la
performance de l'entreprise ne repose pas uniquement sur l'existence de
nombreux salariés, mais aussi leur capacité à
développer ensemble un autre capital qu'est le capital organisationnel,
constitué par les processus opérationnels, les valeurs et la
réputation de l'entreprise, les normes comportementales, et
l'implication des salariés au projet de l'entreprise (Alain Chamak,
07/06/2006).
Dans une dimension socioéconomique, comme le disent
Bringer et al, l'accroissement de la performance de l'entreprise passe par le
développe de son potentiel humain (Bringer, 2011). La performance
humaine suggère une forte motivation, une forte implication et un
engagement des employés dans la réalisation de leurs
tâches. Dans cette optique, l'entreprise devrait veiller à ce que
les employés soient satisfaits et enthousiastes dans l'exercice de leur
travail. Certaines études se sont intéressées à la
création de valeur par et pour les employés. Il a
été constaté dans ce cadre que la valeur de l'individu et
sa croyance se trouvent à la base de ce qu'il fait au travail.
La performance humaine pourrait être
appréhendée au niveau de l'individu ou au niveau du groupe. Elle
implique la performance du salarié, ses compétences, son poste.
La performance du groupe de travail pour sa part, repose sur ses
activités, ou de la sous-unité. Ce n'est qu'après avoir
fait l'analyse à ces deux niveaux qu'il est possible de mesurer la
performance de l'entreprise dans son ensemble (Martory, 2004). Par ailleurs,
pour améliorer cette performance humaine, l'entreprise doit fixer des
objectifs qui permettent aux employés d'orienter leur attention vers les
activités importantes et de fournir par la suite, les compétences
nécessaires pour les atteindre (Martory, 2004).
Il faut noter entre autre que cette performance humaine repose
sur d'autres éléments tels que l'individu lui-même et
l'organisation. L'influence de l'individu sur la performance humaine implique
son engagement et sa confiance. Mais les facteurs organisationnels pour leur
part se réfèrent aux pratiques de ressources humaines. Ce dernier
point englobe l'organisation dutravail et la qualité de l'encadrement
des dirigeants de l'entreprise (Oubya, 2016).
II.1.2.4.1. LES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE HUMAINE
Le processus ressources humaines est l'un des piliers de la
performance des entreprises, car les ressources humaines constituent pour
l'entreprise le capital immatériel source de valeur pour la firme, bien
que cette valeur ne soit pas directement perceptible par le client final. Ce
capital humain, géré au travers des processus RH (ressources
humaines) impact directement le fonctionnement des processus métiers
(processus opérationnels) et des processus de décisions
stratégiques (processus de pilotage). Le capital immatériel
représenté par le savoir-faire et les compétences d'un
collaborateur est exploité et mise en oeuvre au travers de
l'activité à laquelle il contribue. Ce capital représente
un réel potentiel pour l'entreprise. C'est là que de nombreuses
entreprises doivent leur réussite aux équipes qui les composent
et il est donc nécessaire de pouvoir mesurer la performance humaine de
l'organisation (consulting, 2023).
Il existe plusieurs indicateurs de la performance humaine.
Ainsi la performance humaine pourrait aussi être mesurée sur la
base du taux d'efficacité des formations ou de recrutement (rapport
entre le nombre de formations ou de recrutements espérés et du
nombre de formations ou de recrutements réalisés). La performance
humaine pourrait être aussi déterminée à partir du
taux d'absentéisme qui témoigne aussi du climat social de
l'entreprise. Enfin, la performance humaine peut se déterminer à
travers les turn-over au sein de la société ou sur la base du
nombre d'évolution de postes(Bernard girard, 2014)
II.1.2.4.2. INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE
HUMAINE
Ce type de performance met l'accent sur l'importance des
ressources humaines. Cette ressource a été un peu
négligée par rapport aux autres types. Or, c'est elle qui est
à la base de toutes les activités faites au sein d'une
société. Elle permet de ce fait de tenir compte de la base
même de la performance de l'entreprise et évite à
l'entreprise de se focaliser uniquement sur les ressources matérielles
et financières qui pourtant, ne peuvent pas remplacer le capital humain
qui conçoit, travaille, innove, s'implique et procède à
toutes les activités menées au sein de l'entreprise (Oubya,
2016).
Mais la performance humaine est intimement reliée
à l'individu et à la notion d'organisation. De ce fait, une
mauvaise organisation pourrait l'affecter. L'esprit d'équipe est une
valeur fortement véhiculée de nos jours. Cependant, il n'est pas
toujours évident de consolider les membres de l'équipe
étant donné que chaque individu est unique et qu'il
possède ses propres méthodes qui ne coïncident pas
forcément avec celles des autres membres de l'équipe, d'où
les conflits, la mésentente voire même la dissolution de
l'équipe toute entière (Oubya, 2016).
II.1.2.5. LA PERFORMANCE SOCIALE
La performance sociale de l'entreprise a été
définie par Khouatra comme étant « la capacité de
l'organisation à satisfaire les besoins des acteurs internes et externes
de l'organisation, c'est-à-dire ses parties prenantes : personnel,
actionnaires, clients, fournisseurs, institution »(Khouatra, 2005).
La performance sociale de l'entreprise implique la
considération de l'éthique dans le monde des affaires. Elle ne
peut pas être séparée de la notion de responsabilité
sociétale de l'entreprise. Elle ne peut pas être limitée
à la simple relation entre l'employeur et son employé, mais tient
compte entre autre de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise.
Ceci englobe les différentes parties prenantes de l'entreprise ainsi que
l'ensemble des obligations, et des responsabilités de cette
dernière en ce qui concerne la société, l'environnement
aussi bien économique que social, les obligations légales et
économiques de l'entreprise envers la société(Autissier,
2010).
Parmi les parties prenantes de l'entreprise, nous pouvons
citer plus particulièrement, les salariés de l'entreprise qui
subissent une certaine condition de travail. La performance sociale est
née de la volonté de l'entreprise à améliorer le
bien-être des salariés au travail et d'augmenter par la suite,
leur efficacité(Autissier, 2010)
La performance sociale est la résultante des
différentes interactions entre les parties prenantes qui englobent tous
les acteurs internes et externes reliés de près ou de loin aux
activités de l'entreprise. Ces acteurs interagissent entre eux pour
atteindre les objectifs communs. En effet, chaque partie prenante joue un
rôle spécifique au sein de l'entreprise et la
complémentarité de leurs actions est à la base même
de cette performance sociale(Tremblay, 2004). Mais dans une entreprise, la
performance doit toujours générer du profit pour les actionnaires
et pour le reste de l'organisation. Dans ce cadre, certaines recherches ont
affirmé le probable lien de la performance sociale de l'entreprise et sa
performance financière. Mais cette affirmation reste encore non
vérifiée, ou non confirmée. Elle ouvre de ce fait, une
autre voie de recherche pour le gestionnaire.
Toutefois, le non établissement de liens entre ces deux
types de performance n'a pas pour autant réduit l'engouement des
différents acteurs pour améliorer la performance
sociale(Tremblay, 2004)Ceci semble être reflété à
travers le fait que la politique de gouvernance de l'entreprise ne doit pas
être évaluée sur la seule base de sa performance
économique, mais également sur sa performance sociale et
environnementale. Par conséquent, les entreprises se trouvent
actuellement contraintes de déterminer des normes de performance sociale
et de prendre en considération les différentes interactions entre
les parties prenantes de l'entreprise. (Turcotte, 2005).
Ainsi, la notion de performance sociale ne peut pas être
séparée de la performance globale de l'entreprise. Elle suppose
en effet qu'il existe une harmonie entre les différents acteurs
composant l'entreprise, mais ce climat ne peut être obtenu sans qu'il n'y
ait un bon climat social qui fournit une certaine sérénité
aux différents acteurs de l'entreprise.
II.1.2.5.1. LES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE SOCIALE
La performance sociale de l'entreprise pourrait être
appréhendée à partir de la rotation du personnel ou encore
de l'absentéisme qui donne une idée en ce qui concerne
l'atmosphère de travail et les différentes interactions qui ont
lieu au sein de l'organisation.
Etant donné que la performance sociale implique toutes
les parties prenantes dont les employés, elle pourrait aussi se baser
sur la satisfaction des employés et à la pratique de gestion des
ressources humaines. Dans ce cadre, Colot et al pensent qu'uneentreprise est
jugée socialement performante quand elle est apte à mettre en
place une pratique de gestion des ressources humaines qui permette de
déceler le rôle de chaqueindividu ausein de l'entreprise afin
qu'ilsoit valoriséet que l'employé soitmotivé et
attaché à l'entreprise.
Etant donné que la performance sociale se focalise plus
particulièrement sur le capital humain, il a été
montré qu'il existe autant d'indicateurs de performance sociale que
d'indicateurs concernant le capital humain. Dans ce cadre, la performance
sociale de l'entreprise pourrait être appréhendée via le
climat social au sein de l'entreprise, l'exposition des salariés au
stress, la qualité du management, la qualité du gouvernement
d'entreprise, la morale des employés, l'implication et la
représentation sociale du travail (Colt O, 2008).
II.1.2.5.2. INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE
SOCIALE
La performance sociale de l'entreprise s'impose comme
étant une balise permettant de savoir si l'entreprise est
confrontée à des risques sociaux et économiques ou si ses
salariés travaillent dans une atmosphère ne permettant pas
d'améliorer leur performance et leur bien-être au travail.
En d'autres termes, la performance sociale de l'entreprise
permet de savoir si ses activités sont à l'origine de troubles
psychosociaux pour les salariés ou à l'origine de troubles
écologiques pour la collectivité. La performance sociale de ce
fait donne des indicateurs sur la création de valeur pour chaque partie
prenante. C'est aussi un autre moyen pour mesurer les relations existantes
entre les employeurs et les employés. La performance sociale permet
entre autre de mesurer et de gérer les impacts des activités de
l'entreprise sur son environnement (Autissier, 2010).
La performance sociale constitue une autre démarche
pour construire une bonne image de l'entreprise. Les marchés financiers
deviennent de plus en plus exigeants en ce qui concerne les comptes relatifs
à la performance sociale de l'entreprise et les impacts de ses
activités sur l'environnement. Bien que ce bilan sociétal ne soit
pas obligatoire, il a été observé que l'entreprise avait
tout intérêt à le faire pour donner une bonne impression
aux acteurs externes qui évaluent ses activités. C'est la raison
pour laquelle, elles sont encouragées à donner des renseignements
concernant leurs produits, leurs services, leur relation avec les clients. Les
acteurs externes exigent entre autre des informations sur la gestion
économique, l'organisation du travail, la gestion des ressources
humaines, l'environnement humain, social et institutionnel biologique et
physique de l'entreprise (Allègre, 2008).
II.1.2.6. LA PERFORMANCE STRATEGIQUE
Dans la société actuelle où la pression
concurrentielle est exacerbée, l'entreprise doit être capable de
développer des stratégies qui pourraient lui permettre
d'atteindre ses objectifs et de développer des avantages concurrentiels
pour se différencier de ses concurrents. L'entreprise est amenée
par la suite à développer des actions qui puissent lui permettre
d'atteindre ses objectifs stratégiques. La performance
stratégique correspond de ce fait à la transformation des
objectifs stratégiques de l'entreprise en performance à long
terme (Oubya, 2016)Mais elle pourrait aussi être définie comme
étant « le maintien d'une distance avec les concurrents, entretenue
par une forte motivation (système d'incitation et de récompense)
de tous les membres de l'organisation et une focalisation sur le
développement durable » (Ouattara, 11 janvier 2008).
Les recherches sur la performance stratégique se
focalisent sur les outils de pilotage de la stratégie afin de permettre
le développement de la performance de l'entreprise. La performance
stratégique de l'entreprise a pour objectif de développer les
avantages concurrentiels. Elle repose sur la capacité de l'entreprise
à reconsidérer les avantages stratégiques à
acquérir et à développer un avantage compétitif
durable. Elle repose entre autre sur sa capacité à discerner et
à exploiter les sources de valeurs qui puissent créer de la marge
et permettre une excellence à tous les niveaux de l'entreprise (Oubya,
2016).
Mais la performance de l'entreprise ne peut être obtenue
à moins qu'il n'y ait fixation d'objectifs stratégiques par les
dirigeants de l'entreprise. Ces objectifs peuvent porter sur différentes
dimensions comme l'amélioration de la qualité des produits,
l'amélioration de son plan marketing, l'adoption d'une technologie pour
améliorer la productivité, etc. La détermination des
objectifs stratégiques de l'entreprise constitue la première
démarche pour obtenir des objectifs opérationnels afin d'assurer
la performance à long terme de l'entreprise(Ouattara, 11 janvier
2008).
La performance stratégique de l'entreprise et son
développement à long terme repose sur la qualité du
management, l'organisation, les méthodes et les processus qu'elle
entreprend pour réaliser ses activités. Dans ce cadre, une
entreprise performante stratégiquement est celle qui dispose d'un
exécutif performant, qui est apte à développer, vendre et
appliquer les bonnes stratégies. Ceci implique une
complémentarité au niveau des compétences des
différents membres de l'organisation ainsi qu'une solidarité
entre eux (Ouattara, 11 janvier 2008).
Outre la potentialité des ressources humaines, les
compétences impliquent aussi l'application d'une bonne méthode
adaptée aux objectifs à atteindre. Ceci suppose l'utilisation
d'outils adéquats pour piloter la stratégie mise en place par
l'entreprise, ainsi que les différents piliers du développement
à savoir, les coûts, la qualité, les projets, l'analyse des
risques, etc.
La performance stratégique de l'entreprise
dépend des différents principes de management mis en place. Cela
nécessite une qualité des services ou des produits
proposés non seulement aux clients externes mais aussi, aux clients
internes(Ouattara, 11 janvier 2008).
La performance stratégique dépend intimement des
objectifs stratégiques. Certains consultants ont déterminé
six types d'objectifs stratégiques basés sur six contraintes
très fréquentes chez l'entreprise. Il s'agit notamment :
Ø Des résultats financiers pendant une
période bien déterminée ;
Ø De la segmentation, de la satisfaction et de la
fidélité des clients ;
Ø De la performance des processus ;
Ø Des investissements et des projets qui permettent
d'améliorer les moyens techniques informatiques, intellectuels,
organisationnels aidant à réaliser de nouveaux leviers de
performance ;
Ø De la maîtrise des risques puisque ces derniers
existent toujours pour chaque projet mené au sein de l'entreprise ;
Ø De la compétitivité ce qui renvoie
à la part de marché que l'entreprise veut conquérir.
II.1.2.6.1. INDICATEURS DE LA PERFORMANCE STRATEGIQUE
La performance stratégique de l'entreprise peut
être évaluée sur la base de sa valeur de marché et
de sa valeur bilancielle correspondant à la valeur des fonds propres de
l'entreprise. Le ratio entre la valeur de marché de la firme et la
valeur propre permet de déterminer si la stratégie de
l'entreprise a permis de générer des profits et si ces derniers
vont durer à l'avenir. Un ratio supérieur équivaut
à une stratégie efficiente tandis que dans le cas contraire, il
existe des anomalies au niveau du plan stratégique mis en place par
l'entreprise(Magakian, 2007).
II.1.2.6.2. INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE
STRATEGIQUE
La performance stratégique de l'entreprise permet
d'évaluer l'efficience des stratégies mises en place. Dans ce
cadre, elle constitue un outil de planification stratégique pour
l'entreprise et permet d'apprécier la qualité des
décisions prises et d'améliorer par la même occasion, le
pilotage de ces dernières. Elle permet entre autre de déterminer
si les plans stratégiques mis en place sont adaptés aux
structures pour une performance sur le long terme(Ingham, 1995).
La performance stratégique de l'entreprise permet entre
autre de déterminer si l'entreprise possède des
opportunités qui permettent une montée en compétence, une
évolution des métiers, une amélioration de la situation de
l'entreprise (Ingham, 1995).
Pourtant, si la performance stratégique permet de
mettre en exergue, l'efficacité des différentes démarches
et l'efficience des décisions des dirigeants de l'entreprise, elle ne
permet pas pour autant de déterminer les différentes
démarches pour rendre meilleurs les différents piliers de la
performance de l'entreprise (Ingham, 1995).
II.1.2.7. PERFORMANCE CONCURRENTIELLE
Les études concernant la performance concurrentielle se
réfèrent à la recherche d'un bon positionnement de
l'entreprise par rapport à ses concurrents et aux différentes
démarches qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs (Bounfour,
2008). Les chercheurs se sont aussi intéressés à la
dynamique concurrentielle qui permette d'analyser le positionnement de
l'entreprise sur le marché, ainsi que les stratégies
d'amélioration du positionnement des produits sur ce marché.
La performance concurrentielle suppose que l'entreprise est
apte à s'adapter aux différentes actions de la concurrence pour
rester compétitive. Cette adaptation ne peut se faire à moins
qu'il n'y ait considération de la nature du système
concurrentiel. Ce dernier permet en effet de déterminer la
stratégie à mettre en place dans le but de pérenniser la
performance de l'entreprise. Les sources potentielles de performance sont
acquises par le biais de la connaissance des modifications observées au
niveau des systèmes concurrentiels. Dans cette optique, l'entreprise
pourrait se lancer dans l'exploitation du potentiel existant ou se focaliser
sur le développement de nouvelles formes d'avantages concurrentiels par
anticipation ou construction des règles de jeu qui pourraient être
imposées à l'avenir.
Aussi, la performance concurrentielle de l'entreprise semble
également être reliée à l'analyse stratégique
des règles de jeu concurrentiel. Vu sous cet angle, la performance
concurrentielle pourrait être assimilée à la
compétitivité de l'entreprise.
La performance concurrentielle renvoie aussi aux jeux des
forces concurrentielles de l'entreprise. Ces jeux englobent la mise en
situation de défense, la modification de l'équilibre et
l'anticipation de l'évolution du secteur. Elle pourrait aussi impliquer
la part de marché de l'entreprise et l'écart stratégique,
autrement dit, l'écart entre la performance souhaitée et celle
qui est effectivement atteinte.
Dans un contexte de forte concurrence, l'entreprise doit
connaître la perception de la performance de ses produits par les
consommateurs, par rapport aux produits concurrents. Ainsi, elle va chercher
les failles et les imperfections senties par les consommateurs afin de
discerner les zones d'amélioration possible.
Pour analyser la performance concurrentielle de l'entreprise,
les chercheurs emploient souvent le modèle des cinq forces de Porter ou
encore à travers l'écart stratégique entre l'entreprise et
ses concurrents.
II.1.2.7.1. INDICATEURS DE LA PERFORMANCE
CONCURRENTIELLE
La performance concurrentielle de l'entreprise pourrait
être appréhendée en se basant sur la part de marché
relative qui correspond au rapport entre les ventes réalisées et
la vente réalisée par le leader du marché. La performance
concurrentielle de l'entreprise peut aussi être déterminée
à partir de la part de marché absolue de l'entreprise
c'est-à-dire, par le rapport entre les ventes de l'entreprise et les
ventes totales des entreprises en concurrence. Elle peut aussi être
connue en analysant la satisfaction des clients. Pour ce faire, les entreprises
peuvent s'entretenir avec leurs clients afin de connaître le fonds de
leurs pensées ou en faisant des études formelles (Oubya,
2016).
II.1.2.7.2. INTERETS ET LIMITES DE LA PERFORMANCE
CONCURRENTIELLE
La performance concurrentielle de l'entreprise permet de se
situer par rapport à ses concurrents et par rapport à ses
clients, ce qui permet à l'entreprise de corriger ses démarches
et les différentes décisions qu'elle prend dans le but d'obtenir
et d'améliorer les profits qu'elle génère. C'est
également un moyen permettant de connaître ses clients les plus
récents que les plus anciens, et leurs comportements afin de
connaître ce qu'ils recherchent dans le service ou les produits
proposés par l'entreprise(Oubya, 2016).
II.1.3. L'ANALYSE DE LA
PERFORMANCE
L'analyse de la performance de l'entreprise s'avère
être utile pour rendre compte d'abord de la performance réelle de
cette dernière et de se servir des informations à des fins
décisionnelles. Pour mesurer la performance de l'entreprise, il existe
des indicateurs basés sur des données objectives fournissant des
indications quantitatives et qualitatives concernant une situation
précise de l'entreprise et dont ont été abordées
quelques-unes dans la partie précédente.
Le choix de tel ou tel indicateur repose donc sur les
objectifs qui vont constituer une sorte de « filtre » afin d'obtenir
des informations fiables et pertinentes dans la gestion de l'entreprise. Pour
cela l'indicateur devrait être clair pour qu'il soit facile à lire
et à exploiter par l'utilisateur. Il devrait être capable
d'alerter les dirigeants quant à la décision qu'ils doivent
prendre au cas où il y aurait un problème.
II.1.3.1. ANALYSE PAR LES INDICATEURS D'EQUILIBRE
FINANCIER
L'analyse financière est restée
focalisées sur l'étude de la situation financière de
l'entreprise maintenir le degré d'équilibre suffisant pour
assurer en permanence sa solvabilité. À cet effet l'analyse
financière de l'entreprise est appréciée par deux
éléments caractéristiques : les indicateurs
d'équilibre financier (FR, BFR, TN) et les ratios d'équilibre.
L'équilibre financier d'une entreprise s'estime de deux
principes de base, la solvabilité qui est la capacité de faire
face à ses dettes, permettant de mesurer son degré d'autonomie
financière et la liquidité qui indique la disponibilité
immédiate.
Généralement, on distingue trois
déterminantes des équilibres financiers sont :
v Le fonds de roulement (FR) : indique l'équilibre
financier à long terme ;
v Le besoin en fonds de roulement (BFR) : indique
l'équilibre financier à court terme ;
v La trésorerie nette (TN) : indique l'équilibre
financier immédiat.
1.1. Le fonds de roulement (FR)
Il est défini comme le surplus des ressources
permanentes dégagées après avoir financier les besoins
permanents par les ressources permanentes.
Selon PEYRARD Josette : « Le fonds de
roulement est considéré comme une marge de sécurité
pour l'entreprise, qui servira à financer une partie de l'actif
circulant qui n'est pas financé par les dettes à court terme.
»
1.1.2. Les différents types de fonds de
roulement
1.1.2.1. Le fonds de roulement net (FRN) «
permanent »
Le fonds de roulement net est la marge de
sécurité représente la partie de l'actif circulant qui
n'est pas financée par les dettes à court terme, mais qui sera
financée par une partie des capitaux permanents. Le fonds de roulement
permanent représente également la part des capitaux permanents
utilisée pour financer le cycle d'exploitation.
Le fonds déroulement permanent peut être
calculé à partir du bilan financier par deux méthodes:
v 1ére méthode : par le haut
de bilan
Le fonds de roulement net est l'excédent de capitaux
permanents sur l'actif immobilisé permettent de financer l'actif
circulant. Il se calcule selon la formule suivante :
Fonds de roulement net = Capitaux permanents - Actif
immobilisé (AI)
v 2ére méthode : par le bas
de bilan
Le fonds de roulement net est la marge de
sécurité constituée par l'excédent de capitaux
circulants sur les dettes à court terme.
Le fonds de roulement net = Actif circulant (AC) - Dettes
à court termes (DCT)
Figure N° 01 : Schéma représentatif
de fonds de roulement (FRN)
|
Actif immobilisé
|
|
Capitaux permanents
|
Actif circulant
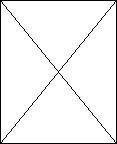
|
Le fonds de roulement net
|
|
Dettes à court termes
|
Source : fait par moi-même.
1.1.2.2. Le fonds de roulement propre
(FRP)
Le fonds de roulement propre est un indicateur qui permet
d'apprécier l'autonomie d'une entreprise par rapport aux financements de
ses différents investissements matériels et
immatériels.
Le fonds de roulement propre se calcule comme suit :
Le fonds de roulement propre = Capitaux propre - l'actif
immobilisé (AI)
1.1.2.3. Le fonds de roulement étranger
(FRE)
Le fonds de roulement étranger représente la
partie des immobilisations financées par les capitaux étrangers,
c'est-à-dire les emprunts à long et moyen terme.
Le fonds de roulement étranger se calcule comme suit
:
Le fonds de roulement étranger = DLMT - DCT
1.1.2.4. Le fonds de roulement global
(FRG)
Il représente l'ensemble des valeurs mises à la
disposition de l'exploitation de l'entreprise. Le fonds de roulement global se
calcule de la manière suivante :
Le fonds de roulement global = Fonds de roulement net + Les
dettes à court terme
Interprétation du fonds de
roulement
Le fonds de roulement (FR) peut se présenter en trois
cas différents :
v Cas N° 01 : Lorsque le FR >
0 (positif)
Ce qui signifie que les capitaux permanents sont
supérieurs aux emplois immobilisés.Dans ce cas l'entreprise
à un équilibre financier long terme et dégage une marge de
sécurité qui représente une part des capitaux permanents
après le financement des valeurs immobilisées et qui est
affectées au financement des emplois circulants.
v Cas N° 02 : Lorsque le FR = 0
(nul)*
Dans ce cas l'entreprise ne dégage aucun excès
de ressources sur les emplois permanents, ce qui va mettre l'entreprise dans
une position de risque d'arrêt d'activité dans le cas où le
besoin de liquidité persiste.
v Cas N° 03 : Lorsque le FR <
0 (négatif)
Cette situation résulte de l'insuffisance des capitaux
permanents pour financer les valeurs immobilisées et se trouve dans
l'obligation de rechercher les moyens financiers permettant d'augmenter son
fonds de roulement pour assurer une liquidité financière à
court terme.
1.2. Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Le besoin en fonds de roulement (BFR) traduit le besoin de
financement du cycle d'exploitation (l'activité de la structure). Il
résulte du dégagé dans le temps entre les encaissements et
les décaissements. Il s'agit d'un besoin de financement structurel
à court terme que génère le cycle d'exploitation. Il est
donc « le solde des comptes du bilan directement rattachés au cycle
d'exploitation (essentiellement) poste clients, fournisseurs et stocks
»
Le besoin en fonds de roulement est caractérisé
par le fait qu'il soit :
v Structurel : Le besoin en fonds de
roulement est dit structurel car il dépend de la structure propre de
chaque entreprise.
v Permanent : Le besoin en fonds de roulement
est dit permanent car il se définie par le montant des actifs circulants
qui n'est pas financé par des passifs de même nature.
Le calcul du besoin en fonds de roulement peut s'effectuer
comme suit :
BFR= (stocks+ créances) - passif courant
Ou bien :
BFR = (Actif courant - trésorerie) - passif courant
1.2.1. Les différents du besoin en fonds de
roulement
Le besoin en fonds de roulement comprend deux types :
1.2.1.1. Le besoin en fonds de roulement
d'exploitation (BFRE)
Le BFRE représente la partie des actifs cycliques
d'exploitation qui n'est pas financées par les ressources
d'exploitation.
Il se calcule comme suit :
BFRE = Actif circulant d'exploitation - passif circulant
d'exploitation
1.2.1.2. Le besoin en fonds de roulement hors
exploitation (BFRHE)
Le BFRHE correspond à la partie des actifs hors
exploitation qui n'est pas financées par les ressources cycliques hors
exploitation.
Il se calcule comme suit :
BFRHE = Actif circulant hors exploitation - passif circulant
hors exploitation.
Interprétation du besoin en fonds de
roulement
Le besoin en fonds de roulement peut se présenter en
trois cas, à savoir :
v Cas N° 01 : BFR > 0
Le BFR positif : On dit que l'entreprise a un
besoin de financement d'exploitation, donc les ressources cycliques n'arrivent
pas à financer l'actif circulant. Dans ce cas, ce besoin en fonds de
roulement doit être financé soit par le long terme (fonds de
roulement), sinon il sera couvert par le court terme.
v Cas N° 02 : BFR = 0
BFR est nul : C'est une situation qui
signifie que les dettes à court terme arrivent juste à financer
les emplois cycliques.
v Cas N° 03 : BFR < 0
Le BFR négatif : Dans ce cas la valeur
des ressources cycliques (DCT) est supérieure à la valeur des
emplois cycliques (les emplois hors disponibilité), c'est-à-dire
les ressources cycliques couvrent largement les emplois cycliques, et donc pas
de besoin de financement.
1.3. La trésorerie nette (TN)
La trésorerie est définie comme «
l'ensemble des actifs rapidement transformables en liquidité pour le
règlement des dettes à court terme.
Le concept de trésorerie correspond à la
nécessité d'éviter la cessation de paiement qui souvent
à la liquidation des biens ou à un règlement judiciaire.
»La trésorerie est la différence entre les besoins et les
ressources de l'entreprise, elle représente également l'ensemble
des ressources financières qui permettent de financer ses
dépenses à court terme.
La trésorerie met en relation les
éléments les plus liquides d'actif circulant aux dettes à
court terme, ainsi elle peut se calculer de deux manières :
Trésorerie nette (TN) = Fonds de roulement (FR) -
Besoin en fonds de roulement (BFR)
Ou bien :
Trésorerie nette (TN) = Valeur disponible (VD) - Dettes
à court terme (DCT)
1.3.1. Interprétation de la trésorerie
nette
La trésorerie peut se présenter en trois cas
:
v Cas N° 01 : FR > BFR, alors
: TR > 0
La trésorerie positive : signifieque
les ressources stables (FR) couvrent largement les besoins de financement
liés à l'activité de l'entreprise (BFR). Le reste des
ressources stables constitue une marge liquide (disponibilité).
v Cas N° 02 : FR = BFR, alors :
TR = 0
La trésorerie nulle : c'est le cas
où le la valeur du fonds de roulement est égale à la
valeur du besoin en fonds de roulement. Dans ce cas, l'entreprise ne dispose
pas suffisamment de ressources financières pour financer la
totalité de ses besoins. Dons l'entreprise ne dispose pas de
liquidité.
v Cas N° 03 : FR < BFR, alors
: TR < 0
La trésorerie négative :
signifie que la valeur du fonds de roulement n'arrive pas à
couvrir la valeur du besoin en fonds de roulement. Dans ce cas, on dit que
l'entreprise a une situation déséquilibrée à court
terme.
2. ANALYSE PAR L'OPTIQUE RATIO
II.2. LES MODELES DE SCORES :
ANALYSEURS DE PERFORMANCE PAR EXCELLE
II.2.1. CONCEPT DU MODELE DE
SCORES
Les modèles de scores se sont développées
grâce aux travaux qui ont été entrepris aux Etats- Unis
d'Amérique dans les années 1960, notamment avec le fameux Z-score
d'Altman inventé en 1968, fonction discriminante de cinq ratios
financiers. Elle a significativement contribué au développement,
à la promotion et à une meilleure compréhension du
modèle de scores et de ses techniques, etc.
En France, ces modèles furent utilisés pour la
première fois en 1975, essentiellement en matière de
crédit à la consommation, sous l'impulsion de plusieurs auteurs :
Collongues, 1977, Conan & Holder, 1979, Holder, et al, 1984 et les
responsables successifs des travaux effectués au sein de la Banque de
France à partir de l'exploitation des données de sa centrale de
bilan (Wafia., 2019).
Les modèles de scores sont considérés
comme « des outils d'aide à la prise de décision (...).
Selon Anderson, ces modèles, sont le recours aux modèles
statistiques en vue de transformer des données (qualitatives,
quantitatives) en indicateurs numériques mesurables à des fins
d'aide à la décision (...). Sa définition diffère
selon le but pour lequel il lui est fait recours, mais le principe reste le
même.
A. PRINCIPES DES MODELES
Les modèles de score utilisent l'indicateur
probabiliste du risque de crédit, c'est-à-dire une note de risque
ou une probabilité de défaut. Dans leur quasi-totalité,
les banques et organismes financiers utilisent l'analyse statistique pour
prédire si un emprunteur serait un bon ou un mauvais payeur et prendre
la décision appropriée : acceptation sans condition, prise de
garanties ou refus (Wafia., 2019). Ces modèles utilisent des
données historiques (généralement l'histoire des
performances passées des emprunteurs ou celle des prêts consentis)
et des techniques statistiques qui se calculent à base de logiciels
(Wafia., 2019).
B - OBJECTIF DES MODÈLES DE SCORES
Les modèles de scores ont pour objectif de
déterminer les effets de diverses Caractéristiques des
entreprises sur leur chance de faire défaut. Ils produisent
également des « scores» qui sont des notes mesurant le risque
de défaut des entreprises potentiels ou réels permettant de
ranger ces différentes entreprises en classes de risques. En effet, les
scores contribuent à la détection précoce de la
défaillance et apporte une aide précieuse au diagnostic
individuel (Wafia., 2019).
C - AVANTAGES ET LIMITES DE MODÈLES DE SCORES
1.AVANGES
Les modèles de scores sont avantageux car ils
permettent un traitement de masse de données nombreuses et cela en un
temps réduit. La durée de traitement des dossiers peut passer de
jours à quelques heures pour les crédits standards, favorisant
ainsi une économie de coût (Wafia., 2019).
L'adoption du score permet aux analystes de crédit de
concentrer leur attention sur d'autres aspects de la relation de
clientèle et du risque ainsi que le traitement identique de toutes les
données. Elle permet également de mieux contrôler le risque
de crédit, de détecter de façon précoce les
défauts de paiement des entreprises, d'estimer les pertes ainsi que
d'évaluer les probabilités de défaillance (Wafia., 2019).
2.LIMITES
À titre de limites, on note que les modèles de
scores mesurent mal les changements de toute nature qui modifient l'attitude
des emprunteurs par rapport au défaut ; ils négligent les
éléments qualitatifs relatifs à la qualité des
dirigeants ou caractéristiques particulières des marchés
sur lesquels opèrent les emprunteurs. Leur nature statistique fait
qu'ils comportent des erreurs qui consistent à classer en défaut
des emprunteurs performant et vice versa engendrant ainsi des coûts pour
les prêteurs (Wafia., 2019).
II.2.2. LES METHODES D'ANALYSE
DE PERFORMANCE D'ENTREPRISE
Angela Madalina Petrescu, a classé ces modèles
d'analyse en trois grandes catégories :
v Les méthodes basées sur le jugement humain ;
v Les méthodes basées sur l'intelligence
artificielle ; et
v Les méthodes statistiques.
Les méthodes statistiques sont subdivisées
à leur tour en trois :
v Les méthodes structurelles,
v Les modèles hybrides ; et
v Les méthodes économétriques
basées sur des données comptables.
II.2.2.1 LES METHODES BASEES SUR LE JUGEMENT HUMAIN
Elles s'appuient sur des techniques quantitatives et des
points de vues subjectives des organismes afin de fonder leur décision.
Ces méthodes présentent un certain nombre d'inconvénients,
notamment : leurs coûts en terme de ressources et d'argent pour
développer un système d'experts, sa lenteur pour la prise de
décision, ainsi que son caractère subjectif puisque la
décision revient essentiellement aux caractéristiques de
l'organisation, ce qui risque de les biaiser (...).
II.2.2.2. LA METHODE EMPIRIQUE : LE MODELE DES «
CREDIT MEN »
C'est la première méthode qui a permis
l'établissement d'un score avec note unique. Ce modèle est le
fruit de l'expérience accumulée des banquiers américains
au niveau de la gestion du risque crédit et/ou de défaillance.
Selon eux, chaque entreprise intègre trois facteurs :
v P : Le facteur personnel à savoir, la
compétence et le dynamisme des dirigeants et du personnel. Ce facteur a
un poids de 40%.
v E : Le facteur économique : l'avenir de la branche.
Ce facteur est pondéré à 20%.
v F : Le facteur de la situation financière de
l'entreprise, qui est pondéré à 40%.
S= 40% P + 20% E + 40% F
La somme de ces trois facteurs donne un score unique comme
représentée dans le modèle. Dans leur rationalité,
ces auteurs ont centré leur attention sur un facteur qui est le facteur
de la situation financière, car selon eux, ce secteur impacte presque
tous les autres facteurs et est la condition de premier ordre desurvie de toute
organisation (Wafia., 2019). Ce facteur est estimé à travers cinq
ratios qui sont choisis grâce à la pratique des analystes, sans
aucune analyse statistique.
TABLEAU N°2 : RATIOS DU MODELE DE CREDIT-MEN
|
N°
|
IDENTIFICATION DU RATIO
|
FORMULE
|
|
01
|
Ratio de trésorerie
|
Réalisable et disponible / Dettes à court terme
|
|
02
|
Ratio d'indépendance financière ou de
solvabilité
|
Capitaux propres / Dettes à moyen et long terme
|
|
03
|
Ratio de rotation crédit clients
|
Ventes TTC / (clients + effets à recevoir + effets
escomptés non échus).
|
|
04
|
Ratio de rotation des stocks
|
Achats / Stock moyen
|
|
05
|
Ratio de couverture
|
Capitaux propres / Valeurs immobilisées nettes
|
Source : Élaboré par
nous-même sur base des ratios du modèle.
Chaque ratio est une comparaison du ratio de l'entreprise par
rapport au ratio type du secteur.
Ri = Ratio de l'entreprise/ Ratio type du secteur = REi / RSi
La fonction financière finale du modèle
crédit-men' est donc présentée comme suit :
Z = 25 R1 + 25 R2 + 20 R3 + 20 R4 + 10 R5
REGLE DE DECISION
Ø Z > 100 : la situation financière est bonne
;
Ø Z = 100 : la situation financière est normale
;
Ø Z < 100 : la situation financière est
mauvaise.
Cette méthode présente l'avantage d'être
très simple et pratique. Elle s'appuie sur l'expérience et
l'intuition du banquier. Cependant elle reste très subjective, notamment
pour le choix des ratios et leur pondération. C'est ainsi que des
méthodes statistiques d'analyse de performance des entreprises ont
été développées. (Wafia., 2019).
II.2.2.3.2. L'ANALYSE DISCRIMINANTE MULTI-VARIEE
Le pionnier de cette méthode est Fisher, à
travers l'initiation des travaux sur l'analyse discriminante en 1933, il a
proposé une technique d'analyse utilisée jusqu'aujourd'hui
étant donné ses résultats pertinents. Par la suite,
d'autres techniques se sont développées mais celle de Fisher
reste une référence pour la plupart des fonctions de scores
actuellement (Wafia., 2019).
L'analyse discriminante répond à une question
fondamentale à savoir : laquelle des combinaisons linéaires des
variables explicatives est la plus discriminante ? Celle-ci est de deux types :
1) Analyse discriminante à but descriptif
: son rôle est de voir comment les variables explicatives
permettent à priori de différencier les groupes. Il s'agit tout
simplement de relever les variables les plus significatives et les plus
pertinentes pour décrire ces différences.
2) Analyse discriminante décisionnelle ou
prédictive : elle permet de construire à partir
d'un échantillon d'individus connus des règles statistiques de
décision qui seront appliquées dans le futur et qui serviront
à affecter les individus à l'un des groupes de classement. Ces
règles devront minimiser les erreurs de diagnostic et de
prévision (Wafia., 2019). Cette méthode permet d'apprécier
la situation financière d'une entreprise d'une manière globale
à travers une combinaison linéaire de plusieurs ratios
considérés simultanément en prenant en
considération leurs poids respectifs de manière
interdépendante. Elle permet de classer toutes les entreprises d'un
échantillon à l'aide d'une fonction score Z (Wafia., 2019). Ceci
suppose la constitution préalable d'un échantillon d'entreprises
performantes et celles défaillantes que l'on va comparer à un
échantillon de ratios. Ces derniers doivent séparer au mieux les
deux groupes d'entreprises. Le score s'exprime par la fonction linéaire
suivante :
Z = á1X1 +
á 2X2+ ....... + á NXN
Avec : Xi : les ratios comptables et financiers ;
ái : les coefficients associés aux
ratios.
Soulignons qu'aucune fonction score ne dispose d'un pouvoir
séparateur absolu, il y a toujours une zone d'erreur entre les deux
groupes :
?1er type d'erreur : Le score classe
une entreprise défaillante parmi celles performante ;
?2ème type d'erreur
: Le modèle classe une entreprise performante comme
étant défaillante (Wafia., 2019).
II.2.2.3.2.1. LES PRINCIPAUX MODELES D'ANALYSE
DISCRIMINANTE
1.LE MODELE D'ALTMAN
Son étude a porté sur un échantillon de
66 entreprises, composé de deux groupes 33 performantes et 33
défaillantes. A partir de 22 ratios extraits des états financiers
(bilans et comptes de résultats), Altman a choisi 5 ratios qui
séparent le mieux les deux groupes d'entreprises. Altman a suivi la
fonction suivante: Z = á1X1 + á 2X2+ ... + á NXN, les
ratios (Xi) sont pondérés par des valeurs ái (Wafia.,
2019).
Pour juger de la performance d'une entreprise la
régression prend en compte plusieurs ratios à savoir la
liquidité, la solvabilité, la rentabilité,
l'activité et la croissance ; qui représentent, selon Altman, les
indicateurs les plus significatifs pour analyser la performance des
entreprises. Il voulait que son modèle ne néglige aucun de ces
aspects de la situation financière d'une entreprise. Ainsi, selon
Altman, la combinaison linéaire des ratios qui discrimine le mieux les
deux groupes d'entreprises est la suivante :
Z = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 +
0,999 X5
TABLEAU N°3 : RATIOS DU MODELE D'ALTMAN
|
N°
|
IDENTIFICATION DU RATIO
|
FORMULE
|
|
01
|
X1
|
FDR / Total Actif
|
|
02
|
X2
|
Réserves / Total Actif
|
|
03
|
X3
|
Bénéfice avant intérêt et
impôt / Total Actif
|
|
04
|
X4
|
Capitalisation boursière ou FP / total des dettes
|
|
05
|
X5
|
Chiffre d'affaires / Total Actif
|
Source : Elaboré par
nous-même sur base des ratios du modèle
Le choix de ces variables se justifie par la valeur de
prédiction qu'elles représentent respectivement : la
liquidité, le conservatisme, la rentabilité, la capitalisation et
la productivité de l'entreprise. Les résultats ont montré
que toutes les entreprises ayant obtenu un score de 2,99 ou plus étaient
performantes. Celles qui avaient un score inférieur à 1,81
étaient en faillite. Le score de la zone entre 1,81 et 2,99 donnait un
signal ambigu : certaines entreprises étaient performantes alors que
d'autres défaillantes (Wafia., 2019).
Par conséquent, l'utilisation d'un seuil unique pour
classer les entreprises risque d'entrainer des erreurs. Altman a fixé la
valeur critique de son score à Z = 2,675 afin de minimiser ces erreurs.
Ainsi, une entreprise qui obtient un score Z < 2,675 sera classée en
situation défaillante, ou plus précisément un score Z <
1,81 annonce sa défaillance dans un délai d'un an ; et un score Z
> 2,99 signale que l'entreprise est en bonne santé financière
(Wafia., 2019).
Le modèle z-score d'Altman a connu par la suite, des
limites d'utilisation, vu la petitesse de l'échantillon sur lequel a
porté l'étude (33 sociétés performantes et 33
défaillantes) et sa concentration uniquement sur des entreprises du
secteur manufacturier ; ce qui laisse planer un doute sur la précision
des coefficients (Wafia., 2019).
Afin d'améliorer son modèle à cinq
variables, Altman a développé en 1977 un nouveau modèle
commercial plus élaboré appelé le modèle ZETA, avec
de nouvelles variables de classification. Il abandonna la variable X5 afin de
minimiser l'effet de l'industrie relié à la rotation des actifs
et remplaça la variable X4 par les actifs nets comptables / passifs
totaux.
Sa deuxième étude a porté sur un
échantillon de détaillants et de firmes manufacturières
ayant fait faillite durant les années 1969-1975. L'échantillon
contient 53 entreprises défaillantes et 58 autres performantes.
Il conclut que ce modèle ZETA est bon pour estimer les
faillites jusqu'à un horizon de cinq ans. Par ailleurs, le modèle
ZETA (1977), comparativement au modèle de 1968, donnait des
résultats équivalents pour l'horizon d'un an, très
légèrement supérieurs à un horizon de 2
années pour la classification des non défauts et beaucoup plus
précis pour la classification des faillites sur un horizon de 2 à
5 ans (Wafia., 2019).
2. LE MODELE DE COLLONGUES
Yves COLLONGUES a entrepris en 1977 une étude en France
sur un échantillon composé de 35 entreprises performantes et 35
défaillantes. Il a analysé au départ 19 ratios pour ne
retenir que 9 ratios les plus discriminants. Sa fonction discriminante est la
suivante :
Z = 4,983 X1 + 60,0366 X2 -
11,834 X3
TABLEAU N°4 : RATIOS DU MODELE DE COLLONGUES 1
|
N°
|
IDENTIFICATION DU RATIO
|
FORMULE
|
|
01
|
X1
|
Frais de personnel/valeur ajoutée
|
|
02
|
X2
|
Frais financiers/ chiffre d'affaires hors taxes
|
|
03
|
X3
|
Fonds de roulement net/total bilan
|
Source : Élaboré par
nous-même sur base des ratios du modèle
REGLE DE DECISION
Z > 5,455, l'entreprise sera considérée
défaillante.
Z< 5,455, l'entreprise sera considérée
performante.
Afin d'affiner son étude, COLLONGUES a testé sa
fonction de nouveau sur deux échantillons distincts. Le premier
composé de 27 entreprises ayant déposé leur bilan, le
second de 21 entreprises en situation de performance. Suite à ce test,
il a modifié son score pour aboutir à la fonction suivante :
Z= 4,6159 X1- 22 X4
- 1,9623 X5
TABLEAU N°5 : RATIOS DU MODELE DE COLLONGUES 2
|
N°
|
IDENTIFICATION DU RATIO
|
FORMULE
|
|
01
|
X4
|
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires H.T.
|
|
02
|
X5
|
Fonds de roulement net / stocks.
|
Source : Elaboré par
nous-même sur base des ratios du modèle
REGLE DE DECISION
Z > 3,0774, l'entreprise est déclarée
défaillante.
Z < 3,0774, l'entreprise est déclarée
performante.
3. LE MODELE DE CONAN ET HOLDER
En France, de nombreuses études ont essayé
d'analyser la performance des entreprises à travers l'analyse
discriminante, mais la plus importante est celle de CONAN et HOLDER du fait
qu'ils ont testé la multi-normalité des ratios financiers
utilisés et ont validé leur modèle sur un
échantillon de contrôle. Leur étude a été
réalisée en 1978 et a porté sur un échantillon de
95 entreprises saines et 95 en difficulté sur la période
1970-1975. Au début, 31 ratios ont été
sélectionnés pour n'en garder que 5 à la fin. La fonction
discriminante de Conan & Holder se présente comme suit :
Z= 0,24 X1 + 0,22 X2 + 0,16 X3 - 0,87 X4 - 0,10 X5
TABLEAU N°6 : RATIOS DU MODELE CONAN ET HOLDER
|
N°
|
IDENTIFICATION DU RATIO
|
FORMULE
|
|
01
|
R1
|
EBE / Endettement global
|
|
02
|
R2
|
Capitaux permanents/ total du bilan
|
|
03
|
R3
|
Réalisable et disponible / total du bilan
|
|
04
|
R4
|
Frais financiers / chiffre d'affaires H.T
|
|
05
|
R5
|
Frais de personnel / valeur ajoutée
|
Source : Élaboré par
nous-même sur base des ratios du modèle
REGLE DE DECISION
Z < 0,04 l'entreprise est en situation de
défaillance. 0,04 < Z < 0,09, zone de prudence.
Z > 0,09 l'entreprise est jugée performante.
4. LE MODELE DE LA BANQUE DE FRANCE
La banque de France a choisi un échantillon assez large
d'entreprises, grâce à sa centrale des bilans. L'étude a
porté sur : 1036 entreprises en difficultés (procédure
judiciaire ou de sauvetage) et 1150 entreprises normales. A partir de 30 ratios
sélectionnés au départ, seulement 19 ont été
retenus.
Le score de la Banque de France s'intéresse plus
à l'endettement financier (importance, structure et coût de
l'endettement). La fonction discriminante de la Banque de France est la
suivante :
100 Z = - 1,255 X1 + 2,003 X2 - 0,824 X3 + 5,221 X4 -
0,689 X5 - 1,164 X6 + 0,706 X7 + 1,408 X8 - 85,544
TABLEAU N°7 : RATIOS DU MODELE DE LA BANQUE DE FRANCE
|
N°
|
IDENTIFICATION DU RATIO
|
FORMULE
|
|
01
|
X1
|
Frais financiers/ EBE
|
|
02
|
X2
|
Ressources stables / actif économique
|
|
03
|
X3
|
CAF / Endettement
|
|
04
|
X4
|
EBE / CA HT
|
|
05
|
X5
|
délai crédit fournisseurs : (dettes commerciales
/ achats TTC)*365
|
|
06
|
X6
|
taux de variation de la valeur ajoutée
|
|
07
|
X7
|
délai découvert clients : (stocks en cours +
créances d'exploitation
- avances clients) /production TTC
|
|
08
|
X8
|
investissements physiques / valeur ajoutée
|
Source : Élaboré par
nous-même sur base des ratios du modèle
REGLE DE DECISION
Z > 0,125 : l'entreprise est performante.
-0,250< Z <0,125 : l'entreprise est en zone
d'incertitude.
Z < -0,250 : l'entreprise a des caractéristiques
comparables à celles des entreprises défaillantes durant leurs
dernières années d'activité (Wafia., 2019).
En Somme, toutes les méthodes statistiques d'analyse de
la performance se sont largement développées à travers le
temps. Chaque technique est venue pour combler les lacunes de sa
précédente. Par ailleurs, leur degré de fiabilité
varie en fonction d'un certain nombre de paramètres notamment, la
fiabilité des données de l'échantillon, les
critères de choix de cet échantillon puis les variables
explicatives choisies par chaque modèle afin d'analyser la performance
des entreprises.
Il importe aussi de préciser que ces méthodes
fournissent des clignotants qui doivent déclencher des
précautions à prendre quant à la gestion des entreprises
mais aussi pour la recherche des causes profondes de ses difficultés,
pour qu'elles puissent les dépasser. Ces précautions concernent
aussi bien les entreprises qui doivent sauver leurs activités, mais
aussi tous leurs partenaires.
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE ET INTERPRETATION
DES RESULTATS
Le présent chapitre est le plus expérimental de
notre recherche, car il va au au-delà de toutes les
considérations théoriques pour présenter les
données dans la première section, l'analyse de la performance
par la structure financière dans la deuxième, en s'appuyant sur
les états financiers de la PHL et constater dans quelles mesures cette
dernière permet d'atteindre son équilibre financier ;
l'analyse de la performance par l'optique ratio sera la troisième
section ; afin, l'analyse de la performance par le modèle de
COLLONGUES.
III.1. PRESENTATION DES DONNEES
Dans cette section, il s'agit de présenter les
données mais pour raison d'ordre, nous avons jugé bon de renvoyer
ces données aux annexes 2 (voir l'annexe 1).
En considérant les données des annexes 2, nous
avons constaté durant les trois années d'étude que les
valeurs immobilisées ont une valeur plus importante par rapport aux
autres éléments de l'actif respectivement de 85,32%, 86,89 % et
82,35% pour les trois années de notre étude.
Quant aux éléments de passif, une augmentation
des capitaux permanents est enregistrée en 2021 de 85,1% par rapport
à 2020 et 84,5% en 2022 à cause de l'augmentation des fonds
propres. Donc l'entreprise dispose d'une marge qu'elle utilise pour financer
son cycle d'exploitation. Ce qui donne un bon signe de solvabilité.
Évolution et interprétation du compte de
résultat :
Le tableau présenté dans l'annexe 3 nous indique
ce qui suit :
v Une augmentation progressive du chiffre d'affaire dû
à l'augmentation du prix de vente des cheptels
v Une valeur ajoutée négative. Ceci montre un
dysfonctionnement dans le cycle d'exploitation et une mauvaise santé
financière de l'entreprise.
v EBE négative à cause de l'augmentation des
charges des personnels
v Résultat financier négatif en 2022 à
cause de l'augmentation du niveau d'endettement de l'entreprise.
v Résultats nets d'exercices négatifs en 2021 et
2022 ce qui signifie que la PHL a réalisé un déficit
durant les deux années.
III.2. ANALYSE DE LA PERFORMANCE PAR LA STRUCTURE
FINANCIERE DE LA PHL
Pour analyser la structure financière de la PHL, les
indicateurs financiers sont pris en considérations. Ceux-ci forment
l'ensemble des informations issues des bilans financiers et comptes de
résultats.
Parmi ces indicateurs, on retrouve :
v Le fond de roulement (FR)
Le fonds de roulement représente la partie des capitaux
permanents qui excède la valeur des investissements durable. Il permet
de financer les besoins générés par le cycle
d'exploitation de l'entreprise.
Le fonds de roulement est un indicateur de l'équilibre
financier à long terme.
v Le besoin en fond de roulement
(BFR)
Le besoin en fonds de roulement exprime les besoins de
financements générés par le cycle d'exploitation de
l'entreprise.
Le besoin en fonds de roulement est un indicateur de
l'équilibre financier à court terme.
v La trésorerie nette
La trésorerie nette est le résultat de tous les
flux d'encaissements et décaissements effectués par l'entreprise
au cours d'une période donnée. Elle permet de juger
l'équilibre financier de l'entreprise à très court
terme.
La trésorerie nette est l'indicateur de
l'équilibre financier immédiat.
TABLEAU N°8 : CALCLUL DES FONDS DE ROULEMENT DE
LA PHL
|
|
ANNEES
|
RESS ACYC
|
EMPL ACYC
|
FONDS DE ROULEMENT
|
|
2020
|
3479765487
|
3750610282
|
-270 844 795
|
|
2021
|
6717721880
|
6858919888
|
-141 198 008
|
|
2022
|
5643754341
|
5498148002
|
145 606 339
|
Source : conçu par
nous-même sur base des données des annexes 2
L'observation de ce tableau, nous montre que le fonds de
roulement est négatif durant les deux années soit 2021 et 2022,
cela veut dire que les emplois stables ne sont pas entièrement
financés par les ressources stables (manque d'équilibre
financier), la PHL a utilisé une partie de ses dettes à court
terme pour financer le long terme. Par conséquent en 2022 il devient
positif ce qui veux dire que les ressources stables couvrent les emplois
stables et l'entreprise est capable de dégager une marge de
sécurité qui servira pour le financement de son cycle
d'exploitation et les autres besoins de financement à court terme.
TABLEAU N°9 : CALCLUL DE BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT DE LA PHL
|
ANNEES
|
STOCKS + REALISABLES
|
DETTES A C.T NON BANCAIRES
|
BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT
|
|
2020
|
609803977
|
915916615
|
-306 112 638
|
|
2021
|
927785172
|
1176056542
|
-248 271 370
|
|
2022
|
898928958
|
1033009793
|
-134 080 835
|
Source : conçu par
nous-même sur base des données des annexes 2
La PHL a enregistré un besoin en fonds de roulement
négatif durant les trois années de notre étude, soit -
360112638, - 248271370 et - 134080835. De 2020 à 2022.
C'est-à-dire les ressources cycliques couvrent largement les emplois
cycliques, et donc pas de besoin de financement.
TABLEAU N°10 : CALCLUL DE LA TRESORERIE NETTE DE
LA PHL DE 2020 A 2022
|
|
ANNEES
|
FONDS DE
ROULEMENT
|
BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT
|
TRESORERIE
|
|
2020
|
-270 844 795
|
-306 112 638
|
35 267 843
|
|
2021
|
-141 198 008
|
-248 271 370
|
107 073 362
|
|
2022
|
145 606 339
|
-134 080 835
|
279 687 174
|
Source : conçu par
nous-même sur base des données des annexes 2
Pour les trois exercices la trésorerie nette est
positive reflète l'excédent du FR à travers le BFR ce qui
signifie que l'entreprise assure un équilibre financier immédiat,
c'est-à-dire qu'elle peut exploiter toute opportunité qui se
présente sur le marché. Autrement dit, l'entreprise se trouve en
mesure de financer des dépenses nouvelles sans avoir recours à un
mode de financement externe.
TABLEAU N°11 : CALCUL DE LA CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT
|
NATURE
|
FORMULE
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
CAF
|
Résultat net + Dotation aux provisions et
amortissement
- Reprise + VNC
- produit de cession des éléments de l'actif
|
-95987929,97
|
-93125041,49
|
3862913
|
Source : élaboré par nous-même sur
base des données du tableau n°3
L'entreprise présente
une CAF négative pendant les deux premières
années de notre étude, cela signifie qu'elle ne parvient
pas à plus d'argent qu'elle n'en dépense, et donc qu'elle ne
génère pas d'excédents de
trésorerie, qui pourra être réutilisé par
la suite. En d'autres termes.
III.3 : ANALYSE DE LA PERFORMANCE PAR L'OPTIQUE
RATIOS
Les ratios sont des outils de mesure et de contrôle de
l'évolution, dans le temps, de la performance économique et
financière ainsi que des structures de l'entreprise. Ils servent
à mesurer la rentabilité, la structure des coûts, la
productivité, la solvabilité, la liquidité,
l'équilibre financieret autres. Dans notre cas nous allons analyser la
liquidité, l'endettement, la rentabilité économique,
l'autonomie financière, et les charges du personnel.
TABLEAU N° 12: RATIO DE LIQUIDITÉ GENERALE
DE LA PHL : 2020/2021/2022
|
DESIGNATIONS
|
ANNEES
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Actif circulant
|
645071820
|
1034858534
|
1178616132
|
|
Dettes à court terme
|
915916615
|
1176056542
|
1033009793
|
|
RAPPORT
|
0,70
|
0,88
|
1,14
|
Source : élaboré par nous-même sur
base des données des annexes 2.
Nous constatons que le ratio de liquidité
générale est inférieur à 1 durant les deux
années donc de 2020 à 2021, ce qui signifie que l'entreprise se
trouve en difficulté de faire face à ses dettes à court
terme. Il devient légèrement supérieur à 1 en 2022.
Ce qui est dû à l'augmentation des actifs circulants de la
société.
TABLEAU N°13 : RATIO DE L'ENDETTEMENT GLOBAL DE LA
PHL : 2020/2021/2022
|
DESIGNATIONS
|
ANNEES
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Dettes totales
|
916081615
|
1176221542
|
1033174793
|
|
Capitaux propres
|
3479600487
|
6717556880
|
5643589341
|
|
RAPPORT
|
0,26
|
0,18
|
0,18
|
Source : élaboré par nous-même sur
base des annexes 2
Au vu de ce tableau, voyons que le ratio d'endettement global
est resté inférieur à 1 pendant toute les années de
notre ce qui signifie que l'entreprise dépendant de financements
extérieurs autrement dit l'entreprise est dépendante
financièrement par rapport aux tiers.
TABLEAU N°14 : RATIO DE LA RENTABILITÉ
ÉCONOMIQUE DE LA PHL : 2020/2021/2022
|
DESIGNATIONS
|
ANNEES
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
CAF
|
-95987929,97
|
-93125041,49
|
3862913
|
|
CA Hors taxe
|
2439346502
|
2423198971
|
1462049682
|
|
RAPPORT
|
-0,04
|
-0,04
|
0,003
|
Source : élaboré par nous-même sur
base des annexes 2
Le ratio de rentabilité économique mesure la
capacité de l'entreprise à dégager un résultat en
utilisant l'ensemble de ses moyens ainsi l'efficacité
opérationnelle de l'entreprise. Nous avons constaté que le ratio
de rentabilité économique de la PHL est négatif pour les 2
années 2020 et 2021 aussi positif en 2022 mais inférieur
à 1, cela signifie que les charges et investissement de l'entreprise
sont plus élevées par rapport aux revenus. Ceci ne peut pas
permettre à l'entreprise de disposer assez des ressources pour maintenir
son activité.
|
DESIGNATIONS
|
ANNEES
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Capitaux propres
|
3479600487
|
6717556880
|
5643589341
|
|
Total bilan
|
4395682102
|
7893778442
|
6676764134
|
|
RAPPORT
|
0,79
|
0,85
|
0,85
|
TABLEAU N°15 : RATIOS D'AUTONOMIE
FINANCIÈRE DE LA PHL: 2020/2021/2022
Source : élaboré par nous-même sur
base des annexes 2
Le ratio d'autonomie financière indique le degré
de l'indépendance de la PHL vis-à-vis de ses créanciers.
On constate que ce ratio durant les trois derniers années que ce ratio
est inférieur à 1 donc 0,79 en 2020, 0,85 en 2021 et 2022, cela
signifie que l'entreprise n'est pas en mesure d'investir pour son
développement.
TABLEAU N°16 : RATIOS DE CHARGE DU PERSONNEL
DE LA PHL : 2020/2021/2022
|
DESIGNATIONS
|
ANNEES
|
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Charge du personnel
|
688134778
|
715085297
|
550317695
|
|
Chiffre d'affaire
|
2439346502
|
2423198971
|
1462049682
|
|
RAPPORT
|
0,28
|
0,30
|
0,38
|
Source :
élaboré par nous-même sur base des données des
annexes 3
Ce ratio vise à mesurer le coût de la
main-d'oeuvre de l'entreprise.Ainsi, à partir de ce ratio, nous
constatons une diminution du ratio des frais de personnel à partir de
l'année 2021 à cause de la hausse des frais de personnels.
III.4: ANALYSE DE LA PERFORMANCE PAR LE MODELE DE
COLLONGUES
III.4.1. PRESENTATION DU
MODELE
Cette partie du travail constitue la partie clés de
notre travail, car il va au-delà de toutes les considérations
théoriques et c'est à travers le modèle d'YVES COLLONGUES
que nous allons afin évaluer la performance de la compagnie pastorale du
haut-lomami.
En effet, Yves COLLONGUES a entrepris en 1977 une étude
en France sur un échantillon Composé de 35 entreprises
performantes et 35 défaillantes. Il a analysé au départ 19
ratios pour ne retenir que 9 ratios les plus discriminants. Sa fonction
discriminante est la suivante :
Z = 4,983 X1 + 60,0366 X2 -
11,834 X3
X1 : frais de personnel/valeur ajoutée
X2 : frais financiers/chiffre d'affaire hors taxes
X3 : fonds de roulement net/total bilan
REGLE DE DECISION
Z > 5,455, l'entreprise sera considérée
défaillante.
Z< 5,455, l'entreprise sera considérée
performante.
Afin d'affiner son étude, COLLONGUES a testé sa
fonction de nouveau sur deux Échantillons distincts. Le premier
composé de 27 entreprises ayant déposé leur bilan, le
second de 21 entreprises en situation de performance. Suite à ce test,
il a modifié son score pour aboutir à la fonction suivante :
Z= 4,6159 X1- 22 X4 -
1,9623 X5
Où :
X4 : résultat d'exploitation/chiffre d'affaire HT
X5 : fonds de roulement net/ stocks
REGLE DE DECISION
Z > 3,0774, l'entreprise est déclarée
défaillante.
Z < 3,0774, l'entreprise est déclarée
performante.
III.4.2. APPLICATION DU MODELE
TABLEAU N°17 : APPLICATION DU MODELE
2020
|
X1-X5
|
RATIOS
|
RAPPORT
|
MODELE
|
CONCLUSION
|
|
X1-X5
|
COEFF
|
CO*R
|
|
X1
|
688134778
|
0,779669822
|
4,6159
|
3,598877933
|
DEFAILLANCE
|
|
882597682
|
|
X2
|
|
|
|
|
|
|
|
X3
|
|
|
|
|
|
|
|
X4
|
72721613
|
0,029811924
|
-22
|
-0,655862332
|
|
2439346502
|
|
X5
|
-270 844 795
|
-0,58954293
|
-1,9623
|
1,156860094
|
|
459414880
|
|
Z= 4,6159 X1- 22 X4 - 1,9623 X5
|
4,099875695
|
Source : Élaboré par
nous-même sur base des données des annexes 2 et 3
TABLEAU N°18 : APPLICATION DU MODELE 2021
|
X1-X5
|
RATIOS
|
RAPPORT
|
MODELE
|
CONCLUSION
|
|
COEFF
|
CO*R
|
|
X1
|
715085297
|
0,841439778
|
4,6159
|
3,884001872
|
DEFAILLANCE
|
|
849835384
|
|
X2
|
|
|
|
|
|
|
|
X3
|
|
|
|
|
|
|
|
X4
|
-7187463
|
-0,00296611
|
-22
|
0,065254314
|
|
2423198971
|
|
X5
|
-141 198 008
|
-0,28644816
|
-1,9623
|
0,562097221
|
|
492926919
|
|
Z= 4,6159 X1- 22 X4 - 1,9623 X5
|
4,511353406
|
Source : Élaboré par
nous-même sur base des données des annexes 2 et 3
TABLEAU N°19 : APPLICATION DU MODELE 2022
|
X1-X5
|
RATIOS
|
RAPPORT
|
MODELE
|
CONCLUSION
|
|
COEFF
|
CO*R
|
|
X1
|
550317695
|
1,49757782
|
4,6159
|
6,912669459
|
DEFAILLANCE
|
|
367471852
|
|
X2
|
|
|
|
|
|
X3
|
|
|
|
|
|
|
|
X4
|
-182767423
|
-0,12500767
|
-22
|
2,750168722
|
|
1462049682
|
|
X5
|
145 606 339
|
0,270781816
|
-1,9623
|
-0,531355158
|
|
537725690
|
|
Z= 4,6159 X1- 22 X4 - 1,9623 X5
|
9,131483023
|
Source : élaboré par nous-même sur
base des annexes 2 et 3
TABLEAU N°20 : EVOLUTION DES SCORE Z DE LA
SNCC
|
ANNEES
|
SCORE
|
|
|
2020
|
|
4,099875695
|
|
2021
|
|
4,511353406
|
|
2022
|
|
9,131483023
|
Source : élaboré par
nous-même sur base des tableaux numéros 17-19
L'application du modèle de Collongues nous a conduits
aux résultats suivants :
Z > 3,0774, l'entreprise est déclarée
défaillante en 2020 avec un score de 4,099875695
Z > 3,0774, l'entreprise est déclarée
défaillante en 2021 avec un score de 4,511353406
Z > 3,0774, l'entreprise est déclarée
défaillante en 2022 avec un score de 9,131483023
À travers le tableau ci-dessus, nous remarquons que
l'entreprise présente un score supérieur à 3,0774 qui
selon les règles de décision des COLLONGUES, l'entreprise est
déclaréedéfaillante pendant toute notre période
d'étude.
Les résultats obtenus à travers cette
étude nous permettent de conclure que la compagnie pastorale du
haut-lomami est défaillante, D'ailleurs, ces résultats sont
conformes avec les enseignements de l'analyse financière qui
préconise l'analyse du couple rentabilité/risque pour
décider de la situation financière de toute entreprise.
.
CRITIQUE ET SUGGESTION
1. CRITIQUE
À l'issue de notre étude axée sur
« l'impact de la gestion des ressources humaines sur la performance
des entreprises agropastorales cas de la compagnie pastorale du
haut-lomami », nos analyses nous ont conduits à quelques
critiques :
v La détermination du salaire ne tient pas compte du
coût de vie des agents de la PHL
v Le non-respect des avantages sociaux selon qu'ils sont
prévus par la législation congolaise
v Les travailleurs ne sont pas rémunérés
en fonction du temps presté, c'est-à-dire qu'ils travaillent
même au-delà du temps prévu, et les heures
supplémentaires ne sont pas payées.
2. SUGGESTIONS
Après avoir relevé les difficultés qu'a
les fonctionnaires de la PHL, signalons que la gestion des ressources humaines
joue un rôle très important sur la performance de l'entreprise.
Sur ce, nous ne pouvons pas conclure sans toutefois donner
certaines recommandations à la compagnie pastorale du Haut-lomami.
v Mettre en place une bonne politique de la gestion des
ressources humaines et la gestion de carrière selon le temps
prévu, parce que sa performance en dépende forcement ;
v Mettre en place une politique salariale qui tient compte au
minimum vital et surtout du taux actuel.
v Améliorer les conditions de vie de ses travailleurs
en respectant tous les avantages sociaux des travailleurs.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail qui est intitulé
« impact de la gestion des ressources humaines sur la performance des
entreprises agropastorales. Cas de la compagnie pastorale du
Haut-lomami ».
Pour bien élaborer ce travail, nous l'avons
subdivisé en 3 chapitres hormis l'introduction et la
conclusion :
v Le premier chapitre traite d'analyses conceptuelles et
de la présentation du milieu d'étude,
v Le deuxième parle des théories explicatives
sur la gestion des ressources humaines et sur la performance ;
v Le troisième chapitre traite analyse et
interprétation des résultats.
Ce sujet nous a permis de comprendre que l'entreprise ne peut
être conçue comme une entité isolée du milieu dans
lequel elle agit. Elle est entourée par plusieurs types d'environnements
tels que : l'environnement social (emploi, climat et tensions sociales,
syndicats) ; l'environnement démographique (structure de la population
par âge, sexe) ; l'environnement politique et juridique
(réglementation économique, sociale) ; l'environnement
économique ( conjoncture générale, concurrence,
ménages (pouvoir d'achat, consommation, épargne)) et
l'environnement international (conjoncture internationale, concurrence
internationale, organisme internationaux). Elle doit surveiller en permanence
cet environnement. En effet, Celui-ci peut influencer ses décisions
ainsi que la stabilité de son activité soit de manière
positive (opportunités environnementales) soit de manière
négative (contraintes ou menaces environnementales).
Pour atteindre l'objectif de ce travail, nous sommes partis
des deux questions suivantes :
Ø De quelle manière la gestion des ressources
humaines peut-elle influencer la performance de l'entreprise ?
Ø Comment une bonne gestion des ressources humaines
pourrait-elle contribuer au développement harmonisé de
l'entreprise ?
Afin de répondre à toutes ces
préoccupations, nous avons proposé les hypothèses
suivantes :
Ø La gestion des ressources humaines influence la
performance d'une entreprise dans le sens où l'homme serait
considéré comme une ressource qui conditionne les plus le devenir
de l'entreprise parmi les autres ressources.
Ø À travers nos suggestions et observations
faites, la gestion de ressources humaines pourrait contribuer au
développement harmonisé de l'entreprise si les conditions
relatives à la bonne gestion et à l'organisation de ces
ressources sont d'application en entreprise.
L'utilisation de la méthode inductive et l'approche
analytique a été en effet conforme aux ambitions que nous avons
donc donné à ce travail par les modèles des scores, les
techniques restant celles documentaire et d'interview.
Nos analyses étaient rendu possible grâce
à l'utilisation de la structure financière de la PHL enfin de
déterminer les indicateurs financiers ; l'utilisation des ratios en
général et le modèle de COLLONGUES comme modèle
central de nos analyses.
Ainsi nous avons constaté que la PHL est une
société qui a connu une défaillance pendant toute la
période de notre recherche donc de2020 à 2022, suite aux
résultats observé lors de nos analyses (résultats net
négatifs durant presque toute la période de notre recherche,
ainsi à travers l'application du modèle des COLLONGUES nous avons
trouvé une défaillance totale de l'entité durant les 3
bonnes années de notre recherche avec les scores suivants (4,099875695
en 2020, 4,511353406 en 2021 et 9,131483023 en 2022 tous supérieurs
à 3,0774 d'où selon les règles de décision de
longue qui préconise la défaillance de l'entreprise ayant un
score supérieur à 3,0774.
En dépit de toutes ces analyses faites, nos
hypothèses sont confirmées et nous disons qu'il est
inévitable de traiter l'importance des ressources humaines dans le
développement de l'entreprise selon trois dimensions : l'acquisition de
compétences clés, la rétention des individus au sein de
l'organisation et l'apprentissage permanent. L'acquisition des
compétences clés est la phase la plus cruciale du
développement de l'entreprise. Elle permet l'approvisionnement de
l'organisation en individus compétents qui s'occupe du
déroulement du travail, de l'établissement des objectifs de
développement et du contrôle des résultats finaux. Pour une
entreprise, savoir conserver ses talents est aussi important que de savoir les
recruter.
Nous ne prétendons pas avoir épuisé tous
les aspects de notre sujet, le domaine étant vaste. Néanmoins,
nous prétendons avoir atteint notre objectif, celui de signaler l'impact
de la gestion des ressources humaines sur la performance des entreprises
agro-pastorales. D'autres chercheurs peuvent nous compléter sur cette
étude si vaste car toute oeuvre humain est toujours liées
à des imperfections.
BIBLIOGRAPHIE
Aktouf. (1978). Méthodologie des sciences sociales
et approche qualitative des organisations Une introduction à la
démarche classique et une critique.
Aktouf. (1988). méthodologie des sciences sociales
et approche qualitative des organisations Une introduction à la
démarche classique et une critique,.
al, d. m. (2015). l'histoire de la structurations des
disciplines scientifiques, est cruciale.
Alain Chamak, C. f. (07/06/2006). Le capital Humain-
comment développer et l'évaluer. (E. liaisons,
Éd.)
Albert Corhay, M. M. (2008). Fondements de gestion
financière: manuel et applications (éd. du CEFAL).
Lièges.
Allègre, C. B. (2008). gestion des ressources
humaines.
Autissier, D. (2010). la capacité de transformation
comme composante du capital humain.
Ballé, M. (2009). apprendre à apprendre avec
le lean. Paris.
Bayle, J.-L. L. (2000). Initiation aux méthodes des
sciences sociales. (L'harmathan, Éd.) Montréal.
Becker, B. (1996). « The Impact of Human Resource
Management on Organizational Performance.Progress and Prospects (Vol. 39
n°4). Academy of Management Journal,. Consulté le Juin Dimanche,
2023
Becker, B. M. (1997). Becker, B.E., M.A« HR as a
Source of Shareholder Value- Research and Recommendations », Human
Resource Management (Vol. vol.36). Consulté le juin Dimanche,
2023
benveniste, E. (s.d.). probleme de linguistique
générale.
Bergeron, p. G. (2001). la gestion dynamique
(éd. 3iem édition, Vol. 934). (G. Morin, Éd.)
BERLAND, N. (2010). mesure de la performance globale des
entreprises. Angèle Renaud.
Bernard girard, G. (2014). repenser la
responsabilité sociale de l'entreprise. Montréal.
BLANCHE, J. (1965). revue de geographie alpine.
Bounfour, A. (2008). Capital immatériel,
connaissance et performance.
Bringer, e. a. (2011). les moyens de mesure et de pilotage
du contrôle de gestion.
CADIN, F. (1997). gestion des ressources humaines.
paris: dunod.
Chandler, a. (1992). organisation et performance des
entreprises. (E. d'organisation, Éd.) Paris.
CHARREAUX, G. (1997). Le gouvernement des entreprises,
théories et faits.
Charreaux, G. (1998). Le point sur la mesure de
performance des entreprises. Paris .
Conrod. (2001). la performance de l'entreprise.
Dalloz. (2010). Lexique d'Economie, (éd. 11e
édition).
DOLAN Shimon L., S. T. (2000). "la gestion des ressources
humaines: tendance, enjeux et pratiques actuelles", (éd.
9éme édition).
Genaivre, E. (Août 2006). Ethique et gouvernance
d'entreprise en France-broché. (publibook, Éd.) paris.
George R. Terry, S. G. (1985). les principes du
management. (E. GF, Éd.)
GILBERT P., C. M. (1996). Comment évaluer la
performance? question universelle, réponses contingentes.
GIRAUD, e. a. (2004). contrôle de gestion et
pilotage de la performance (éd. 2éme édition).
Paris.
GOTTELAND, D. (2005). développer un nouveau
produit: méthodes et outils.
GRANT. (1991). "the resource based theory of
competitive" (Vol. Vol. 3). california: california management review.
Guerard. (2006). Regards croisés sur
l'économie mixte: Approche pluridisciplinaire. Droit public et Droit
privé. Paris: l'harmattan.
Guy, A. (2006). université paul verlaine.
Ingham, M. (1995). Management stratégique et
compétitivité. (d. Boeck, Éd.)
JEAN-YVES LE LOUARN, T. W. (01/08/2001). Evaluation de la
gestion des ressources humaines. (E. liaisons, Éd.)
Montréal.
Khouatra. (2005). gouvernance de l'entreprise et
création de la valeur partenariale. Malo J.L.
LAROUSSE, l. p. (2007). Dictionnaire français
ILLUSTRE (éd. éd. française juillet 2006).
Lise Chrétien, G. A. (2015). Impacts des pratiques de
gestion des ressources humaines sur la. Revue internationale sur le travail
et la société, 3(1), pp. 107-128.
Récupéré sur lise.chretien@mng.ulaval.ca ,
guy_arcand@uqtr.ca , tellier@gestion.uottawa.ca , michel_arcand@uqtr.ca
LOUART, P. (1991). gestion des ressources humaines.
Paris: Eyrolles.
MACE, G. (1988). Guide d'élaboration d'un projet de
recherche. les presses de l'université laval.
Magakian, J.-l. (2007). comprendre la stratégie de
l'entreprise (éd. 2).
Martory, B. (2004). Tableaux de bord sociaux.
Maurel, X. G. (2009). Lexique d'economie. . Paris :
dalloz, .
MILOUD. (2003). Le pilotage de la performance globale de
l'entreprise et le balanced.
N'DA. (2015). Recherche et méthodologie en sciences
sociales et humaines Réussir sa thèse, son mémoire de
Master ou professionnel, et son article.
Ndiaye, P. .. (2015). Analyse de la performnce
financière des sociétés de transport d'hydrpcarbures: cas
de TAD (Transport Amadou DIAYE). Dakar: école supérieur de
management.
Ouattara, W. (11 janvier 2008). Productivités et
externalités des dépenses publiques en zone UEMOA (Vol. 19).
African development review.
Oubya, G. (2016). Contribution à l'étude des
déterminants de la performance de l'entreprise: impact de la
création de valeur pour le client sur la performance des entreprises
hotelières en tunisie. Tunisie, sciences de gestion tunisie.
PERETTI. (2003-2004). Gestion des ressources humaines
(éd. 11).
PLAUCHU, V. (juillet 2008). méthodologie du
diagnostic d'entreprise.
PONSARD. (2005). Return on investiment in desease
management.
SIMON RICHOZ, L.-M. B. (2010). santé et
développement territorial enjeux et opportunités (éd.
1).
THOMAS. S. (1962). la gestion des entreprises
(éd. éd PUF,). paris.
Tremblay. (2004). famille-travail, conciliation.
Turcotte. (2005). décisions de la CSC.
VALLEMONT, S. (1999). gestion des ressources humaines dans
l'administration. (l. d. française, Éd.)
VENANZI, D. (2012). Financial performance measures and
value creation: the state of the art.
Wikipedia, W. (2023).
ANNEXE 1 . BILIAN COMPTABLE DE LA PHL/ KIABUKWA 2020
(EN FRANCS COURANTS
Source : Élaboré par le service comptable de
la PHL/KIABUKWA
|
DESIGNATION
|
VALEUR BRUIT
|
AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
DESIGNATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
|
VAL IMMOBILISEES
· Immob incorporelles
Frais d'établissement
|
44.000.000
|
-
|
44.000.000
|
Capital
Report à nouveau
Résultat
|
543.007.787
128.000.425
-170.299.133
|
|
Total immob incorporelles
|
44.000.000
|
-
|
44.000.000
|
Total capitaux propres
|
500.709.079
|
|
· Immob corporelles
Bâtiment
Aménagement et installa
Matériel et Mobilier
Matériel de transport
|
406.235.369
1.252.839.720
1.303.937.348
743.597.845
|
369.180.278
978.432.133
945.881.293
685.397.704
|
37.055.091
274.407.587
358.056.055
58.200.141
|
Encaissement des dettes fin
|
150.000
|
|
· Total dette à long terme
|
156.000
|
|
· Fournisseurs
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
|
35.267.848
3.625.822
171.830.377
705.192.568
|
|
Total immob corporelles
|
3.704.610.272
|
2.978.891.408
|
727.718.874
|
|
Total val immobilisées
|
3.750.610.272
|
2.978.891.408
|
771.718.874
|
|
VAL CIRCULANTES
· Val d'exploitation
Stock marchandise
Mp et autres appro
Stock et en cours
|
2.698.980
505.170.388
-48.454.488
|
-
-
-
|
2.698.980
505.170.388
-48.454.488
|
Total dettes à CT
|
915.916.615
|
|
|
Total val d'exploitation
|
459.414.880
|
-
|
150.389.097
|
|
· Val réalisables
Fournisseur avances versé
Client
Autres créances
|
23.815.949
70.274.201
56.300.947
|
-
-
-
|
23.813.949
70.274.201
56.300.947
|
|
Total valeurs réalisables
|
150.389.097
|
-
|
150.389.097
|
|
· Val disponibles
Banque et caisse
|
35.267.843
|
-
|
35.267.843
|
|
Total valeurs disponibles
|
35.267.843
|
-
|
35.267.843
|
|
TOTAL ACTIF
|
4.395.682.102
|
2.978.891.408
|
1.416.790.694
|
TOTAL PASSIF
|
1.416.790.694
|
BILIAN COMPTABLE DE LA PHL/
KIABUKWA 2021 (EN FRANCS COURANTS)
|
DESIGNATION
|
VALEUR BRUIT
|
AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
DESIGNATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
|
VAL IMMOBILISEES
· Immob corporelles
Bâtiment
Aménagement et installa
Matériel et Mobilier
Matériel de transport
|
1.100.528.836
3.360.395.070
2.039.857.765
358.138.217
|
985.643.978
2.845.681813
1.437.873.915
336.388.084
|
114.884.858
514.713.257
601.983.850
21.750.133
|
Capital
Report à nouveau
Résultat net
|
543.007.787
600.973.007
-32.011.704
|
|
Total capitaux propres
|
1.111.969.090
|
|
· Emprunte de dettes financières
|
165.000
|
|
Total immob corporelles
|
6.858.919.888
|
5.605.587.790
|
1.253.332.098
|
Total capitaux empruntés
|
165.000
|
|
VAL CIRCULANTES
· Val d'exploitation
Stock marchandise
Mp et autres appro
Stock et en cours
|
-
-
492.926.919
|
-
-
-
|
-
-
492.926.919
|
Clients avances reçues
Fournisseurs d'exploita
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
|
74.949.156
10.520.426
145.052.473
107.103.360
838.430.627
|
|
Total val d'exploitation
|
492.926.919
|
-
|
492.926.919
|
Total dettes à CT
|
1.176.056.542
|
|
· Val réalisables
Fournisseur avances versé
Client
Autres créances
|
5.668.648
357.523.603
71.666.002
|
-
-
-
|
5.668.648
357.523.603
71.666.002
|
|
|
Total valeurs réalisables
|
434.858.253
|
-
|
434.858.253
|
|
· Val disponibles
Banque et caisse
|
107.073.362
|
-
|
107.073.362
|
|
Total valeurs disponibles
|
107.073.362
|
-
|
107.073.362
|
|
TOTAL ACTIF
|
7.839.778.422
|
5.605.587.790
|
2.288.190.632
|
TOTAL PASSIF
|
2.288.190.632
|
Source : Direction comptable de la PHL/KIABUKWA
BILIAN COMPTABLE DE LA PHL/
KIABUKWA 2022 (EN FRANCS COURANTS)
|
DESIGNATION
|
VALEUR BRUIT
|
AMORTISSEMENT ET DEPRECIATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
DESIGNATION
|
VALEUR NETTE COMPTABLE
|
|
VAL IMMOBILISEES
· Immob corporelles
Bâtiment
Aménagement et installa
Matériel et Mobilier
Matériel de transport
|
1.520.937.656
614.039.709
2.081.256.944
1.281.913.693
|
1.389.449.522
218.329.231
1.352.720.846
1.271.408.367
|
131.488.134
395.710.478
728.536.098
10.505.326
|
Capital
Report à nouveau
Résultat net
|
543.007.787
820.382.133
48.291.455
|
|
Total capitaux propres
|
1.411.681.375
|
|
· Emprunte de dettes financières
|
165.000
|
|
Total valeurs immobilisées
|
5.498.148.002
|
4.231.907.966
|
1.266.240.036
|
Total capitaux permanents
|
1.441.846.375
|
|
VAL CIRCULANTES
· Val d'exploitation
Stock et en cours
|
537.725.690
|
-
|
537.725.690
|
Clients avances reçues
Fournisseurs d'exploita
Dettes fiscales
Autres dettes
Ecart de conversion
|
50.864.717
18.784.264
148.822.472
534.851.166
279.687.174
|
|
· Val réalisables
Fournisseur avances versé
Client
Autres créances
|
14.159.848
230.759.548
116.283.872
|
-
-
-
|
14.159.848
230.759.548
116.283.872
|
Total dettes à CT
|
1.033.099.723
|
|
|
· Val disponibles
Banque et caisse, cheque
|
279.687.174
|
-
|
279.687.174
|
|
Total valeurs circulantes
|
1.178.616.132
|
0
|
|
|
TOTAL ACTIF
|
6.676.764.134
|
4.231.907.966
|
2.444.856.168
|
TOTAL PASSIF
|
2.444.856.168
|
Source : Direction comptable de la PHL/KIABUKWA
ANNEXE 2. BILAN FINANCIER ACTIF 2020-2022
|
ACTIF
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
VAL IMMOBILISEES
· Immob incorporelles
Frais d'établissement
|
44.000.000
|
|
|
|
Total immob incorporelles
|
44.000.000
|
|
|
|
· Immob corporelles
Bâtiment
Aménagement et installa
Matériel et Mobilier
Matériel de transport
|
406.235.369
1.252.839.720
1.303.937.348
743.597.845
|
1.100.528.836
3.360.395.070
2.039.857.765
358.138.217
|
1.520.937.656
614.039.709
2.081.256.944
1.281.913.693
|
|
· · Total val immob corporel
|
3.704.610.272
|
6.858.919.888
|
5.498.148.002
|
|
Total val immobilisées
|
3.750.610.272
|
6.858.919.888
|
5.498.148.002
|
|
VAL CIRCULANTES
· Val d'exploitation
Stock marchandise
Mp et autres appro
Stock et en cours
|
2.698.980
505.170.388
-48.454.488
|
-
-
492.926.919
|
-
-
537.725.690
|
|
Total val d'exploitation
|
459.414.880
|
492.926.919
|
537.725.690
|
|
· Val réalisables
Fournisseur avances versé
Client
Autres créances
|
23.815.949
70.274.201
56.300.947
|
5.668.648
357.523.603
71.666.002
|
14.159.848
230.759.548
116.283.872
|
|
Total valeurs réalisables
|
150.389.097
|
434.858.253
|
361.203.268
|
|
· Val disponibles
Banque et caisse
|
35.267.843
|
107.073.362
|
279.687.174
|
|
Total valeurs disponibles
|
35.267.843
|
107.073.362
|
1.178.616.132
|
|
TOTAL ACTIF
|
4.395.682.102
|
7.839.778.422
|
6.676.764.134
|
BILAN FINANCIER PASSIF 2020-2022
|
PASSIF
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Capital
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice
Amortissement
|
543.007.787
128.000.425
-170.299.133
2.978.891.408
|
543.007.787
600.973.007
-32.011.704
5.605.587.790
|
543.007.787
820.382.133
48.291.455
4.231.907.966
|
|
Sous total capitaux propres
|
3.479.600.487
|
6.717.556.880
|
5.643.589.341
|
|
DETTE A LONG TERME
Emprunte de dettes financières
|
165.000
|
165.000
|
|
|
Sous total dettes à long terme
|
165.000
|
165.000
|
165.000
|
|
TOTAL capitaux permanents
|
3.479.765.487
|
6.717.721.880
|
5.643.754.341
|
|
DETTES A COURT TERME
Fournisseurs
Client avance reçues
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
|
35.267.848
3.625.822
171.830.377
705.192.568
|
10.520.926
74.949.156
145.052.473
107.103.360
838.430.360
|
18.784.264
50.864.717
148.822.472
279.687.174
534.851.166
|
|
Sous total dettes à CT
|
915.916.615
|
1.176.056.542
|
1.033.009.793
|
|
TOTAL PASSIF
|
4.395.682.102
|
7.893.778.422
|
6.676.764.134
|
BILAN FINANCIER DES GRANDS MASSES
|
ANNEES
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
ACTIF
|
MONTANT
|
MONTANT
|
MONTANT
|
|
VALEURS IMMOBILISEES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
|
44.000.000
3.706.610.282
|
-
6.858.919.888
|
-
5.498.748.002
|
|
Total valeurs immobilisées
|
3.750.610.282
|
6.858.919.888
|
5.498.148.002
|
|
VALEURS CIRCULANTES
Valeurs d'exploitations
Valeurs réalisables
Valeurs disponibles
|
459.414.880
150.389.097
35.267.843
|
492.926.919
434.858.253
107.073.362
|
537.725.690
361.203.268
279.687.174
|
|
TOTAL valeurs circulantes
|
645.071.820
|
1.034.858.534
|
1.178.616.132
|
|
TOTAL ACTIF
|
4.395.682.102
|
7.893.778.442
|
6.676.764.134
|
|
PASSIF
CAPITAUX PERMANENTS
Fonds propres
Dettes à long terme
|
3.479.600.487
165.000
|
6.717.556.880
165.000
|
5.643.589.341
165.000
|
|
TOTAL capitaux permanents
|
3.479.765.487
|
6.717.721.880
|
5.643.754.341
|
|
Dettes à court terme
|
915.916.615
|
1.176.056.542
|
1.033.009.793
|
|
TOTAL PASSIF
|
4.395.682.102
|
7.893.778.422
|
6.676.764.134
|
|
ANNEES
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
ACTIF
|
Par rapport au sous total
|
Par rapport au total actif
|
Par rapport au sous total
|
Par rapport au total actif
|
Par rapport au sous total
|
Par rapport au total actif
|
|
VALEURS IMMOBILISEES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
|
1,17
98,83
|
1,00
84,32
|
-
100
|
-
86,89
|
-
100
|
-
82,35
|
|
Total valeurs immobilisées
|
100
|
85,32
|
100
|
86,89
|
100
|
82,35
|
|
VALEURS CIRCULANTES
Valeurs d'exploitations
Valeurs réalisables
Valeurs disponibles
|
71,23
23,31
5,47
|
10,45
3,42
0,80
|
47,63
42,021
10,35
|
6,24
5,51
1,36
|
45,62
30,65
23,73
|
8,05
5,41
4,19
|
|
Sous total valeurs circulantes
|
100
|
14,64
|
100
|
13,11
|
100
|
17,65
|
|
TOTAL ACTIF
|
-
|
100
|
-
|
100
|
-
|
100
|
|
PASSIF
CAPITAUX PERMANENTS
Fonds propres
Dettes à long terme
|
99,99
0,005
|
79,16
0,0038
|
99,99
0,00245
|
85,099
0,002090
|
99,99
0,0039
|
84,53
0,0025
|
|
Sous total capitaux perman
|
100
|
79,1638
|
100
|
85,10109
|
100
|
84,53
|
|
Dettes à court terme
|
100
|
20,84
|
100
|
14,89
|
100
|
15,47
|
|
Sous total dettes à CT
|
100
|
20,84
|
100
|
14,89
|
100
|
15,47
|
|
TOTAL PASSIF
|
-
|
100
|
-
|
100
|
-
|
100
|
|
LIBELLE
|
2022
|
2021
|
2020
|
|
Ventes des marchandises
|
15.508.640
|
4.250.518
|
14.579.328
|
|
- Achats des marchandises
|
-2.900.830
|
-14.429.498
|
4.348.800
|
|
- Variation des stocks des marchandises
|
-847.221
|
-1.024.820
|
1.576.095
|
|
+ MARGE COMMERCIALE SUR MARCHAN
|
11.760.589
|
-11.203.800
|
8.654.433
|
|
+ Ventes des produits fabriqués
|
2.419.760.032
|
2.398.117.153
|
1.420.689.975
|
|
+ Produits accessoires
|
4.718.830
|
29.831.300
|
26.780.379
|
|
+ CHIFFRE D'AFFAIRES
|
2439346502
|
2.423.198.971
|
1.462.049.682
|
|
+ Produits stockée (déstockage)
|
0
|
0
|
-48.454.465
|
|
+ Autres produits
|
45.875
|
90.881
|
0
|
|
- Autres produits
|
-1.213.547.735
|
-1.054.223.555
|
737.178.935
|
|
- Variation des autres approvisionnements
|
45.745.992
|
-156.891.490
|
-123.775.616
|
|
- Transport
|
-137.319.073
|
-127.375.551
|
66.873.839
|
|
- Services extérieurs
|
-196.440.213
|
-150.964.375
|
105.695.671
|
|
- Impôt et taxes
|
-51.508.700
|
-83.881.430
|
59.873.961
|
|
- Autres charge
|
-5.892.666
|
-2.541.206
|
3.947.513
|
|
+ VALEUR AJOUTEE
|
882597682
|
849.835.384
|
367.471.852
|
|
- Charge du personnel
|
-688134778
|
-715.085.297
|
550.317.695
|
|
+ EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
|
194462904
|
134.750.087
|
-182.845.844
|
|
- Dotation aux amortissements provisions
|
-44.428.542
|
-71.738.384
|
75.831.290
|
|
+ RESULTAT FINANCIER
|
150.034.362
|
63.011.703
|
-125.014.554
|
|
+ Revenus financiers et assimilés
|
192
|
0
|
56.177
|
|
- Frais financiers et charges
assimilés
|
-77312941
|
-70.199.166
|
57.694.360
|
|
- Pertes et charges
|
0
|
0
|
114.686
|
|
+ RESULTAT FINANCIER
|
-77.312.941
|
-70.199.166
|
-57.752.869
|
|
+ RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
|
72.721.613
|
-7.187.463
|
-182.767.423
|
|
- Impôt sur le résultat
|
-24.430.158
|
24.824.241
|
12.468.290
|
|
+ RESULTAT NET
|
48291455
|
-32.011.704
|
-170.299.133
|
ANNEXE 3. COMPTE DE RESULT



