THEME : NECESSITE D'UNE REORGANISATION DES
REGIMES FISCAUX
DEROGATOIRES AU BENIN : CAS DU CI ET DU
RF/ZFI
Soutenu par : MAGBONDE
YETINGNON BARTHELEMY
IDENTIFICATION DU JURY
PRESIDENT: Pierre ADAMMADO
VICE-PRESIDENT:Sèmiou LASSISSI
MEMBRE: Josué ATTERE
L'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature n'entend
donner
aucune
approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur
.
DEDICACE
A mon père Léonard MAGBONDE, à
ma mère Marguérite TOSSA, et mon frère
Félix MAGBONDE, je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier en tout premier lieu et
très chaleureusement,
M. Eric AKAKPO-DJIHOUNTRY, administrateur des impôts en
service à la
DDET, et, M. Honorat FADJI, administrateur, membre de la
Commission Technique des Investissements en service à la DLC, qui ont
coordonné mes travaux en vue du présent mémoire. Toujours
disponibles dès la phase de recherche, mais également tout au
long de la rédaction, et ce malgré leurs responsabilités
importantes et nombreuses, ils ont su me donner des conseils précis
d'une utilité déterminante, sans pour autant m'imposer un
quelconque modèle de pensée.
Je souhaite également exprimer ma reconnaissance
particulière envers M. le Directeur Technique de l'A-ZFI, qui s'est
véritablement rendu disponible pour nous fournir quelques informations
à sa disposition.
Enfin j'adresse mes remerciements les plus sincères :
ü aux membres du jury qui ont accepté
d'apprécier ce travail et de l'enrichir par leurs observations et
contributions ;
ü à tous les personnels enseignant et
administratif et au Directeur de l'ENAM pour les efforts consentis dans le
cadre de ma formation ;
ü à tout le personnel de la DGID pour leur
contribution ;
ü à toutes les personnes qui ont accepté de
me rencontrer au titre de mes recherches ;
ü à Fèmi ADJELE ; Gertrude GBETO-DANSOU ;
ü à toutes les personnes qui, d'une manière
ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ce
mémoire.
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
ABE : Agence Béninoise pour
l'Environnement.
ABePEC : Agence Béninoise pour la
Promotion des Echanges Commerciaux.
ADEx : Association de Développement
des Exportations.
A-ZFI : Agence d'administration de la Zone
Franche Industrielle.
BOAD : Banque Ouest-Africaine de
Développement.
BCEAO : Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest.
CCI : Commission de Contrôle des
Investissements.
CCIB : Chambre de Commerce et d'Industrie du
Bénin.
CGI : Code Général des
Impôts.
CI : Code des Investissements.
CIPB : Conseil des Investisseurs
Privés au Bénin.
CNPB : Conseil National du Patronat du
Bénin.
CPI : Conseil Présidentiel de
l'Investissement.
CTI : Commission Technique des
Investissements.
DCIDAM : Direction du Centre des Impôts
de Dantokpa et des Autres Marchés.
DCIME : Direction des Centres des
Impôts des Moyennes Entreprises.
DDI : Direction Départementale des
Impôts.
DGCPI : Direction Générale du
Centre de Promotion des Investissements.
DGDI : Direction Générale du
Développement Industriel.
DGE : Direction des Grandes Entreprises.
DGID : Direction Générale des
Impôts et des Domaines.
DGR : Direction de la Gestion des Ressources.
DIE : Direction de l'Information et des
Etudes.
DIP : Département des Investissements
Privés.
DNI : Direction Nationale des
Investissements.
DNVEF : Direction Nationale de
Vérifications et d'Enquêtes fiscales.
DPI : Département Public des
Investissements.
FNI : Fonds National d'Investissement.
IGS : Inspection Générale des
Services.
IRPP : Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques.
IS : Impôt sur les
Sociétés.
MCIPPME : Ministère du Commerce, de
l'Industrie et de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises.
MDPAEEAP : Ministère du
Développement, de la Prospective, de l'Analyse Economique et
l'évaluation de l'Action Publique.
MEF : Ministère de l'Economie et des
Finances.
MFRE : Mission Fiscale des Régimes
d'Exception.
RF/ZFI : Régime fiscal de la Zone
Franche Industrielle.
RNI : Recette Nationale des Impôts.
RPI : Recette Principale des Impôts.
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine.
ZES : Zone Economique
Spécialisée.
ZFI : Zone Franche Industrielle.
LISTE DES TABLEAUXPages
Tableau n°1 : Evolution du nombre
d'entreprises candidates aux différents
régimes et zones du CI, de 2009 à
2012..............................................19
Tableau n° 2: Identification des
problématiques possibles........................28
Tableau n°3: Problématique
retenue.................................................41
Tableau n°4 : La
problématique
spécifiée..........................................34
Tableau n°5 : Tableau de bord de
l'étude...........................................41
Tableau n°6 : Evolution du nombre
d'entreprises, des emplois prévisionnels et des emplois
créés au régime général de la ZFI, de 2006
à 2011..................51
Tableau n°7 : Evolution des
emplois prévisionnels des entreprises agréées au CI
de 2007 à
2011..........................................................52
Tableau n°08 : Synthèse du
diagnostic..............................................58
Tableau n°09 : Synthèse de
l'étude.................................................73
LISTE DES GRAFIQUESPages
Graphique n°1 : Evolution du
nombre de projets d'investissements abandonnés ou non
démarrés, par période de cinq (05)
ans.................18
Graphique n°2 : Evolution de la
balance commerciale du Bénin, de 2007 à
2011.................................................................22
Graphique n°3 : Illustration du
nombre d'entreprises agréées à la ZFI, de 2007
à 2011..............................52
Graphique n°4:répartition des
données d'enquête relatives au problème de la faible
créativité du régime fiscal des investissements au
Bénin...................53Graphique n°5:
répartition des données relatives au niveau élevé
d'abandon
des projets d'investissement
agréés...................................................54
Graphique n°6 :
répartition des données d'enquête relative au cadre
juridique
peu
satisfaisant...........................................................................54
Graphique n°7 :
répartition des données d'enquête relative
à la multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements au Bénin.............55
LISTE DES ANNEXES
Annexe n°1 : Organigramme de la DGID
Annexe n°2 : Missions de quelques
structures du système des investissements
au Bénin
Annexe n°3 : Tableaux relatifs
aux graphiques n°1 et n°2
Annexe n°4 : les tableaux de
distribution des données relatives aux problèmes
spécifiques
Annexe n°5 : Questionnaire
d'enquête
GLOSSAIRE
Agrément : accord devant
être obtenu de l'Administration pour que certaines réalisations
projetées par les particuliers puissent être
exécutées, ou bénéficient d'un régime
financier ou fiscal de faveur.
Crédit d'impôt : c'est
une dette de l'Etat envers le contribuable au titre d'un impôt
donné. Dans le cadre de notre étude, c'est par le crédit
que la créance du contribuable vis à
à vis de l'Etat est reconnue. Le crédit correspond au coût de
la fiscalité indirecte liée aux prestations et est
matérialisé par la délivrance d'un certificat de
crédit dénommé MP2 accompagné de la remise d'un
formulaire MP3 qui permet au contribuable de régler ses impôts.
vis de l'Etat est reconnue. Le crédit correspond au coût de
la fiscalité indirecte liée aux prestations et est
matérialisé par la délivrance d'un certificat de
crédit dénommé MP2 accompagné de la remise d'un
formulaire MP3 qui permet au contribuable de régler ses impôts.
Exonération : elle est
définie par le lexique fiscal comme une dispense totale ou partielle
d'impôt sous certaines conditions fixées par la loi pour des
motifs variés (le plus souvent d'ordre économique et social).
Impôt: Prestation
pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de droit
privé ou éventuellement de droit public par voie
d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie
déterminée en vue de la couverture des charges publiques de
l'Etat et des collectivités locales, d'intervention économique et
sociale. Incitations fiscales à
l'investissement: ce sont les dispenses accordées aux
investisseurs dans le but de promouvoir l'investissement.
Investissement : au sens
étroit, acquisition de biens de production en vue de l'exploitation
d'une entreprise et de dégager un revenu ou une augmentation de la
capacité de production. Au sens large, acquisition d'un capital en vue
d'en percevoir ou d'en consommer le revenu. Au sens particulier et familier,
l'investissement est synonyme de placement, de mise en réserve d'un bien
de consommation durable en vue de sa revente ou de sa consommation
ultérieure.
Dans cette étude, l'investissement tout court doit
s'entendre investissement privé.
Méthode des quotas : une technique
statistique consistant à subdiviser la population étudiée
en de sous-ensembles de classes que l'on peut distinguer à partir des
caractères communs et connus.
Normes ISO: Publiées par l'ISO
(International Standards Organization) en 1987, les normes de la série
ISO 9000 sont des normes internationales d'?assurance de la
qualité» devenues normes nationales dans les différents pays
de l'Union Européenne à la suite de leur adoption par le
Comité Européen de Normalisation.
Régimes d'exception : ce sont
des allègements fiscaux, des exonérations hors Code
Général des Impôts (CGI), hors Code des Douanes (CD). Ils
sont également prévus par le Code des Investissements (CI), le
régime général de la zone franche industrielle, les
dispositions conventionnelles, les accords bilatéraux.
Système : ensemble
cohérent plus ou moins complexe, composé d'un nombre
déterminé de structures ou d'éléments souvent
divers reliés à un plan commun ou concourant à un but
commun ; ou ensemble des dispositifs ou des solutions mise en oeuvre en vue
d'atteindre un objectif donné ou encore ensemble d'organes ou de
structures reliées de telle sorte qu'ils puissent accomplir , en
étroite coopération, une certaine fonctions.
Variable de contrôle : c'est la
variable qui sert à subdiviser la population mère en de
sous-ensembles en utilisant la méthode des quotas.
Zone Franche Industrielle : Espace
économique enclavé, délimité
géographiquement ou sectoriellement, bénéficiant de
privilèges dans le domaine fiscal et de contraintes réduites pour
les réglementations et les procédures administratives. Les
principales zones franches sont : Hong Kong, Singapour, Kao shium (T'ai-Wan)
RESUME
Les finances publiques se portent mal. Aucun pays ne
connaît désormais d'excédent budgétaire. Un moindre
déficit constitue le maximum possible de vertu. Dans ce contexte, il
faut aller à la recherche des ressources budgétaires ; le budget
étant le moteur des politiques publiques dans toute démocratie.
L'une des composantes essentielles de ces ressources est la fiscalité,
un instrument de choix pour un pays comme le Bénin.
Nul doute que la finalité de l'action gouvernementale
est le développement économique et social de la Nation. Dans une
économie libérale, un tel essor n'est pas l'apanage ou la
préoccupation exclusive de l'Etat : il faut noter le concours de
certains acteurs tels que les opérateurs économiques, les
entrepreneurs ou des investisseurs comme il est convenu de les appeler. C'est
dire que la situation des investissements privés est déterminante
dans la quête du bien-être collectif convoité.
L'Etat doit alors gérer deux intérêts
antagoniques : rechercher à travers la fiscalisation le maximum de
ressources pour financer ses politiques, et permettre aux investisseurs
d'atteindre leur principal but, le profit. Comment concilier ces deux
intérêts sans porter préjudice ni à l'un ni à
l'autre ? Le Bénin a une formule : encadrer, réglementer,
légiférer, déroger. C'est ce qui ressort notamment de la
consécration du code des investissements et du régime
général de la zone franche industrielle. Mais les
retombées escomptées se font toujours attendre, les acteurs se
plaignent et les populations reçoivent le coup.
Le problème est devenu très préoccupant
et il faut opérer un choix décisif. Dans ces circonstances, nous
nous sommes intéressé à la problématique de la
dynamisation du système des investissements au Bénin, à
travers le thème « Nécessité d'une
réorganisation des régimes dérogatoires au Bénin :
cas du CI et du RF/ZFI ».
Le problème général qu'il convient de
résoudre ici est le caractère peu dynamique du système des
investissements au Bénin. Quatre problèmes spécifiques ont
été identifiés. Il s'agit :
- de la faible créativité du régime
fiscal des investissements au Bénin ;
- d'un cadre juridique peu satisfaisant ;
- du niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés, et
- de la multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements.
Nous nous sommes alors fixé des objectifs. En
général, dynamiser le système des investissements au
Bénin, et de façon spécifique, proposer les conditions
requises pour un régime fiscal productif des investissements ;
déterminer les mesures idoines à prendre pour la survie des
projets agréés; relever les obstacles réglementaires
inhibant l'attraction des capitaux, et enfin contribuer à la mise en
place d'une structure simplifiée et autonome de gestion des
investissements. A cet effet, des hypothèses ont été
formulées et une enquête a été diligentée
dans le but de vérifier les hypothèses émises.
De l'analyse des données d'enquête, les causes
réelles des problèmes spécifiques ont été
découvertes et il ressort que :
- la faible créativité du régime fiscal
des investissements au Bénin est engendrée par la non-garantie
des déterminants de l'investissement et la pluralité des
régimes d'exception ;
- le défaut de financement et surtout le coût
élevé de procédures doublé des faux frais sont
à la base du niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés ;
- le cadre juridique peu satisfaisant résulte de la
lourdeur de la procédure d'agrément et de l'absence de certains
règlements d'application;
- l'inefficacité de la stratégie
managériale des investissements a donné lieu à une
multiplicité de structures intervenant dans le système.
Ce diagnostic étant établi, nous sommes à
même de proposer des solutions susceptibles d'anéantir les
problèmes handicapants. C'est justement ce à quoi est
consacré le deuxième chapitre du présent document.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE PRELIMINAIRE :CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ETUDE,
OBSERVATIONS
DE STAGE ET CIBLAGE DE LA
PROBLEMATIQUE.......................................... 2
SECTION1 : Cadre institutionnel et restitution des observations
de stage................... 6
Paragraphe1 : Présentation de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines (DGID) ......6
Paragraphe2 : Etat des lieux sur la fiscalité des
investissements au Bénin ......................15
SECTION2 : Ciblage de la
problématique...................................................... 27
Paragraphe1 : Choix de la problématique et justification
du sujet..................................... 27
Paragraphe2 : Spécification de la problématique et
détermination des séquences de résolution de la
problématique spécifiée.................
....................................................32
CHAPITRE PREMIER 36
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DU CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE DE
L'ETUDE...................................................... 36
SECTION1 : Cadre théorique et méthodologique de
l'étude................................... 37
Paragraphe1 : Cadre théorique de
l'étude....................................... ...................37
Paragraphe2 : Choix de la méthodologie de
recherche.................................................46
SECTION2 : Collecte des données et établissement
du diagnostic...................... 49
Paragraphe1 : Mobilisation des données, difficultés
rencontrées et limites des données.. ...... 49
Paragraphe2 : Analyse des données et établissement
du diagnostic....................................51
CHAPITRE DEUXIEME :
POUR LA DYNAMISATION DU SYSTEME DES INVESTISSEMENTS AU
BENIN....59
SECTION 1 : Réflexions
suggestives............................................................... 60
Paragraphe 1 : Approches de solutions aux problèmes
spécifiques n°1 et n°2 .................... 60
Paragraphe 2: Approches de solutions aux problèmes
spécifiques n°3 et n°4 ..................... 67
SECTION 2 : Plaidoyer pour l'opérationnalisation des
solutions proposées................... 70
Paragraphe 1 :
Recommandations.........................................................................70
Paragraphe 2 : Synthèse de
l'étude............................................................................73
CONCLUSION
GENERALE.................................................................. 76
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................
77
ANNEXES......................................................................................
80
TABLE DES
MATIERES.........................................................................
88
Nécessité d'une réorganisation des
régimes fiscaux dérogatoires au Bénin : cas du CI et du
RF/ZFI
INTRODUCTION GENERALE
Les voix s'accordent désormais. Les acteurs sociaux,
les théoriciens de l'analyse économique, les praticiens du droit
fiscal corroborent : « la fiscalité est et demeure l'un des
instruments privilégiés de politique économique et de
politique sociale, donc de développement d'une Nation». Le souci
majeur de tout gouvernement responsable étant le bien-être
individuel et collectif de tous les citoyens, le véritable
développement économique et social s'illustre, audelà d'un
voeu chèrement formulé, comme une préoccupation cardinale
des pouvoirs publics. Plus qu'une spécificité béninoise,
la préoccupation a pris une ampleur communautaire. Et, depuis quelques
décennies, au Bénin comme ailleurs dans la sous-région,
les politiques publiques renferment des orientations structurelles et
stratégiques focalisées sur les déterminants de la vie
économique notamment l'investissement public et surtout privé. Le
poids économique de l'investissement n'étant plus à
démontrer, le maîtriser et le cerner sous ses divers aspects, le
rêve ne serait pas absurde de voir prospérer une économie
avec une croissance à deux (02) chiffres.
Dans cette optique, le Bénin a, dès
1990, procédé à l'édition d'un code des
investissements (CI) et, à partir de 1999, institué une zone
franche industrielle (ZFI) définitivement consacrée en 2005. Il
s'agit en fait des textes législatifs relatifs aux investissements
privés dans leurs aspects les plus diversifiés. Pour exercer un
effet magnétique sur les investisseurs, certaines dispositions de ces
régimes ont accordé des faveurs par rapport droit commun en
matière de fiscalité : c'est la dérogation fiscale.
Les principaux objectifs poursuivis par la
République du Bénin en instituant ces régimes
dérogatoires, sont, entre autres, la promotion et la diversification des
exportations, l'amélioration et le redressement de la balance
commerciale et celle des paiements, les gains en devises, le
développement des services de la sous-traitance, la création
d'emplois, la valorisation des ressources locales, la mise en oeuvre de la
politique d'aménagement du territoire par l'implantation
d'activités dans les zones économiquement moins
développées.
Aujourd'hui, force est de remarquer que, malgré les
efforts accomplis depuis les années 1990 en passant par 1999, ces
régimes d'exception semblent ne pas jouer convenablement le rôle
qu'on était en droit d'attendre d'eux. En effet, les résultats
sont toujours mitigés et les efforts ne sont pas perceptibles sur
l'économie béninoise.
Les décideurs politiques s'accordent pour
reconnaître une faible contribution du secteur secondaire à la
formation du PIB alors que l'industrialisation est réputée pour
être un vecteur privilégié pour la promotion de l'emploi.
Le problème est d'autant plus aigu, dans un contexte
caractérisé par une balance commerciale structurellement
déficitaire doublé d'un cortège de crises, que le
gouvernement a dû convoquer une table ronde pour un partenariat public/
privé afin d'asseoir les bases d'un développement participatif
à travers un cadre fiscal propice au monde des investissements et ne
pénalisant pas les recettes budgétaires.
Réfléchissant dans ce sens, nous avons
décidé de mener une étude sur la nécessité
d'une réorganisation des régimes fiscaux dérogatoires au
Bénin notamment le CI et le régime fiscal de la ZFI. Ce faisant,
nous comptons apporter notre contribution à la dynamisation du
système des investissements dans le double objectif de procurer des
ressources budgétaires nécessaires à la vie de la
cité et de garantir le développement du secteur privé.
Cette étude s'articule autour de trois (03) chapitres
fondamentaux : un chapitre préliminaire consacré à la
restitution des observations de stage suivie du ciblage de la
problématique après une brève présentation du cadre
institutionnel et physique de recherche ; le chapitre 1er aborde le
cadre théorique et méthodologique de l'étude à
travers sa conception et sa mise en oeuvre, et , enfin le chapitre
2ème traite des approches pratiques de solutions ainsi que
des recommandations subséquentes pour une meilleure efficacité
des solutions proposées.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ETUDE,
OBSERVATIONS DE STAGE ET CIBLAGE
DE LA PROBLEMATIQUE
Après la restitution des observations de stage à
travers le cadre institutionnel en première partie, la section
deuxième abordera le ciblage d'une problématique retenue.
SECTION1 : Cadre institutionnel et restitution des
observations de stage
Notre stage pratique s'est déroulé au sein
d'une structure qui mérite d'être présentée et des
observations sont faites sur le dispositif et le fonctionnement d'un
système.
Paragraphe1 : Présentation de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines (DGID)
Avant une présentation sélectionnée de
quelques structures, la DGID sera d'abord présentée dans sa
généralité.
I- Description générale de la
DGID
La description générale de la DGID se fera
à travers son historique, son organisation, ses attributions et ses
missions.
A°) Historique et organisation de la
DGIDLa DGID a une histoire et une organisation bien
structurée.
1-) Historique
Une des directions techniques du Ministère de
l'Economie et des Finances (MEF), la DGID a connu une évolution dans le
temps. De « Services des Contributions Directes » à la DGID,
des mutations ont été opérées.
Depuis l'accession du Bénin à
l'indépendance jusqu'en 1968, l'organisation de l'administration fiscale
a été caractérisée par l'existence de deux services
: le Service des Contributions Directes(SCD) localisé dans l'actuel bloc
administratif des impôts de l'avenue Monseigneur Steinmetz, et le Service
de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre (SEDT) situé à
GANHI. Le SCD a été renommé « Direction des
Impôts » (DI) par le décret n°215 /PR/MFAE du 26 juin
1967 et, à son tour, le SEDT est transformé en
« Direction de l'Enregistrement, des Domaines et du
Timbre » (DEDT). C'est au cours de l'année 1968 que se
réalisera la fusion des deux directions avec la création de la
Direction Générale des Impôts (DGI). En 1993, la DGI est
érigée en DGID aux termes du décret n°93-44 du 11
mars 1993.
2°) Organisation de la DGID La
DGID regroupe trois grandes catégories de direction :
ØLes Directions Techniques ou
Opérationnelles à compétence territoriale.
Il s'agit de la Direction du Centre des Impôts de
Dantokpa et des
Autres Marchés (DCIDAM) puis des six (06)
Directions
Départementales des Impôts (DDI) que sont :
- la Direction Départementale des Impôts de
l'Atacora et de la Donga (DDIAD) ;
- la Direction Départementale des Impôts de
l'Atlantique et du Littoral (DDIAL) ;
- la Direction Départementale des Impôts du
Borgou et de l'Alibori (DDIBA) ;
- la Direction Départementale des Impôts du Mono
et du Couffo (DDIMC)
- la Direction Départementale des Impôts de
l'Ouémé et du Plateau (DDIOP) ;
- la Direction Départementale des Impôts du Zou
et des Collines (DDIZC).
ØLes Directions Techniques ou
Opérationnelles à compétence nationale.
Il faut compter ici :
- la Direction des Centres des Impôts des Moyennes
Entreprises (DCIME) ;
- la Direction des Domaines de l'Enregistrement et du Timbre
(DDET) ;
- la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ;
- la Direction Nationale de Vérification et
d'Enquêtes Fiscales (DNVEF);
ØLes Directions centrales.
Elles sont au nombre de sept (7). Nous citons :
- le Centre de Formation Professionnelle des Impôts
(CFPI) ;
- la Direction de la Gestion des Ressources (DGR) ;
- la Direction de l'Information et des Etudes (DIE) ;
- la Direction de la Législation et du Contentieux
(DLC) ;
- l'Inspection Générale des Services (IGS) ;
- la Mission Fiscale des Régimes d'Exception (MFRE) ;
-la Recette Nationale des Impôts (RNI).
B°) Attributions et
missions
Les missions de la DGID relèvent d'un certain nombre
d'attributions.
1°) Attributions
Il est important de mettre en exergue d'abord les
compétences de la DGID.
Conformément aux dispositions de l'article 1er
de l'arrêté n°112/MEF/DC/SGM/DGID du 17 février
2009, la Direction Générale des Impôts et des domaines
(DGID) est compétente pour ce qui concerne :
- le domaine privé de l'Etat ;
- les droits d'enregistrement et de timbre ainsi que les taxes
assimilées ;
- la gestion des biens vacants ou placés sous
séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté
générale ;
- les impôts directs et taxes assimilées ;
- les impôts indirects et taxes assimilées autres
que ceux exigibles au cordon douanier, et
- l'organisation et la conservation de la
propriété et des droits fonciers.
Ainsi, aux termes de l'arrêté
n°112/MEF/DC/SGM/DGID du 17 Février 2009 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la DGID, cette dernière a pour
attributions :
ï le contrôle fiscal ;
ï la conservation foncière, des hypothèques
et autres droits fonciers ;
ï la détermination de l'assiette, la liquidation,
le contrôle et le contentieux de tous les impôts et taxes
prévus au Code Général des Impôts ;
ï la gestion du domaine privé de l'Etat et,
ï le recouvrement et le reversement au Trésor
Public des impôts et taxes ainsi que des redevances domaniales et des
taxes annexes.
2°) Missions
La DGID est investie de trois missions principales :
ï Une mission
financière
Elle consiste à procurer des ressources
financières à l'Etat en vue de la couverture des dépenses
publiques. Cette mission se matérialise par les attributions de la DGID
en matière d'assiette, de contrôle et de recouvrement des
impôts.
ï Une mission
socio-économique
En raison des effets palpables des recettes fiscales sur
l'économie nationale, il doit être remarqué que la DGID a
une mission économique et sociale, à travers sa contribution
à la réalisation des objectifs économiques et sociaux du
gouvernement. L'impôt recouvré par la DGID joue le rôle de
pompe aspirante et foulante. Ainsi, les riches sont lourdement imposés
afin d'octroyer des allocations sociales aux plus démunis à
travers les bourses et secours octroyés aux étudiants, sans
oublier les diverses primes aux fonctionnaires. C'est dans ce cadre qu'il est
prévu chaque année au budget de l'Etat, des lignes de
crédits pour les indigents, ainsi que pour la lutte contre le paludisme,
l'électrification des zones rurales et la fourniture d'eau potable dans
les zones les plus reculées.
Toutes ces actions sociales visent la réduction de la
pauvreté et des inégalités. De même, l'Etat peut
à travers l'impôt taxer ou détaxer un produit pour
décourager ou en faire la promotion.
La DGID ne se contente pas seulement de renflouer les caisses
de l'Etat ; elle participe aussi au programme d'ajustement structurel qui vise,
avant tout, la réalisation des objectifs macroéconomiques de
l'Etat. Ainsi, le niveau général des recettes
réalisées par la DGID conditionne-t-il le niveau des
décaissements, des prêts, dons ou aides accordés par les
partenaires que sont le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque
Mondiale, le Club de Paris, la Banque Africaine de Développement (BAD),
la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD),...
?Une mission politique
La réalisation des objectifs macroéconomiques
par la DGID permet non seulement au Bénin de respecter les
critères de performance du 1er et du
2èmeordres exigés par la
communauté internationale et l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), mais aussi de renforcer la crédibilité
de l'Etat vis-à-vis des partenaires au développement. Cela
constitue un enjeu majeur pour tout gouvernement.
II- Présentation ciblée des structures
intervenant dans lesystème en observation.
Il s'agit ici d'une brève présentation de la
DLC, de la MFRE et de la RPI/DGE.
A°) Description de la DLC et de la
MFRE
Scindée en deux, la rubrique comporte une
présentation de la DLC et une présentation de la MFRE.
1°) Présentation de la
DLC
Il convient d'examiner ici les attributions et l'organisation
de la structure.
ØAttributions
La DLC, de par sa dénomination, est compétente
en matière de législation fiscale et des contentieux relatifs aux
impôts émis, liquidés et recouvrés par la DGID.
Nommé par arrêté ministériel, et
sur proposition du Directeur Général des Impôts et des
Domaines, le Directeur de la Législation et du Contentieux a des
charges. Celles-ci résultent des attributions de la DLC. Il s'agit de :
- la codification et la mise à jour permanente du Code
Général des Impôts
(CGI) et du Livre des Procédures Fiscales (LPF) ;
- la diffusion de la documentation fiscale et la
présentation des campagnes d'information à l'intention des
contribuables en collaboration avec la DIE ;
- l'élaboration des avant-projets de textes fiscaux ;
- l'élaboration des textes d'application en toutes
matières fiscales ;
- le traitement et l'instruction de tous les dossiers de
réclamation et de recours gracieux à l'exception des demandes en
décharge ou en réduction d'impôts locaux dont le montant se
trouve dans la limite des compétences déléguées aux
DDI.
ØOrganisation
La DLC comporte deux services que sont le Service du
Contentieux (SC), et le Service de la Législation et de la Documentation
(SLD).
Le SLD est compétent pour l'élaboration des
avant-projets de textes fiscaux ; la codification et la mise à jour du
CGI et du LPF ; la préparation des campagnes d'information ; la
collecte, le traitement, la mise à jour et la diffusion de la
documentation. Quant au SC, il s'occupe de l'instruction et du traitement de
tous les recours gracieux et de toutes les réclamations à
l'exception de ceux relevant de la compétence des DDI. Il assure
également le contrôle des états de
dégrèvements, le suivi des instances introduites auprès
des juridictions compétentes en liaison avec la RNI et l'Agence
Judiciaire du Trésor (AJT).
2-) Présentation de la MFRE
La présentation de la MFRE est focalisée sur son
organisation et son historique.
ØHistorique de la MFRE
Toute entreprise dans l'exécution des Marchés
Publics à financement extérieur avant 1992 pouvait
bénéficier de l'achat des biens et services hors taxe (HT) en ce
qui concerne toutes les catégories d'impôts après toute
demande préalablement adressée au niveau de chaque
ministère bénéficiaire dudit marché. Cette
procédure d'octroi des exonérations confuse et frauduleuse a
très tôt entraîné une baisse des recettes fiscales et
occasionné d'énormes désagréments dans la gestion
des finances publiques.
Face à la crise économique et financière
qui secouait le Bénin à
l'époque, d'importantes réformes ont
été entreprises dans le but de :
- connaître le coût des exonérations
accordées dans le cadre de la réalisation des Marchés
Publics ;
- mieux contrôler et de limiter le volume des
exonérations octroyées.
Compte tenu de l'expérience plus ou moins fructueuse
de la Mission Fiscale des Marchés Publics (MFMP), le gouvernement a
décidé d'étendre cette procédure d'obtention de
crédit intérieur et douanier à tous les autres
régimes d'exception.
La procédure MP a été étendue
à tous les autres régimes d'exception suite à la signature
de l'arrêté n° 236/MF/DC/DGID/DGDDI/MFMP du 17 septembre
1996. En effet, les régimes d'exception sont des avantages ou
allègements fiscaux hors CGI et hors Code des Douanes répondant
à une procédure particulière visant à faire prendre
en charge par l'Etat certains impôts et taxes dus par les
bénéficiaires.
Les régimes d'exception actuellement en vigueur sont :
ï Les exonérations traditionnelles
Ce type d'exonération est accordé aux
entreprises postulant à un marché public à financement
extérieur sous forme d'un crédit d'impôt équivalant
au coût de la fiscalité indirecte intérieure et
douanière (TVA, Droit de Douane et Taxe ad valorem) assise sur les
matériels et équipements ou matériaux nécessaires
à l'exécution des marchés ou à la
réalisation des projets qui, à terme resteront la
propriété du maître d'ouvrage.
ï Les exonérations classiques
Les exonérations classiques existaient bien avant la
création de la MFMP et relèvent de la Convention de Vienne de
1961 qui concerne les représentations diplomatiques et consulaires, les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales, etc.
ï Les exonérations sur intrants agricoles
Dans le souci de promouvoir le secteur agricole, l'Etat a
élargi les exonérations aux intrants agricoles.
ï Les exonérations sur titres de concours
consolidés de la
BCEAO
Elles portent sur les titres d'Etat émis sous la
supervision de la BCEAO par le Trésor Public des Etats membres de
l'UEMOA. Les intérêts de ces titres cédés aux
institutions financières et personnes physiques devraient être
passibles de l'IRPP/RVM et de l'impôt sur les Sociétés
(IS). Mais, sur décision des Etats membres de l'UEMOA, les revenus de
ces titres sont exonérés desdits impôts.
ØOrganisation et attributions
La MFRE, conformément à la note de service
n°129 / MF/DGID/
MFMP du 15 novembre 1995, devrait normalement disposer d'un
Secrétariat Administratif et de deux sections à savoir la Section
Exonération et la Section Administrative et Législative.
- La Section Exonération comporte la Division Etude
Exonération Classique et MP et la Division Crédit.
- La Section Administrative et Législative comporte la
Division Etude Contrats et Marchés et la Division Archives et Courriers.
Compte tenu de l'insuffisance des moyens humains et
matériels, l'organigramme établi par la note de Service ci-dessus
citée n'est pas totalement fonctionnel.
La MFRE est chargée de la gestion des
exonérations sur les marchés publics à financement
extérieur et des autres régimes d'exception accordés sur
le territoire national.
Elle s'occupe également de l'étude des projets
de marchés et contrats ainsi que de la représentation de la DGID
dans les commissions de dépouillement des offres en ce qui concerne les
marchés publics.
B°) Description de la RPI/DGE
1°) Organisation de la RPI/DGE
La RPI est dirigée par un comptable public ayant au
moins 10 ans d'ancienneté et nommé par arrêté du
Ministre chargé des Finances sur proposition du DGID. Elle dispose de
quatre (04) divisions à savoir :
- la Division Recouvrement ;
- la Division Comptabilité ;
- la Division Caisse ;
- la Division Recette d'ordre.
Il est à noter que c'est la Division Recette d'ordre
qui s'occupe de la gestion des crédits d'impôts notamment ceux
liés aux exonérations.
(1) Attributions de la RPI/DGELa RPI a
pour attributions :
- le recouvrement des impôts et taxes
gérés par la DGE ;
- la gestion des crédits d'impôts notamment ceux
liés aux exonérations ;
- la poursuite des contribuables réfractaires et
l'établissement des cotes irrécouvrables.
Paragraphe2 : Etat des lieux sur la fiscalité des
investissements au Bénin.
Il nous revient d'examiner dans cette rubrique quelques
régimes fiscaux dérogatoires avant de procéder à
l'inventaire des forces et faiblesses qui s'y dégagent.
I°) Examen de quelques régimes fiscaux
dérogatoires
Nous nous sommes intéressés ici au Code des
Investissements (CI) du Bénin et au Régime Fiscal de la Zone
Franche Industrielle (RF/ZFI).
A-) Constats au niveau du CI et de la ZFI
Des observations sont faites à travers les
procédures, l'organisation structurelle et réglementaire.
1°) Observations relatives au CI
Le système des investissements est régi au
Bénin par deux textes fondamentaux : la loi n°90-002 du 09 mai
1990, portant code des investissements en République du Bénin et
la loi n°2005-16 du 08 septembre
2005, portant régime général de la ZFI.
Le CI, à l'instar du Régime général de la ZFI,
renferme des dispositions, a priori, favorables à l'investissement.
L'existence de ces mesures incitatives devrait susciter un
engouement à l'investissement susceptible d'induire le
développement économique et social du Bénin.
Nous aborderons ici les points les plus essentiels des
avantages fiscaux du CI. Outre le régime spécial, le CI comporte
cinq (5) régimes privilégiés dénommés A, B,
C, D et E. Ces différents régimes donnent droit à la fois
à des avantages au cordon douanier et des privilèges en
régime intérieur. Au cordon douanier, pour tous les
régimes privilégiés, nous avons généralement
une exonération des droits et taxes d'entrée à l'exception
de la taxe de voirie et de la taxe statistique (sur les machines,
matériels et outillages destinés spécifiquement à
la production et à l'exportation dans le cadre du programme
agréé ; les pièces de rechanges spécifiques aux
équipements dans la limite d'un montant égal à 15% de la
valeur CAF des équipements), et une exemption des droits et taxes de
sortie, applicables aux produits préparés, manufacturés et
exportés par l'entreprise.
En régime intérieur, nous avons globalement une
exonération de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
(IRPP) ou de l'Impôt sur les Sociétés (IS), qui
s'étend sur une durée de cinq (5) ans, sept (7) ans ou neuf
(9) ans en fonction de la zone d'installation. Mais, un
traitement particulier est réservé aux investissements lourds et
structurants. Notons au passage que d'autres exonérations sont
accordées sous un régime dit hors codes (H.C.), non
consacré par le CI. Ce régime institué par voie
réglementaire viole l'article 98 de la constitution béninoise du
11 décembre 1990 qui stipule expressément que l'impôt est
du domaine de la loi. On comprend alors que la charge que constituent les
exonérations sera lourde pour l'Etat parce que se traduisant par des
dépenses fiscales, dépenses dont l'efficacité
demeure jusqu'ici incertaine ; ceci participe de l'aggravation du
déficit budgétaire.
L'agrément à l'un quelconque des régimes
suit une procédure définie.
Conformément aux dispositions des articles (art.) 24
à 30 du CI, le dossier d'agrément, constitué en vingt (20)
exemplaires, doit être déposé au ministère du
plan1 après l'autorisation préalable d'installation
délivrée par le ministre dont dépend l'activité
projetée. Après l'avis de la Commission Technique des
Investissements (CTI) et sur proposition du ministre du plan, le
Président de la République décrète ou non
l'agrément dans un délai de deux
(2) mois à compter de la date de dépôt du
dossier complet. L'entreprise agréée notifie l'achèvement
du programme d'investissement à la Commission de Contrôle des
Investissements (CCI) et un arrêté conjoint est pris pour
constater cet achèvement. Dans la pratique, il est aisé de
constater que le nombre d'entreprises qui se portent candidates
à cette procédure est en baisse. Sur le nombre
d'entreprises qui optent ou qui sont agréées aux régimes
privilégiés, très peu parviennent à démarrer
l'investissement prévu.
Le comble est que nous assistons, comme l'illustre le
graphique suivant, à une évolution de plus en plus
croissante des projets agréés mais abandonnés.
11 Actuel ministère du développement, de
la prospective et de l'analyse économique.
Graphique n°1 : Evolution du
nombre de projets d'investissements abandonnés ou non
démarrés, par période de cinq (05) ans1(*).
0
10
20
30
40
50
1991
à
1995
1996
à
2000
2001
à
2005
2006
à
2010
Total des abandons/non
démarrés
Total des abandons/non
démarrés
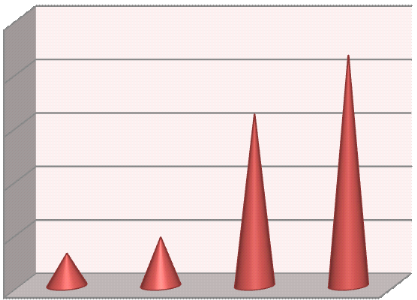
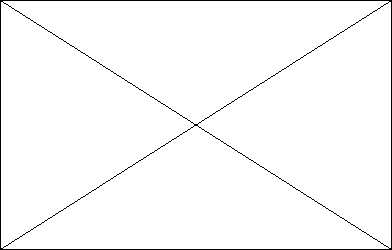
Source : Centre de Promotion des
Investissements
Par ailleurs, il à noter qu'après la
zone1, c'est la zone 3 qui accueille plus de candidats ; ce
qui pourrait permettre, à long terme, un développement
équilibré du territoire national. Le CI (en son
art.53) ne tolère pas la prorogation d'agrément
et fait obligation aux entreprises agréées d'exercer cinq (5) ans
au moins après expiration de l'agrément. Pour garantir le respect
des obligations, le code 3 a prévu des sanctions en
cas d'infractions. Toutefois, le système demeure
incapable à promouvoir l'investissement de masse ; une
incapacité qui se traduit par une quasiinexistence de candidats
aux régimes privilégiés D et E, et sur la zone 2.
Le tableau ci-dessous rend compte de cet état de chose.
Tableau n°1 : Evolution du nombre
d'entreprises candidates aux différents régimes et zones
du CI, de 2009 à 2012.
|
1
|
2
|
3
|
Zones
|
Régimes
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
Spécial
|
H.C
|
Total
|
|
Années
|
|
13
|
-
|
9
|
2009
|
8
|
11
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
22
|
|
9
|
1
|
5
|
2010
|
6
|
7
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
15
|
|
7
|
1
|
2
|
2011
|
5
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
13
|
2
|
7
|
2012
|
4
|
4
|
5
|
-
|
-
|
1
|
8
|
22
|
Source : Centre de promotion des
investissements, 2012
Exemple de lecture dans le tableau :
En 2009, parmi les 22 entreprises candidates pour l'agrément, 13 ont
choisi la zone 1 et 09 la zone 2. De même, 08 ont opté pour le
régime A, 11 pour le régime B et 03 pour le régime
spécial.
2°) Observations relatives à la
ZFI
La ZFI est administrée par une société
anonyme baptisée « Agence d'administration de la ZFI » (A-ZFI)
dans laquelle l'Etat est actionnaire.
Peuvent bénéficier du régime de la ZFI,
les entreprises et promoteurs de zone qui remplissent un certain nombre de
conditions prévues par la loi n°2005-16 du 8 septembre 2005. La
procédure d'agrément est réglementée. Ainsi, en
vertu des dispositions du chapitre VIII de la loi susmentionnée, tout
candidat désireux de bénéficier du régime doit
déposer un dossier en trois (3) exemplaires à l'A-ZFI. Le dossier
sera ensuite affecté à la commission d'agrément dont le
secrétariat est assuré par la Direction Générale du
Développement Industriel (DGDI) au Ministère du Commerce et de
l'Industrie (MCI). A la réception du dossier, le secrétariat de
la commission délivre un récépissé de
conformité du dossier. Un arrêté interministériel
est élaboré pour agréer ou non, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de délivrance du
récépissé, en ce qui concerne la zone
géographiquement délimitée. Ce délai est de
quarante-cinq(45) jours pour les points francs. Nous pouvons déjà
remarquer qu'entre le dépôt des dossiers et la délivrance
du récépissé de conformité, il n'est fait
mention d'aucun délai. L'entreprise agréée
dispose d'un délai de six (6) mois pour amorcer la phase d'installation,
à compter de la notification de l'agrément (art.47 du
décret n°2003-400 du 13 octobre 2003). Passé ce
délai, l'entreprise est mise en demeure de régulariser sa
situation dans un délai de soixante (60) jours au risque d'un retrait de
son agrément. Dans tous les cas, la période d'installation ne
doit pas excéder trente (30) mois. Ces dispositions sont difficilement
mises en application et les délais ne sont presque jamais
respectés avec un véritable retard dans
l'élaboration et la signature de l'arrêté
interministériel. Une fois la procédure achevée,
l'entreprise agréée se voit accordée des privilèges
douaniers, des allègements fiscaux en régime intérieur et
des garanties, auxquels s'ajoute la « facilité de guichet unique
» qui permet à l'investisseur d'opérer dans un
environnement dégagé de contraintes bureaucratiques. De
plus l'A-ZFI est un auditeur et un assistant permanent des contribuables
agréés à la ZFI.
Au titre des avantages fiscaux, les entreprises
agréées au régime de la ZFI bénéficient,
à compter de la date de démarrage de leurs activités :
ï d'une exonération de l'IRPP ou de l'IS pendant
les 10, 12, et 15premières années à compter de la date
d'obtention de l'agrément, respectivement pour les zones
géographiquement délimitées 1, 2 et 3 prévues
à l'article 2 de la loi portant sur le régime
général de la ZFI au Bénin ;
ï d'une réduction de l'IRPP ou de l'IS au taux de
20% pendant cinq (05) ans à compter de la 11ème,
13ème et 16ème année respectivement
pour les zones 1, 2 et 3 ;
ï d'une réduction du versement patronal sur
salaires (VPS) au taux de 4% pendant les cinq (05) premières
années d'exercice ;
ï exonération de la patente pour une durée
de dix (10) ans ;
ï d'une exonération de l'impôt sur les
propriétés bâties et non bâties pour une durée
de dix (10) ans ;
ï d'une réduction au taux de 5% de l'impôt
sur le revenu des valeurs mobilières pendant les Cinq (05)
premières années d'exercice ;
ï d'une exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pendant la durée de l'agrément sur les
livraisons de produits semi-finis ou semi-ouvrés, les emballages, les
livraisons faites à soi-même dans la mesure où elles
s'intègrent au processus de production, et sur les travaux et services
fournis pour le compte de l'entreprise agréée au régime de
la ZFI.
Pour les activités liées au régime de la
ZFI, les promoteurs de zone bénéficient, en plus des cinq(5)
premiers points énumérés ci-dessus, d'une
exonération de l'impôt sur le revenu des créances et de
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pendant les cinq (5)
premières années d'exercice, et d'une exemption de la TVA sur les
achats des biens nécessaires à l'aménagement, la
construction et l'équipement de leur zone. Au sujet des avantages
fiscaux, s'agissant de la réduction du VPS au taux de 4%, l'article 214
du CGI dispose que le taux du VPS est de 4% et est réduit à 2%
pour les
Etablissements d'Enseignement privés. L'on ne saurait
donc parler d'une réduction d'autant plus que le taux du droit commun
est de 4%. De même l'article 53 du CGI inclut le Revenu des Valeurs
Mobilières (RVM) dans l'une des catégories de revenus passibles
de l'IRPP, et donc soumis au barème à taux progressif de 0%
à 45% (art. 138 du CGI). C'est dire qu'une réduction au taux de
5% de l'IRVM est illusoire. Tout ceci atteste que les textes fiscaux
sont non actualisés.
A l'état actuel de la situation, huit (8) entreprises
sont agréées à la zone géographiquement
délimitée de Sèmè-podji au nombre desquelles nous
dénombrons trois (3) d'origine béninoise. Signalons au passage
que le site de Sèmè-podji est partiellement
viabilisé (10,38% de viabilisation). Au total, depuis 2005,
vingt-six (26) entreprises sont soumises au régime de la ZFI, dont
dix-huit (18) d'origine étrangère, soit un taux de participation
étrangère de 69,23%. Il convient ainsi de souligner qu'il
y a une faible participation nationale. On comprend enfin que le
nombre d'entreprises agréées est globalement peu satisfaisant
avec un faible niveau des exportations au niveau
macroéconomique, comme le témoignent les données
suivantes, en pourcentage du PIB2(*).
-
16
-
14
-
12
-
10
-
8
-
6
-
4
-
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Balance
Commerciale
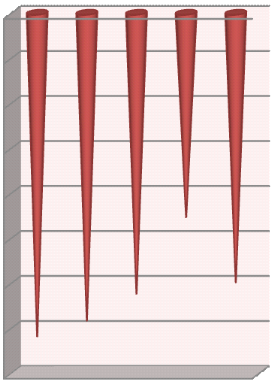
Graphique n°2 : Evolution de la
balance commerciale du Bénin, de 2007 à
2011.
Il est aisé de constater que les attentes sont encore
loin d'être comblées. Si l'objectif visé est de juguler le
chômage à travers la création d'emplois suscitée par
l'installation des usines, des industries et entreprises, il y a lieu de
reconnaître que le taux de chômage ou du sous-emploi reste
considérablement élevé. Les rares industries qui se sont
installées n'ont pas pu assurer, en tout cas jusqu'ici,
le transfert de technologies ; la ZFI manque de
compétitivité.
A la limite, le régime fiscal des investissements
est peu créatif.
Par ailleurs, nous remarquons malheureusement une
absence de précision sur certains articles de la loi n°2005-16 du 8
septembre 2005, la redondance des dispositions de certains
articles du vieil décret n°2003-400 du 13 octobre 2003
notamment les articles 21 et 23, 29 et 31. Par exemple, en ce qui concerne les
anciennes entreprises sur le territoire douanier, pour qu'elles soient
agréées, elles doivent exporter 65% de leur production les deux
dernières années, avec un chiffre d'affaire à fixer. Cette
imprécision laisse libre cours à la discrétion des
décideurs. Tout ceci nous conduit à noter que le cadre
juridique reste peu propice à l'investissement dans un contexte
caractérisé par une vraie distance entre la prévision et
la réalisation (23% d'écart pour les emplois et 28% pour les
investissements).
Lorsque nous nous permettons de faire le point des structures
intervenant dans le système des investissements privés au
Bénin, nous constatons qu'elles sont nombreuses. En
effet, en cette matière, plusieurs organismes ou structures
détenant une parcelle de pouvoir opèrent sur le terrain. Nous
pouvons compter : la Commission Technique des
Investissements (CTI), la Commission de Contrôle des
Investissements (CCI), la Direction Générale du
Développement Industriel (DGDI) (aujourd'hui Direction
Générale des Industries), l'Agence d'Administration de la Zone
Franche industrielle (A-ZFI), la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Bénin (CCIB), l'Association de Développement des
Exportations (ADEx), le
Conseil National du Patronat du Bénin (CNPB), l'Agence
Béninoise de Promotion des Echanges Commerciaux (ABePEC), la Direction
Générale du Centre de Promotion des Investissements (DGCPI), le
Fonds National des Investissements (FNI), le Conseil des Investisseurs
Privés au Bénin (CIPB), le Conseil Présidentiel de
l'Investissement (CPI)3(*).
Intéressons-nous à présent à la
gestion de ces régimes fiscaux dérogatoires par la DGID.
B°) Gestion fiscale des régimes fiscaux
dérogatoires
Il serait question d'aborder ici ce qu'apportent la DLC, la
MFRE et la RPI dans le système en observation.
La DLC de par ses attributions apparaît comme un acteur
de premier plan dans la consécration des régimes fiscaux
d'exception parce que l'édiction des avants projets de texte fiscaux
relevant de sa compétence. En effet, même si tous les textes et
codes élaborés par d'autres structures ne sont pas de sa propre
initiative, la DLC y contribue quand même en faisant des observations sur
les aspects fiscaux qu'ils comportent.
Les bénéficiaires des dispositions
dérogatoires, pour jouir des avantages à eux accordés,
notamment les exonérations, doivent souscrire des déclarations
MP1 de différentes couleurs selon la nature des exonérations.
Signalons ici que les exonérations accordées dans le cadre des
régimes privilégiés du CI et du régime
général de la ZFI relèvent de la catégorie des
exonérations classiques (voir l'historique de la MFRE pour les autres
catégories d'exonérations). La MFRE dispose d'un logiciel
de traitement informatisé des dossiers aboutissant à
l'édiction des MP2. Toutefois ce logiciel appelé GESEXO
est relativement lent dans le traitement des informations avec
une absence de certains détails statistiques. Dans cet
environnement, la bonne collaboration entre agents de la douane et ceux
du fisc aboutit à la délivrance des crédits
douaniers et intérieurs. Par contre un nombre considérable de
dossiers restent non traités et parfois encombrants. Il se pose donc le
problème d'insuffisance de personnel et du
mauvais archivage des dossiers.
Une fois le MP2 édicté et remis à
l'usager, celui-ci se dirige vers la RPI ou la recette de douane de
Cotonou-port. A la recette d'ordre, les MP3 sont délivrés au
contribuable pour la consommation du crédit figurant sur le MP2.
Par ailleurs, il est à noter que la MFRE
s'intéresse, en général, à la fiscalité
indirecte. La non prise en compte des exonérations en
matière d'impôts directs dans les statistiques de la MFRE
doit être perçue comme un défaut dans la gestion des
régimes d'exception d'autant plus qu'une évaluation globale des
dépenses fiscales est mise en cause. L'exemple qui frappe le plus est
que les exonérations d'impôts directs accordés aux
entreprises agréées à la ZFI n'entrent pas dans les
statistiques de la MFRE. Remarquons également que la MFRE ne dispose pas
de représentant ni dans la CTI ni dans la Commission d'Agrément
à la ZFI. Ainsi sommes-nous en mesure de souligner que la MFRE
joue un rôle limité en ce qui concerne
l'appréhension des dépenses fiscales. Hormis le non traitement de
toutes les exonérations d'impôts directs comme l'ex IBIC, le VPS,
etc., rappelons que la MFRE accorde des crédits d'impôt sous un
régime dit hors codes dont le champ des exonérations reste
inconnu du grand public. Dans ces circonstances subsistent
inéluctablement les risques de fraudes et d'évasions
fiscales.
II°) Inventaire des atouts et des
problèmes
Dans cette rubrique, les forces et opportunités sont
regroupées en atouts et, les faiblesses et menaces sont classées
dans les problèmes.
A°) Inventaire des atouts
D'après l'état des lieux
précédemment réalisé, il se dégage comme
atouts :
ï l'existence des mesures incitatives à
l'investissement ;
ï la prévention des infractions relatives aux
mesures dérogatoires ;
ï la bonne collaboration entre les acteurs de la MFRE
;
ï la bonne identification de l'opération à
exonérer ;
ï un traitement informatisé des dossiers ;
ï la non tolérance de la prorogation
d'agrément ;
ï l'ouverture de la zone 3 à nombre de candidats
;
ï l'obligation d'exercer cinq (5) ans au moins
après expiration d'agrément ;
ï une procédure d'agrément définie
;?les facilités de guichet unique.
B°) Inventaire des
problèmes
Les problèmes relevés sont :
ï la faible créativité du régime
fiscal des investissements au Bénin ;
ï le faible taux de participation des entreprises
nationales à la ZFI ;
ï le niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés ;
ï le faible niveau des exportations ;
ï un manque de compétitivité de la ZFI ;
ï la non assurance de transfert de technologies ;
ï la multiplicité des structures intervenant dans
le système des investissements ;
ï la non prise en compte de toutes les
exonérations d'impôts directs par la MFRE ;
ï le retard dans l'élaboration et la signature de
l'arrêté interministériel ;
ï la non actualisation des textes ;
ï l'accord d'exonérations sous le régime
hors codes ;
ï un nombre considérable d'agréments pour
des activités non démarrées ;
ï un cadre juridique peu satisfaisant ;
ï une absence de précision sur certains articles
de la loi n°2005-16 ;
ï la redondance des dispositions de certains articles ;
ï une incapacité du système à
promouvoir l'investissement de masse ;
ï une quasi-inexistence de candidats aux régimes D
et E
ï la relative lenteur de GESEXO ;
ï une absence de certains détails statistiques de
GESEXO ;
ï une insuffisance de personnel ;
ï un mauvais archivage ;
ï le risque de fraude et d'évasion fiscale ;
ï le rôle limité de la MFRE ;
ï l'incertitude sur l'efficacité des
dépenses fiscales ;
ï une absence de délai pour la délivrance
du récépissé de conformité de dossiers ;
ï la faible viabilisation de la ZFI.
SECTION2 : Ciblage de la problématique.
Le ciblage de la problématique se fera à
travers son choix, la justification du thème, sa spécification et
l'énumération des séquences de résolution.
Paragraphe1 : Choix de la problématique et
justification du sujet.
Il est important d'identifier les problématiques
possibles avant d'opérer un choix.
I- Identification des problématiques possibles
et choix dela problématique de l'étude.
Trois problématiques sont dégagées.
A°) Présentation des problématiques
identifiées
Après examen des problèmes inventoriés,
trois centres d'intérêt ont été retenus, chacun
aboutissant à une problématique susceptible de faire objet d'une
étude. Le résultat se présente comme suit :
Tableau n° 2: identification des
problématiques possibles
|
N° d'ordre
|
Centres d'intérêt
|
Problèmes spécifiques
|
Problèmes généraux
|
Problématiques
|
|
1
|
Traitement des dossiers d'exonération
|
- relative lenteur de GESEXO
- absence de certains détails statistiques de GESEXO
- insuffisance de personnel
- mauvais archivage
|
Traitement non optimal des dossiers d'exonération
à la MFRE
|
Problématique de traitement
optimal des dossiers d'exonération à la MFRE
|
|
2
|
Le système des investissements au Bénin
|
- la faible créativité du régime fiscal
des investissements au Bénin - manque de compétitivité de
la ZFI - non assurance de transfert de technologies
- faible niveau des exportations - niveau élevé
d'abandon des projets d'investissement agréés
- nombre considérable d'agréments pour des
activités non démarrées
- faible taux des entreprises
nationales agréées (ZFI)
- un cadre juridique peu satisfaisant - absence de
précision sur certains articles de la loi n°2005-16
- redondance des dispositions de
certains articles
- non actualisation des textes
- incapacité du système à promouvoir
l'investissement de masse
- quasi-inexistence de candidats au régime D et E
- multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements
- absence de délai pour la délivrance du
récépissé de conformité de dossiers
- retard dans l'élaboration et la signature de
l'arrêté interministériel
- faible viabilisation de la ZFI
|
Caractère peu dynamique du système des
investissements au Bénin
|
Problématique de dynamisation du
système des
investissements au Bénin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Gestion dépenses fiscales
|
des
|
|
- - - - - non prise en compte de toutes les
exonérations d'impôts
directs par la MFRE
Risques de fraude et d'évasion fiscale
Accord d'exonérations sous le régime hors codes
rôle limité de la MFRE
l'incertitude sur l'efficacité des dépenses
fiscales
|
Faible encadrement des dépenses fiscales
|
Problématique d'un meilleur encadrement des
dépenses fiscales
|
Source : résultats de nos
observations
B°) Choix proprement dit de la
problématique
Les trois (03) problématiques dégagées
relèvent de notre domaine d'expertise et méritent
réflexion, mais seule une sera retenue et subira de diagnostic.
La problématique de traitement optimal des
dossiers d'exonération à la MFRE retient
déjà l'attention des autorités responsabilisées en
la matière. Il nous semble donc inopportun de vouloir disséquer
un mal déjà diagnostiqué d'autant plus que les
autorités se sont engagées sur la voie de sa résolution.
En outre la résolution de cette problématique donnera
satisfaction, a priori, pour ne pas dire uniquement, aux
bénéficiaires des régimes d'exception ; des
bénéficiaires dont le nombre est négligeable devant
l'effectif de la population béninoise. C'est dire donc que la
résolution de ce problème n'entraine pas une satisfaction
collective. Il serait ainsi plus intéressant de se concentrer sur la
résolution d'une problématique d'envergure nationale qui,
à terme, lorsque tous les efforts seront coordonnés et
harmonisés, fera disparaître même le mal ponctuel qu'on
craignait. La problématique n°1 est du coup écartée.
Quant à la problématique d'un meilleur
encadrement des dépenses fiscales, il est à signifier
que certains de nos prédécesseurs, dans un passé encore
trop récent, ont attaqué et apporté des solutions au
problème général de la non maîtrise des
dépenses fiscales. Ces derniers parlaient en termes de mauvaise pratique
des régimes d'exception, d'évaluation des dépenses
fiscales, ou encore de rationalisation. Nous n'en voulons pour preuve que les
mémoires intitulés «Problématique d'une
meilleure pratique des régimes fiscaux d'exception au
Bénin» et « Réflexion sur la
problématique des dépenses fiscales au Bénin
», soutenus respectivement par IDOHOU Judicaël en mai 2012et Donald
SONOMBITI en mars 2011, ainsi que le thème «
Régimes fiscaux d'exception : une nécessaire rationalisation
» traité par ADIDO Karim en 20084(*). Il est donc clair que c'est
choisir volontairement de perdre son temps que de vouloir s'attarder sur un
problème déjà résolu ; sur ce, la
problématique n°3 est rejetée.
Revenant sur la problématique de dynamisation
du système des investissements au Bénin, plus qu'une
préoccupation de l'administration fiscale, le problème a pris une
ampleur nationale ; il fait courir le gouvernement, interpelle les
opérateurs économiques, intéresse l'opinion publique et
fait l'actualité. L'administration, avec ses partenaires, se cherche.
Les portes de sortie semblent fermées et, les recettes
budgétaires voire l'économie béninoise reçoivent
des coups. La résolution d'une telle problématique ne peut que
donner un ouf de soulagement à tout l'environnement économique
béninois.
Au regard de ces considérations, nous décidons
de porter notre recherche sur la problématique n°2.
II°) Justification du
thème
A°) Rappel de la
problématique
La problématique retenue est celle de la dynamisation
du système des investissements au Bénin. Elle se présente
comme suit :
Tableau n°3: Problématique
retenue.
|
Problèmes spécifiques
|
Problème général
|
Problématique
|
|
- la faible créativité du régime fiscal des
investissements au Bénin
- manque de compétitivité de la ZFI
- non assurance de transfert de technologies
|
|
|
|
- faible niveau des exportations
- niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés
- nombre considérable d'agréments pour des
activités non démarrées
- faible taux des entreprises nationales agréées
(ZFI)
- un cadre juridique peu satisfaisant
- absence de précision sur certains articles de la loi
n°2005-16
- redondance des dispositions de certains articles
- non actualisation des textes
- incapacité du système à promouvoir
l'investissement de masse
- quasi-inexistence de candidats au régime D et E
- multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements
- absence de délai pour la délivrance du
récépissé de conformité de dossiers
- retard dans l'élaboration et la signature de
l'arrêté interministériel
- la faible viabilisation de la ZFI
|
Caractère peu dynamique du système des
investissements au Bénin
|
Problématique de dynamisation du système des
investissements au Bénin
|
Source : Résultats de nos
observations
B°) Formulation du thème
Nous savons que le système des investissements au
Bénin est régi fondamentalement par le Code des Investissements
et le régime général de la Zone Franche Industrielle.
Comme annoncés plus haut, ces régimes renferment des
dérogations par rapport au droit commun en matière fiscale.
Au vu de la problématique choisie, notre sujet
d'étude pourra être libellé :
«Nécessité d'une réorganisation des
régimes dérogatoires au Bénin : cas du CI et du
RF/ZFI». C'est dire qu'une bonne dynamisation passe par une
réorganisation du système. Cette façon de libeller le
thème de notre recherche nous permet de prendre en considération
tous les problèmes spécifiques afin d'y apporter les solutions
idoines.
Paragraphe2 : Spécification de la
problématique et détermination des séquences de
résolution de la problématique spécifiée.
Il convient de donner un contour précis au
thème du mémoire et de décliner les pistes de
résolution des problèmes y relatifs.
I- Spécification de la
problématique
Précisons d'abord les fondements d'un tel exercice.
A°) Fondements
Il s'agit de rappeler les critères sur lesquels nous
devons nous appesantir pour une bonne spécification. Ces principes sont
globalement au nombre de quatre (4) :
ï on ne résout pas plusieurs fois le même
problème dans un même mémoire ;
ï on ne résout pas un problème ne relevant
pas de son domaine de compétence ;
ï on ne résout pas un problème ne
présentant aucune complexité ; ?on ne résout pas un
problème déjà résolu.
B°) Spécification proprement
dite
En application de ces différents critères le
regroupement suivant est fait :
ØLa faible créativité du régime
fiscal des investissements au Bénin
ï manque de compétitivité de la ZFI ;
ï non assurance de transfert de technologies ;
ï faible niveau des exportations ;
ï faible viabilisation de la ZFI
Øun niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés
ï nombre considérable d'agréments pour des
activités non démarrées ;
ï faible taux de participation des entreprises
béninoises à la ZFI.
Øun cadre juridique peu satisfaisant
ï absence de précision sur certains articles de la
loi n°2005-16 du 8 septembre 2005 ;
ï redondance des dispositions de certains articles ;
ï non actualisation des textes fiscaux ;
ï absence de délai pour la délivrance du
récépissé de conformité de dossiers ;
ï incapacité du système à promouvoir
l'investissement de masse ;
ï quasi-inexistence d'entreprises candidates aux
régimes D et E.
Ømultiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements
ï retard dans l'élaboration et la signature de
l'arrêté interministériel.
Les problèmes spécifiques
énumérés en pointillés sont englobés dans
les autres. En d'autres termes, la résolution des problèmes
englobants entraine la disparition des effets des problèmes
englobés. En conséquence, la problématique
spécifiée se dégage :
Tableau n°4: La
problématique spécifiée.
|
Problèmes spécifiques
|
Problème général
|
Problématique
|
|
|
N°1- la faible créativité
du régime fiscal des investissements au Bénin ;
|
|
|
|
|
N°2- le niveau élevé
d'abandon des projets d'investissement agréés
N°3- un cadre juridique peu satisfaisant;
N°4- la multiplicité des
structures intervenant dans le système des investissements
|
Le caractère peu dynamique du système des
investissements au
Bénin
|
Problématique dynamisation système investissements
Bénin
|
de du des au
|
Source : résultats de nos
observations
II- Séquences de résolution de la
problématique spécifiée
L'énumération des séquences sera suivie de leur
organisation.
A°) Enumération des
séquences
La résolution de la problématique respecte une
démarche bien définie :la fixation des objectifs de
l'étude ;la formulation des hypothèses ; la construction du
tableau de bord de l'étude ; la revue de la littérature; le choix
de l'outil de mobilisation des données; le choix de l'outil d'analyse
des données; la mobilisation des données; l'analyse des
données; le traitement des données et l'établissement du
diagnostic; les approches de solutions; les conditions de mise en oeuvre des
solutions ; et la construction du tableau de synthèse de l'étude.
Ces séquences seront organisées.
B°) Organisation des
séquences
Le reste du travail est scindé en deux (02)
chapitres. Le chapitre premier regroupe les objectifs, les hypothèses,
le tableau de bord, la revue de littérature et de la collecte des
données jusqu'à l'établissement du diagnostic.
Tout ceci est traité sous le vocable « conception
et mise en oeuvre du cadre théorique et méthodologique de
l'étude ». Le second et dernier chapitre regroupe les
séquences, approches de solution, conditions de mise en oeuvre des
solutions et le tableau de synthèse de l'étude.
Nécessité d'une réorganisation des
régimes fiscaux dérogatoires au Bénin : cas du CI et du
RF/ZFI
CHAPITRE PREMIER
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DU
CADRE THEORIQUE ET
METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE
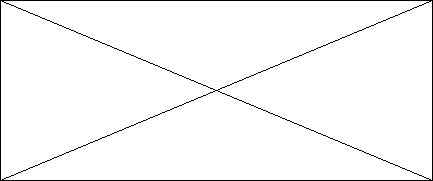
Ce premier chapitre présente, dans une première
partie, le cadre théorique et méthodologique de l'étude,
puis dans une seconde partie, la collecte des données et
l'établissement du diagnostic.
SECTION1 : Cadre théorique et
méthodologique de l'étude
Après l'exposé du cadre
théorique, suivra la méthodologie de recherche.
Paragraphe1 : Cadre théorique de l'étude
Cette rubrique s'intéresse aux objectifs, aux
hypothèses de recherche ainsi qu'à la revue de littérature
relativement aux problèmes spécifiques identifiés.
I- Des objectifs à l'élaboration du
tableau de bord del'étude
Il serait intéressant de rappeler d'abord les
problèmes répertoriés tout en présentant les
objectifs visés, avant de passer à la formulation des
hypothèses.
A°) Rappels des problèmes et
présentation desobjectifs
Notre étude vise un objectif
général et des objectifs spécifiques.
Ø Objectif général
L'objectif général de l'étude est
lié au problème général qu'il convient de rappeler
ici : le caractère peu dynamique du système des investissements
au Bénin. Face à ce problème général, nous
nous sommes fixé comme objectif de dynamiser le système des
investissements à travers des propositions de solutions concrètes
après diagnostic. Cet objectif général se décline
en des objectifs spécifiques.
Ø Objectifs spécifiques
Relativement au problème de la faible
créativité du régime fiscal des investissements, nous
comptons proposer les conditions requises pour un régime fiscal
productif des investissements au Bénin. S'agissant du niveau
élevé d'abandon des projets d'investissement
agréés, nous essayerons de déterminer les mesures idoines
à prendre pour une survie des dits projets. Quant au cadre juridique peu
satisfaisant, pour l'endiguer, nous devons relever les obstacles
réglementaires inhibant l'attraction des capitaux. Enfin, en ce qui
concerne la multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements, nous envisageons de contribuer à la
mise en place d'une structure simplifiée et autonome de gestion des
investissements.
B°) Hypothèses liées à la
problématique de l'étude
En s'inscrivant dans une logique de recherche de type «
diagnostic », notre hypothèse est bi-variée ; au moins une
cause est reliée à un problème. Ceci dit,
déterminons les causes possibles.
Ø Causes supposées
Un problème a une ou plusieurs causes. Ainsi, pour le
problème spécifique n°1, les causes suivantes sont retenues
: l'absence d'industries lourdes ; la pluralité des régimes
d'exception et la non-garantie des déterminants de l'investissement.
Le problème spécifique n°2 peut avoir comme
causes : le défaut de financement ; le coût élevé de
procédures et les faux frais.
Les causes supposées du troisième
problème spécifique sont l'absence de certains règlements
d'application ; la lourdeur de la procédure d'agrément et
l'absence de juristes compétents.
Au problème spécifique n°4 peuvent
être rattachées les causes suivantes : le souci d'optimiser la
gestion du système ; l'inefficacité de la stratégie
managériale des investissements.
Signalons que la recherche d'une cause générale
qui traduirait fidèlement les causes spécifiques a
été infructueuse. Mais, nous avons la conviction que, si les
problèmes spécifiques sont résolus, le problème
général disparaîtrait.
ØFormulation des hypothèses
Les hypothèses sont construites à partir des
causes les plus plausibles. Il convient donc de retenir, avant toute
hypothèse et pour chaque problème, la cause la plus
déterminante.
Au sujet du problème spécifique n°1, s'il
est vrai que la pluralité des régimes d'exception peut inhiber
les effets attendus d'un programme d'investissement et entraîner sa
non-productivité, il n'en demeure pas moins vrai qu'une réduction
drastique des avantages fiscaux sans aucun effort au niveau des autres facteurs
stimulants fera subsister le problème. Le même raisonnement est
valable pour l'absence d'industries lourdes. Il s'en suit donc que la
nongarantie des déterminants de l'investissement est retenue comme la
cause la plus plausible du problème spécifique n°1.
L'incompétence des hommes chargés de codifier
certaines réalités économiques et sociales peut
effectivement rendre peu attractif le cadre ainsi consacré. Mais dans le
cas d'espèce, nous estimons que le béninois ne souffre pas
d'incompétence. Aussi estimons-nous que, même si les
règlements d'application sont pris et que la procédure
d'agrément consacrée est relativement complexe et lente, le cadre
juridique va être toujours peu satisfaisant. En conséquence la
lourdeur de la procédure d'agrément est retenue pour le
troisième problème spécifique. De même, le
défaut de financement nous paraît plus déterminant pour le
problème spécifique n°2, car, nous pensons que, bien que le
coût élevé de procédure et les faux frais puissent
décourager un projet d'investissement, lorsque l'entreprise est
financièrement soutenue, elle pérenniserait son investissement.
Il est donc adopté comme cause la plus plausible. En ce qui concerne le
quatrième problème spécifique (PS4), même si le
souci d'optimiser la gestion du système disparaissait, le
problème ne sera pas véritablement résolu tant qu'il
n'existera pas une stratégie claire et efficace de management des
dispositifs mis en place ; d'où l'inefficacité de la
stratégie managériale des investissements est la cause retenue
comme la plus plausible pour ce PS4.
En considération des causes
adoptées, les hypothèses s'énoncent comme suit:
Hypothèse spécifique
n°1 : La faible créativité du régime
fiscal des investissements au Bénin est engendrée par la
non-garantie des déterminants de l'investissement.
Hypothèse spécifique
n°2 : Le défaut de financement est à la base du
niveau élevé d'abandon des projets d'investissement
agréés.
Hypothèse spécifique
n°3 : Le cadre juridique peu satisfaisant résulte de
la lourdeur de la procédure d'agrément.
Hypothèse spécifique
n°4 : L'inefficacité de la stratégie
managériale des investissements a donné lieu à une
multiplicité de structures intervenant dans le système.
En absence d'une cause générale,
l'hypothèse générale n'est pas formulée.
Le tableau suivant fait le point des objectifs et des
hypothèses.
Tableau n°5 : Tableau de bord de
l'étude.
|
Niveau d'analyse
|
Problématique
|
Objectifs
|
Causes supposées
|
Hypothèses
|
|
Niveau général
|
(problème général)
Le caractère peu dynamique du système des
investissements
|
Dynamiser le système des investissements au
Bénin
|
-
|
-
|
Niveaux spécifiques

|
1
|
La faible créativité du régime fiscal des
investissements au
Bénin
|
Proposer les conditions requises pour un régime fiscal
productif des investissements
|
La non-garantie des déterminants de l'investissement
|
La faible créativité du régime fiscal des
investissements au Bénin est engendrée par la non-garantie des
déterminants de l'investissement
|
|
2
|
Le niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés
|
Déterminer les mesures idoines à prendre pour la
survie des projets agréés
|
Le défaut de financement
|
Le défaut de financement est à la base du niveau
élevé d'abandon des projets d'investissement
agréés
|
|
3
|
Un cadre juridique peu satisfaisant
|
Relever les obstacles réglementaires inhibant
l'attraction des capitaux
|
La lourdeur de la procédure d'agrément
|
Le cadre juridique peu satisfaisant résulte de la lourdeur
de la procédure d'agrément
|
|
4
|
Une multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements
|
Contribuer à la mise en
place d'une structure simplifiée et autonome de gestion
des investissements
|
L'inefficacité de la stratégie
managériale des investissements
|
L'inefficacité de la stratégie managériale
des investissements a donné lieu à une multiplicité de
structures intervenant dans le système
|
Source : résultats de nos
observations
Intéressons-nous à présent à ce
que dit la documentation existante au sujet des problèmes
spécifiques à résoudre.
II- Revue de littérature
La revue de littérature permet, dans le cadre de toute
recherche, de s'assurer au préalable de l'état des connaissances
acquises sur le sujet ou le domaine abordé. Il nous revient ainsi de
faire le point des connaissances livresques sur les problèmes en
résolution. Ceci nous permettra de donner une orientation à notre
travail par rapport à cette littérature.
Après l'exploration de quelques mémoires et
ouvrages, nous aborderons les résultats issus de certaines rencontres de
grande envergure.
A°) Les mémoires de fin de formations
universitaires et autresouvrages
Les mémoires et ouvrages abordés ici ne traitent
pas explicitement et uniquement des problèmes spécifiques en
résolution dans cette étude. Mais une lecture minutieuse de ces
documents nous a permis de relever les points de vue des auteurs, relativement
aux problèmes identifiés. En effet, en 2010, Capistran
Fréjus LEKE, à travers son mémoire intitulé «
Contribution de la fiscalité à l'amélioration du climat de
l'investissement privé au Bénin », estime que la faible
créativité du régime fiscal des investissements est le
résultat d'une inexistence de système performant de
débouchés. A ce propos, il suggère la mise en place d'une
procédure de commercialisation des principaux produits vivriers à
l'image de celle ayant cours au niveau des cultures de rente. La même
année, son collègue Hospice Yannick NOULEKOUN, lui, dans son
étude baptisée « Réflexion sur la rationalisation des
mesures fiscales incitatives à l'investissement pour un meilleur
rendement fiscal », envisage la suppression à long terme de
certaines mesures incitatives à l'investissement afin d'éviter
les distorsions concurrentielles au niveau des investissements.
Par ailleurs, l'ouvrage intitulé «
l'investissement direct étranger au service du développement :
optimiser les avantages, minimiser les coûts » et publié en
2005 à Paris dans les éditions de l'Organisation
de Coopération et de Développement Economique (OCDE), prouvait
que la faible productivité d'un système d'investissement tient
généralement au fait que les facteurs prioritaires et les
conditions offertes par les pays d'accueil sont peu attractifs. Ce document
ajoute que l'aspect fiscal n'est pas décisif pour l'investisseur et
qu'il faille mettre l'accent sur d'autres aspects plus essentiels. Dans cette
perspective, dans son article publié dans « Le Monde5(*) » du 24 septembre 2010 sous
le titre « La fiscalité dérogatoire traduit la
dégénérescence de l'Etat », Michel BOUVIER opte pour
la suppression d'un certain nombre de niches fiscales tant elles ont pris de
l'ampleur. Pour OUMAN, dans son étude sur « La théorie des
exonérations » datant de 2000, l'expérience de nombreux pays
montre déjà que les régimes d'incitations et
d'exonérations fiscales ont été utilisés avec peu
de succès pour « compenser » un environnement des affaires peu
favorable à l'initiative privée. Il conclut à cet effet
qu'une action directe sur les handicaps à la créativité
est certainement plus efficace qu'une action à travers les
exonérations et les incitations fiscales.
Au sujet du niveau élevé d'abandon des projets
d'investissements agréés, Nicolas BERLOGEY, dans son ouvrage
intitulé « La sensibilité de l'investissement à la
fiscalité directe des entreprises et des ménages » et
publié en 1995, découvrait que « l'entreprise peut voir en
pratique sa capacité d'investissement obéré par des
difficultés de financement, particulièrement si son ratio
d'endettement est déjà élevé et si (cas des petits
investissements) son accès au marché des capitaux est
réduit ». En ce qui concerne le caractère peu favorable du
cadre juridique, Karim M. ADIDO, à travers son mémoire
intitulé :
« Les régimes fiscaux d'exception au Bénin
: une nécessaire rationalisation » et soutenu en 2008,
suggère l'élaboration d'une charte des investissements
votée par le législateur et invite les acteurs
intéressés, au respect des dispositions législatives et
réglementaires en matière d'accord des exonérations. Pour
Pierre PELLERIN (2001) : « La rentabilité du recours aux
encouragements fiscaux pour promouvoir l'investissement » P.52, la
meilleure stratégie envisageable pour promouvoir un investissement
durable consiste à créer un cadre juridique et
réglementaire stable et transparent, et à mettre en place un
système fiscal conforme aux normes internationales. Quant à la
multiplicité des structures intervenant dans le système des
investissements, les travaux de Vito TANZI et Howell ZEE, rendus publics en
mars 2001 sous le titre : « Une politique fiscale pour les pays en
développement », incriminent le mode de gestion des encouragements
fiscaux et proposent la limitation du pouvoir discrétionnaire lors du
choix des bénéficiaires de ces mesures.
Que disent alors les experts de ces problèmes
handicapants ?
B°) Forums africains et internationaux, et
séminaires de haut niveausur les investissements
privés.
Attirer les IDE, maximiser les investissements privés
et faire prospérer les économies nationales ont toujours
été les objectifs prioritaires de la plupart des dirigeants
africains et acteurs internationaux, inscrits à l'ordre du jour lors des
grandes rencontres. C'est ce qui justifie l'organisation du séminaire de
haut niveau par l'Institut du FMI en coopération avec l'Institut
multilatéral d'Afrique6(*), sous le thème « Réaliser le
potentiel d'investissements rentables en Afrique ». Fondé sur les
stratégies d'amélioration des systèmes d'incitations
fiscales, ce séminaire a permis de comprendre que les
inconvénients des incitations fiscales ont une part de
responsabilité dans la faible créativité des
systèmes dérogatoires, et que les facteurs non fiscaux jouent un
rôle beaucoup plus important que les mesures fiscales dans la
détermination du niveau et de la qualité des flux
d'investissement. Il a donc été recommandé d'éviter
un taux d'imposition nul.
Par ailleurs, le rapport et projet de propositions
finalisés en mars 2008 de la « Commission Economie et
Développement (CED) » de l'OCDE sur « le développement
des petites et moyennes entreprises (PME) africaines » reconnaît que
le non accès direct aux sources de financement des PME est un handicap
majeur à leur survie. Ainsi, selon ce rapport, l'échec du recours
aux banques fait valoir la spécificité du financement de la PME.
Cette prise de conscience tardive s'explique par une autre : la conscience
que, répondre à un tel besoin de
financement, c'est créer un nouveau métier. En témoigne
l'échec du recours au secteur bancaire existant auquel on pensait et on
pense toujours confier, à l'aide d'incitations diverses, la tâche
de financer les PME. Dans cette même optique, il a été
noté, au cours de la table ronde « secteur public- secteur
privé »7(*), que
les PME et les Petites et Moyennes Industries (PMI) ferment souvent à
cause du défaut d'accompagnement de l'Etat sur le plan de la formation
et de l'appui financier. Il serait donc intéressant de promouvoir de
nouvelles approches en matière de concours financier. De même, en
Novembre
2009, le Forum Africain sur l'Administration Fiscale (ATAF)
s'est proposé, entre autres objectifs, d'améliorer le climat de
l'investissement en agissant sur le cadre de l'investissement et en dotant les
marchés financiers de règles et d'institutions
appropriées.
Revenant sur le cadre juridique de l'investissement, son
inadéquation a été pointée du doigt lors du Forum
Africain des Infrastructures (FAI) 5eme édition8(*).
Aussi, d'après les conclusions de la table ronde «
secteur public- secteur privé », serait-il nécessaire de
créer un environnement législatif et réglementaire qui
permette aux entreprises et industries d'exister et de rêver. Pour ce qui
est de la multiplicité des structures intervenant dans le système
des investissements, sans y apporter une solution concrète, la
Commission Economie et Développement de l'OCDE admet que la
pluralité des dispositifs d'appui à l'entreprise dans une
même Nation, même s'ils sont conçus pour être
pérennes, remet en cause la viabilité de chacun.
Déclinons à présent la
méthodologie de recherche suivie.
Paragraphe2 : Choix de la méthodologie de
recherche
La méthodologie que nous adopterons a une double
dimension : une dimension basée sur les enquêtes (dimension
empirique) et une dimension liée aux modèles et seuils de
décision (dimension théorique).
I- Le pourquoi et comment de
l'enquête
Il sera question ici des objectifs de l'enquête, de la
population ciblée et des outils pratiques nécessaires dans le
processus d'une enquête.
A°) Finalités et cadre de
l'enquête
Dans toute recherche scientifique, l'objectif principal est
la vérification des hypothèses préalablement
émises, histoire d'apporter des solutions originales aux
problèmes identifiés. Ceci dit, de façon
spécifique, nous nous sommes fixé comme objectif de
l'enquête :
- de nous assurer que la faible créativité du
régime fiscal des investissements est engendrée par la
non-garantie des déterminants de l'investissement ;
- de vérifier si le défaut de financement est
effectivement à la base du niveau élevé d'abandon des
projets d'investissements agréés ;
- de certifier ou non que le cadre juridique peu favorable
à l'investissement résulte de la lourdeur de la procédure
d'agrément ;
- d'approuver ou désapprouver l'hypothèse selon
laquelle l'absence d'une stratégie managériale des
investissements a donné lieu à une multiplicité des
structures de gestion intervenant dans le système.
Notre enquête pratique s'intéresse à une
population formée par l'ensemble des acteurs qui, d'une manière
ou d'une autre, influencent le système des investissements au
Bénin. Cette population englobe les cadres de la DGID, de la Direction
Générale du Centre de Promotion des Investissements, de la
Direction Générale du Développement Industriel, de
l'A-ZFI, du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des
Petites et Moyennes Entreprises (MCIPPME), du Ministère du
Développement, de la Prospective, de l'Analyse
Economique et de l'Evaluation de l'Action Publique (MDPAEEAP),
et du MEF ainsi que quelques entreprises privées.
Nous comprenons par-là que la taille de la population
mère est difficilement repérable. En conséquence, un
échantillon de taille n?49 (nombre de questionnaires effectivement
récupéré) est pris. Et, nous avons adopté une
technique de collecte d'information qui exige le recours à la
réflexion, au raisonnement, à l'expérience, à la
connaissance du milieu enquêté, pour choisir les unités
à interroger. Il s'agit donc d'un sondage non probabiliste dont les
éléments de l'échantillon sont sélectionnés
par la méthode des quotas, avec comme variable de contrôle, la
structure d'appartenance. La sélection se présente ainsi qu'il
suit : 10 individus à la DGID ; 05 à la DGCPI ; 06 à la
DGDI ; 05 à l'A-ZFI ; 07 au MCIPME, 04 au MDPAEEAP et 12 individus qui
sont des représentants d'entreprises privées
agréées.
B°) Les outils de mobilisation, de
dépouillement et deprésentation des
données.
Les données à collecter, compte tenu de nos
hypothèses, sont de nature qualitative. Les informations sont donc
mobilisées en utilisant un guide d'entretien, un questionnaire9(*) et parfois la méthode
accélérée de recherche participative (MARP).
Le dépouillement des informations recueillies aurait pu
être assisté par ordinateur (en utilisant des progiciels STATA,
EWIES, ACCESS, SPSS). Mais en considération de la taille de notre
échantillon, nous avons préféré un
dépouillement manuel à travers le tri à plat. Les
résultats sont ainsi passés dans l'ordinateur sous le logiciel
EXCEL pour leur présentation.
S'agissant de la présentation des données
mobilisées, les outils disponibles sont des tableaux et des graphiques
(diagrammes, histogrammes, courbes). Nos variables statistiques étant
essentiellement qualitatives, les représentations correspondantes sont :
des diagrammes circulaires, diagrammes semi-circulaires, à bandes et
diagrammes en tuyau d'orgue. Pour des raisons de commodité, nous
utiliserons les graphiques dans le texte principal et les tableaux en annexe.
II- Approches théoriques
employées
L'approche théorique permet l'analyse des
données, au regard des théories disponibles.
A°) Choix de théorie
appropriée
Relativement à nos problèmes
spécifiques, la revue de littérature n'a
révélé aucune théorie au sujet de la
vérification des hypothèses. En conséquence, nous nous
sommes contentés des seuils de décision. En d'autres termes, le
défaut d'une théorie appropriée en la matière nous
contraint à la fixation des seuils de décision.
B°) Choix du seuil de
décision
Un seuil de décision est fixé relativement
à chaque hypothèse d'étude. Les première et
troisième hypothèses comportent chacune trois (03) items
spécifiés.
L'item retenu est celui ayant un poids supérieur au
poids moyen des causes (soit
33%). A défaut, l'item ayant le poids le plus
élevé est adopté.
Quant à la deuxième hypothèse, elle
comporte deux items spécifiés. La cause réelle est celle
qui obtient un poids supérieur ou égal à 50%. Si aucune
cause ne satisfait à cette condition, alors la cause ayant le poids le
plus élevé est réelle.
S'agissant de la quatrième hypothèse, est
retenu comme cause réelle, la cause ayant un poids supérieur
à 50%. Si aucune cause ne répond à ce principe, toute
cause ayant un poids non nul, sera retenue comme cause réelle.
SECTION2 : Collecte des données et
établissement du diagnostic.
Le premier paragraphe est consacré à la
mobilisation des données et les contraintes y relatives, tandis que le
second est réservé à l'analyse des données
recueillies.
Paragraphe1 : Mobilisation des données,
difficultés rencontrées et limites des données.
Il s'agira de dire succinctement le contexte d'organisation
des enquêtes et les difficultés y relatives.
I- Organisation des enquêtes
Les enquêtes que nous avons conduites ont connu une
phase préparatoire qui a précédé celle de la
réalisation.
A°) Préparation des
enquêtes
En vue de rendre plus compréhensive la formulation des
questions pour les enquêtés, le questionnaire a fait l'objet
d'un test avant d'être corrigé grâce aux observations faites
par les personnes ressources consultées.
Afin de garantir une meilleure compréhension des
questions, le questionnaire a été conçu exclusivement en
tenant compte des problèmes spécifiques identifiés au
cours de cette étude. Cela nous permet de recueillir plus
aisément l'essentiel des avis des enquêtés sur notre
thème.
B°) Réalisation des
enquêtes
Il est à signaler que ces enquêtes se sont
déroulées sur une période de deux mois et demi, plus
précisément du 15 Octobre 2012 au 11 Janvier 2013. Les
enquêtes nous ont conduit dans diverses structures, soit pour recueillir
des informations documentaires, soit pour distribuer des questionnaires, ou
pour solliciter un entretien. Aussi faut-il souligner que ces enquêtes ne
se sont pas déroulées sans difficultés.
II- Difficultés et limites
Les limites des données sont mises en exergue
après l'exposé des difficultés rencontrées.
A°) Difficultés
rencontrées
Les difficultés rencontrées lors de la
réalisation de nos enquêtes sont multiformes et de divers ordres :
- notre présence continuelle, matin et soir, au lieu du
stage ne nous a pas permis de recueillir le maximum d'informations pour nos
recherches ;
- la non-disponibilité des agents à
répondre à nos préoccupations parce qu'ils sont
préoccupés par la réalisation des objectifs à eux
assignés ;
- la réticence de certains acteurs à la
livraison des informations demandées ;
- la non-disponibilité de certaines statistiques ; -
difficultés financières.
Ces difficultés expliquent la limite des données
recueillies.
B°) Limites des données.
Ces limites concernent essentiellement l'insuffisance des
informations collectées et leur qualité. Elles sont
spécifiquement liées aux marges d'erreur pouvant provenir non
seulement de ces difficultés, du temps à nous imparti, mais aussi
de notre jeune expérience en matière de conduite d'une
enquête.
Néanmoins, nous nous sommes efforcé de
respecter, autant que faire se peut, les règles, normes et principes
académiques établis en la matière. Donc ces
difficultés et limites ne sont pas de nature à disqualifier le
caractère scientifique et technique des résultats que nous
présenterons.
Toutes les données mobilisées à partir des
enquêtes sont analysées.
Paragraphe2 : Analyse des données et
établissement du diagnostic.
Suite à la présentation des données
mobilisées, nous procèderons à l'évaluation du
degré de vérification des hypothèses.
I°) Présentation et analyse des
données.
Les problèmes spécifiques sont regroupés
deux à deux.
A°) Données relatives aux
problèmes spécifiques n°1 et n°2.
Nos recherches sur le terrain nous ont permis de recueillir
quelques données allant dans le sens du problème de la faible
créativité du régime fiscal des investissements, et du
problème du niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés. Les données se résument de
la manière suivante :
Tableau n°6 : Evolution du nombre
d'entreprises, des emplois prévisionnels et des emplois
créés au régime général de la ZFI, de 2006
à 2011.
|
Année
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Total
|
|
Nombre d'entreprises agréées
|
06
|
05
|
04
|
06
|
03
|
02
|
26
|
|
Nombre d'emplois prévus
|
1982
|
521
|
695
|
967
|
435
|
739
|
5339
|
|
Nombre d'emplois créés
|
705
|
395
|
614
|
701
|
378
|
300
|
3093
|
Source : A-ZFI 2012
Les emplois créés sont occupés aussi
bien par les Béninois que par les étrangers. Les chiffres
relatifs exclusivement aux nationaux ne sont pas disponibles ; et c'est
à déplorer. Mais nous savons de même que le taux de
chômage reste considérablement élevé. Selon les
chiffres de la Banque Mondiale en 2012, le taux de chômage
juvénile est de 70% et le secteur secondaire (secteur industriel ne
contribue qu'à hauteur de 10% au Produit Intérieur Brut (PIB)).
Aussi doit-on souligner l'écart toujours persistant entre les
prévisions et les réalisations.
Graphique n°3 : Illustration du
nombre d'entreprises agréées à la ZFI, de 2006 à
2011.
n°3.
Modalités
Nombre
d'observations
Fréquences relatives
Absence de certains règlements d'application
22
44
,90%
Absence de juristes compétents
0
0
%
Lourdeur de
la procédure d'agrément
23
,94%
46
Autres
04
,16%
08
Total
49
100
%
0
1
2
3
4
5
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nombre d'entreprises
agréées
Nombre d'entreprises
agréées
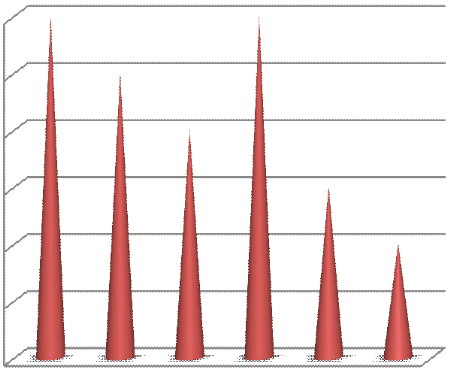
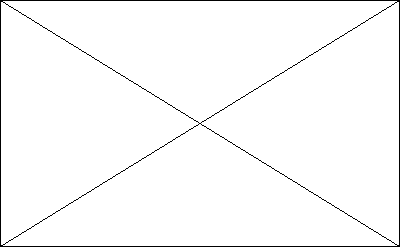
De l'observation de ce graphique, il ressort que le nombre
d'entreprises agréées a chuté entre 2006 et 2008, puis
augmenté en 2009. La décroissance a repris à partir de
2010. Signalons que seulement deux (02) dossiers étaient en étude
pour le compte de l'année 2012.
Tableau n°7 : Evolution des
emplois prévisionnels des entreprises agréées au CI de
2007 à 2011.
|
Année
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Total
|
|
Nombre d'emplois prévus
|
7179
|
1122
|
1167
|
591
|
701
|
10760
|
Source : Centre de Promotion des
Investissements, Novembre 2012.
Pour la période examinée ici les chiffres ne
sont pas disponibles par rapport aux réalisations.
Il convient maintenant d'exposer les données
collectées sur la base du questionnaire.
Qu'est-ce qui, selon vous, engendre la faible
créativité10(*) du régime fiscal des investissements au
Bénin ? Cette question posée aux enquêtés au cours
de nos recherches nous a permis de recueillir les données
nécessaires pour la vérification de l'hypothèse
spécifique n°1. Le traitement des données mobilisées
a permis l'obtention du graphique suivant.
Graphique n°4 : répartition des
données d'enquête relatives au problème de la faible
créativité du régime fiscal des investissements au
Bénin.
38
,78%
14
,29%
,69%
34
12
,24%
Non
-
garantie des
déterminants de
l'investissement
Absence d'industries lourdes
Pluralité des régimes
d'exception
Autres
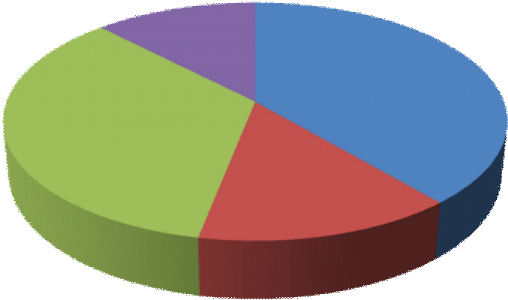
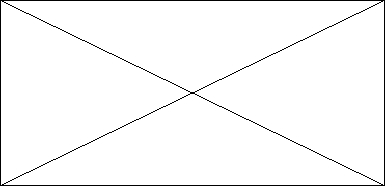
S'agissant du problème du niveau élevé
d'abandon des projets d'investissement agréés, la question «
qu'est-ce qui peut être à la base du niveau élevé
d'abandon des projets d'investissements agréés? » nous a
permis de faire la répartition des données suivantes.
Graphique n°5: répartition
des données relatives au niveau élevé d'abandon
des projets d'investissement agréés.
44
,90%
48
,98%
6
,12%
et les faux frais
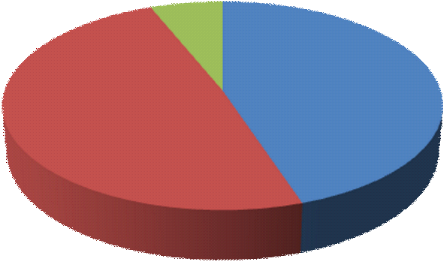
Défaut de financement
Coût élevé de procédures
Autres
B°) Données relatives aux
problèmes spécifiques n°3 et n°4. Nous
nous sommes servi de la question n°3 du questionnaire, pour l'examen des
causes du problème spécifique n°3. « Qu'est-ce qui
explique, selon vous, le fait que le cadre juridique béninois est peu
favorable à l'investissement ? » ; telle est la question dont les
réponses sont organisées à travers le graphique qui suit.
Graphique n°6 :
répartition des données d'enquête relatives au cadre
juridique peu satisfaisant.
44
,90%
0
%
46
,94%
8
,16%
Absence de certains
règlements d'application
Absence de juristes
compétents
Lourdeur de la procédure
d'agrément
Autres
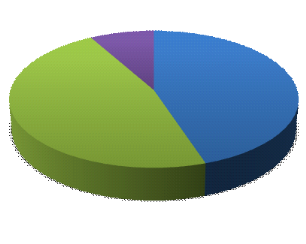




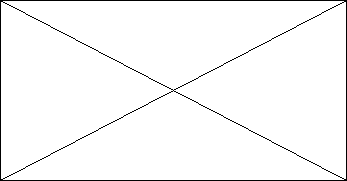
En ce qui concerne le quatrième problème
spécifique, nous avons exploité les réponses
générées par la question : « Qu'est-ce qui a
donné lieu à la multiplicité des structures de gestion
intervenant dans le système des investissements au Bénin ?
».
Le schéma suivant rend compte graphiquement des
résultats de nos investigations.
Graphique n°7 :
répartition des données d'enquêtes relatives
à la multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements au Bénin.
83
,67%
,25%
12
4
,08%
L'inefficacité de la
stratégie
managériale des
investissements
Le souci
d'optimiser la
gestion du
système
Autres
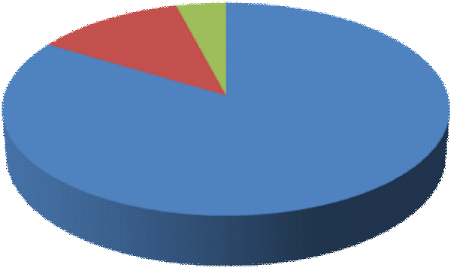
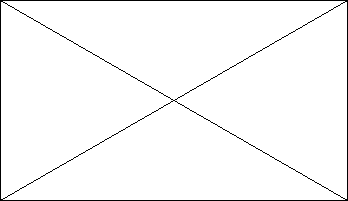
II-/ Etablissement du diagnostic
Dans cette rubrique, nous avons procédé à
l'évaluation du degré de vérification des
hypothèses puis à la synthèse du diagnostic.
A°) Degré de vérification des
hypothèses
La première hypothèse de notre étude est
formulée : « La faible créativité du régime
fiscal des investissements au Bénin est engendrée par la
non-garantie des déterminants de l'investissement ». D'après
le graphique n°4, 38,78% des enquêtés estiment que la
non-garantie des déterminants de l'investissement est la cause du
problème identifié ; 14,29% pensent que c'est plutôt
l'absence d'industries lourdes, et 34,69% soutiennent que la pluralité
des régimes d'exception est la cause majeure du problème à
résoudre. Ceux qui ont évoqué des causes disparates
rangées dans la modalité «Autres»
s'élèvent à 12,24% de la population enquêtée.
Au regard du seuil de décision fixé, une cause qui obtient un
poids de 33% au moins est considérée comme réelle. Vu que
les causes « la non-garantie des déterminants de l'investissement
» et « la pluralité des régimes d'exception » ont
totalisé respectivement 38,78% et 34,69%, elles sont donc responsables
du problème spécifique n°1. Nous en déduisons que
l'hypothèse selon laquelle la faible
créativité du régime fiscal des investissements au
Bénin est engendrée par la non-garantie des déterminants
de l'investissement est confirmée. Cependant la cause
du problème est double. En d'autres termes, nous retenons : la
faible créativité du régime fiscal des investissements au
Bénin est engendrée par la non-garantie des déterminants
de l'investissement et la pluralité des régimes d'exception.
Au sujet du problème spécifique n°2, tel
que révélé par le graphique n°5, aucune des causes
identifiées n'a atteint la barre des 50% requis pour être
décisive. Nous avons enregistré 44,90% pour la cause n°1 ;
48,98% pour la cause n°2 et 06,12% pour l'item « Autres ». En
considérant le seuil de décision, « le coût
élevé de procédures et les faux frais » est la cause
réelle du deuxième problème spécifique, parce
qu'ayant le poids le plus élevé. En conséquence,
l'hypothèse spécifique n°2 est
infirmée. Mais il serait assez aberrant de faire abstraction
d'une cause ayant un poids aussi considérable (44,90%) que celle
libellée « défaut de financement ». C'est dire que
cette cause va être également prise en compte pour
l'éradication absolue du problème. Les causes réelles
étant connues nous pouvons retenir : Le défaut de
financement et surtout le coût élevé de procédures
doublé des faux frais sont à la base du niveau
élevé d'abandon des projets d'investissement
agréés.
Revenant sur le problème spécifique n°3,
les informations traitées révèlent que 46,94% des
enquêtés attestent que la lourdeur de la procédure
d'agrément justifie le caractère peu favorable du cadre juridique
béninois, en matière d'investissement, et 44,90% estiment
plutôt que c'est l'absence de certains règlements d'application
qui entache le cadre juridique existant. Une proportion de 08,16% de la
population interrogée a identifié des causes disparates
rangées dans l'item « Autres ». La cause
spécifiée n°2 a obtenu un poids de 0% ; elle n'existe donc
pas. En référence au seuil de décision, les causes
spécifiées n°1 et n°3 sont les causes réelles
parce qu'ayant chacun un poids (respectivement 44,90% et 46,94%)
supérieur au poids moyen des causes (33%). Nous déduisons ainsi
que l'hypothèse spécifique n°3 est confirmée
puis que la cause supposée fait partie des causes
réelles. En somme, il peut être affirmé que le
cadre juridique peu satisfaisant résulte de la lourdeur de la
procédure d'agrément et de l'absence de certains
règlements d'application.
Les résultats d'enquêtes relatifs à la
vérification de la quatrième hypothèse spécifique
se présentent comme suit : 04,08% pour l'item n°3 ; 12,25% pour
l'item n°2 ; et 83,67% pour l'item n°1. En application du seuil de
décision fixé, la cause spécifique n°1 se
dégage comme cause réelle. Il est donc clair que
l'hypothèse spécifique n°4 est
confirmée ; c'est-à-dire que
l'inefficacité de la stratégie managériale des
investissements a donné lieu à une multiplicité de
structures intervenant dans le système.
Faisons à présent le point du diagnostic.
B°) Synthèse du diagnostic
Il est question ici de faire le résumé des
connaissances acquises après la vérification des
hypothèses.
Pour des raisons de commodité, les informations
à retenir sont consignées dans le tableau ci-dessous.
Tableau n°08: synthèse du
diagnostic
|
Numéros d'ordre
|
Problèmes spécifiques
|
Causes réelles
|
Diagnostic proprement dit
|
|
1
|
la faible créativité du régime fiscal des
investissements au Bénin
|
la non-garantie des déterminants de l'investissement et
la pluralité des régimes d'exception.
|
la faible créativité du régime fiscal des
investissements au Bénin est engendrée par la non-garantie des
déterminants de l'investissement et la pluralité des
régimes d'exception
|
|
2
|
Le niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés.
|
Le défaut de financement et surtout le coût
élevé de procédures doublé des faux frais
|
Le défaut de financement et surtout le coût
élevé de procédures doublé des faux frais sont
à la base du niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés
|
|
3
|
le cadre juridique peu satisfaisant
|
la lourdeur de la procédure d'agrément et
l'absence de certains règlements d'application
|
le cadre juridique peu satisfaisant résulte de la lourdeur
de la procédure d'agrément et l'absence de certains
règlements d'application
|
|
4
|
une multiplicité de structures intervenant dans le
système des investissements.
|
l'inefficacité de la stratégie managériale
des investissements
|
l'inefficacité de la stratégie managériale
des investissements a donné lieu à une multiplicité de
structures intervenant dans le système.
|
Source : Résultats de nos
analyses
Nécessité d'une réorganisation des
régimes fiscaux dérogatoires au Bénin : cas du CI et du
RF/ZFI
Chapitre deuxième
POUR LA DYNAMISATION DU
SYSTEME DES INVESTISSEMENTS AU
BENIN
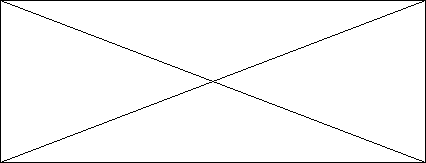
Les véritables problèmes qui minent le
système béninois des investissements sont identifiés. Les
sources de ces différents obstacles sont décelées. Il nous
appartient donc d'agir ; agir pour anéantir ou détruire les
causes et renforcer les atouts. Nous allons, à cet effet, proposer des
solutions susceptibles de rendre plus dynamique le système en
étude. Ces solutions vont nécessiter certaines actions
préalables et une certaine coordination et coopération pour leur
efficacité ; c'est pourquoi des recommandations seront faites à
l'endroit de tous les acteurs intéressés.
SECTION 1 : Réflexions suggestives.
Le premier paragraphe est consacré aux approches de
solutions des problèmes spécifiques n°1 et n°2, tandis
que les deux derniers problèmes spécifiques trouveront leurs
approches de solutions au deuxième paragraphe.
Paragraphe 1 : Approches de solutions aux
problèmes spécifiques n°1 et n°2
D'après le diagnostic, nous savons que le
problème de la faible créativité du régime fiscal
des investissements est, en grande partie, dû à l'absence de
garantie des déterminants de l'investissement, mais aussi à la
pluralité des régimes d'exception. Pour résoudre ce
problème, c'est-à-dire pour un régime fiscal des
investissements rentable et productif, nous devons agir sur les deux
principales causes. Une action qui doit consister à garantir les
déterminants de l'investissement et à rationnaliser, à
réduire, à la limite à supprimer les dérogations
fiscales inhibantes.
En ce qui concerne la garantie des déterminants, un
accent doit être mis sur le coût ou la qualification de la main
d'oeuvre, les équipements et infrastructures, la disponibilité et
la proximité des matières premières. La stabilité
politique doit être préservée et une souplesse des
règlements relatifs aux transactions financières internationales
doit être au rendez-vous. La situation géographique du
Bénin (port- ZFI ou ZFI-marché extérieur), le renforcement
de la justice, la sécurisation du foncier sont également des
facteurs susceptibles d'exercer un effet attractif sur les investisseurs. Le
vote de la loi sur la sécurisation des droits fonciers au Bénin
par l'Assemblée Nationale en sa plénière du 14 janvier
2013 est un pas en avant ; mais le chemin parcouru est encore dérisoire.
En outre, l'achèvement de la viabilisation de la ZFI de
Sèmèpodji ainsi que le démarrage de celle de Gakpè
à Ouidah doivent constituer une priorité pour le gouvernement. De
même, les études préalables à l'érection des
bâtiments industriels doivent être réalisées ; cela
réduirait les délais d'attente.
La question de l'énergie électrique interpelle.
Les quelques entreprises qui tentent l'indépendance
énergétique connaissent des difficultés. De même les
prestations de la SBEE laissent à désirer, ou du moins sont peu
satisfaisantes.
C'est dire qu'il est nécessaire d'augmenter la
puissance électrique sur les sites industriels, tout en assurant la
continuité de sa fourniture.
La proximité du marché nigérian est, a
priori, un atout. Mais le difficile accès à ce marché
ralentit l'engouement des investisseurs à opérer au Bénin.
Nous proposons à ce sujet une solution à double pans :
l'élaboration d'une politique de protection des investissements
intérieurs, et le relèvement des barrières à la
libre circulation des produits ?made in Benin». Il s'agit notamment de
trouver un accord particulier avec le Nigéria qui reverra sa norme
NAFDAC, afin de permettre l'accès au marché de ce pays. Il faut
également supprimer les exonérations sur les intrants
accordées à certaines entreprises et qui empêchent
l'entrée des produits ?made in Benin» dans les marchés
?UEMOA et
CEDEAO».
Parmi les autres moyens importants du genre utilisés
pour attirer les
Investisseurs Directs Etrangers (IDE), il convient de citer une
meilleure protection des droits de propriété intellectuelle, le
renforcement de l'Etat de droit et l'amélioration des systèmes
judiciaires, la privatisation des entreprises publiques, la
déréglementation des marchés et, bien entendu, la
libéralisation des politiques qui régissent les échanges
et l'investissement. Pour la littérature économique, les
transferts de technologies sont peut-être le principal mécanisme
par lequel la présence de sociétés
étrangères peut avoir des externalités positives dans
l'économie d'accueil en développement. Les entreprises
multinationales sont la principale source d'activités de recherche et de
développement (R-D) dans le monde développé, et leur
niveau de technologie est généralement plus élevé
que celui des pays en développement, de sorte qu'elles sont en mesure de
générer de très importantes retombées
technologiques. Cependant, le rôle joué par les entreprises
multinationales pour faciliter ces retombées varie selon le contexte et
selon les secteurs.
Pour agréer les entreprises étrangères,
obligation leur sera faite de soustraiter 40% des investissements
projetés aux nationaux ; ceci permettrait le transfert de technologie.
C'est dire que chaque délivrance d'agrément sera
subordonnée à la présentation d'un certificat de
coopération avec un investisseur national. Aussi faudrait-il garantir la
certification des normes de la série ISO 9000 aux produits issus des
différentes zones, pour favoriser les exportations vers l'Europe et
l'Amérique du Nord. En clair, l'Etat se doit de marquer une meilleure
volonté politique en posant des actions plus hardies pour rendre
opérationnelle la ZFI.
Par ailleurs, la ZFI qui est un instrument de promotion des
investissements ne saurait constituer, à elle seule, la solution
définitive aux problèmes qu'il convient de résoudre en vue
d'atteindre le développement. C'est pourquoi il urge de créer des
Zones Economiques Spécialisées (ZES), entièrement
viabilisées, dans tous les départements, sur des terrains
immatriculés au nom de l'Etat, pour un développement
économique territorialement équilibré ; par exemple en
installant des usines relativement à l'activité dominante de
chaque région, tout en se référant aux modalités de
perception de la Taxe de Développement Locale (TDL).
A la différence des ZFI, les
ZES couvriraient des superficies plus grandes et ne seront pas
nécessairement des zones industrielles, mais un aménagement
d'espaces ruraux et urbains pour une intégration de zones
sous-équipées et fortement équipées. Elles seront
orientées vers la promotion des ressources locales et transformeront les
faiblesses économiques d'une région défavorisée en
atouts grâce à la complémentarité avec d'autres
zones potentiellement plus favorisées. Ces ZES vont
ainsi créer une forte interdépendance entre les activités
des régions où elles sont instituées. Les ZES
attireront en général, les capitaux de la diaspora.
Pour ce qui est de la pluralité des régimes
d'exception, nous savons que la mobilisation des ressources nationales par le
biais de l'imposition est indispensable pour permettre aux pays d'Afrique de
dégager les recettes nécessaires à la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il
convient donc de limiter le coût financier des stimulants fiscaux en
soumettant toute entreprise agréée à la législation
commune mais modérée. Tout ceci d'autant plus que les
congés fiscaux sont moins rentables que les autres mesures. En effet ils
engendrent :
ï des pertes de recettes élevées ;
ï des investissements temporaires favorisés au
détriment des investissements durables ;
ï le risque d'évasion fiscale de grande ampleur ;
ï la récupération des impôts
exonérés par le Trésor du pays de résidence de
l'investisseur.
Les incitations fiscales les plus efficaces sont le
crédit d'impôt pour investissement et les déductions
initiales pour investissement, doublées d'une complexité
administrative réduite au minimum. Les investissements qui
dépendent de leur emplacement et qui sont fondamentalement viables
(surtout les projets portant sur les ressources naturelles) ne devraient pas
bénéficier d'avantages fiscaux particuliers. Au contraire, les
gouvernements doivent s'efforcer de négocier une part équitable
des rentes tirées des ressources naturelles.
Rappelons que le sous-sol béninois est assez riche en
ressources minières.
C'est ce qui ressort de diverses missions de prospection qui
ont abouti à l'établissement d'une cartographie minière.
En effet, les travaux de recherches géologiques ont permis de
découvrir d'importantes zones métalliques aurifères.
Nous avons par exemple de gisement filonien et de l'or
métal à Perma ; du fer à Loumbou-loumbou et à
Madékali ; de phosphates enrichis à Mékrou ; des
matériaux et combustibles fossiles tels que le calcaire, le marbre et
l'argile à Onigbolo et à Hlaw (Commune de Zogbodomey) ; le
kaolin, le sable siliceux et les graviers dans le Mono Couffo, et les pierres
ornementales (granodiorites, monzonites, rhyolites,...) ; la liste n'est pas
exhaustive. Tout ceci pour dire que des industries minières
spécialisées doivent être installées dans les
milieux propices pour relancer l'économie (la fiscalité y est).
S'agissant du niveau élevé d'abandon des
projets d'investissement agréés, la cause réelle
étant principalement le coût élevé de
procédures et les faux frais, puis en second rang le défaut de
financement, pour l'endiguer, il faut revoir les coûts de
procédures et mettre en place un système d'assistance
financière. En effet, doivent être revus à la baisse, les
frais d'étude de dossier, les frais de cabinet d'étude pour
l'Etude d'Impact Environnemental, les redevances à l'AZFI. Tous ces
frais seront désormais versés à la Banque Béninoise
d'Investissement11(*).
Mais les redevances peuvent ne plus être perçues compte tenu des
changements que nous apportons et exposons plus bas. Ces redevances sont
différentes des loyers de baux qui elles, sont et doivent être
dues sans interruption aucune. Elles ne concernent non plus les prestations
pécuniaires directement liées à l'exploitation d'une
richesse commune au pays, à l'extraction ou l'exploitation d'une
ressource minière ou naturelle. Il n'est donc pas question de supprimer
les redevances minières.
Pour maintenir le caractère dérogatoire, un
système de subventions doit être mis en place pour amoindrir la
charge aux entreprises agréées. Signalons que le soutien aux
exportations industrielles peut être assuré non seulement par des
moyens fiscaux mais aussi par des moyens monétaires, des moyens de
politique commerciale ou de crédit et surtout par le jeu des
subventions.
Il est aussi admis que les incitations financières
les plus importantes sont les subventions ; les prêts bonifiés et
les garanties de prêts sont aussi très courants.
La subvention en question pourrait être au taux de 40%
des investissements projetés ou 70% des impôts recouvrés.
Les impôts recouvrés doivent s'entendre ici des impôts
autrefois exonérés en régime intérieur et qui sont
en principe dus par chaque entreprise agréée. Il est important
qu'une structure prenne en charge un tel système ; d'où la
naissance d'une Banque Béninoise d'Investissement (BBI). Il sera
affecté à cette Banque, les impôts recouvrés chez
les entreprises agréées, les frais de procédure et de
dossier, elle octroiera des prêts aux investisseurs à jour
vis-à-vis du fisc, à un taux débiteur égal à
celui directeur de la BCEAO. La BBI gérera également les actions
de la
DNI12(*).
Même les frais d'étude de dossier d'agrément au CI
(désormais ZES) et les cotisations au FNI iront à la BBI. Cette
banque doit être perçue comme un instrument financier à la
disposition de DNI.
Précisons que le jeu des subventions est
limité dans le temps, au moment où l'entreprise peut voler de ses
propres ailes, ou à défaut, des durées d'agrément
prévues dans les textes initiaux.
Pour mieux appréhender la quantité des produits
fabriqués dans les zones, les entreprises seront tenues d'adopter une
comptabilité analytique informatisée. Il serait donc utile que
les personnes chargées des contrôles maîtrisent cet outil de
travail afin que toute anomalie soit décelée et justifiée
par le producteur.
Quand les exonérations et avantages fiscaux
deviendront des subventions, une myriade de mesures sociales sera prise et, le
débat ne se posera plus en termes de droits acquis, mais en termes de
droits à acquérir. Une période d'adaptation de cinq (05)
ans pourra être accordée aux entreprises agréées
à l'un ou à l'autre des paradis fiscaux. Pour les entreprises de
ce nouveau régime, afin de rendre disponibles et à temps les
subventions, un système de retenue à la source d'impôts
directs (surtout de l'IS) sera mis en place à un taux compris entre 5%
et 10% lors des importations. Les impôts indirects seront
acquittés dans les conditions de droit commun. Le système de
retenue à la source présente plusieurs avantages :
- avantage de sécurité : facilité pour le
fisc de recouvrer le reste ;
- avantage de rapidité : dès le moment où
la matière imposable prend naissance, l'impôt (ou du moins une
fraction de l'impôt) est encaissé et pourra immédiatement
servir certaines entreprises en quête de financement ;
- avantage de commodité : le fisc dispose d'un seul
interlocuteur (la douane) au lieu d'en avoir plusieurs
Toujours dans ce souci d'appui financier, l'amortissement
accéléré est la forme d'encouragement fiscal qui
présente le moins grand nombre des inconvénients propres aux
congés fiscaux, mais qui possède par ailleurs toutes les vertus
des crédits d'impôt et des déductions pour placements en
permettant, par surcroît, de combler les lacunes de ces dernières.
Paragraphe 2: Approches de solutions aux
problèmes spécifiques n°3 et n°4
Le cadre juridique béninois est peu propice à
l'attraction des investisseurs. Les opérateurs économiques le
confirment. La lourdeur de la procédure d'agrément et l'absence
de certains règlements d'application en sont les causes. Pour
remédier à cet état de chose, il faut une refonte de la
législation disponible.
En d'autres termes, il est impérieux de procéder
à l'édiction d'un code unifié des investissements qui, en
dehors d'une disposition commune, soulignera les particularités
liées aux ZFI et aux ZES (y compris les régimes de l'actuel CI).
Parlant du code unifié des investissements, il n'est pas question d'un
simple regroupement des textes en la matière, mais une harmonisation
avec des spécificités. Les premières actions doivent
consister à actualiser et appliquer rigoureusement les dispositions
légales et réglementaires de la ZFI (loi modificative,
décret d'application, différents arrêtés). En
attendant les réformes plus approfondies, il faut, à court terme,
la prise du décret et de l'arrêté qui porteront
d'application de la loi 2005-16 du 08 septembre 2005).
La procédure d'agrément doit être
simplifiée. Il importe ainsi de fixer un délai maximal à
ne pas dépasser, à compter de la date du dépôt du
dossier complet. Il s'agit notamment de réduire à deux (02)
semaines le délai de délivrance du certificat d'impact
environnemental qui prend habituellement deux(02) à six
(06) mois. De même, la loi doit fixer un délai
entre le dépôt et la délivrance du
récépissé de conformité du dossier ; par exemple un
examen sur-le-champ. Toujours dans une logique de simplification, il n'y aura
plus d'intervention par mandat dans la procédure d'instruction.
Il faudrait en outre spécifier les privilèges
aux cordons douaniers du régime des investissements structurant du
« CI » pour limiter la corruption, l'arbitraire. Les
différents régimes du « CI » seront adaptés
à nos suggestions et figureront dans la rubrique des Zones Economiques
Spécialisées du code unifié des investissements. De plus,
la création d'une brigade du service des douanes spécifique
à la ZFI et aux ZES, à l'image des dispositions de l'article 15
du décret 2003-400, est d'une nécessité impérieuse.
Toujours au plan législatif, il doit être procéder à
la définition avec les fournisseurs tels que la SBEE, la
SONEB et BENIN-TELECOM d'un système de prise en charge
des entreprises en ZFI. Autrement dit, un accord préalable va être
trouvé avec ces sociétés pour la consécration de
tarifs préférentiels, et le renforcement du potentiel d'action
des dites sociétés.
La mise en oeuvre de ces dispositions doit être
assurée par une structure bien organisée.
Par ailleurs, la résolution du problème que
constitue la multiplicité des structures intervenant dans le
système des investissements passe par la mise en place d'une
stratégie managériale conduite par des hommes avertis travaillant
au sein d'une même instance. En clair, il faut agir. A défaut
d'agir par certitude de réussir, il faut agir par conviction du devoir.
Il urge donc de donner vie à une Direction Nationale des Investissements
(DNI). La DNI doit être comprise comme étant une structure
simplifiée, autonome, de gestion des investissements, avec un conseil
d'administration. L'autonomie signifie que les dirigeants doivent jouir d'une
indépendance politique car il faudrait éviter que
l'instabilité du régime, par le jeu des alternances ou des
alliances politiques agisse sur la souplesse, la rigueur, le sens de
l'honneur, la responsabilité, le patriotisme, le nationalisme, le
dynamisme et l'abnégation qui doivent caractériser
l'équipe de la direction. Il s'agit d'une autonomie relative d'autant
plus que cette direction sera astreinte à l'obligation de
résultat ; c'est pourquoi elle doit disposer d'un conseil
d'administration qui se réunira régulièrement pour la
revue des tâches, les nouvelles orientations, les comptes rendus et
l'évaluation de la performance de la dite direction. La DNI comportera
deux départements : un public (pour les investissements publics) et un
privé (pour les investissements privés). Le Département
Public des Investissements (DPI) peut jouer le rôle de l'Agence Nationale
d'Exécution des Grands Travaux (ANEGT) que l'Etat envisage de
créer. Le Département des Investissements Privés (DIP)
regroupera les membres des structures clés de gestion et d'assistance
aux investisseurs du secteur privé. Ceci implique la suppression de
l'A-ZFI, de la DGCPI, de la DGDI, du CPI et de l'ABePEC, d'autant plus que
leurs attributions vont être entièrement prises en compte par la
DNI. La Direction Nationale des Investissements regroupera en outre des
techniciens à divers niveaux qui se chargeront, les uns de
l'étude des dossiers d'agrément, les autres du contrôle a
priori et a posteriori des investissements. Dans ces conditions il ne serait
plus opportun d'avoir à l'externe une commission technique des
investissements et une commission de contrôle des investissements.
En d'autres termes, ces différentes structures se
retrouveront en miniature dans le DIP. Le DIP comportera deux grandes divisions
: la division des industries pour la ZFI et la division des ZES. La DNI
gère la BBI et comporte les spécialistes en expertise
environnementale d'où la suppression de l'ABE.
Au sein de la DNI, il doit être créé un
service qui se chargera de :
- tenir les statistiques relatives à la ZFI et à
la ZES, en matière d'emplois créés, des exportations, des
importations, de la contribution au PIB de chaque entreprise
agréée ;
- recenser les besoins des industries en matière de
main d'oeuvre afin d'orienter la formation des jeunes non qualifiés ;
- fournir des renseignements susceptibles d'améliorer
les prestations des différentes zones.
L'opportunité de l'installation d'un service de
contentieux pourrait être analysée, afin d'accélérer
le traitement d'éventuels litiges entre les investisseurs
eux-mêmes ou entre un investisseur et la DNI. Un tel service pourra
recueillir les plaintes des investisseurs et faire des propositions.
Quelles sont alors les conditions de mise en oeuvre de ces
différentes mesures ?
SECTION 2 : Plaidoyer pour l'opérationnalisation
des solutions proposées.
L'essentiel de notre travail est mis en exergue suite aux
conditions de mise en oeuvre des solutions proposées.
Paragraphe 1 : Recommandations
Les solutions suggérées dans cette étude
nécessitent la contribution de tous les acteurs intéressés
pour rendre concrètes et effectives leurs manifestations curatives.
Elles interpellent au premier plan le Gouvernement béninois. Ce dernier
devra faire diligence et responsabiliser les intervenants à divers
niveaux, pour qu'ils s'engagent au plus tôt sur les pistes de solutions
dégagées. Ces solutions appellent à une réforme
législative et structurelle : par exemple, supprimer l'article 16 du CI
qui consacre le FNI, du fait de la création de la BBI ; réviser
l'organigramme de certains ministères tels que ceux en charge de
l'industrie, de l'analyse économique, de l'environnement etc.
L'Etat doit en outre s'investir plus dans le secteur
secondaire pour l'essor économique du pays. En effet, le secteur
industriel est toujours plus créatif, comme le témoigne le vieil
effet de flexion cher aux économistes : « lorsqu'en un endroit sont
créés cent (100) emplois tertiaires, le chômage ne diminue
que de vingt (20) ; lorsque ce sont des emplois industriels, le chômage
diminue de cinquante (50) ». Pour cela nous invitons le Gouvernement
à prendre les textes législatifs et réglementaires
créant et prévoyant l'aménagement des sites devant
accueillir les ZES. Si l'Etat estime qu'il ne dispose pas pour l'instant des
moyens financiers nécessaires pour la viabilisation de ces zones, il
doit être prévu que chaque entreprise désireuse de
s'installer procède à l'aménagement de sa portion, avec en
retour, un traitement fiscal et douanier exceptionnel pour, exclusivement, les
travaux y relatifs. Aussi l'Etat devra-t-il mettre plus l'accent sur la
promotion du nationalisme économique tout en recherchant les IDE. Il
serait donc souhaitable d'encourager les sociétés anonymes
nationales où l'on pourra compter des salariés actionnaires, des
managers actionnaires à côté des ?actionnaires»
actionnaires.
Par ailleurs il est aisé de remarquer que nous n'avons
pas touché aux privilèges fiscaux, au cordon douanier, des
entreprises agréées. Cela résulte de notre souci de
préserver les atouts du Port Autonome de Cotonou à la quête
permanente de la compétitivité, dans un espace communautaire
concurrentiel. Notre action limitée à la fiscalité
intérieure est mesurée et nécessaire car si la
fiscalité devenait intangible, la société serait
condamnée à l'immobilisme absolu. Tous les acteurs sont ainsi
invités à s'accorder sur une définition de l'impôt
qui satisfait à la fois le politique, le sociologue, l'économiste
et le juriste. Ne conviendrait-il pas de réaffirmer le principe
d'universalité de l'impôt ainsi que son corollaire, celui
d'égalité fiscale ? L'égalité fiscale doit rimer
avec la justice fiscale, une égalité de sacrifice, une
égalité dans les rapports.
En fait, une réforme communautaire s'avère
impérative pour revenir à cet
« idéal fiscal » car l'harmonisation
communautaire des normes fiscales est admise par tous comme facteur
d'intégration économique.
Signalons au passage que l'occident n'a pas vraiment
intérêt au développement de l'Afrique, parce que l'Afrique
constitue le réceptacle des produits industriels provenant du Nord, le
marché d'écoulement des ?out put» occidentaux. Or notre
plaidoyer vise à renverser la tendance ; c'est pourquoi nous insistons
pour que soient prises en compte les solutions proposées. Nous voulons
croire ici avec M. Kako NUBUPKO, Président de l'Association Africaine
d'Economie Politique, que « la recherche africaniste est vieille de ses
écoles de pensée et riche des faits stylisés issus de ses
multiples terrains de recherche. Il n'y a aucune raison que les solutions aux
problèmes que vivent les populations africaines soient corsetées
par les recettes du ?prêt-à-penser» idéologique,
provenant de Washington, de Francfort, de Paris et nous en oublions ».
En ce qui concerne l'administration fiscale, elle devra
collaborer pour faire aboutir les réformes fiscales envisagées ;
des réformes qui amélioreront les recettes budgétaires et
soulageront les investisseurs. L'on devra notamment souligner une
véritable collaboration entre la DNI et la DGID, entre la DGID et la
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), puis
entre la DGDDI et la DNI. Une sensibilisation sur le bien-fondé des
mesures projetées doit être organisée conjointement par le
Gouvernement et le Patronat béninois.
En définitive aucun animateur de la vie
économique, politique et sociale ne doit rester en marge de ce qu'il
convient de faire.
Paragraphe 2 : Synthèse de l'étude
Pour des raisons de commodité, nous avons
préféré mettre en lumière le fruit de notre travail
de recherche à travers un tableau synthétique. Ce tableau prendra
en compte le problème général et les problèmes
spécifiques, les objectifs poursuivis, les causes réelles des
problèmes vivants et les grandes lignes des approches de solutions.
Tableau n°09 : synthèse de
l'étude13(*)
|
Niveau d'analyse
|
Problèmes
|
Objectifs
|
Causes réelles
|
Diagnostic
|
Approches de solutions
|
|
|
|
|
|
|
|
Niveau général
|
(Problème général)
Le caractère peu dynamique du système des
investissements
|
Dynamiser le système des
investissements au
Bénin
|
-
|
-
|
-
|
NIVEAUX SPECIFIQUES

|
1
|
La faible créativité du régime fiscal des
investissements au
Bénin
|
Proposer les conditions requises pour un régime
fiscal productif des investissements
|
la non-garantie des déterminants de l'investissement et la
pluralité des régimes
d'exception
|
la faible créativité du régime fiscal des
investissements au Bénin est engendrée par la non-garantie des
déterminants de l'investissement et la pluralité des
régimes d'exception
|
- régler la question préalable du coût ou la
qualification de la main d'oeuvre, les équipements et infrastructures,
la disponibilité et la proximité des matières
premières, de l'énergie,...
- protection des droits de propriété intellectuelle
- faire obligation aux investisseurs étrangers de
sous-traiter 40% des investissements projetés aux nationaux
- aider les entreprises dans l'obtention du certificat des normes
ISO de la série 9000 - création des Zones Economiques
Spécialisées (ZES), entièrement viabilisées, dans
tous les Départements,
- accélérer les travaux de construction du
2ème port en eau profonde
- faire payer à toute entreprise agréée tous
les impôts dus en régime intérieur
- oeuvrer pour le libre accès aux marchés
extérieurs des produits ?made in Benin»
|
|
2
|
Le niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés
|
Déterminer les mesures idoines à prendre pour la
survie des projets agréés
|
Le défaut de financement et surtout le coût
élevé de procédures doublé des faux frais
|
Le défaut de financement et surtout le coût
élevé de procédures doublé des faux frais sont
à la base du niveau élevé d'abandon des projets
d'investissement agréés
|
- revoir à la baisse, les frais d'étude de dossier,
les frais de cabinet d'étude pour l'Etude d'Impact Environnemental, les
redevances à l'A-ZFI.
- subventionner au taux de 40% des investissements
projetés ou 70% des impôts recouvrés, les investisseurs
surtout locaux
- l'administration du jeu des subventions suscite la
création d'une Banque
Béninoise d'Investissement
- un système de retenue à la source d'impôts
directs (surtout de l'IS) sera mis en place à un taux compris entre 5%
et 10% lors des importations, pour les entreprises agréées
- autoriser la pratique d'amortissements
accélérés
|
Réalisé par Barthélémy
Yêtingnon MAGBONDE
|
3
|
le cadre juridique
peu satisfaisant
|
Relever les obstacles
réglementaires inhibant
l'attraction des capitaux
|
La lourdeur de la procédure d'agrément et l'absence
de certains règlements d'application
|
le cadre juridique peu satisfaisant résulte de la lourdeur
de la procédure d'agrément et de l'absence de certains
règlements d'application
|
- procéder à l'édiction d'un code
unifié des investissements, avec la prise immédiate de tous les
règlements y relatifs qui porteront modalités d'application -
trouver un accord avec les fournisseurs tels que la SBEE, la SONEB et
BENINTELECOM pour la mise en place de tarifs préférentiels, et le
renforcement de leur potentiel d'action
- simplifier la procédure d'agrément en fixant des
délais à chaque phase et en supprimant les interventions externes
ralentissantes
- spécifier les privilèges au cordon douanier du
régime des investissements lourds et structurants
|
|
4
|
une multiplicité de structures
intervenant dans le système des
investissements.
|
Contribuer à la mise en place
d'une structure simplifiée et
autonome de gestion des investissements
|
l'inefficacité de la stratégie managériale
des investissements
|
l'inefficacité de la stratégie managériale
des
investissements a donné lieu à une
multiplicité de structures intervenant dans le système.
|
- Mise en place Direction Nationale des investissements (DNI).
Autonome, avec un conseil d'administration ; elle comportera deux
départements : un public (pour les investissements publics) et un
privé (pour les investissements privés). Le Département
Public des Investissements (DPI) peut jouer le rôle de l'Agence Nationale
d'Exécution des Grands Travaux (ANEGT) que l'Etat envisage de
créer. Le Département des Investissements Privés (DIP)
regroupera les membres des structures clés de gestion et d'assistance
aux investisseurs du secteur privé. - la suppression de l'A-ZFI, de la
DGCPI, de la DGDI, du CPI, de l'ABePEC, et de l'ABE
- Réviser l'organigramme des ministères
touchés
|
Réalisé par Barthélémy
Yêtingnon MAGBONDE
CONCLUSION GENERALE
Le caractère peu dynamique du système des
investissements au Bénin constitue fondamentalement un handicap pour la
prospérité de l'économie béninoise. Sa
neutralisation interpelle plus d'un : le Gouvernement d'abord, les
investisseurs ensuite, les différents acteurs enfin. A divers niveaux de
la chaîne de prise de décision, il faut agir ; agir sur le
régime fiscal des investissements. Plus précisément, le
système des investissements nécessite une réorganisation,
aussi bien sur le plan fiscal que structurel. C'est dire que les
dérogations, fiscales en l'occurrence, méritent d'être
repensées pour le bien de l'économie nationale. Et c'est ce sur
quoi nous insistons dans la présente étude.
Le présent document constitue un outil d'aide à
la prise de décision, à la disposition de tous les acteurs
intéressés. Il traduit notre volonté à participer
et à apporter notre contribution, quoique modeste, à la
résolution des problèmes majeurs qui se posent à notre
époque.
Puisque tous les pays d'Afrique aspirent au
développement, à l'industrialisation, ne serait-il pas pertinent
de réfléchir sur la nécessité d'une
consécration des Etats-Unis d'Afrique ? Le scandale géologique
harmonisé de l'Afrique ne suffisait-il pas pour mettre le continent sur
orbite ? Les pistes de recherche sont ainsi ouvertes.
Bibliographie
vOuvrages et mémoires
ï Abibou ABOUBAKARI, (2005) : « Contribution
à l'amélioration du climat de l'investissement au Bénin
» ; ENAM-Bénin.
ï Fréjus LEKE, (2010) : « Contribution de la
fiscalité à l'amélioration du climat de l'investissement
privé au Bénin » ; ENAM-Bénin.
ï Hospice NOULEKOU, (2010) : « Réflexion sur
la rationalisation des mesures fiscales incitatives à l'investissement
pour un meilleur rendement fiscal » ; ENAM-Bénin.
ï Judicaël IDOHOU, (2012) : «
Problématique d'une meilleure pratique des régimes fiscaux
d'exception au Bénin » ; ENAM-Bénin.
ï Karim ADIDO, (2008) : « Régimes fiscaux
d'exception : une nécessaire rationalisation » ;
ENAM-Bénin.
ï Michel BOUVIER, (2010) : « La fiscalité
dérogatoire traduit la dégénérescence de l'Etat
», le ?Monde» du 24 septembre 2010 ;
ï Nicolas BERLOGEY, (1995) : « La sensibilité
de l'investissement à la fiscalité directe des entreprises et des
ménages » ;
ï OUMAN, (2000) : « La théorie des
exonérations fiscales » ;
ï Pierre PELLERIN, (2001) : « La rentabilité
du recours aux encouragements fiscaux pour promouvoir l'investissement »
;
ï Vito T. et Howel Z. (2001) : « Une politique
fiscale pour les pays en développement » ;
vTextes législatifs et
réglementaires
ï Ordonnance n°2008-06 du 05 novembre 2008 portant
modification des articles 11 nouveau, 33 nouveau, 47-1 et 47-2 de la loi
n°90-002 du 09 mai 1990, telle que modifiée par l'ordonnance
n°2008-04 du 28 juillet 2008 et instituant par les articles 47-4 à
47-8 le régime « E » relatif aux investissements structurants
;
ï Loi n°90-002 du 09 mai 1990 portant code des
investissements ;
ï Loi n°90-033 du 24 décembre 1990 modifiant
les articles 34 ; 41 ; 43 ; 47 ; 49 ; 51 ; 59 ; 62 et 74 de la loi
n°90-002 du 09 mai 1990 portant code des investissements ;
ï Loi n°99-001 du 13 janvier 1999 portant loi de
finances pour la gestion 1999 ;
ï Loi n°2005-16 du 8 septembre 2005 portant
régime générale de la zone franche industrielle ;
ï Loi n°2010 46 du 31 Décembre 2010 portant loi de finances pour la gestion
2011 ;
46 du 31 Décembre 2010 portant loi de finances pour la gestion
2011 ;
ï Code Général des Impôts,
édition 2011;
ï Arrêté n°236/MF/DC/DGID/MFMP du 17
Septembre 1996 portant généralisation de la procédure MP1
à toutes les exonérations ;
ï Arrêté n° 112/MEF/DC/SGM/DGID du 17
Février 2009 portant
Attributions, Organisation et Fonctionnement de la DGID ;
ï Arrêté n°38/MPREPE/DC/SG/DPI/SACI du
09 décembre 1998 portant modalités de demande d'agrément
aux régimes privilégiés et spécial du code des
investissements
ANNEXES
Annexe n°1
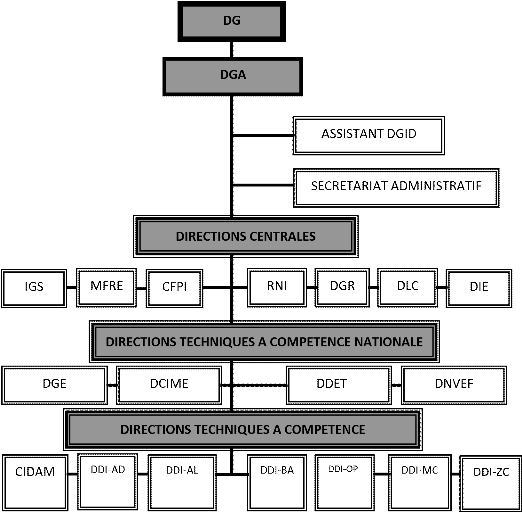
LEGENDES :
D.D.I.-A.D : Direction Départementale des
Impôts de l'AtacoraDonga
D.D.I-A.L : Direction Départementale des
Impôts de l'Atlantique et du Littoral
D.D.I.-B.A : Direction Départementale des
Impôts du Borgou et de l'Alibori
D.D.I.-O.P : Direction Départementale des
Impôts de l'Ouémé et du Plateau
D.D.I.-M.O : Direction Départementale des
Impôts du Mono et du Couffo
D.D.I.-ZC : Direction Départementale des
Impôts du Zou et des Collines
ANNEXE N°2
Au nombre des autres instruments que le Bénin met
à la disposition des investisseurs privés figurent :
Ø le Conseil Présidentiel de l'Investissement :
sous la direction du Président de la République, il formule
semestriellement des propositions et recommandation sur les questions se
rapportant au développement des investissements publics et privés
au Bénin. Il est composé de dix-huit (18) membres dont six (06)
investisseurs étrangers potentiels et six (06) investisseurs
béninois ;
Ø le Centre de Promotion des Investissements : elle a
pour mission de favoriser le développement et la promotion des
investissements au Bénin ; accueillir et conseiller les investisseurs
étrangers afin de faciliter la réalisation rapide de leurs
projets, et amorcer toutes mesures susceptibles d'améliorer le climat
des investissements au Bénin ;
Ø la Chambre de Commerce et d'industrie du Bénin
: elle a pour mission essentielle de représenter, de protéger,
d'assurer et de défendre les intérêts des acteurs
économiques auprès des pouvoirs publics, des institutions
privées nationales et des organismes extérieurs. Elle
héberge le Centre de Formalité des Entreprises ;
Ø l'Agence Béninoise de Promotion des Echanges
Commerciaux : organisme public dont la vision est de devenir une plateforme
d'information économique et commerciale, et un puissant instrument
d'accompagnement au service des investisseurs nationaux et étrangers ;
Ø le Conseil National du Patronat du Bénin : un
interlocuteur représentatif face aux pouvoirs publics pour la promotion
du secteur. Il comporte dixneuf (19) groupements professionnels.
Annexe n°3
Tableau : Evolution des projets
d'investissements agréés, abandonnés ou non
démarrés de 1991 à 2010.
|
1991 à 1995
|
1996 à 2000
|
2001 à 2005
|
2006 à 2010
|
|
Total des agréés
|
23
|
30
|
83
|
90
|
|
Total des abandons/non démarrés
|
6
|
9
|
32
|
43
|
|
Taux de
souffrance
|
26,1%
|
30%
|
38,55%
|
47,8%
|
Source: CPI, 2012.
Tableau : Evolution de la balance
commerciale du Bénin, de 2007 à 2011.
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Exportations
|
9,2
|
9,8
|
10,6
|
12,5
|
11,5
|
|
Importations
|
23,5
|
23,4
|
23,1
|
21,6
|
23,5
|
|
Balance Commerciale
|
-14,4
|
-13,7
|
-12,5
|
-9,1
|
-12
|
Source : INSAE, 2012
Annexe n°4
Modalités
Nombre d'observations
Fréquences relatives
Défaut de financement
22
,90%
44
Coût élevé de procédures et les
faux frais
24
48
,98%
Autres
03
6
,12%
Total
49
100
%
Source
:
résultats de
nos enquêtes.
Tableau : distribution des
données d'enquête relatives au problème spécifique
n°1.
Source
:
résultats de nos enquêtes.
Modalités
Nombre
d'observations
Fréquences
relatives
Non
-
garantie des déterminants de l'investissement
19
,78%
38
Absence d'industries lourdes
07
14
,29%
Pluralité des régimes d'exception
17
,69%
34
Autres
06
12
,24%
Total
49
100
%
Tableau : Distribution des
données d'enquêtes relatives au problème spécifique
n°2.
Tableau: distribution des
données d'enquêtes relatives au problème spécifique
Source : résultats de nos enquêtes.
Tableau: distribution des
données d'enquêtes relatives au problème spécifique
n°4.
Modalités
Nombre
d'observations
Fréquences
relatives
L'inefficacité de la stratégie
managériale des investissements
41
83
,67%
Le souci d'optimiser la gestion
du système
06
12
,25%
Autres
02
,08%
4
Total
49
100
%
Source
:
résultats de nos enquêtes.
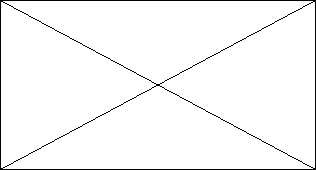
Annexe n°5
QUESTIONNAIRE
Madame/Monsieur bonjour.
Dans le cadre de la préparation et de la
rédaction d'un mémoire professionnel sanctionnant notre fin de
formation au cycle1 de l'ENAM, une étude se mène sur les
régimes dérogatoires au Bénin notamment
le code des investissements et le régime général
de la zone franche industrielle, en vue de l'amélioration du
système des investissements. Nous vous prions donc de bien vouloir
donner des éléments de réponses aux questions suivantes :
1) Qu'est-ce qui, selon vous, engendre la faible
créativité14(*) du régime fiscal des investissements au
Bénin ?
Réponse1
a) La non- garantie des déterminants de
l'investissement
b) L'absence d'industries lourdes
c) La pluralité des régimes d'exception
d) Autres (à préciser).....................
2) Qu'est-ce qui peut être à la base du niveau
élevé d'abandon des projets d'investissements
agréés?
Réponse2
a) Le défaut de financement
b) Le coût élevé des procédures, y
compris les faux frais
c) Autres (à
préciser).............................................
3) Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que le cadre
juridique béninois est peu favorable à l'investissement ?
Réponse3
a) L'absence de certains règlements d'application

b) L'absence de juristes compétents
c) La lourdeur de la procédure d'agrément
d) Autres (à
préciser)...................................................
4) Qu'est-ce qui a donné lieu à la
multiplicité des structures de gestion intervenant dans le
système des investissements au Bénin ?
Réponse4
a) L'inefficacité de la stratégie
managériale des investissements
b) Le souci d'optimiser la gestion du système
c) Autres (à
préciser)...........................................................
Infiniment merci de votre franche participation.
TABLE DES MATIERES
|
DEDICACE
|
i
|
|
REMERCIEMENTS
|
ii
|
|
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
|
iii
|
|
LISTE DES TABLEAUX
|
v
|
|
LISTE DES GRAFIQUES
|
vi
|
|
LISTE DES ANNEXES
|
vii
|
|
GLOSSAIRE
|
viii
|
|
RESUME
|
x
|
|
SOMMAIRE
|
xii
|
|
INTRODUCTION GENERALE
|
1
|
|
CHAPITRE PRELIMINAIRE
|
2
|
CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ETUDE, OBSERVATIONS DE STAGE ET
CIBLAGE DE LA PROBLEMATIQUE 2
SECTION1 : Cadre institutionnel et restitution des
observations de stage
6
Paragraphe1 : Présentation de la Direction
Générale des Impôts et des
Domaines (DGID) 6
|
I-Description générale de la DGID
|
6
|
|
A°) Historique et organisation de la
DGID
|
6
|
|
B°) Attributions et missions
II- Présentation ciblée des structures
intervenant dans le système en observation. 11
|
8
|
|
A°) Description de la DLC et de la MFRE
|
11
|
|
B°) Description de la RPI/DGE
Paragraphe2 : Etat des lieux sur la fiscalité des
investissements au
Bénin. 15
|
15
|
|
I°) Examen de quelques régimes fiscaux
dérogatoires
|
15
|
|
A-) Constats au niveau du CI et de la ZFI
|
16
|
|
B°) Gestion fiscale des régimes fiscaux
dérogatoires
|
24
|
|
II°) Inventaire des atouts et des problèmes
|
25
|
|
A°) Inventaire des atouts 25
B°) Inventaire des problèmes 26
SECTION2 : Ciblage de la problématique. 27
Paragraphe1 : Choix de la problématique et
justification du sujet. ..... 27
|
|
I-Identification des problématiques possibles et
choix de la
|
|
|
problématique de l'étude
|
27
|
|
A°) Présentation des problématiques
identifiées
|
28
|
|
B°) Choix proprement dit de la problématique
|
29
|
|
II°) Justification du thème
|
30
|
|
A°) Rappel de la problématique
|
30
|
|
B°) Formulation du thème
Paragraphe2 : Spécification de la
problématique et détermination des séquences de
résolution de la problématique
spécifiée.
32
|
31
|
|
I-Spécification de la problématique
|
32
|
|
A°) Fondements
|
32
|
|
B°) Spécification proprement dite
|
32
|
|
II-Séquences de résolution de la
problématique spécifiée
|
34
|
|
A°) Enumération des séquences
|
34
|
|
B°) Organisation des séquences
|
34
|
|
CHAPITRE PREMIER
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DU CADRE THEORIQUE ET
|
36
|
|
METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE
|
36
|
|
SECTION1 : Cadre théorique et méthodologique de
l'étude
Paragraphe1 : Cadre théorique de l'étude
37
|
37
|
|
I-Des objectifs à l'élaboration du tableau
de bord de l'étude
|
37
|
|
A°) Rappels des problèmes et
présentation des objectifs
|
37
|
|
B°) Hypothèses liées à la
problématique de l'étude
|
38
|
|
II-Revue de littérature
|
41
|
|
A°) Les mémoires de fin de formations
universitaires et autres ouvrages 42
|
B°) Forums africains et internationaux, et
séminaires de haut niveau sur
les investissements privés.
44
Paragraphe2 : Choix de la méthodologie de
recherche 46
I-Le pourquoi et comment de l'enquête
46
A°) Finalités et cadre de l'enquête
46
B°) Les outils de mobilisation, de
dépouillement et de présentation des
|
données.
|
47
|
|
II-Approches théoriques employées
|
48
|
|
A°) Choix de théorie appropriée
|
48
|
|
B°) Choix du seuil de décision
|
48
|
|
SECTION2 : Collecte des données et établissement
du diagnostic.
Paragraphe1 : Mobilisation des données,
difficultés rencontrées et
limites des données. 49
|
49
|
|
I-Organisation des enquêtes
|
49
|
|
A°) Préparation des enquêtes
|
49
|
|
B°) Réalisation des enquêtes
|
49
|
|
II-Difficultés et limites
|
50
|
|
A°) Difficultés rencontrées
|
50
|
|
B°) Limites des données.
|
50
|
Paragraphe2 : Analyse des données et
établissement du diagnostic......... 51
|
I°) Présentation et analyse des
données.
|
51
|
|
A°) Données relatives aux problèmes
spécifiques n°1 et n°2.
|
51
|
|
B°) Données relatives aux problèmes
spécifiques n°3 et n°4.
|
54
|
|
II-/ Etablissement du diagnostic
|
55
|
|
A°) Degré de vérification des
hypothèses
|
55
|
|
B°) Synthèse du diagnostic
|
57
|
|
Chapitre deuxième
|
59
|
POUR LA DYNAMISATION DU SYSTEME DES INVESTISSEMENTS AU
BENIN 59
SECTION 1 : Réflexions suggestives. 60 Paragraphe
1 : Approches de solutions aux problèmes spécifiques n°1 et
n°2 60
Paragraphe 2: Approches de solutions aux
problèmes spécifiques n°3 et
n°4 67
SECTION 2 : Plaidoyer pour l'opérationnalisation des
solutions proposées. 70
|
Paragraphe 1 : Recommandations
|
70
|
|
|
Paragraphe 2 : Synthèse de l'étude
|
73
|
|
|
CONCLUSION GENERALE
|
|
76
|
|
Bibliographie
|
|
78
|
|
ANNEXES
|
|
80
|
|
TABLE DES MATIERES
|
|
88
|
* 1 Voir l'annexe n°3
pour le tableau correspondant 3 Il s'agit du code des
investissements.
* 2Voir l'annexe n°3 pour
les données.
* 3 Voir l'annexe n°2 pour
le rôle de chaque structure dans le système des investissements au
Bénin
* 4 Les trois auteurs sont des
anciens étudiants de l'ENAM.
* 5 Un quotidien français
* 6 Séminaire du 28
février au 1er mars 2006 à Tunis (Tunisie)
* 7 Organisée à
Cotonou du 29 au 31 octobre 2012.
* 8 Les 8 et 9 novembre 2012
à Abidjan en Côte d'Ivoire.
* 9 Voir en annexe n°5,
l'exemplaire du questionnaire utilisé.
* 10 La faible
créativité s'entend ici de la non-atteinte des objectifs majeurs
non seulement sur le plan fiscal mais aussi sur le plan macroéconomique.
* 11 Voir plus loin pour son
existence.
* 12 Voir le paragraphe 2 pour
son existence.
* 13 Les pistes de solutions
mentionnées dans ce tableau synthétique sont très
partielles (pour rester dans le cadre défini par l'ENAM). Pour mieux
cerner les différents aspects de ces dernières, il est
préférable de se référer au texte lui-même.
* 14 La faible
créativité s'entend ici de la non-atteinte des objectifs majeurs
non seulement sur le plan fiscal mais aussi sur le plan macroéconomique.



