CHAPITRE I: DU CONTEXTE A LA METHODOLOGIE
Ce chapitre traite en cinq sections la problématique de
la gestion des déchets dans une métropole africaine, la ville de
Ouagadougou en l'occurrence. Il s'agit du contexte et de la justification, des
objectifs, des hypothèses, de la définition des concepts, ainsi
que de l'approche méthodologique de la présente étude
intitulée : « SIG et gestion des déchets solides à
Ouagadougou : Cas du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo ».
1.1. Le contexte et la justification de
l'étude
Si les déchets constituent aujourd'hui un
problème majeur en milieu urbain, cette perception est relativement
récente. S. Barles (2005) montre que longtemps les ordures issues des
activités humaines, quelles soient ménagères ou
liées aux activités économiques, ont constitué un
bien monnayable. Ainsi, beaucoup de petits métiers, comme les
chiffonniers, existaient grâce à la présence de ce que l'on
n'appelait pas encore déchets. A l'instar de la capitale
française, Ouagadougou à l'arrivée des explorateurs
donnait une image considérée insalubre au regard des perceptions
d'aujourd'hui. Ainsi, le capitaine Binger décrivait Ouagadougou en ces
termes lors de son passage en 1892 : Je m'attendais à trouver
quelque chose de mieux que ce qu'on voit d'ordinaire comme résidence
royale dans le Soudan, car partout on m'avait vanté la richesse du Naba,
le nombre de ses femmes et de ses eunuques. Je ne tardai pas à
être fixé, car le soir même de mon arrivée, je
m'aperçus que ce que l'on est convenu d'appeler palais et sérail
n'est autre chose qu'un groupe de misérables cases entourées de
tas d'ordures autour desquelles se trouvent des paillotes servant
d'écuries et de logements pour les captifs et les griots.
A l'époque, ce qui est considéré comme un
dépotoir par le colonisateur sert de fumure dans les champs de case. Y.
Déverin Kouanda (1993) dans sa thèse portant sur la
représentation et la gestion de l'environnement en pays mosse
explique la place du Taampure (tas d'ordures).
Les déchets jouent un rôle important. Il s'agit
d'objets considérés sans déchéance, qui ont
toujours une utilité sous une forme ou sous une autre (L.
Albigès, 2007). L'excrément animal, la matière
végétale ont une destination finale pour l'agriculture ou
l'élevage. Le « taampure » constitue également une
sorte de jalon marquant la limite entre le domaine familial et
l'extérieur (J. Etienne, 2004).
L'arrivée des colonisateurs impose un modèle
urbain calqué sur un plan géométrique. Désormais,
à l'habitat dispersé succède la concentration de la
population sur de petits espaces (les parcelles). Or, en pays mossi, la
dispersion de l'habitat allait, jusqu'à présent, de pair avec le
tas d'ordures proches de la cour qui devient alors objet de
désagrément concomitant aux changements de modes de vie (Y.
Deverin-Kouanda, 1993).
Les décennies suivantes ont confirmé la
difficile gestion des ordures ménagères. La croissance urbaine
mal maîtrisée par les autorités municipales a
contribué à la multiplication des déchets à travers
la ville et particulièrement en périphérie.
En 2004, sous l'égide du bureau d'étude canadien
DESSAU-SOPRIN, un Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD)
était mis en place. L'objectif principal était d'améliorer
la collecte des déchets ménagers notamment par la mise en place
de centres de pré-collecte (au nombre de trente cinq) et d'un centre
d'enfouissement technique implanté en périphérie nord de
la capitale. Par ailleurs, la ville était découpée en 12
zones dont la gestion était attribuée à des entrepreneurs
privés ou des Groupements d'Intérêt Economique (GIE).
Il est rapidement apparu qu'une partie des déchets
collectés pouvaient faire l'objet d'une valorisation contribuant d'une
part à une diminution des tonnages enfouis au CTVD dont le site de
regroupement des déchets est prévu pour durer 10 ans, et d'autre
part, à la création d'activités génératrices
de revenus.
Le Projet Stratégie de Réduction des
Déchets Solides de Ouagadougou -Création d'emploi par des actions
de collecte, de tri et de valorisation (PSRDO-CER) a été
créé en 2009 comme un élément de réponse
à ces observations.
Ce projet, initié par la commune de Ouagadougou en
collaboration avec l'Initiative Développement Stratégique
(Organisation Non Gouvernementale de solidarité et de coopération
internationale basée en France), la Communauté Urbaine de Lyon
(France), le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement
à faible coût (Institution Inter-états regroupant 17 pays
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dont le siège est basé
à Ouagadougou au Burkina Faso) et l'Association de Volontariat et de
Coopération Internationale (LVIA Italie), se propose de contribuer
à donner une plus value aux déchets en les valorisant. Il s'agit
également de participer à la réduction de la
pauvreté, tout en participant à assainir les quartiers,
grâce à l'implication des ménages et des opérateurs
économiques, producteurs de
déchets et à la mobilisation des associations de
quartier impliquées dans la filière de collecte et de traitement
des déchets.
Afin de préciser et de tester la méthodologie,
le projet se limite à deux zones d'intervention : la zone de
pré-collecte 12 qui regroupe les secteurs 20, 21 et 22 (arrondissement
de SigNonghin) et la zone de pré-collecte 6 qui est composée en
partie du secteur 30 (arrondissement de Bogodogo). Ces zones concernent des
quartiers périphériques défavorisés,
caractérisés par un déficit d'accès aux services
sociaux de base et qui sont l'objet d'une restructuration en cours dans le
cadre du projet « Projet de désenclavement des quartiers
périphériques de Ouagadougou et d'accès aux services
essentiels », sur financement de l'Agence Française de
Développement (AFD).
Les premières activités du PSRDO-CER ont
porté sur la connaissance précise de l'existant en matière
de gestion des déchets (contexte, opérations engagées,
producteurs de déchets, etc.), des éléments indispensables
à une meilleure planification des actions futures. Cette étude
s'inscrit dans cette étape préliminaire. Elle pose l'application
SIG comme un outil susceptible de participer à une meilleure
connaissance des pratiques actuelles. Ce travail pose la double contrainte
cadre universitaire et professionnel et impose donc une obligation de
résultats appliqués dans un cadre conceptuel tourné vers
la recherche fondamentale.
1.2. Les objectifs
L'objectif principal de cette étude est de créer
une base de données spatialisées, donc gérée sous
SIG, dont le but est l'optimisation des circuits de collecte des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et des Groupement d'Intérêt Economiques
(GIE) oeuvrant dans le secteur de la collecte des déchets. Il s'agit
également de capitaliser les informations disponibles en vue de mieux
suivre et évaluer les performances des actions qui seront menées
dans le cadre du (PSRDO- CER) et concernant le volet collecte des
déchets organisé par la Municipalité. Le secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo constitue le cadre de l'étude.
Quatre objectifs spécifiques sont fixés :
- identifier les acteurs de la gestion des déchets ;
- définir l'utilité d'un SIG ainsi que des
indicateurs d'analyse spatiale pour la gestion des ordures
ménagères ;
- cartographier le siège des associations de collecte
des déchets, les abonnés aux services de pré-collecte des
déchets du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo, et les circuits
des collecteurs ;
- identifier les types de points de regroupement des
déchets utilisés par les opérateurs de précollecte
du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo et déterminer les
quantités théoriques de déchets qui y sont
transférés.
1.3. Les hypothèses
Dans l'optique d'améliorer nos connaissances sur la
gestion des déchets solides dans la
ville de Ouagadougou, nous posons l'hypothèse
principale que le SIG constitue un outil efficace de capitalisation, d'aide
à la décision et de suivi-évaluation des actions en
matière de gestion des déchets ménagers.
De cette hypothèse principale, découlent quatre
hypothèses spécifiques :
- les acteurs intervenant dans la gestion des déchets
solides à Ouagadougou sont clairement identifiés et
catégorisés ; chacun d'eux jouant un rôle bien
déterminé dans le cycle de gestion des déchets ;
- le SIG est un outil qu'on peut appliquer à la gestion
des ordures ménagères ;
- la répartition spatiale des abonnés par
opérateurs de pré-collecte des déchets au secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo repose sur une logique territoriale ;
- les centres de collecte du secteur 30 de l'arrondissement de
Bogodogo, tous fonctionnels constituent les points de regroupement
privilégiés de la quasi-totalité des déchets
collectés dans le secteur.
1.4. La définition des concepts
Cette partie donne une définition des mots et termes
consacrés que nous avons utilisés dans ce rapport. Le lecteur
pourra donc aborder dans les chapitres suivants le vocabulaire avec plus de
facilité.
Base de données: C'est un
ensemble de données qui correspond à une représentation
fidèle des données d'un domaine avec un minimum de contraintes
imposés par le matériel. C'est donc une entité dans
laquelle, il est possible de stocker des données de façon
structurée, exhaustive et sans redondance.
Déchets : Il existe plusieurs
définitions du terme « déchets » ; cependant pour les
besoins de cette étude, nous retiendrons celles relatives à la
loi française du 15 juillet 1975 et aux conventions de Bâle et de
Bamako.
Selon la loi française du 15 juillet 1975, un
déchet est tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou
tout généralement tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l'abandon. Ce sont les mêmes termes qui
ont été retenus pour définir les déchets dans le
code de l'environnement burkinabé.
Les conventions de Bâle et de Bamako entendent par
« déchet », des substances ou objets, qu'on élimine,
qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en
vertu des dispositions du droit national.
En toute logique, on englobe sous terme « déchets
» tous les déchets solides, liquides et gazeux qui ont un impact
négatif sur l'environnement. Les déchets solides étant des
matériaux mis au rebut et qui ne sont pas évacués par le
biais de canalisations comme les eaux usées et les boues.
Gestion des déchets : C'est
la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la
réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement
ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs
effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou
l'agrément local. C'est un processus qui intègre à la fois
la production des déchets et leur traitement. La production correspond
aux choix des produits à la source, à leur utilisation, à
leur valorisation. Le traitement correspond au tri des déchets, à
leur collecte, au transport, et au traitement et/ou le stockage des
déchets.
La gestion des déchets concerne tous les types de
déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun
possédant sa filière spécifique. Les manières de
gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un
pays développé ou en voie de développement, dans une ville
ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un
industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques
pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est
habituellement sous la responsabilité des autorités locales,
alors que la gestion des déchets des industriels est sous leur propre
responsabilité.
Recyclage : C'est un
procédé par lequel les matériaux qui composent un produit
en fin de vie (généralement des déchets industriels ou
ménagers) sont réutilisés en tout ou en partie. Pour la
plupart des gens dans les pays développés, le recyclage regroupe
la récupération et la réutilisation des divers
déchets ménagers. Ceux-ci sont collectés et triés
en différentes catégories pour que les matières
premières qui les composent soient réutilisées.
Système d'Information Géographique
(SIG) : Les Systèmes d'Information
Géographiques, nés dans les années 60 au Canada, ont
été définis par plusieurs auteurs. Selon la
Société française de Photogrammétrie et de
télédétection (1989) les SIG sont : «Un
système informatique permettant, à partir de diverses sources, de
rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner,
d'élaborer et de présenter des informations localisées
géographiquement (géoréférencées)
».
Selon R Randremanana et al. (2001), un SIG peut
être défini comme « Un ensemble de données de
nature diverse, structurées de façon à être
gérées facilement et dont le point commun est d'être
géoréférencées, c'est-à-dire être
repérées dans l'espace, à l'aide de coordonnées
géographiques. »
Nous retiendrons pour les besoins de notre étude la
définition de P Givaudan (2009) pour qui les Systèmes
d'Information Géographiques « associent des composantes
matérielles, logicielles et humaines afin de définir et
décrire un espace géographique, de le connaître, de le
gérer et de prendre des décisions le concernant.
».C'est un ensemble de données repérées dans
l'espace structurées de façon à pouvoir en extraire
commodément des synthèses utiles à la décision.
Valorisation des déchets : Elle
consiste dans " le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant
à obtenir, à partir de déchets, des matériaux
réutilisables ou de l'énergie". C'est
l'objectif des politiques de gestion des déchets, en plus
de la prévention. Deux types de valorisation sont retenus : la
valorisation matière et la valorisation énergétique.
1.5. L'approche méthodologique
Elle a consisté à rechercher la documentation
sur la gestion des déchets solides dans les pays en développement
et plus particulièrement au Burkina Faso. Les principales sources de
documentation ont été le Centre Régional pour l'Eau
Potable et l'Assainissement à faible coût (CREPA siège),
l'Université de Ouagadougou, ainsi que la mairie de la ville de
Ouagadougou.
La revue de la littérature relative à la gestion
des déchets en milieu urbain comme à Ouagadougou est riche.
Toutefois, nous avons privilégié 4 documents qui constituent des
axes de recherche en réponse aux objectifs posés lors de notre
stage.
DESSAU-SOPRIN, SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES DECHETS
DE OUAGADOUGOU (2000) propose une organisation intégrée
de toutes les activités reliées à la gestion des
déchets et des aménagements appropriés. Il fournit
également les cadres financier, institutionnel et réglementaire
propres à assurer la gestion efficace des déchets selon le
concept de quartier propre qui a été préalablement
établi dans un plan d'action devant permettre au Gouvernement du Burkina
Faso d'atteindre les objectifs reliés à la gestion des
déchets solides et assignés par le vaste projet d'environnement
urbain, soit le 3ème Projet de Développement Urbain
(PDU) sous la responsabilité du Projet d'Amélioration des
Conditions de Vie Urbaines (PACVU).
MAS.S, VOGLER.C. (2006) dans le cadre d'un
stage réalisé au CREPA ont réalisé un état
des lieux des transformations des déchets solides de la ville de
Ouagadougou et recensé les filières de valorisation. Il ressort
de cette étude que, la mise en oeuvre progressive du schéma
directeur de gestion des déchets porte ses fruits bien que certaines
difficultés sont observées au niveau de la pré-collecte et
de l'évacuation des déchets.
NIKIEMA/Meunier. A (2007) s'est
intéressée à la gestion des déchets à
travers une analyse
essentiellement descriptive des pratiques
déclarées par les chefs de ménages lors du
Recensement
Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1996. De cette
analyse, il
ressort que les comportements en matière
d'élimination des déchets se traduisent par une opposition
spatiale centre périphérie. En effet, dans les quartiers
centraux, la majorité des ménages utilisait à cette
époque les bacs mis à leur disposition. Dans l'auréole
péricentrale hétérogène cohabitent des
ménages convertis à l'utilisation de poubelles avec d'autres
évacuants encore simplement leurs déchets dans la rue. Certains
quartiers comme les 1200 logements, la zone du bois, la patte d'oie et plus
ponctuellement ceux ou sont implantés les cités de la
période révolutionnaire s'individualisent par leur abonnement
à un service privé de ramassage des ordures. Dans la
périphérie, on observe un mode d'évacuation dans la rue
s'apparentant aux pratiques villageoises fondées sur le rejet des
ordures ménagères à l'extérieur de la cour.
SCHERRER M. (2007) à partir d'une
étude réalisée à Ouahigouya (Burkina Faso) a
élaboré une base de données (BD) et un Système
d'Information Géographique (SIG) contenant des informations relative
à la gestion des déchets de la ville et permettant
d'évaluer les performances du système mis en place.
La base de données, créée avec le
logiciel Access, regroupe diverses informations concernant les
opérateurs de pré-collecte des ordures ménagères,
les points de regroupement des déchets présents dans la ville, la
décharge, ainsi que la production de déchets de la population de
Ouahigouya. Quant au SIG, il a été réalisé avec le
logiciel Arc View. Il comporte différentes cartes thématiques
présentant les résultats d'analyse des données tels que le
taux d'abonnement au service pré- collecte des déchets,
différentes statistiques sur la population de Ouahigouya ou encore
l'état et la localisation des bacs publics.
Il convient toute fois de noter que, compte tenu du
délai imparti pour le travail, les outils mis en place n'ont pas
été totalement finalisés car signale l'auteur, toutes les
données nécessaires n'ont pas pu être obtenues. De ce fait,
plusieurs cartes thématiques n'ont pas pu être
créées car aucune information sur les abonnées n'a pu
être obtenue. Aussi, le géoréférencement
c'està-dire l'attribution des coordonnées géographiques
réelles aux éléments du SIG n'a pas été
possible à cause des raisons citées plus haut.
1.5.1. L'échantilonnage
Le secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo, zone
d'intervention du PSRDO-CER, a été retenu comme site
d'étude. Les activités ont porté sur le recensement des
associations collectrices de déchets, et des ménages
abonnés aux services de pré-collecte de la zone
d'étude.
Le tableau suivant dresse l'état des associations
opératrices de collecte des déchets de notre zone d'étude
et du nombre de leurs clients.
Tableau 1 : Les associations de
pré-collecte des ordures ménagères du secteur 30 et leurs
clients.
|
Numéro d'ordre
|
Nom de l'association
|
Nombre d'abonnés de l'association
|
|
1
|
Association Souto-Nooma
|
150
|
|
2
|
Association Sougre- Nooma
|
1268
|
|
3
|
Association Santé plus
|
417
|
|
4
|
Association Yilemdé
|
573
|
|
5
|
Association Cosalu
|
120
|
|
Totaux d'abonnés du secteur 30
|
2735
|
Source : PSRDO, Résultat d'enquête
Cinq opérateurs de pré-collecte de déchets
officiellement déclarés se partagent donc le territoire du
secteur 30. Ces derniers totalisent un nombre d'abonnés estimé
à 2735.
Nos activités devaient consister au
géoréférencement de l'ensemble des abonnés de la
zone. Or, il est rapidement apparu que le temps disponible pour cette
étude serait trop court pour finaliser les activités du
calendrier de travail. Un échantillon a donc été
défini sur la base des associations. Les associations Sougr-Nooma et
Cosalu représentant respectivement la plus grande association (avec un
nombre total d'abonné estimé à 1268) et la plus petite
association (avec un nombre total d'abonnés estimé à 120)
ont été retenues. Ce choix avait pour but de comparer les
différences de fonctionnement selon la taille de la structure. Ainsi,
nos travaux ont porté sur 1388 clients, soit un taux de couverture du
secteur 30 d'environ 51% (figure 1).
Figure 1 : Les résultats atteints à
l'issue de la phase de collecte des données
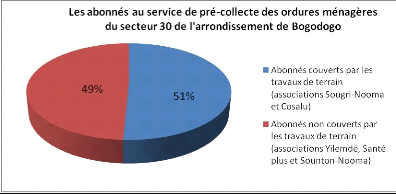
Source : PSRDO-CER, Résultat d'enquête
1.5.2. La collecte des données
Elle s'est appuyée sur différents outils.
Un guide d'entretien (cf. annexe 1) a été
adressé aux services municipaux ; cela dans le but d'obtenir de plus
amples informations sur les caractéristiques sociodémographiques
de la ville de Ouagadougou, de connaître le schéma d'organisation
de la filière déchets et le rôle de la commune dans la
gestion des ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou.
Le relevé des coordonnées géographiques
des sièges des opérateurs de pré-collecte des
déchets solides, des abonnés aux services de pré-collecte
et des points de regroupement des déchets du secteur 30 a
été réalisé par Global Positioning System (GPS).
Des fiches d'identification étaient parallèlement remplies
à l'aide des propriétaires. Pour valider ces relevés, une
carte sur support papier était utilisée pour matérialiser
la position de l'abonné.
Un guide d'observation des points de regroupement des
déchets a permis de compléter le panel d'outils
utilisés.
D'une manière générale, les
enquêtes nous ont permis de recueillir des informations sur la gestion
des déchets solides, sur le profil sociodémographique et
économique des opérateurs de collecte et de leurs
clientèles, ainsi que sur les destinations desservies et la
répartition du marché de collecte entre les opérateurs.
1.5.3. Les variables de l'étude
Les variables d'études définissent les besoins
d'informations pour tester les hypothèses de notre travail. En
regroupant les objectifs spécifiques, les hypothèses, les
variables, la population cible et les outils de collecte, nous obtenons le
tableau suivant. Ce tableau est nommé : grille conceptuelle.
Tableau 2 : Grille conceptuelle
|
Objectifs spécifiques
|
Hypothèses
|
Variables
|
Population cible
|
Outils de collecte des données
|
Echelle d'observation
|
|
Identifier les acteurs de
|
Les acteurs
|
-Type et nombre d'acteurs
|
-Commune de
|
-Exploitation de
|
Secteur 30 de
|
|
la gestion des déchets
|
intervenant dans la
|
intervenant dans la filière
|
Ouagadougou
|
documents
|
l'arrondissement
|
|
dans la zone d'étude
|
gestion des déchets
|
déchets au secteur 30.
|
|
existants
|
de Bogodogo
|
|
solides à
|
|
-CREPA
|
|
|
|
|
-Types d'activités se
|
|
-Guide d'entretien
|
|
|
Ouagadougou sont
clairement
identifiés et catégorisés ; chacun
d'eux
jouant un rôle bien déterminé dans le cycle de gestion des
déchets.
|
rapportant à la gestion des
déchets solides dans
le
secteur 30 de Ouagadougou.
|
-Entreprise CGMED
-Les opérateurs de pré-
collecte
|
-Fiche d'identification
|
|
|
Objectifs spécifiques
|
Hypothèses
|
Variables
|
Population cible
|
Outils de collecte de données
|
Echelle d'observation
|
|
Définir l'utilité d'un SIG
ainsi que des
indicateurs
d'analyse spatiale pour
la gestion des ordures
ménagères.
|
Le SIG est un outil qu'on peut appliquer à la gestion
des ordures ménagères.
|
-Les fonctions du SIG
-Les avantages fournis par le SIG dans le domaine de la gestion
des déchets.
|
-CREPA
-Commune de
Ouagadougou
-Entreprise CGMED
|
- Exploitation de documents existants.
|
Commune de
Ouagadougou, secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo.
|
|
|
|
-Les opérateurs de pré-
collecte
|
|
|
|
Cartographier le siège
|
La répartition
|
Le nombre d'abonnés au
|
-Commune de
|
-Guide d'entretien
|
Commune de
|
|
des associations de
collecte des déchets, les
abonnés aux services
de
|
spatiale des abonnés
par opérateurs de
pré-collecte des
|
service de pré collecte.
-La satisfaction des abonnés
par rapport à la
prestation
|
Ouagadougou -CREPA
|
-Fiche d'identification
|
Ouagadougou, secteur 30 de
l'arrondissement
|
|
pré-collecte des déchets
du secteur 30 de
l'arrondissement de
|
déchets au secteur 30
de l'arrondissement
de
Bogodogo repose
|
des opérateurs de pré-
collecte.
|
-Les opérateurs de pré-
collecte
|
-Relevé GPS
|
de Bogodogo.
|
|
Bogodogo, et les circuits des collecteurs.
|
sur une logique
territoriale.
|
-Les zones de couverture de chaque opérateur de
précollecte.
|
-Les abonnés au service de pré-collecte des
déchets.
|
|
|
|
Objectifs spécifiques
|
Hypothèses
|
Variables
|
Population cible
|
Outils de collecte de données
|
Echelle d'observation
|
|
identifier les types de
|
les centres de
|
- Les centres de pré-
|
-Direction de la Propreté
|
Exploitation de
|
Commune de
|
|
points de regroupement
|
collecte du secteur
|
collecte
|
-Projet PSRDO-CER
|
documents
|
Ouagadougou,
|
|
des déchets utilisés par
|
30 de
|
|
|
existants
|
secteur 30 de
|
|
|
- L'état des bacs publics et
|
|
|
|
|
les opérateurs de pré-
collecte du secteur 30 de
|
l'arrondissement de
Bogodogo, tous
|
des sites de transit.
|
--CREPA
|
-Guide d'entretien
|
l'arrondissement de Bogodogo
|
|
|
|
-Entreprise CGMED
|
|
|
|
l'arrondissement de
|
fonctionnels
|
-La couverture spatiale des
|
|
-Fiche
|
|
|
Bogodogo et déterminer
les quantités
théoriques
|
constituent les points
de regroupement
|
bacs publics et des sites de transit
|
-Les opérateurs de collecte
|
d'identification
|
|
|
de déchets qui y sont transférés.
|
privilégiés de la
quasi-totalité des
déchets collectés
dans le secteur.
|
-La fréquence de vidange des bacs et des sites de
transit.
|
-Les abonnés au service de pré-collecte des
déchets.
|
-Relevé GPS
--Guide d'observation
|
|
1.5.4. Les outils de traitement de
données
Le traitement des données collectées a
été effectué sous diverses formes :
- le transfert des données du GPS vers un fichier Excel a
été réalisé avec le logiciel GPS expert.
- Une base de données créée avec le
logiciel MS Access a regroupé les diverses informations concernant les
opérateurs de collecte des ordures ménagères, les
ménages abonnés à ce service, ainsi que les points de
regroupement des déchets dans ces secteurs.
- couplé à MS Access le logiciel SIG Arc View 3.2 a
été utilisé aussi bien pour des requêtes spatiales
que pour des représentations cartographiques.
De façon générale, il est à noter
que, les analyses ont été réalisées avec MS Excel,
MS Access, ArcView; cela suivant la nature des informations
recherchées.
1.5.5. Les difficultés
rencontrées
La réalisation de cette étude a été
jalonnée de nombreuses difficultés qui ont nui à
l'exhaustivité de la base de données. Ce sont :
- la réticence de certains enquêtés :
parler des pratiques d'assainissement n'est pas chose aisée car c'est
toucher à la vie privée des personnes. De ce fait, nous avons
été confrontés à la réticence voire au refus
de communication de certaines personnes ;
- les contraintes liées au climat : la campagne de
collecte de données s'est déroulée en saison chaude du 15
mars au 25 avril 2010. Compte tenu du temps disponible pour cette étude
et afin de recenser le maximum d'abonnés, les enquêtes
débutaient à 7h pour se terminer à 18h30, quelque soit le
jour de la semaine.
CHAPITRE II : DE L'ETUDE DU MILIEU A LA PRESENTATION
DE LA FILIERE DECHETS
Ce chapitre traite, en deux sections, des
généralités sur la gestion des déchets solides
à Ouagadougou. D'une part, il présente le milieu de
l'étude, d'autre part, l'historique et les acteurs de la gestion des
déchets.
2.1. Présentation du milieu de
l'étude
Le cadre général de notre étude est la
ville de Ouagadougou. Elle est située entre 12° 18 et 12° 36
de latitude nord et 1° 26 et 1° 36 de longitude ouest. Les limites
communales vont audelà de la limite urbanisée. En effet, les
limites de la commune se fondent sur celles de la province du Kadiogo. La
commune compte trente (30) secteurs urbains et dix-sept (17) villages
périphériques et est découpée administrativement en
cinq (05) arrondissements (cf. carte 1).
Carte 1 : Présentation de la commune de
Ouagadougou
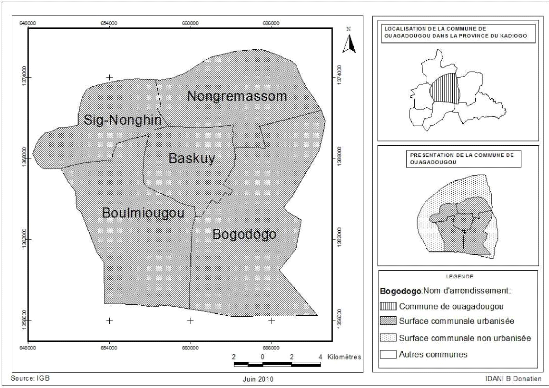
2.1.1. Influence des aspects physiques sur la gestion des
déchets
Le relief de la ville de Ouagadougou est monotone. Il est
constitué d'une vaste pénéplaine appelée couramment
« plateau mossi » qui correspond à l'affleurement du socle
granitogneissique ancien et qui occupe près de 85% de la superficie du
pays. Il s'élève à une altitude de 250 à 300
mètres (Kietiyeta, 2003). Cette platitude du relief rend plus facile la
collecte des ordures ménagères d'autant plus que la quasi
majorité des véhicules utilisés pour la collecte sont
à traction asine.
Sur le plan climatique, Ouagadougou est sous l'influence de la
zone soudanienne du climat tropical sec. La ville comme tout le reste du pays
connaît une saison pluvieuse qui dure de juin à septembre (4
mois), et une saison sèche d'environ huit mois, qui s'étend
d'octobre à mai. La pluviométrie moyenne annuelle se situe entre
700 et 900 millimètres avec 60% des précipitations qui se
concentrent entre juillet-août (Direction de la
météorologie nationale, 2003). Durant la période
hivernale, les acteurs de la filière déchets rencontrent divers
problèmes liés à la collecte et à
l'évacuation des ordures. Cela n'est pas sans conséquences. En
effet on peut noter des troubles environnementaux (nuisances olfactives chez
certains abonnés et aux alentours des dépotoirs) et des cas de
maladies (paludisme et bronchite notamment) chez les collecteurs de
déchets qui sont presque tout le temps contraints de braver la pluie
pour accomplir leur tache quotidienne.
Les températures sont sous l'influence des deux grandes
saisons. Pendant la saison des pluies, la température diurne est
d'environ 26°C. Elle atteint une moyenne de 42°C pendant la saison
sèche avec cependant, quelques fortes baisses au mois de décembre
-janvier (température minimale moyenne de 19°C). En termes de
gestion des déchets, il convient toutefois de noter que les fortes
températures ont une influence sur la décomposition
précoce de diverses matières dont celles organiques contenues
dans les déchets. Cela engendre des nuisances olfactives et peut
également être sources de divers problèmes de
santé.
Deux principaux vents soufflent sur Ouagadougou. On distingue
l'Harmattan, un vent sec et actif soufflant d'octobre à mai et la
Mousson un autre vent qui soufflant de mai à octobre apporte de
l'humidité. Ces vents sont souvent responsables de la dispersion des
divers déchets plastiques (sachets plastiques utilisés comme
emballages) et toxiques (piles) pouvant entraîner des conséquences
extrêmement graves pour la santé des habitants et l'environnement
urbain.
Sur le plan hydrologique, Ouagadougou est située dans
le bassin versant du Massili (affluent du Nakambé). La présence
de trois barrages (n°1, 2 et 3) permet de constituer des retenues d'eau
pour la ville. Ces retenues se succèdent sur un talweg qui s'allonge
d'Ouest en Est. Quatre marigots drainent l'ensemble des eaux de ruissellement
vers la zone de dépression. Ces marigots ont été
aménagés en caniveaux à ciel ouvert et ont prit
respectivement les noms de : Canal du Kadiogo, Canal du Centre, Canal de
Wemtenga, et Canal de Zogona. Ces différents canaux jouent un rôle
important dans l'évacuation des eaux pluviales de la ville. Mais le
manque d'entretien de ces ouvrages en fait de véritables lieux de
dépotoir où stagnent des eaux usées de toute sorte et
parfois également des déchets solides.
2.1.2. Profil socio-économique de la ville de
Ouagadougou
En termes de gestion des déchets solides, le profil
socio-économique de la population est particulièrement important
dans la mesure où de nombreuses études ont montré que le
statut économique impliquait une production d'ordures souvent plus
importante et d'une composition différente d'un ménage à
l'autre.
D'après les résultats du dernier Recensement
Générale de la Population et de l'Habitation (RGPH), la ville de
Ouagadougou comptait 1 475 223 habitants en 2006. La pyramide des âges de
Ouagadougou à l'image de celle du Burkina Faso a la physionomie
classique d'une pyramide des villes des pays en développement : une base
élargie correspondant à une population majoritairement jeune
s'effilant doucement vers les classes les plus âgées. L'habitat
ouagalais forme un paysage composite ou se côtoient le moderne et
l'ancien, et ou cohabitent diverses formes d'habitats alliant le banco
traditionnel et le béton. Du point de vue de l'équipement,
Ouagadougou présente un profil très différencié.
Elle donne de ce fait l'image d'une ville à plusieurs vitesses avec un
coeur loti, équipé et desservi par des réseaux d'adduction
en eau et en électricité, de voiries, de caniveaux etc., qui
offre un certain confort individuel aux résidents du centre, une
périphérie viabilisée mais ne disposant pas de la
totalité de ces équipements et enfin une auréole
extrême correspondant aux périphéries non loties au sein
desquelles les résidents dépendent des équipements
collectifs disponibles dans les quartiers réguliers plus ou moins
proches, voire parfois dans les villages alentours.
Le profil de la population est donc très
différencié selon les quartiers, cependant la gestion des
déchets répondant à une logique administrative (les
limites communales) englobe une diversité de situations.
L'arrondissement de Bogodogo, qui s'étend sur 105 km2 au
sud-est de la commune de Ouagadougou, a été retenu comme site
d'étude (cf. carte n°2). Le secteur 30 a fait l'objet d'une
attention particulière puisqu'il constitue le site d'intervention du
projet PRSDO-CER, structure d'accueil de notre stage.
Carte 2 : Présentation de l'arrondissement
de Bogodogo
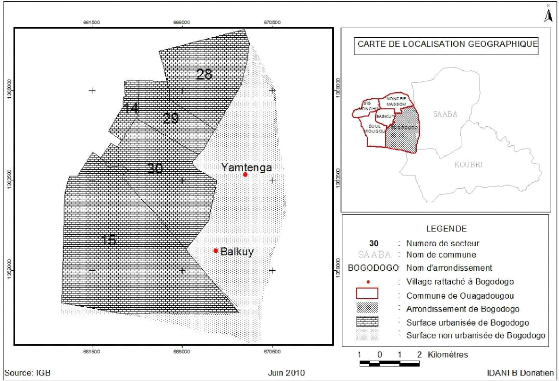
Avec une population estimée à 108119 habitants
(RGPH 2006), le secteur 30, site de notre étude est partagé entre
un habitat loti et un habitat non loti. L'alimentation en eau potable dans ce
secteur est essentiellement assurée par l'ONEA, des forages à
motricité humaine et, dans quelques rares cas des puits
traditionnels.
De grands éléments structurent le secteur. On
distingue, le Secrétariat Permanent du Salon International de
l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), un Centre Médical avec Antenne
chirurgicale (CMA) et la SONABEL.
2.2. Présentation de la filière
déchet 2.2.1. Historique de la gestion des déchets
Depuis l'indépendance du pays en 1960,
différents modes de gestion des déchets ont été mis
en place dans la ville de Ouagadougou avec plus ou moins de succès.
Ainsi, la régie municipale actrice principale de la
gestion des déchets et de l'assainissement de la ville depuis 1958
concède la responsabilité de la filière au privé
(société Nakoulma) en 1968. Entre 1979 et 1986, le manque de
moyens financiers conduit la collectivité municipale à une
rupture du contrat avec cette entreprise. La commune procède alors,
à travers son service de la voirie, à l'enlèvement et
à l'enfouissement des ordures dans les bancotières de la ville,
jusqu'en 1986.
A partir de cette date, la Direction Nationale des Services
d'Entretien de Nettoyage et d'Embellissement (DINASENE) prend le relais. Elle
est transformée en Office en 1988. Cependant, incapable d'assurer la
charge de la collecte dans l'ensemble de la ville, l'ONASENE est contraint de
se soumettre au Partenariat Public-Privé (PPP). La collecte de la
redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères oscille
entre 300 et 1000 FCFA (Bayili, 1996). L'ouverture de ce nouveau secteur
d'activités favorise la multiplication des entreprises ; Cependant
aucune structure officielle ne vient régir ce marché qui ne
respecte pas la réglementation environnementale dans la mesure où
les déchets sont dispersés par les acteurs de la collecte dans
des lieux non appropriés, parfois à quelques centaines de
mètres seulement de là où ils avaient été
collectés.
En 1993, la dégradation de la situation conduit la mairie
à reprendre la gestion de ce secteur par l'intermédiaire de la
Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM).
A partir de 2000, la municipalité
bénéficie du soutien de la Banque Mondiale à travers le
2ème et le 3ème Projet de Développement Urbain (PDU). Ce
projet a eu pour objet d'asseoir les bases du principe du «pollueur
payeur» par la récupération partielle des coûts de
fonctionnement. En 2001, à la faveur de la décentralisation et de
la mise en oeuvre du Plan Stratégique d'Assainissement de la ville de
Ouagadougou (PSAO), la commune se dote d'une direction qui s'occupe de la
propreté et de l'assainissement de la ville.
De concert avec le Projet d'Amélioration des Conditions
de Vie Urbaine (PACVU), le 3ème PDU favorise la création des
structures privées de gestion des déchets et améliore les
possibilités locales de valorisation. Aussi, soutient-il selon les
recommandations du Schéma Directeur de Gestion des Déchets, la
construction de trente cinq (35) centres de transit des déchets solides
et la réalisation du Centre d'Enfouissement Technique (CET) en 2001
devenu de nos jours le Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (CTVD). Les trente secteurs (30) de la ville de Ouagadougou sont
alors divisés en douze (12) zones de collecte dont la gestion est
confiée aux entrepreneurs privés et aux GIE et en trois lots pour
le transport des déchets à destination du CTVD.
Carte 3 : Présentation de la filière
déchet
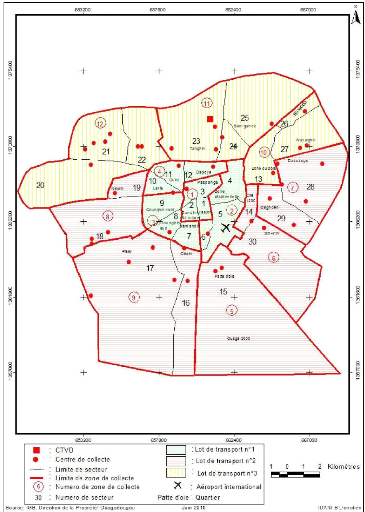
2.2.2. Les acteurs de la gestion des déchets
solides
La filière déchets regroupe plusieurs acteurs
qui concourent à sa mise en oeuvre. Au Burkina Faso, la Politique et
Stratégie Nationale d'Assainissement (PNSA) distingue cinq principaux
types d'acteurs aux rôles différents. Ce sont l'Etat, les
collectivités territoriales, le secteur privé, les populations et
leurs organisations, et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Pour ce
qui concerne le cas spécifique de la ville de Ouagadougou, on distingue
:
+ L'Etat
Plusieurs départements ministériels
interviennent dans la filière déchets solides mais le
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (MECV) joue un
rôle prépondérant ; à ce titre, il assure :
- l'élaboration de la Stratégie Nationale
d'Assainissement ;
- la définition du cadre juridique applicable à la
gestion des déchets
- la réalisation d'études d'impact et de suivi
environnemental du CTVD
+ La Direction de la Propreté (DP) : une structure
rattachée à la commune
Au Burkina Faso, la décentralisation a
conféré aux communes la gestion de l'assainissement. Ainsi, le
maire de Ouagadougou est chargé sous le contrôle du conseil
municipal de veiller à:
- la protection de l'environnement et de prendre en
conséquence les mesures propres à empêcher ou à
supprimer la pollution et les nuisances ;
- la protection des espaces verts et contribuer à
l'embellissement de la commune.
Pour atteindre ces objectifs, il se fait quotidiennement
accompagner par la Direction de la Propreté (DP), une structure
créée à cet effet.
Créée en mai 2001 par arrêté portant
organisation de la mairie de Ouagadougou, la DP assure cinq missions
principales :
- le nettoiement et la collecte des déchets ;
- le transport des déchets à partir des centres de
collecte jusqu'au centre technique de valorisation des déchets ;
- le traitement et la valorisation des déchets ;
- la prévention des pollutions et nuisances ;
- le curage des ouvrages hydrauliques (caniveaux, canaux) ;
D'une manière générale, pour la collecte et
la pré-collecte des déchets, la DP utilise des bennes tasseuses,
des camions portes-bacs et portes bennes ainsi que des bacs.
+ Le Projet Stratégie de Réduction des
Déchets de Ouagadougou (PSRDO) : Un outil au service de la
commune
Le Projet Stratégie de Réduction des
Déchets de Ouagadougou- Création d'Emplois et de Revenus par des
actions de tri et de valorisation (PSRDO-CER), est un projet initié par
la commune de Ouagadougou en collaboration avec l'Initiative
Développement Stratégique (IDS), la Communauté Urbaine de
Lyon, le Centre Régional de l'Eau Potable et d'Assainissement à
faible cout (CREPA) et l'Association de Volontariat et de Coopération
Internationale (LVIA). Avec un budget global estimé à un million
cent vingt cinq milles six cents soixante quinze (1.125.675) euros, c'est un
projet d'une durée de vie de 3 ans dont le lancement a eu lieu le 10
juin 2009. Il a l'ambition de fédérer tous les acteurs
concernés par la filière des déchets (administration,
opérateurs de collecte, ménages) autour de nouveaux
systèmes rentables et durables de gestion du tri, collecte, compostage
et valorisation.
Carte 4: Localisation géographique du
PSRDO/CER et de son champ d'action
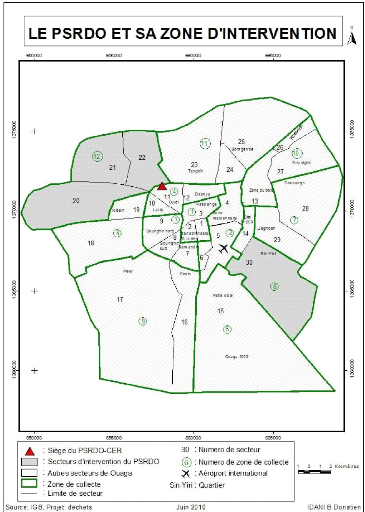
+ Les entreprises privées
Depuis le début des années 90, compte tenu de
l'ampleur des tâches et de l'insuffisance des moyens du secteur public,
on assiste à une implication progressive des acteurs du secteur
privé dans la gestion des ordures. Ces entreprises interviennent
notamment dans la précollecte, le transport des déchets solides
des centres de collecte vers le CTVD, ainsi que dans la gestion de ce
même CTVD. A titre illustratif, l'entreprise CGMED est adjudicataire de
la zone de collecte n°6 qui contient les secteurs n°14 et 30 de la
ville.
Pour ce qui concerne le transport des déchets, il
convient ici de signaler qu'il incombe à l'entreprise EBTE (Entreprise
Burkinabè des Travaux et d'Equipement) de s'occuper du transport des
déchets du lot n°3 ; le transport des lots n°1 et n°2
(auquel appartient le secteur 30) étant toujours à la charge de
la commune.
La gestion du CTVD quant à elle est assurée par
l'entreprise ECHA (Entreprise de Construction et de l'Habitat). A ce titre,
elle a en charge l'enfouissement des déchets, ainsi que le
contrôle des pollutions dues à l'activité
d'enfouissement.
+ Les associations et groupements
Les structures communautaires (associations, groupements)
comme les entreprises privées font la pré-collecte dans les
différents secteurs de la ville de Ouagadougou.
Le fonctionnement de ces dernières est très
distinct. En effet, d'un côté, nous distinguons des
fédérations d'associations qui bien que menant une vie
associative sont par le biais des Groupements d'Intérêt Economique
(GIE) adjudicataires par appel d'offre des zones de collecte où elles
exercent. De l'autre côté, ce sont les entreprises privées
concessionnaires des zones de collecte qui confèrent des autorisations
d'exploiter des sous parties de leurs zones à des associations contre
redevance de sous-traitance.
C'est ainsi que, dans l'arrondissement de SIG NOGHIN, nous
avons des associations de collecte qui sont adjudicataires d'une zone de
collecte. Pour être adjudicataires, ces associations ont dû se
regrouper en GIE Action pour la Protection de l'Environnement et payent chacune
au GIE une cotisation mensuelle de 10.000 F.
A BOGODOGO (précisément au secteur 30), il n'y a
pas de GIE et les associations n'ont pas de relation entre elles. Elles sont
sous-traitantes de l'entreprise privée CGMED, adjudicataire de la zone
de collecte. Ces associations ont d'abord été de petites
structures informelles qui se sont par la suite regroupées pour former
les associations sous l'impulsion d'une personne, en général une
femme, qui n'intervenait pas dans la collecte mais seulement dans la gestion.
Ainsi, cette dernière mettait les outils à la disposition des
femmes et se chargeait des fiches d'abonnés et de la collecte des
redevances. La motivation principale de ces femmes pionnières
était le souci de la préservation de l'environnement dans leur
quartier. Ces associations au départ informelles ont dû prendre le
statut d'association de Loi n°10/92/ADP (portant Liberté
d'association) pour pouvoir répondre à l'appel d'offre en 2005
que lançait l'entreprise CGEMED qui était devenue concessionnaire
de la zone de collecte. Les contrats d'enlèvement des ordures se font
sous le nom de CGMED et les associations collectrices de déchets doivent
en échange payer une redevance équivalente à 20 % des
recettes. Les contrats avec GCMED étaient pour une durée d'un an
renouvelable. En juin 2009, CGMED a signé des contrats avec ses
sous-traitants pour trois ans correspondant à la durée de vie du
PSRDOCER.
+ Les Partenaires Techniques et Financiers
(PTF)
Des organisations non gouvernementales appuient techniquement
et/ou financièrement le secteur de la gestion des ordures
ménagères dans la ville de Ouagadougou.
Pour ce qui concerne les domaines de la recherche et de l'appui
technique, nous distinguons principalement :
L'Institut International d'Ingénierie pour
l'Eau et L'Environnement (2ie)
- Participation à l'élaboration de la
Stratégie Nationale d'Assainissement ;
- Réalisation d'études sur la gestion des
déchets. L'Université de Ouagadougou
(UO)
- Participation au comité de contrôle et de suivi
Environnemental (CCSE) ;
- Réalisation d'études sur la gestion des
déchets.
Le Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST)
- Participation au Comité de Contrôle et de Suivi
Environnemental (CCSE) du CTVD. Jumelage du Grand Lyon avec la
Commune de Ouagadougou
- Fourniture de matériel à la DP ;
- Appui à la formation des cadres municipaux.
Le Centre Régional pour l'Eau Potable et
l'Assainissement à faible coût (CREPA)
- Réalisation d'études et de projets pilotes sur la
pré-collecte et la valorisation des déchets ;
- Formation des acteurs de la filière ;
- Participation aux activités d'Information, d'Education
et de Communication (IEC) dans le domaine de l'assainissement.
Outre les aspects techniques, la filière de gestion des
déchets est aussi soutenue sur le plan financier. Les aides proviennent
d'organismes très différents. On peut citer : la Banque Mondiale,
l'Union Européenne, le FAARF, l'Ambassade d'Allemagne, le CREPA,
l'UNICEF, le Ministère de la Promotion de la Femme, Projet National
Karité (PNK), et Promo Femme.
| 


