|

N°d'ordre NNT : 2018LYSE3034
THÈSE de DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE
LYON
Opérée au sein de
l'Université Jean Moulin Lyon 3
École Doctorale de Droit-ED 492
Discipline de doctorat : Droit international
et relations internationales
Soutenue publiquement le 06/07/2018, par :
Arsène Désiré NENE BI
L~())(&7,9,7(~'(6~'52,76~'(E/~ENFANT EN COTE D'IVOIRE
: ENTRE NORMES INTERNATIONALES ET REALITES LOCALES
Devant le jury composé de :
Monsieur DOUMBE-BILLE Stéphane,
Professeur des Universités, Université Jean Moulin Lyon 3
Monsieur BARRIERE Louis-Augustin, Professeur des
Universités, Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de
thèse
Monsieur LAGHMANI Slim, Professeur,
Université de Carthage (Tunis)
Madame BOUCAUD Pascale, Professeur,
Université Catholique de Lyon
Madame N'DRI-TEHOUA Pélagie, Maître
de Conférences, Agrégée de droit public,
Vice-Présidente de l'Université Alassane Ouattara
(Bouaké-Côte d'Ivoire), Rapporteur Monsieur MARTIAL
Mathieu, Professeur des Universités, Université de
Grenoble Alpes, Rapporteur
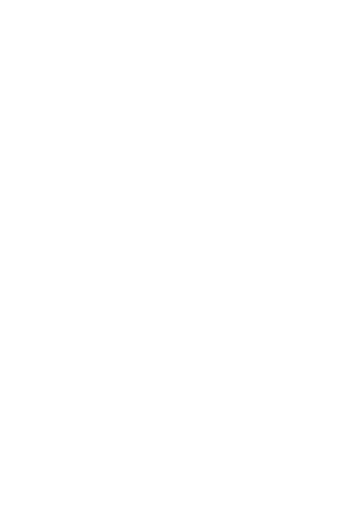
À mon fils Eliakim Enzo Noah NENE BI À tous
les enfants de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier

Remerciements
Mes premiers remerciements vont à Monsieur le
Professeur Louis-Augustin BARRIERE, mon directeur de recherche ; Merci Monsieur
Le Professeur pour votre patience et votre encouragement. Votre oeil critique
m'a été très précieux pour structurer le travail et
pour améliorer la qualité de la réflexion. Merci
également à Mme Sandrine CORTEMBERT qui m'a initié au
monde de la recherche en acceptant la direction de mon mémoire de
recherches de Master 2. Avec votre distance bienveillante, vous n'avez
cessé d'être une conseillère, un soutien et un appui pour
moi. Puissiez-vous ici trouver l'expression de ma sincère gratitude.
À ces rencontres du premier jour, répondent les
rencontres du dernier jour : celles avec le jury de thèse ; Je remercie
les membres du Jury et les rapporteurs qui ont consacré beaucoup de leur
temps et de leur énergie à la lecture et à
l'évaluation de ce travail universitaire permettant d'accéder au
titre de docteur en droit public. Je tiens à vous remercier
chaleureusement.
Je remercie également les membres du Centre Lyonnais
d'Histoire et de la pensée politique et ceux du centre de droit
international pour leur soutien durant ces années. Par ailleurs, mes
gratitudes sont aussi envers l'Université Jean Moulin Lyon 3 et
l'Institut des droits de l'Homme de Lyon. Ma reconnaissance est profonde pour
la France qui m'a adoptée et m'a donné une opportunité de
participer à l'oeuvre du rapprochement franco-ivoirien ; Mention
spéciale à la Fondation de France qui m'a permis de
réaliser mon projet de spécialisation en droits humains.
Je remercie mes amis et ma famille pour ce qu'ils sont, tout
simplement. En particulier, je veux exprimer à mes parents toute la
reconnaissance qui est la mienne pour leur confiance et leur présence
à mes côtés, discrètement mais
profondément.
Enfin, il y a la rencontre de ma vie, mon épouse,
Salimatou DIARRA épouse NENE. Mes sentiments s'adressent aujourd'hui
principalement à toi. Il est rare de rencontrer une personne si
généreuse, si compréhensive et il est encore plus rare de
partager sa vie avec elle. J'ai cette chance extraordinaire. Puisse le Seigneur
te bénir davantage.

LISTE DES ABREVIATIONS
SIGLE Libellé
Aff. Affaire
AFDI Annuaire Français de droit international
Al Alinéa
ANE. Acteur Non Etatique
Art. Article
Ass. Plén. Assemblée Plénière de
la Cour de Cassation
Bull Bulletin
C/ Contre
CADBE Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant
CADHP Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
C.civ Code civil
CEDH. .Cour Européenne des droits de l'homme
CIDE Convention Internationale relative aux Droits de
l'Enfant
CE Conseil d'Etat français
Chron. Chronique
C.I.J. Cour Internationale de Justice
Civ Chambre civile de la Cour de Cassation
Coll. Collection
CP Code Pénal
CPI. Cour pénale internationale
CPP Code de Procédure Pénale
CRDF Cahier de la recherche sur les droits fondamentaux
Crim Chambre criminelle
CS Cour Suprême
D. Dalloz
DDHC. Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen
DUDH. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Éd. Editions
FANCI. Forces Armées Nationales de Côte
d'Ivoire
FLGO. Front de Libération du Grand Ouest
FPI. Front Populaire Ivoirien
GAJA. Grands Arrêts de la Jurisprudence
Administrative
GAJC Grands Arrêts de la Jurisprudence Civile
Gaz. Pal. Gazette du palais
Idem. Dans le même ouvrage cité
Ibid. / Ibidem. Le même
In Publié dans, paru dans
J.O. Journal Officiel
J.O.R.C.I. Journal Officiel de la République de
Côte d'Ivoire
L.I.D.J. Librairie Ivoirienne de Droit et de Jurisprudence
L.G.D.J Librairie Générale de droit et de
jurisprudence
MP. Ministère Public
MPCI Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire
MPIGO. Mouvement Populaire Ivoirien du Grand Ouest
NEI. Nouvelles Editions Ivoiriennes
N° Numéro
Obs. Observations
OIT. Organisations Internationale du Travail
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
Op. cit. Opere citato ; cité plus haut.
OUA. Organisation de l'Unité Africaine
P. Page
PDCI. Parti Démocratique de Côte d'Ivoire
PIT. Parti Ivoirien des Travailleurs
Pp. Pages
PIDCP Pacte International des Droits Civils et Politiques
PIDESC Pacte International des Droits Economiques et Sociaux
Culturels
PUCI. Presses Universitaires de Côte d'Ivoire
PUF Presses universitaires de France
R.A.D.H Recueil africain des droits humains
R.A.D.I.C Revue africaine de droit international
comparé
R.C.A.D.I. Recueil des cours de l'académie de droit
international de la Haye
R.D.L.F. Revue des droits et libertés fondamentaux
RDR. Rassemblement des Républicains
R.F.D.C Revue française de droit constitutionnel
R.F.S.P Revue Française de Science Politique
R.G.D.I.P Revue Générale de droit international
Public
R.J.P.I.C. Revue Juridique et politique, indépendance
et coopération
RPDP. Revue Pénitentiaire et de droit pénal
R.Q.D.I. Revue québécoise de droit
international
RCJCS. Répertoire Chronologique de la Jurisprudence
Cour Suprême
RTDC. Revue trimestrielle de droit civil
R.T.D.H. Revue Trimestrielle des droits de l'Homme
R.U.D.H. Revue Universelle des droits de l'Homme
S. Suivants
S/dir. Sous la direction de
SFDI Société Française de droit
international
Sp. Spécialement, précisément
T. Tome
TGI. Tribunal de Grande Instance
TPD. Tribunal de Premier Degré
TPI. Tribunal de Première Instance
UA Union Africaine
UNESCO Organisation des nations unies pour l'éducation,
la science et la
culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
V Voir
Vol. Volume

Sommaire
INTRODUCTION GENERALE 13
PREMIÈRE PARTIE : L'INTEGRATION EN DROIT IVOIRIEN
DES NORMES
INTERNATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT
55
Titre I : UN DISPOSITIF JURIDIQUE AU CONTENU REEL
59
Chapitre I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES
INSTRUMENTS
PROTEGEANT LES DROITS DE L'ENFANT 62
Chapitre II : LA RECEPTION NATIONALE DES DROITS
INTERNATIONAUX DE
L'ENFANT 125
Titre II : DES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE GARANTIE A
EFFECTIVITE
LIMITEE 199
Chapitre I : LE ROLE LIMITE DES MECANISMES
GOUVERNEMENTAUX 201
Chapitre II : L'IMPORTANCE VARIABLE DES INSTITUTIONS
D'APPUI ET DE
CONTROLE 259
SECONDE PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES
DROITS DE
L'ENFANT A L'EPREUVE DES REALITES LOCALES 341
Titre I : DES MANIFESTATIONS PREOCCUPANTES DE
L'INEFFECTIVITE 343
Chapitre I : LES ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT EN
PERIODE DE PAIX
346
Chapitre II : DES ATTEINTES D'UNE GRAVITE PARTICULIERE
EN SITUATION
DE GUERRE OU D'URGENCE 420
Titre II : LES CONDITIONS D'UNE EFFECTIVITE AMELIOREE
492
Chapitre I : L'IDENTIFICATION DES CAUSES D'INEFFECTIVITE
DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'ENFANT 494
Chapitre II : LES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR D'UNE
EFFECTIVITE
AMELIOREE 570
CONCLUSION GENERALE 633
ANNEXES : 637
BIBLIOGRAPHIE 650
INDEX 725
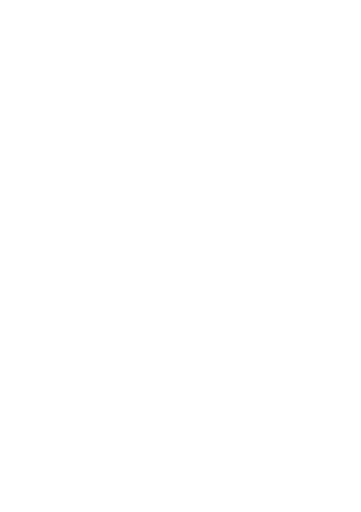
13
INTRODUCTION GENERALE
« Pour interroger l'avenir, nous n'avons pas besoin
des projections des super ordinateurs. Pour une grande part, le prochain
millénaire est déjà visible à la façon dont
nous nous occupons de nos enfants aujourd'hui. Le monde de demain pourra bien
être influencé par la science et la technologie, mais nous pouvons
l'entrevoir considérant, avant toute chose, la façon dont nous
prenons soin du corps et de l'esprit de nos enfants1 ».
Cette assertion de l'ancien Secrétaire
Général des Nations Unies, Monsieur Kofi ANAN, qui place l'enfant
au centre de la vie sociale et du développement d'un pays, indique
également qu'il est un être vulnérable qui doit
nécessairement être protégé. Ainsi, dans ce monde en
pleine mutation, l'une des questions qui se pose avec acuité est celle
de savoir s'il y a réellement un avenir réservé aux droits
de l'enfant ?
Faisant un parallèle entre la création du moteur
à explosion et l'idée des droits de l'homme, Monsieur Kenneth
MINOGUE affirme : « Le moteur à explosion permet de se
déplacer rapidement tandis que les droits de l'homme représentent
un système de protection destiné à nous préserver
de la violence arbitraire et à éviter que nos besoins
fondamentaux ne soient négligés »2.
Poursuivant sa réflexion visant à mettre en exergue la
faiblesse humaine, il ajoute : « créatures extrêmement
vulnérables, les êtres humains ont besoin d'une certaine
protection. L'escargot est protégé par sa coquille, le
caméléon par son mimétisme, le lion est fort et rapide,
l'homme, lui est lent et fragile »3.
Pour être symbolique, cette analyse interpelle sur la
nécessité qu'il y a pour la société de garantir
à l'espèce humaine ses droits essentiels. En ce qui concerne
l'enfant, il en faut davantage au regard de son extrême
vulnérabilité.4 Dans le même registre, des
auteurs
1
www.unicef.org/french/CRC/Special.htm
(consulté le 15/10/2012).
2 MBANDJI-MBENA (E.), Les droits fondamentaux de l'enfant
en droit camerounais, Thèse de doctorat, Thèse de doctorat,
Université de Toulouse, 2013, p.2.
3 MINOGUE (K.), « L'histoire de la notion des droits de
l'homme », in Anthologie des droits de l'homme, New York,
éd. Nouveaux Horizons, 1989, p.7. ; MBANDJI-MBENA (E.), Op.cit.
p.2.
4 FERNAND-LAURENT (J.), « Les droits de l'homme,
fondement de toute éthique et de toute idéologie : De la
déclaration française à la déclaration universelle
», in Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, Les
droits de l'homme en questions, Paris, La documentation française,
1989, pp.213-219, p.215.
14
soutiennent que, « contrairement à l'animal,
le petit de l'homme ne naît pas mature. Le nourrisson est
entièrement dépendant et nécessite la proximité
maternelle. Ainsi, l'être humain va voir son évolution
dépendre de la maturation neurologique, mais également, c'est
tout à fait singulier, de ses relations à l'environnement. De
cette particularité, vient la fragilité mais également la
richesse de l'être humain compte tenu de l'indispensable et très
longue exposition au monde ambiant »5. Dans ces
conditions, la protection de l'enfant devient alors une impérieuse
nécessité, notamment dans tout Etat de droit6. Tout
Etat partie aux Conventions relatives aux droits de l'homme en
général et spécifiquement, des droits de
l'enfant7, adhère à cette approche et démontre
par-là, sa préoccupation envers leur citoyen en devenir, et du
devenir du monde8. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de
cette mouvance. Arrimé à cette redéfinition de la
protection juridique de l'enfance depuis des décennies, cet «
enthousiasme9 » de la Côte
d'Ivoire10 , pays côtier situé en
Afrique de l'Ouest, s'est-il réellement traduit dans son droit
et dans les faits ?
Mais tout bien considéré, on ne saurait traiter
la question centrale de ce sujet sans avoir au préalable, fourni la
définition des notions essentielles qu'appelle le sujet. Il convient
alors, pour cerner les contours de ce sujet, de l'aborder sous l'angle
notionnel, avant de dégager l'intérêt et la
problématique en découlant.
5 BEAUVALLET (O.) et SUN YUNG (L.), Justice des
mineurs, (s/dir.), BERGER LEVRAULT, Paris, 2012, n°399. ;
MBANDJI-MBENA (E.), Les droits fondamentaux de l'enfant en droit
camerounais, Thèse de doctorat, Thèse de doctorat,
Université de Toulouse, 2013, p.2.
6 CHEVALLIER, « L'État de droit », Revue
de droit public, n°2, Mars-avril 1988, pp.313-380,
spéc.pp.314-315. ; Voir HAMON (L.), « L'État de droit et son
essence », Revue française de droit constitutionnel,
n°4, 1990, pp.699-712.
7 Engagement renouvelé dans le préambule de la
Convention de New York de 1989 ; UNICEF, Un monde digne des enfants,
juillet 2002, pp.67-69. ; HARDY (A.), BOURSERIE (J.) et DELBARD (D.), « La
Convention internationale des droits de l'enfant et le principe fondamental de
protection en droit français » RRJ Droit positif,
Aix-Marseille, PUAM, Vol.2, 2001, pp.907-940, p.907.
8 MBANDJI-MBENA (E.), Les droits fondamentaux de l'enfant
en droit camerounais, Thèse de doctorat, Thèse de doctorat,
Université de Toulouse, 2013, p.2.
9 PICARD (E.), « L'émergence des droits
fondamentaux en France », AJDA, n° spéc., 20 juillet
-20 aout 1998, p. 6. MBANDJI-MBENA (E.), Les droits fondamentaux de l'enfant en
droit camerounais, Thèse de doctorat, Thèse de doctorat,
Université de Toulouse, 2013, p.2.
10 Pour une présentation de la Côte d'Ivoire,
voir :
http://www.presidence.ci/la-cote-divoire/
(consulté le 16 /03 /2015).
15
§ 1. LA DEFINITION DES NOTIONS ESSENTIELLES DU
SUJET
A travers quelques millénaires, l'ancienne Chine nous a
laissé une parole de sage qui s'énonce, in extenso,
comme suit : « s'il me fallait, un jour être empereur de Chine,
je commencerais par écrire un dictionnaire ; le malheur des Hommes,
c'est qu'ils ne s'entendent pas sur le sens des mots »11.
De même, Michel TROPER démontrait que l'auteur de toute
définition en droit n'échappait pas à la
spéculation car, ainsi qu'il l'écrit, « les
définitions sont l'équivalent de conventions de langage qui ne
sont jamais indépendantes du contexte et de la doctrine desquels
s'inspire le chercheur »12.
Cette précieuse parole du sage chinois et cette
pensée de Michèle TROPER nous imposent de procéder
à une opération définitoire des termes essentiels de ce
sujet. A titre liminaire, nous rappellerons donc quelques truismes, ferons des
précisions terminologiques pour situer le sujet et fixer les
idées.
A. DROITS DE L'ENFANT
Pour une meilleure compréhension de la notion «
droits de l'enfant », nous envisagerons successivement la notion
d'enfant avant d'en arriver à ses droits à proprement parler.
a. Définition du terme enfant
Il importe de préciser la notion d'enfant. Qui, en
effet, est considéré comme enfant ? La question est importante ;
elle comporte des aspects juridiques et non juridiques. La réponse
à cette question procède d'une certaine perception du
développement de l'être humain, du moment à partir duquel
il peut s'assumer, répondre de lui-même, être responsable.
Un séjour dans le droit romain apparait inévitable pour toute
recherche sur le droit de l'enfant. Dans la Rome antique, l'infantus
est étymologiquement Qui fari no possunt, « celui
qui ne parle
11 GUIE (H.), Cours d'Histoire des Idées
politiques, Maitrise de Droit, carrières publiques, 1998.
12 Michel TROPER, « Pour une définition
spéculative du droit », Droits, n° 10, 1989,
pp.101-104, spéc. p.103.
16
pas »13 ». Pour Duclos, c'est
aussi celui qui ne « comprend pas la portée de ses actes
»14. Partant, naît la non-imputabilité de
l'enfant en bas âge. En droit romain, le pater familias a
théoriquement droit de vie et mort sur ses enfants. Françoise
DEKEUWER-DEFOSSEZ affirme que : « le droit romain comme l'ancien droit
français voyaient dans l'enfant, l'objet de la puissance
paternelle...L'enfant n'était pas considéré comme
titulaire de droits15». Il est donc à la
fois sa protection et sa loi selon l'âge de l'enfant. Trois
périodes sont généralement prises en compte : de la
naissance à sept ans, de sept ans à douze ou quatorze ans selon
qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille et de quatorze ans à
vingt-cinq ans. A sa naissance, le nouveau-né est étendu sur le
sol, si le père le relève et ordonne de le nourrir16,
il le reconnaît. Dans le cas contraire, il est abandonné,
exposé. Le père pouvait tuer son fils en cas de
difformité, le vendre selon son bon vouloir17.
Au deuxième siècle, l'empereur Constantin abroge
le droit de vie et de mort du père sur l'enfant. L'enfant reste soumis
à la puissance du père de famille. Il est alienis juris
persona, c'est-à-dire soumis au droit d'un autre, soumis à
la puissance du père18. Jusqu'à l'âge de
quatorze ans, on parlera d'Impubes, c'est-à-dire qui n'est pas
encore pubère. L'enfant romain devient alors, à cet âge,
sui juris, sujet autonome de droit. En réalité, l'enfant
romain pubère pouvait dans certains cas et selon les époques,
bénéficier d'une protection légale
importante19. Le droit romain n'apporte pas de définition
stricte de ce qu'est l'enfant. Il est défini par le concept de
minorité ou bien par celui de filiation. Il en va de même en
Côte
13 Roy (A.) (dir), Dictionnaire historique de la langue
française, Le Robert, Paris, Tome 1, 1992, p. 1239. « Le mot
signifie proprement `qui ne parle pas' ; il est formé de in,
préfixe négatif, et du participe présent de fari `parler'
» ; en grec, phemi.
14 DUCLOS (M.), Rome et le droit, Le Livre de Poche,
Paris, 1996, p. 57. ; Concernant les différents stades de la condition
juridique de l'enfant, voir le chapitre « la famille et le droit
familial » pp. 50- 68.
15 DEKEUWER-DEFOSSEZ ( F.), Les droits de l'enfant,
Paris, PUF, 2010, p.4.
16 De là vient l'expression « élever un enfant
».
17 La loi romaine des XII tables a été
rédigée en 451 et en 450 av. J.C. Il s'agit de la première
édification de droit privé depuis la création de la
cité, table IV relative à la famille. ; GAUDEMET (J.), Droit
privé romain, Paris, Montchretien, 1998, p.71.
18 CASTALDO (A.) et LEVY (J-P.), Histoire du droit
civil, Dalloz, 2e ed., 2010, n°49 et sq.
19 La Lex Laetoria de circumscriptione adulescentium
protégeait le mineur de ceux qui voulaient le tromper (-191
AC), Le Senatus Consulte Macedonianum interdisait les prêts
d'argent à un fils de famille et permettait à celui qui avait
bénéficié d'un prêt de ne pas le rembourser, (69-79
AC sous Vespasien.). De même, le Senatus Consulte Oratio Severi
(195 apr. J.C) interdisait à un tuteur de bénéficier
des biens de l'enfant dont il avait la charge in Duclos (1996), p. 59.
17
d'Ivoire où le concept de mineur est abondamment
utilisé dans la législation nationale pour désigner
l'enfant20.
La puissance du père de famille, immense en droit
Romain, est reprise par le Code napoléonien en France et par nombre de
codes de droit civil des pays d'Afrique francophone au vingtième
siècle. Paradoxalement l'autonomie et la responsabilité,
précoces pour les enfants, sont limitées par le droit de la
Convention de 1989, pour sa plus grande protection. L'historien, plus que le
juriste, peut relever la place et le rôle de l'enfance au Moyen-âge
et comprendre ses rapports avec le régime juridique en vigueur. C'est en
partant de la condition de vie des enfants et de la place qu'ils ont dans la
société à travers l'étude de l'iconographie
médiévale que PHILIPPE ARIES21 nous montre que le mot
« enfant » revêt une signification différente
de celle communément acceptée aujourd'hui. La thèse
principale d'Ariès consiste à signaler que l'enfance
n'était pas représentée jusqu'au dix-huitième
siècle. Les enfants étaient des « adultes en miniature
» et l'enfance, une époque de transition. Pour lui, la «
conscience de la particularité enfantine »22
était inexistante au Moyen-âge. Si les travaux de l'historien ne
font pas l'unanimité aujourd'hui23, leur apport principal est
de relativiser une notion atemporelle de l'enfance. La psychanalyste
Françoise DOLTO, commentant le texte d'Ariès repris dans le
premier chapitre de la Cause des Enfants, affirme que « dans
le langage écrit, l'enfant reste un objet. Il faudra beaucoup de temps
pour qu'il soit reconnu comme sujet »24. Il s'agissait de
cacher les traits de l'enfant, indignes d'être représentés.
Peu à peu, ont été, signale la psychanalyste, introduit
dans les oeuvres, des objets, au second plan,
20 Article 14 alinéa 3 du code pénal ivoirien
« ...Est mineur au sens de la loi pénale, toute personne
âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. Les
mineurs de 10, 13 et 16 ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors
de la commission de l'infraction. ».
Article 1er de la loi ivoirienne n° 70-483 du
3 aout 1970, sur la minorité : « Le mineur est l'individu de l'un
ou de 1'autre sexe, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans
accomplis. ».
21 ARIES (P.), L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien
Régime, Seuil, collection «Points-Histoire » 1975,
316p.
22 ARIES (P.), L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien
Régime, Seuil, collection «Points-Histoire » 1975 (P.)
(1975), p.177.
23 RENAULT (A.), La libération des enfants,
Calmann-Lévy, 2002. L'auteur expose les thèses d'Ariès
ainsi que les nuances qu'ont apportées sociologues et historiens de la
famille. Il reconnaît toutefois que l'ouvrage d'Ariès «
marqua l'émergence, pour ainsi dire, ex nihilo, d'une nouvelle
discipline ». p. 41. ; De même, l'historien américain Lloyd
de Mause signale qu'Ariès a laissé de côté de
nombreuses preuves montrant que les artistes médiévaux pouvaient
peindre les enfants avec réalisme. Il s'oppose également au
concept « d'invention de l'enfance ». De Mause, La
evolución de la infancia, Historia de la infancia, LI,
Madrid, 1991 p. 15 à 92.
24 DOLTO (F.), La cause des enfants, Le Livre de Poche,
Paris, 1985, p. 16.
18
comme des jouets, prémices de l'acceptation d'une
pensée propre. Sans représentation, l'enfant n'existe pas comme
sujet.
La particularité de l'enfance en tant qu'étape
spécifique de la vie, et non plus comme antichambre de l'âge
adulte, sera pensée par Locke puis par Rousseau. « En pensant
l'homme démocratique, ils ont rendu philosophiquement possible les
droits de l'enfant25». Telle est la thèse de
Dominique YOUF, philosophe, spécialiste de la question des droits de
l'enfant. Pour que les individus puissent jouir de droits, il fallait
atténuer la toute-puissance du « souverain » entendu
symboliquement comme père de famille.
L'avènement des droits de l'enfant sera sans conteste
une défaite pour la puissance du père de famille, une
défaite souhaitée par les premiers promoteurs des droits de
l'enfant. Déjà, à l'époque de la déclaration
française des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'autorité
paternelle est remise en question. L'enfant appartient d'abord à la
patrie, disent les révolutionnaires, remodelant ainsi la filiation et la
conjugalité. « C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la
restauration partielle de la puissance paternelle par le Code civil
napoléonien26 ». L'introduction progressive de
limites à cette autorité se fera, concernant les enfants, d'abord
au nom de leur protection, puis, presque un siècle plus tard, au nom de
leurs droits. S'opère alors un rééquilibrage du triptyque
enfant, père (famille) et Etat. En étudiant la famille des
18e et 19e siècles, Jacques DONZELOT met en
évidence cette intervention progressive de l'Etat sur l'enfance. La
société s'adapte à la révolution industrielle qui
cherche une main-d'oeuvre toujours plus nombreuse, plus disciplinée,
plus contrôlée. L'enfant devient une « denrée
» qu'il faut « conserver » parce qu'il devient
utile et parce que, démographie oblige, il y en a moins. L'école
publique voit le jour, l'apprentissage diminue. La famille quitte la rue et la
place publique pour se resserrer sur elle-même. Au moment où
l'Etat accroît son contrôle sur les enfants, ceux-ci n'ont plus
d'autres horizons que leur propre famille. L'histoire de
l'enfance27, nous dit Jacques DONZELOT, est celle
25 YOUF (D.), Penser les droits de l'enfant, PUF, Paris,
2002, p. 26.
26 YOUF (D.), Penser les droits de l'enfant, Paris,
2002, p. 31.
27 Ecrire l'histoire de l'enfance est une tâche
compliquée. Salazar (G.), « Infancia en Chile durante los siglo
XIX y XX », Conférence pour les Institutions liées
à l'Enfance dans la Cinquième région du Chili, San Felipe,
Chili, 28 et 29 juin 2001. Pour l'historien chilien, « les
enfants ne laissent pas beaucoup de trace pour reproduire leur histoire. Les
enfants ne font pas les choses que font les grands. Ils ne font pas de coups
d'Etat, ils ne mettent pas en place des politiques publiques (...) Faire
l'histoire des enfants est très compliqué ». De fait,
l'enfant fait partie de l'histoire lorsqu'il devient adulte. Cette
difficulté de faire l'histoire de l'enfant est souvent
évoquée, voir : Alzate Piedrahita (M.V), « El `
descubrimiento' de la infancia : historia de un
19
de son contrôle. Il rejoint en cela Michel FOUCAULT qui
parlera du collège comme un lieu d'enfermement : « il y eut le
grand renfermement des vagabonds et des misérables, il y en a eu
d'autres plus discrets, mais insidieux et efficaces »28.
Ce curieux mélange entre des institutions soucieuses d'éduquer,
de contrôler comme le dit Foucault et l'arrivée massive des
enfants dans le monde du travail, marquera, en droit, une reconnaissance de la
spécificité juridique des enfants. Il est à craindre que
la notion juridique d'enfant soit selon les contextes, opposée à
la notion ethno-anthropologique de l'enfant, voire à la psychologie
personnelle de l'individu considéré. L'enfant du droit
international des droits de l'homme n'est pas un personnage monolithique.
L'enfant est un personnage éclaté et son concept est autonome. La
Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), suivie en cela par
d'autres textes, retient le critère de l'âge, du nombre de jours
passés sur la terre : est enfant, au sens de la convention de New York,
« tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si
la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation
qui lui est applicable »29. Il faut donc distinguer
l'enfance et la majorité. Dix-huit (18) ans, c'est l'âge de la
majorité pour tous les Etats qui ratifient la convention. Mais cette
majorité peut fluctuer en fonction des lois nationales. En d'autres
termes, la Convention des Nations Unies, à la différence de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, abandonne une
bonne part de la définition de la notion même d'enfant aux ordres
juridiques nationaux et d'autres réglementations internationales. Les
différences sont, à ce sujet, particulièrement importantes
d'un Etat à un autre. En matière de conflits armés,
l'âge de 18 ans émerge dans le consensus de la communauté
internationale, au regard du protocole facultatif concernant l'implication
d'enfants dans les conflits armés adopté le 25 mai 2000. Comment
comprendre que, le terme de l'enfance étant déjà
échu, un individu soit toujours traité comme un enfant notamment
en matière matrimoniale ou électorale ? Prenons l'exemple de la
notion même d'enfant, selon la législation qui lui est applicable.
La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE) est
plus stricte : l'enfant désigne ici aux termes de l'article 2 de ladite
convention
sentimiento », Revista de ciencias humanas,
n°30, Universidad tecnologica de Pereira, Colombie, décembre 2002.
Pour l'auteur, l'histoire de l'enfance débute avec Ariès (1973)
qui a montré justement le caractère invisible des conceptions de
l'enfance. Dans ce sens, Salinas Meza (R.), « La historia de la
infancia, una historia por hacer », Revista de historia social y de las
mentalidades n° 5, Santiago, 2001, p. 11. « La présence de
l'enfant dans l'histoire a été une authentique présence
occulte ce qui rend très difficile la tâche de l'historien quand
il veut identifier ces traces car elles se confondent presque toujours avec
celles de la vie des adultes ».
28 FOUCAULT (M.), Surveiller et punir, Gallimard, 1987,
p. 143.
29 Article 1er Convention internationale relative aux
droits de l'enfant de 1989.
20
« tout être humain âgé de moins de
18 ans ». Si l'on s'en tient à la situation actuelle du droit
positif ivoirien, elle assimile l'enfant au mineur ; elle semble aussi
s'aligner sur la flexibilité de la CIDE. La difficulté concernant
ce concept, est qu'en droit ivoirien, il existe diverses acceptions de
minorité : la minorité pénale fixée à moins
de 18 ans30, la minorité civile à moins de 21
ans31; le code électoral ivoirien retient aujourd'hui
l'âge de 18 ans pour la majorité électorale32
alors qu'avant cette période , elle était fixée à
21 ans; Aux termes de l'article 23.8 du code du travail ivoirien , les enfants
ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme
apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation
édictée par voie réglementaire. L'enfant en Côte
d'Ivoire moderne n'est donc pas une réalité juridique
monolithique. Pire, en Côte d'Ivoire, diverses considérations
d'ordre socio-culturel, exercent encore aujourd'hui une certaine influence sur
la conception de la notion d'enfant ainsi que des droits à lui
reconnus.
Dans le cadre de la présente étude, l'enfant
sera défini au regard de la définition de cette notion en droit
international des droits de l'homme. Par enfant, nous viserons donc, tout
être humain âgé de moins de 18 ans conformément
à la CIDE ratifiée par la Côte d'Ivoire.
Au regard de la vulnérabilité de l'enfant, la
communauté internationale en est arrivé, à lui
concéder au-delà des droits partagés avec les adultes, une
protection particulière à travers ce qu'il est convenu d'appeler
droits de l'enfant. Mais que recouvre cette notion de droits de l'enfant ?
b. Droits de l'enfant
Traiter des droits de l'enfant revient d'abord, en
réalité, à poser la problématique
générale de la démarche juridique internationale relative
à l'enfant, ses déterminants, ses acteurs, son contenu et son
effectivité. Les instruments, normatifs ou institutionnels,
évoluent en effet en rapport avec un milieu, une époque, dont ils
traduisent et reflètent les idées et les préjugés.
Cela est vrai en général (ubi societas ibi jus) pour le
droit, cela l'est encore plus particulièrement pour le domaine des
droits de l'homme, indépendamment de toute
30 Article 14 du code pénal ivoirien.
31 Article 1er de la loi de 1970 sur la
minorité.
32 Article 3 de la loi N°2000-514 du 1er
Août 2000 portant code électoral.
21
perspective de relativisme culturel33. Le droit des
droits de l'homme, et spécifiquement le droit international des droits
de l'homme, est fondamentalement un droit idéologique34,un
droit subversif sur le plan juridique, politique, économique, social et
aussi culturel. Il bouscule, avec la question des femmes et des enfants, des
logiques culturelles et de civilisation longtemps ancrées, des
équilibres sociaux dont l'origine relève parfois du mythe, des
arbitraires intériorisés dont l'objectivation ne va pas sans
résistances et déchirements. Parler des droits de l'enfant, dire
que l'enfant est une personne pourvue de sa dignité propre et de son
autonomie, ne va pas de soi. Que le droit international énonce que
« l'enfant n'est pas la propriété de ses parents, ni de
l'Etat, ni d'une église quelconque, ni de qui que ce soit
»35 est une attitude révolutionnaire. Elle l'est
d'autant plus que, par le principe de l'universalité qui
l'imprègne ou, en tout cas, par la prétention à
l'universalité qui le soutend, le droit international des droits de
l'homme a une dynamique d'harmonisation, de rapprochement des politiques
étatiques et de convergence des logiques culturelles vers l'idéal
commun à atteindre, vers une conception commune des droits et
libertés de l'homme, selon les termes de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme. La sanctuarisation de la personne de
l'enfant sur le plan international est un élément important de la
conscience juridique internationale de notre époque, une conscience
qu'il faut traduire en actes concrets, constants et quotidiens.
Il importe, à titre liminaire, de retracer
brièvement l'historique de la protection de l'enfant en droit
international et de présenter brièvement les principaux textes
pertinents, d'exposer ensuite les déterminants fondamentaux de cette
protection.
i. Evolution historique et données fondamentales de la
protection internationale des droits de l'enfant
33 MBONDA(E-M) « Les droits de l'homme à
l'épreuve du droit à la différence »In Cahier de
l'UCAC, n°2,1997, Yaoundé, pp.33-52.
34 SUDRE (F.), Droit international et européen des
droits de l'homme, Paris, PUF, 2016, pp.30 et ss;MEGRET (F.), «
L'étatisme spécifique du droit international », Revue
québécoise de droit international, 24.1 (2011) p125-127.
35 LOPATKA (A), « Le droit de l'enfant fait
apparaître la complexité du noyau intangible » in
Meyer-Bisch, P. Le noyau intangible des droits de l'homme, Fribourg,
suisse, 1991, p.77.
22
L'enfant n'intègre pas les préoccupations de la
société internationale seulement aujourd'hui36. Au
début du 20ème siècle déjà, dans
le prolongement de la lutte contre l'esclavage37 et la traite, est
signé le 18 mars 1904, l'Arrangement international pour la
répression de la traite des femmes et des enfants38 ; il faut
mentionner ensuite la Convention pour la répression de la traite des
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 02
décembre 194939. Toutefois, il est universellement admis, non
sans raison, de considérer que le premier texte portant
spécifiquement sur les droits de l'enfant est la Déclaration sur
les droits de l'enfant adoptée à Genève le 26 septembre
1924, à l'initiative de l'Union internationale des secours aux enfants,
une organisation britannique, et ce bien que depuis 1919, existait
déjà dans le cadre de la SDN, un comité de protection de
l'enfant. Cette déclaration de 1924 sera révisée en 1948.
Sur la base de ces précédents et grâce au travail du Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) créée le 11
Décembre 194640, sera adoptée le 20 Novembre 1959, une
nouvelle déclaration des droits de l'enfant.
Le 20 Novembre 1989, est adoptée la Convention
internationale sur les droits de l'enfant (CIDE)41, malgré la
réticence de certains Etats soucieux de limiter l'inflation normative en
matière de droits de l'homme. Cela ne signifie pas cependant que, avant
la CIDE, les droits de l'enfant n'étaient pas protégés au
plan universel et qu'ils ne relevaient que du droit déclaratoire, du
droit mou. Non seulement les droits fondamentaux de l'homme et donc ceux de
l'enfant font partie de ce bloc d'obligations qui s'imposent aux Etats,
même en dehors de
36 KAMGA (B.K), « La codification internationale des
normes relatives aux droits de l'enfant » in Les petites
affiches, 30 Novembre 1990, n° 144, pp.13-19. ; CLERGERIE (J.-C.)
« L'adoption d'une Convention internationale sur les droits de l'enfant
» in RDP, 1990, pp.435 et ss.
37 Pour messieurs Ibrahima Baba KAKE et ELIKIA M'BOKOLO,
« parmi les faits les plus répréhensibles de l'histoire de
l'humanité, l'esclave tient la première place. Il est l'acte le
plus attentatoire à l'égard des droits de l'homme puisqu'il nie
la dignité humaine, fondement de ces droits, à une
catégorie d'individus » Ibrahima Baba KAKE (I-B) et M'BOKOLO (E.),
Histoire générale de l'Afrique, ABC, Paris, 1977, p.9. ;
MEMEL-FOTE (H.), L'esclavage lignager africain et l'anthropologie des
droits de l'homme, Leçon inaugurale au Collège de France,
Lundi 18 décembre 1995, p.28.
38 GARCIA (L.), La traite des femmes pour les fins de
prostitution : les conventions internationales et la législation
canadienne sur le sujet, mémoire présenté comme
exigence partielle de la maîtrise en droit international,
Université de Québec à Montréal, Octobre 2009,
pp.44-48.
39 NATIONS UNIES, Recueil des traités, vol.96,
p.271.
40
https://www.unicef.org/french/about/who/index_history.html
(Consulté le 02 mai 2018).
41
http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
(consulté le 23/09/2013).
23
tout lien conventionnel42, mais en plus, des
instruments à portée obligatoire incluaient les droits de
l'enfant. Il en est ainsi de la Convention du 10 Décembre 1962 sur le
consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des
mariages43, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques dont l'article 2444 est remarquable de clarté, le
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 10),
les conventions du 12 Août 1949 relatives au droit humanitaire des
conflits armés ainsi que les protocoles additionnels de 1977 ( articles
77 et 78 du Protocole additionnel n°I45), les conventions de
l'OIT dont l'une des plus importantes, adoptée le 17 Juin 1999 à
Genève, sous le numéro 182 des instruments de l'OIT, concerne
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination.
A côté des conventions universelles, il existe
des textes régionaux, soit généraux avec des dispositions
spécifiques sur les enfants, soit des conventions spécifiques sur
les droits de l'enfant. Il en est ainsi de la Charte africaine sur les droits
et le bien-être de l'enfant46, de la Convention
européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage
du 15 Octobre 1975, de la Convention européenne sur l'exercice des
droits des enfants du 26 janvier 1996. Cette panoplie de textes s'est enrichie
depuis le 25 mai 2000 de deux protocoles facultatifs à la CIDE : l'un
concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, l'autre
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants.
Les instruments ne sont pas seulement conventionnels ou
résolutoires : il faut mentionner, dans ce panorama, des
stratégies telles que l'année internationale de l'enfance
déclarée en 1979 par les Nations Unies, les Règles de
Beijing de 1985 relatives à la justice pour mineurs, la
Déclaration et le Plan d'Actions issus du Sommet mondial des enfants en
1990.
42 C.I.J, « Réserves à la convention sur la
présentation et la répression du crime de génocide»
Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil 1951, pp.15 et ss.
43 RAYOU (Y.) « Les enfants nés hors mariage en
Algérie : la vulnérabilité par la négation du droit
». in Otis, G. (Dir.) Démocratie, droits fondamentaux et
vulnérabilité. Actes des troisièmes journées
scientifiques du réseau « droits fondamentaux »tenues au Caire
du 12 au 14 novembre 2005, .Presa Universitara Clujeanana, Cluj Napoca,
2006, pp.309-320.
44
http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
(consulté le 23/09/2013).
45
http://www2.ohchr.org/french/law/protocole1.htm
(consulté le 20 octobre 2013).
46
http://www.achpr.org/fr/instruments/child/
(consulté le 20 octobre 2013).
24
Ces nombreux textes et documents de portée juridique
fort diverses, révèlent néanmoins de manière
globale, une approche des droits de l'enfant sur le plan international, assise
sur un certain nombre de déterminants, de principes cardinaux. Sans les
développer en profondeur ici, il y a lieu cependant de les mentionner
:
- Le principe de non-discrimination entre enfants, qui traduit
le mieux l'universalité de leur protection. Aucune distinction de sexe,
de situation sociale, de filiation47 ne doit être faite entre
les enfants dans la jouissance de leurs droits ;
- Le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, lequel doit être une considération primordiale pour tous
ceux qui abordent les problèmes qui le concernent (voir article 3-1,18
-1 et 21-1 de la CIDE)48 ; En France, l'utilisation de l'expression
« l'intérêt supérieur de l'enfant » a
longtemps fait l'objet d'une grande hésitation. La Cour de cassation
semble (...) ne l'avoir employé que deux fois avant 198949
dans son arrêt du 18 juin 197550 (...) et dans son arrêt
du 10 mai 197751. Après cette date et particulièrement
après le revirement de 2005, la Cour de cassation a pris l'habitude de
recourir à cette expression, sans pour autant écarter le seul
intérêt de l'enfant. En effet, la jurisprudence française
manifeste une certaine réticence à substituer totalement «
« l'intérêt supérieur » à «
l'intérêt » de l'enfant52». Soutenue par
une grande partie de la doctrine qui critique ce recours inflationniste
à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, Adeline
GOUTTENOIRE affirme : « Intérêt supérieur de
l'enfant : point trop n'en faut53 ». Jean HAUSER
renchérit, à son tour, qu' « on sait, qu'après
avoir beaucoup hésité, la Cour de cassation a fini par accepter
l'effet direct de la Convention internationale sur les droits de l'enfant et
notamment le critère du fameux
47 RAYOU (Y.) « Les enfants nés hors mariage en
Algérie : la vulnérabilité par la négation du droit
».in Otis, G. (Dir.) Démocratie, droits fondamentaux et
vulnérabilité. Actes des troisièmes journées
scientifiques du réseau « droits fondamentaux »tenues au Caire
du 12 au 14 novembre 2005.Presa Universitara Clujeanana, Cluj Napoca,
2006, pp.309-320.
48 Voir RUBELLIN-DEVICHI (J.), « Le principe de
l'intérêt de l'enfant dans la loi et la jurisprudence
françaises » in Revue française des affaires
sociales, n°4, oct.-déc. 1994, 28 novembre 1994, p.159.
49 LEBRETON (G.), « Le droit de l'enfant au respect de
son intérêt supérieur. Critique républicaine de la
dérive individualiste du droit civil français », CRDF
n° 3, 2003, p.80.
50 Cass. Civ. 2ème ,18 juin 1975, Yamani,
arrêt n°462.
51 Cass. Civ. 1re, 10 mai 1977, Ballesteros
arrêt n°386.
52 LEBRETON (G.), op. cit. p.80.
53 GOUTTENOIRE (A.), Droit de la famille, comm. 28,
février 2006, p.22.
25
« intérêt supérieur de l'enfant
»54 ». Les confusions qui peuvent être
suscitées par cela ne sont pas minimes.
En effet, l'affrontement sémantique de ces deux
expressions n'est que « l'arbre qui cache la forêt »
étant donné que le qualificatif « supérieur »
n'est pas le premier problème. La formule simple de
l'intérêt de l'enfant, elle-même, est « parfaitement
fuyante (...) propre à favoriser l'arbitraire
judiciaire55 ».
- Le droit pour tout enfant de faire entendre ses points de
vue ou opinions dans toutes les questions qui le concernent, dès lors
qu'il a l'âge du discernement. Il s'agit là d'une véritable
révolution puisqu'on est loin de l'infans latin, celui «
qui ne parle pas ». Comme le dit Michel MANCIAUX, le droit
à la parole « est un droit fondateur qui fait sortir l'enfant
de son statut d'objet sans voix »56 ;
- Le rôle fondamental de la famille (famille
nucléaire, élargie ou même la communauté) dans
l'éducation de l'enfant57;
- Le principe de la prise en compte de l'importance des
traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant58;
- Le principe de l'application de la règle la plus
favorable à l'enfant. Le droit international des droits de l'homme est
un standard minimum commun et ne saurait interdire que les Etats soient plus
généreux pour les enfants dans leurs législations
nationales respectives.
Ces considérations exposées, il importe
d'évoquer tour à tour l'énoncé des droits et
devoirs de l'enfant d'une part, et la mise en oeuvre des droits de l'enfant,
d'autre part.
54 HAUSER (J.), « L'intérêt supérieur
de l'enfant et le fait accompli : une filiation quand je veux et avec qui je
veux, par n'importe quel moyen », RTD Civ. 2008, p.93. ; Voir
aussi du même auteur « Ordre public de direction : le retour ou le
chant du cygne ? Adoption plénière, reconnaissance et mère
porteuse, adoptions simples et père incestueux », RTD Civ.
2004, p.75.
55 GOBERT (M.), Le droit de la famille dans la jurisprudence
de la Cour de cassation, Conférence, Cycle Droit et technique de
cassation 2005-2006, Neuvième conférence, 11 décembre
2006, publiée sur le site de la Cour de Cassation. (Consulté le
02/05/2013).
56 MANCIAUX (M.), « Les droits de l'enfant : leur
évolution au regard de la protection et de la promotion de la
santé de l'enfant, de la famille et de la communauté ».In
RILS, 1998, vol.49-1, p.250. ; Voir l'Observation
générale n°12(2009) du Comité des droits de l'enfant,
Le droit de l'enfant d'être entendu, .CRC/C/GC/12 du 20 juillet
2009.
57 Article 5 CIDE.
58 12ème considérant du préambule de la
CIDE.
26
ii. L'énoncé des droits et devoirs de
l'enfant
Suivant l'article 29-1 de la déclaration universelle
des droits de l'homme, « l'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de
sa personnalité est possible ». L'énoncé des
droits de l'enfant est allé de pair, surtout dans le contexte africain,
avec celui corrélatif de devoirs.
Bien que ce soit « un raccourci peu facile
»59, on a coutume de ramener les droits de l'enfant au
triptyque suivant : protection, prestations, participation. L'enfant s'est vu
reconnaitre presque toutes les catégories de droits (droits civils,
droits économiques et sociaux, droits culturels), à l'exclusion
peut être des droits de la troisième génération.
Sans vouloir rentrer dans le détail de tous ces droits, l'on peut les
regrouper, en suivant le Professeur Pascale BOUCAUD60, en cinq
rubriques : le droit à la vie, le droit à l'identité et
aux attributs de la personnalité, les libertés fondamentales, la
protection contre toute forme de violence, le droit aux prestations
économiques, sociales et culturelles :
- L'enfant a droit à la vie et à la survie : Le
droit à la vie ne signifie pas seulement le droit de n'être pas
tué, de n'être pas de manière arbitraire privé de sa
vie ; il implique aussi le droit de ne pas être placé dans les
conditions d'existence telles que la mort apparaisse comme l'horizon
inévitable et immédiat61. La question la plus complexe
en rapport avec le droit à la vie de l'enfant est celle de savoir si la
vie avant la naissance est aussi protégée par le droit
international, comme l'est sans conteste la vie après la naissance.
Mettant sur la sellette la question de l'avortement et la diversité des
régimes juridiques de cette pratique à travers le monde, cette
question n'obtient aucune réponse ferme et unanime. En fait, il
règne une troublante indécision du droit international en la
matière, à l'exception de la Convention américaine des
droits de l'homme qui proclame que le droit à la vie « doit
être protégé par la loi, et en général
à partir de la conception ». On regrettera la fâcheuse
expression « en général » qui affaiblit la
proclamation. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est
muette sur la question. Peut-être, faut-il voir une expression
discrète de la
59 MANCIAUX (M.) « La convention des Nations Unies sur
les droits de l'enfant : que changera-t-elle ? ». in R. I..L.S.,
1991, vol.42-1p.177.
60 BOUCAUD (P.) « Peut-on parler d'un noyau intangible
des droits de l'enfant ? ». In. Meyer Bisch, op.cit. pp.81-96.
61 OLINGA (A.D.) «le droit à des conditions
matérielles d'existence minimales en tant qu'élément de la
dignité humaine ».In Marin, J.Y (Dir.).Les droits
fondamentaux, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp.91-103.
27
position africaine dans l'article 14 du Protocole de Maputo
à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples62, relatif aux droits de la femme, lequel
article prévoit que l'avortement médicalisé peut
être autorisé par les Etats dans les circonstances bien
précises, y compris « lorsque la grossesse met en danger (...)
la vie de la mère ou du foetus ». En évoquant «
la vie du foetus », le Protocole de Maputo du 11 juillet 2003
reconnait dans le foetus une vie humaine, une vie à protéger, une
vie qui ne peut être interrompue que si la grossesse la met, en tout
état de cause, en danger ; c'est-à-dire, semble-t-il, si cette
vie naissante n'a aucune chance plausible d'être viable à la
naissance. Le foetus n'aurait donc pas dans ce cadre un droit à la vie
de caractère absolu. Lorsque la vie de la mère est en jeu, «
l'avortement se trouve couvert par une limitation implicite du droit
à la vie du foetus pour, à ce stade, protéger la vie et la
santé de la femme »63. En somme,
pour beaucoup d'auteurs, « le droit à la vie ne paraît
intangible que pour l'enfant déjà né, à compter du
jour de sa naissance, jusqu'à sa majorité
»64 ; tout au plus, consent-on à
admettre que « la protection juridique de l'enfant avant la naissance
est une question toujours ouverte dans le droit international
»65.
Pourtant, une disposition pourrait, non pas résoudre
les problèmes, mais fixer une ligne de conduite, le 9è paragraphe
du préambule de la CIDE, reprenant en cela les termes de la
Déclaration de 1959 : l'enfant a besoin d'une protection juridique
appropriée « avant comme après la naissance ».
Le Saint-Siège, au moment de ratifier ce texte, a fait une
déclaration exprimant sa conviction que ce passage du préambule
« guidera l'interprétation de l'ensemble de la convention
»66. L'attitude des Etats reste contrastée. Au
moment de sa ratification de la CIDE, le Royaume-Uni déclare que selon
son interprétation, « la convention n'est applicable qu'en cas
de naissance vivante »67 alors que pour l'Argentine,
« le mot enfant doit s'entendre de tout être humain du moment de
la conception jusqu'à l'âge de 18 ans »68
;
62
http://www.achpr.org/fr/instruments/achpr/
(consulté le 22 octobre 2013).
63 Commission Européenne des droits de l'homme,
Xème. Royaume-Uni, 13 Mai 1980, Décisions et Rapports n°19,
p.244.
64 BOUCAUD (P.) op.cit.
65 LOKPATA (A.)op.Cit.p.76.
66 Doc.CRC/C/2/Rev.5 du 30 juillet 1996, p.32.
67 Idem, p.31.
68 Idem, p.13.
28
- S'agissant de la protection de l'identité et des
attributs de la personnalité de l'enfant, il faut également
évoquer un ensemble de droits : le droit d'être enregistré
aussitôt après la naissance, de recevoir un nom, d'acquérir
une nationalité, de connaître une vie familiale normale,
c'est-à-dire connaître autant qu'il est possible ses deux parents,
lesquels ont une responsabilité commune pour l'élever, ne pas
être séparé d'eux autant que se faire se peut, sauf pour
l'Etat à suppléer l'absence de famille. L'adoption de l'enfant
est réglementée, encore qu'elle soit très souvent
proscrite par certaines cultures, notamment islamiques. L'enfant a droit au
respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Le
Mali a clairement fait savoir qu'une telle disposition était
inapplicable, compte tenu du code de la famille de ce pays69 ;
- S'agissant des libertés fondamentales, l'enfant
jouit de la liberté d'expression ;
en particulier, il a le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
dès qu'il est capable de discernement. Ce droit de l'enfant à la
parole, qui est un droit d'être entendu et écouté et non
pas un droit d'être suivi, un droit qui risque de se heurter à des
difficultés culturelles qui ne conçoivent pas que les cadets
sociaux, et, a fortiori, des enfants, puissent prendre la parole au
milieu des aînés ou adultes, quelques fois même pour des
questions qui les concernent directement. Ce droit à la parole peut
aboutir à conférer à l'enfant un locus standi
devant les instances judiciaires, lorsqu'il y va de ses
intérêts. L'enfant jouit de la liberté de pensée, de
conscience, de religion, d'association, de réunion ; il jouit du droit
à un procès équitable ;
- L'enfant est protégé contre toute forme de
violence, de mauvais traitements
ou d'exploitation. Il doit être mis
à l'abri de la torture, des traitements cruels, inhumains ou
dégradants, au sein de la famille ou en dehors de celle-ci, il doit
être mis à l'abri des combats armés, de l'exploitation
économique, de l'usage des stupéfiants, de l'exploitation
sexuelle, des enlèvements, de la vente ou de la traite. La Charte
africaine des droits et le bien-être de l'enfant précise, à
son article 1er, que « toute coutume, tradition, pratique culturelle
ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations
énoncées dans la présente Charte doit être
découragée dans la mesure de cette incompatibilité
». Pour être une formule
69 Doc.CRC/C/2/Rev.5 du 30.7.1996, p.25.
29
pudique, cette expression indique incontestablement les
pratiques telles que l'excision et l'infibulation, pratiques pouvant être
rangées parmi les tortures psychologiques ;
- S'agissant des droits économiques, sociaux et
culturels, l'enfant a droit à la santé, à la
sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, aux
loisirs et la vie culturelle ; les enfants en situation de handicap ont droit
à une protection spéciale, de même que les enfants
réfugiés ou des enfants appartenant à des minorités
ou des populations autochtones. Il convient d'insister sur le droit à
l'éducation. L'Etat doit offrir l'infrastructure de base pour
l'éducation des enfants, l'enseignement primaire étant
obligatoire et, progressivement, gratuit70. Tout en reconnaissant et
préservant le droit des parents de choisir le type d'éducation
à dispenser à leurs enfants, le droit international
précise le but visé par l'éducation donnée aux
enfants. Quel que soit le type d'éducation choisi, il doit tendre
à l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, du
développement de ses capacités et potentialités, du
respect des droits de l'homme et libertés, du milieu naturel, à
préparer l'enfant à vivre dans une société libre,
tolérante et humaine71. Toutefois, il est difficile de juger
la légitimité d'un système d'éducation, dès
lors que l'enfant doit aussi être instruit du respect de ses valeurs
culturelles et des valeurs nationales du pays dans lequel il vit. Ces valeurs
sont-elles toujours compatibles avec les droits de l'homme, et
particulièrement des droits de l'enfant ? La question mérite
d'être posée.
Après cet exposé des droits, il convient de
préciser que leur universalité est très loin d'être
acquise. Bien que la CIDE soit aujourd'hui ratifiée par plus de 190
sujets de droit international susceptibles de rentrer dans un lien
conventionnel72, les ratifications sont grevées de
très nombreuses et non moins dangereuses réserves qui fragilisent
en fin de compte le consensus dont la convention se veut le reflet. Par
exemple, la quasi-totalité des Etats ayant l'islam pour religion ont
déclaré que les dispositions de la convention incompatibles avec
l'islam et la charia sont inapplicables. En fait, ces Etats ne s'engagent
à respecter que ce qui existe dans leur droit national respectif.
70 Il faut rappeler que l'article 26 de la Déclaration
Universelle des droits de l'homme énonce que « l'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental » et que cette Déclaration
est intégrée dans la Constitution ivoirienne du 1er
Aout 2000.
71 Voir l'observation générale n°1 du
Comité des Droits de l'enfant intitulée « Les buts de
l'éducation ». Doc.CRC/GC/2001/1 du 17 avril 2001.
72 Seuls les USA, la Somalie et le Sud Soudan n'ont pas
ratifié la CIDE.
30
Outre les droits reconnus à l'enfant, la
problématique des devoirs de l'enfant se retrouve principalement dans le
cadre africain, lequel met un point d'honneur à exhiber la
consécration des devoirs comme un élément de
spécificité. C'est l'article 31 de la Charte africaine sur les
droits et le bien-être de l'enfant qui traite de ces devoirs. Tout enfant
a des responsabilités envers sa famille, la société,
l'Etat et toute autre communauté légalement reconnue ainsi
qu'envers la communauté internationale. Plus précisément,
l'enfant doit : - OEuvrer à la cohésion de sa famille, respecter
ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et les assister en cas de besoin ;
- Servir sa communauté nationale, renforcer la
solidarité de la société et de la nation ;
- Préserver le bien être moral de la
société ;
- Contribuer à la réalisation de l'unité
africaine.
La remarque que l'on peut faire est celle selon laquelle,
compte tenu de leurs formulations mêmes, les devoirs imposés
à l'enfant ont une portée limitée et foncièrement
abstraite, notamment ceux qui débordent la sphère familiale et
scolaire et qui semblent concerner plus les adultes que les enfants. Certes,
l'enfant doit être éduqué en ce sens que les droits ne sont
pas absolus ou illimités, mais il ne faudrait pas oublier que le but du
droit international des droits de l'homme est de le protéger d'abord et
non de l'obliger ou de le contraindre. Aussi, ne traiterons-nous que des droits
de l'enfant à l'exclusion de ces devoirs.
3. La mise en oeuvre des droits de l'enfant
La mise en oeuvre des droits de l'enfant ne présente
pas d'originalité particulière par rapport aux autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme. L'effectivité des droits
de l'enfant doit être assurée à la fois sur les plans
international que national.
a. La mise en oeuvre des droits de l'enfant sur le plan
international
Au plan international, l'effectivité des droits de
l'enfant est promue tant par des mécanismes non conventionnels que par
des procédures conventionnelles. Sur le plan non conventionnel, mention
doit d'abord être faite de l'UNICEF, mise en place en 1946 et dont
l'action en faveur de l'enfant, en dépit des difficultés
inévitables, doit être saluée et encouragée. Il faut
mettre également en évidence l'action d'autres institutions
internationales
31
telles que l'UNESCO, l'OMS ou l'OIT dont l'action en ce qui
concerne le travail des enfants est aujourd'hui considérable.
Par ailleurs le Conseil des Droits de l'homme, à la
suite de la Commission des Droits de l'homme des Nations Unies, peut recevoir
des cas, diligenter des enquêtes en rapport avec les droits de l'enfant,
initier des études, examiner la situation des enfants dans tel ou tel
pays. Une attention particulière doit être portée sur les
mécanismes de suivi de la Déclaration mondiale en faveur de la
survie, de la protection et du développement des enfants, de même
que le plan d'actions qui lui est annexé, lequel était valable
jusqu'à l'an 2000 et comprenait un certain nombre d'objectifs à
atteindre en termes de taux de mortalité, de taux de malnutrition,
d'accès à l'eau potable, à l'éducation de base, de
protection de l'enfant en situation de conflit armé. La
conférence de 1990 a élaboré une stratégie de
financement qui vise à assurer la disponibilité des ressources
nécessaires pour subvenir aux besoins essentiels et combattre les pires
aspects de la pauvreté : c'est la fameuse initiative 20/20.
L'idée est que les pays en développement consacrent au moins 20%
de leurs budgets nationaux aux services sociaux de base et que les pays
industrialisés affectent 20% de leur aide au développement au
même but. L'initiative a été examinée en 1996 et
réexaminée depuis lors.
Sur le plan conventionnel, il faut dire que les conventions
générales comportant des dispositions relatives aux enfants
possèdent des mécanismes de contrôle qui peuvent être
utilement actionnés au profit des enfants : d'abord la procédure
d'examen des rapports périodiques, puis celles des communications,
devant le comité des Droits de l'homme ou la commission africaine de
Banjul. Plus spécifiquement, la CIDE est suivie dans son application par
un comité des droits de l'enfant qui compte 10 membres élus pour
4 ans et siège à New York. Son rôle se limite à
examiner les rapports que les Etats parties à la convention doivent lui
faire parvenir, d'abord deux ans après sa ratification, puis tous les
cinq ans. L'action de cet organe est aujourd'hui particulièrement
consistante et constitue une mine d'informations sur les politiques nationales
en faveur des enfants. En Afrique, la Charte relative au droit et au
bien-être de l'enfant a mis sur pied, un comité d'experts
fonctionnels depuis que la Charte est entrée en vigueur. Le
comité d'experts africains non seulement reçoit des rapports
périodiques des Etats, mais aussi, reçoit et examine des plaintes
individuelles, procédant de la mauvaise ou de la non-application des
textes sur le plan national.
32
b. La mise en oeuvre des droits de l'enfant sur le plan
national
Par leur proximité, leur connaissance du milieu, les
instances nationales sont en première ligne pour la protection des
droits de l'enfant. Le niveau international pour les rouages conventionnels,
est toujours subsidiaire. L'essentiel des dispositions des instruments
internationaux placent l'Etat au coeur du système international de
protection des droits de l'enfant. Pèsent sur lui, à la fois des
obligations négatives mais surtout des obligations positives. Le fait
que l'Etat soit partout dans la convention des Nations Unies a abouti à
d'inextricables problèmes juridiques, notamment sur le terrain de
l'applicabilité directe de l'instrument. En France, la Cour de cassation
a estimé qu'il résulte du texte même de la convention du 26
janvier 1990 que, conformément à l'article 4 de celle-ci, ces
dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats
parties, de sortes qu'elles ne peuvent être directement invoquées
devant les juridictions73. Le Canada, pays dualiste, n'admet pas
l'applicabilité directe de la CIDE74. Le gouvernement
allemand, lors de la ratification de la convention, a déclaré que
celle-ci « ne s'applique pas directement sur le plan intérieur.
Elle impose aux Etats des obligations de droit international (...)
»75. C'est à dire qu'au-delà de la ratification
formelle, le destin de la règle internationale relative au droit de
l'enfant connaît des (in) fortunes diverses d'un Etat à un
autre.
S'agissant de la Côte d'Ivoire, il faut dire que ce pays
a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits
de l'enfant. En particulier, elle a ratifié la Convention relative aux
droits de l'enfant (CIDE) le 04 Février 1991. De même, la
Côte d'Ivoire a ratifié,
73 Cass.Fr.1ere Civ., 15 juillet 1993 XC. A.S.E du val de
Marne. Voir sur cette jurisprudence OLINGA (AD), « L'applicabilité
directe de la convention internationale sur les droits de l'enfant devant le
juge français », R.T.D.H., 1995, N°24, pp.678-714.
74 Voir LA VALLEE (C.) « La convention internationale
relative aux droits de l'enfant et son application au Canada » in
RIDC, 3-1996, pp.65-630. ; De la même auteure, voir «
L'actualisation des droits de l'enfant dans une perspective globale. Entre
l'universalité de la convention relative aux droits de l'enfant et les
particularismes de la charte africaine sur les droits et le bien-être de
l'enfant ». In Otis G. (Dir.).Démocratie, droits fondamentaux
et vulnérabilité. Actes de troisièmes journées
scientifiques du réseau « droits fondamentaux » tenues au
Caire du 12 au 14 novembre 2005. Presa Universitara Clujeana,
Cluj Napoca, 2006, pp. 267-290. ; dans le même ouvrage, voir l'article de
MARTIN-CHENUT (K.) « le modèle d'intervention à
l'égard de l'enfance délinquante prôné par le droit
international des droits de l'homme comme hybridation des modèles
existants en droit comparé », pp.291-307. ; Voir aussi Nations
Unies, Doc.HRI/Core/1/Add.91 du 12 janvier 1998, p.31.
75 Doc.CRC/C/2 REV.5 du 30.7.1996, p.11.
33
par le biais du décret n° 2002-47, la Charte
africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant(CADBE), puis, en
2003, la Convention 182 de l'OIT sur l'âge minimum ainsi que la
convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants. Il ne
semble pas, suivant une pratique ivoirienne longtemps dénoncée,
et qui, souhaitons-le, s'estompera à brève
échéance, qu'il ait eu une réflexion préparatoire
sérieuse avant la ratification de ces instruments, notamment quant aux
conséquences normatives, institutionnelles, politiques et
financières qu'ils comportent. Se pose aussi le problème de
l'introduction des normes relatives aux droits de l'homme en droit interne. En
principe, les traités régulièrement ratifiés sont
automatiquement intégrés dans l'ordre juridique ivoirien et
bénéficient d'une autorité supérieure aux lois
ordinaires76 ; les normes internes qui leur sont contraires,
à défaut d'être formellement annulées ou exclues de
l'ordre juridique par les procédures consacrées, doivent rester
inappliquées. Point n'est besoin d'une loi ou d'un texte quelconque
supplémentaire pour permettre au texte ratifié de déployer
ses effets, sauf si ses dispositions exigent absolument des mesures juridiques
complémentaires. Toutes les dispositions autosuffisantes sont
directement invocables devant les tribunaux. La Côte d'Ivoire est un pays
dont l'ordre juridique interne est de tendance moniste vis-à-vis de
l'ordre juridique international. Exiger qu'une loi soit adoptée avant
que les dispositions d'un traité soient invocables serait créer
une procédure de « réception » des
traités que la Constitution de ce pays ne connaît pas, exception
faite des traités de paix, des traités relatifs à
l'organisation internationale ou des traités modifiant les lois internes
de l'Etat ivoirien77.
Reste un problème de conciliation d'instruments
internationaux portant sur le même objet, dans le même ordre
juridique. Prenons l'exemple de la notion même d'enfant, selon la
législation interne qui lui est applicable. La Charte africaine est plus
stricte : l'enfant désigne ici « tout être humain
âgé de moins de 18 ans » (art. 2). Si l'on s'en tient
à la situation actuelle du droit positif ivoirien, elle assimile
l'enfant au mineur ; elle semble aussi s'aligner sur la flexibilité de
la CIDE. Pourtant, on peut penser qu'en cas de contradiction entre les
76 Article 87 de la Loi N°2000-513 du 01er
Aout 2000 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire,
reprise à l'article123 de la Constitution du 08 novembre 2016 : «
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou Accord, de
son application par l'autre partie. ».
77 Article 85 de la Loi N°2000-513 du 01er
Aout 2000 portant constitution de la Côte d'Ivoire, reprise à
l'article 120 de la loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 portant
Constitution de la République de Côte d'Ivoire : « Les
traités de paix, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat
ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
».
34
dispositions de la CIDE et celles de la Charte africaine, ces
dernières doivent l'emporter, non seulement du fait de leur
postériorité aux dispositions onusiennes, mais aussi du fait de
leur spécialité régionale, les signataires de la Charte
africaine étant aussi signataires de la CIDE, dont ils connaissaient les
prescriptions au moment de leurs discussions. Les dispositions plus
contraignantes de la Charte africaine l'emportent sur celles plus souples de la
CIDE. C'est la règle en matière d'interprétation de
traités successifs78.
Outre la notion de « droits de l'enfant »,
notre opération définitoire s'attachera à présent
à analyser celle relative à notion de « norme ».
B. NORME
Du latin norma, qui exprime l'idée de «
règle », le terme « norme »79 peut être
rapproché d'un ordre, d'une prescription. Dans le cadre de cette
étude, on considérera tout d'abord à la suite de Hans
Kelsen qu'une norme est la « signification d'un acte de volonté
»80. Cet acte est celui « par lequel une conduite
est ou prescrite, ou permise et en particulier habilitée
»81. Cette définition de la norme en tant que
signification d'un acte de volonté semble pouvoir recueillir l'accord
des deux principaux courants du positivisme juridique, le courant normativiste
comme le courant réaliste82, même si ses implications
théoriques varient selon le point de vue à partir duquel on se
place. A ce stade de l'analyse, on peut se limiter à retenir que le
point de divergence entre ces deux courants porte sur le véritable
titulaire du pouvoir normatif83. Dans une optique normativiste,
l'acte de volonté est en principe accompli par le législateur et
le rôle des juges se limite à appliquer la norme qui
résulte de cet acte. Au
78 Article 30 convention de Viennes sur le droit des
traités.
79 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, pp.12-13.
80 KELSEN (H.), Théorie générale des
normes, (1979), Léviathan, PUF, 1996, p.2. ; BETAILLE (J.), Les
conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit public
interne, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2012,
pp.12.
81 KELSEN (H.) Théorie pure du droit,
2ème ed., (1960),trad.Ch. Eisenmann, LGDJ Bruylant, 1999,
p.13. ; BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de l'effectivité de
la norme en droit public interne, Thèse de doctorat,
Université de Limoges, 2012, pp.12.
82 MILLARD (E.), « Qu'est-ce qu'une norme juridique ?
», CCC, n°21, 2006, p.59.
83 Plus largement, v. PFERSMANN (O.), Entrée «
norme », in Denis ALLAND et Stéphane RIALLS (dir.),
Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p.1079. et s. ;
MILLARD (E.) « Qu'est -ce qu'une norme juridique ? », CCC,
n°21, 2006, p.59 et s.
35
contraire, pour les réalistes, c'est
l'interprète, et à titre principal le juge, qui accomplit l'acte
de volonté exprimant la signification du simple énoncé
produit par le législateur. Il en résulte dans cette optique que
le pouvoir normatif se situe bien davantage du côté des juges que
du côté du législateur84.
Ensuite, la norme est envisagée dans le cadre de cette
étude comme l'expression d'un « devoir être
»85. Pour Hans Kelsen, la norme signifie « que
quelque chose doit être ou avoir lieu », il s'agit d'un acte
« dirigé vers le comportement d'autrui
»86. La signification de cet acte « est qu'une
personne (ou d'autres personnes) doit se comporter d'une manière
déterminée »87. Ainsi, dans une optique
normativiste, « une norme consiste à modéliser des
actions par l'obligation, la permission ou l'interdiction. Elle décrit
un monde idéal, non le monde réel »88. Cela
a deux implications importantes pour l'étude de l'effectivité.
D'une part, la distinction entre le « devoir être » et
« l'être » implique nécessairement qu'un
écart est possible entre le pôle normatif et le pôle
factuel. C'est dans cet interstice que se situe l'étude de
l'effectivité des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. D'autre
part, l'objet du « devoir être » constitué par
la norme est d'influencer l' « être », c'est-à-dire le
fait. Le devoir être « entend donc gouverner les faits
»89. C'est la fonction de direction des conduites humaines
exercée par les normes juridiques.
Enfin, le terme de « norme » est
privilégié en ce qu'il couvre un champ étendu. Il
désigne en effet « un concept plus général que
celui de « règle » ou de « loi », couvrant toutes
les variétés d'obligations, de permissions, ou d'interdictions,
quel que soit le domaine (droit,
84 Les définitions de la norme données par le
dictionnaire de théorie et de sociologie du droit reflètent la
divergence entre ces deux courants (M.T et D.L., in André-Jean ARNAUD
(dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de
sociologie du droit, 1ère éd., LGDJ, 1988,
p.267). Ainsi, dans une optique normativiste, la norme est un «
énoncé impératif ou prescriptif appartenant à
un ordre ou système normatif, et obligatoire dans ce système
». La validité de la norme implique ici nécessairement
son caractère obligatoire, ce qui n'est pas le cas pour les
réalistes. De plus, norme et énoncé sont confondus. Dans
une optique réaliste, elle est la « signification prescriptive
d'un énoncé, quelle que soit sa forme, et en
général de tout acte humain, au regard d'un certain ordre ou
système normatif ». La norme est ici distinguée de
l'énoncé qui n'en est que le support. Seule constitue une norme
la signification de cet énoncé, laquelle résulte de la
volonté de l'interprète.
85 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, pp.13.
86 KELSEN (H.), Théorie générale des
normes, (1979), Léviathan, PUF, 1996, p.2. ; BETAILLE (J.),
Op.cit, p.13.
87 KELSEN, (H.), op.cit. p.2.
88 PFERSMANN (O.), Entrée « norme », op. cit.,
p.1080.
89 PICARD (E.), L'impuissance publique en droit »,
AJDA, 1999, n° spécial, p.11.
36
morale, etc.) et quel que soit le degré de
généralité ou de particularité, d'abstraction ou de
concrétisation »90. Il permet aussi d'inclure les
« principes91 ». Cependant, seules les normes
« juridiques » seront envisagées dans le cadre de
cette étude. On entend par là, exclure les normes
morales92 et se limiter aux normes juridiques
considérées comme valides au sein d'un ordre juridique
donné.
En un mot, par norme du droit international, on entend une
règle ou principe de droit international public. Par exemple, le
principe du respect des traités ( pacta sunt servanda) est une
norme de droit international. Cette norme est considérée comme
une norme de droit international public, parce qu'elle est issue d'une source
du droit international public et de la procédure qui la
caractérise. Pour un exemple, le principe du respect des traités
est une norme de droit international public parce qu'il est issu du droit
coutumier et reconnu à l'art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969 (CV1 ; RS 0.111)93. Cette
distinction est importante, car une même norme de droit international
public peut être issue de plusieurs sources différentes. C'est
ainsi qu'il est possible de fonder le principe du respect des traités
sur la règle coutumière pacta sunt servanda ou sur l'article 26
de la CV1.
Par normes internationales , nous visons ainsi principalement,
les normes contenues dans la Convention Internationale des droits de l'enfant,
la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, mais aussi
celles issues des autres instruments internationaux contraignants ou non
contraignants relatifs aux droits de l'enfant, voire, des droits de l'homme et
qui contribuent à un mieux-être des droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire.
90 PFERSMANN (O.), Entrée « norme », op.
cit., p.1079. ; BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.13.
91 Dans le cadre d'une critique de la distinction
établie par Ronald Dworkin entre les normes et principes DWORKIN (R.),
Prendre les droits au sérieux, PUF, Paris, 1996, p.80), Michel
Troper objecte à juste titre que « le fait que les principes
n'imposent pas une conduite précise ne signifie pas qu'ils ne sont pas
des normes » (Michel TROPER, Philosophie du droit, 3ème
éd., Que sais-je ?, PUF, 2011, p.75). Les principes « ne se
distinguent des autres normes que par leur degré élevé de
généralité ou leur caractère vague ou
programmatique » (Ibid., p.76). ; .) ; BETAILLE (J.),
Les conditions juridiques de l'effectivité de la norme en droit
public interne, Thèse de doctorat, Université de Limoges,
2012, pp.12.
92 Une norme morale, comme toute autre norme, peut aussi
être effective. Lorsqu'une norme morale correspond au contenu d'une norme
juridique, son effectivité peut même venir appuyer celle de la
norme juridique.
93 BESSON (S.), Droit international public.
Abrégé de cours et résumés de
jurisprudence, Stampfli Editions SA, Berne, 2011, p.178.
37
D. REALITES LOCALES
Le terme réalité dérive de l'expression
latine scolast realitas qui signifie « caractère de ce
qui est réel »94. Quant à l'adjectif local,
il dérive aussi du mot latin localis et signifie « qui
a rapport à un lieu ». Le lieu ici visé est la
Côte d'Ivoire. Par réalités locales, nous visons non
seulement les pratiques traditionnelles, mais aussi et surtout l'ensemble des
mesures juridiques, institutionnelles, politiques et sociales ayant cours en
Côte d'Ivoire et qui ont un impact quelconque sur le vécu
quotidien des enfants ainsi que de leurs droits.
La définition des termes essentiels,
opérée, on peut s'autoriser à défricher le champ
d'intérêt du sujet.
§ 2. INTERET DU SUJET
Au-delà du caractère filial de notre attachement
à la Côte d'Ivoire et de notre militantisme95 pour la
cause des droits de l'enfant, ce thème de recherches présente un
double intérêt indiscutable : d'une part, un intérêt
socio-politique, et, d'autre part, un intérêt scientifique qu'il
convient d'exposer.
A. L'INTERET SOCIO-POLITIQUE
Cet intérêt est perceptible tant au niveau de la
société nationale que de la société
internationale.
1. L'importance des droits de l'enfant dans les relations
internationales
Idée-force, ou maître mot, des peuples
contemporains, les droits de l'homme, et incidemment, les droits de l'enfant,
sont à l'ordre du jour dans le monde. Ils ont retrouvé partout,
sur tous les points du globe, un regain d'honneur et d'intérêt,
même si celui-ci n'est pas dénué
d'arrière-pensées politiques. Un des enjeux majeurs qui se
dessinent de nos jours
94
http://www.cnrtl.fr/etymologie/réalité
(consulté le 22 janvier 2014).
95 Voir notre poème : NENE BI (A.D.),
« Enfant, je défendrai à toujours ta cause !
», In. Misères et Espoirs : Voici ma mélodie !,
Edilivre, 2018, pp. 83-84.
38
est l'établissement, à l'échelle
planétaire, d'un droit international adopté et respecté
par tous. Les obstacles sont considérables, le principe de la
souveraineté des Etats n'étant pas le moindre.
En l'absence d'un tel droit international, les tentatives
d'intervenir dans les conflits locaux et les affaires nationales se
multiplient. Que ce soit sous l'égide de l'Organisation des Nations
Unies, ou au titre de l'aide humanitaire, elles se réclament et
s'inspirent des droits de l'homme et prétendent oeuvrer à la
protection de la personne humaine partout où elle est menacée. Il
semble donc que, de plus en plus, les droits de l'homme servent de normes
à ceux du citoyen, mais aussi une action politique au niveau mondial.
Mais il ne faudrait pas qu'ils soient employés au détriment de la
question du droit des peuples.
Assurément, une prise de conscience mondiale, va
crescendo, tendant à procurer à l'être humain le
plein épanouissement de sa personnalité et de sa dignité,
en un mot son bonheur ; à telle enseigne que les droits de l'homme, et
partant les droits de l'enfant, sont devenus, non seulement un enjeu majeur
dans les relations internationales, mais aussi une conditionnalité de
l'aide internationale.
a. Le respect des droits de l'enfant : un enjeu
majeur dans les relations internationales
L'universalité des droits de l'enfant, loin
d'être acquise dans les faits, reste cependant une affirmation forte qui
trouve sa légitimation dans la plupart des instruments juridiques
internationaux auxquels ont librement souscrit presque tous les Etats membres
de la communauté internationale. Mais, à l'instar des droits de
l'homme, les droits de l'enfant sont un discours à la fois
polysémique et hégémonique ; ils sont un outil à
tout faire96, avec des risques évidents d'être
détournés de leurs fonctions véritables97.
Ainsi, les droits de l'enfant représentent aujourd'hui un enjeu
politique, géopolitique et géostratégique majeur dans les
relations entre Etats. C'est ce que montre la fonction qui leur est
dévolue, laquelle fonction se décline sous différentes
formes.
Il s'agit d'abord d'un facteur d'intégration
éthique : la Déclaration de la Conférence de Vienne de
1993 affirme que : « eu égard aux buts et principes de
l'Organisation des Nations
96 YACOUB (J.), Les droits de l'homme sont-ils exportables ?,
Paris, Ellipses, 2005, pp. 133-166.
97 BESSIS(S.), L'Occident et les autres, Paris, La
Découverte §Syros, 2001-02, pp.238-328.
39
Unies, la promotion et la protection de ces droits sont
une préoccupation légitime de la communauté internationale
»98. Les droits de l'enfant, tels qu'ils résultent
des instruments juridiques internationaux, développent un consensus
mondial quant au statut même de l'enfant. Dès lors, ne peuvent
véritablement faire partie de cette communauté internationale ou
s'en réclamer que ceux des Etats qui font clairement allégeance
à ces valeurs des droits de l'enfant, s'engageant ainsi à les
respecter et les faire respecter.
Ils sont un facteur de « civilisation
»99 des Etats en tant que membres de la communauté
mondiale, ce qui les engage à respecter un certain nombre d'obligations
au niveau national et international. Les instruments juridiques internationaux
sont des outils de mise en oeuvre et d'évaluation de cette civilisation
mondiale des droits de l'homme-enfant. En ce sens, les droits de l'enfant sont
un moyen de penser aux évènements tragiques, une lentille
à travers laquelle notre société peut être vue et
critiquée, un ensemble d'aspirations qui constitue le coeur de
l'idéologie libérale. Les droits de l'homme sont devenus, selon
les mots de Richard Rorty, une « vérité dans le
monde100 ».
Vitrine attirante sur la scène politique
internationale, les valeurs de l'Etat de droit font recette101 et
sont proclamés par la plupart des Etats, du moins, en théorie.
Même les Etats dont la qualification d'Etats démocratiques fait
l'objet de débats comme les pays de l'Europe de l'est102, et
ceux dits du Sud103, affirment constitutionnellement leur
attachement à l'Etat
98 Déclaration de la Conférence des Nations unies
sur les droits de l'homme du 25 juin 1993, art.4.
99 L'article 3 commun aux quatre conventions de Genève
du 12 Août 1949 fait mention des garanties reconnues comme «
indispensables entre les peuples civilisés ».
100 RORTY (R.), « Human Rights, rationality and
sentimentality », in On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures
1993, Stephen Shute and Susan Hurley, eds. (New York, Basicbooks, 1993,
p.134.
101 HAMON (L.), « L'Etat de droit et son essence »,
Revue française de Droit constitutionnel, n°4, 1990,
p.699.
102 A titre d'exemple, voir l'art. 1, al. 1 de la Constitution
de la Fédération de Russie du 12 décembre 1993 : « La
Fédération de Russie est Etat démocratique,
fédéral, un Etat de droit ayant une forme républicaine de
gouvernement » ; Art. 1 de la Constitution ukrainienne du 28 juin 1996 :
« L'Ukraine est un Etat de droit souverain, indépendant,
démocratique et social » ; Art.1, al.1 de la Constitution de
Biélorussie adoptée le 24 novembre 1996 : « La
République de Biélorussie est un Etat de droit social,
démocratique et unitaire ».
103 En Afrique, c'est notamment le cas du Bénin qui
dès le Préambule de sa Constitution affirme « sa
détermination par la présente Constitution (Loi n° 90-32 du
11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin) de créer un Etat de droit et de démocratie
pluraliste... ». Le Sénégal dans sa Constitution de 2001
affirme : « Le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel
l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le
contrôle d'une justice indépendante et impartiale ». Le
Burkina Faso dans sa Constitution du 27 janvier 1997 s'est engagé dans
le préambule à préserver les acquis des droits collectifs
et individuels (...) ». En Amérique du Sud, la Constitution de la
République bolivarienne du
40
de droit. Il s'agit en fait pour ces Etats en adhérant
aux principes de l'Etat de droit, d'acquérir ainsi « un minimum de
respectabilité internationale »104. Comme le note John
TASIOULAS : « le discours de ces derniers temps sur les droits de l'homme
a été élevé au statut d'une lingua franca
éthique »105 . Les Etats dans leur majorité ont
compris que l'Etat de droit ne va pas sans garanties constitutionnelles des
droits et libertés fondamentaux et ces garanties doivent être
fondées sur « le mixte de naturalité et de
rationalité qui est propre à l'homme »106.
Dans ce processus de construction de l'Etat de droit en Afrique, les droits de
l'enfant ont sans doute une importance indéniable en tant que composante
essentielle de l'Etat de droit. Cet Etat de droit ne doit plus être
aujourd'hui une notion purement « incantatoire
»107 en Afrique et singulièrement en Côte
d'Ivoire.
Les droits de l'enfant renforcent la citoyenneté et la
démocratie tant au niveau national qu'international. Il y a aujourd'hui
la manifestation d'une conscience de citoyenneté mondiale qui fait que
l'on se sent concerné par ce qui se passe ici ou ailleurs : exploitation
et traite des enfants, résistance à l'oppression à
l'échelon mondial, interdiction de la torture et combat pour l'abolition
de la peine de mort, lutte contre la pauvreté, les maladies ou tout
autre fait qui porte atteinte à la dignité et qui compromet le
bien-être et l'avenir des enfants.
Enfin, à l'instar des droits de l'homme, les droits de
l'enfant sont aujourd'hui, un enjeu politique et géostratégique
dans les relations internationales. C'est un argument de poids dans la
conception des nouvelles théories, notamment le droit (et même le
devoir) d'ingérence politique, puis humanitaire et maintenant judiciaire
avec l'avènement des juridictions pénales internationales et
l'universalité de leurs compétences108. Un autre
aspect
Venezuela de 1999 proclame dans son article 2 : « Le
Venezuela se constitue en un Etat démocratique, de droit et de justice
(...) ».
104 HAMON (L.), « L'Etat de droit et son essence »,
Revue française de Droit constitutionnel, n°4, 1990,
p.700.
105 TASIOULAS (J.), « The moral reality of Human rights
», in Freedom from poverty as a human right: who owes what to the very
poor? , Thomas Pogge, ed. Oxford, Oxford University Press, 2007, p.75.
106 GOYARD-FABRE (S.), L'Etat, figure moderne de la
politique, Armand Colin, Coll. « Cursus », Paris, 1999, p.95.
107 DE GAUDUSSON (J.D.B.), « Défense et
illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de
pratique du pouvoir », in Mélanges en l'honneur de
Louis-Favoreu : Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 2007,
p.610.
108 KOUDE (R.K.), La pertinence opératoire des
droits de l'homme : de l'affirmation universaliste à
l'universalité récusée, Thèse de doctorat en
Philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3, 2009, p.323.
41
de l'importance des droits de l'enfant dans les relations
internationales, c'est qu'ils se présentent comme une
conditionnalité de l'aide internationale.
b. Le respect des droits de l'enfant : une
conditionnalité de l'aide internationale
Depuis 1990, les droits de l'homme, sinon, les droits de
l'enfant sont devenus une condition d'octroi de l'aide internationale, une
référence naturelle, voire obligée, des discours des
hommes politiques. Les pays développés et les institutions
internationales conditionnent l'octroi de leurs aides et de leurs prêts
aux gouvernements des pays sous-développés au strict respect des
droits de l'homme et des exigences démocratiques. De façon
générale, il est aujourd'hui établi un lien direct entre
l'assistance occidentale et la démocratie véritable, celle qui
repose sur certaines valeurs universelles, telles : le respect des droits
humains, le respect des droits de l'enfant, l'investissement dans le droit
à l'éducation des enfants, la lutte contre la traite et
l'exploitation des enfants, le multipartisme, la participation des citoyens
à des élections libres et honnêtes, le libre choix des
gouvernants, l'Etat de droit, la bonne gouvernance. Ainsi, depuis le sommet
franco-africain de la Baule109, en date du 21 juin
1990, l'aide de la France est devenue graduée à l'égard
des régimes politiques africains : elle est tantôt enthousiaste,
tantôt tiède, et cela, selon que les régimes politiques
bénéficiaires sont attachés ou non aux droits de l'homme.
En juillet 1996, au terme de son voyage officiel au Congo,
précisément à Brazzaville, le Président Jacques
CHIRAC avait mis les chefs d'Etat africains en garde en ces termes : «
Il faut en finir avec les coups de force ou d'Etat, les putschs, les
juntes, les pronunciamientos et toutes les manifestations de transition
violente. Ces évènements d'un autre âge sont, pour chacun
de nous, une véritable humiliation. Pour les peuples, ils sont une
déception et l'alibi trop commode du désengagement.
»110.
109 Discours de François MITTERAND à la Baule,
20 juin 1990, in Politique étrangère de la France,
mai-juin 1990, p.130. ; AKONO (F.T.), Le discours de la baule et les
processus démocratiques en Afrique. Contribution à une
problématique de la démocratie et du développement dans
les pays d'Afrique noire francophone, Thèse de doctorat en science
politique, Université de Clermont-Ferrand 1, 1995, 644p.
110 CHIRAC (J.) cité par Nicolas AGBOHOU, Le franc
CFA et l'Euro contre l'Afrique, Editions Solidarité Mondiale A.S.,
Paris, 1999, p.207.
Il a également suggéré de cimenter le
socle des valeurs intangibles telles que « la liberté, la
dignité, le respect de l'autre, l'égalité des hommes, le
droit qui les garantit »111. Pour les pays dont la
politique se situe aux antipodes de ces valeurs fondamentales, « le
risque est grand de voir se tarir l'octroi de l'aide extérieure
»112 . Au fond, à l'heure actuelle, les pays
développés et/ou bailleurs de fonds internationaux s'abstiennent
et souvent refusent de consentir des aides ou prêts aux pays
sous-développés qui violent les droits de l'enfant ; autrement
dit, ils subordonnent l'aide au développement au respect rigoureux des
droits de l'homme, donc, des droits de l'enfant. L'intérêt de
notre sujet de recherche ayant été précisé au
niveau du droit international et du droit des relations internationales, il
importe d'examiner son intérêt national indéniable.
42
111 Idem, p.208.
112 Ibid., p.208.
43
2. L'importance des droits de l'enfant dans la
société nationale
Gouverner un pays d'une façon démocratique tient
compte des besoins et des droits de sa population113. Ces besoins et
ses droits ne se réduisent pas à des choses matérielles.
Ils sont aussi non matériels. Plus spécifiquement les droits de
l'enfant selon la CIDE couvrent les deux aspects de l'enfant : son corps et son
esprit. Il s'agit du nouveau concept du « bien-être »
de l'enfant114. Le bien-être de l'enfant est le droit pour
l'enfant de vivre dans des conditions matérielles nécessaires
à son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
Etant donné que l'enfant a besoin d'être pris en charge
matériellement dans sa nourriture, son logement et sa santé, ce
dernier doit être pris en charge au niveau intellectuel, psychologique et
moral.
Il existe une relation inséparable entre la culture
démocratique diffusée dans une nation et la perception des
esprits de ces citoyens. Et comme l'enfant est un individu à part
entière, il est aussi affecté par la culture politique dominante.
Un intérêt particulier de cette thèse visera à
démontrer la relation existant entre le contexte politique et le respect
des droits de l'enfant.
L'intérêt national au niveau politique de cette
étude consiste à faire face à un devoir né d'une
prise de conscience et d'une conviction. L'étude est née d'une
prise de conscience, du fait qu'il y a une distance objective entre la
réalité vécue par les enfants en Côte d'Ivoire et la
reconnaissance de leurs droits et libertés consacrés par les
Constitutions et les instruments internationaux relatifs aux droits de
l'enfant.
De nombreux pays, comme la Côte d'Ivoire se sont
engagés lentement dans le mouvement international et national de
reconnaissance et de protection des droits de l'enfant. En effet, après
son accession à l'indépendance, ce pays n'a pas pris
véritablement à coeur dans son droit interne, la question de
l'enfant et sa première Constitution le montre
113 ENFANCE TIERS MONDE, Les enfants : levier pour un
développement humain durable Investir dans les enfants, Ven
Brussels, 2005 p.2.
114 GOUTTENOIRE (A.), « Le bien-être de l'enfant
dans la Convention internationale des droits de l'enfant »,
Informations sociales, 2010/4 n°160, pp.30-33.
44
clairement115. Ce sont les Constitutions de
2000116 et de 2016117qui insistent sur la protection des
droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. En plus des lois en matière
de protection de l'enfant, elle a également adhéré aux
instruments de protection des droits de l'homme en général et de
l'enfant en particulier. Nonobstant la ratification des instruments
spécifiques, la Côte d'Ivoire n'a pas toujours
démontré un intérêt réel pour la
défense des droits de l'enfant comme en témoigne la situation
réelle des enfants dans ce pays. L'actualité de notre sujet y
trouve son fondement. Une étude sur les droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire apparait très opportune au vu de la ratification par l'Etat de
Côte d'Ivoire, des textes internationaux relatifs aux droits des enfants.
De façon globale, cette étude permettrait de mesurer
l'écart entre les textes et leur application réelle sur le
terrain. Mieux, elle vise à interpeller l'opinion internationale et
nationale sur son devoir de protection de l'enfant en tant qu' « avenir du
monde » car « l'avenir du monde, c'est-à-dire celui de ses
enfants dépend de chacun d'entre nous. Car il appartient à chacun
d'entre nous d'améliorer le sort de son prochain
»118.
Une telle étude est donc opportune et nécessaire
dans la mesure où elle nous permettrait de situer les acteurs de la
protection de l'enfance sur les actions concrètes
réalisées en matière de mise en oeuvre des droits de
l'enfant en Côte d'ivoire au regard de ce qui est prescrit par les
conventions internationales et régionales.
Une telle étude entend donner un aperçu des
limites de la mise en oeuvre de la protection afin d'aider les acteurs de la
protection de l'enfance à réorienter les actions pour une
meilleure prise en charge des enfants en Côte d'Ivoire, afin de
déboucher à terme , à une effectivité optimale des
droits reconnus aux enfants.
En somme, une telle étude vise à mieux faire le
point sur les acquis, afin de mieux définir des perspectives pour une
effectivité optimale des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. En
effet, cette étude permettrait :
115 En effet, la Constitution ivoirienne de 1960 ne comporte
aucune disposition expresse qui réfère aux droits de l'enfant.
116 Cela est perceptible dans les Articles 5 et 6 de la
Constitution ivoirienne de 2000 qui feront l'objet d'un examen minutieux dans
les développements ultérieurs.
117 Articles 5, 10, 16,31, 32,34 de la loi n°2016-886 du
08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte
d'Ivoire.
118 Propos tenu par un enfant nommé GOKCE de
nationalité turc, âgé de 16 ans lors de l'assemblée
tenue par l'Union interparlementaire. Voir UNICEF, La protection de
l'enfant guide à l'usage des parlementaires, 2004, p.7.
45
- de disposer d'une base de données fiables
susceptibles d'orienter les politiques nationales de mise en oeuvre des droits
de l'enfant en termes de besoins, préoccupations et de prise en charge
de véritables intérêts des groupes cibles par les
gouvernants ;
- d'apporter des réponses ciblées et
spécifiques prioritaires en termes de protection et de défense
des droits de l'enfant.
En un mot, à l'actualité du sujet s'associe, un
autre intérêt social devant nous permettre d'analyser le
système juridique ivoirien de protection des droits de l'enfant afin
d'en déterminer les forces et les faiblesses. Au-delà, un dernier
intérêt social consisterait à entrevoir de possibles
solutions à la réalisation d'une effectivité optimale des
droits reconnus aux enfants vivant sur le territoire ivoirien.
Par ailleurs, l'importance du sujet de recherches «
les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire : entre normes
internationales et réalités locales » n'apparait pas
seulement au niveau socio-politique ; il revêt un intérêt
scientifique indéniable, car c'est une discipline universitaire
transversale peu enseignée et vulgarisée en Côte
d'Ivoire.
B. L'INTERET SCIENTIFIQUE : LES DROITS DE L'ENFANT,
UNE DISCIPLINE TRANSVERSALE NON AUTONOME ET PEU DIFFUSEE EN COTE
D'IVOIRE
La question de l'effectivité de la règle de
droit en général, et des droits fondamentaux en particulier,
présente un grand intérêt pour tout juriste.
L'effectivité de la règle de droit est la condition
nécessaire de l'existence de l'Etat de droit défini comme :
« un Etat qui se soumet à un régime de
droit119 , c'est-à-dire dont l'action est entièrement
encadrée et régie par le droit... (et dont les) divers organes ne
peuvent agir qu'en vertu d'une habilitation juridique et faire usage que des
moyens autorisés par le droit »120.
Pour François LUCHAIRE, le juriste a pour devoir de
veiller à l'application du droit dans ses écrits et dans son
enseignement121. Cette obligation s'accroit de façon
exponentielle en matière de droits fondamentaux. Ainsi, au
Congrès de New Dehli du 10 janvier 1959,
119 HENRY (J-P), « Vers la fin de l'Etat de droit ?
», RDP, 1977, pp.1207-1235, p.1211.
120 CHEVALLIER (J.) « La mondialisation de l'Etat de
droit », in M. BORGETTO (coord.), Droit et politique à la
croisée des cultures, Mélanges Philippe Ardant, LGDJ, Paris,
1999, pp.325-337. , spéc. p.326.
121 LUCHAIRE (F.), « De la méthode en droit
constitutionnel », RDP, 1981, pp.275-329, spéc. p.282.
46
organisé par la Commission Internationale des juristes,
il a été expressément affirmé que la
primauté du droit étant un principe dynamique : « ...il
appartient avant tout aux juristes d'en assurer la mise en oeuvre et le plein
épanouissement, non seulement pour sauvegarder et promouvoir les droits
civils et politiques de l'individu dans la société libre, mais
aussi pour établir les conditions économiques, sociales et
culturelles lui permettant de réaliser les aspirations légitimes
et de préserver sa dignité »122.
Si les droits de l'homme sont aujourd'hui enseignés
dans les universités ivoiriennes, tel n'est pas le cas des droits de
l'enfant, stricto sensu.
Eu égard à son intérêt
socio-politique et à l'intérêt scientifique certain qu'ils
présentent, l'enseignement des droits de l'enfant mérite
d'être renforcé, aujourd'hui, dans les universités
publiques et privées de la Côte d'Ivoire ; Mieux, comme les droits
de l'homme, cette matière se révèle être une
discipline-synthèse des matières de droit public. Au fond, les
Droits de l'enfant s'analysent en une « science carrefour » ou «
droit-carrefour », car ils se trouvent au confluent du Droit public et du
Droit privé. Partant, ils se présentent comme une matière
interdisciplinaire, ou transversale, étant le lieu de confluence, ou de
convergence, d'une multiplicité et variété de disciplines
juridiques. Dans ces circonstances, il n'est guère étonnant de
voir, ou de savoir, que cette étude sur les « droits de
l'enfant » tend à promouvoir toutes les branches du droit,
donc tout le droit, c'est-à-dire la science juridique dans son ensemble.
De même, l'absence d'une importante doctrine uniquement centrée
sur la problématique justifie à plus d'un titre cette
étude. A cet égard, ici, le sujet de recherche présente un
intérêt scientifique certain.
En somme, cette étude présente un grand
intérêt aux niveaux international, national, et sur les plans
politique, académique et scientifique. En effet, cette thèse
pourra servir de sources d'informations pour les praticiens et de pistes de
préconisations de réformes pour les autorités
publiques.
Et c'est de cet intérêt que découle la
problématique du sujet.
122 Cité in MBAYE (K.), Les droits de l'homme en
Afrique, 2e éd., A. Pedone, Paris, 2002, p.80.
47
§ 3. LA PROBLEMATIQUE
Relativement au sujet de recherche, une question se pose
liminairement : Pourquoi une étude sur « Les droits de
l'enfant en Côte d'Ivoire : entre normes internationales et
réalités locales » ? Ou encore, une telle
étude pour quoi faire ?
L'importance d'une telle question vient de ce que les droits
de l'enfant, revêtent un caractère universel. Dès lors,
cette étude semble, a priori, briser la nature universaliste ou unitaire
des droits de l'enfant, qui par essence, concerne tout enfant et tous les
enfants à la fois.
On le sait : l'enfant est éminemment un être
complexe : il est ondoyant, inconstant et divers. En outre, il vit dans une
société capricieuse, qui change au gré des circonstances.
Il est évident que tout cela retentit sur ses droits, bien que ceux-ci
possèdent un fond invariable, qui est un véritable atome
insécable, résistant à l'usure du temps, et transcendant
les espaces et les époques123. Parce qu'ils sont
consubstantiels à l'enfant qui, lui-même, évolue, ou varie,
d'une société à une autre, les droits de l'enfant
apparaissent comme relatifs et évolutifs. Il s'ensuit que leur mise en
oeuvre peut se décliner différemment suivant l'environnement
socio-politique considéré. C'est donc à juste titre que
ces droits présentent des particularités dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, pays ayant accédé à la liberté
de se gouverner et s'administrer elle-même, en date du 7 Aout 1960.
Cette indépendance acquise, la Côte d'Ivoire va
adhérer au mouvement de reconnaissance et de protection aussi bien
international que national des droits de l'homme et plus
particulièrement, des droits de l'enfant. Partant, l'on espérait,
en bonne logique, un renouvellement qualitatif de la vie socio-politique et
culturelle ivoirienne, un sort meilleur des droits, notamment des droits de
l'enfant, après les graves et massives atteintes aux droits
enregistrés durant l'époque coloniale. Cette circonstance laisse
surgir une série de questions :
L'ordre juridique nouveau, résultant de l'Etat nouveau,
consacre-t-il des droits au profit de l'enfant vivant sur le sol ivoirien ?
Quelles sont les pratiques quotidiennes relatives aux droits de l'enfant dans
cette ère nouvelle de la Côte d'Ivoire ? Existe-t-il des
réponses satisfaisantes d'ordre juridique et institutionnel de promotion
et de protection des droits de
123 KOFFI KONAN (E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Thèse unique de droit public,
Université de Cocody-Abidjan, UFR-SJAP, 2008, p.90.
48
l'enfant en Côte d'Ivoire ? Existe-t-il en
matière des droits de l'enfant, un écart entre, d'une part, les
textes internationaux, et d'autre part, leur interprétation et leur
application en Côte d'Ivoire ? Y'a-t-il des facteurs inhérents
à l'ordre socio-historique et politique qui, tout en accentuant la
menace infantile, inhibent l'effectivité des droits reconnus aux enfants
dans cet Etat ? Mieux, les enfants vivant sur le territoire ivoirien
bénéficient-ils de droits concrets ou réels
dénués de toute portée illusoire ou abstraite ? Comment
repenser l'action juridique, politique et institutionnelle pour une meilleure
effectivité des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, pays aspirant
à l'émergence à l'Horizon 2020 ?
Ces nombreuses questions peuvent être regroupées
en une seule, à la question fondamentale suivante : Quels sont les
facteurs d'origine juridique et extra-juridiques qui participent ou qui servent
de fondement à l' (in)effectivité des droits de l'enfant ? Ou
encore, quel est l'état des droits de l'enfant dans l'Etat Côte
d'Ivoire ?
Pour répondre à cette question délicate,
il est, apparemment, tentant de se placer successivement sous la
première République, la deuxième République ainsi
que la récente troisième République. Mais une telle
démarche historique pourrait nous conduire à un travail difforme
ou disproportionné, et ce pour la raison fondamentale tenant à
ceci que la deuxième République a existé du
01er Aout 2000 au 08 novembre 2016 au est également la date
d'établissement la troisième République. Dès lors,
il paraît utile d'emprunter une autre voie.
Pour mesurer l'effectivité des droits reconnus aux
enfants en Côte d'Ivoire, il faut examiner la législation et les
politiques nationales ainsi que l'existence et l'efficacité des
structures et mécanismes requis pour leur mise en oeuvre ; C'est
à cette condition que l'on pourrait mesurer les progrès et
limites liés à l'effectivité des droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire, en ayant en toile de fond, les réalités
quotidiennes auxquelles font face les enfants.
§ 4. HYPOTHESE
Nous procédons, dès à présent,
à la formulation de notre hypothèse centrale. En effet, «
si l'on expérimentait sans idées préconçues, on
irait à l'aventure », écrit Claude BERNARD. C'est dire
que l'hypothèse est une proposition de réponse à la
question posée. Notre hypothèse centrale est la suivante : La
situation des droits de l'enfant demeure encore préoccupante en
Côte d'Ivoire ; en effet, en dépit d'une certaine
effectivité théorique fondée
49
sur des acquis normatifs et institutionnels, de nombreuses
pesanteurs politiques, juridiques, économiques, socioculturelles font
encore obstacle à une effectivité optimale des droits de l'enfant
en Côte d'Ivoire. Le cadre juridique et institutionnel souvent
inapproprié et la non application des lois positives existantes
constituent également de sérieux obstacles à la jouissance
effective des droits reconnus aux enfants. Mieux, s'il est vrai qu'en
Côte d'Ivoire, des efforts juridiques et institutionnels insuffisants ont
été réalisés, il n'en demeure pas moins que cet
édifice juridique et institutionnel perfectible, sert d'habillage
à des tristes réalités infantiles dont on ne saurait
cacher la nudité, entamant derechef, de façon grossière
l'effectivité optimale des droits de l'enfant. Pour une
effectivité optimale des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, un
renforcement des mécanismes de mise en oeuvre des droits de l'enfant
apparaît plus qu'opportun.
Par quels procédés pourrons-nous valider cette
hypothèse ?
50
§ 5. METHODOLOGIE
Il faut recourir à une démarche
appropriée, en gardant à l'esprit que le choix d'une
méthode conditionne tout le travail scientifique. En effet, «
la méthode éclaire l'hypothèse et détermine les
conditions de la recherche124 ». Notre démarche
s'articule autour de trois étapes successives, à savoir : la
recherche documentaire, l'analyse et le choix de solutions. La recherche
documentaire a eu pour but de dresser un inventaire le plus exhaustif possible,
du point de vue normatif et doctrinal, en matière de reconnaissance et
protection des droits de l'enfant. Il était question de collecter et
d'intégrer les instruments juridiques et les mécanismes
régissant la protection juridictionnelle et non juridictionnelle sur le
plan national ivoirien. Cette étape nous a amené à
rassembler les informations, notamment les données statistiques sur le
sort des enfants et l'action menée par les différents
intervenants dans la protection des enfants en Côte d'Ivoire. Aussi,
avons-nous eu recours à certains documents officiels et rapports des
différents organes de l'Onu à savoir, le Comité des droits
de l' enfant de l'ONU, l'Unicef, le BIT. Nous avons eu aussi à mener des
enquêtes qualitatives sur le terrain ivoirien. La presse ivoirienne a
été suivie avec intérêt pour y relever des
éléments pertinents à notre argumentaire. Beaucoup de
temps a été consacré aux discussions avec des personnes
ressources travaillant dans les institutions onusiennes, des Organisations non
gouvernementales (ONG), des professionnels du droit, en particulier des
professeurs de droit. Nous avons mis à profit les nouvelles
technologiques de l'information et de la communication (NTIC125),
notamment pour la documentation onusienne ainsi que les données
difficiles à obtenir auprès des services compétents.
L'analyse, quant à elle, nous a permis d'évaluer
l'effectivité des normes et mécanismes de protection des enfants.
Le constat d'échec nous a amené à dégager les
limites juridiques et les pesanteurs contextuelles qui inhibent l'atteinte
d'une effectivité optimale des droits de l'enfant. Nous avons saisi
l'occasion pour poser la question cruciale de la menace
124 Pour différentes options méthodologiques,
voir, entre autres, KONTCHOU KOUEMEGNI (A.). « Méthodes de
recherche et nouveaux domaines en relations internationales ». In :
Revue Camerounaise des Relations Internationales (RCRI), éd.
Spéciale, n°16-17 décembre 1992.
125 Les NTIC sont aujourd'hui un outil incontournable en
recherche juridique avancée. A ce sujet, voir Serge GUINCHARD (S.),
HARICHAUX (M.) et Renaud de TOURDONNET (R.). Internet pour le droit ;
connexion-recherche-droit. Paris : Montchrestien, 1999, 283p.
51
permanente contre les enfants, et plus
particulièrement, les raisons apparentes et inavouées des
atteintes permanentes aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.
Au plan méthodologique, notre démarche a
été plurielle, car l'interdisciplinarité du sujet impose
une triangulation, voire un « cocktail méthodologique
»126. A l'instar du Professeur Maurice KAMTO, nous sommes
d'avis qu'aucune méthodologie, ancienne ou nouvelle, ne doit a priori
être exaltée ou rejetée, pourvu que le chercheur demeure
conscient de l'ensemble dans lequel s'insère ou s'intègre sa
propre entreprise. Nous avons donc adopté une méthode personnelle
comme le recommande, avec pertinence, M. WRIGHT : « soyez un bon
ouvrier. Evitez les procédures trop rigides. Cherchez surtout à
développer et à exploiter votre imagination. Travaillez à
la réhabilitation de l'artisan intellectuel, dans toute sa
simplicité, soyez-en vous-même. Que chaque homme fasse sa
méthodologie pour son propre compte, que chacun fasse sa propre
théorie. Que la théorie et la méthode se pratiquent comme
un véritable métier. Défendez le primat de l'intellectuel
isolé ; luttez contre la domination des équipes de techniciens de
recherche. Abordez pour votre propre compte les problèmes de l'homme et
de la société »127.
Aussi, avons-nous eu recours, au cours des deux
premières étapes, à deux principales, à savoir :
l'approche comparative et l'approche synthétique.
L'approche comparative, « par son insistance à
découvrir la règle sous la coïncidence et l'explication sous
la concomitance128 », devrait nous donner la clé de
la connaissance cumulative. « Penser sans comparer est impensable,
parce qu'il n'y a pas de connaissance de soi qui ne passe par celle de
l'autre»129. En partant des diverses expériences
dans des pays considérés, il s'est agi d'évaluer
l'effectivité des différents aspects de la protection des
enfants, eu égard au contenu du droit conventionnel de protection. Nous
avons évalué la réalité des droits fondamentaux
garantis aux enfants en Côte d'Ivoire en les confrontant aux normes
internationales pertinentes, mais aussi et surtout, en analysant des
politiques
126 Selon John TODD, toute recherche approfondie en
matière sociale doit absolument être interdisciplinaire. Le
cocktail méthodologique est ainsi l' « ensemble de divers
procédés et démarches intellectuelles conduisant à
la recherche de la vérité ». Pour cette
définition, voir TODD (J.), Mixing qualitative and quantitative
methods. New York : Cornell University Press. 1980, pp.135-148.
127 WRIGHT (M.), L'imagination sociologique, Paris :
Editions Maspero, 1971, p.233.
128 DOGAN (M.) et PELASSY (D.), La comparaison
internationale en sociologie politique. Paris : LITEC, 1980, p.3.
129 Ibid. p.5.
52
publiques de mise en oeuvre des droits de l'enfant par
certains Etats parties (France, Bénin, Togo...) aux conventions
internationales pertinentes .
L'approche synthétique nous a permis, par la suite, de
dégager une vue d'ensemble des particularités inhérentes
à la situation des enfants en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvions pas
prendre les différentes villes ivoiriennes séparément et
individuellement ; ce qui aurait été fastidieux et nous aurait
mené à des conclusions partielles et par voie de
conséquence, partiales. La méthode synthétique devait nous
être très utile, notamment, pour envisager une vision d'ensemble
des problèmes liés à l'effectivité ou
l'ineffectivité des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.
Enfin, tout au long de la troisième phase, nous avons
formulé des approches de solutions pouvant contribuer à un
meilleur sort des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. La
problématique des souffrances endurées par les enfants
étant placée dans un contexte global, nous sommes arrivés
à la conclusion que le problème central est la persistance des
résistances aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Pour cerner
une telle problématique et tenter de trouver des pistes de solutions
idoines, nous avons eu recours à plusieurs approches dont :
- L'approche par « l'arbre à problèmes
», qui préconise de s'attaquer à un problème
global en partant du secondaire au principal130. C'est-à-dire
que nous avons proposé des pistes de solutions convergentes, d'abord
pour régler les problèmes connexes ou secondaires, avant d'en
proposer pour le problème central ;
- L'approche « diachronique » qui nous a
permis d'évaluer les percées juridiques réalisées,
au plan normatif et jurisprudentiel, depuis l'adhésion de la Côte
d'Ivoire à la convention internationale des droits de l'enfant ;
- L'approche « droits de l'homme
»131, par laquelle nous avons envisagé
l'effectivité comme la réalisation totale et pleine de l'ensemble
des droits reconnus aux enfants. Nous avons analysé lesdits droits en
des créances dues par la puissance publique aux enfants, en tant que
membres les plus vulnérables de la population. Ceci met à la
charge de l'Etat un certain nombre d'obligations positives, entre autres, la
prévention
130 REINTJENS (F.). La guerre des Grands Lacs : alliances
mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique Centrale, Paris :
L'Harmattan, 1999, p.171.
131
http://www.parentsparticipation.eu/fr/man-observatoire/quest-ce-quune-une-approche-de-leducation-
basee-sur-les-droits-de-lhomme(consulté
le 20/01/2018).
53
concrète et la répression des violations subies
par les enfants. L'approche « droits » nous a ainsi permis
de discuter l'effectivité des droits fondamentaux de l'enfant, notamment
à travers l'action politique, administrative, législative et
juridictionnelle de l'Etat ivoirien ;
- L'approche syncrétique s'est imposée, car le
caractère interdisciplinaire de nos hypothèses nécessitait
le recours à une démarche dépassant le cadre exclusivement
juridique et empruntant, avec la prudence scientifique nécessaire, des
outils dans d'autres sciences sociales. L'effectivité ne peut se
définir, s'appréhender uniquement à travers le droit, il
faut la rattacher à d'autres disciplines des sciences humaines comme la
littérature, la philosophie ou la sociologie, mais aussi à une
discipline autonome à laquelle le droit s'intéresse par un
travail de « juridicisation », il s'agit des sciences de
l'information et de la communication. Le sujet de recherches, à travers
cette approche hors du droit, cette focalisation externe pour emprunter un
terme propre à la littérature, permet de penser le droit de
manière pluridisciplinaire, car comme le dit le professeur Claude
CHAMPAUD : « celui qui ne sait que le Droit, ne connait pas le droit
»132. Un autre auteur célèbre, DEL VECCHIO
écrit : « Le droit est de toutes les sciences la seule qui
doive connaître toutes les autres »133. Nous sommes
d'avis que le juriste à lui seul ne pourrait faire face à l'effet
dévastateur des atteintes aux droits de l'enfant. Celles-ci sont, en
effet, d'une logique et d'une dynamique extrêmement complexes. Pour
aboutir à des résultats conséquents et utiles, le juriste
aurait besoin de la contribution du sociologue, du psychologue, du politologue,
de l'historien, de l'ethno-anthropologue, de l'économiste, du
stratège militaire, du sage africain, de la mère de famille et de
l'intellectuel.
Ainsi, la consultation des personnes ressources dans ces
différents domaines, ainsi que des spécialistes dans d'autres
sciences sociales, a contribué à valider nos propositions
contenues dans le plan ci-dessous.
132 Cité par J-J. SUEUR in Introduction à la
théorie du Droit, Préface G. FARJAT, collection Logiques
juridiques, L'Harmattan, Paris 2001, 207 p.
133 Cité par F. TERRÉ in Le droit et le
bonheur, Dalloz 2010, p. 26.
54
§ 6. PLAN
Au fond, relativement aux droits de l'enfant, la
présente étude est focalisée sur deux chantiers
interactifs et complémentaires, à savoir :
- L'intégration en droit ivoirien, des normes
internationales de protection des droits de l'enfant (Première
partie) et;
- L'effectivité de la protection des droits de l'enfant
à l'épreuve des réalités locales
(Deuxième Partie).
55
Première partie :
L'INTEGRATION EN DROIT IVOIRIEN DES
NORMES INTERNATIONALES DE
PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT

57
L'intégration des normes internationales de protection
des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, met en présence plusieurs
logiques dans ce pays. La première relève de la dynamique
exogène de la matière qui implique qu'un corps de règles
formalisé dans un cadre extérieur à l'Etat s'impose dans
l'ordre juridique national. La deuxième, quant à elle porte sur
l'assimilation de ce droit dans la production normative nationale, afin de lui
faire produire l'effet escompté. L'opposition entre ces logiques
exogène et endogène crée une forme de tension qui appelle
une solution originale. Cette réalité juridique exclut de fait
toute forme de mimétisme, car il s'agit d'une part de donner sens
à cette matière dans le droit national et d'autre part d'en faire
des normes référentielles dans l'univers socio-culturel national.
Cette nécessité nous place donc sur un terrain organisationnel
qui prédétermine les conditions d'effectivité du droit
international des droits de l'enfant. L'intégration des normes
internationales de protection des droits de l'enfant en droit ivoirien renvoie
ici, à un certain espoir suscité du fait de la conjonction d'un
certain nombre de déterminants mis en place par l'Etat afin de donner
vie aux droits de l'enfant. Cette espérance se fonde sur les mesures
normatives et institutionnelles.
Somme toute, l'intégration des normes internationales
de protection des droits de l'enfant en droit ivoirien doit s'entendre ici
comme devant renvoyer, d'une part, à leur reconnaissance ou
consécration normative ; d'autre part, à la mise en place
d'acteurs institutionnels jouant un rôle à des degrés
divers avec des moyens permettant de contribuer à donner vie aux droits
reconnus aux enfants. Mieux, cette intégration s'opère en
principe par la médiation de la règle de droit qui en assure
l'organisation. Le recours à l'effectivité induit le
caractère certain de la protection des droits de l'enfant de par
l'énoncé du droit qui le prescrit et dont le contenu met en
exergue non seulement ces droits, mais aussi les institutions en charge de leur
garantie134.
En tout état de cause, la protection des droits de
l'enfant en Côte d'Ivoire, repose sur un dispositif juridique au contenu
réel (Titre1), soutenu par des mécanismes
institutionnels de garantie à effectivité limitée
(Titre 2).
134 KEUDJEU DE KEUDJEU (J.R.), « L'effectivité de
la protection des droits fondamentaux en Afrique subsaharienne francophone
», Revue CAMES/SJP. n°001/2017, p.104.

59
Titre I : UN DISPOSITIF JURIDIQUE AU CONTENU REEL

61
Les droits de l'enfant sont à l'ordre du jour dans le
monde entier et notamment dans tout Etat qui se veut démocratique.
Ainsi, en vue de satisfaire à cette exigence, l'Etat de Côte
d'Ivoire a souscrit au mouvement juridique de protection des droits de
l'enfant. Désormais, devenue Etat partie aux diverses normes
internationales relatives aux droits de l'enfant, la Côte d'Ivoire,
s'engage ainsi à reconnaitre et respecter les obligations juridiques qui
découlent de ces normes. Ce faisant, elle est amenée à
rendre lesdites normes applicables sur son territoire ou à y conformer
sa législation nationale. Ce mouvement amorcé ne peut se faire
sans influer, d'une certaine manière, sur le droit national de
l'État partie.
En d'autres termes, nous nous intéresserons ici, aux
sources juridiques des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire ; cela suppose
que soient répertoriées, de jure, les principales
sources juridiques qui, de statut conventionnel ou non conventionnel,
constitutionnel ou légal, organisent et permettent aux enfants vivant en
Côte d'Ivoire de bénéficier d'un dispositif juridique de
protection au contenu réel. Ce dispositif juridique au contenu
réel est mesurable à travers deux actions importantes
menées par l'Etat ivoirien, à savoir : une reconnaissance
internationale des instruments protégeant les droits de l'enfant
(Chapitre 1) mais aussi par la réception nationale des
droits internationaux de l'enfant (Chapitre 2).
62
Chapitre I :
UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES
INSTRUMENTS
PROTEGEANT LES DROITS DE L'ENFANT
Prosaïquement, dire qu'un Etat a conclu un traité,
c'est affirmer qu'il a donné son consentement à être
lié par ce traité. En Côte d'Ivoire, les pouvoirs publics
usent de divers modes d'expression du consentement à être
lié par un traité : la signature, la ratification et
l'adhésion. Et, l'engagement de l'Etat de Côte d'Ivoire est
parfait, dès qu'il exprime ce consentement.
En principe, pour les conventions internationales soumises
à la procédure longue, la conclusion s'effectue au moyen de deux
actes successifs : la signature et la ratification.
La signature135 est le premier acte de la
procédure de conclusion mais la phase ultime de la négociation :
elle clôt la négociation menée au cours de longues et
âpres discussions. Toutefois, dans certains cas, « la signature
peut constituer en elle-même, l'expression par l'Etat de son consentement
à être lié par le traité qui devient alors
obligatoire à son égard, du seul fait qu'il l'a
signé136 ». Ces cas ont trait à la
procédure courte, applicable aux accords en forme
simplifiée137. Il va sans dire que ceux-ci échappent
à l'exigence de la ratification : car leur conclusion se réalise
selon la procédure courte, à un seul degré ; de sorte que
l'Etat de Côte d'Ivoire est lié dès la signature. Il est
donc clair que pour ce type de conventions, aucun retard n'existe, de
façon générale, pour la conclusion puisque la signature
seule suffit pour l'expression du consentement de la Côte d'Ivoire.
Quant à la ratification138, elle constitue
le second acte de la conclusion et n'intervient que dans les conventions
soumises à la procédure longue, à un double degré,
c'est-à-dire dans les traités formels ou solennels : elle permet
à ceux-ci de produire leurs effets. Il s'agit d'une prérogative
propre du Président de la République. Cette prérogative
reconnue au Président
135 DEYRA (M.), Droit international public, Gualino,
4ème édition, 2014, p.37.
136 N'GUYEN (Q. D), PELLET (A.) et DAILLER (P.), Droit
international public. , L.G.D.J., Paris, 8e édition, 2009,
p.136.
137 CHAYET (C.), Les accords en forme simplifiée, in
Annuaire français de droit international, volume 3, 1957,
pp.3-13.
138 DEYRA (M.), Droit international public, Gualino,
4ème édition, 2014, pp37-38.
63
de la République tire son fondement de l'article 84 de
la Constitution du 1er Aout 2000 reprise par l'article 119 de la
Constitution de 2016 aux termes desquels: « Le président de la
République négocie et ratifie les traités et les accords
internationaux. ». Certes le Président de la République
est le seul organe compétent pour négocier et ratifier les
traités et accords internationaux car il a seul, qualité pour
représenter l'Etat et agir en son nom au plan international. Mais, dans
la pratique, la plupart des traités et accords internationaux sont
négociés par des plénipotentiaires.
Pour certaines conventions internationales, le droit interne
peut rendre la ratification plus difficile, et partant, la procédure
plus longue. Ainsi, aux termes des articles 85 de la Constitution du
1er Août 2000 et 120 de la Constitution du 8 novembre 2016,
« Les traités de paix, les traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de
l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi
». L'alinéa 2 de l'article 120 de la Constitution du 08
novembre 2016 ajoute que « la loi d'autorisation en vue de la
ratification est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel
». Une lecture attentive de ces textes permet de constater que la
ratification de trois types de conventions, ne pourra être
réalisée qu'à la suite d'une autorisation parlementaire
soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Il s'agit : des
traités de paix139, des traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale et les traités qui modifient les
lois internes de l'Etat. Que le débat interne s'impose pour ces
traités est, dès lors, évident. Néanmoins, rien
n'interdit à l'exécutif de soumettre, de manière
facultative, d'autres engagements internationaux à cette
procédure.
En outre, l'usage de la technique de la ratification est
rendue plus compliqué dans l'hypothèse où la convention
à ratifier comporte une clause contraire à la Constitution : dans
ce cas, aux termes de l'article 122 de la Constitution ivoirienne du 08
novembre 2016, « ...l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution ». On le voit
la procédure de révision est une procédure longue et
complexe. Ainsi, certaines conventions ne sont conclues qu'après de
multiples étapes franchies : négociations, signature,
autorisation parlementaire, contrôle du Conseil Constitutionnel ou
révision constitutionnelle, ratification. La longueur et la
complexité de la procédure de ratification constituent, on le
constate, une cause indiscutable de retard dans la conclusion des
traités.
139 BECKER (J.J.), « Les conséquences des
traités de paix », Revue historique des armées,
n°254, 2009, pp.3-8.
64
Au surplus, dans tous les cas, le Président de la
République reste libre de ratifier ou de refuser de ratifier la
convention. Et la décision de refus de ratifier prise par le
Président de la République ne peut pas être portée
devant les tribunaux, car il s'agit d'un acte de gouvernement140 :
tel, il échappe à tout contrôle juridictionnel.
A côté de la signature et de la ratification, se
trouve la technique de l'adhésion141 qui s'analyse
également comme une expression du consentement à être
lié. Suivant GERARD CORNU, « l'adhésion est un acte
unilatéral par lequel une personne se rallie à une situation
juridique déjà établie (statut, pacte, concordat,
convention) en devenant, le plus souvent, membre d'un groupement
préexistant (association, société, syndicat, etc.) ou
partie à un accord dont elle n'était pas, à l'origine,
signataire. »142. Mieux, en droit international public,
l'auteur précise que « l'adhésion est l'acte par lequel
un Etat devient partie à un accord dont il n'était pas signataire
»143.
Selon le Professeur Louis CAVARE, « l'adhésion
est l'acte par lequel un Etat s'approprie les stipulations d'une convention
passée entre d'autres Etats et, est appelée à
bénéficier des droits qu'elle procure comme à assumer les
obligations qu'elle impose »144. Ainsi, par cette
technique, tout Etat, qui était originairement étranger à
un traité, peut-il donner son consentement définitif, pour
devenir partie à ce traité. Un dépouillement des
conventions conclues par la Côte d'Ivoire sur les droits de l'homme ou
les droits de l'enfant, offre de voir que ce pays use abondamment de la
technique de l'adhésion. A l'instar de la signature et de la
ratification, l'adhésion à une convention ressortit au pouvoir
discrétionnaire des autorités publiques ivoiriennes. Or,
celles-ci peuvent, pour des raisons d'opportunité, de pure
opportunité politique, refuser d'adhérer à une convention
déjà en vigueur, ou attendre des mois, des années ou
même des décennies pour y adhérer. La
140 GIRARD (D.), « Les actes de Gouvernement demeurent
insusceptibles de tout recours juridictionnel en France », Note sous TC, 6
juillet 2015, K. et autres, n° C03995, Revue générale du
droit online, 2015, numéro 22851
www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22851
( consulté le 12/12/2015).
141 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association
Henri Capitant, 10e édition mise à jour quadrige, PUF,
2014, p.30.
142 Ibid..
143 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association
Henri Capitant, 10e édition mise à jour quadrige, PUF,
2014, p.30.
144 CAVARE (L.), Le droit international positif, Tome II,
les modalités des relations juridiques internationales. Les
compétences respectives des Etats, A. PEDONE, Paris, 3e
édition, 1969, p.179.
65
compétence discrétionnaire des pouvoirs publics
ivoiriens constitue ainsi, de façon évidente, une cause de retard
de conclusion des conventions internationales.
On le sait : l'adhésion à une convention
internationale ou sa ratification n'est pas obligatoire : le Président
de la République jouit en la matière d'un pouvoir
discrétionnaire. Il s'ensuit que ce dernier peut, après avoir
négocié et signé une convention internationale, refuser de
la ratifier, et cela, pour des raisons d'opportunité, de pure
opportunité politique. Jouissant d'un pouvoir discrétionnaire
dans le choix du moment, les pouvoirs publics ivoiriens attendent des mois, des
années, voire des décennies pour procéder à la
ratification de certaines conventions internationales, ou à
l'adhésion à d'autres. Il en résulte, dans ces conditions,
des retards parfois longs. Au fond, ces retards longs, par trop longs,
observés par les pouvoirs publics ivoiriens pour ratifier les
conventions internationales ou pour y adhérer sont condamnables, car
celles-ci portent sur les droits fondamentaux de l'être humain,
singulièrement de l'enfant. Toutefois, on peut saluer et se
réjouir de cet engagement certes tardif mais précieux ; car les
textes auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit offrent aux droits de
l'enfant de bénéficier d'une présomption
d'effectivité en vertu du principe de pacta sunt
servanda.
De ce qui précède, on peut indiquer que les
droits de l'enfant en Côte d'ivoire reposent sur une catégorie des
sources juridiques d'origine internationale. L'attitude de l'Etat de Côte
d'Ivoire à l'égard desdites sources d'origine internationale
amène à distinguer, d'une part, une reconnaissance indirecte
à travers des instruments généraux des droits de l'homme
(Section1), et d'autre part, une reconnaissance directe
à travers des instruments spécifiques aux droits de l'enfant
(Section 2).

67
Section I : UNE RECONNAISSANCE INDIRECTE A TRAVERS LES
INSTRUMENTS GENERAUX DES DROITS DE L'HOMME
La reconnaissance indirecte des droits de l'enfant à
travers les instruments généraux des droits de l'homme a
été opérée sur les plans universel (Paragraphe 1)
et régional (Paragraphe 2).
§ 1. AU NIVEAU UNIVERSEL
Avant 1940, la protection des droits de l'homme, à
l'échelle universelle, était embryonnaire et fragmentée.
Le Pacte de la SDN n'avait envisagé que la protection de deux
catégories d'hommes : les minorités nationales et les populations
des pays sous mandat145. Quant à l'Organisation
internationale du Travail (OIT), elle visait la protection des seuls
travailleurs en tant que tels146. Cependant, l'universalité
des droits de l'homme a été proclamée et reconnue par les
instruments internationaux onusiens au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Ces droits reconnus et proclamés s'adressent à tous les hommes
sans exclusion aucune ; que l'on soit homme, femme, enfant, adulte.
Chronologiquement, parmi ces instruments auxquels la Côte d'Ivoire est
partie, on détache, la Charte des Nations Unies et la DUDH (A) d'une
part, et les Pactes internationaux de 1966 (B). A côté de ces
instruments universels susvisés, se greffe un instrument
régional, à savoir, la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples (C). Ces instruments reconnaissent à des degrés
divers une certaine protection des droits de l'enfant.
145 MOUTON (M.R.), « La SDN et la protection des
minorités nationales en Europe », Relations
internationales, n°75, Automne 1993, pp.315-328. ; BARRE (M.C.),
Les minorités territoriales et le droit international, R.Q.D.I,
vol. 6, n°1,1990, pp.12-23. ; GRIMAL (H.), La décolonisation,
de 1919 à nos jours, Edition complexe, 1985, pp. 17-19.
146 BIT, Droits fondamentaux au travail et normes
internationales du travail, Genève, Bureau international du
Travail, 2004, pp.1-2.
68
A. L'ADHESION DE LA COTE D'IVOIRE A LA CHARTE DES
NATIONS UNIES ET LA DUDH
Au titre de la proclamation d'une protection universelle des
droits de l'Homme, il faut compter en tout premier lieu avec la Charte de San
Francisco de 1945, qui contient des objectifs généraux en termes
de paix, de développement et de droits de l'Homme, mais aussi et surtout
avec la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Pour avoir
fait de l'homme, c'est-à-dire tout être humain, l'objet des droits
consacrés, la Charte des Nations Unies (1) et la DUDH (2)
présentent un intérêt certain pour les droits de
l'enfant.
1. La Charte des Nations Unies
La Charte des Nations Unies fut signée le 26 juin
1945147 par les 50 Etats ayant participé à la
Conférence de San Francisco.
Tous les Etats africains sont parties, sans exception,
à la Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le
26 juin 1945. La Côte d'Ivoire fut admise à l'ONU, le
20/09/1960148. Cette adhésion leur confère la
qualité de membres de la plus grande organisation mondiale. Par l'effet
de cette adhésion, ils ont adhéré aux principes contenus
dans cette charte. C'est dans la charte des Nations Unies que la protection
générale des droits de l'homme a pour la première fois
obtenu un statut formel en tant que partie du droit
international149. Le terme « droit de l'homme »
est mentionné à plusieurs reprises dans la Charte150.
La Charte de l'Onu est une convention internationale, qui impose aux Etats
signataires, l'obligation de respecter les droits de l'Homme sans
définir ni même mentionner lesdits droits. La charte
établit une corrélation claire entre la paix et la
sécurité internationale et le respect des droits de l'homme. Dans
le préambule de la Charte, les Etats membres proclament à nouveau
leur « foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité de droits des hommes et des femmes,
147 Le texte français de la Charte est disponible
à partir de l'adresse suivante :
www.un.org/french/aboutun/charter.htm
(consulté le 15/03/2013).
148
http://www.un.org/fr/members/index.shtml
(consulté le 12 septembre 2014) ; le Bénin, le Burkina, le Congo,
le Gabon, le Madagascar, le Niger sont aussi devenus membres de l'Onu à
cette même date du 20/09/1960.
149 JESSICA (C.), LAWRENCE (J.C.), Les droits de
l'homme, Harvey J.Langholtz, Peace operations trainig institute,
Williamsburg, 2014, p.23.
150 Le préambule et les articles 1, 13, 55, 62, 68 et 76
de la Charte de l'ONU.
69
ainsi que des nations grandes et petites » et se
montrent résolus « à favoriser le progrès social
et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande ».
Parmi les buts des Nations Unies, l'article 1, paragraphe 3 de
la Charte énonce la réalisation de « la
coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire,
en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion » . Une idée analogue est
exprimée à l'article 55 c de la charte qui précise
également que les Nations Unies favorisent « le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion », tandis qu'aux termes de l'article 56, les Etats
s'engagent, en vue d'assurer le respect des droits de l'homme à
coopérer avec l'Onu. Cette première consécration
générale des droits de l'homme dans un traité
international fondamental inaugure leur essor, en les plaçant au coeur
des missions conférées à l'organisation
universelle151.
La charte confie aux organes principaux des Nations Unies,
à savoir l'Assemblée Générale et le Conseil
économique et social (ECOSOC), des compétences d'études et
de recommandations en matière de droits de l'homme152 . En
somme, l'oeuvre de la Charte en matière des droits de l'homme est
modeste. Certes, engage-t-elle les organes des Nations Unies à favoriser
et à développer les droits de l'homme. Mais à part
l'interdiction explicite de toute discrimination fondée sur la race, le
sexe, la langue ou la religion, elle ne comporte aucune définition de ce
qu'il faut entendre par « droits de l'homme ». Pire, la
Charte n'instaure aucun mécanisme effectif de contrôle du respect
de ces droits.
Cependant, le mérite de la Charte, est d'avoir
soustrait les droits de l'homme au domaine réservé des Etats, en
ce qu'elle oblige les Etats à coopérer avec l'organisation pour
le respect des droits de l'homme. Cette lecture paraît être en
contradiction avec le célèbre article 2 § 7, qui dispose:
«Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les
Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
membres à soumettre les affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente
Charte»; ceci sans préjudice de l'application du
151 WACHSMANN (P.), Les droits de l'homme, Paris,
Dalloz, 4ème édition, 2002, p.12.
152 Art. 13, alinéa 1b, et 62, al.2) Charte des Nations
Unies.
70
Chapitre VII relatif aux pouvoirs du Conseil de
sécurité en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix
ou d'acte d'agression. Que déduire de cette apparente contradiction
entre l'internationalisation des droits garantis à l'individu contre
l'Etat et le rappel du droit de l'Etat à régler souverainement
ses affaires intérieures ? Une première thèse aboutit en
réalité à ruiner les virtualités contenues dans la
proclamation de l'importance attachée par les Nations Unies au respect
des droits de l'homme. Elle ne voit que dans cette mention de la Charte qu'une
déclaration d'intention et s'appuie sur l'article 2, § 7, pour
dénier toute portée contraignante à la mention des droits
de l'homme. Spécialement, comme le souligne le Professeur Wachsmann, en
présence d'un cas concret de violation, même massive , des droits
de l'homme, cette thèse refuse aux Nations Unies, toute
compétence pour évoquer la question et a fortiori pour
réagir de quelque manière que ce soit. Mais, fort heureusement,
à cette vision par trop restrictive, s'oppose une vision plus dynamique
; d'éminents internationalistes en seront les chefs de
file153. Cette doctrine met l'accent sur le fait qu'une affaire ne
saurait être considérée comme relevant essentiellement de
la compétence nationale d'un Etat, à partir du moment où
elle se rattache à une matière régie par le droit
international. En insistant sur l'importance des droits de l'homme, la Charte
oblige alors les Etats parties, en vertu de leur propre consentement à
être liés, à les respecter et à accepter que
l'Organisation puisse examiner l'effectivité de l'engagement pris. La
référence de la Charte aux droits de l'homme et le lien
établi entre maintien de la paix et respect de ces droits peuvent ici
déployer tous leurs effets : la matière est bien
internationalisée, elle rentre dans les compétences de
l'Organisation, ce qui permet aux organes des Nations Unies d'exercer les
différents pouvoirs que leur reconnaît la Charte.
Bien que la Charte ne mentionne pas de façon expresse,
la question des droits de l'enfant, on peut déduire qu'elle vise tous
les hommes y compris les enfants à travers l'expression «
droits de l'homme ». Pour être membre des Nations Unies, la
Côte d'Ivoire, se doit de respecter en conséquence, les droits de
tous les hommes, notamment de l'homme-enfant, et ce conformément au but
des Nations Unies sus indiqué.
Les dispositions de la Charte ont valeur de droit
international positif parce que la Charte est un traité et constitue
à ce titre un document juridiquement contraignant. Tous les Etats
membres de l'Organisation des Nations Unies doivent s'acquitter de bonne foi
des
153 LAUTERPACHT (H.), « The International Protection of
Human Rights », R.C.A.D.I., t. 70, 1947, p.1.
71
obligations qu'ils ont contractées aux termes de la
Charte : obligation de promouvoir le respect et la protection des droits de
l'homme, obligation de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et
avec les autres Etats pour que ces objectifs soient atteints.
Les auteurs de la Charte étaient conscients des lacunes
de celle-ci en matière de droits de l'homme : elle n'énonce pas
de droits de l'Homme et ne met en place aucun mécanisme
spécifiquement chargé d'en assurer la mise en application dans
les Etats membres. Aussi dès 1946, l'Assemblée
générale recommanda à l'ECOSOC de créer un organe
subsidiaire, la Commission des droits de l'homme, composée des
représentants des Etats, en vue de la rédaction d'un instrument
approprié. La commission prépara un traité et une
déclaration. Suite à l'opposition du bloc soviétique
à l'idée de traité contraignant, seul le projet de
déclaration a été retenu. C'est ainsi que
l'Assemblée générale adopta, par sa résolution 217
(III), la Déclaration universelle des Droits de l'homme qui n'est pas
sans enjeu dans la reconnaissance internationale des droits de l'enfant.
2. La déclaration universelle des droits de
l'homme
« La déclaration universelle des droits de
l'homme représente le premier manifeste, le premier mouvement d'ordre
éthique, que l'humanité organisée n'ait jamais
adopté »154. Lors de la Table Ronde sur les droits
de l'homme (Oxford, 11-19 novembre 1965), René Cassin disait : « La
Déclaration universelle (...) ne se présente pas uniquement comme
la protestation nécessaire et positive de la conscience humaine en
riposte à des atrocités d'une ampleur inouïe. Elle est
aussi, c'est ce qui fait sa force durable, l'expression des aspirations
élémentaires, permanentes de l'ensemble de l'humanité :
celles sans doute des êtres déjà parvenus à un
certain niveau de vie, de culture et d'exigences, mais aussi celles des
centaines de millions d'êtres humains encore accablés par
l'oppression, la misère, l'ignorance et commençant à
prendre conscience des conditions nécessaires à leur
dignité collective et individuelle »155. La DUDH a
été rédigée par la Commission des droits de l'homme
en 18 mois (janvier 1947-décembre 1948). Elle fut adoptée par
l'Assemblée Générale qui représentait les 58 Etats
membres des Nations Unies, le 10 Décembre 1948156. C'est
le
154 CASSIN (R.) et AGI (M.), La Cité Humaine,
Cours de DUEDH, inédit, cité par M. Roger KOUDE dans son cours de
Philosophie des droits de l'Homme, Institut des droits de l'Homme de
Lyon, 2010.
155 In l'enseignement des droits de l'homme, Unesco, Paris,
1985.
156 Http : //
WWW.UN.ORG/french/aboutun/historique.htm
(consulté le 02/12/2012).
72
premier texte international qui a énoncé que les
droits fondamentaux et libertés publiques doivent être
considérés comme inaliénables à la personne humaine
et donc proclamés comme étant universels. D'ailleurs, les auteurs
qui l'ont rédigée et les Etats membres de l'assemblée
générale qui l'ont ratifiée étaient de
différentes cultures, traditions et religions. La DUDH comprend aussi
bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux
et culturels.
Si elle est la manifestation quasi unanime des Etats composant
alors l'ONU, c'est au prix d'un laborieux compromis entre deux blocs
idéologiques d'alors : le monde marxiste et le monde occidental. Aussi
fait-elle une place non négligeable aux droits économiques et
sociaux, exaltés par le bloc marxiste, comme le droit à la
sécurité d'existence, le droit au travail, le droit syndical, le
droit au repos et aux loisirs, le droit à la santé, à
l'éducation et à la culture157 . Le monde occidental
obtient, en échange, la consécration des droits civils et
politiques classiques, comme la liberté religieuse, la liberté
d'expression, le droit à un procès équitable, ainsi que le
droit de propriété, mais doit renoncer à la reconnaissance
du droit de grève et de la liberté de commerce et d'industrie que
le bloc soviétique récuse. Ainsi, elle témoigne d'un net
recul de l'individualisme comme en témoigne son article 29 qui met
l'accent sur les devoirs de l'individu envers la communauté «
dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible ». En outre, la Déclaration
consacre de nouveaux droits qui ne peuvent se concevoir que dans une
perspective transfrontalière. Il s'agit notamment du droit de chaque
individu à une nationalité (art.15), du droit de quitter
n'importe quel pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays (art.13,
§2), et de recevoir et de diffuser des informations et des idées
sans considération de frontières (art.19).
La DUDH ne prévoit cependant aucune institution
spécifique de promotion et de protection des droits et libertés
qu'elle se contente de proclamer.
Considérant les droits de l'enfant, on remarque d'abord
que la DUDH énonce que « toute personne a droit... ».
L'enfant étant inclus dans les vocables « toute personne
» ou « tout individu » bénéficie
ipso facto de tous les droits reconnus dans cette déclaration ;
Ensuite, le terme enfant n'est cité qu'aux articles 25 et 26 de la DUDH.
L'article 25- 2 dispose que « la maternité et l'enfance ont
droit à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient
nés
157 Articles 22à 27 de la DUDH.
73
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la
même protection sociale». Il résulte donc de ce texte
que des mesures spéciales de protection doivent être prises par
les Etats en faveur de l'enfance mais aussi de la femme durant la
maternité et ce au nom de l'intérêt certain de l'enfant
à naître. De même, cet article rappelle
l'égalité des droits des enfants, y compris adultérins, ou
simplement nés hors mariage. Quant à l'article 26-3, il
énonce « Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants
». Se trouve ainsi affirmé le droit à
l'éducation en faveur de l'enfant.
La déclaration de 1948 a été
conçue par ses auteurs comme un idéal commun à atteindre,
une exhortation issue du tréfonds de la conscience universelle. Pour
être une recommandation de l'Assemblée générale de
l'Onu, elle est en principe dépourvue par elle-même, de force
juridique contraignante. Les jurisprudences nationales françaises
confirment cette interprétation158. Le juge français a
considéré que la DUDH étant une déclaration et non
un traité international, elle a une valeur juridique modeste et n'est
pas même invocable en droit français159. Dans le
même ordre d'idées, les juridictions allemandes ont refusé,
dans certains cas, de reconnaitre le caractère de droit coutumier
international à certaines dispositions de la DUDH160 . Il en
va autrement de la position d'une certaine doctrine et de la jurisprudence
américaine qui accordent un caractère coutumier et donc
obligatoire à la déclaration. L'idée de recourir à
la DUDH en tant que règle coutumière a été
défendue dans un premier temps par la doctrine qui considère que
la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations
Unies, ou du moins certaines de ses dispositions, correspond à une
coutume internationale161. La Jurisprudence a suivi la voie de la
doctrine dans le sens de la
158 Cf. Cass, 4 décembre 2001, R.W., 2001-2002, p.1353
; C.E. fr. 23 novembre 1984, Roujansky, Rec. Lebon, p.383.
159 CE 18 avr. 1951, Elections commune de Nolay, Lebon
p. 189.
160 Voir les exemples de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle fédérale allemande cités par MERON (T.),
Human Rights and Humanitarian Norms as Customary International Law,
Clarendon Press, Oxford, 1989, 263 p., p. 133, note 183. Selon la Cour
constitutionnelle fédérale, l'article 13-2 de la DUDH accordant
le droit à toute personne de quitter un pays ne contient pas de
règle universelle de droit international et, de ce fait, ne fait pas
partie du droit allemand en vertu de l'article 25 de la loi fondamentale.
161 LILLICH (R.B), « The Role of Domestic Courts in
Enforcing International Human Rights Law ». , American Association of
International Law Proceedings of the 74th Annual Meeting, 1980,
p.20-25 ; June M. Ross, « Limitations on Human Rights in international
Law: their Relevance to the Canadian Charter of Rights and Freedoms. ».,
HRQ, 1984, p.180-223, p.197 et note 81 ; HUMPREH ( J.), « The
Universal Declaration of Human Rights: its History, Impact and Juridical
Character »., in B.G. RAMCHARAN(dir.), Human Rights: Thirty Years
After the Universal Declaration, Martinus Nijhoff, la Haye, 1979, 274p.,
p.28-37,p.29 et p.37 ; MOULTON (E.), « Domestic Application of
International Human Rights», Saskatchewan Law Review 1990,
74
consécration de la DUDH en tant que norme
internationale coutumière162 , mais de façon plus
ponctuelle. Ainsi, les tribunaux américains citent souvent la DUDH comme
une source de droit international coutumier, même si elle ne constitue
pas l'unique référence. A titre d'exemple, dans l'affaire
Filartiga v.Pena-Irala, la Cour d'appel du second circuit a
considéré que l'interdiction de la torture « est devenue
partie du droit international coutumier telle que mise en évidence et
définie par la DUDH (...) »163 . De même,
dans l'affaire Rodriguez-Fernandez v. Wilkinson, la Cour d'appel du
dixième circuit a fait référence aux articles 3 et 9 de la
DUDH pour conclure au caractère coutumier de l'interdiction de la
détention arbitraire164.
Toutefois, on peut se demander si, au niveau international,
une évolution ne se dessine pas vers la reconnaissance du statut de
droit international coutumier à la Déclaration. A cet
égard, les conceptions divergent. Certains dénient à la
Déclaration la valeur coutumière en excipant de l'absence d'une
pratique étatique généralisée tendant vers un
respect des droits qu'elle contient165. D'autres font valoir que
toutes les dispositions de la Charte font partie intégrante du droit
international coutumier, la Déclaration s'analysant en une
interprétation authentique des dispositions de la Charte sur les droits
de l'homme que les Etats se sont engagés à
respecter166.
Lorsqu'on se réfère, non plus au contenant,
c'est-à-dire l'acte, à l'instrument qu'est la résolution,
mais à son contenu, on se rend compte qu'elle constitue un acte
renfermant des
p.39. ; DECAUX (E.), « De la promotion à la
protection des droits de l'homme, droit déclaratoire et droit
programmatoire » in La protection des droits de l'homme et
l'évolution du droit international, Colloque de la S.F.D.I, Pedone,
Paris, 1998, 344p., p.81-119, p.108.
162 Voir LILLICH (R.B.), « Invoking International Human
Rights Law in Domestic Courts », in Cincinnati Law Review, 1985,
p.402. ; « La commission des Droits de l'homme des Nations Unies, faisant
référence à la DUDH a admis qu'étant donné
la solennité et la signification plus grande d'une déclaration,
on peut considérer que l'organe qui l'adopte manifeste ainsi sa vive
espérance que les Membres de la communauté internationale la
respecteront. Par conséquent, dans la mesure où cette
espérance est graduellement justifiée par la pratique des Etats,
une déclaration peut être considérée par la coutume
comme énonçant des règles obligatoires pour les Etats
». Rapport de la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies,
E/3616/Rev. 1, § 105.
163 Cour d'appel, 2nd circuit, Etats-Unis, 30 juin
1980, Filartiya v. Pena-Irala, 630 F.2d 876.
164 Cour d'appel, 10th circuit, Etats-Unis, 9 juillet 1981,
Rodriguez-Fernandez v. Wilkinson, 654 F.2d 1382 (1981).
165 SUDRE ( F.), Droit international et européen
des droits de l'homme, Paris, PUF, 4ème édition,
1999, p.116.
166 SOHN (L.), « The New international law: Protection of
the rights of individuals rather than States », American University
Law Review, 1982, p. 16 et s.
75
principes obligatoires s'imposant aux Etats, à la fois
au double plan national et international. Au plan national, tous les Etats
modernes, y compris la Côte d'Ivoire, font référence aux
principes et droits de l'Homme tels que définis par la DUDH, à
travers leurs constitutions respectives. Il s'ensuit que celle-ci acquiert
valeur de droit positif. L'Etat se doit donc de les respecter au même
titre que sa Constitution. Au plan international, les principes contenus dans
la DUDH constituent non seulement des règles obligatoires, mais encore
des règles impératives. Ce sont des règles obligatoires
qui trouvent leur fondement sur une base à la fois conventionnelle et
coutumière.
Au plan conventionnel, la déclaration peut être
appréhendée comme une explicitation des principes contenus dans
la Charte. Celle-là constitue ainsi une interprétation
autorisée de celle-ci167. La Charte qui est un acte
obligatoire se borne dans certains de ses articles (1 à 55) à
prescrire le respect des droits de l'Homme sans le mentionner. La
déclaration, qui est une résolution, c'est-à-dire un acte
non obligatoire, vient citer les Droits de l'Homme et les définir,
comblant ainsi la lacune de la Charte. La Charte confère ainsi sa valeur
à la déclaration. La CIJ est allée dans ce sens lorsque,
dans son arrêt relatif au personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est
fondée à la fois sur les deux actes pour condamner l'Iran
accusé d'avoir violé les droits de l'Homme168.
Au plan coutumier, les principes et droits de la
déclaration universelle consacrés par de nombreux textes
juridiques (constitutions, résolutions, conventions, etc.) ont acquis
valeur de coutume et s'imposent ainsi aux Etats qui sont tenus de les
respecter. Ce sont des règles impératives, c'est-à-dire
des règles si importantes que les Etats souverains ne peuvent y
déroger par des conventions particulières. On peut ainsi soutenir
que certains des droits consacrés par la Déclaration sont
à ces points essentiels qu'ils ont pénétré le droit
international coutumier : génocide, esclavage, disparition involontaire
d'individus, torture ou autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants, détention arbitraire prolongée,
167 Voir en ce sens CASSESSE (A.), Le droit international
dans un monde divisé, Berger-Levrault, 1986, p.124. ; SALCEDO (J.A
Carel LO), « Les valeurs juridiques de la Déclaration dans
l'ordre international », in la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme 1948-98, la Documentation française, Paris, 1999,
p.290 et 293.
168 TCHICAYA (B.), Mémento de la jurisprudence du
droit international public, Hachette, 4ème
éd.2007, pp.109-111.
76
discrimination raciale systématique, ainsi que les
violations systématiques et graves des droits internationalement
reconnus169. C'est cette conception que la Cour internationale de
justice paraît avoir partagée dans son arrêt du 24 mai 1980
relatif à l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran170 en déclarant que
: « le fait de priver abusivement de leur liberté des
êtres humains et de les soumettre, dans des conditions pénibles,
à une contrainte physique, est manifestement incompatible avec les
principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme ».
Cela étant, on ne saurait ignorer le vaste rayonnement
que la Déclaration a connu dépassant de loin les espoirs de ses
auteurs. Exaltant la primauté de l'individu, la DUDH continue
aujourd'hui d'assurer « le défi d'une révolution
inachevée : celle qui a pour but de placer l'être humain au centre
de toute valeur nationale et internationale »171. La
Déclaration a servi de source d'inspiration à maintes
constitutions nationales. Ses dispositions ont été reprises par
différentes déclarations et traités sur les Droits de
l'Homme tant au niveau universel qu'au niveau régional. Par ailleurs, en
tant qu'elle contient le fonds de principes d'éthique à laquelle
devrait tendre toute société humaine, la Déclaration fait
oeuvre de pédagogie. Elle fournit à l'opinion publique mondiale
et aux organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales,
un précieux instrument de référence dans la
sensibilisation des Etats à la cause des droits de l'homme, des droits
de l'enfant.
Au-delà de son caractère coutumier liant tout
Etat membre de l'Onu, l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la
DUDH, rappelons-le, est de statut constitutionnel. En tant que telle, elle fait
partie du droit positif ivoirien, et devient par ricochet, une précieuse
source des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Le contenu de la
Déclaration universelle des droits de l'homme fut repris et
amélioré sous une forme conventionnelle dans les deux pactes
adoptés à
169 BUERGENTHAL (Th.) et. KISS (A.), La protection
internationale des droits de l'homme, N.P. Engel, Strasbourg, 1991, p.22.
; ROBERTSON (A.H) et MERRILS (J-G), Human Rights in the World,
Manchester University Press, 4ème éd. 1996, p.29.
170 Rec., 1980, p.42.
171 MARTENSON (J.) « The Preamble of the universal
Declaration of Human Rights and the UN Human Rights Programme », in
Eide et al., The Universal Declaration of Human Rights- A Comentary,
1993, p.17.
77
l'unanimité par l'Assemblée
générale de l'ONU, le 16 décembre 1966, dans sa
résolution 2200 A (XXI).
Outre la DUDH qui a acquis une valeur constitutionnelle, la
Côte d'Ivoire a adhéré aux deux pactes internationaux de
1966 qui présentent des enjeux majeurs pour les enfants et leurs
droits.
B. L'ADHESION DE LA COTE D'IVOIRE AUX PACTES
INTERNATIONAUX DE 1966
La Côte d'Ivoire est partie à ces deux pactes.
Toutefois son adhésion est intervenue vingt-cinq ans après leur
adoption. Le fondement juridique de cette adhésion est la loi
n°91-883 du 27 Décembre 1991 autorisant l'adhésion et le
décret n°91-884 du 27 Décembre 1991 portant adhésion
de la République de Côte d'Ivoire aux deux pactes. Après
avoir présenté ces pactes (1), on n'examinera leur apport dans la
protection des droits des enfants (2).
1. Présentation des pactes de 1966
Les deux pactes des droits de l'Homme, adoptés par
l'Assemblée générale de l'Onu le 16 décembre 1966,
ont mis les textes dans leur contexte. Ce faisant, il a fallu vingt ans de
débats souvent serrés pour les adopter (de 1946 à 1966) et
dix ans de délai pour leur entrée en vigueur (de 1966 à
1976), preuve s'il en faut, des difficultés rencontrées quand il
s'agit d'entériner un texte à l'échelle internationale. En
raison du manque de valeurs communes entre les traditions libérales, les
traditions socialistes marxistes, et les Etats du Tiers-Monde, on a
été amené à adopter deux pactes
séparés, l'un relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, l'autre aux droits civils et politiques, faits sans cesse de
compromis172. Ces deux pactes viennent compléter et renforcer
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Tous deux
contiennent une énumération longue et précise des droits
traditionnels (53 articles) et des droits économiques (31
articles)173. Tout y est, des droits individuels aux droits
collectifs et communautaires, extensibles pour certains, accompagnés de
restrictions pour d'autres. Un exemple. Le droit de changer de religion
à l'honneur dans la Déclaration
172 YACOUB (J.), Les droits de l'homme sont-ils
exportables ? Géopolitique d'un universalisme, éd ellipses,
Paris, 2004, p.70.
173 MADIOT (Y.), Droits de l'Homme, éd. Masson,
2eme édition, Paris, 1991, p.87.
78
de 1948 (art.18), ne figure plus explicitement dans le pacte
des droits civils et politiques, qui a été remplacé par le
droit d'adopter une religion (art.18 du Pacte). Ce qui n'empêche pas
cependant les experts du Comité des droits de l'Homme de lire cette
nouvelle clause dans le sens de la première, c'est-à-dire du
droit au changement. Or si le sens est le même, pourquoi donc a-t-on
changé de formulation ?
Ces deux pactes internationaux ont introduit la notion
fondamentale de conditions susceptibles de rendre possible progressivement la
jouissance des droits de l'homme en tenant compte des ressources disponibles,
relativisant ainsi l'application des droits de l'homme. Or cette notion de
progressivité des droits de l'homme, qui ne figurait pas dans la
Déclaration de 1948, est une concession faite par les Etats
européens aux pays en voie de développement. Les
préambules des Pactes qui exposent leur orientation philosophique,
soulignent dans des termes identiques le caractère progressif de leur
mise en oeuvre :
« Reconnaissant que, conformément à la
Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de
l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques
et libéré de la crainte et de la misère, ne peut
être réalisé que si les conditions permettant à
chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses
droits économiques, sociaux, et culturels, sont créés
».
En conséquence, « chacun des Etats parties au
présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par
l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en
vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le
Présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en
particulier par l'adoption de mesures législatives ». On
pensait, entre autres, au caractère obligatoire et à la
gratuité de l'enseignement primaire avec le souhait de voir adopter
« un plan détaillé des mesures nécessaires pour
réaliser progressivement dans un nombre raisonnable d'années
fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous » ( art. 14).
En même temps, les Etats parties reconnaissent la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et leurs droits égaux et inaliénables, qui constituent le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Le
même préambule mentionne d'emblée
79
les devoirs : « Prenant en considération le
fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la
collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer
de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le Présent Pacte
».
En outre, l'insertion d'un article sur le droit des Peuples
à disposer d'eux-mêmes, à trouver son accomplissement par
l'adoption d'une disposition incorporée dans les deux pactes et
libellée dans des termes identiques. Ce droit collectif jouit de
préséance sur les autres droits puisqu'il figure en
première place :
« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans
préjudice des obligations qui découlent de la coopération
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel,
et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au Présent pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non
autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la
réalisation des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes
et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies ».
Quinze articles traitent des droits économiques.
L'article 10 est consacré à la famille, aux mères et aux
enfants. Les Etats parties reconnaissent que : « Une protection et une
assistance aussi large que possible doivent être accordées
à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de
la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps
qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation
d'enfants à charge. » (par.1).
Par ailleurs, lors des discussions, il y eut des oppositions
fondamentales sur le droit de propriété, ce qui explique la non
incorporation de ce droit dans les Pactes. Mais ces deux pactes174
n'obéissent pas à la même conception que celle qui anime la
Déclaration. En 1966, l'Onu comptait 122 membres au nombre desquels de
nombreux Etats du tiers monde. Il en
174 MOURGEON (J.), Les pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, AFDI. , 1967, p.327.
80
résulte un très sensible affaiblissement de
l'individualisme au profit d'un phénomène de collectivisation des
droits de l'Homme175.
Les pactes constituent avec la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, « la Charte internationale des droits de
l'Homme » : ce sont les 3 textes fondamentaux de protection des
droits de l'homme. Les deux pactes ont des dispositions communes, notamment
leur préambule qui vient rappeler que les deux catégories de
droits sont indivisibles. Ce principe d'indivisibilité et
d'interdépendance des droits de l'homme sera, d'ailleurs, solennellement
consacré dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne
adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits
de l'homme. Les deux pactes consacrent également le droit à
l'autodétermination des peuples (article 1) ainsi que
l'égalité des sexes pour l'accès à l'ensemble des
droits fondamentaux (article 3).
Le Pacte international sur les droits civils et politiques
protège notamment : Le droit à la vie (article 6) ;
L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (article 7) ; L'interdiction de l'esclavage et des travaux
forcés (article 8 ) ; Le droit à la liberté et à la
sécurité, et l'interdiction de la détention arbitraire
(article 9) ; L'égalité devant les tribunaux et les cours de
justice (article 14); Le droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion (article 18) ; Le droit de vote et d'être
élu au suffrage universel et égal (article 25).
Le Pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels protège notamment : Le droit au travail (article 6)
; Le droit à un niveau de vie suffisant (article 11) ; Le droit de jouir
d'un bon état de santé (article 12) ; Le droit à
l'éducation (article 13) ; La gratuité de l'enseignement primaire
(article 14); Les droits culturels (article 15).
Les pactes ayant été analysés, on peut
à présent procéder à l'examen de leurs enjeux pour
les droits de l'enfant.
2. Les enjeux des pactes pour les droits de
l'enfant
Les Pactes présentent des enjeux majeurs pour les
Droits de l'Enfant. En effet, « les deux pactes internationaux font
également référence aux droits de l'enfant et confirment
des droits
175 SUDRE (F.), Droit international et européen des
droits de l'homme, PUF, 2016, p.76 et s.
81
qui avaient déjà été
consacrés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
la Déclaration de Genève de 1924 et la Déclaration des
Droits de l'Enfant de 1959. »176
L'article 24 du Pacte international sur les droits civils et
politiques réaffirme le droit des enfants à une protection, et le
droit à un nom et à une nationalité :
« Tout enfant, sans discrimination aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part
de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de
protection qu'exige sa condition de mineur.».
Le droit des enfants à bénéficier d'une
protection contre l'exploitation infantile et l'obligation des États
à fixer un âge minium au travail sont confirmées par le
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), en son article 10. L'article 12 de ce PIDESC confirme encore le droit
des enfants à jouir du meilleur état de santé possible.
Enfin, le droit à l'éducation des enfants et le principe de
gratuité de l'enseignement primaire pour tous les enfants sont
réaffirmées par l'article 13 en ces termes:
« [...] l'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa
dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.».
Comme le reconnait l'Ong internationale « Humanium »
: « La réaffirmation de ces droits est une avancée
importante dans la protection des droits de l'enfant. En effet, le droit
à une protection et le droit à une identité, ainsi que le
droit à l'éducation et à la protection contre
l'exploitation font partie des droits les plus fondamentaux des enfants. Avant
l'adoption des pactes internationaux, ces droits n'étaient reconnus que
par des déclarations. Les pactes confèrent une valeur
contraignante à ces droits. Dès lors, tous les États
parties sont juridiquement tenus de respecter et de faire respecter ces droits
pour tous les enfants relevant de leur juridiction.
»177.
Au-delà des textes universels à caractère
général, l'enfant de la Côte d'Ivoire
bénéficie aussi de la protection des droits de l'homme
proclamés au niveau régional africain, par le biais de la Charte
africaine des droits de l'homme et de peuples (C.A.D.H.P).
176
https://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/
(consulté le 20/06/2018).
177
https://www.humanium.org/fr/normes/pactes-internationaux-1966/
(consulté le 20/06/2018).
82
83
§ 2. AU NIVEAU AFRICAIN : LE CAS DE LA CHARTE
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Le système africain de protection des droits de l'Homme
constitué par la charte revêt une importance fondamentale pour la
communauté internationale venant en complément et en renforcement
de la protection internationale des droits de la personne humaine. Aussi,
l'Assemblée générale des Nations Unies n'a-t-elle pas
manqué d'adresser, le 16 décembre 1981, ses vives
félicitations à l'OUA pour l'adoption de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples178. Ainsi, la communauté
internationale s'enrichit, dans le cadre régional, d'un nouvel
instrument juridique. Après l'Europe, avec la convention de Rome sur la
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 et l'Amérique, avec la Convention de San José de
Costa Rica relative aux droits de l'Homme du 22 novembre 1969, c'est l'Afrique
qui se préoccupe d'assurer la protection internationale des droits de
l'homme.
Le résultat n'a pas été atteint sans
difficultés, car l'idée d'un instrument de protection des droits
de l'homme, conçue dès janvier 1961 par les juristes africains,
n'a pu voir le jour que le 28 juin 1981, soit vingt ans plus tard. La charte a
été en fait le fruit des souffrances atroces des peuples
africains qui ont atteint un seuil intolérable en République
centrafricaine, en Guinée Equatoriale et en Ouganda. Ces trois peuples
ont en effet subi les dictatures violentes et sanglantes. Ces dictatures
respectivement de l'empereur Bokassa 1er, du Président Macias
NGUEMA et du Maréchal Idi Amin DADA, dictatures sanctionnées par
leur chute spectaculaire en 1978-1979, ont été marquées
notamment par le massacre de centaines d'enfants. La réaction des
peuples africains à la répression, ainsi que la répulsion
ressentie par leurs dirigeants face à ces horreurs n'ont pu que faire
prendre conscience de la nécessité d'une protection
régionale des droits de l'Homme.179
La Côte d'Ivoire a adhéré à la
CADHP en date du 27 décembre 1991, soit dix (10) ans après son
adoption et cinq (5) ans après son entrée en vigueur.
Afin de mieux cerner les traits généraux de la
C.A.D.H.P, nous utiliserons la démarche comparative qui nous permettra
de faire ressortir tout d'abord ses ressemblances avec les
178 Résolution A/Res/36/154.
179 Voir en ce sens A.F.D.I. 1981 P.426-427.
autres instruments internationaux de protection des droits de
l'homme avec lesquels elle conserve une certaine fraternité dans la
droite filiation de la Déclaration universelle des droits de l'Homme(A).
Nous examinerons ensuite seulement, les aspects spécifiques de cet
instrument régional (B) avant de mettre en exergue les enjeux du
traité africain des droits de l'homme pour l'enfant (C).
A. LES ELEMENTS DE RESSEMBLANCE ENTRE LA CHARTE ET LES
AUTRES INSTRUMENTS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
L'analyse de la C.A.D.H.P révèle une adaptation
et une interprétation, mais en aucun cas une remise en cause radicale de
la substance du corpus de la protection internationale des droits de l'homme.
C'est ce qui a conduit OUGUERGOUZ a déclaré que « les
similitudes de la Charte africaine et de la charte internationale des droits de
l'homme sont plus nombreuses que les différences
»180 .
Sans prétendre épuiser l'examen des points
communs entre la CADHP et les autres traités de protection des droits de
l'homme, nous pouvons néanmoins relever trois traits marquants qui
traduisent cette proximité.
Tout d'abord, sur le plan formel, la charte africaine utilise
la technique juridique conformément au droit des traités de
Vienne. On pouvait s'attendre au moment de la rédaction de la Charte
africaine que d'autres techniques, ou formulation soient sollicités. En
effet, si l'on garde présent à l'esprit les tensions relatives au
paradigme de l'universalisme des droits de l'homme, c'est souvent la
formulation juridique qui est avant tout indexée pour récuser le
caractère universel des droits de l'homme. Or, c'est cette même
technique qui est reprise par les rédacteurs de la charte africaine.
Cette technique de proclamation des droits qui rappelle le décalogue,
aurait pu céder le pas au mythe, légende ou d'autres modes de
consécration en Afrique.
Ensuite, sur le plan matériel, hormis quelques
exceptions, la CADHP reprend le catalogue des droits inspirés de la
Déclaration universelle des droits de l'homme. La Charte africaine
contient, un catalogue de droits que l'on retrouve, mutatis mutandis, dans les
autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Comme
ces textes, la charte
180 OUGUERGOUZ (F.), Cours polycopié Institut
international des droits de l'homme, 1999, p.23.
84
africaine consacre les droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, même si cette dernière
va plus loin en formulant les droits de troisième
génération, dits de solidarité. La Charte africaine est du
point de vue des droits qu'elle consacre très proche des autres
traités de protection des droits de l'homme, notamment des deux pactes
et la Déclaration universelle des droits de l'homme.
En sus, une certaine emprunte de modernité traverse la
philosophie à la base de cet instrument. Ce qui fait de la charte un
texte équilibré entre tradition et modernité. Tout en
conservant des éléments de tradition africaine, la CADHP reste
profondément ancrée dans une conception moderne des droits de
l'homme. Tout d'abord, elle consacre (pas exclusivement) dans une certaine
mesure le triomphe de l'individualisme au coeur de la philosophie moderne des
droits de l'homme. Elle proclame aussi les droits de l'Etat et ceux des
peuples, tout en accordant une place aux droits individuels, de telle
manière que l'on ne peut pas lui faire le procès d'établir
une prépondérance de la communauté sur l'individu. Or, la
philosophie traditionnelle à la base des sociétés
africaines a été décrite comme celle qui consacre
justement le primat du groupe sur l'individu. Pourtant, se démarquant de
cette caractéristique majeure de la philosophie africaine
traditionnelle, la charte consacre l'individualisme, tout en essayant de le
diluer par des éléments communautaires.
Poussée par le vent de la modernité, la CADHP,
consacre les droits de troisième génération qui
constituent une nouvelle catégorie de droits de l'homme, qui ont
récemment émergé en droit international, sans doute du
fait des tristes événements enregistrés à la fin du
dernier siècle. Au coeur de ces nouveaux droits, se trouve l'idée
de solidarité et de fraternité : « ceux-ci sont des
droits de l'homme sécrétés par l'évidente
fraternité des hommes et par leur indispensable solidarité,
droits qui uniraient les hommes dans un monde fini(...). Ils sont nouveaux car
les aspirations qu'ils expriment sont nouvelles sous l'angle des droits de
l'homme visant à faire pénétrer la dimension humaine dans
des domaines dont elle était jusqu'ici trop souvent absente,
étant abandonnés à l'Etat, aux Etats.
»181. Ces droits de solidarité sont : le droit au
développement, le droit à la jouissance égale du
patrimoine commun de l'humanité, le droit à la paix et le droit
à un environnement sain.
181 VASAK (K.) , Pour une troisième
génération des droits de l'homme, in Etudes et Essais en
l'honneur de Jean PICTET, Comité international de la Croix-Rouge et
Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, p.639.
85
Enfin, même lorsque la CADHP déclare dans son
préambule s'inspirer « des vertus des traditions historiques et
des valeurs de civilisation africaine » et qu'elle érige en
devoirs des individus « l'obligation de veiller dans ses relations
avec la société, à la prévention et au renforcement
des valeurs culturelles africaines positives », elle l'entoure d'une
exigence « d'esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation » qui l'inscrit dans la modernité. En ne retenant
que les « valeurs africaines positives », l'Afrique
sélectionne dans ses valeurs historiques celles qui sont capables de
soutenir les fondations d'une civilisation moderne et universelle. Nous pouvons
remarquer que la charte africaine ne fait aucune référence aux
dieux, aux esprits, aux ancêtres, aux rites d'initiation, à aucune
forme de transcendance, qui du reste, sont présent dans la cosmogonie
africaine. Cet appel à la modernité se retrouve dans le discours
du Président SENGHOR à l'ouverture des travaux de
rédaction de la charte en ces termes : « Mesdames, messieurs
les experts, gardez-vous à votre tour d'élaborer une charte des
droits de l'homme africain ; l'humanité est une et indivisible et les
besoins fondamentaux de l'homme sont partout identiques. Il n'y a ni
frontière, ni race quand il s'agit de sauvegarder les libertés et
les droits attachés à la personne humaine. Cela ne veut pas dire
qu'il faille renoncer à penser par nous-mêmes et pour
nous-mêmes. »182.
Au-delà des traits communs qu'elle présente avec
les autres instruments qui l'ont précédé, cette Charte
présente quelques particularités même si la plupart des
droits consacrés ne sont forcément par des innovations.
B. DES SPECIFICITES DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE L'HOMME ET DES PEUPLES
La plupart des spécificités de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples ont pour fondement les
traditions et les valeurs de civilisation africaine. Ces
caractéristiques propres figurent en filigrane dans les trois discours
faits à l'ouverture des travaux de la conférence des experts au
moment de la rédaction de la Charte à Dakar du 28 novembre au 8
décembre 1979.183 En dehors de la dénomination de
l'instrument qui est une particularité que la charte ne partage pas avec
les autres instruments de protection des droits de l'homme (sauf en Afrique la
charte de l'OUA, la charte culturelle de l'Afrique, la charte des droits et
182 Cité par MBAYE (K.), Les droits de l'Homme en
Afrique, pedone, 1998, p.125.
183 Il s'agit des discours des présidents Senghor,
Diawara, et du SG de l'époque Edem KODJO. Cité par MBAYE (K.),
op.cit., pp.151-160.
86
du bien-être de l'enfant) on peut retenir trois
principales spécificités de la charte sur un triple plan
philosophique, normatif et organique.
Les spécificités philosophiques recouvrent deux
aspects : les valeurs de civilisation et la conception africaine des droits de
l'homme. S'agissant des valeurs africaines de civilisation, dans le
préambule de la charte, on retrouve cette volonté des auteurs de
considérer que si les valeurs de civilisation africaine doivent nourrir
la philosophie de la charte, il est également souligné que toutes
les traditions ne sont pas bonnes à garder. Seules les valeurs «
positives » qui correspondent aux besoins de la
société africaine doivent servir de base à la conception
de la charte. Quant à la conception africaine des droits de l'homme qui
traverse la charte, elle semble liée à la conception du droit en
Afrique. Une conception qui appréhende le droit moins comme un
instrument de défense contre le groupe, mais comme un ensemble
d'instruments protecteurs du groupe dont fait partie l'individu184 .
On relève donc avec le Professeur Oberdorff qu'il « existe bien
une conception africaine des droits de l'homme qui n'est pas simplement leur
traduction à une région du monde, elle-même très
diversifiée. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de
1981 prend en considération à plusieurs reprises, dans son texte,
l'idée d'une spécificité africaine » qui renvoie
à « un système de pensée holiste
»185. Comme le souligne Michel Levinet186,
suivant la conception africaine des droits de l'homme, « les droits de
l'homme ne sont pas séparables des droits des peuples ; les droits de
l'homme ne sont pas dissociables de ses devoirs envers des entités
essentielles comme la famille, l'Etat, voire la communauté africaine
». Si l'on rapporte cette conception aux principes fondateurs de la
théorie moderne des droits de l'homme, elle se rapproche d'une forme
d'« universalisme concurrent ». En effet, les approches
diffèrent sensiblement, cette théorie présupposant que
« la personne humaine doit être respectée par
elle-même et non plus qu'elle appartient à un
tout187.
Quant aux particularités organiques liées au
système originaire de la CADHP, notons à la fois l'absence d'une
cour africaine des droits de l'homme, l'absence d'une déclaration
préalable pour la compétence des organes pour recevoir des
communications, et enfin la
184 Ibid., p.163.
185 OBERDORFF (H.), Droits de l'homme et libertés
fondamentales, LGDJ, manuel, 5e éd., 2015, p.47et s.
186 LEVINET (M.), Théorie générale de
droits et des libertés, Bruyant, 2008, p.216.
187 DE BOULOIS (X.D), Droits et libertés
fondamentaux, PUF, « Licence Droit », 2010, p.19.
87
place prépondérante accordée par la
charte africaine à un organe composé des chefs d'Etats et de
gouvernement.
De nombreuses analyses ont longtemps voulues voir dans
l'absence d'une cour africaine des droits de l'homme, une conséquence
directe de la conception du Droit en Afrique qui serait plus conciliatoire que
contentieux. Il faudrait faire la critique d'une telle
argumentation188 . Dans tous les cas, l'absence d'une Cour africaine
des droits de l'homme a été un fait objectif donné
à un moment précis ; lequel fait objectif a longtemps
caractérisé la structure du mécanisme africain de
sauvegarde des droits de l'homme, à la différence des deux autres
mécanismes régionaux européen et américain. En
revanche, les justifications philosophiques que l'on prête à cet
élément objectif, sont très subjectives et relèvent
d'une analyse hasardeusement inconsistante et du reste scientifiquement peu
rigoureuse. Mieux, cette absence d'une Cour africaine indexée dès
l'adoption de la charte a disparu, depuis l'adoption en date du 09 juin 1998
à Ouagadougou du protocole facultatif relatif à la
création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Boudée au départ par les Etats, il ne comptait que six
ratifications en 2003 (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Maurice,
Sénégal, Afrique du Sud). A ce jour, 24 Etats ont signé et
ratifié ce protocole, 25 Etats l'ont signé mais pas
ratifié et 5 Etats n'ont pas encore signé ou ratifié cet
instrument. Le Protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004 et les
juges ont prêté serment en juillet 2006. Mais, depuis le
1er juillet 2008, l'Union africaine a adopté, à
Sharm El Sheik, en Egypte, le protocole portant statut de la Cour
Africaine de justice et des Droits de l'Homme et des peuples. L'on s'achemine
vers l'extension des compétences de la cour aux affaires pénales
(reprise des principaux crimes de la CPI : génocide, crime contre
l'humanité, crime de guerre).
Une autre spécificité critiquable du
système originaire africain de protection des droits de l'homme
réside dans l'absence d'une possibilité de mise en place d'un
régime d'exception en cas de circonstances exceptionnelles. La CADHP ne
contient effectivement pas de clause comparable à l'article 15 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
188 KONDE MBOM (J.M), Le contrôle international de
l'application de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
Presses Universitaires du septentrion, 1999, p. ; Voir également MBAYE (
K.),les droits de l'homme en Afrique, op-cit, p.165.
88
89
et des libertés fondamentales ou de l'article 27 de la
convention américaine des droits de l'homme189.
La place prépondérante accordée à
un organe des chefs d'Etas dans le mécanisme de sauvegarde apparait
comme une situation sui generis en droit international des droits de
l'homme. Cette caractéristique singulière de la C.A.D.H.P. ne se
rencontre dans aucun traité de protection des droits de l'homme. En
effet, si l'on trouve à des degrés limités l'action des
organes politiques dans le contrôle de l'application des instruments de
défense des droits de l'homme, il est souvent question d'un organe
ministériel aux compétences réduites. Il en va ainsi
notamment en Europe où l'influence du Conseil des ministres s'est
réduite avec le protocole 11 à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au-delà de l'impact négatif d'une telle implication de l'organe
politique dans le dispositif originaire de sauvegarde de la Charte, nous
pouvons d'ores et déjà indiquer la
décrédibilisation, et une certaine désaffection de
l'opinion internationale vis-à-vis de la charte africaine du fait
justement qu'il est suspendu dans une certaine mesure à la bonne
volonté des chefs d'État du continent. Surtout que les
dispositions de la C.A.D.H.P.190 instaurent une
prépondérance de cet organe politique qui se voit doté
d'un véritable pouvoir décisionnel au détriment de la
Commission africaine des droits de l'homme reléguée à un
organe d'études et de propositions.
Les spécificités normatives tiennent à
l'unicité de l'instrument, à la consécration des droits et
devoirs spécifiques et des nouveaux droits.
L'OUA a préféré l'unicité
conventionnelle à la dualité adoptée par la
majorité des systèmes de protection des droits de l'homme. Ainsi,
la CADHP, proclame dans le même texte, toutes catégories
confondues des droits de l'homme, contrairement aux autres systèmes qui
les séparent191. Elle réussit de ce fait à
faire coexister trois catégories différentes de droits dans un
seul instrument : droits civils et politiques (articles 8 à 14), droits
économiques sociaux et culturels (articles 15 à 18), droits de
solidarité (articles 19 à 22)192.
189 OUGUERGOUZ (F.), La Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, op.cit.p.24.
190 Articles 58 et 59.
191 ETEKA YEMET (V.), La charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, l'Harmattan, 1996, p. 175.
192 OUGUERGOUZ (F.), Recueil des cours Institut international
des droits de l'homme, 1999, p.5.
Elle est ainsi fidèle au principe
d'indivisibilité des droits de l'homme, et de leur
interdépendance qui appelle une approche plus
globalisante193.
L'examen de la genèse de la CADHP nous permet de mieux
saisir les spécificités qui la caractérisent. On en arrive
ainsi à la conclusion selon laquelle, la charte africaine est la somme
d'un difficile compromis sur un sujet sensible, car il comporte des
implications directes qui révèlent à l'extérieur la
manière dont sont gérés les Etats.
En dépit de ces spécificités, la CADHP
n'est pas sans conséquence sur les droits de l'enfant.
C. LES ENJEUX DE LA CADHP POUR LES ENFANTS
Tout peuple, tout homme, chaque homme vivant sur le territoire
ivoirien est bénéficiaire des droits inscrits dans cette charte.
Tel est le cas des enfants qui au-delà du bénéfice des
droits civils et politiques, des droits de solidarité reconnus à
tout homme dans cette charte, se voient accorder une attention
particulière au niveau des droits économiques, sociaux et
culturels. En effet, la CADHP accorde une attention singulière à
la protection de la famille et de certaines catégories de personnes
à savoir, les enfants et les femmes.
La famille, en tant qu'élément naturel de base
de la société, bénéficie d'une protection
particulière. Les devoirs de l'Etat envers elle, prescrits par l'art. 18
par.1 et 2, consistent pour celui-là à protéger celle-ci
en veillant à «sa santé physique et morale» et
à l'assister «dans sa mission de gardienne de la morale et des
valeurs traditionnelles reconnues par la communauté». Quant
à l'individu, il pèse sur lui l'obligation de respecter sa
famille, d'oeuvrer pour sa cohésion, de protéger son
développement harmonieux et même de «respecter à
tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de
nécessité.» La famille bénéficie ainsi de
cette protection renforcée non seulement en sa qualité
d'élément naturel et fondamental de la société,
mais également en tant qu'instrument de promotion des droits de l'homme
et des peuples. C'est effectivement elle qui assure, en premier lieu, la
formation et l'éducation des enfants et tous ses membres y participent
sans exception :
193 Déclaration et plan d'action de la
conférence de Vienne sur les droits de l'homme, juin 1993, par 1
(1er considérant).
90
grands-parents, parents, oncles et tantes, frères et
soeurs, cousins et cousines. Mais, la Charte africaine retient-elle une
acception aussi compréhensive de la famille ? Rien n'est moins
sûr. Elle ne donne aucune précision et les législations
internes des Etats africains optent généralement pour la famille
« nucléaire », c'est-à-dire le sens restreint
du terme, ne comprenant que les époux et les enfants194. Il
s'agit peut-être d'un compromis permettant la coexistence de deux
conceptions, l'une africaine, l'autre occidentale. Toutefois, le contexte et
les objectifs de la Charte autorisent à faire pencher la balance du
côté de la conception africaine, d'autant plus que pour la famille
retenue, l'accent est mis sur le respect des parents et leur assistance, et en
dehors de celle-ci, sur certaines catégories de personnes qui font
l'objet d'une protection particulière.
Les catégories de personnes qui
bénéficient de protection particulière sont, aux termes de
l'article 18, la femme et l'enfant d'une part et d'autre part les personnes
âgées et les handicapés. Pour la première
catégorie, il pèse sur l'Etat, l'obligation de non-discrimination
et de protection conformément aux « déclarations et
conventions internationales » y relatives195. Quant
à la seconde, il lui est reconnu le « droit à des
mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques et moraux » (art. 18 par.4). Ces dispositions tirent
incontestablement leur source d'inspiration de la tradition africaine. Celle-ci
est, en effet, très protectrice des catégories de personnes
visées. Il en va ainsi de l'enfant qui, perçu comme un don du ou
des dieux ou de la nature, est titulaire de droits bien précis, tels que
le droit à la maternité, le droit à une famille, le droit
à une éducation, le droit à une formation. Cette
protection est renforcée au point de prohiber toute discrimination entre
l'enfant adultérin, l'enfant naturel et l'enfant
légitime196.
Il ressort de ce qui précède que les droits de
l'homme sont inhérents à la nature humaine, de même que
l'égalité en droits et en dignité. Ainsi les droits de
l'homme dont parlent les instruments juridiques sus-analysés, sont les
droits de tous les hommes, y compris les enfants. Cette consécration
transcendantale de l'égalité universelle des êtres humains,
en
194 DEGNY-SEGUY (R.), « Codification et uniformisation du
droit », in Encyclopédie juridique de l'Afrique, T.1,
l'Etat et le droit, p. 453 et s.
195 Art. 18 par. 3.
196 Cette idée d'égalité entre enfants
est reprise par nombre de législations internes des Etats africains.
Voir étude précitée, DEGNY-SEGUY (R.), « Codification
du droit en Afrique », in E.J.A. p.64. ; Voir aussi
BAKARY (T.), « Introduction, » in Les Droits de l'Homme en
Afrique, Institut de droits de l'homme et de la paix, Université de
Dakar, 1991, p.10.
matière de droits, n'a pas occulté la
réalité redoutable de la différence inégalitaire
entre les composantes de l'espèce humaine sur le fondement de divers
critères, notamment sur le sexe et l'âge. L'enfant, homme
vulnérable, le plus petit des hommes en âge, se verra
progressivement être le bénéficiaire d'un ensemble de
droits contenus dans divers instruments internationaux. Ainsi, des instruments
juridiques spécifiques à l'enfant auxquelles la Côte
d'Ivoire est partie, viendront au secours des instruments à
caractère généraux ci-dessus évoqués. Ce
faisant, ces textes reconnaissent directement des droits aux enfants.
91
.

93
Section II. UNE RECONNAISSANCE DIRECTE A TRAVERS DES
INSTRUMENTS SPECIFIQUES AUX DROITS DE L'ENFANT
La démarche sectorielle de consécration
d'instruments internationaux de protection des droits de l'enfant s'explique
d'une part, par une certaine inefficacité des textes
généraux, d'autre part, par l'occurrence des violations des
droits de l'enfant dans le monde, et particulièrement en Afrique. Il
s'agit donc de l'expression juridique d'une volonté d'organiser une
protection supplémentaire des droits de l'enfant. Pour y arriver, divers
instruments juridiques internationaux vont être consacrés au
profit de l'enfant tant au niveau universel (Paragraphe 1) que
régional africain (Paragraphe 2).
§ 1. AU NIVEAU UNIVERSEL
Au niveau universel, en vue de renforcer la protection
juridique des enfants vivant sur le territoire ivoirien, la Côte d'Ivoire
a respectivement ratifié la Convention internationale des droits de
l'enfant (CIDE) (A), les deux protocoles facultatifs à ladite convention
ainsi que le protocole de Palerme (B), puis les conventions n°131 et 182
de l'OIT (C).
A. LA RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L'ENFANT (CIDE)
La Côte d'Ivoire a ratifié la CIDE le 04
février 1991, soit 6 (six) mois après l'entrée en vigueur
de la CIDE. Pour mieux comprendre le contenu de ce premier instrument universel
dédié à la protection de l'enfant, il importe d'examiner
les droits que ce texte consacre au profit des enfants (1) avant d'analyser les
obligations en découlant à la charge des Etats (2).
1. Des droits au profit des enfants
La convention des droits de l'enfant de 1989 couvre toute la
gamme des droits de l'homme. Il est d'usage de les classer en deux
catégories, d'une part les droits civils et politiques et de l'autre,
les droits économiques, sociaux et culturels. Bien que l'article 4 se
réfère à ces catégories, les articles du dispositif
ne sont pas eux-mêmes classés de la sorte. La convention cherche
au contraire à mettre en exergue le lien qui unit étroitement
tous les droits et qui en fait un bloc, afin de garantir ce que l'Unicef
appelle « la survie et le
94
développement » de l'enfant. Il serait
utile, à cet égard, de décrire la gamme des droits
garantis par la Convention comme les « trois P » :
prestation, protection et participation. Les enfants ont donc le droit
d'obtenir la prestation d'un nombre de choses et de services allant d'un nom et
d'une nationalité à des soins de santé et une
éducation. Ils ont le droit d'être protégés d'actes
tels que la torture, l'exploitation, la détention arbitraire ou le
retrait injustifié de la garde des parents. Enfin, les enfants ont le
droit d'agir et de s'exprimer, en d'autres termes de participer aux
décisions concernant leur vie et à la vie de la
société dans son ensemble. La CIDE ne fait pas de distinction
entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux
et culturels. Comme le souligne Guillemette Meunier, les droits contenus dans
la CIDE, pour des raisons pédagogiques, sont décrits en 3 «
P », c'est-à-dire, Prestation, Protection et
Participation197. Ainsi, au titre des droits contenus dans la CIDE,
on peut opérer la classification suivante :
- Droits Prestation : le droit à un nom, le droit à
la nationalité, le droit aux soins de santé, le droit à
l'éducation ;
- Droits Protection contre : la torture, l'exploitation, la
détention arbitraire, le retrait non justifié du droit de garde
des parents ;
- Droits Participation : le droit de participation aux
décisions les concernant, etc
En rassemblant ces droits dans un texte unique qui les
cimente, la Convention vise trois objectifs essentiels :
- Réaffirmer, à l'intention des enfants, des
droits que d'autres traités accordent déjà à tous
les êtres humains. L'application de certains de ces droits aux enfants,
tels que la protection contre la torture, n'est pas sujette à
controverse. D'autres droits, tels que la liberté d'expression, la
liberté d'association, la liberté de religion et le droit
à la sécurité sociale ont suscité des débats
enflammés tout au long du processus de rédaction pour savoir si
les enfants devaient ou non en bénéficier directement et, si oui,
dans quelles conditions. Ainsi, la réaffirmation de ces droits
n'était nullement superflue, elle était au contraire le moyen de
souligner que les enfants sont eux aussi des êtres humains ;
197 MEUNIER (G.), L'application de la Convention des
Nations-Unies relatives aux droits de l'enfant dans le droit interne des
États parties, l'Harmattan, Paris, 2002, 253 p., p.43.
95
- Donner à une série de droits de l'homme
fondamentaux un statut privilégié pour qu'il soit tenu compte des
besoins spéciaux et de la vulnérabilité des enfants.
L'exemple évident qui vient à l'esprit est celui de conditions de
travail acceptables, pour lesquelles les normes doivent être plus
strictes pour les enfants et les jeunes que pour les adultes. Un autre exemple
est celui des conditions de privation de liberté d'un mineur ;
- Elaborer des normes dans des domaines qui concernent plus
particulièrement ou exclusivement les enfants. La sauvegarde des
intérêts de l'enfant au cours de la procédure d'adoption,
l'accès à l'éducation primaire, la prévention de
l'abandon et des mauvais traitements au sein de la famille et la protection
contre ces situations, le recouvrement des pensions alimentaires sont
quelques-unes des questions spécifiques à l'enfant qui sont
couvertes par la convention.
Au-delà de l'ampleur de sa portée, cette
convention apparait comme une innovation constructive en ce qu'elle
présente trois nouveautés fondamentales. Tout d'abord, elle
introduit la notion des droits de «participation» de
l'enfant, grande absente des Déclarations précédentes.
Dans la même veine, elle reconnait explicitement qu'il faut veiller
à ce que les enfants eux-mêmes soient informés de leurs
droits. Ensuite, la Convention soulève diverses questions qui ne
l'avaient été dans aucun autre instrument international : le
droit à la réadaptation des enfants victimes, par exemple, de
diverses formes de cruauté et d'exploitation, l'obligation des
gouvernements de prendre des mesures visant à l'abolition des pratiques
traditionnelles nuisant à la santé de l'enfant. Elle comporte des
principes et normes qui ne figuraient à ce jour que dans des instruments
non contraignants, notamment les questions relatives à l'adoption et
à la justice pour mineurs.
La convention mentionne par ailleurs deux notions essentielles
ayant d'importantes retombées :
- d'une part, « l'intérêt
supérieur »198 de l'enfant devient
une considération primordiale dans toutes les «
décisions qui concernent les enfants », conjointement avec
tous les droits pertinents figurant ailleurs dans le texte de la Convention ;
En réalité, la CIDE emprunte cette notion à la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée
198 Article 3 CIDE.
96
le 20 novembre 1959. Le principe 2 de cette Déclaration
prévoit : « dans l'adoption des lois en vue d'assurer une
protection spéciale aux enfants, l'intérêt supérieur
doit être la considération déterminante. ». Loin
d'être une notion juridique stricto sensu, ce terme fait l'objet de
nombreuses études multidisciplinaires dont les effets peuvent être
parfois très variés. Cette notion, en dépit de sa
signification, est à la fois ancienne et nouvelle. « On en
trouve trace dans la favor liberorum des Instituts de Justinien ou dans le plus
grand avantage de l'enfant inscrit dans le code Napoléon comme
critère (subsidiaire) de choix entre les père et mère
divorcés »199. Sur le concept de
l'intérêt de l'enfant, Jean CARBONNIER écrivait : «
l'intérêt de l'enfant, c'est la notion magique. Elle a beau
être dans la loi, ce qui n'y est pas c'est l'abus qu'on en fait
aujourd'hui. A la limite, elle finirait par rendre superflues toutes les
institutions du droit familial200 ». Si
l'intérêt pour l'enfant consiste à le protéger
physiquement et moralement en raison de sa vulnérabilité,
désormais on cherche l'intérêt de l'enfant parce qu'il est
sujet et non plus un simple objet de droit201.
- d'autre part, le principe selon lequel les parents (ou
autres personnes légalement responsables) doivent donner à
l'enfant l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice de
leurs droits, d'une manière qui corresponde au «
développement des capacités»202 de
l'enfant.
Pour une mise en oeuvre concrète de ces droits de
l'enfant consacrés par la CIDE, les rédacteurs ont assortis ces
droits d'un certain nombre d'obligations pesant sur les Etats.
2. Des obligations à la charge des
Etats
La convention de New York est rédigée de telle
manière qu'elle fait peser sur les Etats de nombreux engagements, non
seulement pour donner vie aux droits reconnus, mais surtout pour organiser des
politiques publiques adaptées aux droits de l'enfant par exemple pour
la
199 FULCHIRON (H.) « De l'intérêt de l'enfant
aux droits de l'enfant » in Une Convention, plusieurs
regards. Les droits de l'enfant : une belle
déclaration ! Et après ? Introduction aux droits de
l'enfant, Tome 1 (1995), 1997, p.19.
200 CARBONNIER (J.) cité par Gilbert DELAGRANGE,
Comment protéger l'enfant ?, Karthala, 2004, p.30.
201 RENAUT (A.), La libération des enfants,
contribution philosophique à une histoire de l'enfance, Bayard,
2002, p.337-341. ; DE SINGLY (F.) « L'enfant à l'épreuve de
ses droits » in Enfants, adultes : vers une égalité de
statuts ?, Universalis, Paris, 2004, pp.63-76.
202 Article 5 CIDE.
97
famille, la protection de l'enfance, la régulation de
procédures d'adoption, les enfants handicapés, la santé,
pour l'éducation et la formation, la lutte contre l'exploitation des
enfants dans le travail ou sur le plan sexuel203. En d'autres
termes, plus qu'un simple catalogue des droits de l'enfant, la Convention est
une liste complète des obligations que les États acceptent de
contracter vis-à-vis des enfants. Il s'agit d'obligations directes,
telles que la mise à disposition d'établissements scolaires ou
l'instauration d'un système approprié pour l'administration de la
justice pour mineurs, ou d'obligations indirectes permettant aux parents,
à la famille élargie ou au tuteur de remplir pleinement leur
rôle et leurs responsabilités en matière de bien-être
et de protection de l'enfant. En d'autres termes, la Convention n'est
absolument pas une « charte de libération de l'enfant
», pas plus que son entrée en vigueur ou son contenu ne
remettent en cause l'importance de la famille, ce que confirme la lecture de la
Convention envisagée comme un tout. Toutefois, d'aucuns s'efforcent de
prouver le contraire en pointant l'index sur des dispositions précises,
qui tirées de leur contexte, peuvent sembler hostiles envers les parents
et la famille ou laisser croire qu'elles confèrent à l'enfant un
degré d'autonomie contestable. Il est important de rappeler que l'esprit
et la lettre de la Convention ne recherchent ni l'un ni l'autre.
Quant à sa portée juridique, il est à
rappeler que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant est
perçue, par la doctrine, comme le premier instrument juridique
spécifique à caractère obligatoire pour la protection des
enfants au plan international. Perçue sous cet angle, la Convention
devrait être opposable aux États parties tant au plan
international qu'au plan interne. Ainsi, en tant qu'instrument juridique
à caractère obligatoire, les juridictions nationales et
internationales devraient pouvoir sanctionner sa violation. La recherche du
consensus qui a abouti à l'adoption de la CDE a favorisé un
manque de fermeté et de contrainte dans sa
rédaction204, favorisant ainsi des interprétations
diverses quant à sa portée. Ce fut le cas en France «
où a éclaté une controverse jurisprudentielle et
doctrinale passionnée (...) les uns déplorant la mollesse et les
autres souhaitant à cette Convention la portée et la force les
plus grandes, (...) et qu'elle ne soit
203 OBERDORFF (H.), Droits de l'Homme et Libertés
fondamentales, A. Colin, 2003, p.52.
204 GRANET (F.), « La Convention de New-York sur les
droits de l'enfant et sa mise en oeuvre en France », in
L'enfant et les Conventions internationales , Dir. RUBELLIN-DEVICHI
(J.) et RAINIER (F.), Presses Universitaires de Lyon, 1996, 492 p., pp.95-114,
spéc. p.95.
98
pas reléguée au rang des pieuses
déclarations qui satisfont l'esprit en donnant bonne conscience sans
rien coûter. »205 .
La Convention permet aux Etats d'émettre des
réserves lors de la signature ou de la ratification, à condition
que celles-ci ne soient pas incompatibles avec son objet et son
but206. Contrairement à la Côte d'Ivoire, les pays
islamiques ont émis des réserves à l'égard des
articles relatifs à l'adoption, qui n'existe pas dans ces Etats. De
même, la France (elle a ratifié la CIDE en 1990), a émis
une déclaration interprétative sur la question du droit
systématique d'interjeter appel d'une décision constatant une
infraction commise par un mineur (art.40). Elle a aussi émis une
réserve sur le droit à la vie (art.6) dont elle a
précisé qu'elle ne constituait pas un obstacle à
l'interruption volontaire de grossesse. Une autre réserve émise
par la France a trait à l'article 30 relatif aux minorités. Le
conseil d'Etat a rappelé dans l'arrêt du 3 juillet 1996,
Paturel207, que « le gouvernement français
a déclaré que l'article 30 de la Convention relative aux droits
de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'a pas lieu de
s'appliquer en ce qui concerne la République française ; qu'il ne
peut donc être utilement invoqué ».
Comme elle appartient à la sphère des droits de
l'homme, la Convention permet de sortir la question des enfants du domaine d'un
sentimentalisme et d'un sensationnalisme bien intentionnés, mais
déconsidérés, dans lequel elle était
généralement restée enfermée, avec parfois des
conséquences désastreuses.
Mais, malgré ses faiblesses, la CIDE constitue
aujourd'hui le seul instrument à caractère universel qui pourrait
amener la communauté internationale à obliger les États
à prendre des mesures au plan interne pour assurer la jouissance
effective des droits qui y sont reconnus et promus.
Outre la CIDE, l'Etat de Côte d'Ivoire a
également ratifié les deux protocoles facultatifs à la
CIDE en vue de renforcer la protection juridique des enfants en période
de conflit armé et la protection des enfants contre la vente, la
prostitution et la pornographie infantile.
205 GRANET (F.), op. cit. p.96.
206 Art. 51 al. 2 de la CIDE.
207 JCP 1996.I.2279, obs. Ch. Rouault.
99
B. LA RATIFICATION DES DEUX PROTOCOLES FACULTATIFS A
LA CIDE ET DU PROTOCOLE DE PALERME
La récente ratification des deux protocoles facultatifs
à la CIDE en 2001, au lendemain de la crise ivoirienne a eu pour effet
de renforcer le cadre normatif international de protection des enfants en
Côte d'Ivoire. Il s'agit du protocole facultatif de la CIDE concernant
l'implication d'enfants dans les conflits et le protocole facultatif de la CIDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants . La même année la Côte
d'Ivoire a marqué son adhésion au Protocole de Palerme. Nous
examinerons ces trois textes en relevant leur importance dans la protection des
droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.
La ratification du protocole facultatif de la CIDE concernant
l'implication d'enfants dans les conflits contribue au renforcement de la
protection des enfants en temps de guerre.
D'emblée, il est opportun de noter qu'avant 2011, la
protection des enfants en Côte d'Ivoire en période de guerre
était assurée par les Conventions de Genève et de leurs
protocoles. En effet, La Côte d'Ivoire a respectivement
adhéré aux quatre conventions de Genève, le 28/12/1961 ;
De même, elle a adhéré aux deux protocoles facultatifs aux
conventions de Genève, le 20/09/1989.
Le droit international humanitaire s'applique dans toutes les
situations de conflit armé. Et il va de soi que les dispositions
générales du droit international humanitaire sur la protection
des civils au cours des conflits armés s'appliquent également aux
enfants. Toutefois, quelques vingt-cinq (25) articles des conventions de
Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977, traitent
spécifiquement de la protection des enfants.
La quatrième convention de Genève
afférente à la protection des civils dans les situations de
conflit armé, comporte moult dispositions consacrés aussi
à la protection des enfants. On peut citer : l'article 14 indiquant que
les Parties pourront créer des zones de sécurité afin de
protéger, entre autres, les enfants de moins de quinze ans ; l'article
17 vise aussi les enfants au titre de la mesure d'évacuation des civils
hors des zones assiégés ; l'article 23 relatif au libre passage
de produits de première nécessité destinés aux
groupes particulièrement vulnérables de la population civile,
fait explicitement référence aux enfants de moins de quinze ans ;
l'article 24 a trait à la protection des enfants de moins de quinze ans
devenus
100
101
orphelins ou séparés de leur famille du fait de
la guerre et prévoit l'identification des enfants de moins de douze ans
; l'article 38 applicable aux personnes protégées sur le
territoire national des belligérants, inclut les enfants
âgés de moins de quinze ans parmi les personnes devant jouir de
tout traitement préférentiel au même titre que les
ressortissants de l'Etat concerné ;quant à l'article 50, il
réfère aux enfants dans les zones occupées et des
institutions qui doivent en prendre soin, tandis que l'article 51 interdit
à la Puissance occupante d'astreindre au travail les personnes
âgées de moins de 18 ans ; l'article 68 interdit de condamner
à mort toute personne protégée âgée de moins
de dix-huit ans au moment de l'infraction.
Outre ces dispositions, le principe d'une protection
spéciale en faveur des enfants en situation de conflit armé
international est établi explicitement par le Protocole additionnel I
aux conventions de Genève. L'Article 77 (1) du protocole dispose in fine
: « Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et
doivent être protégés contre toute forme d'attentat
à la pudeur. Les parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide
dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison
».
Le protocole additionnel II aux conventions de Genève
comprend des dispositions analogues pour la protection des enfants en cas de
conflit armé non international. Ainsi, l'article 4 relatif aux «
garanties fondamentales »contient des dispositions
spécifiquement consacrées à la protection des enfants, et
reprend certains des principes de la Quatrième convention de
Genève, et notamment ceux des articles 17, 24 et 26.
Il est important d'indiquer que la responsabilité de
l'application du droit international humanitaire, y compris la protection
particulière qu'il accorde aux enfants, est une responsabilité
collective. Il est du devoir de chaque Etat partie aux Conventions de
Genève de respecter et de faire respecter ces normes. La Convention
relative aux droits de l'enfant reprend ce devoir en son article 38, en
disposant : « Les Etats parties s'engagent à respecter et
à faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection
s'étend aux enfants » Suivant cet article, les Etats parties
à la CIDE « prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection et de soins »,
conformément à leurs obligations au titre du droit international
humanitaire de protéger les populations civiles lors des conflits
armés.
Le droit international a fixé à 15 ans
l'âge minimum pour le recrutement dans les forces armées et la
participation aux hostilités. Cette limite a été
établie après la fin de la deuxième guerre mondiale, sans
doute parce qu'elle correspondait à l'âge de la fin de
l'école dans les pays occidentaux208.
Cette limite fut reprise par la Convention relative aux droits
de l'enfant bien que des efforts vigoureux aient été accomplis
par le CICR, d'autres organisations non gouvernementales, diverses agences des
Nations Unies et certains Etats aux fins de tenter de relever l'âge
minimal de recrutement et de participation aux hostilités à 18
ans. Nonobstant l'adoption finale de l'article 38 de la convention relative aux
droits de l'enfant, le débat houleux209 qu'il avait
suscité a créé un sentiment d'insatisfaction
partagée par de nombreuses délégations. Aux termes de
l'article 38 de la convention relative aux droits de l'enfant, les Etats :
« prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller
à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne
participent pas directement aux hostilités ». En
réalité, la Convention n'a pas freiné le
phénomène des enfants soldats.
Dans son étude sur l'impact des conflits armés
sur les enfants, Madame Graça MACHEL précise : « La
convention sur les Droits de l'enfant, si elle assure une protection
complète, doit néanmoins être renforcée pour ce qui
est de la participation des enfants aux conflits armés ».
C'est pourquoi la journée thématique sur les enfants dans les
conflits armés organisée en 1991 a été le
prétexte pour recommander la rédaction d'un Protocole facultatif
à la CDE, relatif au recrutement et à la participation des
enfants dans les conflits armés. Dans
208 BADIANE (S.), Les enfants aux deux bouts
du fusil, Presses Universitaires de Dakar, 2004, p.305.
209 En ratifiant la Convention, un certain nombre d'Etats ont
fait des déclarations pour exprimer leur souci de voir que l'article 38
n'interdit pas la participation aux hostilités et l'enrôlement
dans les forces armées de toutes les personnes de moins de 18 ans. Par
exemple :
« La principauté d'Andorre déplore le fait
que la Convention relative aux droits de l'enfant n'interdit pas l'utilisation
d'enfants dans les conflits armés. Elle ne souscrit pas aux dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 concernant la participation et
l'enrôlement d'enfants à partir de l'âge de 15 ans
».
« En ce qui concerne l'article 38 de la Convention
relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare
qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit
l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son
droit interne-lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de
l'article 41 ».
« L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de
l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux
hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette
règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui
prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale » ( voir aussi les
déclarations de l'Allemagne, de la Colombie, de l'Espagne, des Pays-Bas,
de la Pologne et de l'Uruguay, CRC/C/2/Rév.7).
102
cette perspective, l'Assemblée générale
de l'Onu adopta par consensus, en date du 25 mai 2000, un Protocole facultatif
se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la participation des enfants aux conflits armés. Entré
en vigueur le 18 janvier 2002210, ce protocole a été
ratifié par la Côte d'Ivoire le 03 Aout 2011 au lendemain d'une
crise politico-militaire ayant fait de nombreuses victimes, y compris des
enfants. Il interdit aux Etats et aux acteurs non gouvernementaux d'utiliser
les enfants dans les conflits armés. Bien que ce document n'interdise
pas l'engagement volontaire des enfants ayant plus de 15 ans dans les forces
armées, ils ne peuvent pas être enrôlés ou
utilisés de force dans un combat s'ils ont moins de 18
ans211. Les principales dispositions de ce texte porte
sur212 :
- La participation aux hostilités : "Les
États parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller
à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint
l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux
hostilités." ;
- La conscription : " Les États parties veillent
à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans
ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces
armées." ;
- Les groupes armés non-gouvernementaux : " Les
groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un
État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans
les hostilités des personnes âgées de moins de dix-huit
ans." De même, "Les États parties prennent toutes les
mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de
ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique voulues pour interdire
et sanctionner pénalement ces pratiques." ;
- L'engagement volontaire : les États parties doivent
relever l'âge minimum de l'engagement volontaire au-delà de celui
de quinze ans prévu par la Convention, et déposer une
déclaration contraignante indiquant l'âge minimum qu'ils
s'engagent à respecter. En pratique, cela signifie que l'âge
minimum de l'engagement volontaire est porté à au moins seize
ans. Les États parties qui autorisent l'engagement volontaire avant
l'âge de dix-huit ans doivent mettre en place une série de
garanties assurant que l'engagement soit effectivement volontaire; qu'il ait
lieu avec le
210 UNICEF, Combattre la Traite des Enfants, Guide à
l'usage des parlementaires, n°9, 2005, p.27.
211 UNESCO, Droits de l'Homme Questions et
réponses, Editions Unesco, 4ème édition,
pp 70-71.
212
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/Fchapter12.html#3
(consulté le 20/09/2014).
103
consentement, en connaissance de cause, des parents ou tuteurs
légaux de l'intéressé; que les recrues soient pleinement
informées des devoirs qui s'attachent au service militaire; que la
preuve de l'âge soit apportée ;
- Application : les États parties doivent
démobiliser les personnes enrôlées ou utilisées en
violation du Protocole, et apporter toute l'assistance nécessaire
à leur réadaptation et à leur réinsertion.
Les organes des Nations Unies et ONG concernés
encouragent les Etats à ratifier ce protocole facultatif et à
retenir l'âge de dix-huit ans comme minimum pour l'engagement volontaire.
Les Nations Unies ont fait savoir que les Etats participant à des
missions de maintien de la paix de l'ONU ne doivent pas y faire participer
d'observateurs âgés de moins de vingt-cinq ans, qu'ils
appartiennent à la police civile ou aux forces armées et que dans
l'idéal, les hommes de troupe devraient avoir plus de vingt-et-un ans,
mais jamais moins de dix-huit.
Par ailleurs, cette protection des enfants en période
de conflit armé est davantage renforcée par le statut de la Cour
pénale internationale adopté en 1998 ; lequel statut a
été récemment ratifié par la Côte d'Ivoire,
en date du 15 Février 2013213 . Aux termes dudit statut, sont
définis comme « (a) crimes de guerre, la conscription ou
l'enrôlement ou l'utilisation au cours d'hostilités, par les
forces armées ou des groupes armés, d'enfants âgés
de moins de 15 ans ; (b) comme un délit de génocide, le transfert
forcé d'enfants originaires d'un groupe ethnique, racial ou religieux
menacé dans un autre groupe ; (c) comme des crimes de guerre : le viol,
l'esclavage sexuel et la prostitution des enfants sous la contrainte
».
La même année 2011, la Côte d'Ivoire a en
outre ratifié le deuxième protocole facultatif à la CIDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants.
Ratifié par la Côte d'Ivoire, le 07 septembre
2011, ce Protocole facultatif complète les dispositions de la Convention
relative aux droits des enfants en établissant les critères
213
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/Cote_d_Ivoire.aspx
(consulté le 10 Octobre 2014).
104
détaillés requis pour pénaliser les
violations des droits de l'enfant à l'égard de la vente
d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en
scène des enfants.
Ses principales dispositions comprennent : les
définitions des délits de "vente
d'enfants"214, de "prostitution des enfants"215 et
de "prostitution mettant en scène des enfants"216; des normes
relatives au traitement de toute violation au titre du droit interne, y compris
à l'égard de ceux qui s'en rendent coupables217; la
protection des victimes et les efforts de prévention218; un
cadre permettant d'accroître la coopération internationale en la
matière, notamment en ce qui concerne les poursuites visant les auteurs
d'infractions219.
Le Protocole facultatif met un accent particulier sur les
sanctions pénales devant frapper les violations graves des droits de
l'enfant, en l'occurrence la vente d'enfants, l'adoption illégale, la
prostitution infantile et la pornographie mettant en scène des enfants.
De même, le texte met en avant la valeur de la coopération
internationale comme moyen de combattre ces activités transnationales,
et des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation pour
améliorer la protection des enfants contre ces graves violations de
leurs droits.
En un mot, le protocole vise l'interdiction de la vente
d'enfants aux fins de leur exploitation sexuelle, de leur mise au travail ou de
leur adoption, et couvre la prévention, l'interdiction et l'assistance
aux victimes. Si la Convention relative aux droits de l'enfant
214 Article 2- a du Protocole facultatif de la CIDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants : « ...On entend par vente
d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis
par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne
ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.
».
215 Article 2-b du Protocole facultatif de la CIDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants : « On entend par prostitution
des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles
contre rémunération ou tout autre forme d'avantage ».
216 Article 2-c du Protocole facultatif de la CIDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants: « On entend par pornographie
mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités
sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute
représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins
principalement sexuelles ».
217 Articles 3 à 8 du Protocole facultatif de la
CIDE concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants.
218 Article 9 du Protocole facultatif de la CIDE
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants.
219 Article 10 Protocole facultatif de la CIDE concernant
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants.
105
insiste surtout sur la prévention de l'exploitation
sexuelle, le Protocole est axé sur la criminalisation de la prostitution
des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
Il convient de rappeler que l'interprétation des deux
Protocoles facultatifs peut se faire à la lumière de la
Convention dans son ensemble, et se fonder sur les principes de
nondiscrimination, de l'intérêt supérieur de l'enfant, et
de sa participation. Ces deux protocoles présentent ainsi qu'on vient de
le démontrer des enjeux certains pour les droits de l'enfant, à
l'instar du Protocole de Palerme auquel la Côte d'Ivoire a
adhéré en 2011.
Le Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, communément appelé « Protocole de
Palerme », a été adopté par la résolution
A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la cinquante-cinquième session
de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies. Il est entré en vigueur, conformément à son article
17, le 25 décembre 2003. Il vise à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier celle des
femmes et des enfants220. Il a fallu attendre douze (12)
années après son adoption, pour que la Côte d'Ivoire en
soit partie ; elle a en effet ratifié ce protocole en date du 25 Octobre
2012. A ce jour, 182 Etats y sont parties au nombre desquels certains pays
africains tels que l'Algérie qui l'a ratifié le 07 Octobre 2002
et la République du Bénin, le 30 août 2004221.
Conformément à son article 1er, le Protocole de
Palerme (PP) se veut un complément de la Convention contre la
criminalité transnationale et s'applique à la prévention,
aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions de traite
lorsqu'elles sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel
organisé y est impliqué, de même qu'à la protection
des victimes de ces infractions. Rappelons, néanmoins, que l'une des
particularités du Protocole de Palerme est d'avoir réussi
à obtenir un consensus international sur la notion de « traite
» des êtres humains, et donc de la traite des enfants. En
effet, le protocole de Palerme est le premier instrument de droit international
qui donne une définition précise de la traite. Outre qu'il
préconise des politiques et des programmes complets pour empêcher
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il contient
des dispositions détaillées sur les obligations qui incombent aux
parlements
220 Art.3 du Protocole de Palerme de 2000.
221 Pour plus d'information, se référer au
recueil des traités des Nations Unies, vol.2237, p.319. Voir
aussi :
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2007/12/13/XVIII-12.fr.pdf
(consulté le 21/10/2014).
106
d'adopter des lois contre la traite, sur la répression
et le traitement des victimes. Au nombre des mesures évoquées,
figurent l'incrimination du trafic, les sanctions appropriées, la
protection des victimes dans les pays d'accueil et les échanges
d'information entre pays.
Outre cela, l'Etat ivoirien a aussi renforcé son
engagement international en souscrivant à d'autres instruments
juridiques internationaux sectoriels de protection des enfants.
C. LA RATIFICATION DES CONVENTIONS N°138 et 182 de
l'OIT
On examinera successivement l'apport de chacune des
conventions 138222 et 182223 de l'OIT dans le processus
d'affirmation et de protection des droits de l'enfant.
L'élimination du travail des enfants implique que soit
adoptée et appliquée une politique mettant en oeuvre de
manière coordonnée un ensemble de moyens. C'est dans cette
perspective de développement que s'inscrit la convention 138 sur
l'âge d'admission à l'emploi, adoptée en 1973 par la
Conférence internationale du Travail. Ratifiée par la Côte
d'Ivoire, le 7 Février 2003224, elle met l'accent sur la
nécessité de permettre à l'enfant d'acquérir les
connaissances qui lui permettront de jouer à l'avenir son rôle
dans la société et de protéger son développement
physique, intellectuel et moral225.
Les conventions internationales du travail adoptées
avant 1973 se référaient explicitement au travail salarié
industriel (conventions 5 et 59), commercial (conventions 33 et 60), ou
souterrain (convention 123) et au travail dans l'agriculture, sans
préciser s'il s'agit de travail salarié ou non (convention 10).
Ces conventions avaient pour objectif l'adoption et la mise en oeuvre d'une
législation interdisant le travail des enfants en dessous d'un certain
âge.
La convention 138 vise tout travail ou emploi, salarié
ou non, et poursuit un objectif beaucoup plus ambitieux que les conventions
anciennes qu'elle révise. Il ne s'agit pas seulement de fixer un
âge minimum d'admission à l'emploi et donc d'interdire le
travail
222 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.103.
223 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.106.
224
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312283(
consulté le 20 Septembre 2014).
225 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.103.
107
salarié en dessous d'un certain âge, mais de
définir et d'appliquer une politique visant l'élimination du
travail des enfants et l'élévation progressive de leur âge
d'admission à l'emploi. Il y a lieu de rappeler que la convention
établit des règles minimales. Il est toujours possible d'aller
au-delà de ce plancher et d'adopter des mesures plus favorables aux
enfants.
Les États qui ratifient la convention 138 supportent en
principe des obligations minimales. L'engagement central de la convention
réside dans la poursuite d'une politique nationale dont l'objectif est
d'assurer « l'abolition effective du travail des enfants et
d'élever progressivement l'âge minimum d'admission à
l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents
d'atteindre le plus complet développement physique et mental
»226. Les États ont la liberté de choisir
les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif. Néanmoins, il faut
souligner qu'une politique relative au travail des enfants n'a de sens que si
elle est coordonnée avec l'ensemble des autres aspects de la politique
de l'enfance (éducation, santé infantile, soutien aux familles
etc.). En particulier l'âge d'admission à l'emploi doit
correspondre à l'âge de fin de scolarité
obligatoire227 .
En outre, une politique visant l'abolition effective du
travail des enfants doit être coordonnée avec la politique de
l'emploi, avec celle des revenus et notamment avec les mesures prises pour
réduire la pauvreté et les risques d'exclusion, ainsi qu'avec les
mesures prises pour réduire la pauvreté et les risques
d'exclusion, ainsi qu'avec les mesures de sécurité sociale. La
recommandation 146 qui accompagne la convention précise (paragraphes 1
à 5) ce que pourrait être le contenu des politiques en
matière de travail des enfants. Elle insiste particulièrement sur
« la haute priorité » à accorder à un
ensemble de mesures couvrant un très vaste champ et sur l'indispensable
coordination entre les mesures prises pour abolir le travail des enfants et les
mesures prises en matière d'éducation, de santé ou
d'emploi.
La convention 138 procède aussi à une
spécification d'un âge minimum d'admission au travail pour les
enfants. La politique nationale en matière de travail des enfants doit
établir un critère délimitant ce qui est permis
socialement et juridiquement et ce qui ne l'est pas. L'Etat qui ratifie la
convention doit déclarer un âge minimum en dessous duquel, aucune
personne d'un âge inférieur ne devra être admise à
l'emploi ou au travail dans une profession
226 Article 1 de la Convention 138 de l'OIT.
227 Article 2 Paragraphe 3 de la Convention 138 de l'OIT.
108
quelconque, sauf exceptions prévues dans la
convention228. Cet âge minimum est fixé à
l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire (si celui-ci est
égal ou supérieur à 15 ans) et ne peut, en tout cas,
être inférieur à 15 ans229 . A côté
de ce principe, il existe de nombreuses exceptions. Certaines sont transitoires
et doivent faciliter la ratification par le plus grand nombre de pays ;
d'autres peuvent être permanentes, afin de laisser aux gouvernements une
plus grande souplesse dans l'application de la Convention.
Les mesures d'application sont au nombre de trois230 :
«
a) L'adoption de mesures appropriées (y compris
des sanctions) pour assurer l'application de la convention ,
·
b) La détermination des personnes responsables de
l'application de la convention (employeurs, parents, représentants
légaux, etc.) et ,
·
c) La tenue de registre par l'employeur contenant le nom,
la date de naissance, des personnes de moins de 18 ans qui sont dans son
établissement (article 9, paragraphe 3). »
La convention 138 est-elle un instrument approprié pour
relever le défi que pose le travail des enfants tant dans les pays
industrialisés que dans les pays en voie de développement ?
Plusieurs de ses dispositions, de même que celles des conventions
internationales du travail relatives à l'interdiction du travail de nuit
ou à l'examen médical des enfants et des adolescents, visent
spécifiquement et exclusivement le travail salarié. A ce titre,
elles jouent un rôle central car le travail salarié est, et
demeurera sans doute longtemps encore, un modèle dominant de la
modernité. Peut-elle jouer un rôle semblable pour des
activités non salariées, pour le secteur non-structuré ou
pour les activités agricoles à la limite de l'économie de
subsistance ? Il semble que la réponse soit positive. En
établissant l'obligation de définir et d'appliquer une politique
nationale visant l'élimination du travail des enfants, la convention
invite tous les intéressés, y compris les ONG, a une approche
globale du problème. Les mesures à prendre dans les
différentes situations (travail salarié, travail dans le secteur
non-structuré, travail dans le secteur agricole, travail comme
domestique etc.) ne sont pas de
228 Article2, paragraphe I de la Convention 138 de l'OIT.
229 Article 2, paragraphe3 de la Convention 138 de l'OIT.
230 Article 9 de la Convention 138 de l'OIT.
109
même nature ; elles doivent cependant être
coordonnées d'autant plus qu'un certain nombre d'instruments efficaces
pour lutter contre le travail des enfants seront bien souvent les mêmes
(généralisation de l'enseignement gratuit et obligatoire
notamment en milieu rural et dans les quartiers pauvres des villes ; politique
des revenus ; mesures de protection sociale etc.).
La Convention n°182 de l'OIT sur les pires formes du
travail des enfants apparaît également comme une source
internationale précieuse de protection des enfants en Côte
d'Ivoire.
Adoptée à la 87ème session de
la Conférence Générale de l'OIT en date du 17 juin 1999 et
entrée en vigueur le 19 novembre 2000, la Convention n°182 porte
sur les pires formes du travail des enfants. La Convention n° 182 de l'OIT
sur les pires formes de travail des enfants a été ratifiée
le 21 janvier 2002. Depuis lors, l'État ivoirien s'est engagé
à prendre toutes les mesures nécessaires aux termes de la
Convention et de sa Recommandation pour faire de l'élimination des pires
formes du travail des enfants une réalité sur son territoire.
Comme son nom l'indique, elle appelle à l'interdiction
et à l'élimination des pires formes de travail des enfants.
Celles-ci sont définies à l'article 3 et recouvrent toutes les
formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits
armés ; l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à
des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de
spectacles pornographiques ou aux fins d'activités illicites, notamment
pour la production et le trafic de stupéfiants ; et les travaux qui, par
leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles
de nuire à la santé, à la sécurité ou
à la moralité de l'enfant231. Elle vient donc
compléter la Convention n°138 et sa Recommandation 146. Elle
s'applique à tous les enfants de moins de 18 ans, même si dans
l'Etat en question, la majorité est fixée avant 18 ans.
Comptant au total 16 articles, la Convention développe
en huit points, les obligations des États parties, les notions d'enfant
et de pires formes de travail des enfants, et les mesures concrètes
à prendre par les États parties.
231 UNICEF, Combattre la Traite des Enfants. Guide à
l'usage des parlementaires, n°9, 2005, p.27-28.
110
Ainsi, dans son 1er article, elle oblige les
États parties « à prendre des mesures immédiates
et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires
formes du travail des enfants (...) ». Les articles 2 et 3
précisent le sens à donner aux notions d' « enfant
» et « pires formes de travail des enfants » ;
ensuite les articles 4 à 8 abordent les différentes mesures
à prendre par les États parties pour se conformer aux exigences
de la norme ; enfin, les articles 9 à 16 abordent les dispositions
générales qui découlent de la ratification de la norme.
Qu'entend-t-on par travaux qui par leur nature ou les
conditions dans lesquelles ils s'exercent sont susceptibles de nuire à
la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant ?
La réponse est apportée par la Directive 190 de l'OIT qui vise :
«
- Les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau,
à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés ; (il en
va ainsi des travaux dans les mines auxquels sont soumis certains enfants en
Côte d'Ivoire avec l'utilisation d'un produit chimique redoutable, le
mercure) ;
- Les travaux exposant les enfants à des substances ou
des procédés dangereux, ou à des conditions de
température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à
leur santé ; (c'est le cas des enfants atteints de la maladie du tabac
vert : absorption de 54 mg de nicotine par jour soit 50 cigarettes
fumées) ;
- Les travaux s'effectuant avec des machines ou des outils
dangereux : coupe de la canne à sucre ;
- Les travaux sur des déchetteries :
polybromodiphynyléther qui freinent la développement
neurologique, mercure, plomb : maladies gastro-intestinales, dermatologiques,
respiratoires ».
Quel que soit le niveau de développement des pays
concernés, la Convention interdit toutes ces formes d'exploitation
« extrême » du travail des enfants qui portent non
seulement atteinte à leur intégrité physique et morale,
mais aussi à tous leurs droits, et impose aux pays de prendre des
mesures « immédiates et efficaces » pour les
éradiquer. Pour cela, la Convention met en avant la
nécessité de la coopération et l'assistance
internationale232. Les Etats liés par la Convention devront
ériger en infractions pénales ces formes de travails et
prévoir des sanctions pénales en tant que mesures
préventives, ainsi que des mesures de
232 Article de la Convention 182 de l'OIT.
111
réinsertion et de
réintégration233. Contrairement à la Convention
138, la Convention 182 se veut juridiquement plus contraignante en ce qu'elle
exige l'élimination immédiate des pires formes de travail des
enfants, et interdit de faire travailler des enfants dans le cadre d'un
apprentissage ou d'une activité de formation qui relèverait des
pires formes de travail énoncées234.
A l'instar de la Convention n°138, la Convention
n°182 sur les pires formes du travail des enfants s'accompagne
également d'une Recommandation. En effet, la Recommandation (R)
n°190 sur les pires formes du travail des enfants a été
adoptée le 17 juin 1999 pour compléter les dispositions de la
Convention n°182 et doit s'appliquer conjointement avec la Convention. La
R. n° 190 aborde les mesures spécifiques à prendre et les
politiques à mettre en oeuvre par les États parties pour
atteindre le but visé par la Convention Elle décrit donc le mode
d'application de cette convention en dressant la liste des programmes d'action
à envisager par les gouvernements, celle des travaux dangereux et les
modalités de mise en oeuvre par les Etats membres de l'OIT. Ce texte
complète la Convention de 1973 ainsi que sa recommandation concernant
l'âge minimum d'admission à l'emploi, lesquelles restent les
instruments fondamentaux en matière de travail des enfants.
Ouverte par les Nations Unies, la voie afférente
à la consécration d'instruments spécifiques de protection
des droits de l'enfant, va inspirer des acteurs régionaux avec la
naissance de divers instruments régionaux de protection des enfants et
notamment en Afrique.
§ 2. AU NIVEAU AFRICAIN
Au niveau africain, la Côte d'Ivoire va souscrire
à divers instruments spécifiques à la protection de
l'enfant, notamment, par son adhésion à la charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant (A) ainsi que la signature de divers
accords multilatéraux ou bilatéraux de protection de l'enfant
dans des domaines particuliers (B).
233 Article 7 de la Convention 182 de l'OIT.
234 LA-ROSA (A.), LA VENUE (dir.) La Protection de
l'enfant en droit international pénal : état des lieux,
Mémoire de Master recherche, Université de Lille, 2003-2004, p.
85.
112
A. LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ETRE DE
L'ENFANT
Adoptée au lendemain de la Convention des Nations Unies
relatives aux droits de l'enfant en juillet 1990, la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant apparait comme le premier instrument
juridique africain, en matière de protection des droits de l'enfant. Les
États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)
(devenue aujourd'hui Union africaine), entendaient se doter d'une norme
régionale de protection de l'enfant qui prend en compte, comme l'indique
le préambule de la Charte, les vertus de l'héritage culturel
africain et les valeurs de la civilisation africaine235. La
Côte d'Ivoire y a adhéré le 13 mars 2002. Ce texte consacre
des droits au profit des enfants et des obligations tripartites que nous
examinerons à travers son contenu et sa portée.
1. Le contenu de la Charte
Globalement, la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant est restée fidèle à son
aînée, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
dans sa forme. Comptant au total 48 articles, elle est divisée en quatre
chapitres qui prennent en compte respectivement, les droits et protection de
l'enfant (art.1 à 31), la création et l'organisation d'un
comité sur les droits et le bien-être de l'enfant (art.32 à
41), le mandat et la procédure du comité (art. 42 à 45) et
enfin les dispositions diverses (art. 46 à 48). Elle se veut une norme
progressiste à travers la prise en compte des vertus de
l'héritage culturel africain, du passé historique et des valeurs
de la civilisation africaine qui devraient, aux termes de la Charte, inspirer
et guider la réflexion en matière de droits et de protection de
l'enfant africain.236 Ainsi s'annonce le démarcage voulu par
la Charte vis-à-vis de la CIDE237.
A la lecture de la CADBE on se rend compte de la
volonté de précision voulue par celle-ci dans la
définition de l'enfant en son article 2, à travers laquelle
l'enfant est défini comme « tout être humain
âgé de moins de 18 ans». Nonobstant les critiques que
cette disposition suscite quant à son réalisme238,
elle a l'avantage d'être précise.
235 Cf. le septième paragraphe du préambule de la
Charte.
236 Cf. 6è point du préambule de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
237 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.108-110.
238 Lire les commentaires d'Alain-Didier OLINGA sur la
définition de l'enfant africain.
113
En ce qui concerne les droits reconnus et promus par la
Charte, nous pouvons noter : « le droit à la non-discrimination ;
la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans
toute action et toute procédure judiciaire ou administrative le
concernant ; le droit à la survie et au développement ; le droit
à une nationalité ; le droit à la liberté
d'expression ; le droit à la liberté d'association ; le droit
à liberté de pensée, de conscience et de religion ; le
droit à la protection de sa vie privée ; le droit à
l'éducation ; le droit aux loisirs, activités
récréatives et culturelles ; le droit à la santé et
le droit à la protection et aux soins des parents. Dans le même
temps, tout en reconnaissant l'importance de la cellule familiale pour la
protection de l'enfant et de l'obligation qu'a l'État de l'assister dans
sa mission (art.18), la Charte offre une protection particulière aux
enfants handicapés (art.13) ; aux enfants en conflit avec la loi
(art.17) ; aux enfants réfugiés (art.23) et aux enfants des
mères emprisonnées. De même, elle insiste sur la
nécessité pour les États parties de protéger les
enfants contre : le travail des enfants (art.15) ; les pratiques
négatives sociales et culturelles (art.21); l'exploitation sexuelle
(art. 27) ; la consommation de drogues (art.28) ; la vente, la traite,
l'enlèvement et la mendicité (art.29). »239.
A l'instar de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être l'enfant a eu
droit à sa part de devoirs à la charge de ses
bénéficiaires (les enfants). En effet, l'article 31 de la Charte,
qui boucle le chapitre sur les droits et obligations, énumère
quelques responsabilités de l'enfant envers « sa famille, la
société, l'État et toute communauté reconnue
légalement ainsi qu'envers la communauté
internationale.» Ainsi, l'enfant doit :
- oeuvrer pour la cohésion de sa famille, respecter ses
parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes
circonstances et les assister en cas de besoin ;
- servir la communauté nationale en plaçant ses
capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ;
- préserver et renforcer la solidarité de la
société et de la nation ;
239 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.108-110.
114
- préserver et renforcer les valeurs culturelles
africaines dans ses rapports avec les autres membres de la
société dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
consultation et contribuer au bien-être moral de la société
;
- préserver et renforcer l'indépendance nationale
et l'intégrité de son pays ;
- et enfin, il doit contribuer au mieux de ses capacités,
en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et
réaliser l'unité africaine.
L'examen minutieux de cette charte appelle quelques
observations.
Certes, la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant affirme dès son article 2, qu'on entend par «
Enfant », « tout être humain âgé de
moins de 18 ans ». Elle a ainsi, expressément, fixé
l'âge maximal de l'enfant, le plafond qu'on ne saurait crever, à
dix-sept (17) ans accomplis. Mais curieusement, elle n'a point
réglé le commencement de la vie à telle enseigne que l'on
se demande, à juste titre, si la vie de l'enfant commence avant ou
après la naissance. Fort heureusement, les droits nationaux fixent le
début de cette vie de l'enfant.
En outre, la Charte contient une pluralité de formules
générales et abstraites, voir imprécises comme : «
- Intérêt supérieur de l'enfant (article
4) : S'agit-il de l'intérêt matériel, social, familial ou
financier de l'enfant ?
- L'évolution des capacités de l'enfant (article
9) : S'agit-il de capacités physiques, morales, intellectuelles ou
matérielles de l'enfant ?
- La vie privée de l'enfant (article 10) : à
partir d'où commence cette vie privée de l'enfant, et
jusqu'où s'arrête-t-elle ?
- Le contrôle raisonnable (article 10) : La Charte se
borne à affirmer que les parents gardent le droit d'exercer un
contrôle raisonnable sur la conduite de leurs enfants. Mais, elle ne
précise pas le sens de « contrôle raisonnable
». Alors, à partir de quand le contrôle des parents
devient-il déraisonnable ?
- Les valeurs morales, traditionnelles et culturelles
africaines positives (article 11) :
115
Ces exemples de termes généraux et ambigus peuvent
être multipliés à l'infini. »240.
Comment reconnaitre que de telles valeurs sont positives ou,
au contraire négatives ? Une réponse a été
donnée par le Comité créée par cette charte, le
Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de
l'enfant (CAEDBE) dans sa note d'orientation pour la commémoration de la
journée de l'enfant africain, du 16 juin 2013, note intitulée
« Eliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants :
notre responsabilité collective »241. La liste des pratiques
néfastes que l'on peut trouver partout en Afrique est longue, elle
inclut certaines pratiques relativement bien connues et d'autres moins connues.
Dans la première catégorie, sont inclus les mutilations
génitales féminines, le mariage forcé, le mariage
d'enfants, l'utilisation de dot, les crimes d'honneur et les rites d'initiation
dégradants et nuisibles. Dans la deuxième catégorie, se
trouvent des pratiques néfastes telles que l'uvulectomie, l'extraction
des dents de lait, le « repassage des seins », la
préférence pour l'enfant mâle, l'infanticide des
bébés filles et la sélection prénatale du sexe, les
« tests de virginité », l'offrande des jeunes filles vierges
à des prêtres (Trokosi), le « remplacement » d'une
personne assassinée par une autre personne (enfant), la gavage et les
tabous nutritionnels, les enfants accusés de sorcellerie, de meurtre,
les mutilations et le sacrifice d'enfants pour des organes et des membres
à utiliser dans des rituels de sorcellerie.
On le constate : les droits conventionnellement
consacrés laissent voir que les termes à contenu imprécis
et élastique, notions à contenu variable242 ou encore
termes à géométrie variable et aux effets
aléatoires sont multiples. Cette flexibilité, ou souplesse, qui
caractérise les concepts utilisés montre clairement que les
droits consacrés sont éminemment abstraits. La compétence
des organes juridictionnels ou quasi juridictionnels appelés à
les appliquer s'en trouve, ainsi accrue : ceux-ci apprécieront
discrétionnairement leur sens autant que leur valeur et conditions
d'application.
240 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, l'Harmattan 2015, pp.108-110.
241 CAEDBE, Note d'orientation pour la commémoration de
la journée de l'enfant Africain (JEA) du 16 juin 2013 - «
Eliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant
les enfants : notre responsabilité collective ».
242 GHESTIN (J.), « L'ordre public, notion à
contenu variable, en droit privé français », in Chaim
PERELMAN et Raymond VANDER ELST (Etudes publiées par), Les notions
à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, 1984,
pp.77-97.
116
2. Portée juridique de la CADBE
A la lecture de la Charte, ses effets juridiques s'orientent
vers trois catégories : l'enfant, la famille (parents) et l'État.
Dès lors, le non-respect par une partie de ses obligations devrait
donner lieu à une revendication de la part des autres. Et, on pourrait
se poser la question de savoir comment une partie lésée peut
obliger l'autre partie à respecter ses obligations ?
En ce qui concerne les obligations à la charge des
parents, notamment celles énumérées aux articles 19 et 20,
elles sont obligatoires et leur inobservation peut, le cas
échéant, donner lieu à une répression. Ici,
l'État à qui incombe, en premier lieu, la responsabilité
de prendre « toutes les mesures nécessaires » pour la
mise en oeuvre des droits contenus dans la Charte, peut prendre des mesures de
protection et de répression internes, en guise de représailles
contre les parents. Par exemple, l'État peut mettre en place des mesures
de protection de remplacement qui viseraient à retirer le droit à
l'autorité parentale (ceci en tenant compte de l'intérêt de
l'enfant). Ou encore si le non- respect de l'obligation parentale est dû
à l'absence de moyens des parents, l'État a, dans ce cas,
l'obligation de les aider à assumer leurs devoirs envers l'enfant.
Quant aux obligations qui incombent à l'État
partie, l'enfant, ses parents ou ses représentants légaux peuvent
saisir le juge interne pour constater la violation et appliquer la sanction qui
s'impose. Ceci étant, nous devons relever qu'en ce qui concerne les
droits dits à «réalisation progressive », il
appartiendra au juge interne de déterminer si l'État a
oeuvré dans « la limite des moyens disponibles » afin
de décider de la violation ou non du droit.
Concernant les obligations pesant sur les enfants, le
Professeur Yves Madiot estime que les devoirs mettent « l'individu au
service de la communauté et permettent de justifier toutes les
oppressions. »243 . En effet, si pour tous les africains,
le respect des parents, des personnes âgées et la prise en charge
des parents par l'enfant244, font partie de la culture et de
243 Cf. MADIOT (Y.), Considérations sur les droits
et devoirs de l'homme, Cité par BOUKONGOU (J-D), op.cit., p.103.
244 Sur ce point, la Charte donne l'impression de
s'écarter de la définition qu'elle a donné de l'enfant,
qui se limite à 18 ans. Car en faisant appel aux valeurs culturelles,
elle semble justement ignorer le fait que dans les cultures africaines, la
notion d'enfant est difficile à déterminer. Dans certaines
cultures, par exemple, tant que les parents vivent, l'on est toujours
considéré comme enfant et traité comme tel par eux.
117
l'éducation reçue, ce n'est sans doute pas le
lieu d'ériger ses valeurs en obligations. En effet, si la Charte se veut
un instrument juridique obligatoire, sa violation devrait être
sanctionnée. Dès lors, on pourrait s'interroger sur la pertinence
de ces dispositions. Sauf si, comme l'a mentionné le Professeur Yves
Madiot, elles pourraient servir de prétexte pour justifier
l'impunité en cas de violation de la Charte245.
De ce qui précède, on observe que les enfants
bénéficient de droits reconnus et protégés à
travers des textes spécifiques tant au niveau universel qu'africain
auxquels la Côte d'Ivoire a librement mais tardivement
adhéré. Des accords régionaux et bilatéraux
viennent renforcer ces textes protecteurs des droits de l'enfant, constituant
ainsi des sources juridiques précieuses.
B. A TRAVERS LA SIGNATURE D'ACCORDS REGIONAUX ET
BILATERAUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS
Seront examinés respectivement les accords
régionaux (1) et bilatéraux (2) en matière de lutte contre
la traite des enfants.
1. Les accords régionaux de protection des enfants
contre la traite
Ces accords régionaux sont au nombre de deux : l'accord
multilatéral de coopération en matière de lutte contre la
traite des enfants en Afrique de l'Ouest et l'accord multilatéral de
coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en
particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre.
L'accord multilatéral de coopération en
matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l'Ouest a
été conclu en date du 27 juillet 2005 à Abidjan, capitale
économique de la Côte d'Ivoire246. Les Etats parties
sont : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée,
Libéria, Niger, Mali, Nigéria et Togo. Soit un total de neuf
États signataires247.
245 Cf. MADIOT (Y.), op. cit.
246 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.111.113.
247 Les États signataires de l'accord,
énumérés sont ceux dont les signatures des
représentants figurent sur l'original du document de l'accord. Il est
possible que d'autres États soient parties à l'Accord. En effet,
selon son article 23, l'adhésion est ouverte à tout pays de la
sous-région ouest africaine.
118
Cette importante convention régionale ouest-africaine
compte au total 29 articles : «
- l'article 1 porte sur la définition des expressions
spécifiques utilisées dans l'accord ;
- les articles 2 à 5 énoncent les principes
essentiels de l'accord en réaffirmant l'interdiction de la traite des
enfants, l'obligation de traiter tous les enfants victimes de traite avec
respect et sans discrimination et la recherche de l'intérêt
supérieur de l'enfant et son bien-être ;
- l'article 6 détermine le champ d'application de
l'accord ; Il appert de cet article que l'accord s'applique à la
prévention, la protection, le rapatriement, la réunification, la
réhabilitation, la réinsertion, la répression et la
coopération en matière de traite des enfants ;
- les articles 7 à 11 portent sur les obligations des
États parties. On y distingue des obligations communes248
à toutes les parties et celles particulières249, selon
que l'État partie soit le pays d'origine, de transit ou de destination.
En ce qui concerne les obligations communes, on peut citer, entre autres :
l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour
détecter la traite des enfants, d'élaborer et de mettre en oeuvre
des plans d'action et des programmes de lutte contre la traite des enfants tant
au plan national que régional, de prendre les dispositions
nécessaires pour harmoniser les législations en matière de
traite avec les autres parties, etc. Les obligations particulières du
pays d'origine consistent, entre autres : à mettre en place un
dispositif de rapatriement, de réhabilitation et de réinsertion
de l'enfant victime ; d'identifier les zones d'origine, de transit et les
itinéraires ; de poursuivre et de punir les auteurs et complices de la
traite des enfants etc. En ce qui concerne le pays de transit, il a pour
obligations, entre autres : d'identifier les zones d'origine, de transit et de
destination ; de poursuivre et de punir les auteurs et leurs complices ;
d'organiser, en étroite collaboration avec les autorités
administratives et
248 Cf. Art.7 et 8 de l'Accord multilatéral de
coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en
Afrique de l'Ouest.
249 Cf. art. 9 à 11 de l'Accord multilatéral de
coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en
Afrique de l'Ouest.
119
diplomatiques du pays d'origine, le rapatriement de l'enfant
victime ; d'assurer la prise en charge provisoire de l'enfant victime de traite
avant son rapatriement dans son pays d'origine ; etc. Quant au pays de
destination, il a, entre autres obligations : de retirer immédiatement
l'enfant victime de la situation de traite ; de poursuivre et de punir les
auteurs et leurs complices ; d'organiser le rapatriement de la victime en
concertation avec les autorités du pays d'origine ; de
récupérer et de restituer à la victime les biens,
rémunérations, indemnités et toutes autres compensations
qui lui sont dues ; etc. ;
- enfin, les articles 12 à 22 mettent l'accent sur la
mise en place d'un mécanisme de suivi : la Commission Régionale
Permanente de Suivi (CRPS), dont le secrétariat est basé à
Abidjan. Cet organe a en charge le suivi et l'évaluation des actions
menées par les parties dans la mise en oeuvre de l'accord (à
travers un rapport annuel) et de proposer des approches de solutions aux
problèmes rencontrés par les acteurs de la lutte contre la traite
des enfants. »250
Inspirés par l'accord ouest-africain, des Etats de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont conclu un accord multilatéral de
coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en
particulier des femmes et des enfants.
L'accord de coopération de lutte contre la traite en
Afrique de l'Ouest et du Centre, a été réalisé
à Abuja (Nigéria) le 6 juillet 2006, soit environ un an
après celui adopté à Abidjan pour le compte de l'Afrique
de l'Ouest251. Il a été signé par 26
États252 dont la Côte d'Ivoire. La particularité
de cet Accord réside dans la détermination des objectifs qu'il
vise et la prise en compte de l'entraide judiciaire en matière
pénale au niveau des États parties. Concernant
250 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, Dissertation, zur Erlangung des
Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Bayr, 2013, pp.111.113. ; BELLO (S.), La
traite des enfants en Afrique, L'application des conventions internationales
relatives aux droits de l'enfant en République du Bénin,
L'Harmattan 2015, pp.111.113.
251 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.111.113.
252 Ce nombre correspond au nombre de signatures
apposées sur le document de l'accord qui se trouve en annexe : l'Angola,
le Bénin, le Burkina-Faso, le Burundi, le Cap-Vert, le Cameroun, la
République Centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République
du Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée
Équatoriale, le Libéria, la Mali, le Niger, le Nigéria, le
Rwanda, Sao Tome á Principe, le Sénégal, la Sierra Leone,
la République du Tchad et le Togo.
120
les objectifs, l'Accord vise à développer un
front commun afin de prévenir, supprimer et punir la traite des
personnes par la coopération ; protéger, réhabiliter, et
réinsérer les victimes de traite ; assurer l'entraide dans les
investigations liées à la traite, l'arrestation et la poursuite
des coupables à travers les autorités compétentes de
chaque État partie ; etc. (art. 2). Quant à l'entraide
judiciaire, aux termes de l'article 14 de l'Accord, les États parties
doivent prendre les mesures nécessaires pour s'entraider dans la
recherche, la poursuite et l'arrestation des personnes impliquées dans
la traite des personnes. Dans ce cadre, l'assistance portera sur
l'identification et la localisation des personnes suspectées de traite,
l'identification et la localisation des victimes de traite, le recueil des
témoignages, la signification des actes judiciaires, la perquisition, la
saisie, le gel et la confiscation des produits ou des instruments du crime, le
transfert temporaire des personnes gardées à vue, l'arrestation
et la détention de toute personne impliquée en vue de son
extradition, etc.253
Au-delà des accords multilatéraux au plan
régional, l'État ivoirien a également conclu des accords
bilatéraux avec d'autres États de la sous-région.
2. Les accords bilatéraux contre le trafic
transfrontalier d'enfants
La Côte d'Ivoire a conclu deux accords bilatéraux
en matière de trafic transfrontalier d'enfants avec deux Etats voisins,
à savoir : le Mali et le Burkina-Faso :
- L'accord bilatéral de coopération entre la
République de la CI et la République du Mali en matière de
lutte contre le trafic transfrontalier d'enfants
Les Gouvernements ivoirien et malien ont signé à
Bouaké le 01er septembre 2000, une convention
dénommé « Accord de coopération entre la
République de Côte d'Ivoire et la République du Mali en
matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants
». Cet accord de coopération relatif à la lutte contre
le trafic d'enfants est prévu pour une durée de trois ans
renouvelable. Il est composé d'un préambule et d'un dispositif
composé de 13 articles. Le trafic d'enfant y est défini comme
« l'ensemble du processus par lequel un enfant est
déplacé à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un pays dans les conditions qui le transforment en valeur
marchande pour l'un au moins des adultes en présence et quelle que soit
la finalité du déplacement de l'enfant ; tout acte comportant le
recrutement, le transport, le recel ou
253 BELLO (S.), Ibid.
121
122
la vente d'enfant ; tout acte qui entraine le
déplacement de l'enfant à l'intérieur ou à
l'extérieur du pays »254.
Les articles 2 et 3 consacrent les principes essentiels de cet
accord à savoir : l'interdiction du trafic des enfants sous toutes ses
formes et la prise en compte par les Etats signataires, de
l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes actions en
faveur des enfants victimes de trafic.
Les deux Etats « s'engagent à prendre des
mesures pour lutter contre les déplacements et les non retours illicites
d'enfants à l'étranger »255 . Ils prennent
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit. La commission permanente de Suivi du protocole a été mise
en place près d'un an après la conclusion de l'accord, en raison
des contraintes matérielles qu'elle soulevait, tandis qu'un
différend persiste entre les deux pays sur l'évaluation de
l'ampleur du phénomène de trafic d'enfants maliens en Côte
d'Ivoire.
- L'accord de coopération en matière de
lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte
d'Ivoire et le Burkina
Malgré les dispositions de prévention au niveau
régional, des centaines d'enfants font toujours l'objet de trafic entre
la Côte d'Ivoire et le Burkina. Selon Mme Chantal Compaoré, «
les services de l'enfance au Burkina Faso sont constamment
sollicités pour le rapatriement des victimes de cette traite
»256. Mieux, La Côte d'Ivoire,
premier producteur mondial de cacao, est considérée comme une
importante destination régionale du trafic d'enfants en provenance des
pays frontaliers, notamment le Burkina Faso et le Mali, afin de travailler dans
ses cultures. Il apparaissait donc opportun qu'après le Mali en 2011, la
Côte d'ivoire ait signé, le jeudi 17 Octobre 2013 au centre de
conférence internationale du Ministère des Affaires
Etrangères à Abidjan-Plateau, un accord de coopération
dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants
avec le Burkina Faso. Une volonté manifeste pour ces deux Etats,
d'éradiquer définitivement ce fléau.
Il s'agit d'un accord de coopération engageant les deux
pays à lutter contre la traite croissante des enfants du Burkina Faso
vers la Côte d'Ivoire. On peut se réjouir de la
254 Article 1 de l'accord de coopération entre la
Côte d'Ivoire et le Mali du 01er septembre 2000.
255 Article 11 al.1 de l'accord de coopération entre la
Côte d'Ivoire et le Mali du 01er septembre 2000.
256
http://news.abidjan.net/h/477803.html
(consulté le 10/11/217).
signature de cet accord qui permettra à n'en point
douter, de faire reculer le phénomène. Une initiative
saluée à juste titre par La Présidente du Comité
National de Surveillance (CNS), Mme Dominique Ouattara en ces termes
«J'en suis heureuse car, la mise en commun de nos efforts nous
permettra de combattre beaucoup plus efficacement tous les abus et violences
qui sont quotidiennement faites à de milliers d'enfants dans nos pays.
Parmi ces violences, la traite des enfants est l'une des manifestations les
plus extrêmes, et les plus périlleuses pour leur survie
»257 ; dans le même ordre
d'idées, elle explique le menu des conditions difficiles dans lesquelles
vivent les enfants victimes de traite. « En effet, les enfants qui en
sont victimes sont souvent recrutés et transportés hors de leur
pays où de leur localité d'origine. Ils sont
séparés de leurs familles et isolés dans des
régions où ils ne possèdent pas de statut légal.
Ils vivent souvent dans un état de précarité social
très avancé et n'ont pas accès à
l'éducation, à la santé et au loisir
»258.
Comme on le voit, les signataires fondent un espoir immense
sur la signature de cet accord de coopération pour freiner
définitivement les vagues de trafic des enfants. Reste à
espérer que l'accord constituera un outil efficace d'élimination
du phénomène.
Il ressort de cet accord que, les deux Etats se sont
engagés "à élaborer et mettre en oeuvre des plans
d'actions, des programmes et projets régionaux de lutte contre la traite
des enfants". Le chapitre 1 de cet accord est consacré aux
définitions des termes essentiels de cet accord, à savoir :
enfant, traite des enfants, État d'origine, État de destination,
État de transit, identification, rapatriement, réhabilitation,
réinsertion, répression, prévention, protection,
réunification, coopération. Quant au chapitre 2 de cet accord, il
expose les trois principes essentiels sur lesquels se fonde la convention :
l'interdiction de la traite des enfants259, le traitement avec
dignité et sans discrimination de tout enfant victime de traite
transfrontalière260 et la prise en compte prioritaire du
bien-être, de l'intérêt supérieur et de la
257
http://www.travaildesenfants.org/fr/actualites/la-mise-en-commun-de-nos-efforts-nous-permettra-de-combattre-les-abus-et-violences-faits
(consulté le 10/11/217). 258
http://www.travaildesenfants.org/fr/actualites/la-mise-en-commun-de-nos-efforts-nous-permettra-de-combattre-les-abus-et-violences-faits
(consulté le 10/11/217).
259 Article 2Accord de coopération en matière de
lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte
d'Ivoire et le Burkina.
260 Article 3Accord de coopération en matière de
lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte
d'Ivoire et le Burkina.
123
participation de tout enfant dans toutes actions en faveur des
enfants victimes de traite261. Il ressort de cette convention que
cet accord s'applique à la lutte contre la traite
transfrontalière des enfants notamment dans les domaines de la
prévention, de la protection, du rapatriement, de la
réunification, de la réhabilitation, la réinsertion, la
répression et la coopération262. Le traité
prévoit également des obligations à la charge des
États signataires. Ainsi, distingue-t-on les obligations
communes263 des obligations particulières variant suivant
qu'il s'agisse du pays d'origine264, du pays de
transit265 ou du pays de destination266. Cet accord
prévoit également un mécanisme de suivi appelé
Commission permanente de suivi (CPS).
Il apparait important d'indiquer que ces accords
bilatéraux sont devenus une sorte d'effet de mode entre
différents pays ouest-africains. Ainsi, plusieurs accords de
coopération en matière de lutte contre la traite des personnes
ont été signés entre le Bénin et le
Nigéria267. L'accord de coopération sur « la
prévention, la répression et la suppression de la traite des
personnes en particulier des femmes et des enfants » entre ces deux
pays suscités en est un exemple. Cet Accord a été
signé par les deux parties à Cotonou (Bénin) le 09 juin
2005. Il comporte au total 23 articles dont les articles 1 à 18
déterminent : le sens des termes utilisés268, le but
visé par l'Accord269, le champ d'application, les
modalités d'application de
261 Article 4Accord de coopération en matière de
lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte
d'Ivoire et le Burkina.
262 Article 5Accord de coopération en matière de
lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte
d'Ivoire et le Burkina.
263 Articles 6 et 7Accord de coopération en
matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants
entre la Côte d'Ivoire et le Burkina.
264 Article 9Accord de coopération en matière de
lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte
d'Ivoire et le Burkina.
265 Article 11Accord de coopération en matière
de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la
Côte d'Ivoire et le Burkina.
266 Article 10Accord de coopération en matière
de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la
Côte d'Ivoire et le Burkina.
267 A en croire les données de la brigade de protection de
mineurs, le Nigéria serait la principale destination des enfants
béninois victimes de traite régionale.
268 Article 1 de l'accord de coopération sur «
la prévention, la répression et la suppression de la traite
des personnes en particulier des femmes et des enfants entre le
Bénin et le Nigeria du 09 juin 2005.
269 Article 2 de l'accord de coopération sur «
la prévention, la répression et la suppression de la traite
des personnes en particulier des femmes et des enfants entre le
Bénin et le Nigeria du 09 juin 2005.
124
l'Accord270 ; l'identification, la protection et la
prise en charge des victimes271 ; le rapatriement, la
réhabilitation et la réinsertion des victimes272. Les
articles 19 à 23 quant à eux sont réservés aux
dispositions finales de l'Accord.
Comme on peut le constater, l'Etat de Côte d'Ivoire
marque sa volonté de protéger ses enfants par la conclusion de
divers instruments universels ou régionaux de protection des droits de
l'enfant. Parallèlement à cette étape, ce pays va
s'évertuer à organiser la réception nationale des droits
internationaux de l'enfant.
270 Articles 4 à 11 de l'accord de coopération
sur « la prévention, la répression et la suppression de
la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants entre le
Bénin et le Nigeria du 09 juin 2005.
271 Articles 12 à 15 de l'accord de coopération
sur « la prévention, la répression et la suppression de
la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants entre le
Bénin et le Nigeria du 09 juin 2005.
272 Articles 16 à 18 de l'accord de coopération
sur « la prévention, la répression et la suppression de
la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants entre le
Bénin et le Nigeria du 09 juin 2005.
125
Chapitre II :
LA RECEPTION NATIONALE DES DROITS INTERNATIONAUX
DE
L'ENFANT
La réception, par l'ordre juridique interne, de normes
d'origine externe s'inscrit dans le contexte du pluralisme
juridique273. Ce dernier est la situation dans laquelle des normes
originaires de plusieurs ordres juridiques différents (international,
régionaux, interne) sont susceptibles d'être appliquées sur
un même territoire274. La cohabitation de plusieurs ordres
juridiques imparfaitement intégrés peut ainsi donner lieu
à des contradictions entre plusieurs normes. Ce contexte rend
nécessairement plus difficile le maintien de la cohérence de
l'ordre juridique interne. Dès lors que deux normes sont susceptibles de
s'appliquer à un même objet, la cohérence impose
d'organiser la supériorité de l'une de ces deux normes sur
l'autre275. En effet, chaque ordre juridique, international,
régional (africain, européen, américain ou asiatique) et
interne, se conçoit comme autonome par rapport aux autres276.
Cette volonté d'autonomie conduit à des risques de contradiction
importants. Ainsi, l'ordre juridique interne français se
caractérise par la primauté de sa Constitution sur le droit
international et sur le droit de l'Union européenne277. Mais
le droit international, comme le droit de l'Union, se conçoivent eux
aussi comme supérieurs à l'ordre juridique interne, y compris
à sa Constitution278. Il en résulte une ignorance
partielle entre les ordres juridiques279. « Même si la
Constitution d'un Etat oblige ses organes à faire primer une norme
interne sur tout engagement international contraire, il n'en reste pas moins
que, internationalement, il accepte de voir dans cette attitude un manquement
à ses obligations,
273 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
274 Plus largement, on peut le définir comme l'«
existence au sein d'une société déterminée, de
mécanismes juridiques différents s'appliquant à des
situations identiques » (Jacques VANDERLINDEN, « Vers une nouvelle
conception du pluralisme juridique », RRJ, 1993, p. 573). V. Sally Engle
MERRY, « Legal Pluralism », Law & Society Review, vol. 22,
n°5, 1988, p. 869
275 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
276 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
277 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
278 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
279 Ibid.
126
et à le payer d'une responsabilité
internationale »280. Ainsi, « au regard du droit
international et de la Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de
simples faits »281, et il en va de même pour les
Constitutions nationales282. La situation est la même en ce
qui concerne le droit de l'Union qui affirme sa primauté sur l'ordre
interne283.
La réception du droit international des droits de
l'enfant en Côte d'Ivoire met en présence deux logiques dans ce
pays. La première relève de la dynamique exogène de la
matière qui implique qu'un corps de règles formalisé dans
un cadre extérieur à l'Etat s'impose dans l'ordre juridique
national. La seconde, quant à elle, porte sur l'assimilation de ce droit
dans la production normative nationale, afin de lui faire produire l'effet
escompté. Les instruments juridiques nationaux sont des lois qui
relèvent de « l'expression de la volonté
générale»284 des ivoiriens. Étant la
manifestation de la volonté populaire, ces textes sont pour certains
adoptés par le peuple ou législateur, tandis que d'autres tirent
leur origine du système colonial. En effet, le système juridique
ivoirien s'est basé en grande partie sur le droit civil
français285. En Côte d'Ivoire,
l'antériorité de certaines lois ivoiriennes à l'adoption
de la CIDE montre que les pouvoirs publics ivoiriens se sont
intéressés assez tôt à la protection des droits de
l'enfant. De sorte que, depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire
a eu à coeur la question des droits de l'enfant au même titre que
celle des droits humains. Cela transparaît non seulement à travers
une progressive reconnaissance constitutionnelle des droits de l'enfant
(Section I) mais aussi par des mesures d'application
législative et réglementaire (Section II).
280 COMBACAU (J.), « Le droit international : bric à
brac ou système ? », APD, t. 31, 1986, p. 95.
281 CPJI, arrêt n° 7 du 25 mai 1926, affaire des
intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, rec.
série A, n° 27, p. 19.
282 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
283 BETAILLE (J.), Les conditions juridiques de
l'effectivité de la norme en droit public interne, Thèse de
doctorat, Université de Limoges, 2012, p.73.
284 TERRE (F.), Le juriste et le politique, trente ans de
journalisme au Figaro, Editions Dalloz, 2003, p. 30.
285 KOUABLE GUEU (C.), « The Legal System in Côte
d'Ivoire : Where Do We Stand ? », avril 2009, disponible en ligne
sur
www.nyulawglobal.com/globalex/Cote_dIvoire.htm#_2._The_Organization
(consulté le 25/10/ 2014).
127
Section I : UNE PROGRESSIVE CONSTITUTIONNALISATION DES
DROITS DE L'ENFANT
Deux types de données permettent de prendre la mesure
du sort et de l'importance de la reconnaissance constitutionnelle : le mode de
reconnaissance des droits et le lieu de formulation. Ces techniques de
consécration ont évolué dans le but d'affirmer «
non pas des droits et des libertés nominaux, proclamés et
figés dans leur splendide abstraction(...), mais plutôt des droits
et des libertés aspirant à la vie, destinés à
être concrétisés, vécus, utilisés
»286. Ainsi, il est apparu que le constituant a voulu
accorder une place primordiale aux droits de l'homme-enfant d'abord en
déplaçant le site constitutionnel des droits, et ensuite en
affirmant les droits dans un souci d'assurer leur effectivité.
Partant, la constitutionnalisation des droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire est perceptible tant au niveau des formes de reconnaissance
des droits de l'enfant (Paragraphe1) que des techniques de consécration
(paragraphe 2).
§ 1. UNE EVOLUTION DES FORMES DE RECONNAISSANCE
DES DROITS DE L'ENFANT
Avant d'en arriver à la constitutionnalisation à
proprement parler des droits de l'enfant, il importe de présenter avant
tout, le statut de la constitution dans le droit des droits de l'homme de
façon générale (A). Après quoi, nous
démontrerons successivement, l'implicite reconnaissance des droits de
l'enfant à travers les deux constitutions (B) et la consécration
expresse de la protection de l'enfant en tant que personne vulnérable
sous les Constitutions du 1er Août 2000 et de novembre 2016
(C).
A. LE STATUT DE LA CONSTITUTION DANS LE DROIT DES
DROITS DE L'ENFANT
La constitutionnalisation de la protection de l'enfant
procède de ce que la protection de l'enfant a eu un écho
favorable dans la constitution ivoirienne ; si avant l'adoption de la
Constitution de 2016, certains auteurs affirment que la Côte d'Ivoire a
acquis trois (03)
286 OLINGA (A.D), « L'aménagement des droits et
libertés dans la constitution camerounaise révisée
», RUDH du 31 Octobre 1996, vol. 8, p.117.
128
constitutions287, il convient d'analyser seulement
les deux (03) dernières, à savoir celle de 1960, de 2000 et 2016
qui sont du reste celles adoptées depuis l'indépendance du pays.
Avant d'entrer dans le fond, il convient de définir la notion de
Constitution. La définition de la Constitution nécessite
nécessairement de distinguer la définition matérielle de
celle formelle. Au sens matériel, la Constitution se définit
comme « l'ensemble des règles quelle que soit leur nature ou
leur forme relatives aux principaux organes de l'État, à leur
désignation, à leur compétence et à leur
fonctionnement »288. Au sens formel, la Constitution est
un document rédigé ou révisé selon une
procédure spéciale, c'est une loi spéciale au-dessus des
lois ordinaires, avec une procédure d'élaboration et de
révision qui est tout aussi spéciale a contrario des
lois ordinaires289.
La Constitution d'un pays, c'est le document de base, l'acte
juridique fondamental qui, dans un État, consacre, d'une part,
l'existence des droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d'autre
part, l'aménagement du pouvoir politique nécessaire au
fonctionnement de l'État.
De plus, comme l'écrit si pertinemment le Professeur
Francis Delpérée, « Au commencement du droit est la
Constitution...La constitution, c'est la règle juridique qu'une
société politique qui s'organise en État se donne pour
permettre la réalisation du bien public. A cette fin, elle
établit en premier, les droits et les devoirs qui reviennent aux membres
de la société politique. Elle détermine également
les règles d'aménagement des pouvoirs publics.
»290.
Afin d'appréhender l'importance de la Constitution dans
les Droits de l'homme et spécialement les droits de l'enfant, il
convient de déterminer les fonctions de la Constitution, qui sont au
nombre de deux : La première qui concerne l'encadrement des pouvoirs
publics a peu d'intérêt dans cette étude ; Pour être
intéressante et appropriée dans le cadre de notre étude,
la deuxième acception définit l'ordre social qui doit être
promu par les pouvoirs
287 NDRI-TEHOUA (P.), « Constitution et démocratie
en Côte d'Ivoire », in RISJPO, mai 2014, PUB, p. 45, p.p.
43-72. Dans son article paru dans la presse universitaire de Bouaké
avant l'adoption de l'actuelle Constitution en vigueur, l'auteur affirme que la
Côte d'Ivoire, en plus de sa constitution de 2000 a eu 2 premières
Constitutions, celle de 1959 et celle de 1960.
288 MELEDJE DJEDJRO (F.), Droit constitutionnel,
édition ABC, 2013, p. 38.
289 NDRI-TEHOUA (P.), Op. cit ., p. 43.
290 DELPEREE (F.), Le droit constitutionnel de la
Belgique, Bruxelles-Paris, Bruyant-L.G.D.J., 2000, p.11
129
publics ainsi que les droits reconnus aux
individus291. Un des objectifs principaux de la Constitution d'un
État, c'est donc la détermination des droits, des
libertés, voire des devoirs des membres de la société
étatique qu'elle est appelée à régir. On ne
conçoit pas une Constitution moderne sans un chapitre, voire un titre
consacré aux droits de l'homme.
En droit interne, la Constitution, est la première
source du droit. C'est par rapport à elle que toutes les autres sources
des droits de l'enfant doivent être interprétées. C'est
à elle qu'on recourt en premier lieu pour justifier, défendre ou
revendiquer un droit, une liberté. D'ailleurs, historiquement, tous les
droits et libertés ont, de tout temps, été de statut
constitutionnel.
Il en découle qu'en matière de droits de
l'enfant, la Constitution, tient la première place dans la
hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique
fondamentale ; « C'est elle qui procure au groupe social toutes les
conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de
défense et de protection des droits de l'homme
»292.
En Côte d'Ivoire, la protection les droits de l'enfant
au niveau constitutionnel, n'a de tout temps pas été
expressément proclamée. Les Constitutions ivoiriennes ont connu
une évolution significative en matière de protection des droits
humains293 et particulièrement en ce qui concerne la
protection des droits de l'enfant. En effet, si les droits reconnus aux enfants
sous la Constitution de 1960 étaient à rechercher dans la
reconnaissance constitutionnelle générale des droits de l'homme,
les différentes Constitutions du 1er Aout 2000 et du 08
novembre 2016, font un point d'honneur aux droits de l'enfant en les visant
expressément. Il apparait donc nécessaire de démontrer
successivement la reconnaissance des droits de l'enfant qui s'est faite de
façon implicite par la Constitution de 1960, puis, leur reconnaissance
expresse par les Constitutions de 2000 et 2016.
291 NDRI-TEHOUA(P.), Op. Cit, p. 43.
292 Idem.
293 NDRI-TEHOUA (P.), Op. Cit., p. 49.
130
B. UNE RECONNAISSANCE IMPLICITE DES DROITS DE L'ENFANT
SOUS LE PRISME DE LA PROTECTION GENERALE DES DROITS DE L'HOMME DANS LA
CONSTITUTION DE 1960 : UN RENVOI AUX GRANDES DECLARATIONS DE DROITS
Les deux grandes déclarations auxquelles le
Préambule de la Constitution du 03 Novembre 1960 renvoie sont : la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la
déclaration universelle de 1948. La première est une
déclaration française tandis que la seconde est une
déclaration onusienne. Un examen respectif de ces deux renvois s'impose
à l'attention, en relevant leurs liens avec la protection des droits de
l'enfant. La DUDH ayant été examiné dans le chapitre
précédent, seule la déclaration des droits de l'homme et
du citoyen (DDHC) sera examinée dans les lignes suivantes.
Par le jeu du renvoi à la DDHC, la Constitution
ivoirienne imprime à la DDHC, une valeur constitutionnelle et fait
d'elle une source de protection des droits de l'homme-enfant ; la DDHC consacre
des droits civils et politiques. Toutefois, cette consécration de droits
emporte des limites.
L'ensemble des droits consacrés, s'articule autour de
deux idées forces : la liberté et l'égalité,
premiers de tous les droits de l'Homme, selon l'expression du Professeur Jean
RIVERO294. Avant de les examiner, il convient d'apporter quelques
précisions sur la dualité « droits de l'homme-droits du
citoyen » qui affleure dans cette déclaration.
La dualité « droits de l'homme et droits du
citoyen » incline à opérer deux grandes distinctions,
à savoir : d'une part, les droits de l'homme et les droits du citoyen ne
sont pas sur le même plan ; d'autre part, l'homme ne saurait se confondre
au citoyen. En fait, une ligne invisible, constituant une différence
qualitative, sépare aussi bien l'homme et le citoyen que les droits de
l'homme et les droits du citoyen295.
Pour bien comprendre la question, il faut déjà
pouvoir distinguer les droits du citoyen de ceux de l'homme. Les premiers sont
les droits que possède toute personne en vertu des lois de l'État
dans lequel il vit. Les seconds sont les droits imprescriptibles de la personne
humaine. Ils peuvent, à ce titre, servir de règle aux
précédents, et se caractérisent par leur
294 RIVERO (J.), Les Libertés Publiques, op.cit.
, p.66.
295 KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Thèse unique de doctorat en droit public,
Université de Cocody, UFR SJAP, 2008, Tome 1, p.109.
131
valeur universelle. Les droits du citoyen, eux varient selon
les législations et la nature des États.
Logiquement, les droits du citoyen se rangent à un
étage inférieur par rapport aux droits de l'homme. En effet,
l'homme est avant tout un être présocial et pré juridique
en ce sens qu'il préexiste à la société et au
droit. Il se différencie, ainsi du citoyen qui est un être
situé dans la société constituée, ou dans la
société organisée. Celui-ci est, dans ces circonstances,
conditionné et subordonné à l'Etat, la
société des sociétés296, tandis que
celui-là est antérieur et même supérieur.
Dans un tel schéma, les droits de l'homme ressortissent
de manière évidente, au droit naturel, contrairement aux droits
du citoyen qui relèvent du droit positif. Droits innés, les
droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine. En tant que
tels, ils sont inviolables et sacrés et s'imposent au pouvoir politique
auquel ils préexistent. Ce sont des droits inconditionnels, voire
inconditionnés, par rapport et par opposition aux droits du citoyen qui
sont des droits conditionnés et limités au triple plan
géographique, temporel et politique. En clair, ceux-ci sont à la
merci de l'Etat, de chaque Etat, dont ils procèdent et auxquels ils sont
subordonnés.
Selon une analyse fort admirable du Professeur Jean RIVERO,
« Les droits de l'Homme sont des libertés. Ils permettent
à chacun de conduire sa vie personnelle comme il l'entend. Ils lui
confèrent une sphère d'autonomie dans laquelle la
société ne peut s'immiscer (...) Les droits du citoyen sont des
pouvoirs : ils assurent la participation de tous à la conduite de la
cité(...). Cette distinction correspond en réalité,
à deux conceptions différentes de la liberté, que Benjamin
Constant a systématisées en opposant la liberté politique
ou liberté des Anciens, à la liberté civile, ou
liberté des Modernes (...). Dans la Déclaration, les deux
catégories, loin de s'opposer, sont indissociables : seule la
reconnaissance des droits du citoyen peut, dans la société
politique, assurer la conservation des droits de l'homme
»297.
Eu égard à son statut particulier, le citoyen
bénéficie de droits particuliers que lui accorde la
Déclaration ; ce sont :
296 GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions
politiques, op.cit., p.5.
297 RIVERO (J.), Les Libertés publiques, op. cit.
, p. 60.
132
- le droit pour chaque citoyen de concourir, personnellement
ou par ses représentants, à la formation de la loi 298;
- Le droit pour tout citoyen de parler, d'écrire,
d'imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la
loi299;
- L'égalité devant l'impôt : une
contribution commune doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés300 ;
- Le droit pour chaque citoyen de constater, soi-même ou
par ses représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée301.
A l'opposé, les autres dispositions de la DDHC sont
d'application immédiates et sont réservées à
l'homme, à tout homme, c'est-à-dire tout être humain y
compris les enfants. A titre illustratif, on peut citer quelques droits
fondamentaux consacrés par le célèbre texte
français de 1789 au profit de l'homme, de la femme , de l'enfant, de la
fille , du garçon , etc : la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression qui sont
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme (article 2), la
présomption d'innocence (article 9), la liberté de religion et
d'opinion (article 10), la libre communication des pensées et des
opinions qui constitue l'un des droits les plus précieux de l'homme
(article 11), etc.
Les droits de l'homme sont les droits fondamentaux de l'homme,
antérieurs à la société. Les droits du citoyen, en
revanche, ont cours seulement dans la Cité. Ils ne se recoupent donc
pas, et l'on peut les distinguer au plan intellectuel, comme on vient de le
faire.
Comment dès lors, comprendre la question : «
Peut-on considérer les droits de l'homme indépendamment de ceux
du citoyen ? » On peut l'interpréter ainsi : s'ils peuvent se
concevoir indépendamment l'un de l'autre, peuvent-ils exister l'un sans
l'autre ? Quels droits pour le citoyen, s'ils ne reposent pas sur la
déclaration des droits de l'homme ?A l'inverse, que serait cette pure et
simple déclaration sans les droits réels du citoyen qui lui
298 Article 6 DDHC.
299 Article 11 DDHC.
300 Article 13 DDHC.
301 Article 14 DDHC.
133
donnent chair ? Cette question revient à
l'interrogation que posait déjà Marx au siècle dernier :
quel est donc cet « homme des droits de l'homme ? »302.
Au XVIIe siècle, la perspective a
considérablement changé. L'existence politique n'est pas
inhérente à l'homme. On pense que la cité est une
création des hommes, antérieurement à quoi les individus
étaient censés vivre dans un état de nature. Cet
état n'a probablement jamais existé, mais il permet aux
philosophes de poser un nouveau rapport à la cité dans lequel les
individus sont premiers.
A la vérité, les droits du citoyen constituent
un complément, autant qu'un adjuvant, des droits de l'homme en ce sens
qu'ils complètent, enrichissent et même améliorent les
droits de l'homme qui leurs sont antérieurs. Au fond, droits de l'homme
et droits du citoyen sont indivisément et inextricablement liés.
En effet, les droits de l'homme se prolongent toujours sous l'aspect des droits
du citoyen car la quête des droits fondamentaux en faveur de tout homme
ne peut être dissociée de celle du citoyen. Il en va ainsi de la
liberté-autonomie qui se prolonge sous la forme de la
liberté-participation.
Indivisibles, les deux types de droits sus-analysés,
évoquent l'idée de liberté, droit primordial. On connait
cette pensée édifiante de RIVAROL qui disait à la fin du
XVIIIe siècle : « On mènera toujours les peuples avec
deux mots, ordre et liberté : mais l'ordre vise au despotisme, et la
liberté à l'anarchie. Fatigués du despotisme, les hommes
crient à la liberté ; froissés par l'anarchie, ils crient
à l'ordre. L'espèce humaine est comme un océan, sujette au
flux et reflux : elle se balance entre deux rivages qu'elle cherche et fuit
tour à tour, en les couvrant sans cesse de ses débris.
»303 .
A la vérité, il y a, aujourd'hui, sur tous les
points de la planète une méfiance, voir une lutte, de plus en
plus grande à l'égard des autorités publiques, qui,
appelées à faire régner l'ordre, se bornent souvent
à confisquer et à violer la liberté, toute liberté.
Or, premier de tous les Droits de l'Homme, la liberté préexiste
et s'impose à tout pouvoir politique et
302 MARX (K.), La question juive [1843], Paris, Union
générale d'éditions, 1968, p.37. ; NOLLEZ-GOLDBACH (R.),
Quel homme pour les droits ? Les droits de l'homme à
l'épreuve de la figure de l'étranger, Paris : CNRS
éditions, 2015, 327 p.
303 RIVAROL cité par JEAN GICQUEL, Droit
constitutionnel et institutions politiques, op. cit. p.28. ; Antoine de
RIVAROL, Discours préliminaire du Nouveau dictionnaire de la langue
française, Facultés intellectuelles et de ses idées
premières et fondamentales ; suivi de De l'Universalité de la
langue française, Berlin, 1785, vol.1, p.219.
134
étatique et, par conséquent, mérite
d'être reconnue et respectée par les autorités publiques.
On comprend, dès lors, que la Constitution de la Première
République Ivoirienne (Constitution de 1960) ait consacré ce
droit fondamental en se référant à la Déclaration
française de 1789 dont l'article 1er dispose : « Les
Hommes naissent et demeurent libres ». A bon droit, le Professeur
Jean RIVERO estime que cette prérogative inaliénable «
trouve son fondement dans la nature »304. L'article 2
de cette Déclaration ajoute : « Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté, et la résistance à l'oppression. »
. Il s'ensuit que de cette notion générale de liberté,
toile de fond, se détachent naturellement d'autres droits, ou
libertés particulières, que déduit et consacre
expressis verbis la Déclaration, à savoir : la
sûreté ou liberté individuelle ; la liberté
d'opinion ; la liberté religieuse ; le droit de propriété
et la résistance à l'oppression.
Cependant, en Côte d'Ivoire la question de la force
juridique de la DDHC ne se pose pas ; tout comme dans les autres pays
africains, celle-ci l'a dès son indépendance incorporée
dans son ordonnancement juridique305. En effet, la
constitutionnalisation, ce que le Professeur Guggenheim a appelé «
l'individualisation »306 de la norme internationale
introduit directement la norme. Cette individualisation légitime la
déclaration de sorte qu'elle soit opposable à toutes les
autorités publiques nationales. Elle peut se faire par
l'intégration de la norme internationale dans un texte de loi.
Le renvoi à ces instruments juridiques réclame
leur application dans l'ordre juridique interne. C'est dans cette même
veine, que s'accordant avec l'auteur précédent, Jean Pierre
ROUGEAUX, pense que le renvoi conduit à l'incorporation de la norme
objet du renvoi dans le système renvoyant307. Cette analyse
nous permet de dire qu'à travers son préambule, l'Etat de
Côte d'Ivoire reconnaît des droits à l'ensemble des citoyens
vivant sur son territoire et particulièrement à l'enfant, qui par
ce jeu, bénéficie en bonne logique juridique, de tous les droits
affirmés dans la DDHC. Il est donc important d'affirmer que certes,
la
304 Cela se justifie par ceci que les hommes naissent libres.
305 Voir le préambule de la constitution de 1960.
306 DAILLIER (P.), FORTEAU (M.) et PELLET (A.), Droit
international public, Paris, L.G.D.J-Montchrestien, 2009, p. 726.
307 ROUGEAUX (J-P), Renvois du droit international au
droit interne, R.G.D.I.P., 1977, p. 362. In TURGIS (S.).
135
Constitution de 1960 ne mentionne pas de façon
précise les droits de l'enfant ; toutefois, son renvoi à la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et à la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) à travers
son préambule ayant valeur constitutionnelle308, offre
d'affirmer que la reconnaissance des droits de l'homme et de l'enfant, in
fine, y est stipulé de façon implicite.
A l'instar du préambule, le corps de la Constitution
ivoirienne du 03 novembre 1960 ne se réfère pas explicitement aux
droits de l'enfant. Mieux, elle n'emploie à aucun moment les termes
enfant ou droits de l'enfant. Elle contient quelques droits fondamentaux, qui
plus est, sont timidement exprimés. Ce mutisme du corps de cette
Constitution sur la question des droits de l'enfant signifie-t-elle que les
enfants et leurs droits sont totalement ignorés ? Une affirmation
péremptoire sur la question serait excessive.
En effet, l'enfant étant un homme avant d'être
cet être singulier appelé « enfant », il
apparait opportun de déduire que l'enfant bénéficie des
droits de l'homme laconiquement affirmés dans le corps de la
Constitution, dans les limites fixées par le législateur. Ces
droits de l'homme se trouvent disséminés dans le corps de cette
Constitution. Il s'agit essentiellement :
- Du droit de vote : « le suffrage est universel,
égal et secret. Sont électeurs dans les conditions
déterminés par la loi, tous les nationaux ivoiriens majeurs, des
deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques
»309 ;
- La sureté individuelle : « Nul ne peut
être arbitrairement détenu. Tout prévenu est
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été établie à la suite d'une procédure lui
offrant les garanties indispensables à sa défense.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de principe dans les conditions prévues par la loi
»310 ;
308 Voir Arrêt société Eky, CE du 12
février 1960, « si la constitution a attribué
compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer les
contraventions et les peines assorties, c'est par dérogation au principe
général énoncé à l'article 8 de la
déclaration des droits de l'homme à laquelle se
réfère le préambule et qui prescrit le caractère
légal des peines (nulla poena sine lege). Si donc seul le
constituant peut déroger à un tel principe dans le
préambule c'est que ce texte a valeur constitutionnelle. ».
309 Article 5 de la constitution ivoirienne du 03 Novembre
1960.
310 Article 61 de la constitution ivoirienne du 03 Novembre
1960.
136
- La liberté de pensée et d'opinion (ou
liberté de conscience) : « la République de Côte
d'Ivoire est laïque »311 ; « elle respecte
toutes les croyances »312 ;
- La liberté religieuse déjà
affirmé à l'article 2 est aussi déductible des
dispositions de l'article 6 libellé comme suit : « elle
respecte toutes les croyances » ;
- La liberté de formation des partis politiques et
d'exercice de leur activité : « Les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement sous la condition de respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et
les lois de la République »313.
Il suit de ce qui précède que moins d'une
dizaine d'articles de cette Constitution ivoirienne de 1960, est
consacré aux droits de l'homme. En raison de leur importance, les droits
de l'homme auraient dû être énoncés de façon
détaillé et claire, car comme le mentionne MOUNIER : «
Pour qu'une Constitution soit bonne , il faut qu'elle soit fondée
sur les droits de l'homme et qu'elle les protège évidemment
,
· il faut donc, pour préparer une constitution,
connaître les droits que la justice naturelle accorde à tous les
individus ,
· il faut rappeler tous les principes qui doivent former la
base de toute espèce de société et que chaque article de
la Constitution puisse être la conséquence d'un principe
»314.
Généralement, la consécration
constitutionnelle des droits humains dans son corpus donne plus de force
à ces droits d'autant plus que cette parcelle de la constitution
bénéficie d'une valeur juridique incontestable. Il est donc clair
que la discrétion du corps de la Constitution ivoirienne de 1960 est
infondée. Mieux elle inquiète. En effet, il revient à la
Constitution, et, plus précisément au corps de la Constitution
d'énoncer avec netteté, le champ de compétences des
gouvernants et l'étendue des droits des gouvernés. Une telle
précision des libertés publiques et une limitation
subséquente de la puissance de l'État auraient pu permettre
d'assurer une meilleure protection, à tout le moins, formelle du citoyen
ivoirien, de toute personne, y compris les enfants, vivant sur le sol ivoirien.
Or, aucun titre entier ni aucune section entière de la Constitution de
1960 n'a été consacré aux droits humains ; pire, aucun
article ne réfère clairement aux droits de l'enfant ; cela
est,
311 Article 2de la constitution ivoirienne du 03 Novembre
1960.
312 Article 6de la constitution ivoirienne du 03 Novembre
1960.
313 Article 7de la constitution ivoirienne du 03 Novembre
1960.
314 MOUNIER cité par Marcel PRELOT, in Encyclopaedia
Universalis, op. cit. , p.710.
137
incontestablement, source d'inquiétudes. Cette
inquiétude sera relativement dissipée grâce à la
Constitution de 2000 et l'actuelle Constitution de 2016 actuellement en vigueur
qui mentionnent les droits de l'enfant.
C. UNE RECONNAISSANCE EXPRESSE DE LA PROTECTION
SPECIFIQUE DE L'ENFANT EN TANT QUE PERSONNE VULNERABLE
A l'opposé de celle de 1960, les Constitutions de 2000
et de 2016 vont jusqu'à constitutionnaliser la protection de l'enfant en
Côte d'Ivoire (CI). La consécration d'un titre sur les droits et
libertés est devenue une constante dans les différents textes
constitutionnels africains. Les constituants ivoiriens de 2000 et de 2016 n'ont
pas fait exception à cette règle. Ainsi, contrairement à
la première Constitution de la Côte d'Ivoire indépendante,
les constituants de 2000 et de 2016 marquent leur attachement aux droits de
l'homme par la définition des droits et libertés dans le corpus
de la Constitution. Cette constitutionnalisation montre les valeurs
prononcées que la Constitution de 2000 et la nouvelle Constitution de
2016 accordent à ces droits et libertés. Elles attachent plus
d'importance à la protection de l'enfant en prévoyant des
dispositions spécialement dédiées aux enfants. Tel est le
cas de l'article 6 de la Constitution de 2000 qui dispose en ces termes :
« L'État assure la protection des enfants ». Il en
est ainsi également de l'article 32 de la Constitution du 08 novembre
2016 qui dispose : « L'Etat s'engage à garantir les besoins
spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures
nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des
enfants...Il s'engage à garantir l'accès des personnes
vulnérables aux services de santé, à l'éducation,
à l'emploi, à la culture, aux sports et aux loisirs. »
Consacrant explicitement une place importante de l'enfant dans la Constitution,
le législateur ivoirien entend montrer son intérêt pour
l'enfant. Il va plus loin en insistant sur le devoir de protection que
l'État doit assurer à la famille qui concourt au
développement de la personnalité de l'enfant. Celle-ci
étant essentielle pour l'épanouissement de celui-ci. Même
si on pourrait objecter l'insuffisance de cette reconnaissance du fait que le
droit à la protection de l'enfant est reconnu dans un seul article de la
Constitution de 2000, il serait intéressant de relativiser cette
conception.
En effet, les articles 5 et 8 de la Constitution de 2000, puis
les articles 31 de la Constitution de novembre 2016 viennent appuyer les
articles 6 et 32 précités, montrant ainsi, l'intérêt
que le législateur a pour la famille : un intérêt
nécessaire au développement
138
harmonieux de l'enfant. La norme suprême ivoirienne
montre que la protection de l'enfant est fondamentale pour la
société, en la constitutionnalisant.
La Constitution ivoirienne de 2016, à l'instar de sa
devancière de 2000, reconnait l'importance de la famille, la
responsabilité de l'État et des collectivités publiques
dans la promotion du bien-être de l'enfant. La Constitution
établit les principes de base pour le système de protection de
l'enfant, élaborant les obligations des familles, de l'État, et
des collectivités publiques pour le bien-être des enfants sur le
territoire national. Elle indique que la famille constitue l'unité de
base de la société, et l'État assure sa protection. Elle
garantit la protection de l'État pour certains groupes
vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et
les personnes porteuses d'handicap315. La Constitution ivoirienne du
1er Aout 2000, indique en son article 8 que : « L'État et les
Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement
de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son
éducation civique et morale et lui assurent la protection contre
l'exploitation et l'abandon moral ».Ce devoir de l'Etat envers la
jeunesse est également reprise à l'article 34 de la Constitution
du 08 novembre 2016 en ces termes : « La jeunesse est
protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre
toutes les formes d'exploitation et d'abandon. L'Etat et les
collectivités publiques créent les conditions favorables à
l'éducation civique et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les
mesures nécessaires en vue d'assurer la participation de la jeunesse au
développement social, économique, culturel, sportif et politique
du pays. Ils aident les jeunes à s'insérer dans la vie active en
développant leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique,
physique et créatif.» Comme on le voit, ces deux
dernières Constitutions ivoiriennes font mieux que la première de
1960 en ce qu'elles consacrent certains articles à la protection des
enfants et non à leurs droits. Toutefois, la Constitution ivoirienne de
2000 apparaissait moins précise sur certains points lorsque l'on tente
de la confronter à la Constitution de certains États tels le
Benin et le Togo. En effet, les articles 12 et 13 de la Constitution
béninoise concernent spécifiquement les enfants et de
façon singulière leur éducation ; alors que l'article
12316 consacre la garantie de l'éducation des
315 Article 6 Constitution Ivoirienne du 1er Aout
2000 ; Article 32 Constitution ivoirienne du 08 Novembre 2016.
316 Article 12 Constitution Béninoise du 11
décembre 1990 :« L'Etat et les collectivités publiques
garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions
favorables à cette fin ».
139
enfants et les conditions nécessaires pour y parvenir,
l'article 13317 de cette loi fondamentale béninoise,
établit, les principes selon lesquels l'État pourvoit à
l'éducation des enfants par les écoles publiques, l'école
primaire est obligatoire et l'enseignement public est gratuit. De même,
l'article 40 précise que l' « État doit intégrer
les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation
et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et
dans tous les programmes des Forces Armées, des forces de
sécurité publique et assimilés ». Cette
constitutionnalisation de l'enseignement des droits de la personne humaine, y
compris les droits de l'enfant, est une avancée notable du Bénin
par rapport à la Côte d'Ivoire, du moins, avant l'adoption de la
Constitution du 08 novembre 2016. De même, la Constitution togolaise
surprend agréablement en établissant l'enseignement primaire
obligatoire et en instaurant une gratuité progressive, elle va
jusqu'à donner un âge obligatoire de fin de
scolarité318. Elle se distingue aussi des autres par la
suppression de discrimination existante entre l'enfant légitime et
l'enfant illégitime319. Fort heureusement, la nouvelle
Constitution ivoirienne de 2016 vient corriger cette lacune en reconnaissant en
son article 10 que : « L'école est obligatoire pour les enfants
des deux sexes dans les conditions déterminées par la loi. L'Etat
et les collectivités publiques assurent l'éducation des enfants.
Ils créent les conditions favorables à cette
éducation... ». Aussi, suivant l'article 28 de ladite
constitution, « L'Etat prend les mesures nécessaires pour
intégrer la Constitution, les droits de l'homme et les libertés
publiques dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires ainsi
que dans la formation des forces de défense et de
sécurité, et des agents de l'Administration. »
En sus, la responsabilité paternelle de l'État
apparait comme le paradigme de la fondation du système ivoirien. Aux
termes de l'article 16 de la Constitution de 2016 : « le travail des
enfants est interdit et puni par la loi. Il est interdit d'employer l'enfant
dans une activité qui
317 Article 13Constitution Béninoise du 11
décembre 1990 : « L'Etat pourvoit à l'éducation de la
Jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est
obligatoire. L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement
public. ».
318 Article 35 Constitution Togolaise adoptée le 27
septembre 1992, révisée par la loi n°2002-029 du 31
décembre 2002 « L'Etat reconnait le droit à
l'éducation des enfants et crée les conditions favorables
à cette fin. L'école est obligatoire pour les enfants des deux
sexes jusqu'à l'âge de quinze (15) ans.
L'Etat assure progressivement la gratuité de
l'enseignement public. ».
319 Article 31 al.2Constitution Togolaise adoptée le 27
septembre 1992, révisée par la loi n°2002-029 du 31
décembre 2002 : « Les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale
et sociale ».
140
le met en danger ou qui affecte sa santé, sa
croissance ainsi que son équilibre physique et mental ».
En effet, une lecture minutieuse de tous ces articles offre de
conclure que l'enfant est supporté par l'État ivoirien pas
seulement pour sa condition d'enfant mais aussi pour le sentiment qu'un enfant
est un futur citoyen.
En tout état de cause, avec la Constitution de 2016, on
note que la Côte d'Ivoire sort progressivement de sa réserve en
instaurant dans sa loi fondamentale plus de dispositions consacrées aux
droits de l'enfant. Cependant, malgré l'insuffisance de cette
reconnaissance constitutionnelle, il convient de relativiser cette conception
car cette consécration constitutionnelle traduit que les droits de
l'enfant sont une donnée fondamentale en Côte d'Ivoire.
Au-delà de ce qui précède,
l'évolution des techniques de consécration justifie aussi cette
progressive constitutionnalisation des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire.
§ 2. UNE EVOLUTION DES TECHNIQUES DE CONSECRATION
DES DROITS DE L'ENFANT
Le lieu d'énonciation des droits de l'enfant est
révélateur de la valeur que les constituants veulent accorder
à la proclamation des droits et libertés. C'est sonder l'esprit
du constituant. Le Professeur Maurice KAMTO, conseille avec raison de
rechercher avant toute chose, l'endroit où sont affirmés les
droits parce que la « détermination du lieu
d'énonciation des droits dans les constitutions africaines est une
étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique ; car avant
même de s'interroger sur leur contenu et leur garantie effective, il faut
s'assurer déjà qu'il s'agit de normes juridiques
»320. Rechercher le siège des droits
énoncés, c'est chercher le degré de juridicité des
droits évoqués.
S'il était possible de douter, de la valeur des normes
proclamant les droits dans les anciennes Constitutions, une chose est certaine
avec les nouvelles Constitutions : elles ont voulu établir avec
certitude l'assise juridique des droits de l'enfant proclamés. En
effet,
320 KAMTO (M.), L'énoncé des droits dans les
Constitutions des Etats africains, Revue juridique africaine 1991,
vol.1-2, p.12. Dans le même sens, voir PHILIPPE (X.),
L'émergence de la protection et du contrôle des droits
fondamentaux en Afrique australe, in J-Y. MORIN (sous la direction),
les droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.325.
141
l'examen des constitutions africaines adoptées à
partir des années 1990 fait ressortir une tendance : celle de
l'intégration et parfois même de la réintégration
des droits de l'homme321, directement dans le texte constitutionnel.
Quelques États se sont démarqués de cette démarche.
Ils ont conservé le préambule comme lieu d'énonciation des
droits de l'homme-enfant, avec néanmoins une particularité, celle
d'affirmer sa valeur constitutionnelle conférant, aux droits une stature
indéniablement constitutionnelle. La Côte d'Ivoire
n'échappe pas à ce constat transposable à la question des
droits de l'enfant car elle les reconnait aussi bien au niveau de son
préambule que du corps de sa loi fondamentale.
A. AU NIVEAU DU PREAMBULE
La Constitutionnalisation des droits et libertés vient
ainsi lever le doute sur la valeur juridique des droits de l'homme auparavant
proclamés, de manière molle dans les préambules des
Constitutions. Quelle valeur leur accorder ? D'ailleurs, ont-ils seulement une
valeur juridique ou s'agit-il seulement des principes moraux ?
Ces interrogations concernaient en fait, quelques pays
anciennement sous domination coloniale française. Par exemple, la
Constitution camerounaise du 2 juin 1972 énumérait les
libertés dans le préambule. Le constituant ivoirien s'est
contenté d'affirmer dans le préambule de sa Constitution de 1960,
son attachement aux valeurs démocratiques et aux déclarations de
1789 et 1948. Il en allait de même du constituant guinéen qui ne
proclamait aucun droit. Il se limitait à affirmer dans le
préambule de la Constitution du 10 Novembre 1958 que : «
l'État de Guinée apporte son adhésion totale à
la Charte des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme (DUDH)... ». La Constitution malienne de 1974 se
contente elle aussi d'affirmer dans son préambule, les droits et les
libertés de l'homme et du citoyen énumérés dans la
DUDH du 10 décembre 1948.322
321 Car certaines constitutions, comme celles du Togo sous
Eyadema ou du Zaïre sous Mobutu ont purement et simplement supprimé
les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux.
322 LECLERCQ (C.), « Les libertés publiques en
Afrique Noire ? » in G.Conac (sous la direction), Les institutions
constitutionnelles des Etats d'Afrique francophone et de la République
malgache, Paris, Economica, 1979, p.227. ; Diarra (E.), «
Constitution et Etat de droit au Mali », RJPIC 1995, n°3,
p.264.
142
En revanche, la question ne se posait pas pour les
États d'Afrique noire anglophone qui avaient hérité de la
pratique anglo-saxone du « Bill of Rights »,
directement inscrit dans le corps même du texte constitutionnel. Il n'y
avait donc aucun doute sur sa valeur juridique323.
Le doute sur la valeur constitutionnelle du préambule
planait jusqu'au début des années 1990 sans avoir reçu une
amorce de solution précise et claire. La justice constitutionnelle
africaine avait très peu été sollicitée sur la
question. Lorsqu'elle fut sollicitée comme ce fut le cas au Cameroun,
elle n'a pas donné de réponse claire. Dans une décision du
08 octobre 1968, la Cour suprême du Cameroun oriental avait
affirmé la valeur constitutionnelle du préambule de la
Constitution du 04 mars 1960324. Le problème, est que cette
Constitution du 04 mars 1960 n'avait plus aucune existence juridique car elle
fut remplacée par la Constitution du 01er septembre 1961, qui
ne comportait pas de préambule. Sous le règne de la Constitution
de 1972, la section judiciaire de la Cour suprême réaffirmera la
valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de
1960325. Mais les juges d'appel soutiendront le contraire dans un
langage assez obscur. Tels sont les termes de la décision : «
il est largement admis que les préambules n'énoncent que les
principes généraux du droit, et ce, à titre indicatif,
alors que la loi énonce les dispositions constitutionnelles proprement
dites et, de ce fait, l'emporte sur le préambule de toute constitution
»326. Selon cet arrêt, la loi ordinaire, «
plus concrète », l'emporte sur le préambule. Cette
décision, émanant de juges du second degré aurait-elle pu
être cassée si elle avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation ?
La jurisprudence passée de la Cour suprême militait pour
l'affirmative, les juges suprêmes ayant auparavant soutenu le
contraire327. Mais elle est restée en l'état, laissant
subsister un doute.
323 LAVROFF (A.D) et PEISER (G.), Les Constitutions
africaines, tome II Etats anglophones, Paris, Pedone, 1964, p.31.
324 OLINGA (A.D), « L'aménagement des droits
et libertés dans la Constitution camerounaise révisée
», R.U.D.H. du 31 octobre 1996, vol. 8, p.117.
325 Arrêt du 22 février 1973. Il affirme que la
règle coutumière qui empêche les femmes d'hériter
est contraire au préambule de la Constitution qui interdit toute
discrimination fondée sur le sexe, in A.D. OLINGA, op. cit,
p.118.
326 Cour d'appel de Garoua, arrêt du 05 avril 1973.
Cité par A.D. OLINGA, op.cit.
327 La question s'est posée devant le juge judiciaire
camerounais et le juge administratif. Mais les deux juges n'ont pu apporter une
solution satisfaisante et claire. Cf. OLINGA (A. D.), «
L'aménagement des droits et libertés dans la constitution
camerounaise révisée », op.cit., p.117.
143
Quant au débat doctrinal sur ce sujet, il ne fit pas
l'objet de vives controverses. La majorité des auteurs et des hommes
politiques328, pragmatiques, s'accordaient à affirmer que la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel français qui a étendu,
en 1971, le bloc de constitutionnalité au préambule, serait
reproduite en Afrique329. Une telle solution était plus
qu'envisageable, puisque la Constitution française de 1958 a
été la grande inspiratrice des institutions africaines
francophones. Les États ayant recopié servilement les
institutions de la France, il ne serait pas surprenant que le juge africain
fasse sienne la jurisprudence du Conseil constitutionnel français. La
reproduction des décisions des deux ordres de juridictions
françaises est un fait courant en Afrique noire.
L'intégration de la déclaration des droits dans
le texte constitutionnel constitue la tendance générale des
nouvelles Constitutions. Néanmoins, certaines Constitutions ont
conservé le préambule comme cadre de déclaration des
droits, cette fois avec une particularité : celle de déclarer la
valeur constitutionnelle de celui-ci.
Habituellement les dispositions du préambule,
rédigées dans un style déclaratoire, sont
assimilées à de simples principes philosophiques ou moraux. Les
intentions qui y sont insérés n'ont pas de valeur juridique
positive. Les droits qui y étaient inclus n'étaient pas
assurés d'être opposables à l'État.
Désormais, les nouvelles Constitutions africaines qui s'attachent
à énoncer les droits fondamentaux dans le préambule,
donnent, par une disposition expresse, une valeur juridique au préambule
: celui-ci a une valeur constitutionnelle. La déclaration des droits est
ainsi constitutionnalisée. Ainsi, par une disposition d'un article de la
Constitution, le constituant camerounais dispose que le «
Préambule fait partie intégrante de la Constitution.
».
328 Cf. Par exemple le point de vue de P. YACE,
Ex-Président de l'Assemblée Nationale ivoirienne : « Le
préambule n'est pas un simple énoncé de principes
philosophiques ou moraux exempt de valeur juridique. Il a même valeur que
la constitution, il est source de droits positifs à l'égard des
pouvoirs publics et des particuliers ». Cité par G. CONAC, Les
Constitutions des Etats d'Afrique noire et leur effectivité, in G.
CONAC (sous la direction), Dynamiques et finalités des droits
africains, Paris, Economica, 1980, p.394.
329 La question s'est posée au juge constitutionnel
français : le préambule de la constitution française de
1946, auquel renvoie le préambule de la constitution de 1958 et qui
contient également la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, a-t-il une valeur constitutionnelle ? Le conseil constitutionnel a
estimé que le préambule de la Constitution de 1958 faisait partie
du bloc de constitutionnalité. Cf. la décision du conseil
constitutionnel Français du 16 juillet 1971.
144
A la différence du constituant camerounais, c'est par
une disposition du préambule que le constituant comorien dispose que le
préambule fait partie intégrante de la
Constitution330. Il reste à déterminer la valeur du
préambule et donc de cette disposition finale. Mais, cette disposition,
in fine, très explicite révèle la volonté
du constituant de faire des droits proclamés dans le préambule
des droits véritablement constitutionnels. Par conséquent, il
convient d'approuver sans réserve la conclusion de ce juriste africain
qui soutient que toute l'importance doit être restituée à
la phrase finale du préambule qui fait des droits consacrés des
droits véritablement constitutionnels331.
La Côte d'Ivoire est également un des pays qui
consacre les droits de la personne, donc de l'enfant, dans le préambule.
Néanmoins, le style de la reconnaissance des droits fait d'elle un cas
à part dans le mouvement d'affermissement de la reconnaissance
constitutionnelle des droits de la personne humaine. En effet, la Constitution
ivoirienne du 03 novembre 1960 s'ouvre en ces termes : « Le peuple de
Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la
démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, par la Déclaration universelle de 1948, tels qu'ils sont garantis
par la présente Constitution. Il affirme sa volonté de
coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui
partagent son idéal de justice, de liberté,
d'égalité, de fraternité et de solidarité
humaine. ».
Ainsi énoncé en termes lapidaires, ce texte
liminaire pèche-t-il par son imprécision. Tout d'abord, il ne
comporte pas d'articles (numérotés), contrairement aux
dispositions du corps de la Constitution. En outre, il n'énumère
guère les droits proclamés. Que, dans ces circonstances, ce
préambule ivoirien, soit source de controverses doctrinales, les
interprétations y afférentes étant divergentes, cela ne
saurait surprendre. Le doute persiste toujours sur la valeur à accorder
au préambule. A-t-il une valeur infra constitutionnelle ou
constitutionnelle ?332
330 Constitution comorienne du 7 juin 1997 (dernier
alinéa).
331 OLINGA (A.D), L'Afrique face à la «
globalisation » des techniques de protection des droits fondamentaux,
op. cit. p.72.
332 Constitution du 3 novembre 1960 modifiée, §1.
La question ne se pose plus car la Constitution de 1960 a été
suspendue depuis le coup d'Etat du 24 décembre 1999. Un nouveau projet
constitutionnel a été soumis à un référendum
populaire le 23 juillet 2000. Ce projet a été adopté et
est devenu la Constitution ivoirienne jusqu'en date du 08 Novembre 2017. Cette
Constitution de 2000 était plus prolifique sur les droits des ivoiriens
qui sont désormais contenus dans le corps de la constitution (chap. 1,
art. 1 à 22). Actuellement la Constitution en vigueur est celle du 8
novembre 2017. Le préambule de cette nouvelle reconnait la valeur
constitutionnelle
145
Le préambule de la Constitution de 1960 se limite
à « proclamer son attachement.. » aux
déclarations de 1789 et de 1948. Se pose alors la question de savoir si
ce préambule a une valeur juridique ou obligatoire. La doctrine
ivoirienne qui a tenté de répondre à cette cruciale
question, balance entre deux grandes tendances : l'une dénie au
préambule tout caractère positif ; l'autre lui reconnait ce
caractère.
Selon la doctrine négative, le préambule ne
contient que de simples dispositions d'ordre moral ou philosophique, donc sans
valeur juridique. Telle est la position du Professeur LEGRE OKOU
Henri333. Quant aux tenants de la thèse positive, ils
estiment que les dispositions du préambule ont une valeur de droit
positif. Mais, ceux-ci se divisent en deux groupes. Pour le premier, le
préambule a, certes une valeur juridique mais une valeur non
constitutionnelle ; tel est le point de vue du Professeur Anne-Marie ASSI ESSO
qui affirme que le Préambule a une « valeur
quasi-constitutionnelle334 ». Pour le second groupe
animé principalement par le Professeur Martin BLEOU, le préambule
a une valeur pleinement constitutionnelle335.
Il convient d'apprécier les différentes
positions ci devant exposées. S'attachant et se limitant au contenu du
Préambule, caractérisé par sa grande
généralité, certains doctrinaires ivoiriens ont
affirmé sans ambages que celui-ci était dépourvu de toute
force juridique ; ce qui semble fondé car selon le doyen VEDEL, «
La règle de droit ne se définit pas seulement par une forme,
mais par un contenu. Un document qui ne modifierait en rien les droits et les
obligations de quiconque ne saurait, même coulé dans une forme
juridique, contenir une règle de droit. Ainsi, de l'acte qui se
bornerait à une simple constatation, ou même de celui qui
énoncerait une règle si vague qu'il serait impossible de
déterminer et le sujet lié par cette règle, et l'objet
exact du droit ou de l'obligation créés.
»336. En outre, leurs arguments reposent sur le fait que
le Préambule, au lieu d'assurer la garantie des principes de la
démocratie et des droits de l'homme définis par les
Déclarations de 1789 et de 1948, ne fait
du préambule en ces termes : « Approuvons et
adoptons librement et solennellement devant la Nation et l'humanité la
présente Constitution comme Loi fondamentale de l'Etat, dont le
Préambule fait partie intégrante ».
333 OKOU (H-L), Cours d'Histoire du Droit, 1ere
année de Licence, Université d'Abidjan.
334 ASSI-ESSO (A-M), Précis de droit civil : Les
personnes- La famille, L.I.D.J., Abidjan 2è édition, 2002,
p.39.
335 Voir BLEOU (M.), Cours de Droit constitutionnel,
1ere année de Licence.
336 VEDEL (G.) cité par RIVERO (J.), Les
Libertés publiques, op. cit. p. 148.
146
que proclamer son attachement à ces principes et
droits. Or, le mot « attachement » a un sens beaucoup plus
politico-philosophique que juridique. Il découle de là une
interprétation littérale du texte consistant à ne
s'attacher qu'à la lettre du texte, au vocabulaire retenu. Pourtant,
l'on sait que ce préambule contient des dispositions floues ou
ambiguës, les termes qui s'y trouvent étant imprécis ; ce
qui a suscité des interprétations diverses et divergentes.
Quoique séduisantes, ces arguments ne sauraient
convaincre. Il est difficile, voire impossible, de dénier toute valeur
juridique au Préambule et ce, pour deux raisons : d'une part, le
préambule fait partie intégrante de la Constitution et a
été élaboré suivant la même procédure
que le corps de la Constitution ; d'autre part, la valeur juridique du
Préambule tient au fait qu'en matière de contrôle de
constitutionnalité, la compétence du juge constitutionnel, n'est
pas limitée au corps de la Constitution mais à l'ensemble du
texte constitutionnel.
En France, relativement, à cette question cruciale
touchant la valeur juridique du Préambule, la doctrine337
était fort divisée sous la IIIe et IVe Républiques. Aux
yeux des Doyens Léon DUGUIT et Maurice HAURIOU, le préambule a
pleine valeur constitutionnelle : c'est une loi impérative,
fondamentale. A l'opposé, pour les Professeurs CARRE DE MALBERG et
ESMEIN, le Préambule ne contient que des principes philosophiques et
moraux : dès lors, il est dépourvu de toute valeur juridique. Il
importe de souligner qu'en France, cette question liée à la
valeur juridique du Préambule n'a été
définitivement tranchée que dans la décision du 16 juillet
1971338, par le Conseil constitutionnel, juge de la
constitutionnalité, qui a censuré une loi portant atteinte
à la liberté d'association. En l'espèce, la haute
juridiction a affirmé solennellement que la totalité des
dispositions du Préambule de la Constitution française a valeur
de loi constitutionnelle. Suivant une édifiante pensée du
Professeur Jean RIVERO, c'est là « une merveilleuse
révolution opérée par la décision du Conseil
constitutionnel du 16 juillet 1971-depuis la prise de la Bastille, le peuple
français aime faire ses révolutions au mois de juillet ! Ici, la
Révolution s'est faite en quatre mots. (Vu la Constitution et notamment
son Préambule). Voilà d'un seul coup, la Déclaration de
1789, le Préambule de 1946, les principes
337 RIVERO (J.), Les libertés publiques, op.cit.,
p. 168.
338 Voir décision du Conseil Constitutionnel du 16
juillet 1971 sur la liberté d'association, R.D.P 1971 (p.1171), et A.J.
1971 (p.537).
147
fondamentaux reconnus par les lois de la
République, intégrés, alors que le Constituant ne l'a pas
voulu, à la Constitution française ! La constitution
française a doublé de volume par la seule volonté du
Conseil constitutionnel »339. Dans le même ordre
d'idées, le Professeur Jean GICQUEL affirme : « il lui a
appartenu d'affirmer l'Etat de droit, en intégrant globalement le
préambule de 1958 au principe de constitutionnalité, le 16
juillet 1971, à l'occasion de la première censure d'une loi, de
manière à subordonner à ses vues, le Parlement.
»340. Procédant du juge suprême
français, cette décision s'impose inéluctablement à
toutes les autres juridictions françaises conformément aux
prévisions de l'article 62 de la Constitution française de
1958341.
Toutefois, parce qu'elle est intervenue postérieurement
à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, cette jurisprudence
ne saurait s'imposer aux tribunaux ivoiriens ; l'article 76 de la Constitution
ivoirienne de 1960 interdit une telle application342. En
dépit de cette inapplication de la jurisprudence française du 16
juillet 1971 en Côte d'Ivoire, on peut à bon droit affirmer que,
le Préambule de la Constitution ivoirienne du 03 novembre 1960 a valeur
constitutionnelle, et ce pour des raisons évidentes. Tout d'abord, il
ressort des travaux préparatoires que le constituant de 1960 a voulu
reconnaitre au Préambule la même valeur que le corps de la
Constitution. En effet, M. PHILIPPE Grégoire YACE, Président de
la Commission constitutionnelle d'alors, a solennellement affirmé au
lendemain de l'accession de la Côte d'Ivoire à
l'indépendance, que le « Préambule n'est pas un simple
énoncé de principes philosophiques et moraux exempts de valeur
juridique, ainsi qu'on se l'imagine parfois. Le Préambule a la
même valeur que la Constitution (...). Il est source de droit positif
à l'égard des pouvoirs publics et des juridictions
»343. En sus, il est évident que ce texte
339 RIVERO (J.), Rapport de Synthèse, in Cours
constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, IIè
colloque d'Aix-en-Provence, des 19-20 et 21 février 1981, Economica
et Presses universitaires d'Aix-Marseille, Paris, 1987, p.520.
340 GICQUEL(J.), Droit constitutionnel et institutions
politiques, Montchrestien, Paris, 14e édition, 1995,
p.101.
341 Article 62 constitution française de 1958 «
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent juridiquement aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles. ».
342 L'article 76 de la Constitution dispose : « la
législation actuellement en vigueur en Côte d'ivoire reste
applicable sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de
contraire à la présente Constitution. ».
343 Philippe Grégoire YACE cité par le Doyen
MELEDJE (F.D), Les rapports entre le droit international et le droit
interne : application à l'ordre juridique ivoirien,
inédit.
148
liminaire et les articles numérotés forment un
tout opaque qui est la Constitution ; et ce tout opaque, a été
élaboré au même moment, suivant la même
procédure ; qui plus est, la compétence du juge constitutionnel
s'étend à ce « tout opaque » constituant le
bloc de constitutionnalité car, en tout cas, aucune loi n'exclut le
Préambule du champ d'intervention du contrôle de
constitutionnalité.
Il appert de de tout ce qui précède que le
Préambule autant que les autres énonciations, ont la même
force, la même valeur juridique. Dès lors, on est autorisé
à affirmer que la thèse de la pleine constitutionnalité
des dispositions du Préambule de la Constitution de 1960 prime sur celle
de la négation et celle d'infra-constitutionnalité ou
quasi-constitutionnalité. Ce même raisonnement sus-indiqué
vaut pour le préambule de la loi fondamentale ivoirienne de 2000, qui,
tout en proclamant « son adhésion aux droits et libertés
tels que définis dans la DUDH de 1948 et dans la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981, exprime son attachement aux valeurs
démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment : le
respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles
que collectives ».
Globalement, « les nouvelles constitutions
procèdent à une reconnaissance dure ou gratinique des droits
fondamentaux »344 soit en considérant le
préambule comme faisant partie du bloc de constitutionnalité,
soit en consacrant un titre du corps de la constitution aux droits
fondamentaux, voire, aux droits de l'enfant.
B. UNE CONSECRATION PLUS CIRCONSTANCIEE DES DROITS AU
NIVEAU DU CORPUS DE LA CONSTITUTION SOUS LES CONSTITUTIONS DE 2000 ET DE
2016
Aujourd'hui, le débat est définitivement clos,
le nouveau constituant ivoirien, voir africain, ayant posé de
manière claire, l'assise juridique des droits de l'homme-enfant dans le
corpus de la Constitution.
Plus que les constitutions de l'ère postcoloniale, les
Constitutions africaines des transitions démocratiques et post apartheid
vont intégrer la proclamation des droits de
344 SINDJOUN (L.), « Les nouvelles Constitutions
africaines et la politique internationale : contribution à une
économie internationale des biens politico-juridiques »,
In. Etudes internationales, juin 1995, n°2, p.334.
149
l'homme et de l'enfant dans le corps même de la
Constitution, « conscientes enfin que le but ultime de tout mouvement
constitutionnel est la proclamation des droits fondamentaux
»345.
Les droits de l'homme-enfant occupent une place
privilégiée au sein de la Constitution. Les droits de
l'homme-enfant viennent en premier dans l'agencement des dispositions
constitutionnelles. Souvent, le titre relatif aux droits de l'homme vient avant
les chapitres concernant l'organisation et le fonctionnement des institutions
publiques346 . Tel est le cas particulier de la Constitution
ivoirienne du 1er Août 2000 dont le titre premier est
consacré aux libertés, droits et devoirs. Il en va
également ainsi de la nouvelle Constitution ivoirienne du 08 novembre
2016 dont le titre 1 est également consacré aux droits,
libertés et devoirs ( articles 1à 47). Parfois, certaines
Constitutions comme la Constitution burkinabè, n'hésitent pas
à placer la reconnaissance des droits avant les dispositions concernant
la forme et le régime de l'Etat ou encore avant les règles
concernant la citoyenneté et la souveraineté. Ces
dernières dispositions sont habituellement énoncées en
tout début de la loi fondamentale.
La primauté accordée aux dispositions relatives
aux droits de l'homme par rapport aux autres dispositions concernant
l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics manifeste la
volonté du constituant de faire des droits de l'homme, des droits de
l'enfant, le coeur du fonctionnement des institutions publiques. Les principes
découlant de la reconnaissance des libertés et droits doivent
innerver le fonctionnement des organes de l'Etat entre eux et également
à l'égard des citoyens. Les droits de l'homme sont une garantie
contre l'arbitraire des gouvernants. C'est pourquoi, le constituant ivoirien,
à l'instar de ceux des démocraties modernes va consacrer avec
autant de force le principe de la séparation des
pouvoirs347.
Cette inclination des nouveaux constituants à
déplacer le site constitutionnel de proclamation va de pair avec le
choix du procédé de déclaration qui, fait de ces droits
non pas « des droits et libertés nominaux, proclamés et
figés dans leur splendide
345 OLINGA (A.D), « L'Afrique face à la
globalisation des techniques de protection des droits de l'homme
», in RJPIC n°1, janv.1999, p.71.
346 Il en ainsi pour les constitutions zambienne, namibienne,
béninoise, congolaise, Djiboutienne, sud-africaine...
347 C'est l'expression de l'effet vertical de la
reconnaissance des droits de l'homme, in X. Philippe, op.cit. p.326.
150
abstraction...mais des droits et libertés-aspirant
à la vie, destinés à être concrétisés,
vécus, utilisés »348.
Dans les nouvelles Constitutions africaines, il existe une
tendance générale, à consacrer de manière
minutieuse et détaillée les droits et libertés. Sans
doute, ce fait est dû, selon le Professeur Jean Du Bois de
Gaudusson, à « l'influence des magistrats, avocats et
professeurs de droit qui ont souvent peuplé les commissions
d'élaboration des Constitutions »349. Les
déclarations des droits sont par conséquent plus longues
qu'auparavant.
Les méthodes de circonscription des droits, de leur
interprétation ou de leurs limites varient d'un État à
l'autre. Concrètement, il est principalement le fruit de
l'héritage colonial : la structure des catalogues des droits
diffère notamment entre les pays anciennement colonisés par la
France et la Belgique et les pays qui ont subi la domination britannique.
Dans les États francophones, les Constitutions de ces
pays consacrent les droits de manière globale, elles énoncent le
principe général. Il appartiendra à la loi d'en fixer le
régime et la mise en oeuvre350. Ces Constitutions accordent
une confiance à la loi. Cette technique a le mérite de donner une
certaine souplesse au domaine des droits de l'homme quoique, elle peut, parfois
s'avérer dangereuse pour la protection des droits de l'homme, donc des
droits de l'enfant. La réalité a montré que, sous
prétexte de sauvegarder l'ordre public ou encore l'intérêt
général, le législateur africain n'a pas
hésité à adopter des lois arbitraires.
Les États africains d'expression anglaise sont plus
méticuleux dans l'énoncé des droits. Les droits sont
concrètement organisés dans la Constitution. En effet, dans les
États anglophones, la technique d'énonciation des droits des pays
africains anglophones est influencée par la tradition anglo-saxonne qui
organise avec un luxe de détails, le contenu des droits de l'homme. Les
droits sont énoncés de manière pragmatique et
concrète. Le souci premier est de permettre une application
immédiate des droits consacrés. Le principe général
est suivi de nombreux développements énumérant les cas
dans lesquels il peut être porté
348 OLINGA (A.D), L'aménagement des droits et
libertés dans la Constitution camerounaise révisée,
op. cit. p.117.
349 In. Les Constitutions africaines publiées en
langue française, op. cit. p.11.
350 Voir Article 71 Constitution ivoirienne 2000.
151
atteinte aux libertés. Le constituant indique aussi la
procédure selon laquelle ces libertés seront mises en oeuvre. Ce
qui explique la longueur parfois vertigineuse de certains articles. La minutie
avec laquelle les constituants ont consacré les droits est significative
et démontre à quel point la volonté de rendre les droits
consacrés a prédominé. Par exemple, le droit à un
procès équitable est expliqué dans toutes ses composantes.
Il implique pour toute personne faisant l'objet d'une poursuite pénale
d'être entendue par un tribunal indépendant, impartial et
compétent. Ce tribunal a la possibilité, pour des raisons de
moralité, d'ordre public ou de sécurité nationale
d'exclure la presse ou le public de tout ou d'une partie des audiences. La
personne arrêtée doit être informée des raisons de
son arrestation dans une langue qu'elle comprend. En définitive, les
codes de procédure s'avèrent presque inutiles car les textes
constitutionnels constituent eux-mêmes de véritables codes de
procédure351. Contrairement aux catalogues des droits dans
les Constitutions francophones, ceux des constitutions anglophones sont
immédiatement prêts à l'emploi. Les limites aux droits
étant abondamment précisées, le pouvoir
d'interprétation des autorités chargées de les appliquer
est sérieusement restreint : « la Constitution définit
ainsi le degré de pouvoir discrétionnaire dont disposent les
autorités publiques dans la mise en oeuvre des droits fondamentaux
»352.
Comme souligné, les constituants ont proclamé de
manière détaillée les droits de l'homme. En nombre, les
droits sont importants, comme si les constituants ont eu peur d'oublier
certains droits et que les gouvernants profitent de cette faille pour ne pas
les reconnaitre. Cette attitude compréhensible, témoigne de la
volonté de « dénoncer très directement des
pratiques autoritaires, dont les pays africains avaient été
victimes sous les dictatures civiles ou militaires »353.
Le contenu des droits s'en ressentira fortement.
En tout état de cause, en Côte d'Ivoire, cette
reconnaissance constitutionnelle des droits de l'enfant à travers le
dispositif de cette loi fondamentale va être exprimée
expressément ou implicitement à travers les articles 3,5, 6 7, 8,
19, 20 et 21 et 22 de la Constitution de 2000, puis réaffirmée
à travers les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 de la Constitution du 08 novembre
2016. Ces articles se rapportent à différents domaines relevant
directement ou indirectement des droits de
351 LAVROFF (D.G) et PEISER (G.), Les Constitutions
africaines, op. cit. pp.30-31.
352 PHILIPPE (X.), op.cit., p.328.
353 CONAC (G.), « Le juge et la construction de l'Etat de
droit en Afrique francophone » in Mélanges en l'honneur de Guy
BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p.106.
152
l'enfant. Cette reconnaissance constitutionnelle va être
davantage précisée à travers l'adoption d'un cadre
législatif national conformément à la volonté du
Constituant exprimé respectivement aux articles 41, 71 et 101 des
Constitutions ivoiriennes de 1960, 2000 et de 2016.
Il suit de ce qui précède que, la Côte
d'Ivoire s'est engagée lentement dans la protection des droits de
l'enfant. En effet, dès son accession à l'indépendance,
l'État ivoirien, n'a pas pris véritablement à coeur dans
son droit interne la question des droits de l'enfant et sa première
constitution le démontre clairement. Toutefois, les Constitutions de
2000 et de 2016 consacrent explicitement la question de la protection de
l'enfant et de ses droits. Ce retour au constitutionnalisme est marqué
par le caractère significatif des similitudes des textes
constitutionnels des États de l'Afrique subsaharienne francophone avec
ceux des grandes démocraties contemporaines354. Cette
pratique constitutionnelle a pu a tort être qualifiée à
raison de « mimétisme » bien qu'il s'agisse là d'une
vision réductrice des États africains355. Si la
Constitution ivoirienne n'explicite pas dans son corpus la protection
accordée à l'enfant, les mesures d'application législative
et réglementaire viennent davantage préciser et renforcer ces
droits.
354 SORO ( P.S-G.), L'exigence de conciliation de la
liberté d'opinion avec l'ordre public sécuritaire en Afrique
subsaharienne francophone (Bénin-Côte
d'Ivoire-Sénégal) à la lumière des grandes
démocraties contemporaines (Allemagne-France), Thèse de
doctorat en droit public, Université de Bordeaux, 2016, p.95.
355 DE GAUDUSSON (J.du B.), « Le mimétisme
postcolonial, et après ? », Pouvoirs, La démocratie en
Afrique, n°129, Seuil, Paris, 2009, pp.45-55, spéc. p.47.
153
Section II : LES MESURES D'APPLICATION LEGISLATIVE ET
REGLEMENTAIRE DES DROITS DE L'ENFANT
La loi, on le sait, est un acte du pouvoir législatif
consistant à édicter des normes de conduite de nature
générale et impersonnelle et dont la violation entraine,
normalement, l'application de la sanction prévue. L'objet d'une loi est
donc d'édicter des normes générales, impersonnelles et
sanctionnatrices.
Les matières couvertes par la loi sont diverses. Il
peut s'agir des matières civiles, des matières pénales ou
commerciales. Il peut s'agir aussi des matières relatives au travail,
à la sécurité sociale ou encore aux sûretés.
Depuis un certain nombre d'années, à cause de la technique du
renvoi constitutionnel, les droits de l'enfant, relèvent aujourd'hui
également de la compétence du pouvoir législatif. La loi
intervient, en effet, en matière de droits de l'enfant, soit pour donner
effet à une disposition constitutionnelle trop générale,
soit pour créer un droit nouveau ou une garantie nouvelle, soit encore
pour en apporter des limitations nécessitées pour des besoins de
la vie en société.
Dans la hiérarchie des sources internes du droit des
droits de l'homme-enfant, la loi occupe la seconde place après la
Constitution. C'est elle qui peut, dans le silence de la Constitution ou en cas
d'obscurité de celle-ci, compléter ou clarifier certaines de ses
dispositions.
Il en découle que, en guise de preuve, le titulaire du
droit revendiqué devrait, en cas d'absence, de silence ou de lacune de
la Constitution, recourir aux lois ou actes ayant force de loi pour asseoir le
bien-fondé de ses allégations.
La Constitution ivoirienne de 2016 dispose, en son article
101, que « La loi fixe les règles concernant (...) les
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques ». La compétence est donc
donnée au Parlement ivoirien pour voter des lois garantissant et
régissant l'exercice des libertés publiques dont
bénéficie chaque individu.
La Législation ivoirienne en faveur de l'enfance et ses
droits, est éparpillée dans divers textes. Le législateur
en conformité avec les textes internationaux des droits de l'enfant est
conscient que « l'enfant en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin de protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique
154
appropriée avant comme après sa naissance
»356. Cette protection se perçoit au triple niveau
civil (Paragraphe 1), social (Paragraphe 2)
et pénal (Paragraphe 3).
§ 1. UNE IMPORTANTE RECONNAISSANCE DES DROITS DE
L'ENFANT AU NIVEAU CIVIL
Il existe en Côte d'Ivoire une diversité de lois
civiles et sociales protégeant l'enfant. Nous examinerons les plus
importantes à savoir les règles de déclaration des enfants
(A) celles tenant à l'incapacité du mineur qui fait l'objet d'un
encadrement juridique rigoureux (B) au nom de l'intérêt
supérieur de l'enfant , puis, nous analyserons le régime de
protection du mineur non émancipé qui constitue un moyen de
contrôle des droits parentaux à l'égard de leurs enfants
(C).
A. UN ENCADREMENT JURIDIQUE DES REGLES DE DECLARATION
DES NAISSANCES FONDEES SUR L'INTERET DES ENFANTS
L'encadrement juridique des règles de
déclaration des naissances fondées sur l'intérêt des
enfants se décline de diverses manières : L'obligation
légale de déclaration et d'établissement d'actes de
naissances donnée comme moyens d'individualisation et de protection des
enfants (1) , les règles de suppléance en cas de perte de
registre ou défaut d'actes de naissance(2), puis, les sanctions de
l'inobservation des règles d'établissement des actes de
naissances (3).
1. L'obligation légale de déclaration et
d'établissement d'actes de naissances, moyens d'individualisation et de
protection des enfants
Cette obligation est régie par la loi n° 64-374,
relative à l'enregistrement des naissances, modifiées par la loi
n° 83-799 adoptée en 1983. Il est fait obligation aux
intéressés de déclarer les naissances à l'officier
de l'état civil dans le délai de trois mois suivant
l'accouchement357. Suivant les dispositions de l'article 43 de
ladite loi, la déclaration est faite par le père ou la
mère ou des parents proches, et ce afin d'éviter de recourir
à la voie judiciaire. Il faut préciser que les personnes
citées par l'article 43 sont tenus concurremment
356 Paragraphe 8 du préambule de la CIDE.
357 Article 41 loi 99-961 ; il était de 15 jours.
155
et sans aucun ordre. L'acte doit contenir un certain nombre de
mentions (année, mois, jour, heure et lieu de naissance, patronyme,
prénoms, nationalité des parents, etc.).
La loi ivoirienne prévoit aussi les déclarations
de naissance en cas de situations spéciales ; celles-ci concernent les
enfants trouvés, les enfants déclarés sans vie et les
naissances en mer.
La situation des enfants trouvés est régie par
l'article 46 de la loi ivoirienne relative à l'état civil. Aux
termes de cet article, il est fait obligation à une personne qui trouve
un enfant nouveau- né de le déclarer à l'officier ou
à l'agent de l'état civil du lieu de découverte. Si elle
ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre (ainsi
que ses vêtements et autres effets) à l'officier. Un
procès-verbal est dressé pour constater cette situation, qui
énoncera éventuellement l'âge apparent de l'enfant. Il faut
noter que si l'acte de naissance vient à être retrouvé ou
si sa naissance est judiciairement déclarée, le
procès-verbal de découverte et l'acte provisoire de naissance
sont annulés358.
Quant à l'article 48 de ladite loi, il a trait à
la situation des enfants déclarés « sans vie
». Dans ce cas, la déclaration est inscrite à sa date
sur le registre du décès et non sur celui des naissances. La
déclaration mentionne seulement qu'il a été
déclaré un enfant sans vie. Il en va différemment en
France ; en effet, suivant la loi française du 08 Janvier 1993,
lorsqu'un enfant est décédé avant la déclaration de
naissance, l'officier établit un acte de naissance et un acte de
décès sur production du certificat médical indiquant que
l'enfant est né vivant et viable359.
La troisième et dernière situation
spéciale concerne le cas des naissances en mer. En cas de naissance
survenue pendant un voyage maritime, sur un bateau de nationalité
ivoirienne, il en est dressé acte dans les 48 heures de l'accouchement
sur la déclaration de la mère ou du père, s'il est
à bord360.
Pour être antérieures aux textes internationaux
pertinents en matière de droits de l'enfant, ces lois ivoiriennes
organisant la déclaration des naissances sont conformes aux
prévisions
358 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.123.
359 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.123.
360 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.124.
156
des desdits textes. Toutes ces mesures légales
relatives à la déclaration de naissance de l'enfant constituent
à n'en point douter une affirmation d'une protection de l'enfant
à travers les actes d'état civil, à l'instar des
règles de suppléance en cas de perte de registre ou défaut
d'actes de naissance.
2. Les règles de suppléance en cas de
perte de registre ou de défaut d'actes de naissance
Le législateur ivoirien a prévu des
règles dites de suppléance dans deux hypothèses bien
déterminées : l'un en cas de perte ou de disparition des
registres ; l'autre, en cas de défaut d'actes de l'état civil.
Ces règles par cela seul, qu'elles permettent de reconstituer
l'état civil de l'enfant, constituent à n'en point douter une
forme de protection de ses droits eu égard à l'importance de
l'acte d'état civil pour la jouissance de plusieurs autres droits
reconnus à l'enfant.
Ces règles sont prévues aux articles 85 à
88 de la loi n° 64-374, relative à l'enregistrement des naissances.
Soit un exemplaire du registre a disparu ou les deux exemplaires ont disparu.
Que faire en pareilles hypothèses dans l'intérêt de
l'enfant ?
Dans la première hypothèse, aux termes de
l'article 85, le Procureur de la République prescrit au greffier de la
section du tribunal ou du tribunal compétent de faire une copie de cet
exemplaire sur un nouveau registre préalablement côté et
paraphé par le président du tribunal361. Dans la
deuxième hypothèse, il n'est plus possible de faire des copies,
la seule solution consiste à reconstituer les actes en vue de leur
transcription sur deux registres côtés et paraphés par le
Président du tribunal. Pour ce faire, le Procureur de la
République invite l'officier ou l'agent de l'état civil de la
circonscription ou du centre secondaire à dresser un état,
année par année, des personnes nées, mariées ou
décédées pendant ce temps362. Après
examen de l'état, le Procureur de la République requiert le
tribunal compétent d'ordonner une enquête et toutes mesures de
publicité opportunes. L'enquête est faite par un juge
361 Voir le cas de disparition des feuilles d'un registre de
l'état civil : Section de trib de Katiola, jugt n°29 du
11/02/1993 ; Cndj/Rec CATBX 1997 n°2 , p.57 ; pour la condamnation
d'un agent de l'état civil, pour faux commis à l'état,
pour avoir détruit une feuille d'un registre concernant un enfant et la
remplacer par un acte avec inscription d'un enfant jamais déclaré
: TPI Bouaké jugt n° 1248 du 22/10/1996, CNDJ /Rec CATBX
1998 n°2 p225.
362 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.125.
157
commis et un double de l'enquête est
déposé au greffe du tribunal et au chef-lieu de la
circonscription ou du centre secondaire où toute personne peut en
prendre connaissance. Une fois l'instruction terminée, le tribunal, sur
les conclusions du Procureur de la République, ordonne le
rétablissement des actes dont l'existence a été
constatée. Un seul jugement contient les actes d'une année
entière pour chaque circonscription. Le jugement est transcrit sur deux
registres côtés et paraphés363. Pour être
une mesure spéciale, cette reconstitution des actes d'état civil
a donc le mérite de permettre aux enfants de pouvoir disposer de leur
actes de naissances afin de jouir éventuellement de tous leurs autres
droits dont la jouissance requiert parfois, la présentation d'un acte de
naissance.
Par ailleurs, en vue de la reconstitution des registres de
l'état civil disparus ou détruits entièrement ou
partiellement depuis la crise socio-politique ivoirienne, des dispositions
spéciales ont été prises avec l'ordonnance n°2007-06
du 17 janvier 2007. Ces dispositions qui dérogent à celles
prévues par la loi 64-374 du 07 octobre 1964, en ses articles 87 et 88,
prévoient une procédure spéciale364 ,
après avoir créée une commission de reconstitution des
registres. La reconstitution doit se faire dans un délai de quatre (4)
mois365, à compter de la mise en place de la commission qui
existe dans la ville d'Abidjan et dans chaque sous-préfecture. Cette
ordonnance a été modifiée et complétée par
une autre en date du 20 décembre 2007 qui étend le champ
d'application de la procédure de reconstitution à toutes les
commissions administratives du pays et indique que les commissions de
reconstitution sont instituées dans chaque sous-préfecture ou
dans chaque commune de la ville d'Abidjan366.
De plus, des lois correctives furent adoptées au
lendemain de la crise post-électorale. Au nombre de celles-ci, figurent
les mesures juridiques spéciales en matière de déclaration
de naissances. Ainsi, l'ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011
relative à l'enregistrement des naissances et des décès
survenus durant la crise apparait comme un correctif visant à
régulariser la déclaration des naissances des enfants nés
durant la crise
363 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.126.
364 Article 5l ordonnance n°2007-06 du 17 janvier 2007.
365 Voir décret 2007-du 20 décembre 2007 portant
modalités d'application de l'ordonnance sus visée.
366 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.126.
158
159
ivoirienne. Cette ordonnance est composée de trois
articles. Aux termes de l'article 1er de ladite ordonnance, «
les naissances ...survenus pendant la période allant du 20 septembre
2002 au 31 juillet 2011, dans les ex-zones Centre-Nord-Ouest, et du 30 novembre
2010 au 31 juillet 2011, sur le reste du territoire national, pourront
être déclarés, nonobstant l'expiration des délais
légaux ».
Quant à l'article 2, il fixe la limite de cette
opération exceptionnelle dans le temps ; suivant cet article, «
les déclarations sont reçues jusqu'au 30 juillet 2012,
à compter de la promulgation de la présente ordonnance
conformément aux lois et règlements sur l'état civil en
vigueur. ». Cette ordonnance a été publiée en
date du 28 septembre 2011 par le Président de la République, M.
Alassane Dramane OUATTARA. L'article 3 précise que cette ordonnance sera
publiée au journal officiel de la République de Côte
d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Toutefois, un
amendement à cette ordonnance a été faite suivant une loi
intervenue le 25 janvier 2013. La loi n° 2013635 du 25 janvier 2013 porte
sur la modification de l'article 2 de l'ordonnance n°2011-258 du 28
septembre 2011 relative à l'enregistrement des naissances et les
décès survenus durant la crise. Adoptée par
l'Assemblée nationale, elle comporte seulement deux articles ; l'article
principal, à savoir l'article premier, proroge l'enregistrement des
naissances intervenues durant la crise ; ce faisant, cet article premier
contient les dispositions de l'article 2 nouveau libellé comme suit :
« Les déclarations sont reçues pendant un délai
de 24 mois, à compter du 1er Aout 2012, conformément
aux lois et règlements sur l'état civil en vigueur ».
Ce qui signifie que cette loi fixe la fin de l'opération au
01er Aout 2014. Une telle décision ne peut qu'être
saluée d'autant plus qu'elle a le mérite de permettre aux enfants
n'ayant pas pu être déclarés durant la période de
crise, d'être enregistrés sur les registres d'état civil.
Les développements qui précèdent nous montrent
l'attachement de l'Etat ivoirien à l'obligation internationale de
veiller à la déclaration des naissances sur ton territoire.
Mieux, ce souci est davantage réaffirmé à travers les
sanctions attachées à l'inobservation des règles
d'établissement des actes de naissance que prévoient les lois
ivoiriennes.
3. Les sanctions de l'inobservation des règles
d'établissement des actes de naissances
Les sanctions des irrégularités commises dans
l'établissement des actes de naissance peuvent être
regroupées en deux catégories selon qu'elle touche à
l'état civil ou l'acte lui-
même. En réalité, on peut distinguer trois
types de sanctions : la nullité des actes, leur rectification, pour ce
qui concerne les actes eux-mêmes. En outre, l'officier peut être
sanctionné. C'est dire qu'il peut voir sa responsabilité
engagée dans l'établissement des actes.
- La responsabilité de l'officier de
l'état civil
L'officier de l'état civil peut commettre des
irrégularités dans la tenue des registres. Il peut s'agir d'une
erreur grave dans la rédaction de l'acte ou d'une acceptation d'une
déclaration mensongère367.
La responsabilité de l'officier de l'état civil
est engagée à travers l'article 12 qui précise que les
officiers sont responsables civilement, disciplinairement et pénalement
des fautes et négligences commises à l'occasion ou dans
l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, en cas d'acceptation de
déclaration mensongère, l'officier sera poursuivi pour faux en
écriture publique. La responsabilité civile pourra
également être engagée si son comportement a
été préjudiciable à l'usager du service public, et
ce sur la base de l'article 1382 du code civil. Enfin, en sa qualité de
fonctionnaire ou d'agent de l'État, il pourra être traduit devant
les instances disciplinaires et subir les sanctions prévues par le
statut de la fonction publique. S'il s'agit d'un agent lié à la
commune par un contrat de droit privé, c'est le code du travail qui
s'applique368. Cette sanction tenant à la
responsabilité de l'officier d'état civil, est protectrice pour
l'enfant , d'autant plus qu'elle appelle les officiers d'état civil
à plus de sérieux dans l'enregistrement des naissances ; elle
peut donc permettre à titre préventif à l'officier
d'enregistrer correctement et rigoureusement les déclarations de
naissances , de sorte à éviter , d'être complice de fausses
déclarations pouvant porter préjudice à l'enfant.
Toujours dans l'intérêt de l'enfant, une autre
sanction prévue par le législateur consiste en l'annulation d'un
acte jugé irrégulier.
- L'annulation de l'acte de
naissance
Il s'agit de l'annulation de l'acte irrégulier,
c'est-à-dire de la destruction rétroactive d'un acte
dressé. Lorsqu'elle aboutit, la personne en cause est privée de
moyen de prouver son
367 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.129.
368 Ibid..
160
état369. Mais en la matière, le
problème est de savoir si un acte peut être annulé aussi
facilement, quand on constate que hormis les actes de mariage pour lesquels la
loi prévoit des cas de nullité, le législateur est
demeuré muet pour les autres actes. Or, il existe un principe essentiel
en matière de nullité selon lequel il ne peut y avoir de
nullité sans texte370.
En fait, il revient au juge du fond d'apprécier la
gravité des irrégularités. Un large pouvoir est donc
accordé au juge pour voir si les irrégularités en cause
sont substantielles ou non pour entrainer l'annulation de l'acte. Il en va
ainsi de l'acte dressé par une personne qui n'est pas investie des
fonctions d'état civil ; peu importe que cet acte ait été
régulièrement signé par la suite par l'officier
compétent, notamment lorsque l'acte est reçu par le
secrétaire général de mairie en l'absence du maire qui n'a
pas eu connaissance de l'acte371. L'acte peut être
régulier en la forme, mais les énonciations sont fausses ou sans
objet372 . Il peut s'agir d'un acte qui a constaté une
naissance imaginaire ou déjà déclarée373
. En revanche, les tribunaux peuvent refuser de prononcer la nullité
lorsque l'irrégularité est moins grave :
irrégularité portant sur l'indication du nom ou de l'âge si
les erreurs n'ont pas pour but de mettre en doute l'identité de
l'intéressé, acte dépourvu de la signature d'un
déclarant.
369 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.129.
370 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.130. ; CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 10e édition mise à jour quadrige, PUF, 2014,
p.694.
371 Civ. 27 mai 1952 : D 1953.125 S 1953. 1. 137.
372 Filiation portée en marge de l'acte de naissance
sans qu'un jugement ne soit intervenu : TPI Gagnoa, jugt n°44 du 25
octobre 1996 : CNDJ/REC JP CATBX 1996 n° 1 p 5 ; pour un acte de
naissance annulé, la naissance ayant été
déclarée à l'officier de l'état civil
compétent trois années plus tard, TPI Gagnoa jugt n°83 du
08/12/2004, mais après l'annulation le tribunal a décidé
que le jugement tenait lieu d'acte de naissance et devait être transcrit
sur le registre de l'état civil non pas de 2004, année du
jugement mais de 1968, ce qui est critiquable ; pour une fausse
déclaration : section de tribunal de Bongouanou, jugement n°825
du 27/07/1996 : CNDJ/ Rec CATBX 1996 n°2 p.134.
373 Naissance antérieurement déclarée
à l'état civil, annulation du second extrait d'acte de naissance
délivré : TPI DALOA, jugt n°86 du 11/11/2005, inédit
; dans le même sens, TPI Bouaflé, jugt n°78 du
09/06/2005, inédit.
161
- La rectification de l'acte de l'état
civil
Il s'agit d'une autre Il s'agit d'une autre sanction des
irrégularités touchant les actes. Elle consiste à corriger
les erreurs ou omissions commises par l'officier dans la rédaction d'un
acte de l'état civil. La rectification permet d'atténuer l'effet
des nullités. Tel est le cas par exemple de l'omission du nom d'une
personne. La loi ivoirienne prévoit deux sortes de rectification : l'une
judiciaire et l'autre administrative.
Considérant la rectification judiciaire, notons que
l'intervention du législateur s'explique par le fait qu'on veut
empêcher les changements frauduleux. La rectification judiciaire est
ouverte lorsque l'erreur ou l'omission est grave. C'est notamment le cas
lorsque l'acte de l'état civil est incomplet, surabondant ou inexact. Il
faut ajouter la question du changement d'état374 ou du
transsexualisme375 qui ne sera pas abordé vu que le juge
ivoirien ne semble pas encore avoir été saisi d'une telle
question.
L'acte est incomplet lorsqu'il a omis des indications
essentielles, c'est-à-dire celles qu'il devrait contenir (date ou lieu
de naissance...). La rectification consistera dans l'addition des mentions
manquantes376 .
374 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.131.
375 Mais elle se pose en droit français. D'abord, le
juge français a refusé de recevoir les actions en rectification
de l'acte de l'état civil estimant qu'en pareille hypothèse, il
s'agit d'une question d'état et qu'on ne peut utiliser l'action en
rectification pour changer de vie (Voir Tribunal civ Seine 18 janvier 1965
J.C.P, 1965, II , 14 421 ; civ.10 mai 1989.D.1989, IR.171 ; civ.21
mai1990. J.C.P 1990, II, 21.588.).
« En dépit des opérations auxquelles elle
s'était soumise, Nadine S. n'étant pas de sexe masculin ».
Cf. civ, 30 nov 1983. D. 1984. 165 « même après le traitement
hormonal et l'intervention chirugicale auxquels il s'est soumis., Norbert
B..continue de présenter les caractéristiques d'un sujet de sexe
masculin » Civ.31 mars 1987, D.1987.445 ; J.C.P 1988 II 21 000. Civ 7 juin
1988 Bull civ. I. N° 176p.122. Gaz. Pal. 1989. 1. 417 ; J.C.P. 1989 IV
286). La cour de cassation a donc refusé de prendre en compte le
phénomène transsexuel.
Mais cela n'excluait pas la possibilité pour le
transsexuel d'obtenir un changement de prénom pour un motif
légitime ( Civ, 21 mai 1990, 4e arrêt. J.C.P 1990.
II.21 588).
Ensuite, condamnée en 1992 par la Cour
européenne des droits de l'homme pour violation du droit à la vie
privée, et donc atteinte à l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, la Cour de cassation s'est alignée en décidant que
« lorsque à la suite d'un traitement médico-chirurgical,
subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le
syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères
de son l'autre sexe auquel correspond son comportement social, le principe du
respect dû à la vie privée justifie que son état
civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence, le principe de
l'indisponibilité de l'état des personnes ne faisant pas obstacle
à une telle modification » (Ass. Plen., 11 déc 1992. 2
arrêts, J.C.P 1993. II. 21 991).
376 CAA arrêt n°108 du 18 février 1977
préc ; TPI Daloa, jugt n°191 du 16/12/1994 : cndj/Rec
CATBX 1998 n°1 p 97, pour une omission du patronyme ; TPI Bouaké
jugt n°190 du 10/04 /1992 : cndj/Rec CATBX 1998, n°4 p 67 ;
TPI Man,jugt n°160 du 28 /10 /1994, pour une adjonction de
patronyme omis ; Pour la rectification
162
L'acte est surabondant lorsque l'acte contient des
énonciations non réglementaires, voire prohibées. Il en va
ainsi de l'indication des circonstances de la naissance sur un acte de
naissance ; la rectification aura pour but de supprimer ici les mentions
surabondantes377.
L'acte peut aussi contenir des énonciations inexactes.
En l'espèce, il peut s'agir d'un nom orthographié sans la
particule, des indications erronées sur le sexe de l'enfant, la date ou
le lieu de naissance ou encore d'un nom mal orthographié. La
rectification a pour but de corriger l'inexactitude378 .
Aux termes de l'article 78 de la loi relative à
l'état civil, la requête en rectification peut être
présentée par toute personne intéressée ou par le
procureur de la République. Il faut souligner que lorsque l'erreur ou
l'omission porte sur une indication essentielle, le Procureur doit agir
d'office. Dans l'hypothèse où la requête n'émane pas
de lui, elle doit lui être communiquée379. La
rectification est ordonnée par le Président du tribunal ou le
juge de la section de tribunal dans le ressort duquel l'acte a
été dressé ou transcrit. S'il s'agit de la rectification
d'un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de l'état
civil, compétence est dévolue au tribunal qui a rendu le
jugement380.
Comme on le voit, le législateur ivoirien, a
adopté, au nom du principe cardinal tenant à
l'intérêt supérieur de l'enfant, diverses lois de nature
civile en vue de protéger les droits de
d'un patronyme qui créerait une confusion : le tribunal
a débouté le demandeur, car l'enfant porte le nom patronymique de
son père, TPI Gagnoa, jugt n°12 du 20/04/2005,
inédit ; pour l'annulation d'un nom et l'adjonction de prénoms,
le nom ne permettant pas d'établir la filiation entre l'enfant et son
père géniteur : TPI Abengourou, jugt n°226 du
26/07/1995, CNDJ/ Rec JP CATBX n°3 /1999, p 186).
377 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.131.
378 CAA,arrêt n°108 du 18 février 1977
: RID 1978 n° 3-4 ,p 5, où le patronyme a été
rectifié en lui adjoignant la particule omise ; Section Trib Dimbokro,
jugt n° 15 du 05/02/1997 : cndj/Rec CATBX 1998 n°2 p 239,
pour une fausse déclaration, l'enfant ayant été
déclaré sous le nom de son oncle-dans le sens, enfant
déclaré sous le nom du frère de la mère en
l'absence du père : TPI Bouaflé ,jugt n°84 du
16/06/2005, inédit ; voir également Rec cndj/1999 n°2 p
196 pour une substitution de nom ; Section de trib Bouaflé, jugt
n°46 du 24 /04/1996 : cndj 1999 n°2 P 172, Section de Trib de
Sassandra, jugt n°08 du 17/01/1996, pour une erreur sur le
prénom ; pour une substitution du nom de la mère : TPI
Daloa,jugt n°109 du 13/08/1997, CNDJ/Rec CATBX 1997 n°1 P
185 ; orthographe du nom de la mère, TPI Gagnoa, jugt n°12 du
20/04 /2005 Préc ; pour une rectification du nom de « jeunesse
»du père : Section de Trib de Dabou, jugt n°05 du
18/01/2000, inédit. Voir également Sect Trib Sassandra, pour
une rectification du nom du père après avoir été
converti à l'islam, jugt n°183 du 03 /09/2003,
inédit ou nom donné par le père très attaché
à l'islam : TPI Bouaflé jugt n°140 du 24/11/2005,
inédit ; Pour patronyme mal orthographié, TPI Gagnoa, jugt
n°3 du 02/06/2004, inédit.
379 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.132.
380 Ibid.
163
l'enfant, notamment ceux touchant à l'état
civil. Cette volonté du législateur ivoirien au niveau de la
protection civile touche aussi la question de l'incapacité du mineur qui
fait l'objet d'un encadrement juridique rigoureux.
B. UN ENCADREMENT JURIDIQUE RIGOUREUX DE L'INCAPACITE
DU MINEUR DANS L'INTERET DE L'ENFANT
L'incapacité juridique frappant le mineur non
émancipé est une incapacité générale
d'exercice qui connait des exceptions. Elle a été rigoureusement
encadrée à travers des lois dans l'intérêt de
l'enfant. La protection qu'elle accorde à l'enfant est perceptible tant
au niveau de son étendue (1) que des sanctions prévues en cas de
non-respect des différentes incapacités (2).
1. L'étendue de l'incapacité du
mineur
L'étendue de l'incapacité est fixée par
l'article 27 de la loi sur la minorité. Aux termes de cet article,
« le mineur non émancipé est incapable de contracter
». Cette incapacité concerne tant les actes juridiques que les
actions en justice ; les faits juridiques en sont donc exclus381.
Le mineur non émancipé ne peut conclure d'actes
juridiques, c'est-à-dire des actes résultant d'une manifestation
de volontés produisant des effets de droit. Ainsi, le mineur non
émancipé ne peut par exemple, ni conclure le contrat de donation,
ni rédiger de testament. Par cette interdiction, le législateur
veut protéger le mineur qui manque de maturité, de
discernement382.
Quant aux actions en justice, notons qu'aux termes de
l'article 29 de la loi sur la minorité, « le mineur ne peut
agir ou défendre en personne qu'assisté de son
représentant légal dans toutes les instances ayant le même
objet ». Il apparait que le mineur non émancipé ne peut
agir sans l'aide de son représentant qui agit en son nom et pour son
compte. C'est le représentant donc qui peut ester en justice.
381 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.147.
382 Ibid.
164
Les faits juridiques donnés comme tout
événement indépendant de la volonté, mais
susceptibles de produire des effets de droits sont exclus de l'étendue
de cette incapacité du mineur en droit ivoirien. Cela dit, une question
mérite d'être posée : qu'en est-il par exemple, lorsque le
mineur renverse quelqu'un avec son vélo ? Autrement dit, le mineur
peut-il être tenu pour responsable ? L'intérêt de la
question réside dans le fait qu'une distinction était
opérée par la jurisprudence. En effet, avant la loi de 1970, une
distinction était opérée entre le mineur capable de
discernement et donc doué de raison, et le mineur qui n'a pas cette
capacité. Il s'agit du mineur âgé de 0 à 7 ans, qui
est appelé l'infans. Incapable de discernement, ce mineur est
considéré par la jurisprudence comme irresponsable. Ce sont les
parents qui répondaient de leurs faits. En revanche, les enfants
âgés de plus de 7 ans étaient capables de discernement, et
répondaient par conséquent de leurs faits. Ainsi, ceux-ci
pouvaient engager leur responsabilité personnelle, en plus de celle de
leurs parents383.
Avec la loi de 1970 sur la minorité, la distinction n'a
plus lieu d'être en ce sens qu'aux termes de l'article 32 «le
mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits, et
son enrichissement sans cause ». Ainsi désormais, tout enfant,
tout mineur répond de tous ses faits ; il est responsable de ses
faits384.
Cette responsabilité civile personnelle du mineur peut
s'ajouter à celle des parents sur la base de l'article 1384
alinéa 3 du code civil385. Il s'agit de la
responsabilité du parent qui exerce la puissance paternelle. En effet,
la responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa 3 n'est
pas une responsabilité solidaire des parents, mais celle du père
investi de la puissance paternelle sur la personne de son enfant mineur vivant
avec eux. Celle de la mère n'est envisagée qu'en cas de
décès du mari. Elle n'est donc pas solidaire386. Aussi
est-il important
383 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.147.
384 Ibid.
385 Section Trib Katiola, jugt n°6 du 5/03/1987,
in cndj/Rec CATBX 1996 n°2 p4, dans lequel le tribunal a retenu la
responsabilité du père en raison du fait dommageable de l'enfant
mineur au moment où l'enfant se trouvait chez sa mère, sur la
base de la présomption de l'exercice des droits de la puissance
paternelle par le père ; voir également, Cass civ
24/04/1989 bull civ n°89.
386 Dans ce sens, CS ch jud form civ arrêt n°344
du 16 /06/2005 : CNDJ / Rec CS ch jud form civ 2006/n°2.
165
de souligner que la rédaction de l'article 32 n'ouvre
pas la voie à la distinction entre l'infans et les mineurs
doués de raison387.
Toutefois, l'incapacité générale
d'exercice frappant le mineur non émancipé est assortie
d'exceptions. Ces exceptions constituent une sorte de capacité
d'exception et concernent les actes que le mineur non émancipé
peut faire lui-même. Il s'agit des actes concernant la personne
même du mineur et de ceux relatifs au patrimoine. Il faudrait cependant
s'interroger sur les actes de la vie courante.
Considérant les actes touchant à la personne du
mineur non émancipé, notons que les actes visés sont ceux
qui excluent la représentation du mineur non émancipé. La
représentation aurait signifié que le mineur était
frappé d'une incapacité absolue de jouissance. Les exceptions
sont prévues par l'article 29 de la loi aux termes duquel « les
actes qui intéressent personnellement le mineur, ne peuvent être
conclus qu'avec son consentement ». Il s'agit des actes concernant
notamment l'état du mineur. Mais, il faut que le mineur soit
âgé de plus de 16 ans. Il en va ainsi :
- Du mariage : le mineur se marie seul, sans le consentement
de son représentant légal. Mais la loi exige en plus de son
consentement, celui de ses parents388 ;
- De l'adoption : le mineur âgé de plus de 16 ans
doit consentir personnellement à son adoption389 ;
- De la reconnaissance d'enfant naturel : le mineur peut
reconnaitre tout seul son enfant ;
- De l'action en recherche de paternité390.
Comme on le voit, ces règles gouvernant l'état
du mineur, bien qu'excluant les enfants de moins de 16 ans, donnent la
possibilité aux enfants de plus de 16 ans, d'exprimer leur point de vue
dans les différents domaines susvisés. Ce faisant, elles sont en
phase avec la CIDE qui postule la prise en compte du point de vue de
l'enfant.
387 Contra, voir Mme TANO (Y.), Le mineur en droit
ivoirien, Thèse de doctorat d'Etat, 1982, p.163 ; lire
également l'article du Professeur KACOU (A.C.), Le mineur et la
responsabilité délictuelle en droit ivoirien, Annales de
l'Université d'Abidjan, DROIT.T.VIII.1988, p 47.
388 Article 5 loi relative au mariage.
389 Article 6 loi relative à l'adoption.
390 Cf. article 26 qui précise que la mère,
même mineure, peut intenter seule l'action.
166
Quant aux actes touchant le patrimoine du mineur non
émancipé, il s'agit essentiellement du contrat de travail, des
actes conservatoires et des actes visés par l'article 33. Aux termes de
l'article 31, le mineur peut conclure lui-même son contrat de travail.
Toutefois, une distinction doit être opérée. Il conclut son
contrat de travail et le rompt avec l'assistance de son représentant
légal à partir de 16 ans391. A partir de 18 ans, il
peut conclure et rompre seul son contrat de travail. Il en résulte
qu'entre 16 et 18 ans, la conclusion du contrat de travail se fait avec
l'assistance du représentant légal en droit
ivoirien392.
S'agissant des actes conservatoires, ils concernent l'ensemble
des actes qui ont pour but d'éviter au patrimoine une perte imminente.
Ce sont des actes qui sont donc utiles et qui n'engagent en principe aucune
dépense. L'article 30 précise que le mineur peut accomplir seul
tous ces actes393.
A ces actes susvisés, se greffent ceux prévus
à l'article 33. En effet, aux termes de l'article 33 « l'acte
accompli par le mineur non émancipé est valable si cet acte est
de ceux que son représentant légal aurait pu lui-même faire
seul ». Mais de quel acte s'agit-il ? S'il ne se pose pas de
problème pour les actes conservatoires, il n'en va plus de même
pour les actes d'administration que le représentant légal peut
faire seul, sans autorisation ni formalités. L'acte d'administration est
un acte de gestion courante du patrimoine du mineur non émancipé.
Ces actes faits par le mineur ne peuvent être attaqués s'ils
n'entrainent pour lui aucun préjudice. Il en va ainsi par exemple du
recouvrement d'une créance ou de la location d'une maison. En tout
état de cause, il faut distinguer l'acte d'administration de l'acte de
disposition.
Les actes de la vie courante ou autorisés par l'usage
constituent aussi une exception à l'incapacité
générale d'exercice du mineur non émancipé. Ici, la
question se pose de savoir si le mineur peut accomplir les actes de toujours ou
pour lesquels il est d'usage qu'un mineur de son âge agisse seul. Il
s'agit en fait des actes de la vie courante dont la passation s'avère
391 Il peut adhérer à un syndicat sauf opposition
de son représentant légal. Voir article 51.7.c.travail.
392 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.149.
393 Ibid.
167
parfois nécessaire394. Tels sont les cas de
l'achat de pain, de ticket de bus de transport ou encore achat d'ouvrages,
etc395.
L'intérêt de la question réside dans le
fait que le législateur ivoirien, contrairement à son homologue
français, ait passé sous silence le problème. En effet, en
droit français, la faculté d'accomplir les actes de la vie
courante a été expressément reconnue au mineur non
émancipé396. Cette faculté est également
reconnue aux mineurs non émancipés en droit
sénégalais397. En droit ivoirien, au contraire, la loi
sur la minorité ne fait aucunement pas allusion aux actes de la vie
courante. Cependant, la faculté qu'on pourrait reconnaitre au mineur non
émancipé peut juridiquement trouver son fondement dans les
dispositions de l'article 33, selon lesquelles « tous les actes
accomplis par le mineur non émancipé sont valables si ces actes
sont de ceux que son représentant légal aurait pu faire
lui-même seul ». Ce qui reviendrait à assimiler les
actes de la vie courante aux actes d'administration. En droit français,
pour la validité de la location d'une automobile par un mineur titulaire
du permis de conduire et disposant des fonds nécessaires au
dépôt de garantie, « le contrat de location de voiture ne
peut être attaqué pour incapacité, mais seulement pour
lésion »398 . Ce qui veut dire que cet acte fait
partie de ceux que l'administrateur peut passer seul. Par conséquent, le
mineur peut le passer. En revanche, l'achat d'une automobile par un mineur sans
l'autorisation de ses parents est nul399.
Au total, il apparait qu'avec toutes ces exceptions, en
Côte d'Ivoire, le champ d'application des incapacités de l'enfant
est réduit. Ce sont les actes accomplis dans cette sphère qui
seront frappés de sanction, et ce dans l'intérêt de
l'enfant.
394 Sur la question, voir MONTANIER (J.C), Les actes de la
vie courante en matière d'incapacité,
Sem-jur.1982.I.3076.
395 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.149.
396 Cf. arts 389 et 450. C. civ.
397 Cf. art 174 al3. Code de la famille.
398 Civ. 04 nov 1970.D.1971.186; sem-jur, 1971, II,16631
; RTD civ 1971.613.
399 Civ. 9 mai 1972. Gaz Pal 1972,2.871.
168
2. Les sanctions de l'incapacité du mineur, un
régime juridique favorable à l'enfant
La sanction frappant l'acte accompli en violation de
l'incapacité du mineur est normalement la nullité dudit acte.
Mais dans certains cas, le législateur ivoirien a prévu la
rescision pour lésion.
La nullité comme sanction des actes accomplis en
violation de l'incapacité est prévue par les articles 33 et
suivants de la loi. En effet, après avoir posé le principe de la
validité des actes accomplis par le mineur non émancipé,
l'article 33 in fine précise que de tels actes sont nuls de
plein droit s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait
pu faire qu'avec une autorisation. Il s'agit d'une nullité relative,
c'est-à-dire que seul le mineur peut agir en nullité. Ainsi,
durant la minorité, l'action appartient au représentant
légal et vise la protection d'intérêt particulier. Les
dispositions de l'article 34 alinéa 2 refusent au contractant la
possibilité d'opposer l'incapacité du mineur avec qui il a
contracté400.
Lorsque l'action aboutit, l'acte disparait de façon
rétroactive, et les parties doivent être remises en l'état.
Cependant, une exception existe en ce qui concerne le mineur non
émancipé. En effet, aux termes de l'article 37, «
lorsque l'action en nullité a été
déclaré fondée, le mineur n'est tenu au remboursement de
ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce
paiement a tourné à son profit », preuve qui n'est pas
toujours facile à rapporter. Ce qui conforte le régime de la
nullité dont l'objectif est la protection de l'enfant, à l'instar
de la sanction tenant à la rescision pour
lésion401.
Lorsque le mineur, agissant seul, a fait un acte que le tuteur
aurait pu faire sans formalités, c'est-à-dire sans l'autorisation
du conseil de famille, par exemple, l'acte accompli n'est pas
nécessairement nul402. Il n'en serait autrement que si le
mineur a subi une lésion. C'est ce que prévoit l'article 33
alinéa 2, sauf si la lésion résulte d'un
événement imprévu. En effet, aux termes de cet article,
les actes passés par le mineur sont rescindables en faveur du mineur,
pour cause de lésion. Il s'agit des actes qui rentrent dans les pouvoirs
d'administration du représentant légal, et qui ont
été accomplis par le mineur seul, sans avoir été
représenté ou assisté. Il en va ainsi en matière de
commande de vêtement, de location, de
400 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.151.
401 Ibid.
402 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.151.
169
logement. Dans ces cas, la sanction consiste dans la
rescision. L'acte est entaché certes de nullité, mais il ne
pourra être attaqué que s'il est prouvé qu'il a
causé une lésion au mineur. La lésion est le
préjudice (pécuniaire) résultant du contrat au moment
où celui-ci a été passé. La preuve consiste
à démontrer que le cocontractant a abusé de
l'inexpérience du mineur et lui a imposé des conditions
onéreuses403. Ainsi, dans la vie courante, les tiers peuvent
contracter avec les mineurs sans s'inquiéter de leur minorité,
dès lors qu'il s'agit d'actes peu importants et qu'ils n'abusent pas de
leur inexpérience404.
Une autre forme de reconnaissance juridique de la protection
accordée à l'enfant réside dans le régime de
protection du mineur non émancipé, qui apparaît
incontestablement comme un levier d'encadrement juridique des droits parentaux
à l'égard de leurs enfants.
C. LE REGIME DE PROTECTION DU MINEUR NON EMANCIPE, UN
MOYEN DE CONTROLE DES DROITS PARENTAUX A L'EGARD DE LEURS ENFANTS
La protection du mineur non émancipé se fait
à travers le système de représentation. Au nom de
l'intérêt supérieur de l'enfant, la loi ivoirienne
prévoit deux modes de représentation. D'une part, la
représentation par les parents à savoir la puissance paternelle
remplacée depuis 2012 par l'autorité parentale ; et d'autre part,
la représentation par le tuteur, la tutelle lorsque les père et
mère sont décédés ou empêchés ou dans
l'impossibilité d'exercer les droits de la l'autorité
parentale.
403 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.151-152.
404 Voir civ. 18 juin 1844 : D.P. 1844, 1. 123 ; Gds
Arrêts n° 67- Paris, 10 juin 1964 : sem jur 1965 II, 13980.
170
1. La substitution de l'autorité parentale
à la puissance paternelle
Pendant longtemps, en Côte d'Ivoire, le droit de la
famille a organisé la protection de l'enfant sous le prisme de la
puissance paternelle. L'instauration de l'autorité parentale en lieu
place de la puissance paternelle s'est faite récemment en 2012. Il
importe donc de dire quelques mots sur le passage de la puissance paternelle
à l'autorité parentale affirmée dans la nouvelle loi
n°2013-33- du 25 janvier 2013 portant abrogation l'article 53 et modifiant
les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n°64-375 du 07 octobre 1964
relative au mariage telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02
Août 1983.
La puissance paternelle se présente comme l'ensemble
des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et
sur les biens de leurs enfants, mineurs et non
émancipés405. C'est une institution qui est commune
à la famille légitime, à la famille naturelle et à
la famille adoptive. Elle présente un certain nombre de
caractéristiques : la puissance paternelle appartient au père et
à la mère, mais non aux ascendants ; elle prend fin à la
majorité de l'enfant ou avec son émancipation ; elle est d'ordre
public, c'est-à-dire qu'elle échappe à la volonté
des intéressés et est par conséquent hors du commerce.
Celui qui la détient ne peut y renoncer ou la céder en
totalité dans ses attributs406. Une éventuelle
cession, notamment celle tendant à limiter ou à modifier
l'exercice de la puissance paternelle serait frappée de nullité.
Dans la même veine, toute convention par laquelle un mari,
séparé de fait de sa femme, autorise celle-ci à s'occuper
exclusivement des enfants communs fut frappé de
nullité407 . La puissance paternelle est un droit
aménagé dans l'intérêt des enfants, et non dans
celui de son détenteur. Dans certains Etats, on parle plutôt
d'autorité parentale. C'est cette appellation qui est aussi
utilisée en droit burkinabè408, comme en droit
congolais409 et français. Le droit burkinabé exprime
cela avec une remarquable formulation. Ainsi, il est précisé
à l'article 510 du CPF burkinabè que l'autorité parentale
a pour but d'assurer la
405 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 10e
édition mise à jour, Quadrige, PUF, 2014, p.830.
406 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.152.
407 Paris, 25 avril 1913 : S.1914, 2.40 ; renonciation au
droit de visite : T.G.II. RIOM, 27 sept 1967 : D.1967.743 ;
l'incessibilité du droit de garde ; Paris, 5 mai 1955 : D.1955, 638.
408 Voir chapitre III du titre V du CPF.
409 Voir chapitre 1er du titre X du CF intitulé
« De l'autorité des père et mère ».
171
sécurité de l'enfant, sa santé, son plein
épanouissement et sa moralité. C'est donc un pouvoir de
protection des enfants et les prérogatives reconnues aux
détenteurs ne sont que la contrepartie des devoirs et de la
responsabilité que leur impose le fait de la procréation. Le
détenteur est assujetti à un contrôle et peut être
déchu. C'est dire qu'elle n'est pas intangible. Le détenteur de
la puissance paternelle a le devoir d'user de ses prérogatives dans
l'intérêt supérieur de l'enfant410. En droit
français, on ne parle plus depuis une loi de 1970 de puissance
paternelle, mais d'autorité parentale pour montrer d'une part, que les
rapports des père et mère avec l'enfant cessent d'être
conçus comme un pouvoir de domination sur la personne : Elle apparait
comme une autorité conférée aux parents pour
protéger l'enfant ; d'autre part, on affirme que l'autorité est
exercée au même titre et de concert par le père et la
mère. Il s'agit d'une proclamation de l'égalité des
parents411.
Le législateur ivoirien a opéré une
réforme de sa législation en 2012 afin d'instaurer
l'autorité parentale en lieu et place de la puissance paternelle. Le
débat parlementaire sur de nouveaux textes de loi modifiant le code de
la famille dans un sens favorable aux droits des femmes a été
particulièrement agité en Côte d'Ivoire. La fin du
"chef de famille", en particulier, a eu bien du mal à
passer412.
Le 21 novembre 2012, le parlement ivoirien a finalement
voté de nouveaux textes de lois portant sur la modification du Code de
la famille. Modifications qui, selon l'exposé des motifs du
gouvernement, visaient à mettre en adéquation le droit ivoirien
et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discriminations à l'égard des femmes des Nations-unies,
ratifiée par le pays en 1995. Les changements et le vote de cette loi ne
se sont pas faits sans débats entre pro et anti militants de la
réforme au sein de l'Assemblée nationale. Il s'agit de ceux qui
pensent que les priorités sont ailleurs, à l'instar de la
députée Yasmina OUEGNIN, qui justifie son « non »
à la loi en ces termes : « d'innombrables textes ont
été votés depuis notre indépendance en faveur de la
protection de la femme et de l'enfant (...) sans la production du moindre effet
notable (...) Il me paraît donc plus important et urgent
410 Voir DONNIER, L'intérêt de l'enfant,
D.1956, chr, 179.
411 Sur la loi de 1970, voir COLOMBET (C.), commentaire de
la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale, D.1971, chron.1.
GOBERT (M.), L'enfant et les adultes, Sem jur 1971, I.2421.
412
http://www.jeuneafrique.com/173177/politique/c-te-d-ivoire-qu-est-ce-qui-change-dans-le-code-de-la-
famille/
( 02/05/2017).
172
de commencer par donner du sens à ces acquis en
invitant l'exécutif à appliquer rigoureusement les lois
déjà adoptées »413.
Malgré ces oppositions, cette loi a finalement
été votée le 21 novembre par une écrasante
majorité de députés (213 voix pour, 10 contre et 6
abstentions)414. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le fond
?
Quelles sont les modifications apportées par les
nouvelles lois ? Un article de la loi n°64375 du 07 octobre 1964 relative
au mariage telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 02 Août
1983 abrogé (article 53), quatre modifiés (58, 59, 60 et 67).
Dans son exposé des motifs, le gouvernement ivoirien justifie ces
changements par la volonté de « consacrer » le
principe de l'égalité entre les sexes et de renforcer «
l'autonomisation des femmes ». L'article 53 qui stipulait que
« l'homme et la femme [contribuaient] aux charges du mariage en
proportions de leur facultés respectives » a été
purement et simplement abrogé. Et si dans son ancienne version,
l'essentiel des charges du foyer pesaient sur le mari, la nouvelle version de
la loi, en son article 59, répartit les dépenses entre les deux
conjoints.
De même, le domicile conjugal doit désormais
être choisi d'un commun accord (article 60 nouveau), alors que dans
l'ancien code, la décision du lieu de résidence revenait à
l'époux. L'article 67 stipule désormais que « chacun des
époux a le droit d'exercer la profession de son choix, à moins
qu'il ne soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession
est contraire à l'intérêt de la famille ». Dans
sa version antérieure, l'article ne mentionnait que la femme, ouvrant la
porte à de multiples interprétations, comme celle disant qu'elle
avait besoin de l'accord de son époux pour exercer une activité
professionnelle.
Mais, le principal point de discorde réside au niveau
de l'article 58 de l'ancien code civil ivoirien. L'article 58 ancien du Code
civil ivoirien dispose de façon directe et claire, que l'homme est le
chef de la famille. Et à ce titre, il exerce cette fonction, dans
l'intérêt commun du ménage et enfants. Il est
évident que la formulation ancienne du Code civil ivoirien, qui
était identique à l'actuelle disposition du Code civil d'un autre
pays africain, le Cameroun, et selon lequel, à son article 213, le mari
est considéré comme étant le chef de la famille,
413
http://www.jeuneafrique.com/173177/politique/c-te-d-ivoire-qu-est-ce-qui-change-dans-le-code-de-la-
famille/ (consulté le 25/02/2016)
414
http://www.jeuneafrique.com/173177/politique/c-te-d-ivoire-qu-est-ce-qui-change-dans-le-code-de-la-famille/
(consulté le 25/02/2016)
173
174
consacrait la conception paternaliste du mariage, et du foyer
conjugal, dirigé par l'homme et dans lequel, la femme n'a qu'un
rôle d'assistance et de soutien, de participation aux charges du
ménage dans la limite de ses capacités, sans obligation, puisque
l'obligation repose sur le mari. Désormais, la nouvelle mouture
énonce que : « la famille est gérée conjointement
par les époux, dans l'intérêt du ménage et des
enfants ».
Dans la forme, lors d'un mariage civil, le maire ne commencera
plus de cérémonie par le traditionnel « l'homme est le
chef de famille ». Dans le fond, si la nouvelle loi donne les
mêmes droits aux deux époux, elle leur donne aussi les mêmes
devoirs. Par exemple, l'homme peut maintenant contraindre son épouse
à contribuer aux frais du ménage par voie de justice, ce qui
n'était pas le cas auparavant.
Dans les faits, le Code de la famille ne fait que s'adapter
à l'évolution de la vie quotidienne de l'Ivoirien urbain car,
avant le vote de cette loi, les femmes contribuaient déjà aux
charges de la famille. Leur donner des droits équivalents à ceux
des hommes, c'est simplement légaliser une pratique déjà
existante.
Mieux, la nouvelle Constitution ivoirienne de 2016, en son
article 31, vient consacrer explicitement l'autorité parentale en ces
termes : « La famille constitue la cellule de base de la
société. L'Etat assure sa protection. L'autorité parentale
est exercée par les père et mère ou à
défaut, par toute autre personne conformément à la loi.
».
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs reconnus aux parents en vertu de la loi, relativement à la
personne de leur enfant.
Il ressort que la nouvelle formulation du législateur
ivoirien change la donne. Désormais, le mari n'aura plus le titre de
chef. Ce qui, de facto, équivaut à un partage de
l'exercice de l'autorité parentale à part égale au sein du
foyer. De plus, la nouvelle formulation entraine de facto et de jure,
une codirection morale et matérielle de la famille, puisque celle-ci est
conjointement dirigée par les époux. De manière plus
précise, une codirection entraine un meilleur équilibre juridique
dans les décisions du ménage. Elle entraine aussi deux visions,
qui, en cas de désaccord du fait de la différence des
époux par le fait de leur éducation, religion,
personnalité, origine, pourrait transformer le couple, plus en lieu de
désorientation qu'en un havre de paix et d'épanouissement, tant
de la femme que des enfants, qui est l'objectif du législateur
ivoirien.
Mais comment s'opère en Côte d'Ivoire le
contrôle des droits reconnus aux parents dans l'intérêt de
l'enfant ?
2. Du contrôle à la
déchéance de l'autorité parentale, une mesure de
protection de l'enfant
Pour assurer la protection de l'enfant, le législateur
ivoirien a prévu des mesures de contrôle et de
déchéance dans l'exercice de l'autorité parentale.
- Le contrôle de l'autorité
parentale
Le législateur prévoit des modalités de
contrôle à travers les mesures d'assistance éducative et la
délégation de l'autorité parentale.
Les mesures d'assistance éducative sont des mesures
dont peuvent faire l'objet des mineurs, soit de leur fait, ou celui des
parents415. Ce qui signifie que l'assistance éducative
intervient dans des cas énumérés par la loi. C'est ainsi,
qu'en ce qui concerne le mineur lui-même, les mesures peuvent être
prises lorsqu'ils sont d'une inconduite ou d'une indiscipline donnant aux
parents ou aux personnes investies du droit de garde des sujets de
mécontentement très graves416. C'est par exemple le
cas du mineur qui se drogue.
Du côté des parents, il est question de
l'immoralité ou de l'incapacité des pères et mère
de la personne investie du droit de garde qui compromet la santé, la
sécurité ou l'éducation de l'enfant. C'est l'exemple du
père alcoolique ou de la mère prostituée. Les mesures sont
décidées par le juge des tutelles qualifiée ou
d'organismes spécialisés417.
En tout état de cause, ces mesures ne mettent pas fin
à l'autorité parentale, et les parents doivent continuer à
entretenir le mineur.
Quant à la délégation des droits de
l'autorité parentale, c'est le fait pour les parents titulaires de
l'autorité parentale de se dessaisir ou d'être dessaisi en faveur
d'un tiers. Elle peut être volontaire ou judiciaire418.
415 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 10e
édition mise à jour, Quadrige, PUF,2014, p.93 ; BROU (K.M.),
Droit civil, Droit des personnes et de la famille, Nouvelle édition
2013, Les éditions ABC, 2013, p.160.
416 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.160-161.
417 Article 11 de la loi ivoirienne sur la minorité.
418 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.161.
175
La délégation volontaire résulte de la
volonté de ceux qui exercent l'autorité parentale de la
déléguer à un tiers, qui doit être capable. La
délégation est temporaire et elle s'opère par
déclaration conjointe des parties intéressées qui sont
reçues par le juge des tutelles. C'est dire que la
délégation volontaire se fait devant le juge des tutelles. Elle
prend fin à l'expiration du délai convenu419.
Pendant sa durée, les droits et obligations relatifs
tant à la garde du mineur qu'à son instruction, son
éducation et sa surveillance passent au délégataire. Mais
il faut souligner que tout doit se faire dans l'intérêt de
l'enfant. Les parties doivent déterminer l'étendue des droits et
obligations délégués.
Quant à la délégation judiciaire, elle
est ordonnée par le juge et vise le mineur recueilli par une personne et
qui n'a pas fait l'objet de réclamation depuis 3 mois. Bien entendu,
cela suppose que cet enfant recueilli ait fait l'objet d'une déclaration
régulière du juge des tutelles420, par celui qui l'a
trouvé.
Dans les deux cas, les parents ou le tuteur peuvent demander
au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu421; c'est dire
que la délégation (volontaire ou judiciaire) a un
caractère provisoire.
- La déchéance de l'autorité
parentale et le retrait des droits : des garanties juridiques pour le
bien-être de l'enfant
La déchéance est prévue aux articles 20
à 23 de la loi sur la minorité. Il existe deux types de
déchéance : la déchéance de plein droit et la
déchéance facultative.
La déchéance de plein droit se présente
comme une sanction encourue par un parent, suite à une condamnation
pénale. C'est ce que prévoit l'article 20 pour les parents
proxénètes lorsque les victimes sont leurs enfants, ou s'ils sont
auteurs, coauteurs ou complices de crime commis par un ou plusieurs de leurs
enfants422.
419 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.161.
420 Articles 16 et 17 de la loi ivoirienne sur la
minorité.
421 Articles 18 et 19 de la loi ivoirienne sur la
minorité.
422 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.162.
176
Quant à la déchéance facultative, elle
est prononcée contre les père et mère condamnés
pour des infractions comme l'abandon d'enfant. Il faut préciser en outre
que la déchéance facultative peut être prononcée en
dehors de toutes condamnation pénale. C'est le cas en présence
d'une inconduite notoire des parents. Dans tous les cas, le juge dispose dans
cette hypothèse d'un pouvoir d'appréciation.
L'action en déchéance ou en retrait partiel des
droits de l'autorité parentale appartient à tout membre de la
famille et au ministère public423.
Le parent qui est déchu de l'autorité parentale
peut néanmoins demander qu'on lui restitue les droits. Par ailleurs,
celui qui a été déchu de l'autorité parentale peut
obtenir la restitution de ses droits, à condition qu'il ait
été réhabilité ; il en va de même en cas de
retrait desdits droits. A cet effet, il peut exercer une action en restitution
devant le juge des tutelles qui se prononcera en tenant compte de
l'intérêt de l'enfant, critère déterminant dans le
cadre des règles gouvernant l'adoption des enfants424.
Les développements qui précèdent nous
montrent que le législateur ivoirien, dans le but de protéger
l'enfant et ses droits a adopté une série de lois civiles
importantes, qui ont pour critère commun, l'intérêt
supérieur de l'enfant. Cette même dynamique juridique de
protection des enfants et de leur bien-être se retrouve aussi au niveau
des lois de nature sociale qui se caractérisent par leur
diversité.
§ 2. UNE DIVERSITE DE LOIS SOCIALES PROTECTRICES
DE L'INTERET DE L'ENFANT
En matière sociale, il existe des lois
antérieures ou postérieures aux normes juridiques internationales
pertinentes qui protègent les droits des enfants. On essaiera de passer
en revue les plus pertinentes. Ainsi après avoir analysé la
reconnaissance législative du droit à l'éducation (A),
nous examinerons successivement l'encadrement juridique constant du travail des
enfants (B) une loi portant statut de pupille de la nation (C) nombreuses
autres lois sociales portant protection des enfants (D).
423 Pour un retrait de la puissance paternelle, voir CA
Daloa arrêt n°111 DU 27/06/1995, Cndj/Rec CATBX 1197n°2
P.113.
424 BROU (K.M.), Droit civil, Droit des personnes et de la
famille, Nouvelle édition 2013, Les éditions ABC, 2013,
p.162.
177
A. UNE RECONNAISSANCE LEGISLATIVE DU DROIT A
L'EDUCATION
Historiquement, les premières écoles qui ont
été introduites en Côte d'Ivoire servaient à former
des agents au service du colonisateur. Les élèves y
étaient enseignés selon le programme éducatif
français.
A la faveur des indépendances des pays africains, il
était normal de former des nationaux qui travailleront désormais
au service de leur pays. « Cela supposait donc un
réaménagement des programmes de l'enseignement dans le sens de
leur adaptation aux réalités culturelles du pays
»425. C'est dans ce sens que le
Président de la République de Côte d'Ivoire de
l'époque, Félix HOUPHOUET-BOIGNY, promulgua le 18 août 1977
la loi n° 77-584 portant réforme de l'enseignement.
Avec le temps, la mobilisation sociale stimulée par les
agences d'aide des Nations Unies et appuyées par les bailleurs de fonds,
va inciter la communauté éducative à une révision
de la loi sur l'enseignement. En 1994, une Concertation Nationale sur
l'Ecole Ivoirienne, regroupant les différents partenaires, a
élaboré un rapport, qui a servi de base à la
réforme promulguée par la loi du 17 septembre 1995426.
Ainsi, conformément à la Constitution
ivoirienne427 et à ses obligations internationales en
matière de droits de l'enfant, l'Assemblée nationale ivoirienne
vota la loi n°95-696 du 7 septembre 1995 portant réforme de
l'enseignement qui énonce les principes gouvernant
l'éducation.
Cette loi réaffirme le droit à
l'éducation et l'égalité de traitement de tous les
citoyens, notamment dans l'enseignement public. Elle est composée de
cinq (5) titres comprenant 74 articles consacrés aux principes
généraux, aux droits et obligations de la communauté
éducative, à l'enseignement préscolaire et primaire,
à l'enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur et
aux dispositions transitoires et finales. Soulignons qu'il n'existe aucune loi
spécifique au droit à l'éducation de l'enfant.
425 Propos recueillis auprès de l'inspectrice de
l'enseignement primaire de la Sous-préfecture de Taabo, lors d'un
entretien en date du 10 Aout 2014.
426 ODOUNFA (A.), « Le défi de l'éducation
pour tous en Côte d'Ivoire », in Background paper prepared for
the Education for All Global Monitoring Report 2003/4 Gender and Education for
All: The Leap to Equality, UNESCO, 2003, p. 7.
427 Article 101 Constitution du 08 novembre 2016 : «
La loi fixe les règles concernant (...) les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ». ; (Voir également Article 71 Constitution du
01er Aout 2000).
178
La loi n°95-696 du 7 septembre 1995 portant
réforme de l'enseignement établit des principes fondamentaux
sur lesquelles l'éducation dispensée doit se fonder : la
neutralité, la gratuité et
l'égalité428.
Le principe de neutralité429,
appliqué à l'éducation, signifie que l'école
publique est non confessionnelle et l'enseignement qui y est donné est
areligieux430. Sur l'éducation, ne doit dominer
aucun courant de pensée politique ou philosophique.
Quant au principe de gratuité, il signifie que
l'enseignement dispensé ne doit pas être onéreux. Mais, il
ne s'applique pas aux droits d'inscription, aux prestations sociales et aux
charges relatives aux manuels et autres fournitures scolaires431 .
Il est d'ailleurs affirmé par les différentes conventions
supra évoquées.
En ce qui concerne le principe de
l'égalité, il « impose la non-discrimination entre
les usagers, quels que soient leur race, leur genre, leurs opinions politiques,
philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou
géographique »432 . On peut dire qu'il tire aussi
son fondement de l'article 30 de la Constitution ivoirienne : «
La République de Côte d'Ivoire...assure à tous
l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race,
d'ethnie, de sexe et de religion. Elle respecte toutes les croyances
».
Toutefois, ladite loi n'institue pas l'obligation scolaire
comme principe malgré une proposition faite en ce sens, dans le
temps, par le ministre M. Pierre Kipré à l'Assemblée
Nationale, refusée « faute de moyens de contrôle
»433. Selon l'UNESCO, la Côte d'Ivoire se serait
à présent dotée d'un cadre législatif rendant
l'école obligatoire de 6 à 16 ans434.
Le travail des enfants fait aussi l'objet d'un encadrement
législatif constamment renouvelé.
428 Cf. article 2 de la loi n°95-696 du 7 septembre 1995
portant réforme de l'enseignement.
429 On peut l'appeler aussi « principe de
laïcité ». Il tire aussi son fondement de l'article 30 de
la Constitution ivoirienne : « La République de
Côte d'Ivoire est...laïque ».
430 ROBERT (J.), Droits de l'Homme et libertés
fondamentales, Paris, Montchrestien, 5è éd., 1993, p.
546.
431 Article 2 de la loi n°95-696 du 7 septembre 1995
portant réforme de l'enseignement.
432 Article 2 de la loi la loi n°95-696 du 7 septembre
1995 portant réforme de l'enseignement.
433 LANOUE (E.), « Côte d'Ivoire », in
Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring
Report 2003/4 Gender and Education for All: The Leap to Equality, UNESCO,
2003, p. 1.
434 UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l'EPT
2002:Éducation pour tous. Le monde est-il sur la bonne voie ? ,
disponible sur :
www.unesco.org/education/efa.
(Consulté le 02/03/2015).
179
B. UN ENCADREMENT JURIDIQUE CONSTANT DU TRAVAIL DES
ENFANTS
En Côte d'Ivoire, le travail des enfants a de tout temps
fait l'objet de réglementation juridique en vue d'une meilleure
protection de l'intérêt des enfants. Cette volonté est
manifeste tant au niveau du code du travail que de lois spéciales
postérieures à ce code.
La loi de 1995 portant code du travail assure la
réglementation du travail des enfants. Nous citerons ici les articles
les plus significatifs. L'article 23-2 du code du travail fixe l'âge
minimum d'accès au travail à 14 ans. Celui-ci interdit de
recevoir même comme apprenti un mineur de 14 ans. Avant l'âge de 14
ans, le mineur doit consacrer son temps aux études ou à la
formation professionnelle ; Les travaux de nuit et les travaux dangereux sont
interdits435 ; L'enfant qui travaille doit offrir librement sa force
de travail et travailler dans des conditions acceptables. Il ne doit pas
être privé de sa liberté de mouvement et il doit percevoir
sa rémunération sinon ce travail est assimilable au travail
forcé et à l'esclavage interdit par la Constitution, le code du
travail436 et le code pénal437. La mise en gage
d'un mineur de 15 ans est sanctionnée par un emprisonnement de cinq
ans438 .
L'examen du code du travail révèle que celui-ci
présente quelques atouts et faiblesses en matière de
réglementation du travail des enfants.
L'interdiction du travail forcé à des mineurs,
l'interdiction du travail précoce aux enfants mineurs de 14 ans et
l'interdiction des travaux de nuit et des travaux dangereux aux mineurs de
moins de 18 ans constituent à n'en point douter des
éléments positifs s'inscrivant dans l'intérêt
supérieur de l'enfant.
En ce qui est des faiblesses, on peut regretter le fait que le
code du travail ivoirien de 1995 n'ait pas réglementé tous les
secteurs d'activité où s'exerce le travail des enfants. Il en va
ainsi de l'absence de réglementation du travail des enfants dans les
domaines de l'agriculture et les mines artisanales. De même, il ne
définit pas les travaux dangereux et les travaux interdits aux enfants
mineurs ; Une autre faiblesse réside dans la faculté
accordée à
435 Article 22-3 du code de travail ivoirien.
436 Article 3 code du travail ivoirien.
437 Articles 376 et 378 du code pénal ivoirien.
438 Article 377 du code du travail.
180
l'inspecteur du travail d'accorder des dérogations en
ce qui concerne les travaux de nuit et les travaux dangereux même pour
les mineurs.
C'est certainement conscient de ces faiblesses que le
législateur ivoirien, à travers de nouvelles et récentes
lois, va procéder à une définition légale des
travaux dangereux interdits aux enfants pour aboutir à la
consécration de l'interdiction de la traite et des pires formes de
travail des enfants. En effet, la volonté législative des
pouvoirs publics de lutter légalement contre la question du travail
nuisible aux enfants s'est fait en deux temps.
D'une part, l'arrêté du 14 mars 2005 qui a le
mérite de dresser la liste des travaux dangereux et interdits aux
mineurs de moins de 18 ans. Cette liste concerne plusieurs domaines à
savoir : l'agriculture et la foresterie, les mines, le commerce et le secteur
urbain domestique, l'artisanat et le transport. Aux termes de l'article
1er dudit arrêté, sont qualifiés de travaux
dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, les travaux dont la liste
suit et qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la
sécurité ou à la moralité de l'enfant :
- Dans l'agriculture : l'abattage des arbres ; le
brûlage des champs ; l'épandage de produits chimiques
(insecticides, herbicides, fongicides, nematicides, etc...), l'épandage
des engrais chimiques, le traitement chimique des pépinières ; le
port de charges lourdes ;
- Dans les mines : la foration et les tirs de mine, le
transport des fragments ou des blocs de pierre ; le concassage, l'extraction de
minerai à l'aide de produits chimiques tels que le cyanure de sodium,
l'acide sulfurique, le dioxyde de soufre, le travail dans les mines
souterraines ;
- Dans le commerce et le secteur urbain domestique : la vente
de support à caractère pornographique, le travail dans les
débits de boisson, la récupération d'objet dans les
décharges publiques ;
- Dans l'artisanat : l'ajustage, le meulage, la vidange,
l'affûtage, le fraisage, le laminage, la descente de moteur, la
manipulation des batteries, la fabrication et la réparation d'armes
à feu, la production de charbon de bois, et le métier de
bûcheron, le ponçage motorisé de cuir et le tannage de la
peau, la teinturerie et l'impression ;
- Dans le transport : l'activité d'apprenti de mini cars
communément appelé gbaka.
181
L'article 2 précise que la liste des types de travaux
ci-dessus énumérés sera, au besoin révisée
chaque année.
Pour être un instrument juridique salutaire, cet
arrêté du 14 mars 2005, n'a pas été et n'est
toujours pas suffisamment vulgarisée au niveau des populations par les
autorités politiques ou administratives.
D'autre part, vu la persistance du travail nuisible à
l'intérêt supérieur et au bien-être des enfants, la
loi n° 2010-272 portant interdiction de la traite et des pires formes de
travail des enfants en Côte d'Ivoire fut adoptée le 30 septembre
2010.
La loi n°2010-272 portant interdiction de la traite et
des pires formes de travail des enfants en Côte d'ivoire appelle à
une double présentation aussi bien formelle que substantielle. En effet,
pris d'abord sous l'angle purement formel, cette loi se compose de 43 articles
subdivisés en cinq chapitres à savoir les dispositions
générales439, les définitions440, la
prévention441, les sanctions442 et les
dispositions finales443. Par ailleurs, cette loi, facilement
accessible en ses termes et foncièrement digeste dans son sens, se donne
pour objectif de définir, de prévenir et enfin de réprimer
la traite et le travail dangereux des enfants et prendre en charge les victimes
comme en témoigne l'article 1 de ladite loi. Cet article s'inscrit dans
le droit fil des instruments internationaux de protection des droits de l'Homme
qui énoncent, consacrent et promeuvent les valeurs principielles de
dignité, d'égalité et de nondiscrimination. Ainsi, sont
concernés par cette loi, tous les enfants « quels que soient
leur race, leur nationalité, leur sexe et leur religion résidant
ou séjournant sur le territoire de la république de Côte
d'ivoire ». L'article 4 interdit les pires formes de travail des
enfants. Ces pires formes de travail sont définies de manière
énumérative, et assurément non limitative en y incorporant
entre autres, toutes les formes d'esclavage et pratiques analogues,
439 Articles 1 et 2 de la loi n° 2010-272 portant
interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en
Côte d'ivoire fut adoptée le 30 septembre 2010.
440 Articles 3 à 15 nouveau de la loi n° 2010-272
portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en
Côte d'ivoire fut adoptée le 30 septembre 2010.
441 Articles 16 nouveau à 17 nouveau de la loi n°
2010-272 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des
enfants en Côte d'ivoire fut adoptée le 30 septembre 2010.
442 Articles 18 nouveau à 39 de la loi n° 2010-272
portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en
Côte d'ivoire fut adoptée le 30 septembre 2010.
443 Articles 40 à 43 de la loi n° 2010-272 portant
interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en
Côte d'ivoire fut adoptée le 30 septembre 2010.
182
183
l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à
des fins d'exploitation sexuelle. Ce faisant, cette définition
épouse, sans différence majeure, celle du protocole additionnel
à la convention, le Protocole relatif à la vente d'enfants,
à la prostitution et à la pornographie infantile. De plus, Cette
loi innove en prévoyant en amont, des mesures visant la protection de la
traite et des pires formes de travail des enfants. Ainsi, aux termes de
l'article 17 de la loi, ces mesures de prévention nécessitent,
voire, exigent la participation et la conjugaison des efforts de l'État
et des collectivités territoriales auxquels la loi enjoint de prendre
« toutes les mesures appropriées » en vue d'assurer
la protection de tous les enfants contre de telles pratiques. Ces mesures de
prévention, au coeur desquelles se trouvent l'intérêt
supérieur et la dignité de l'enfant, comprennent
l'obligation pour le transporteur de vérifier que l'enfant qui
voyage détient tous les documents légaux et les autorisations
administratives requis, la présomption du statut d'enfant
accordée à la victime, une autorisation spéciale en cas de
sortie et d'entrée du territoire national pour les enfants non
accompagné de ses parents ou tuteur...
La loi prévoit enfin des mesures de sanction visant
à lui donner une force doublement probante à savoir dissuasive et
surtout punitive. Et pour cause, que serait une loi sans mesure de sanctions ?
Assurément, un condensé de valeurs et principes axiologiques
dépourvus de force contraignante. Ces mesures de sanctions sont aussi
diverses que variées allant des peines d'emprisonnement de 1 à 20
ans selon les cas ou de la qualité des personnes incriminées, des
amendes pouvant aller jusqu'à 50 millions de Franc CFA, des sanctions
administratives et professionnelles. Aussi, convient-il de rappeler que les
infractions prévues dans la présente loi constituent, aux termes
de l'article 39, des délits dont la tentative est punissable.
Toutefois, si l'on en croit une étude de
l'OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux
fins d'exploitation de leur travail dans le secteur informel à
Abidjan-Côte d'Ivoire», ces dispositions ( mesures de
prévention et de sanction) semblent être inadéquates pour
lutter contre la traite des enfants aux fins d'exploitation économique,
dans la mesure où elles ne visent que les cas d'enlèvement de
mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d'enfants en
Côte d'Ivoire s'appuie sur les réseaux traditionnels de placement
d'enfants et s'effectue par conséquent avec l'accord des parents ou des
personnes ayant la garde des enfants.
Somme toute, l'adoption de la loi 2010-27 du 30
décembre 2010 a constitué à n'en point douter une
avancée législative majeure dans la lutte contre la traite, le
trafic, l'exploitation des enfants en Côte d'ivoire. Cependant, les
mesures de vulgarisation et d'application de cette loi, à l'effet
d'amorcer une évolution à défaut d'une révolution
des habitudes socioculturelles des populations, sont-elles véritablement
prises ?
Outre cela, la Côte d'Ivoire a récemment
adopté une loi portant statut de pupille de la nation qu'il convient
d'examiner à la lumière de l'intérêt des enfants.
C. LA LOI DEFINISSANT LE STATUT DE PUPILLE DE LA
NATION
Adoptée par l'Assemblée nationale lors de la
séance plénière de sa première session
extraordinaire au titre de l'année 2014, la loi n°2014-137 du 24
mars 2014 portant statut de Pupille de la Nation vise à fixer les
règles applicables aux pupilles de la nation444. Il s'agit
d'une loi visant à prendre en charge des enfants d'une catégorie
de fonctionnaires deux ans après la crise électorale qui a
endeuillé la Côte d'Ivoire. Cette loi définit de
façon énumérative les catégories d'enfants
visées par la notion de « pupilles de la Nation ».
Ainsi, aux termes de l'article 2 de cette loi, « Ont le statut de
pupille de la nation :
- Les enfants mineurs des personnels des forces
armées, des personnels de la gendarmerie, des personnels des forces de
police et des autres corps paramilitaires, des magistrats, des fonctionnaires
et agents de l'État et des personnes titulaires de mandat
électif, dont l'un ou les deux parents ou le tuteur légal sont
morts ou sont portés disparus à l'occasion de guerre ou
d'opérations de maintien de la paix ou de la sécurité,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire
national, ou à l'occasion de l'exécution de mission en service
commandé ou de service public, ou se trouvent du fait de ces
évènements, dans l'incapacité de pourvoir à leurs
obligations et charges de famille ;
- Les enfants mineurs des personnes victimes
d'évènements déclarés catastrophes nationales, dont
l'État accepte la prise en charge »
444 Article premier loi n°2014-137 du 24 mars 2014 portant
statut de Pupille de la Nation.
184
Aux termes de l'article 3, les enfants mineurs visés
à l'article 2 sont déclarés pupilles de la Nation par
décret pris en conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre
chargé de la solidarité et ministres intéressés.
Elle précise les formes de protection et de soutien de
l'État dont peuvent bénéficier les enfants reconnus
pupilles de la Nation. Cet article indique que « les pupilles de la
Nation ont droit, jusqu'à leur majorité civile, à la
protection, au soutien financier, matériel et moral de
l'État445.
Le texte précise que la protection, le soutien
financier, matériel et moral de l'État sont également
accordés jusqu'à l'âge de 25 ans aux enfants à
charge des personnes mentionnées à l'article 2, s'ils justifient
de la poursuite d'études supérieures. Pour être la toute
première loi instituant le statut de pupille dans l'histoire de la
Côte d'Ivoire moderne, cette loi comporte des limites
inquiétantes. Tout d'abord, une lecture attentive de
l'énumération des enfants potentiellement
bénéficiaires du statut de pupille, appelle quelques
interrogations. Pourquoi a-t-on omis les enfants des personnes non
visées par l'alinéa 1 de l'article 2 ? Quel est le critère
ayant permis d'écarter les enfants d'une certaine catégorie de
familles ? Mieux, quel sera le sort de l'enfant d'un paysan, agriculteur ou
encore commerçant décédé(s) à l'occasion
d'un conflit armé en qualité de victime civile d'un conflit ?
Pourquoi privilégie-t-on certaines catégories d'enfants au
détriment d'autres enfants ? N'y a -t'-il pas ici, une discrimination
entre les enfants en fonction de leur origine sociale ? Et si discrimination
positive, il doit y avoir, ignorer les enfants d'éventuels victimes
civiles au profit des personnes bénéficiant d'un mandat
électif en période de conflit, apparait-il comme une bonne
solution ? Mieux, le législateur ivoirien fixe-t-il désormais
à 25 ans, l'âge de cessation de la qualité d'enfant ?
De même, l'imprécision du concept de catastrophes
naturelles contenu dans ce texte peut apparaitre comme une volonté
sournoise de ne point considérer certains événements comme
telles ? A quel moment ou dans quelles circonstances, peut-on parler de
catastrophes naturelles ? Qui a compétence pour qualifier ou reconnaitre
une catastrophe comme étant naturelle ? Ce texte brille
négativement par son mutisme sur ces éléments, à
nos yeux, essentiels pour l'intérêt de l'enfant.
445 Article 4 loi n°2014-137 du 24 mars 2014 portant statut
de Pupille de la Nation.
185
186
Au-delà de ses limites, et bien que profitant
spécifiquement aux enfants ayant perdu l'un ou les deux parents en
situation de guerre ou dans l'exécution d'une mission de service public
ou encore en cas de catastrophes naturelles, cette loi vise à combler un
vide juridique en créant les conditions du bien-être de cette
catégorie d'enfants visés, à l'instar de nombreuses autres
lois sociales portant protection des enfants.
D. AUTRES LOIS PERTINENTES EN MATIERE DE PROTECTION
SOCIALE DES ENFANTS
Tout d'abord, on peut citer ici la loi n° 98-756
adoptée en 1998 regardée comme une consécration
législative de la protection des enfants contre les pratiques
traditionnelles néfastes (excision, mariage précoce et
forcé). Cette loi vise essentiellement à interdire et sanctionner
certains actes néfastes sur les enfants ; malheureusement, elle
n'établit pas de services de préventions ou de réponse
pour des enfants et leurs familles. L'une des grosses faiblesses de cette loi,
est manifestement l'inexistence de mesures de réhabilitation pour les
jeunes filles victimes de ces pratiques. Il serait donc souhaitable que des
mesures de réhabilitation soient envisagées par les
ministères techniques et services chargés de la protection des
mineurs.
Ensuite, on peut citer, la loi n° 2001-636
prévoyant la mise en place et le fonctionnement de l'assurance
Médicale Universelle ; même si elle n'est pas spécifique
à l'enfant, elle vise incontestablement un renforcement de la protection
de la santé infantile. Cette loi établit à n'en point
douter un projet novateur auquel adhère l'ensemble de la population, si
l'on en réfère aux résultats des enquêtes
réalisées par l'Institut National de la Statistique (INS) sur la
pauvreté en 2002. L'assurance maladie universelle (AMU) est basée
sur les objectifs principaux suivants :
- Améliorer l'état de santé des populations
en assurant sans exclusion, l'accessibilité financière de tous
aux soins de santé ;
- Développer l'activité de la médecine, en
favorisant l'équilibre de l'offre et de la demande de soins de
santé ;
- Réduire les disparités régionales et
économiques, disparités qui amplifient, les
inégalités entre les groupes et régions et accroissent les
déficits sociaux ;
- Réaliser une meilleure solidarité nationale,
facteur de cohésion sociale.
La protection juridique de l'enfant en Côte d'Ivoire a
aussi été affirmée par un renforcement du cadre
pénal.
§ 3. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES ENFANTS
PAR L'ADOPTION D'UNE DIVERSITE DE LOIS PENALES
Les lois pénales ivoiriennes adoptées depuis les
indépendances, et revisitées depuis 1981, semblent pour la
plupart vétustes. Toutefois, elles contiennent des dispositions
consacrant et protégeant les droits de l'enfant. Cette protection
pénale est assurée aussi bien par le code de procédure
pénale que le code pénal.
La protection pénale telle que prévue par les
textes concernant aussi bien l'enfant délinquant que l'enfant
victime446 . On examinera donc successivement le cadre pénal
applicable aux mineurs délinquants marqué par un caractère
hybride (A) et la protection pénale de l'enfant victime qui se traduit
par une répression pénale des auteurs de violations des droits de
l'enfant (B).
A. UN CADRE PENAL HYBRIDE APPLICABLE AUX MINEURS
DELINQUANTS
A l'instar de la France, qui fut la première a
adopté une loi sur « l'enfance délinquante »
en 1945447, la Côte d'Ivoire, ancienne colonie
française s'est elle aussi intéressée à la question
de ces enfants ou du moins, n'a fait que lui emboiter le pas. C'est dans cet
élan, que quelques articles du code pénal et du code de
procédure pénale, font mention de protection de l'enfant en
conflit avec la loi. Plus précisément, deux lois, la loi n°
69-371 du 12/08/1969 relative au code pénal et celle n° 81-640 du
31/07/1981 relative au code de procédure pénale, consacre un
titre entier à l'enfance délinquante.
446 Celui-ci est protégé par la loi de 1981 du
code pénal ivoirien, qui assure une protection générale
à tout individu et spécifiquement à l'enfant. Ce dernier
bénéficie à cet effet, lui aussi de toute la protection
prévue par le droit pénal. Il jouit d'une protection juridique et
judiciaire qui doit respecter ses droits et ses intérêts en toute
situation et circonstance comme prévu par la Déclaration
Universelle des droits de l'Homme en son article 25 alinéa 2. La loi
pénale ivoirienne prévoit une protection accrue aux enfants
victimes de violences, lorsqu'il se trouve en danger moral et social.
447 BOHUE (Y.), La protection pénale de l'enfant en
droit ivoirien, thèse présentée et soutenue
publiquement le 7 mars 1992 à l'Université nationale de
Côte d'Ivoire, faculté de droit, p.6.
187
Le caractère hybride du cadre pénal applicable
aux mineurs est perceptible à travers l'affirmation d'une
responsabilité pénale des mineurs peu ou prou conforme aux normes
internationales (1) et l'application de règles de droit commun aux
mineurs dans le cadre de l'enquête préliminaire (2).
1. Une responsabilité pénale des mineurs
peu ou prou conforme aux normes internationales
Aux termes de l'article 14 du code pénal ivoirien,
« est mineure au sens de la loi pénale, toute personne
âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction
».
Il appert de cet article que la minorité constitue une
cause d'exclusion ou d'atténuation de la responsabilité
pénale. L'âge de 18 ans fixé par le législateur
ivoirien comme seuil maxima au-delà duquel une personne n'est plus
considérée comme un mineur est en adéquation avec les
dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant448 et
de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant449.
L'article 40 de la CDE prévoit qu'à ce seuil
maxima de responsabilité pénale
corresponde un seuil minima. L'article 4.1 des règles de Beijing ajoute
que ce seuil d'âge ne doit pas être fixé trop bas, eu
égard au manque de maturité affective, psychologique et
intellectuelle du jeune mineur. Un tel seuil d'irresponsabilité
pénale des mineurs a aussi été prévu dans
l'article4.1 des Règles de Beijing ainsi que dans l'article 17.4 de la
Charte Africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. L'article
11.a des RPMPL, ne fixe aucun critère relatif à la
détermination de ce seuil par le législateur de chaque
État. Il laisse ce dernier libre de fixer ce seuil en fonction de ses
réalités sociales.
L'interprétation de l'article 757 alinéa 3 du
Code de procédure pénale (CPP) ivoirien laisse entendre que ce
n'est qu'à partir de 13 ans que le mineur est suffisamment conscient des
actes qu'il pose pour être susceptible de se voir appliquer une sanction
pénale.
448 La Convention relative aux droits de l'enfant a
été adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 20 Novembre 1989. Elle a été ratifiée
par la Côte d'Ivoire en date du 4 février 1991. L'article 1
établit qu'un « enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable ».
449 L'article 2 de la charte Africaine sur les droits et le
bien-être de l'enfant.
188
Cependant, cette limite d'âge fixée à 13
ans constitue t'elle le seuil minima de responsabilité
pénale ? Si l'on lie la responsabilité pénale à
l'administration d'une peine, ce seuil d'âge de moins de 13 ans constitue
effectivement le seul minima de responsabilité pénale.
Cependant, l'article 771 al.2 du CPP dispose que les mineurs âgés
de moins de 13 ans seront susceptibles d'être détenus
préventivement s'ils sont soupçonnés d'avoir commis un
crime.
Sur le critère lié à la tranche
d'âge, le code pénal ivoirien procède à une
catégorisation des mineurs ; ainsi, il précise, en son article
116 que :
« - les faits commis par un mineur de 10
ans450 ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites
pénales ;
- Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en
cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de
minorité451 ;
- Les mineurs de 10 à 13 ans ne peuvent faire l'objet
que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation prévues par la loi ;
- L'excuse atténuante452 ou absolutoire de
minorité bénéficie aux mineurs de 16 à 18 ans dans
les conditions prévues par le code de procédure
pénale. »
Il appert de cet article, que seuls les mineurs de moins de 10
ans sont totalement exempts de toute responsabilité pénale. Quant
aux mineurs dont l'âge oscille entre 10 et 13 ans, ils devront
répondre de leurs actes devant une juridiction ; cette juridiction
saisie, ne pourra que prononcer des mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation qui sont prévues à l'article
783 du code de procédure pénale, à l'exclusion de toute
condamnation pénale. Même si cette catégorie de mineurs ne
peut être sanctionnée par une peine, réservée aux
mineurs âgés de plus de 13 ans, l'existence de mécanismes
éducatifs pouvant être actionnés à leur égard
par un juge, démontre la possibilité pour une juridiction de
reconnaître
450 Pour éviter toute confusion quant à
l'interprétation de l'article 116 du code pénal, relevons que
selon l'article 14 du code pénal, « les mineurs de 10, 13 et 16 ans
sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de
l'infraction ». Il s'agit donc des mineurs de moins de 10, 13 et 16 ans et
non pas de 10, 13 et 16 ans accomplis comme on pourrait le croire à la
première lecture.
451 Au sens de l'article 10 du code pénal (Livre
premier), une excuse absolutoire consiste en « toute raison limitativement
prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire
disparaitre l'infraction, entraine une dispense ou une exemption de peine.
».
452 Au sens de l'article 10 du code pénal (Livre
premier), une excuse atténuante consiste « en toute raison
limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission,
sans faire disparaître l'infraction, entraine une atténuation
obligatoire par la peine encourue ».
189
la responsabilité pénale des mineurs de moins de
13 ans. Cependant, dans l'hypothèse où un mineur de 13 ans est
poursuivi pour crime453, il peut faire l'objet d'un placement
provisoire dans une maison d'arrêt par ordonnance motivée du juge
des enfants. Quant aux mineurs âgés de plus de 13 ans, ils peuvent
être poursuivis et condamnés pénalement.
Il convient de faire quelques précisions : la
convention relative aux droits de l'enfant454, la Charte Africaine
des droits et du bien-être de l'enfant455 accorde aux
États, la latitude de déterminer l'âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale. Toutefois, bien que non contraignantes, les
règles de Beijing456, règles nécessaires au nom
de l'intérêt supérieur de l'enfant, établissent que
le seuil de responsabilité pénale « ne doit pas
être fixé trop bas eu égard aux problèmes de
maturité affective, psychologique et intellectuelle ». En
fixant le seuil de responsabilité pénale à 10 ans et en
prévoyant l'octroi de mesures protection, d'assistance, de surveillance
et d'éducation à l'égard des mineurs de 10 à 13
ans, le législateur ivoirien fait montre de cohérence avec les
principales dispositions internationales en la matière, et ce ,
contrairement à l'enquête préliminaire marqué par
une application de règles de droits commun aux mineurs.
2. Une application de règles de droit commun
aux mineurs dans le cadre de l'enquête préliminaire
Le code de procédure pénale ivoirien ne contient
pas de dispositions spécifiquement applicables aux mineurs dans le cadre
de l'enquête préliminaire. Celle menée par la police
judiciaire devant faire l'objet de développements particuliers dans le
cadre de développements ultérieurs, nous examinerons ici quelques
données textuelles prévues dans le cadre de l'information
judiciaire.
453 Article 771 du code de procédure pénale
ivoirien.
454 L'article 40 de la Convention relative aux droits de
l'enfant établit que « les Etats parties s'efforcent(...)
d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront
présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ».
455 L'article 1 (4) de la Charte Africaine des droits et du
bien-être de l'enfant établit qu'un « âge minimal doit
être fixé en deçà duquel les enfants sont
présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi
pénale ».
456 Article 4.1 de l'ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing) adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 29 novembre 1985. Ces règles
de protection des mineurs sont des recommandations formulées par
l'Assemblée générale des Nations Unies et elles n'ont
aucune force contraignante à l'égard des Etats.
190
Commençons par les mesures restrictives de
liberté à caractère provisoire prises au cours de
l'information. Elles sont de deux ordres :
- Les mesures éducatives ou de placement
énumérées à l'article 770 du CPP
- La détention préventive dont les
modalités sont définies à l'article 771 du CPP.
Existerait-il une troisième catégorie de mesures
provisoires notamment une ordonnance de garde provisoire dans une maison
d'arrêt ? Quel en serait le fondement juridique ?
Notre opinion sur cette question ne souffre d'aucune
ambiguïté. Il n'existe aucune disposition sur l'enfance
délinquante dans le code ivoirien de procédure pénale
prévoyant une ordonnance de garde provisoire dans une maison
d'arrêt. La lecture de l'article 771 du CPP qui dispose que le mineur
âgé de plus de treize ans ne peut être placé
provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si
cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de
prendre toutes autres dispositions doit se faire en rapport avec l'article 769
alinéa 3 du CPP qui dispose que le juge des enfants peut décerner
tous mandats utiles (mandat d'amener457, de
comparution458 , d'arrêt459 , de
dépôt460) en observant les règles de droit
commun à savoir la procédure et les conditions de
délivrance de chaque mandat.
Eu égard au principe de la primauté des mesures
éducatives et de réinsertion socioprofessionnelle sur les mesures
privatives de liberté admis en matière d'enfance
délinquante, l'article 771 a pour objectif de préciser les
modalités d'application de la détention préventive en la
matière.
Si l'usage du terme « placé provisoirement
» dans le contexte spécifique de l'enfance délinquante
peut prêter à confusion, elle n'autorise nullement à
admettre qu'il s'agisse, d'une catégorie sui generis de titre
de placement. Dans le langage courant, il est bien admis d'utiliser
l'expression « placé sous mandat de dépôt
». Certes, dans la pratique l'absence de centre d'observation dans la
plupart des juridictions oblige à prendre une ordonnance de garde
provisoire en confiant l'inculpé au régisseur de la maison
d'arrêt. Mais, c'est une
457 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 10e
éd. mise à jour, PUF, Paris, 2014, p.637.
458 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 10e
éd. mise à jour, PUF, Paris, 2014, p.637.
459 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 10e
éd. mise à jour, PUF, Paris, 2014, p.637.
460 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 10e
éd. mise à jour, PUF, Paris, 2014, p.638.
191
pratique qui n'a aucun fondement légal et est la
résultante du dysfonctionnement et des insuffisances du système
judiciaire et pénitentiaire dans son ensemble. Le bénéfice
de l'excuse absolutoire de minorité acquis de droit au mineur de 13 ans,
excluant l'application de toute peine d'emprisonnement, ce dernier ne devrait
en aucun cas être placé sous mandat de dépôt
même en cas de prévention de crime , cela est une
incohérence au regard du droit international.
Une autre situation incohérente réside au niveau
des délais de la détention. Lorsque le juge des enfants
décerne un mandat de dépôt contre un mineur, il doit s'en
référer aux conditions de droit commun édictées aux
articles 137 à 150 du CPP qui détermine les durées de
détention en fonction de la nature de l'acte et de la peine encourue ;
le législateur n'a prévu aucune disposition dérogatoire en
faveur des enfants ; or il est admis par les conventions internationales que le
mineur doit être détenu le moins longtemps possible. Cette
situation de droit commun appliquée au mineur en détention
préventive est anachronique avec l'article 114 alinéa 1 du code
pénal qui réduit le quantum des peines prononcées contre
le mineur. Il doit être prévu à l'égard du mineur
des délais de détention moins longs, une limitation du nombre de
prolongation du mandat de dépôt dans le cadre de l'application de
l'article 138 alinéa 3 du CPP.
En tout état de cause, toutes les parties
impliquées dans le suivi et le règlement des dossiers des mineurs
doivent scrupuleusement respecter les délais de détention
prévus dans le code de procédure pénale.
Pour conclure sur le point précis, des titres de
placement du mineur, il est souhaitable que le législateur en fasse une
relecture afin que les termes utilisés ne souffrent d'aucune
ambiguïté, et le contenu des textes débarrassé de
toute incohérence.
Considérant la clôture de l'information, les
diligences faites, le juge des enfants peut soit d'office à la
requête du ministère public communiquer le dossier à ce
dernier (article 772 CPP). La communication du dossier au parquet est-elle une
mesure facultative ou obligatoire ? Le juge des enfants peut-il sans provoquer
le réquisitoire du parquet ordonner le renvoi de l'inculpé devant
les juridictions de jugement notamment devant le tribunal pour enfants ?
192
A cette question alors que les parquets répondent par
la négative, les juges des enfants admettent bien une telle
possibilité. En effet, cette disposition spéciale de l'article
772 du CPP déroge à la règle générale de
l'article 175 al 2 du CPP énoncée en ces termes : «
...dès le retour de la procédure au juge d'instruction,
celui-ci s'il estime que la procédure est en état, la transmet au
Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions
au plus tard dans les 10 jours de sa réception ».
L'application effective des dispositions de l'article 772 pourrait être
une solution au non règlement dans les délais impartis des
dossiers communiqués au parquet. Au demeurant, elle ne préjudicie
pas aux intérêts du ministère public, partie au
procès pénal dûment représentée à
l'audience de tribunal pour enfants, le tribunal ne délibère
qu'après avoir entendu le parquet en ses réquisitions.
Pour assurer une meilleure protection des enfants
délinquants et harmoniser la législation ivoirienne aux normes
internationales protectrices des droits de l'enfant, il serait utile que soit
adoptée une révision du chapitre relatif à l'enquête
préliminaire du code de procédure pénale afin
d'intégrer des dispositions spécifiques aux mineurs. Cette
réforme pourrait mettre en avant le caractère exceptionnel du
recours à la garde à vue pour tout enfant, à n'utiliser
qu'en dernier ressort, et pour une durée non renouvelable de maximum 48
heures. Elle pourrait en outre prévoir que les interrogatoires des
mineurs par les officiers de police judiciaire (OPJ) auraient lieu en
présence des parents du mineur, de son tuteur ou, à
défaut, de tout autre adulte qualifié pour représenter le
mineur. Cet adulte qualifié, à définir par la loi,
pourrait être un assistant social, un avocat commis d'office, et à
défaut, un juriste ou para-juriste payé par une ONG en accord
avec le Ministère de la justice (à l'image de ce qui se fait
couramment dans de nombreux pays africains comme en Afrique du Sud, au Malawi
etc.) ou un défenseur choisi par le juge parmi les personnes
présentant toutes les garanties désirables comme le
prévoit déjà l'Article 770 CPP, al.2.
Un autre point qu'il nous parait important d'affronter dans le
cadre de ce chapitre est celui de la déjudiciarisation des litiges
concernant les mineurs délinquants. En effet, la CIDE insiste sur la
nécessité « de prendre des mesures, chaque fois que cela
est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire461 ». Ce concept est repris
à l'article 11 des règles de Beijing qui précise que le
recours à des moyens
461 Article 40 (3) b) de la Convention relative aux droits de
l'enfant.
193
extrajudiciaires « exige le consentement de
l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur462
» et que « cette pratique permet d'éviter les
conséquences négatives d'une procédure normale dans
l'administration de la justice pour mineurs (par exemple le stigmate d'une
condamnation et d'un jugement)463 ».
Le code de procédure pénale ivoirien ne
prévoit pas de moyens de résolution extrajudiciaire des litiges
concernant les mineurs délinquants. Il exclut d'ailleurs
expressément qu'on puisse recourir à la transaction pénale
pour les infractions commises par les mineurs464. Depuis plusieurs
années, le BICE tente néanmoins d'encourager le recours à
la conciliation pour régler les litiges de faible gravité
impliquant les mineurs à travers l'intervention de ses
délégués présents auprès des
différents commissariats d'Abidjan. Devant l'absence d'une
réglementation spécifique et en vue d'harmoniser la
législation ivoirienne aux normes internationales protectrices des
droits de l'enfant, il nous parait très important que le
législateur intervienne afin d'autoriser le recours à des moyens
extrajudiciaires pour traiter les infractions de faible gravité commises
par des mineurs délinquants, moins protégés que les
enfants victimes dont les bourreaux s'exposent à l'application à
leur encontre d'un cadre juridique répressif des violations des droits
de l'enfant .
B. UNE REPRESSION PENALE DES AUTEURS DE VIOLATIONS DES
DROITS DE L'ENFANT
Le Code pénal ivoirien a été
institué par la loi 81-640 du 30 juillet 1981. Nombre d'articles de ce
code protègent l'enfant par l'interdiction de certains comportements
à son égard. Il s'agit de comportements qui portent atteinte
à son intégrité physique et morale et à sa
liberté. Mieux, il définit les peines relatives aux crimes et
délits commis à l'endroit des enfants. Tel, il s'agit en principe
d'un texte particulièrement protecteur des droits de l'enfant.
Le rôle protecteur des droits de l'enfant par le code
pénal n'est plus à contester. Ainsi, par exemple, lorsque le code
pénal réprime le meurtre d'un enfant, on sait qu'il cherche
à protéger par ce biais son droit à la vie. De même,
lorsque ce texte de protection particulière
462 Article 11.3 des Règles de Beijing.
463 Article 11 des règles de Beijing.
464 Article 8 du code de procédure pénale
ivoirien.
194
réprime l'infraction d'arrestation arbitraire, c'est la
liberté individuelle ou collective qui se trouve ainsi
protégée. Et ainsi de suite.
En ce qui a trait aux peines applicables lors d'infractions
perpétrés envers les mineurs, les articles 334,336, et 360
prévoient que les peines peuvent être portées au double
dans les situations d'atteinte à la moralité publique, de
prostitution, d'outrage public à la pudeur impliquant des mineurs.
L'article 337 précise en outre qu'est puni d'un emprisonnement de 2
à 5 ans et d'une amende de 500,000 à 5,000,000 de francs CFA,
quiconque attente aux moeurs excitant ou favorisant ou facilitant la
débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe
au-dessous de l'âge de 18 ans.
De surcroit, l'article 354 prévoit une peine
d'emprisonnement de 5 à 25 ans dans le cas de viol ; la peine
d'emprisonnement à vie peut cependant être prescrite si la victime
est mineure de 15 ans ou si l'auteur du viol est le père, un ascendant,
une personne ayant autorité sur la victime, s'il est chargé de
son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle.
L'article 355 précise quant à lui que les amendes et les peines
d'emprisonnement prévues dans le cas d'attentat à la pudeur
consommé ou tenté avec violence doublent quasiment si la victime
est âgée de moins de 15 ans ou si son auteur est la mère ,
le père ou un ascendant , ou une personne ayant une autorité sur
la victime, s'il est chargé de son éducation, de sa formation
intellectuelle ou professionnelle. Les articles 357 et 358 énoncent les
peines encourues dans les cas d'attentat à la pudeur, consommé ou
tenté sans violence, ou d'acte impudique ou contre nature commis sur une
personne incapable de se protéger en raison de son état mental ou
physique.
En plus de ces articles, le chapitre 3 intitulé les
crimes et délits contre les enfants et les personnes incapables de se
protéger en raison de leur état physique et mental465
fait mention d'autres peines prévues, cette fois-ci, en cas
d'infanticide, des voies de fait et/ou de violences, d'abandon d'enfant,
d'avortement, et finalement d'enlèvement de mineur.
Finalement l'article 376 prévoit qu'en cas d'en cas
d'aliénation de la liberté d'une tierce personne, un maximum de
la peine (10 ans d'emprisonnement et une amende de 5, 000,000
465 Articles 361 à 372 : L'infanticide, une
incrimination des atteintes au droit à la vie (Article 361 Code
pénal), L'exploitation sexuelle/ Le proxénétisme (Article
335, 336 code pénal) ; Les mineurs victimes de violences physiques
(violences et voies de fait : Article 362 Code pénal) ;Les mineurs
victimes de violences sexuelles (viol, attentat à la pudeur : Article
355 à 356 ; outrage public à la pudeur sur mineur article 360) ;
La répression de la non déclaration de l'accueil des mineurs
victimes de maltraitance.
195
de francs CFA) est toujours prononcé si la victime est
âgée de moins de 15 ans. L'article 377 présente l'amende et
la peine d'emprisonnement prévues si une personne met ou reçoit
d'une tierce personne en gage, la peine étant plus sévère
si la victime est âgée de moins de 15 ans. L'article 378 porte sur
les peines encourues si quiconque contraint un mineur de 18 ans à entrer
dans une union matrimoniale de nature coutumière ou de nature religieuse
ou si quiconque impose à autrui un travail ou un service par lequel il
ne s'est pas offert de son plein gré , et ce, dans le but de satisfaire
exclusivement son intérêt personnel. L'article 386 traite des cas
d'atteinte à l'état civil d'un enfant et établit les
gammes de peines d'emprisonnements prévues quant à ce
délit.
Bref, pour être de lourdes peines, ces peines vont des
mesures privatives de liberté à la prison à vie, voir la
peine de mort466. Ces incriminations sanctionnées par le code
pénal ivoirien, sont une autre façon de protéger quelques
droits de l'enfant limitativement pris en charge par le droit pénal.
Cependant, à cause de la rigueur du principe
légaliste qui domine le droit pénal, on ne peut pas dire que tous
les droits de l'enfant, surtout, ceux dont la violation n'est pas
sanctionnée pénalement, sont pris en charge par cette branche
spécifique du droit. Il en va ainsi de la violation du droit à
l'éducation qui n'est pas pénalement sanctionné en
Côte d'Ivoire. Il en découle que la protection pénale des
droits de l'enfant, n'est que sélective.
Toutefois, en dépit de cet aspect sélectif, le
rôle symbolique de protection des droits de l'enfant, assuré par
le code pénal, ne peut être contesté. Le droit pénal
étant un maillon de la chaine ; elle n'est pas la chaine tout
entière.
CONCLUSION DU TITRE 1
Les instruments internationaux généraux de
protection de protection des droits de l'homme auxquels la Côte d'Ivoire
est partie, comportent dans certains cas, des dispositions relatives à
la reconnaissance et la protection des droits de l'enfant. La reconnaissance
des droits de l'homme s'est traduite par l'apparition d'une multiplicité
d'instruments conventionnels et déclaratoires suivis de l'adoption de
textes législatifs au niveau national.
466 La peine de mort étant désormais interdite
par la Constitution ivoirienne, il serait opportun que l'article 361 qui
réprime l'infanticide soit révisée et adaptée
à la loi constitutionnelle.
196
Ce qui a amené certains auteurs à parler d'
« essor normatif considérable...depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale »467 . Toutefois, cette
protection des droits de l'enfant prônée à travers ces
instruments est de caractère général et non
spécifique à l'enfant.
Devant le caractère général des textes et
les violations de plus en plus massives des droits des enfants, certains
États468 ont interpellé les Nations Unies pour
l'adoption de normes contraignantes en faveur de l'enfant. Cet appel a
contribué à la « prolifération des
réglementations »469 et à
l'élaboration de normes spécifiques protégeant l'enfant
aussi bien au niveau international que national ivoirien.
En effet, nonobstant l'existence de la Charte internationale
des droits de l'homme et des instruments nationaux de protection des droits
humains à caractère général, la communauté
internationale dans son ensemble a senti l'ardent besoin de réaffirmer
les droits spécifiques aux enfants. En effet, les droits
proclamés par ces instruments généraux ne sont pas
toujours respectés. L'égalité des hommes est donc une
simple déclaration ou proclamation philosophique qui n'est pas
réalisée dans la pratique.
Au-delà des limites de ces textes tant au niveau formel
que du contenu, dans la doctrine juridique, l'existence des droits
catégoriels, spécifiques à l'enfant pose plusieurs
problèmes dont les plus importants méritent ici attention.
Le premier tourne autour de l'artifice véhiculé
par l'égalité des hommes et l'existence de leurs droits du fait
de la dignité humaine. L'égalité, analysée dans la
théorie comme « un concept de philosophie
politique470 » est paradoxale. C'est dans cette mesure
qu'elle est à la fois désirable et insaisissable,
c'est-à-dire louée et recherchée par tous, mais en
même temps
467 TURGIS (S.), Les interactions entre les normes
internationales relatives aux droits de la personne, Paris, Edition
A-PEDONE, 2012, p.31.
468 DAOUDI (R.), « La codification des droits de l'enfant
: analyse des prises de position gouvernementales », pp.21
à 40, in Maurice TORELLI, La protection internationale des droits de
l'enfant, travaux du centre d'étude et de recherche de droit
international et de relations internationales de l'académie de droit
international, la Haye, Paris, PUF, 1979, p.38.
469 ROBERT (J.), DUFFAR (J.), Droits de l'homme et
libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 2009, p.3.
470 FAVOREU (L.), GAIA (P.)/ GHEVONTIAN (R.)/
MELIN-SOUCRAMANIEN (F.)/ PFERSMANN (O.)/ PINI (J.), ROUX (A.)/ SCOFFONI
(G.)/TREMEAU (J.), Droit des libertés fondamentales, Dalloz,
3ème éd.2005, p.303.
197
qu'elle reste comme le disait le doyen Vedel « une
institution (...) contradictoire et énigmatique471
».
En réalité, c'est pratiquement un truisme de
considérer que l'égalité des hommes est un axiome inexact
ou du moins infidèle à la réalité ; celle de
l'existence même d'une catégorie d'homme dont les droits ne sont
pas respectés. Il convient donc pour atteindre cette
égalité de discriminer, de les prendre à part, afin de
leur consacrer des instruments spécifiques, en vue de la protection de
leurs droits. Ainsi, c'est l'existence des inégalités de
fait472 qui conduisent à la reconnaissance des droits
catégoriels. Pour y parvenir, on utilise deux techniques qui peuvent
être associés : la discrimination positive473 et la
catégorisation. Ici, l'avantage essentiel est accordé à
cette catégorie qui a souffert de discrimination dans le
passé474, c'est de lui consacrer des conventions
particulières ou des lois particulières pour la protection de ses
droits475.
Par ailleurs, l'égalité ce n'est pas seulement
assurer le même traitement à tous, c'est beaucoup plus.
L'égalité de traitement de personnes qui ne se trouvent pas dans
la même situation perpétuera l'injustice, au lieu de
l'éliminer. La véritable égalité ne peut que
procéder d'efforts faits pour lutter contre les inégalités
et y remédier. C'est cette notion plus vaste de l'égalité
qui est devenue le principe cardinal et l'objectif final de l'acceptation et de
la reconnaissance des droits catégoriels.
Ainsi, en spécifiant, en distinguant dans le cadre de
la protection universelle et nationale, l'on reconnait une importance
particulière à la catégorie distinguée, en
l'espèce, les enfants.
471 VEDEL (G.), « L'égalité » in
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ses
origines, sa pérennité, La Documentation française,
1990, p.172.
472 On peut que des inégalités de fait existent
dans la plupart des sociétés depuis longtemps entre les hommes et
les femmes par exemples, et que les enfants dans toute société
sont les êtres les plus faibles.
473 La doctrine emploie les termes d' « Affirmative
Action » ou « action Affirmative » selon la terminologie
nord-américaine, de « mesures positives » comme en Suisse, d'
« actions positives », de « mesures compensatoires » ou
« compensatrice ». Elle obéit aux critères essentiels
suivants : il faut qu'à l'origine existe une inégalité de
fait ; à celle qui doit répondre une différenciation
juridique de traitement ; cette dernière doit être
finalisée, et doit résulter de la volonté expresse de
l'autorité normative d'accorder un avantage à une
catégorie déterminée ayant souffert de discrimination dans
le passé.
474 S'agissant des femmes et des enfants par exemple,
l'intérêt que les Nations unies leur ont porté
résulte « de leur état d'être considérés
comme vulnérables ou particulièrement défavorisés
», IDHPD, « Les droits de la femme et de l'enfant » , in
Education aux droits de l'homme et à la démocratie : La
démocratie au quotidien, n°13, 1998, p.7.
475 C'est ainsi que les femmes et les enfants, « des
mesures spéciales de protection ont été prises pour
assurer leur promotion et l'égalité dans l'exercice de leurs
droits et des libertés fondamentales ». Ibid.
198
Même si dans certains cas, on ne fait que
répéter les droits contenus dans l'instrument à
caractère général, la seule répétition
marque le degré d'importance que l'on veut accorder. Suivant cette
logique, et fort de l'existence de nombreuses situations
d'inégalité de fait, on assiste à une inflation
conventionnelle et législative des droits de l'enfant.
Il est presque acquis, aujourd'hui, qu'une abondante
proclamation textuelle des droits de l'enfant constitue un code de souhaits
moraux ou politiques qui n'emportent juridiquement aucune conséquence
sérieuse s'il n'est pas de garantie sérieuse de leur application.
Ainsi, le Professeur Henri OBERDORFF affirme : « Affirmer ou proclamer
les droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne suffit pas, il
est indispensable de les organiser et de les protéger de manière
adaptée au type des dangers qu'ils courent. Une bonne organisation et
une bonne protection constituent les outils d'une bonne garantie de ces droits
et de ces libertés »476. Il apparait donc opportun
d'analyser les mécanismes institutionnels de garantie des droits de
l'enfant.
476 OBERDORFF (H.), Droits de l'Homme et libertés
fondamentales, 5ème éd., L.G.D.J.-lextenso
éditions, coll. « Manuel », Paris, 2015, p.159.
199
Titre II : DES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE GARANTIE
A
EFFECTIVITE LIMITEE
200
En matière des droits de l'homme, la notion de garantie
renvoie à l'idée de mécanismes institutionnels mis en
place pour assurer, en droit, la promotion, la protection, ainsi que le
contrôle de l'application effective, par les débiteurs, des droits
reconnus aux bénéficiaires.
A la multitude des mécanismes observés
aujourd'hui dans le domaine s'accompagne une diversité des
méthodes et une différenciation des rôles, selon que ces
mécanismes sont dits de « promotion » ou de «
protection » des droits de l'enfant.
Partout se pose le problème de l'efficacité,
voire de l'efficience des mécanismes mis en place. Ces deux
éléments ou critères conditionnent tout choix judicieux en
matière de protection institutionnelle ou de garantie des droits de
l'enfant.
A l'instar de nombre d'Etats, la Côte d'Ivoire est
confrontée à la difficulté du choix des meilleurs
mécanismes de promotion ou/et de protection des droits de l'enfant. Il
se dégage d'un bref parcours de son histoire institutionnelle en la
matière que plusieurs mécanismes ont été
expérimentés, certains avec plus ou moins de réussite,
d'autres avec des résultats complètement mitigés. Il
apparait donc opportun d'examiner le cadre institutionnel de protection et de
promotion des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire en détachant les
mécanismes typiquement gouvernementaux de ceux que l'on pourrait
qualifiés de non gouvernementaux. Ces mécanismes se
caractérisent par le rôle limité des mécanismes
gouvernementaux (Chapitre 1) et l'importance variable des
institutions d'appui et de contrôle (Chapitre 2).
201
Chapitre I :
LE ROLE LIMITE DES MECANISMES
GOUVERNEMENTAUX
Au plan interne, la Côte d'Ivoire dispose de ses propres
mécanismes de promotion et de protection des droits de l'enfant. Les
mécanismes étatiques constituent le premier niveau de protection
des droits accordés par un Etat à ses enfants. Au nom du principe
de subsidiarité caractérisant les mécanismes
internationaux, on peut les considérer comme des garanties de «
première ligne » relatifs aux droits de l'enfant. D'ailleurs en cas
de lacunes ou d'inefficience des mécanismes internationaux ou en cas de
non ratification par un Etat des traités instituant ces
mécanismes, ils constituent, les seules garanties possibles.
A l'heure actuelle, les actions de la Côte d'Ivoire
tournent autour de l'organisation ou de la possibilité d'organisation
des structures et des mécanismes aussi divers que variés,
généraux que spécifiques, dont l'objectif final demeure,
dit-on, l'atteinte d'un meilleur niveau d'effectivité des droits de
l'enfant.
Ces mécanismes gouvernementaux lacunaires, et surtout
limités dans leur rôle s'articulent autour des organes
administratifs à caractère politique et technique
(section 1) et des juridictions spécialisées
pour enfants (section 2).
202
SECTION I. LES ORGANES ADMINISTRATIFS A CARACTERE
POLITIQUE ET TECHNIQUE
Dans quelle mesure l'engagement de la Côte d'Ivoire
à respecter les normes internationales relatives aux droits de l'enfant
a-t-il influencé la mise en place des organes administratifs de
protection de droits de l'enfant dans ce pays ? Et quel est l'apport de ces
organes dans la protection effective des droits de l'enfant ?
Pour répondre à ces interrogations, nous
examinerons successivement les organes de protection à caractère
général (paragraphe 1) et les organes de
protection à caractère spécifique (paragraphe
2).
§ 1. LES ORGANES DE PROTECTION A CARACTERE
GENERAL
L'on note des efforts des gouvernements ivoiriens successifs
dans la mise en place des organes de protection de l'enfant pour assurer la
protection des enfants en général. Au titre des structures
étatiques, les Ministères compétents chargés de la
mise en application de la CIDE477 apparaissent au premier plan. A
défaut d'examiner tous les ministères concernés par la
question des droits de l'enfant, nous aborderons quelques organes majeurs mis
en place dans les ministères de la famille, de la solidarité
nationale et de l'enfant, de la justice, de la législation et des droits
de l'Homme à l'exception des ministères de l'éducation
477 KOMAN (Y.- G.), La convention relative aux droits de
l'enfant : vers une évolution des droits d'expression et de
défense des intérêts de l'enfant en Côte d'Ivoire ?,
Mémoire de fin de cycle, ENA, 2007, p.48.
203
nationale478 et de la santé479
qui jouent tout aussi un rôle important en matière de droits de
l'enfant.
478 Le Ministère de l'éducation nationale
comprend dans son organigramme la Direction de la Mutualité et des
OEuvres Sociales en Milieu Scolaire (DMOSS). La DMOSS est censée
s'occuper des problèmes de protection de l'enfant en milieu scolaire,
entre autres : les problèmes de traitement au long cours,
d'échecs/difficultés scolaires, de violences sexistes, de
maltraitance, etc.). Elle n'a pas de liens fonctionnels avec le MFFAS à
l'exception de sa collaboration avec le PNOEV. Son action est majoritairement
centrée sur les questions de santé pour lesquelles un partenariat
dynamique existe avec le PNSSU. Pour les domaines relatifs à la
protection, elle a recours au MEMJDH.
Outre la DMOSS, il existe des Directions Centrales et services
rattachés qui interviennent dans la protection de l'enfant :
La Direction Nationale des Cantines scolaires (DNC) : elle a
en charge l'alimentation des enfants en milieu scolaire. Son action contribue
à améliorer l'accès et le maintien des enfants, surtout
les filles à l'école. Par le projet de pérennisation des
cantines scolaires, elle lutte, par ailleurs, pour la réduction de la
pauvreté chez les femmes.
La Direction de l'Extra et des Activités
Coopératives (DESAC) : elle intervient dans l'amélioration de
l'environnement scolaire par l'installation de clubs/coopératives
scolaires dans les écoles. A cet effet, elle a en son sein, la
sous-direction de l'Education Pour Tous (EPT) qui lutte à travers le
réseau UNGEI. Ce réseau a en charge la mise en oeuvre des
directives du BREDA/ UNESCO qui veulent que les actions de protection soient
toujours accompagnées d'un volet éducation et
alphabétisation.
La Direction des Ecoles, Lycée et Collège (DELC)
: elle a en charge la gestion de tous les établissements scolaires. En
matière de protection, elle a fait prendre l'arrêté n°
0075/MEN/DELC du 28 septembre 2009, portant interdiction des punitions
physiques et humiliantes à l'école.
Le Service Autonome de l'Alphabétisation (SAA)
: il a en charge la définition de la politique
nationale d'alphabétisation au niveau de la protection, il intervient
dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants en partenariat
avec le MFPE à travers le projet BIT/IPEC.
La Direction de la Pédagogie et de la Formation
Continue (DPFC) : elle s'occupe du développement des programmes
scolaires et de la formation continue des enseignants. Dans ce cadre, elle
définit des modules et programmes relatifs à la protection des
enfants dans les curricula. Ex : Programme d'Education à la Paix et
à la Tolérance (PEPT) et introduction d'un module « Droits
de l'enfant » dans le curriculum de formation dans les CAFOP.
479 Conformément au décret n°2007-507 du 13
juin 2007 portant organisation du Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique, celui-ci n'a pas de responsabilité formelle
en rapport direct avec la protection de l'enfant. Toutefois, dans le cadre d'un
système intégré de protection de l'enfant, ce
ministère pourrait jouer un rôle fondamental. Au regard de cette
potentialité, le cloisonnement actuel du système sanitaire
représente une grande opportunité manquée et une
possibilité à explorer dans les initiatives de renforcement du
système national de protection de l'enfant. Néanmoins, certaines
structures sanitaires-surtout les hôpitaux disposent de travailleurs
sociaux qui servent d'interface avec les Centres Sociaux pour les enfants et
les familles usagers des structures sanitaires qui ont besoin d'une assistance
sociale. Mais dans la pratique, la portée de ce dispositif est quasi
nulle, faute d'un budget d'aide sociale disponible pour les malades
indigents.
204
A. AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE LA
SOLIDARITE NATIONALE
Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à
l'indépendance, les gouvernements successifs ont toujours prévu
un poste ministériel en charge de la problématique
afférente à l'enfant et ses droits. A titre d'exemple, le
décret n°2012-625 du 06 juillet 2012 portant attributions,
organisation et fonctionnement du Ministère de la famille et de la
solidarité nationale met à la charge de ce ministère : de
concevoir, de mettre en oeuvre et d'assurer le suivi-évaluation de la
politique de l'État en matière de développement social et
de solidarité conformément aux lois et règlements en
vigueur en Côte d'Ivoire et conformément aux visions et politique
de développement du gouvernement480.
Les principales missions du ministère de la famille, de
la femme et de l'enfant sont de promouvoir la femme sur le plan
économique, social, juridique et culturel, de protéger les droits
de l'enfant et de favoriser l'épanouissement des citoyens dans le cadre
de la famille. Le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant
est chargé de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du
gouvernement en matière de protection de la femme, de l'enfant, et de la
famille.
En liaison avec les départements ministériels
intéressés, il a l'initiative et la responsabilité
notamment de la promotion économique, sociale, juridique de la femme. Il
contribue aussi à l'élaboration et au suivi des lois et
règlements en matière de protection de l'enfant. Pour remplir ce
mandat, les agents du ministère proposent une sensibilisation sur les
droits de la femme et de l'enfant et diffusent de l'information auprès
de la communauté. Ils donnent par ailleurs de l'assistance et
conseillent les femmes en difficulté, notamment les filles mères,
les veuves et les victimes de violences conjugales.
Ses activités de mise en oeuvre de programmes
d'éducation et d'assistance aux enfants mineurs en difficulté et
des enfants de la rue se font en liaison avec le ministère en charge de
la sécurité sociale qui lutte contre les abandons d'enfants,
promeut la participation à la coordination des activités de
protection de l'enfance, y compris celle des institutions
spécialisées de pris en charge des enfants.
480 Art. 1er du décret n°2012-625 du 06 juillet
2012.
205
206
L'actuel ministre a défini les actions prioritaires
pour protéger spécifiquement les droits de l'enfant :
a) faire retirer tous les textes sur les droits des enfants et
faire le suivi sur la mise en oeuvre ;
b) vulgariser les textes de protection de l'enfant et veiller
sur leur application ;
c) intensifier la lutte contre la traite et l'exploitation des
enfants en faisant respecter les accords transfrontaliers ;
d) actualiser et mettre en oeuvre le document de politique
nationale en faveur de
l'enfant.
En ce qui concerne les directions techniques,
régionales et départementales du ministère, elles assurent
la mise en oeuvre au niveau de chaque département de la politique
nationale en matière de promotion de la famille, de l'enfant, du genre
et de la solidarité nationale. Nous nous pencherons ici sur le
rôle des directions de la protection de l'enfance et la direction
régionale de l'enfant.
1. La direction de la protection de l'enfance
(DPE)
La Direction de la Protection de l'Enfance (DPE) est l'un des
services techniques du Ministère de la famille, de l'enfant et de la
solidarité nationale. Il intervient, comme son nom l'indique, dans la
protection de l'enfance.
Aux termes du décret n°2011-431 du 30 novembre
2011 portant organisation du Ministère de la Famille, de la Femme et de
l'Enfant, la direction de la protection de l'enfant est chargée :
«
- De mettre en oeuvre les programmes d'éducation et
d'assistance aux enfants en difficulté ;
- D'élaborer et de suivre l'application des lois et
règlements en matière de protection de l'enfant ;
- De concevoir et de développer une politique nationale de
protection de l'enfant ; - De lutter contre les abandons d'enfants ;
- D'informer et de sensibiliser sur les droits de l'enfant ; - De
coordonner les interventions en faveur de l'enfant ;
- De participer à la coordination, à
l'identification et à la mise en oeuvre des mesures liées
à la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et les pires
formes de travail des enfants. »481.
La direction de la protection de l'enfance est composée
de trois sous-directions que sont : la sous-direction de la Promotion des
droits de l'enfant, la sous-direction de l'Enfance et la sous-direction de la
planification et du suivi-évaluation. Les sous directions sont
dirigés par des sous-directeurs nommés par
arrêté482.
Une telle institution existe aussi bien dans d'autres pays
ouest africains avec quelques légères différences au
niveau de la composition et des attributions. Il en va ainsi de la Direction de
la protection de l'enfance au Bénin. Comprenant, entre autres, un
service de la Réinsertion de l'enfant et de l'adolescent, un service de
la protection de l'enfant et de l'adolescent et un service de la statistique,
de la recherche et de la législation, la DPE béninoise assure, au
titre de l'article 63 du décret n°2009-244483,
l'élaboration, la mise en oeuvre des programmes en faveur de l'enfant et
de l'adolescent. Pour cette raison, elle est chargée de :
- veiller à la vulgarisation et à l'application
effective des textes juridiques sur la protection de l'enfant, en l'occurrence
la Convention relative aux droits de l'enfant et les autres instruments
juridiques nationaux et internationaux en faveur de l'enfant, ratifiés
par le Bénin ;
- élaborer, en relation avec toutes les structures
concernées, le programme de soutien et de réinsertion sociale des
enfants en situation difficile ;
481 Article 13décret n°2011-431 du 30 novembre
2011 portant organisation du ministère de la Famille, de la Femme et de
l'Enfant.
482 Article 13décret n°2011-431 du 30 novembre
2011 portant organisation du ministère de la Famille, de la Femme et de
l'Enfant.
483 Voir l'article 1er de l'arrêté 2007
n°1280 /MFFE/DC/SGM/DEA/SA, portant Attribution, Organisation et
Fonctionnement de la Direction de l'Enfance et de l'Adolescence.
207
- définir, en collaboration avec les Ministères
et organismes concernés, le cadre de référence pour la
création et le fonctionnement des institutions de protection des enfants
et des adolescents ;
- coordonner les actions des Organismes et des Organisations
Non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de l'enfant et de l'adolescent.
- initier, en collaboration avec d'autres départements
ministériels, des textes législatifs et réglementaires
permettant la mise en application
effective des droits de l'enfant et de l'adolescent ;
- assurer le suivi des programmes, des résolutions et
recommandations issus des rencontres nationales et internationales relatives
à la promotion de l'enfant ;
- Et enfin, assurer la surveillance nutritionnelle des enfants
de 0 à 5 ans.
Comparé à la DPE béninoise, on peut
regretter qu'en Côte d'Ivoire, il n'existe pas au niveau de la DPE une
direction entièrement consacrée à la réinsertion
des enfants eu égard à l'importance de cette notion au nom de
l'intérêt de l'enfant. Qui plus est, cette direction reste
méconnue de la majorité des Ivoiriens car aucune action de
promotion relative à la vulgarisation de cette structure n'est
entreprise. Toutefois, à travers ses attributions, la DPE apparaît
comme étant l'une des chevilles ouvrières dans la mise en oeuvre
des Normes internationales relatives aux droits de l'enfant, ratifiée
par la Côte d'Ivoire au niveau de l'administration ivoirienne.
A côté de la Direction de la protection de
l'enfance qui a une compétence nationale, les démembrements du
ministère au niveau des régions interviennent aussi dans la
protection des enfants. C'est le cas de la Direction régionale de la
famille et de l'enfant qui coordonne les services extérieurs du
ministère de l'enfance.
2. Direction régionale de la Famille et de
l'enfant et ses démembrements
Le territoire ivoirien, depuis le décret
n°2011-263 du 28 Septembre 2011 était découpé en 30
régions484 ; mais en 2012, aux 30 régions existantes,
la région Moronou a été
484 Article 1et 4 décret n°2011-263 du 28 Septembre
2011.
208
ajoutée485 comme la 32ème
région ; les directions régionales et départementales de
l'enfant et de la Solidarité nationale sont présentes dans toutes
les régions et chefs-lieux de départements du pays ; Ce qui
apparait incontestablement salutaire car rapprochant ces directions des
usagers.
Nous aborderons ici le rôle de la direction
départementale dans la protection de l'enfant ainsi que les actions des
services d'actions sociales oeuvrant sous sa tutelle et qui malheureusement se
caractérisent par une inégale répartition sur le
territoire ivoirien. - Le rôle de la direction
régionale dans la protection des enfants
Ayant pour rôle d'assurer la mise en oeuvre locale de la
politique nationale qui relève de la compétence du
Ministère en charge des enfants, la Direction régionale doit
veiller, au niveau de chaque région, à la réalisation des
objectifs du gouvernement en matière de promotion de la femme, de
l'enfant, et de la solidarité.
En ce qui concerne la question spécifique de la
protection de l'enfant, la direction a la charge de veiller à la mise en
oeuvre des actions de protection sociale, à l'application de la
législation en vigueur, de promouvoir et d'harmoniser les
activités des ONG et associations qui oeuvrent dans le domaine de la
protection des enfants, de coordonner, suivre et évaluer les
activités des centres de promotion sociale, de veiller à
l'exécution correcte des prestations des services sociaux
spécialisés, de contribuer à la lutte contre la
pauvreté et les fléaux sociaux, de veiller au respect de
l'application, par les structures d'accueil, des normes et standards en
matière de protection sociale et d'infrastructures, de gérer les
secours conformément aux textes en vigueur etc486. Pour mener
à bien ses missions, la direction sociale se fonde sur un réseau
important des services d'actions sociales marqué au coin d'une
inégale répartition géographique.
- Un réseau important de services d'action
sociale inégalement répartis
485 Article 1 Décret n°2013-du 02 mai 2013 portant
érection de trente et une (31) régions, circonscriptions
administratives, en collectivités territoriales régionales.
486 KOUADIO (K.-H.), Cadre législatif et
institutionnel de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire,
Séminaire de formation du personnel du Médiateur de la
République sur les Droits de l'Enfant Thème "La mise en oeuvre de
la CDE et la situation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire"
Abidjan, du 21 au 22 juillet 2016, inédit.
209
210
Les directions régionales regroupent dans leur zone de
compétence : les centres de protection de la petite enfance, les
complexes socio-éducatifs, les centres d'éducation
spécialisée , le centre d'éducation polyvalent de
Kaniasso-Odienné , les centres d'actions communautaire pour l'enfance ,
les crèches, les garderies d'enfants, les institutions de formations et
d'éducation féminine et le centre éducatif de la zone 4-C.
Nous les regrouperons volontiers sous le terme de services d'action sociale
(SAS) dans le cadre de nos développements. Les services d'action sociale
sont sous la tutelle de la Direction régionale de la famille. Ils
constituent des relais de cette dernière au niveau des populations
à la base (commune). A ce titre, les services d'action sociale appuient
le développement des communautés à la base, à
travers la prévention et la gestion des risques sociaux encourus par les
populations et particulièrement les couches les plus vulnérables
dont les enfants.
Sur le terrain, ils ont normalement à charge :
- d'identifier, à travers une étude du milieu,
les risques sociaux qui entravent le développement humain durable au
sein de la communauté desservie ;
- d'oeuvrer à la résolution progressive des
problèmes sociaux en se basant sur les ressources de l'État, les
potentialités du milieu et les appuis des partenaires ;
- de donner des appuis-conseils aux individus, aux familles et
élus locaux, en cas de nécessité ;
- de contribuer à l'exécution au niveau des
communes des projets et programmes de portée multisectorielle,
compatibles avec la mission du Ministère ;
- d'appuyer les communautés à la base dans la
conception, l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et
l'évaluation des projets et programmes de développement ;
- de contribuer, entre autres, à la promotion de la
famille, de l'enfant, des orphelins et enfants vulnérables ; etc.
Dans la pratique, les services d'action sociale (SAS) sont
loin d'assurer ces charges qui leur sont assignées. D'une part, il a
été relevé sur le terrain, que les SAS ne disposent pas de
moyens nécessaires pour assumer leur mission. L'absence ou l'excessive
modicité de moyens financiers, notamment du budget de fonctionnement,
rend les SAS dépendants des
ONG nationales ou internationales. Aussi, les moyens
matériels et humains font défaut. Dans la plupart des SAS
visités, on remarque que la grande partie du matériel disponible
a été fournie par les partenaires comme l'Unicef ou l'Union
européenne487; A cela s'ajoute aussi un nombre limité
du personnel en place, celui-ci variant entre 1 et 5 personnes dans les SAS
visités.
En Côte d'Ivoire, on dénombre les principales
structures d'actions sociales suivantes : 108 centres sociaux (CS), 17 Centres
d'éducation spécialisés (CES), 43 centres de protection de
la petite enfance (CPE) dont 43 publics et 27 privés, ainsi que 85
centres d'Action communautaire pour l'Enfance (CACE)488. Il existe
également des institutions spécialisées (2 orphelinats, 4
pouponnières et 3 villages SOS.)489 Depuis 2011, les services
d'action sociale sont assurés par le Ministère de la
solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant (MSFFE) et le
ministère de l'emploi des affaires sociales et de la formation
professionnelle. Le MSFFE a le mandat de la coordination et du suivi de
l'action sociale visant la protection de l'enfant.
Comparativement aux autres pays de la région, la
Côte d'Ivoire offre un dispositif de services d'action sociale riche mais
qui est inégalement réparti sur le territoire, et sans
corrélation avec la cartographie des vulnérabilités et des
besoins sociaux.
Chaque année l'institut National de Formation sociale
(INFS) forme environ 500 travailleurs sociaux diplômés, qui sont
déployés dans différents secteurs de la fonction
publique490. Les travailleurs sociaux des services d'action sociale
demeurent en nombre insuffisant et toujours inégalement
déployés sur l'ensemble du territoire. En effet, le
déploiement des services ne cadre pas avec la cartographie de la
pauvreté. La moitié des travailleurs sociaux étant actifs
dans la région des lagunes491 et plus
précisément dans la ville d'Abidjan.
487 Le donateur prend soin de mentionner son nom sur le
matériel en question.
488 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.102.
489 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.102.
490 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.102.
491 En 2014, on relevait un personnel social pour 52000
personnes au niveau national contre 13000 pour la région des lagunes.
Voir Unicef, op.cit.p.99.
211
Dans la moitié des départements, les centres
sociaux n'existent pas. Seulement un département sur cinq dispose d'un
centre d'éducation spécialisée492. Le personnel
local des régions de l'Ouest et du centre du pays ne dépasse pas
pour chacune d'entre elles, vingt travailleurs sociaux. Or ces régions
doivent faire face à des défis importants en termes de
protection493.
Les structures d'action sociale opèrent sans que ne
soient précisément définis leur mandat et leur
fonctionnement494. L'absence d'autonomie de caisse de services
d'action sociale handicape la prestation de services d'assistance en
particulier pour la prise en charge d'urgence. La standardisation des
prestations aux enfants ayant besoin de protection spéciale reste
à mettre en place au niveau national pour chacun des services
concernés. Des procédures multisectorielles de signalement et de
référencement et prise en charge ont été
développées en 2013 mais doivent encore être
opérationnalisées à l'échelle nationale, y compris
avec une formation subséquente de tous les professionnels
concernés. Les professionnels des services de l'action sociale, de la
santé, l'éducation, la sécurité et la justice
doivent avoir leurs compétences renforcées en matière de
détection, référence et prise en charge des enfants
victimes et handicapés495.
Le système de suivi et d'inspection de l'action sociale
est limité. La production périodique de statistiques nationales
sur les besoins sociaux et la réponse adéquate n'est pas soutenue
par un système national d'information et de routine496. La
dispersion des services d'action sociale sous des tutelles
ministérielles différentes impacte négativement sur
l'organisation efficiente, la qualité et le suivi des services d'action
sociale destinés aux populations les plus vulnérables, et en
particulier les enfants en situation de détresse ou de grave danger.
L'absence d'un système de détection et de suivi à base
communautaire est souvent observée497.
En ce qui concerne la protection des enfants, les SAS
accueillent les enfants victimes de traite, de violences de tous genres qui y
sont conduits (même si telle n'est pas leur vocation).
492 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.102.
493 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.102.
494 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.103.
495 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.103.
496 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.103.
497 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en Côte
d'Ivoire, octobre 2014 p.104.
212
Par exemple, dans le domaine de la traite des enfants, les SAS
sont souvent chargés de l'identification des familles des enfants
victimes, des enquêtes sociales diligentées sur les familles des
enfants victimes, du suivi des activités des comités locaux de
lutte contre la traite des enfants. Relevons également que dans
l'intérêt supérieur des enfants, les services d'action
sociale (SAS) collaborent avec les ONG et les centres d'accueil
privés498.
Compte tenu du manque de moyens logistiques et de personnel
qualifié, les SAS sont très limités dans leurs actions sur
le terrain. Ce faisant, ils recourent par le biais de leur ministère de
tutelle, à l'action du ministère en charge de la justice et des
droits de l'homme dont le rôle apparait non négligeable en
matière de protection des enfants et de leurs droits.
B. AU NIVEAU DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE LA
JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME
Comme l'indique sa dénomination, le ministère de
la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques est
chargé de la mise en oeuvre et du suivi de la politique du gouvernement
en matière de justice, de droits de l'homme et des libertés
publiques. L'analyse du décret 2011-257 remplaçant le
décret n°2006-70 du 26 avril 2006, portant organisation du
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme499 , offre
de constater une réorganisation dudit ministère. Aux termes de ce
nouveau décret, le ministère dispose de sept (7) directions, soit
la direction des études de la législation et de la documentation,
la direction des affaires civiles et pénales, la direction des services
judiciaires, la direction des affaires financières, la direction des
archives, des statistiques de l'information, la direction de l'administration
pénitentiaire et finalement, la direction de la protection judiciaire de
l'enfance et de la jeunesse500. Mais nous allons, dans ce point,
nous focaliser sur la Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de
la jeunesse et un autre organe théoriquement donné comme
indépendant mais dont le budget est rattaché au ministère
de la justice, à savoir, la Commission Nationale des Droits de l'Homme
de Côte d'Ivoire (CNDHCI) qui contribue aussi à la mise en oeuvre
des droits de l'enfant.
498 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, pp.41-42.
499 Article 42 du décret n°2006-70 du 26 avril
2006, portant organisation du Ministère de la Justice et des Droits de
l'Homme.
500 Décret 2011-257 du 28 septembre 2011, Article 7.
213
1. La Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance
et de la Jeunesse (DPJEJ)
La direction de la protection judiciaire de l'enfance et de
jeunesse est une direction sous la tutelle du Ministère d'Etat,
Ministère de la justice et des droits de l'Homme (MEMJDH). Relevant du
Ministère de la justice, elle est chargée d'apporter une
assistance judiciaire à la fois aux enfants en conflit avec la loi et
aux enfants en danger physique et moral. Pour ce faire, la Direction comprend
quatre services à savoir le centre d'observation des mineurs
situé au sein de la maison d'arrêt et de correction
d'Abidjan501 (MACA), l'assistance éducative, le service de
liberté surveillé et le centre de rééducation de
Dabou502.
Elle est chargée de :
- Proposer des réformes en matière de politique
de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ;
- Mettre en oeuvre la politique de protection de l'enfance et de
la jeunesse ;
- Proposer des mesures de prévention et de lutte contre
la délinquance des jeunes ;
- Organiser et contrôler les structures d'observation,
d'accueil, de placement, d'assistance éducative, de formation et de
rééducation des mineurs ;
- Mettre en oeuvre le régime de la liberté
surveillée et de l'assistance éducative ;
- Renforcer les relations avec les personnes ou institutions
publiques ou privées recevant des mineurs ainsi qu'avec toutes personnes
et organisations participant à la protection de l'enfance et de la
jeunesse.
Le MEMJDH dispose d'une Direction de la Protection Judiciaire
de l'Enfance et de la Jeunesse. Elle élabore et met oeuvre la politique
de protection judiciaire des enfants503. Les
501 Abidjan est la capitale économique de la Côte
d'Ivoire, dont la capitale administrative et politique est Yamoussoukro. Elle
est également la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'Ouest
francophone. Elle compte selon les autorités du pays, en 2014, 4707000
habitants soit 20% de la population totale du pays, tandis qu'elle
représenterait 60% du produit intérieur brut du pays.
502 Dabou est une ville de Côte d'Ivoire proche
d'Abidjan et située administrativement dans la Région des grands
ponts. La ville de Dabou est chef-lieu de commune, sous-préfecture mais
également chef-lieu du département de Dabou.
503 Décret n°2006-70 du 26 avril 2006 portant
organisation du Ministère de la Justice et Droit de l'Homme.
214
enfants pris en compte par son mandat sont
spécifiquement ceux qui sont en conflit avec la loi. Dans ce cadre, le
MEMJDH emploie des travailleurs sociaux (un par juridiction, mais toutes les
juridictions n'en sont pas encore pourvues), pour des activités
d'enquête sociale, d'observation et de réinsertion. Il convient de
noter que les travailleurs sociaux exerçant au MEMJDH étaient
formés jusqu'en 2010 à l'Institut National de Formation Sociale
504(INFS). Notons que chaque année, cet institut forme
environ 500 diplômés en action sociale (éducateurs
périscolaires, maitres d'éducation spécialisée,
assistants sociaux, éducateurs spécialisés)505.
Il est à noter que l'institut ne dispose pas de module ou de cours
portant spécifiquement sur les problèmes de protection de
l'enfant ou du bien-être de la famille506.
Mais la réforme du secteur de la justice en cours
envisage de regrouper la formation de ses agents dans une nouvelle école
dénommée « l'institut national de formation judiciaire
(INFJ) »507. L'institut est composé de 4
écoles différentes, soit : l'école de la magistrature,
l'école des greffes, l'école des personnels pénitentiaires
et de l'éducation surveillé, puis celle de l'école de la
formation continue et des stages. Ces écoles sont actuellement
réparties sur différents sites, inadaptés aux besoins de
formation et trop étroits. Bien qu'il n'existe pas de formation
spécifique sur la protection de l'enfance destinée aux juges des
enfants, ni aux procureurs, il existe une formation commune de base d'une
durée de 30 heures dispensées à tous les
élèves magistrats depuis 1983, incluant les articles
spécifiques du code pénal
504 Ministère de la Famille, de la femme et des
affaires sociales, Direction de la planification des études et de la
documentation « Cartographie et analyse du système de protection de
l'enfant en Côte d'Ivoire », Rapport final, avril 2010, p.43,
disponible en ligne sur
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2012/09/Cote-dIvoire-Systeme-protection-enfant-Rapport-2010-FRA.pdf
( consulté le 06/05/2015).
505 Ministère de la Famille, de la femme et des
affaires sociales, Direction de la planification des études et de la
documentation « Cartographie et analyse du système de protection de
l'enfant en Côte d'Ivoire », Rapport final, avril 2010, p.43,
disponible en ligne sur
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2012/09/Cote-dIvoire-Systeme-protection-enfant-Rapport-2010-FRA.pdf
( consulté le 06/05/2015).
506 Ibid.
507 L'institut national de formation judiciaire (INFJ) est un
établissement public national à caractère administratif
crée par le décret n° 2005-40 du 03 Février 2005, qui
est devenu fonctionnel en 2008.Il a pour mission la formation initiale et
continue des magistrats, des greffiers, du personnel de l'administration
pénitentiaire et de l'éducation surveillée. L'institut
peut, dans le cadre d'un accord conclu avec les ordres et les chambres
professionnelles, assurer la formation des avocats, des notaires, des huissiers
de justice et des commissaires-priseurs. Il peut également dans le cadre
d'un accord de coopération, assurer la formation des magistrats, des
greffiers, des avocats et du personnel de l'administration
pénitentiaires étrangers. Il est placé sous la tutelle
administrative et technique du ministère chargé de la justice et
sous la tutelle économique et financière du ministre
chargé de l'Economie et des finances.
215
concernant la minorité. Il existe également une
formation pour les agents d'encadrement pénitentiaire et les maitres
d'éducations surveillée, mais pas pour les greffiers. Cette
formation aborde brièvement le sujet du traitement de la
délinquance juvénile et des moyens de rééducation,
mais ne répond actuellement pas aux normes internationales de justice
pour mineurs. Cependant, plusieurs matières, telles que
l'éducation des enfants, la sociologie de la famille, la psychologie de
l'enfance et les procédures à suivre dans le traitement d'un
dossier de mineur, sont enseignées, l'ensemble du cursus insiste
davantage sur la question des enfants en conflit avec la loi. Le directeur
national de l'INFJ est également instructeur à l'école de
la gendarmerie d'Abidjan, et son cours, d'une durée environ de 30
heures, porte sur le traitement des mineurs. Ces cours s'adressent aux
officiers de police judiciaire.
Par ailleurs, le service de l'assistance
éducative508 (SAE) apporte en faveur des enfants victimes et
de leurs parents, des conseils concernant toutes les démarches y compris
celles judiciaires à entreprendre dans l'intérêt des
enfants en danger. Le service procède souvent au placement des enfants
en danger dans des centres sociaux. Le SAE est confrontée dans son
fonctionnement à des problèmes financiers et matériels.
L'absence surtout d'un centre d'accueil d'une grande capacité lui rend
la tâche compliquée. En effet, le SAE utilise le centre d'accueil
« Sauvetage » du Bureau International Catholique pour l'Enfant (BICE)
pour placer les enfants. Ledit centre est géré par le BICE dans
les locaux de l'AE509.
508 Les mesures de protection ou d'assistance éducative
sont contenues dans la loi n° 70-483 du 3 Août 1970 sur la
minorité :
Article 10 : « Les mineurs peuvent faire l'objet de
mesures de protection ou d'assistance éducative : 1°) lorsqu'ils
donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de
garde des sujets de mécontentements très graves, par leur
inconduite ou leur indiscipline ; 2°) lorsque leur santé, leur
sécurité, leur moralité, ou leur éducation sont
compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de
l'immoralité ou de l'incapacité des père ou mère ou
de la personne investie du droit de garde. ».
Article 11 : « Les mesures de protection ou d'assistance
éducative visées à l'article précédent sont
ordonnées par le juge des tutelles qui peut notamment prescrire la
remise du mineur : 1°) celui des père et mère qui n'a pas
l'exercice du droit de garde ; 2°) à un autre parent ou à
une personne digne de confiance ; 3°) à tout établissement
public ou privé relevant du service de l'aide sociale à
l'enfance. ».
Article 12 : « Les frais d'entretien, d'instruction,
d'éducation et de rééducation du mineur qui a fait l'objet
d'une des mesures visées à l'article précédent
incombent aux père et mère. Lorsqu'ils ne peuvent supporter la
charge totale de ces frais et des frais de justice, la décision fixe le
montant de leur participation ou déclare qu'en raison de leur indigence,
il ne sera alloué aucune indemnité. ».
509 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, p.39.
216
L'élargissement des services de la DPJEDJ est
également nécessaire. Cette direction a en charge la protection
des droits des enfants en conflit avec la loi et celle des enfants en danger.
Cependant, il ressort que parmi ses quatre (4) services, seule l'assistance
éducative s'occupe en partie du cas des enfants en danger. La pratique a
même révélé que même au sein du SAE, c'est la
question de l'enfant en conflit avec la loi qui est la plus traitée. Il
convient de créer d'autres services effectivement en charge de la
question de l'enfance en danger afin de faciliter l'écoute, les conseils
et l'orientation de ces enfants et leurs représentants légaux.
Il est important de rendre les enfants victimes plus visibles.
Cela passe pour ce qui concerne les enfants, par la création de centres
sociaux ou de points d'écoute avec un personnel formé pour
recevoir les enfants, les parents, les voisins ou toute autre ayant
connaissance d'une enfant en situation difficile.
Cette direction assure de plus, l'organisation et le
contrôle des structures accueillant des mineurs (centre d'observation des
mineurs, centres éducatifs, de formation et de rééducation
des mineurs)510. Il convient de noter que, malgré le mandat
du ministère qui englobe tant les enfants victimes que ceux en conflit
avec la loi, la pratique montre que seuls ces derniers sont rencontrés
par des juges. On est tenté d'affirmer que tout est en place (sur
papier) pour l'enfant auteur de crime, alors qu'aucune prise en charge
juridique n'est prévue pour l'enfant victime511. Autre
mission intéressante, la direction a aussi pour mandat de «
renforcer les relations avec les personnes ou institutions publiques ou
privées recevant des mineurs ainsi qu'avec toutes personnes et
organisations participant à la protection de l'enfance et de la
jeunesse512. »
Dans la pratique, lorsque la Direction de la protection
judiciaire de l'enfance et de la jeunesse a connaissance d'un cas de violation
des droits de l'enfant ou lorsqu'elle en est saisie, elle contacte la Brigade
de Protection des Mineurs (BPM) qui diligente une enquête. Au terme de
l'enquête, la BPM lui envoie un rapport ou, en cas de
nécessité, la Brigade saisit directement le Procureur de la
République. En ce qui concerne les enfants en danger moral,
510 Décret n°2006-70 du 26 avril 2006 portant
organisation du Ministère de la Justice et Droit de l'Homme, Article
12.
511 Ministère de la Famille, de la femme et des
affaires sociales, Direction de la planification des études et de la
documentation « Cartographie et analyse du système de protection de
l'enfant en Côte d'Ivoire », Rapport final, avril 2010, p.44,
disponible en ligne sur
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2012/09/Cote-dIvoire-Systeme-protection-enfant-Rapport-2010-FRA.pdf
( consulté le 06/05/2015)
512 Décret 2011-257 du 28 septembre 2011, Article 12.
217
la Direction effectue des enquêtes auprès des
parents de l'enfant513. Si à l'issue de l'enquête,
l'enfant peut être retourné dans sa famille, l'on prend soin de
sensibiliser les parents avant de l'y intégrer. Dans le cas contraire,
la Direction entre en contact avec les centres de prise en charge des enfants
en situation difficile. Sur ce plan, il a été relevé que
la Direction s'appuie beaucoup sur les Centres des organisations non
gouvernementales, notamment le Centre « SAUVETAGE » du BICE. Ce
centre semble être le principal sinon l'un des partenaires
privilégiés du Ministère de la justice en matière
de placement des enfants. On peut y ajouter d'autres centres tels la Fondation
AMIGO514 qui se chargent de l'accueil des filles en situation
difficile.
Concernant les enfants en conflit avec la loi, la Direction
assure le suivi judiciaire des dossiers des mineurs en conflit avec la loi.
Dans ce cadre, lorsque l'infraction commise est mineure, la direction
négocie avec le juge pour qu'il ordonne une mesure de placement
alternative. Cependant, on imagine bien que la direction n'est pas
systématiquement informée de tous les cas de mineurs en conflit
avec la loi. La DPJEJ prend souvent connaissance des cas lors des
tournées annuelles qu'elle effectue dans les centres de détention
du pays. Au cours de ces tournées, les mineurs en détention,
souvent en détention provisoire, sont interrogés et les
informations recueillies peuvent amener la DPJEJ à demander la mise en
placement d'un enfant. La Direction assure également la supervision des
conditions d'éducation des enfants au niveau des centres publics et
privés de placement des enfants, conformément aux normes et
standards en vigueur.
513 L'enquête sociale est en réalité
réalisé le centre de protection sociale du ressort des parents de
l'enfant avec qui la direction collabore.
514 La FONDATION AMIGÓ a été
constituée à Madrid (Espagne) le 19 avril 1996 par la
Congrégation de Religieux Tertiaires Capucins1 et dressée en Acte
Publique constitutif de la Fondation conféré celui-ci par le
Notaire Monsieur MARQUES PEREDA Ange l. Le siège central est à
Madrid, Rue Zacarias Homs, 18 28043 MADRID. Le 27 novembre 1999 le Patronat a
accordé, en séance ordinaire, de créer une
Délégation (Bureau National) de la FONDATION AMIGÓ sur le
continent africain dont le siège est à Abidjan (Côte
d'Ivoire) 23 BP 2738 Abidjan 23, dans l'enceinte du Centre AMIGO-DOUME de
Niangon-Lokoa, commune de Yopougon. Le Ministère d'Etat,
Ministère de l'Administration du Territoire a octroyé
l'Arrêté n° 168/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC portant déclaration de
l'Association étrangère dénommée FONDATION AMIGO,
le 17 juillet 2003. Le but de la FONDATION AMIGÓ est : « La
recherche, la formation, la sensibilisation, l'assistance et la
coopération technique dans les domaines de l'éducation et du
social pour le développement humain, la qualité de vie, et
l'amélioration de la prévention, l'assistance,
l'intégration, et la réhabilitation d'enfants, d'adolescents et
de jeunes qui subissent l'abandon, la marginalisation, l'alcoolisme, la
toxicomanie, la délinquance, le mauvais traitement, l'isolement et la
pauvreté».
218
En réalité, la DPJEJ a souvent du mal à
accomplir sa mission. Le manque de moyens, notamment financiers et
matériels semble être son principal handicap. Dans ces conditions,
et vu le rôle qu'elle est censée jouer dans la protection des
droits de l'enfant, il est difficile à ce service d'accomplir
efficacement sa mission.
Outre ces organismes rattachés par les textes à
différents ministères, il importe d'analyser le rôle
joué par la Commission nationale des droits de l'homme dans le processus
de mise en oeuvre des droits reconnus aux enfants en Côte d' Ivoire.
2. De l'apport de la Commission nationale des droits
de l'homme dans la protection des enfants
A la suite d'un long processus commencé en 2000, la
Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI) a
été créée par la Décision n° 2005-08/PR
du 15 juillet 2005 qui a force de loi.
La CNDHCI, qui a commencé à fonctionner de
façon effective le 31 juillet 2007, s'articule autour de trois organes :
l'Assemblée Générale, le Bureau Exécutif et le
Secrétariat Général. Elle exerce des fonctions de
concertation, de consultation, d'évaluation et de propositions en
matière de promotion, de protection et de défense des Droits de
l'Homme. Cette décision susvisée a été
remplacée par la loi n° 2012 -1132 du 13 décembre
2012515 et le décret n° 2012-1133 du 13 décembre
2012 portant création, attributions, fonctionnement et organisation de
la CNDHCI.
Elle est, aux termes de la loi, un organe indépendant,
doté de la personnalité juridique et d'une autonomie
financière. Elle exerce des fonctions de concertation, de consultation,
d'évaluation et de proposition en matière de promotion, de
protection et de défense des Droits de l'Homme.
A ce titre, la Commission Nationale des Droits de l'Homme de
Côte d'Ivoire peut être saisie par toute personne physique ou
morale résidant en Côte d'Ivoire et ayant intérêt
à agir en cas de violation des Droits de l'Homme. Elle peut donc
également être saisie par tout
515 Loi n°2012-1132 du 13 décembre 2012 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDHCI), et qui abroge
la Décision n° 2005-08/PR du 15 juillet 2005 ayant force de loi,
qui elle-même modifiait la loi n°2004-302 du 03 mai 2004 portant
création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte
d'Ivoire (CNDHCI).
219
citoyen victime ou témoin de violations des droits de
l'homme. Aucune condition d'âge ou de nationalité n'est
exigée. Pour l'accomplissement de ses missions, la CNDHCI dispose d'un
pouvoir d'auto-saisine non juridictionnel ; Elle peut en effet se saisir
d'office de tout cas de violation des Droits de l'Homme commis en Côte
d'Ivoire.
Elle procède à des enquêtes non
judiciaires, mène toutes investigations nécessaires sur les
plaintes et dénonciations dont elle est saisie. Dans la conduite de ses
enquêtes, la Commission peut assigner tout témoin à
comparaître et exiger toute assistance de la part des organismes de
l'État, pour permettre la manifestation de la vérité. Elle
adresse un rapport contenant les mesures qu'elle propose au Gouvernement.
Elle peut aussi interpeller toute autorité ou
détenteur d'un pouvoir de coercition, sur les violations des Droits de
l'Homme dans les domaines qui les concernent et propose des mesures tendant
à y mettre fin. Elle peut également procéder à la
visite des établissements pénitentiaires et de tout lieu de garde
à vue, après autorisation du Procureur de la République
compétent qui peut y assister.
Elle étudie toute question relative à la
protection des Droits de l'Homme. Elle informe périodiquement le
Président de la République, le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Conseil constitutionnel,
le Médiateur de la République, le Président du Conseil
économique et social, le Premier Ministre, l'Assemblée nationale,
le Ministre en charge des Droits de l'Homme et tout le Gouvernement de ses
activités et leur fait des propositions tendant à la mise en
oeuvre, par l'Etat, des résolutions des organes et institutions de
l'Organisation des Nations Unies, de l'Union Africaine et de toutes autres
organisations internationales intervenant dans le domaine des Droits de
l'Homme.
Elle remet aux autorités suscitées, un rapport
annuel sur l'état des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire qui doit
être rendu public par ses soins. A cet effet, elle a publié et
diffusé, en 2008, 2009, 2010 et 2011, un rapport annuel516
sur l'Etat des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire. Elle donne à
titre consultatif au Gouvernement, au Parlement et à toute autre
institution de l'Etat, soit à leur demande, soit d'office, des avis
concernant toute question relative à la protection des Droits de
l'Homme.
516
http://www.cndh.ci/publication/pdf/1444079449_Rapport-2014.pdf
(consulté le 06/05/2015)
220
Elle participe à l'élaboration des rapports
prescrits par les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte
d'Ivoire est partie et entretient dans le cadre de sa mission, des rapports
avec les institutions et organisations nationales et internationales
intervenant dans le domaine des Droits de l'Homme, conformément à
la politique définie par le Gouvernement. La Commission Nationale des
Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire se compose de membres avec voix
consultative et de membres avec voix délibérative.
Les membres avec voix délibérative sont : quatre
représentants de l'Assemblée Nationale ; deux
représentants du Conseil économique et social ; deux
représentants du Médiateur de la République ; deux
représentants du Conseil Supérieur de la Magistrature ; deux
représentants de l'ordre des avocats ; un représentant par
centrale syndicale ; quatre personnes reconnues pour leur compétence
dans le domaine des Droits de l'Homme dont au moins une femme ; trois
représentants du monde religieux ; trois représentants du monde
paysan dont au moins une femme ; un représentant de chaque partie
signataire de l'accord de Linas-Marcoussis.
Quant aux membres avec voix consultative, ils proviennent des
ministères concernés.
La nouvelle CNDHCI a redémarré effectivement ses
activités le 21 juin 2013, soit plus de 11 mois après
l'expiration du mandat des premiers commissaires, intervenue depuis le 31
juillet 2012. En effet, au terme du mandat des premiers membres de la
Commission, une réforme a été engagée par le
Gouvernement, à l'issue du Conseil des Ministres du jeudi 06 septembre
2012, à travers l'adoption d'un projet de loi portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de la CNDHCI, visant surtout le
renforcement du cadre institutionnel de la CNDHCI, en rendant son statut
juridique plus conforme aux "principes de Paris517", avec
l'exclusion des entités politiques au profit des organisations non
gouvernementales (ONG).
517 Sur le plan international, la Commission française
a été à l'origine de la relance du réseau
international, particulièrement grâce à l'influence de Paul
Bouchet. Parmi les moments importants, la tenue d'une conférence
internationale des Institutions-soeurs à Paris en octobre 1991, à
l'issue de laquelle les « Principes de Paris concernant le statut des
institutions nationales de défense et de promotion des droits de l'Homme
» ont été adoptés. Ces principes visent notamment
à garantir l'indépendance et le pluralisme de ces institutions.
Ils insistent également sur le fait que les institutions nationales
doivent voir leur mandat énoncé dans un texte constitutionnel ou
législatif, c'est la raison pour laquelle la France a adopté une
loi en 2007. Ces principes prévoient également la
possibilité de compétences à caractère quasi
juridictionnel. Cela n'a pas été suivi en France où l'on a
préféré privilégier un système souple,
compte tenu du fait de l'existence d'autres organes compétents, qu'il
s'agisse du juge administratif ou du Médiateur. L'esprit était
celui d'un club ou les
221
Au-delà de cette volonté affichée, il
nous parait utile de relever deux défis majeurs à la garantie de
l'indépendance de cette Commission. Ses défis sont à
rechercher dans la nomination de ses membres, leur traitement, avantage et
indemnités, ainsi que la détermination du budget de la CNDHCI. Il
s'agit de :
- L'ineffectivité de l'autonomie financière de
la Commission : à ce jour, la CNDHCI a, théoriquement, un budget
propre indépendant mais en réalité celui-ci transite par
la direction financière du ministère en charge des droits de
l'homme. Il en va ainsi de leur traitement, avantages et indemnités
financières qui se font par le ministère de l'économie et
des finances sur proposition du ministère de la justice. Concernant le
budget de la CNDHCI, il est déterminé par le Ministre de la
justice. Ceci offre à ce ministère une opportunité de
bloquer les décaissements au cas où, pour une raison ou une
autre, il serait tenté de bloquer le travail de la Commission. En
réalité ce ministère devient juge de l'opportunité
de ses activités ;
- L'opportunité offerte aux tenants du pouvoir,
à travers différents ministères et organismes
étatiques, de désigner un quota important de membres. En effet,
sur les seize membres de la CNDHCI qui ont voix délibératives
seules sept (7) sont issus de la société civile, les neuf autres
sont des acteurs étatiques. La nomination des membres découle
derechef de la volonté des membres du gouvernement, notamment, des
préfets de région et du ministre de la justice.
Au regard de ce qui précède, des interrogations
importantes méritent d'être posées : L'Etat envisage-t-il
de donner une plus grande autonomie à la CNDHCI notamment en la dotant
de ressources financières directes sans passer par le ministère
en charge des droits de l'Homme ? L'Etat peut-il garantir que la composition de
la CNDHCI est de nature à lui assurer une indépendance
vis-à-vis de toute influence politique ? « Vérité
en deçà des
Commission venues de tous les continents, du Canada comme de
l'Australie se retrouvaient pour la première fois. Les principes de
Paris ont été transmis à la Commission des droits de
l'homme en 1992. Lors de la Conférence mondiale sur les droits de
l'homme de Vienne en 1993, les institutions nationales ont participé aux
travaux à titre propre, avec leurs propres réunions
parallèles. Leur rôle est mentionné à plusieurs
reprises dans la Déclaration et programme d'action de Vienne, notamment
en matière d'éducation et de lutte contre le racisme. Mais la
principale consécration est venue de l'Assemblée
Générale des Nations Unies qui le 20 décembre 1993, dans
une résolution 48/134 adoptée au consensus, fait siens les «
Principes de Paris » annexés à la résolution. Il
s'agit d'un texte de référence, marquant le passage d'un document
privé, élaboré par un « club », à un
document officiel des Nations Unies.
222
Pyrénées, erreur au-delà »,
la vérité de l'indépendance de la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme518 en France est loin
d'être une réalité en Côte d'Ivoire. Cela se confirme
d'autant plus que cette indépendance est mise en doute par l'expert
DOUDOU DIENE. A ce propos, dans son rapport de 2014, il demande le renforcement
de l'indépendance et la liberté de la CNDHCI. Tous ces
éléments montrent son manque d'harmonie avec les principes de
Paris519. Pire, les représentants du gouvernement qui la
composent sont plus élevés que ceux de la société
civile.
S'agissant du domaine particulier des droits de l'enfant, la
CNDHCI a en son sein un département spécialisé en
matière de protection de l'enfant. Ses rapports sur la protection des
droits de l'homme et celui des enfants, témoignent de son implication
pour le respect des droits de celui-ci. Il existe toutefois une volonté
de la Commission de se doter d'un commissaire expressément chargé
des droits de l'enfant ou d'une section ou division spéciale responsable
des droits de l'enfant.
Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé, à la
fin du processus électoral, à assurer la mise en
conformité de la CNDHCI aux Principes de Paris concernant le statut et
le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la
promotion des Droits de l'Homme.
Enfin, il convient de signifier que ce sont de simples
recommandations que cet organe émet, elles n'ont aucune force
exécutoire. Il s'avère donc indispensable de revoir toutes ces
limites en sorte de mener à bien la mission qui lui a été
assignée.
A côté de ces organes à compétence
générale, les pouvoirs publics ivoiriens ont créé
depuis des années de nombreux organes spécifiques en charge des
questions de l'enfance.
§ 2. LES ORGANES SPECIFIQUES DE
PROTECTION
Au nombre des organes mis en place par l'État ivoirien,
figurent divers organes intervenant de façon spécifique sur des
questions précises. On essaiera dans le cadre de ce paragraphe, d'en
examiner les plus pertinentes au regard de leurs compétences et actions.
Nous verrons donc successivement le rôle de la sous-direction de la lutte
contre la traite des
518 Pour plus d'infos sur la CNCDH de France, voir
http://www.cncdh.fr/ (consulté le 06/05/2015).
519
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_fr.pdf
(consulté le 06/05/2015).
223
enfants et la délinquance juvénile (A),
avant de nous appesantir sur les deux Comités de lutte contre
la traite, l'exploitation et le travail des enfants récemment
créés (B) .
A. LA SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES
ENFANTS ET LA DELINQUANCE JUVENILE (S/D-LTEDJ)
Au sein du Ministère de l'Intérieur, il existe
depuis 2006, une Sous-direction de la lutte contre le trafic d'enfant
et la délinquance juvénile (S/DLTEDJ) faisant partie des
forces de Polices Criminelles520. Cette Sous-direction
intègre l'ex-brigade pour mineurs (BPM) en adoptant son mandat et en
élargissant ses compétences territoriales au niveau national.
Quelles sont les attributions de la sous-direction de la lutte
contre la traite des enfants et la délinquance juvénile
(S/D-LTEDJ) en matière de protection des enfants contre la
traite et de quels moyens dispose-t-elle pour accomplir sa mission. Ce sont les
deux points qui seront développés dans les lignes qui vont
suivre.
1. Composition et attributions de la sous-direction de
la lutte contre la traite des enfants et la délinquance
juvénile
Créé par décret n°2006-11 du 22
Février 2006 portant organisation du Ministère de
l'intérieur, la S/DLTEDJ a pour mission à la fois, la lutte
contre la traite des enfants et la délinquance juvénile et la
lutte contre toutes atteintes aux droits fondamentaux des
enfants521. La S/DLTEDJ est une unité centrale basée
à Abidjan et composée de 2 commissaires, 6 officiers de police,
12 sous-officiers de police et 2 travailleurs sociaux. Ils travaillent en
collaboration avec les forces de police locale et les Forces de Défense
et de Sécurité. La S/DLTEDJ remplace dans ses attributions,
l'ex-Brigade pour mineurs (BPM). Toutefois, contrairement à la BM dont
la compétence territoriale se limitait à la ville d'Abidjan, la
SD/LTEDJ a une compétence nationale. Depuis la création de la
S/DLTEDJ, toutes les affaires concernant les mineurs dans les différents
commissariats doivent y être centralisées. Cela signifie que dans
la pratique, les plaintes déposées pour le compte des
520 Décret n°2006-11 du 22 Février 2006
portant organisation du Ministère de l'Intérieur.
521 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, p.37.
224
mineurs ou contre les mineurs au niveau des commissariats doivent
être transférés à la
SD/LTEDJ522.
Elle a pour mission d'assurer la protection de l'enfant et de
l'adolescent en danger. Dans ce cadre, elle est appelée à
constater les infractions commises sur les enfants, de même que les
infractions commises par les enfants eux-mêmes. Dans ces cas, elle se
doit de rassembler les preuves et d'opérer la recherche des auteurs des
infractions commises. Les attributions de la SD/LTEDJ recouvrent trois domaines
d'intervention : la prévention, la protection et la répression.
Ces trois domaines d'intervention sont répartis à travers les
trois services qui composent la SD/LTEDJ, à savoir : le service de la
prévention, le service de la répression et le service de la
statistique et de la documentation523.
En matière de prévention, la SD/LTEDJ a pour
mission d'assurer la sensibilisation des acteurs de ses domaines de
compétence et de détecter, de façon préventive, en
ce qui concerne la traite des enfants, les trafiquants potentiels. Pour cela,
elle effectue quelques fois des sorties au niveau des zones
frontalières, notamment la frontière avec les pays tels le Mali
et le Burkina524. En ce qui concerne sa mission de
répression, en réalité, la SD/LTEDJ ne réprime pas,
car cette prérogative est celle de la justice. Elle contribue à
la répression des auteurs d'infractions, en identifiant les auteurs
qu'elle défère à la justice pour qu'ils soient
jugés. Enfin, elle tient à jour des données statistiques
sur les cas relevant de son domaine d'intervention. Dans la pratique, elle est
saisie pour des affaires relatives à la traite des enfants, à
l'exploitation des enfants sous toutes formes, à la maltraitance
physique et morale des enfants, aux violences sexuelles, à
l'enlèvement d'enfant, aux enfants abandonnés, aux
problèmes conjugaux, etc525. Les actions de la S/DLTEDJ en
faveur des enfants victimes concernent la réception des plaintes, les
enquêtes, l'écoute des victimes, le placement dans des centres
d'accueil et la transmission des Procès-Verbaux (PV) au parquet. Pour
tenir
522 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, p.38.
523 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, p.38.
524 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, p.38.
525 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, pp.50-58.
225
compte de la particularité de l'enfant, la S/DLTEDJ
comprend des agents de police judiciaire (APJ) et des travailleurs sociaux.
En matière d'accès à la justice,
l'écoute et l'enquête par le personnel approprié permettent
de recueillir des informations importantes pour la justice : auteurs de
l'infraction, dommages subis par l'enfant, domicile, besoins de la victime,
etc. Le placement dans un centre d'accueil permet de garder l'enfant dans un
endroit sécurisé pendant que la procédure suit son cours
surtout dans les cas d'enfants ayant subi des dommages de la part de ceux chez
qui ils résidaient526. Le procès-verbal dressé
et transmis au parquet par la SDLTEDJ est par ailleurs, un réservoir
d'informations clés.
Malgré son rôle essentiel dans l'administration
de la justice en faveur de l'enfant victime, la S/DLTEDJ est confrontée
à des difficultés impactant son bon fonctionnement. D'abord, ces
difficultés sont d'ordre matériel ; en effet, l'absence de
véhicules, de bureaux appropriés et surtout l'absence de centre
d'accueil étatique destiné à recevoir les enfants victimes
constituent des freins à l'atteinte des objectifs de la S/DLTEDJ. Les
difficultés sont ensuite d'ordre humain car l'effectif est réduit
pour un organe à compétence nationale. Enfin, il existe des
handicaps d'ordre organisationnel tels que l'absence de ligne
téléphonique, de numéro vert et l'absence de permanence
des assistants sociaux. Vu le rôle clé que doit jouer la S/DLTEDJ,
des actions positives méritent d'être engagées en vue de
faciliter le travail des agents de police et travailleurs sociaux. Face aux
difficultés d'ordre matériel, humain et financier, il est
important de doter la S/DLTEDJ de moyens nécessaires (personnel,
véhicules, locaux appropriés, centre d'accueil pour enfants en
danger) pour fonctionner correctement. Il faut aussi éviter au maximum
la lenteur dans le traitement des dossiers des enfants et agir avec
célérité pour qu'ils soient vite dédommagés.
S'y ajoutent la nécessité de joindre au procès-verbal que
la police transmet au parquet après audition des parties prenantes, le
rapport des travailleurs sociaux qui illustre mieux les besoins de l'enfant et
sa version des faits. Ces besoins peuvent être utiles pour le juge dans
la détermination de la réparation. Aussi, comme
suggéré par des travailleurs sociaux rencontrés, il
importe de créer des salles d'écoute afin que l'enfant puisse
aisément relater les faits. Enfin, il apparait important de sensibiliser
les agents de police sur la nécessité de traiter les enfants
victimes
526 TAPSOBA (J.S.), L'accès des enfants victimes
à la justice en Côte d'Ivoire, mémoire de master II,
CERAP, 2010, p.38.
226
avec une attention particulière et également,
sensibiliser les enfants sur la nécessité de connaitre leurs noms
et prénoms, ceux de leurs parents, leur lieu de résidence et
l'adresse de leurs parents.
Outre l'amélioration des conditions d'accès
à la justice de façon générale, pour voir l'enfant
victime, obtenir effectivement réparation, il faut que l'Etat puisse
doter les institutions spécialisées de moyens pour fonctionner
correctement.
D'abord, la SDLTEDJ doit fonctionner effectivement vu son
rôle particulier en matière de justice pour mineurs. Elle a une
compétence nationale, et partant, devrait voir ses services dotés
de moyens conséquents pour fonctionner correctement. Cela implique des
locaux adaptés, un personnel en nombre suffisant pour traiter les
dossiers des enfants, des moyens de transport nécessaires pour faire les
enquêtes de terrain aussi bien à Abidjan que dans les autres
villes, une ligne téléphonique véritablement ouverte et
accessible, etc. Par ailleurs, il est impératif de décentraliser
les services de la S/DLTEDJ car il s'agit d'une structure à
compétence nationale. Laisser les enfants des autres régions
dépendre uniquement des commissariats n'est pas conforme au principe de
l'égalité puisque ceux d'Abidjan peuvent accéder aux
services de la S/DLTEDJ, qui est une institution spécialisée.
Toujours, pour le compte de la S/DLTEDJ, un centre d'accueil doit être
créé pour faciliter la prise en charge des enfants victimes dont
les cas nécessitent un placement. L'exemple du Bénin
mérite d'être cité car la brigade de protection des mineurs
(BPM) béninoise qui a également compétence nationale,
dispose d'une antenne départementale dans chaque département du
pays527.
A travers la mission qui lui est assignée, la SD/LTEDJ
apparaît comme un organe clé dans la lutte contre le trafic des
enfants.
Par ailleurs, le seul centre d'accueil fonctionne, grâce
aux ONG, l'équipement du centre est l'oeuvre du BICE, qui d'ailleurs est
le principal partenaire du centre. Tout ceci pourrait amener à dire que
l'unique centre n'aurait jamais vu le jour sans le secours des partenaires
techniques et financiers. Dès lors, un regard sur le rôle et le
fonctionnement de ce centre d'accueil s'avère indispensable.
527 OMCT, Droits de l'enfant au Bénin .
Rapport alternatif au comité des Nations Unies des droits de
l'enfant sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant
au Bénin, disponible sur :
http://
www.crin.org/docs/Benin OMCT NGO Report.pdf (consulté le
04/03/2015).
227
2. Le centre d'accueil et de transit des enfants de la
SD/LTEDJ
Principal centre public de transit des enfants victimes de
toutes sortes d'abus et de violences, le centre dénommée «
SAUVETAGE », accueille les enfants victimes de traite et oeuvre
pour leur réinsertion dans leur famille d'origine. Des centaines
d'enfants transitent chaque année par le centre de la
SD/SLTEDJ528. Parmi eux, on dénombre des enfants victimes de
traite, interceptés à Abidjan et ses environs ou en provenance de
pays limitrophes tels le Burkina, le Mali, le Bénin... A en croire les
données recueillies sur le terrain, le Mali et le Burkina seraient les
pays d'origine des enfants victimes de traite hors du territoire national.
Il existe aujourd'hui une procédure de prise en charge
des enfants victimes de traite en Côte d'Ivoire.
Cette procédure comprend trois phases :
- La détection, l'accueil et le rapatriement de
l'enfant victime de traite
La première phase prend en compte la détection,
l'accueil et le rapatriement de l'enfant dans son pays d'origine ; Cette
première phase dure entre un et trois mois. La détection qui peut
être faite par les organismes étatiques, les organisations non
gouvernementales et la communauté du pays d'origine de l'enfant dans le
pays de détection, doit permettre d'avoir un dossier sur
l'enfant529, de l'informer et de l'orienter vers les services
compétents530. En ce qui concerne l'accueil et le
rapatriement de l'enfant, ils doivent se conformer à la procédure
mise en place dans le pays où l'enfant est détecté et la
durée des actions à mener est de un mois à trois mois.
Trois catégories d'intervenants sont identifiées pour jouer un
rôle : la Représentation diplomatique du pays d'origine de
l'enfant, la Structure d'accueil de l'enfant et la Cellule conjointe de la
SD/LTEDJ et de le DPE531. Dans un premier temps, il s'agira
d'informer les autorités du MEMAE532 et du
MSFFE533 et de rechercher les auteurs
528 Par exemple, selon une assistante sociale
dénommée Mme KOFFI que nous avons rencontrée lors de notre
passage en 2013, plus de 500 enfants y avaient transité.
529 Le dossier de l'enfant prendra en compte la
déclaration de la personne ayant détecté l'enfant, le
rapport de police et une fiche personnelle avec la photo de l'enfant.
530 Cette phase théoriquement, doit durer au plus 24
heures.
531 Direction de la Famille, de l'enfant et de l'adolescent.
532 Ministère d'Etat, Ministère des Affaires
Étrangères.
533 Ministère de la Solidarité, de la Famille, de
la Femme et de l'Enfant.
228
de la traite de l'enfant victime, tout en veillant à
son intérêt supérieur. Ensuite, veiller à
l'indemnisation par voie judiciaire de l'enfant victime et organiser son
départ vers son pays d'origine. Enfin, informer les partenaires qui
doivent intervenir dans l'accueil de l'enfant dans son pays d'origine,
coordonner les recherches sur l'identification de ses parents et mobiliser les
ressources matérielles, humaines et financières pouvant permettre
son accueil. La deuxième phase prend en compte, la prise en charge au
retour et la réintégration familiale de l'enfant.
- La prise en charge et la réintégration
familiale de l'enfant victime de traite534
Cette deuxième phase de la procédure, qui varie
entre un et trois mois, doit connaître la participation de la cellule
conjointe de la SD/LTEDJ et de la DPE, les forces de sécurité
publique et des structures de protection et d'accueil des enfants et des
parents de l'enfant. Au cours de cette phase, la SD/LTEDJ et la DPE doivent
d'abord assurer l'accueil de l'enfant, obtenir une ordonnance de placement de
l'enfant, placer l'enfant dans une structure d'accueil et coordonner les
actions de recherche des parents de l'enfant ; ensuite, elles doivent faire
mener une enquête sociale535 pour évaluer les
possibilités de stabilité de l'enfant dans sa famille,
sensibiliser cette dernière et les autorités locales. Les forces
de sécurité, quant à elles, doivent sécuriser les
opérations relatives à l'accueil de l'enfant et assurer la
poursuite judiciaire des trafiquants. En ce qui concerne les centres d'accueil
de l'enfant, ils doivent, dans un premier temps, héberger l'enfant, le
nourrir, l'habiller, lui donner les soins nécessaires, et assurer sa
réinsertion dans sa famille536, puis assurer son retour dans
sa famille d'origine en collaboration avec le MFFE. Enfin, la famille de
l'enfant, si elle est identifiée, doit préparer l'arrivée
de l'enfant, s'engager à garder et suivre l'enfant et attester avoir
reçu son enfant des services compétents du Ministère de la
famille et de l'enfant. Enfin, la troisième phase concerne le processus
de réinsertion sociale de l'enfant.
534 La deuxième phase de la procédure doit
donner lieu à : l'ordonnance de placement, au rapport relatif à
l'identification de l'enfant, un dossier médical de l'enfant, un rapport
de l'action de poursuite judiciaire des trafiquants et leurs complices, un
rapport de suivi de l'enfant au sein de la structure d'accueil, l'inventaire
des biens de l'enfant à son arrivée au centre d'accueil, la
décision du MFPSS de réintégrer l'enfant dans sa
famille.
535 L'enquête sociale est menée par le centre de
promotion sociale de la localité.
536 Outre les points énumérés, les
centres d'accueil doivent ouvrir un dossier sur chaque enfant reçu,
l'encadrer, l'assister juridiquement etc.
229
- Le processus de réinsertion sociale de l'enfant
victime de traite537
La dernière étape de la procédure de
prise en charge de l'enfant victime de traite dure entre deux et trois ans.
Elle doit connaître la participation des structures étatiques (le
MFFE notamment), des organisations non gouvernementales, de la famille et de la
communauté de l'enfant victime. Au cours de cette phase, les services du
MFFE et les ONG doivent veiller à la réinsertion sociale de
l'enfant, coordonner le processus de réinsertion et collecter des
informations relatives à cette réinsertion. En ce qui concerne la
famille de l'enfant, elle doit participer à la recherche et à la
mise en oeuvre des solutions pour la réinsertion de l'enfant ; dans son
rôle, elle doit être accompagnée par la communauté.
D'autres structures peuvent jouer un rôle en ce qui concerne l'appui
à la scolarisation et la formation professionnelle de l'enfant
victime.
La mise en place d'une procédure de prise en charge de
l'enfant victime de traite constitue sans doute une avancée dans la
prise en charge des enfants. Cependant, dans la pratique, ces
différentes étapes sont rarement suivies et les mesures
prévues ne sont presque jamais respectées. En attendant de
revenir, dans la seconde partie de ce travail, sur les problèmes qui
constituent un handicap sérieux pour la lutte contre la traite des
enfants en Côte d'Ivoire, nous remarquons déjà que les
pouvoirs publics ne jouent qu'un rôle de coordination des diverses
actions à mener pour la réinsertion de l'enfant. En effet, les
actions déterminantes, qui peuvent participer efficacement à une
réinsertion réussie de l'enfant (appui à
l'éducation et à la formation professionnelle), étaient
laissées à d'autres structures, notamment les ONG ou partenaires
techniques. Mais avec la création récente de deux Comités
de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, osons
espérer que la donne changera au niveau du degré d'engagement des
acteurs étatiques.
B. LA CREATION RECENTE DE DEUX COMITES DE LUTTE CONTRE
LA TRAITE, L'EXPLOITATION ET LE TRAVAIL DES ENFANTS
Pour permettre une meilleure coordination et capitalisation de
toutes les actions de lutte, un nouveau cadre institutionnel a
été mis en place et un plan d'action national est
élaboré. Le cadre institutionnel de lutte contre le travail des
enfants a été renforcé par la création de
537 La dernière phase doit aboutir à : un projet
de réinsertion de l'enfant victime de traite, l'identification des
structures d'appui, un rapport trimestriel de suivi de l'enfant et un rapport
d'évaluation des actions entreprises
230
deux (02) comités. En effet, le 3 novembre 2011, le
Président de la République a signé deux décrets
portant création de deux Comités de lutte contre la traite,
l'exploitation et le travail des enfants538.
Le premier, le Comité National de Surveillance des
Actions de Lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants
(CNS)539, est présidé par Mme Dominique Ouattara, et
est doté d'un Secrétariat exécutif. Il est composé
de membres du Cabinet de Mme Ouattara, d'experts, et d'organisations nationales
et internationales choisies « pour leurs actions en faveur des enfants
»540. Le Comité National de Surveillance a pour
mission de suivre et d'évaluer les actions du gouvernement en
matière de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des
enfants. A ce titre, il est chargé :
- de suivre la mise en oeuvre des projets et programmes du
gouvernement dans le cadre de la lutte contre la traite, l'exploitation et le
travail des enfants ;
- de suivre l'application des conventions en matière de
lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ;
- d'initier des actions de prévention contre la traite,
l'exploitation et le travail des enfants; - de faire des propositions au
gouvernement en vue de l'abolition du travail des enfants ;
- et de veiller à l'application des orientations du
gouvernement dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la traite
des enfants;
- de proposer des mesures pour la prise en charge des enfants
victimes des pires formes de travail des enfants ;
538 DIENE (D.), Rapport sur la situation des droits de
l'homme en Côte d'Ivoire, 9 janvier 2012, page 15, disponible sur :
http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf (consulté le 30 septembre 2013).
539 Décret n°2011-365, portant création du
Comité National de Surveillance (CNS), le 3 novembre 2011.
540 Discours de Mme Ouattara à l'occasion du lancement
officiel des activités du CNS, le 15 février 2012. Disponible sur
:
http://africaview.net/?action=show_
page&id_page=1791&child_page_start=336 (consulté le 30 septembre
2013) ; Il est composé d'organisations internationales et nationales
oeuvrant dans le domaine de la protection de l'enfance. Ce sont :le Fonds des
Nations-Unies pour l'Enfance (UNICEF) ; le Bureau International du Travail
(BIT) ; l'ONG Save The Children international ; le Bureau International
Catholique de l'Enfance (BICE) ; la Fondation International Cocoa Initiative
(ICI) ; l'International Rescue Committee (IRC); le Conseil du Café
-Cacao ; le Groupement des Exportateurs (GEPEX) ; le Groupement des
Négociants Internationaux (GNI) ; l'Union Générale des
Travailleurs de Côte d'Ivoire (UGTCI) ; le Forum National des ONG d'aide
à l'enfance ; l'ONG Fraternité sans Limites ; la
Coopérative Agricole KAVOKIVA du Haut Sassandra (CAKHS) ; la
Fondation Children of Africa.
231
- de contribuer à la réinsertion scolaire et
professionnelle des enfants travailleurs.
Le second, le Comité Interministériel de Lutte
contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (CIM)541,
est présidé par le ministre d'Etat en charge de l'emploi, des
affaires sociales et de la formation professionnelle, et est composé de
quinze ministères techniques542. Il est doté d'un
Secrétariat technique.
Il a pour mission de concevoir, de coordonner et d'assurer la
mise en oeuvre des programmes et projets en vue de l'interdiction du travail
des enfants. A ce titre, il est chargé:
- de définir et de veiller à l'application des
orientations du gouvernement dans le cadre de la politique nationale de lutte
contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ;
- de valider les différents programmes et projet
exécutés par les partenaires en vue de vérifier leur
conformité avec la politique nationale de lutte contre la traite,
l'exploitation et le travail des enfants ;
- de coordonner les activités de tous les acteurs
intervenant dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des
enfants ;
- d'évaluer l'exécution des programmes et
projets relatifs à la lutte contre la traite, l'exploitation et le
travail des enfants.
Pourquoi deux (2) comités alors que leurs missions sont
très proches : l'une d'entre elles est identique : « veiller
à l'application des orientations du gouvernement dans le cadre de la
politique nationale de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des
enfants ». Un seul comité aurait suffi pour être plus
opérationnel.
Les deux Comités ont travaillé conjointement
pour l'élaboration du Plan d'Action National (PAN) 2012-2014, seul
programme adopté à ce jour contenant des mesures de lutte
541 Décret n°2011-364, portant création du
Comité Interministériel de Lutte contre la traite, l'exploitation
et le travail des enfants (CIM), le 3 novembre 2011.
542 Il est Présidé par le Ministre en charge de
l'Emploi et a pour Vice-président le Ministre en charge de l'Enfant. Il
est composé de : un représentant du Premier Ministre ; un
représentant du Ministre en charge de la Justice ; un
représentant du Ministre en charge de l'Administration du Territoire ;
un représentant du Ministre en charge de l'Economie et des Finances ; un
représentant du Ministre en charge de l'Education Nationale ; un
représentant du Ministre en charge de l'Artisanat , un
représentant du Ministre en charge de l'Agriculture ; un
représentant du Ministre en charge de l'Enseignement Technique ; un
représentant du Ministre en charge des Droits de l'Homme , un
représentant du Ministre en charge de la Communication ; un
représentant du Ministre en charge des Transports ;un
représentant du Ministre en charge de la Promotion de la Jeunesse ; un
représentant du Ministre Délégué à la
Défense.
232
contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales. Le CNS et le CIM se sont appuyés sur une collaboration
avec les institutions publiques, des organisations non gouvernementales et des
institutions internationales, tels que le Bureau International du Travail (BIT)
et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF)543. Ce plan
visait à réduire de manière significative les pires formes
de travail des enfants jusqu'en 2014, et se décline en quatre axes
stratégiques à savoir : La prévention, la protection des
enfants, la poursuite et la répression des auteurs d'infractions, et
enfin le suivi-évaluation des activités. Les stratégies ne
sont toutefois pas définies précisément, et aucune
référence n'est faite quant à la réduction de la
demande en matière d'exploitation sexuelle d'enfants, ni concernant la
participation des enfants dans la lutte contre ce phénomène. D'un
point de vue des ressources, le plan prévoit un coût
s'élevant à 13 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 3
milliards financés par l'Etat ivoirien544. Les 10 milliards
restant doivent donc être financés grâce aux partenaires et
bailleurs de fonds, tout au long de la période d'exécution du
Plan. Dans le cadre du Plan, les actions prioritaires pour 2012 étaient
notamment de sensibiliser la population, créer un site internet de lutte
contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, créer des
infrastructures complémentaires (deux structures d'accueil, mise en
place d'un numéro vert et de deux brigades de protection de mineurs) et
renforcer celle déjà existantes545. Ainsi, des
activités de sensibilisation ont été
réalisées, avec notamment la mise en place de comités de
villageois et de surveillance. Par ailleurs, les compétences des
autorités préfectorales de Yamoussoukro ainsi que les
autorités policières et judiciaires en charge de la
problématique du travail des enfants, ont été
renforcées546. Si
543 Site officiel de Mme Dominique Ouattara, Plan d'Action
National 2012-2014 de lutte contre la traire, l'exploitation et le travail des
enfants, budget et financement du Plan, page 25,:
http://www.dominiqueouattara.ci/sites/default/files/pan_2012-2014_tpfte_partie_narrative_0.pdf
(consulté le 30 septembre 2013).
544 Site officiel de Mme Dominique Ouattara, Plan d'Action
National 2012-2014 de lutte contre la traire, l'exploitation et le travail des
enfants, budget et financement du Plan, page 25,:
http://www.dominiqueouattara.ci/sites/default/files/pan_2012-2014_tpfte_partie_narrative_0.pdf(consulté
le 30 septembre 2013).
545 Site officiel de Mme Dominique Ouattara, Plan d'Action
National 2012-2014 de lutte contre la traire,
l'exploitation et le travail Côte d'Ivoie|52 Côte
d'Ivoie|53 des enfants:
http://www.dominiqueouattara.ci/sites/default/files/pan_2012-2014_tpfte_partie_narrative_0.pdf
4 (consulté le 24 janvier 2013).
546
Abidjan.net, Atelier de formation /
Lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants : La
Première dame renforce les capacités opérationnelles de la
police et de la gendarmerie, Atelier de formation à l'intention des
éléments de la sous-direction de la police criminelle et des
brigades de la gendarmerie nationale en charge
233
aucun bilan officiel n'a été publié, la
Secrétaire exécutive du CNS a néanmoins
énuméré les actions entreprises au cours de l'année
2012, lors de la 23ème réunion de partenariat de la World
Cocoa Foundation (WCF) à Washington en juin 2013547.
Notons toutefois que la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants
n'étant prévue que de façon partielle à travers ce
programme, le CNS ne semble pas considérer cette problématique
comme prioritaire et s'est concentré principalement sur le travail des
enfants dans les plantations de cacaoyers.548 Enfin, le suivi et
l'évaluation du Plan 2012- 2014 est assuré au niveau des deux
comités par différentes entités : un Secrétariat
Exécutif qui assure la coordination au niveau central, le CNS, et enfin
les comités régionaux et départementaux. Par ailleurs,
dans le cadre de l'axe stratégique « suivi-évaluation
des activités », la Présidente du CNS a lancé en
juin 2013 le Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants en
Côte d'Ivoire (SOSTECI), outil ayant vocation à fournir une «
base de données fiable et solide »549. Lors du
lancement de ce nouvel outil, la Présidente du CNS, a appelé les
différents acteurs à s'impliquer d'avantage pour une meilleure
collaboration afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Comme on le voit, en dépit de leurs faiblesses, il
existe divers mécanismes politiques et administratifs afférents
à la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. Cela
traduit une certaine volonté de ce pays à mieux protéger
les enfants. Cette volonté est renforcée par la mise en place de
juridictions spécialisées pour enfants.
de la lutte contre la traite et la délinquance
juvénile au cabinet de la Première Dame à Cocody, le 13
août 2013,:
http://news.abidjan.net/h/467881.
Html (consulté le 30 septembre 2013).
547 Site officiel de Mme Dominique Ouattara, L'engagement de
la Première Dame Dominique Ouattara salué aux Etats-Unis:
http://www.
dominiqueouattara.ci/fr/activites/lutte-contre-le-travail-des-enfants-3
(consulté le 30 septembre 2013).
548 Site officiel de Mme Dominique Ouattara, « Lutte
contre les pires formes de travail des enfants : Le CNS sensibilise les
populations des zones de production de cacao»,:
http://www.
dominiqueouattara.ci/fr/activites/lutte-contre-les-pires-formes-de-travail-des-enfants-0(consulté
le 30
septembre 2013).
549 Cérémonie de lancement du Système
d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants en Côte d'Ivoire
(SOSTECI), présidée par Mme Dominique Ouattara, le 25 juin 2013 :
http://www.dominiqueouattara.
ci/fr/activites/lancement-du-sosteci (Consulté le 29 juin
2013).
234
SECTION II. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES POUR
ENFANTS
La prise en compte des spécificités de la
délinquance juvénile exige l'existence de juridictions
spéciales chargées de juger les mineurs
délinquants550. Cette spécialisation constitue la
clé de voute de la justice pénale des mineurs. A l'instar de bien
de pays africains, en Côte d'Ivoire, le délinquant
âgé de moins de 18 ans au moment des faits relève, sauf
pour les petites contraventions551, d'une juridiction
spécialisée : le tribunal pour enfants pour les délits, la
Cour d'assises des mineurs pour les crimes. Ce faisant, ces juridictions sont
saisies suivant la nature ou la gravité de l'infraction reprochée
à l'enfant, suivant qu'il s'agisse d'une contravention ou d'un
délit (Paragraphe 1) ou bien d'un crime
(Paragraphe 2).
§ 1. LES JURIDICTIONS COMPETENTES EN
MATIERE
CONTRAVENTIONNELLE ET DELICTUELLE
Le Tribunal de simple police est compétent pour
connaitre des contraventions (A) tandis que les délits relèvent
de la compétence du Tribunal pour enfants (B) et du juge des enfants
(C).
A. LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
Le tribunal de simple police est la seule juridiction non
spécialisée appelée à intervenir dans les affaires
impliquant des mineurs. C'est une juridiction de droit commun qui juge les
contraventions552. La procédure suivie devant cette
juridiction est quasi identique à celle indiquée pour tout
tribunal correctionnel553 à la différence que le
prévenu peut se faire représenter par un avocat ou une personne
titulaire d'une procuration554. Cela a pour conséquence
immédiate de rendre la décision du tribunal
contradictoire555. Il est surprenant
550 BOULOC (B.), Procédure pénale,
Précis Dalloz, 22e éd., Paris, 2010, p.456 ;
COMMISSION DE PROPOSITIONS DE REFORME DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945
RELATIVE AUX MINEURS DELINQUANTS, Rapport Varinard. Entre modifications
raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter. La
justice pénale des mineurs 86-87.
551 Le tribunal de simple police est compétent pour
juger des contraventions les moins importantes reprochées aux enfants.
Ainsi, l'enfant, auteur d'une contravention de la circulation, sera jugé
de la même manière qu'un adulte.
552 Art.521, C.P.P. fr. rapp. Art.514 nouveau, C.P.P.iv. ( loi
n°69-371, 12 août 1969).
553 Art.524, et s. C.P.P. iv.
554 Art.537 et 538, C.P.P. iv.
555 Cass. Crim.2 juin 1977 :Bull.crim.1977,
n°64.
235
que les enfants soient justiciables devant une telle
juridiction de droit commun, alors que les principes directeurs de la justice
pour mineurs énoncent clairement la spécialisation des
juridictions pour mineurs.
En droit français, les contraventions de police des
quatre premières classes commises par les mineurs sont
déférées au tribunal de police556.
Au contraire en droit ivoirien, le tribunal de simple police
est compétent pour connaitre des contraventions, toutes classes
confondues. Tel est ce qui ressort des dispositions contenues à
l'article 788 du code de procédure pénale ivoirien « les
contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont
déférés au tribunal de simple police siégeant dans
les conditions de publicité prescrites à l'article 782 pour le
tribunal pour enfants ». Néanmoins, l'article 789
alinéa 2 nouveau du code de procédure pénale ivoirien
précise que « le tribunal peut s'il l'estime conforme à
l'intérêt du mineur, transmettre le dossier au juge des enfants
qui a la faculté de placer le mineur sous le régime de la
liberté surveillée »557.
Cette possibilité de saisine est aussi prévue en
France par l'ordonnance du 2 février 1945 uniquement pour les
contraventions de cinquième classe558.
En tout cas, l'article 789 alinéa 2 du nouveau du code
de procédure pénale ivoirien permet de soustraire le mineur de la
rigueur de la procédure suivie devant le tribunal de police au profit
d'une autre juridiction présentant les garanties de la
spécialisation. Toutefois, si la loi autorise le tribunal de police
à se dessaisir au profit du juge des enfants, il ne peut se
déclarer incompétent pour juger un mineur
déféré devant lui. Telle est la position de la
jurisprudence de la Cour d'appel d'Abidjan confirmée par un arrêt
du 2 mars 1982559. L'arrêt rendu est libellé comme suit
:
« (...) Considérant que le tribunal
susvisé, par jugement de défaut en date du 22 octobre 1981 s'est
déclaré incompétent pour cause de minorité de M.
D., au motif qu'en vertu de l'article 766 alinéa 2 du code de
procédure pénale, en aucun cas, il ne peut être suivi
contre un mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de
citation directe, et renvoyé le ministère
556 Art.21, Ord. 2 février 1945.
557 Article 789 alinéa 2 de la loi N°81-640 du 31
Juillet 1981portant code de procédure pénale ivoirien.
558 Art. L531-2, C. org.Jud.anc. ; art.5, 8 al.8-2, 21, Ord.2
février 1945.
559 C.A. d'Abidjan, 2 mars 1982, Ministère public
c/M.D., Arrêt précité.
236
public à se mieux pourvoir ; considérant que
par acte de Greffe en date du 4 novembre 1981, le Ministère public a
relevé appel de cette décision ; considérant que l'article
766 du code de procédure pénale dispose pour les crimes et
délits, et non pour les contraventions qui relèvent toujours,
quel que soit l'âge de leurs auteurs du Tribunal de simple police, qu'en
l'espèce, les infractions commises par M.D. étant des
contraventions, le prévenu pouvait bel et bien être assigné
devant le Tribunal de simple police suivant la procédure de citation
directe nonobstant sa minorité ; que c'est à tort que le tribunal
de simple police s'est déclaré incompétent ; qu'il y'a
lieu par conséquent de reformer la décision entreprise et de
condamner M.D. du chef des deux contraventions (...) »
L'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan appelle deux
observations. La première est l'intérêt que la loi et la
jurisprudence accordent à la répartition des compétences
entre les différentes juridictions répressives : à savoir,
les crimes sont jugés par la cour d'assises, les délits par le
tribunal correctionnel, et les contraventions par le tribunal de simple police.
Le tout est de faire respecter les règles de procédure
pénale et d'éviter qu'une contravention soit jugée par un
tribunal correctionnel, ou un délit par une cour d'assises. La seconde a
trait à l'intérêt du mineur. Sans remettre en cause le
principe précédent conforté par l'arrêt de la Cour
d'Appel d'Abidjan, le législateur ivoirien reste attaché à
la nécessité de la spécialisation des juridictions pour
mineurs, et autorise pour ce faire quelques dérogations à
certains principes de droit commun. En ce sens, les infractions commises par
les mineurs échappent à la compétence des juridictions
répressives ordinaires pour ressortir à la compétence des
juridictions spéciales à savoir le tribunal pour enfants, le juge
des enfants et la cour d'assises des mineurs.
B. LE TRIBUNAL POUR ENFANTS
En règle générale, le mineur
délinquant n'est pas traduit devant les juridictions de droit commun,
mais plutôt devant des juridictions
spécialisées560. Force est de constater que cette
560 Article 756 CPP. Ivoirien « Le mineur de dix-huit ans
auquel est imputée une infraction qualifiée crime ou délit
n'est pas déféré devant les juridictions pénales de
droit commun et n'est justiciable que des tribunaux pour enfants et de la cour
d'assises des mineurs ».
237
idée fait l'unanimité dans l'ensemble des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant561, et a
fait écho dans le droit positif de presque tous les pays signataires.
Malheureusement, la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant a tout simplement éludé la question
de la spécialisation des juridictions pour enfants, comme si cela ne
présentait aucun intérêt. Pourtant, elle se montre
favorable au traitement spécial de tout mineur accusé ou
déclaré coupable d'avoir enfreint la loi
pénale562. Or, pour parvenir à ce traitement
différentiel ou spécial, les intervenants au procès
pénal du mineur doivent nécessairement présenter la
garantie d'un minimum de spécialisation. Dans le silence de la Charte,
il est loisible de supposer que les rédacteurs ont
préféré réserver à chaque Etat, la primeur
de l'élaboration des lois pénales applicables aux mineurs
conformément aux recommandations de la Charte. Force est de
reconnaître que les Etats s'efforcent de promouvoir la création de
juridictions spéciales, même si dans certains pays, la
spécialisation de la justice des mineurs se fait encore
attendre563. En République populaire du Congo, dans le cadre
de la création des tribunaux populaires, des juridictions pour enfants
ont vu le jour. Il s'agit du juge des enfants, de la Chambre correctionnelle
pour mineurs, la section pour mineurs de la Chambre criminelle564.
Mais dans l'ensemble, ces juridictions n'ont la plupart du temps qu'une
existence théorique. La pénurie de magistrats
spécialisés dans les affaires de minorité fait que les
fonctions de juge des enfants sont exercées par un magistrat ordinaire,
un président de tribunal ou un juge désigné par lui. Ce
qui revient à dire que ce sera le même magistrat qui jugera aussi
bien les adultes que les mineurs, au risque de voir ces derniers traités
suivant les règles applicables aux premiers565. Au Niger, la
compétence des juridictions répressives en matière de
crime a longtemps souffert d'une limite tenant à l'âge de
l'inculpé. Les crimes commis par les mineurs de 16 ans étaient
jugés par le tribunal de première instance statuant en
matière correctionnelle. Le mineur de 13 ans pouvait être
déféré à une juridiction répressive de droit
commun. Il était jugé par le président du tribunal
561 A propos de la spécialisation et la
professionnalisation des acteurs de la justice des mineurs V. art 2-3, Ensemble
des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice des mineurs (Règles de Beijing, 1985), art.40-3 Convention
internationale relative aux droits de l'enfant 1989.
562 Art. 17-3 « Le but essentiel du traitement de
l'enfant durant le procès est son amendement, sa
réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation
».
563 Il en va ainsi du Cameroun.
564 KOKI (A.) « Les tribunaux populaires en
République populaire du Congo », Penant, 1985,
n°786-787, p.110 et s.
565 MANDE DJAPOU (J.) « La législation
centrafricaine de protection de l'enfant », op. cit., p.310.
238
civil et ne devait faire l'objet que de mesures de
surveillance, d'éducation et d'assistance566. Aujourd'hui,
avec une ordonnance intervenue en 1999, la situation a changé. En effet,
le Niger s'est doté en juin 1999 d'un texte de loi qui institue une
juridiction des mineurs, définit le concept de mineur en danger,
réoriente les missions des magistrats vers une démarche plus
éducative que répressive et positionne le ministère public
dans un rôle de protection de l'enfance. Ainsi, l'Ordonnance n°99-11
du 14 mai 1999 portant création, composition, organisation et
attributions des juridictions des mineurs a institué des juridictions
des mineurs au siège de chaque Tribunal de Grande Instance ou
d'Instance. En conséquence, les mineurs qui se rendent coupables
d'infractions à la loi pénale sont jugés par une
juridiction spéciale dénommée tribunal ou juge des
mineurs. Le mineur de moins de 13 ans est pénalement irresponsable mais
peut faire l'objet de mesures de protection ordonnées par le juge des
mineurs567.
Le Cameroun a fait la remarquable expérience d'associer
la société civile au fonctionnement de la justice des mineurs,
avec la création des comités de protection des
mineurs568. Ces comités569 sont très actifs
dans le traitement de la petite délinquance grâce à un
système partenarial mis en place avec le parquet de Douala. Lorsqu'un
mineur commet une infraction de faible gravité, le parquet ne transmet
pas le dossier de poursuite au tribunal, mais le soumet au comité qui
devient en quelque sorte une juridiction pour enfants570. La
création de ces comités s'inscrit dans la droite ligne d'une
stratégie centrée sur la substitution des méthodes du
système pénal par une politique de justice sociale571.
Elle rejoint également
566 RAYNAL (M.) « La diversité dans
l'unité. Le système juridictionnel nigérien »,
Penant, n°805 ( January-May 1991)., p.84 et s.
567 Fondation Joseph The Workers et O.I.F, Guide de bonnes
pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la loi au Niger,
Novembre 2011, pp 8-9.
568 Ibid.
569 Les comités de protection des mineurs sont
composés d'un chef du quartier, d'un père ou d'une mère de
famille, d'un instituteur, d'un policier, d'un représentant politique et
de toute personne dont le comité estime la présence
nécessaire.
570 Outre leur rôle juridictionnel, les comités
de protection des mineurs ont pour mission de susciter la motivation des jeunes
au développement de leurs quartiers, en leur proposant des
activités ou des travaux communautaires. Ils interviennent aussi au
niveau du maintien de l'ordre en assurant la nuit la surveillance des quartiers
et des mineurs, apportent des conseils aux parents d'enfants difficiles,
organisent des débats sur l'éducation, la tradition etc.
571 BERNAT DE CELIS (J.) « Les grandes options de la
politique criminelle », A.P.C., n° 5, 1982, p.43.. ; La
politique de justice sociale rejoint la préoccupation de ceux qui depuis
longtemps savent qu'en favorisant des conditions de vie souvent
précaires, de travail, de santé, de loisirs, de logement, on peut
éviter beaucoup d'actes déviants.
239
le modèle type d'une politique criminelle
participative572. Beaucoup de pays africains ressentent le besoin de
réviser leur système de justice criminelle en y intégrant
les méthodes traditionnelles de résolution des
conflits573, en y associant étroitement la
société civile574. Mais en fait, le processus est
encore à l'état embryonnaire. L'Etat, nouvellement
constitué, reste le principal acteur de la politique criminelle
officielle575. Aussi, l'un des domaines où s'exerce le
contrôle de l'Etat est celui de la justice des mineurs.
En Côte d'Ivoire, suivant en cela le système
français, le Tribunal pour enfants est composé du juge des
enfants qui le préside et de deux assesseurs titulaires ou
suppléants nommés pour quatre ans par le garde des sceaux sur
proposition du président de la cour
572 LAZERGES (C.) « Une politique criminelle
participative. A propos de la mise en place et du fonctionnement des conseils
communaux de prévention de la délinquance (L'exemple du
Languedoc-Roussillon) », A.P.C., n° 10, 1988, p. 91. et s.
ROYARE (S.), « Une politique criminelle participative : L'exemple de la
participation des associations à la variante de médiation
», A.P.C., n°11, 1989, p.107. et s. La politique
criminelle participative se présente comme l'un des moyens de
diversification des réponses à la délinquance. Elle met
l'accent sur le concours de la société civile à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des réponses à
la délinquance. Dans ce corps constitué qu'est la
société civile, sont représentées les associations,
les collectivités locales, les personnes morales ou physiques
concernées par le problème de la délinquance. La politique
criminelle fait donc cohabiter les réponses étatiques et les
réponses sociétales à l'infraction et à la
déviance dans un programme ou une stratégie commune. ; V.
ég. SZABO (D.) « Modèles et mouvements de politique
criminelle. Réflexion sur une approche nouvelle de la politique
criminelle », R.I.C.P.T., Vol. XXXVI, n°2, 1993, p.25 et s.
LIEGE (M-P) « Les habitants acteurs de la sûreté des villes
», R.S.C., n°1, 2000, p. 255 et s.
573 RAYNAL (M.) « Politique criminelle en Centrafrique
», A.P.C., n°14, 1992, p.149.
574 SOUMBOU (A.) « La politique criminelle congolaise
», A.P.C., n°14,1992, p.156.
575 L'emprise de l'Etat sur la conception et les productions
du système pénal a pour conséquence d'imposer un
modèle de politique criminelle centré sur les institutions de
l'Etat, en l'occurrence l'institution judiciaire, et de réduire les
possibilités d'éclosion de modèles sociétaux de
politique criminelle. Même lorsqu'ils existent en marge des
modèles étatiques, il n'en demeure pas moins qu'ils subissent
sans cesse les assauts du contrôle étatique. La vindicte populaire
et l'autodéfense par exemple qui sont deux variantes des modèles
sociétaux admises par le groupe social, n'ont au regard de l'Etat
détenteur exclusif du monopole de la contrainte physique, aucune
légitimité. Dans un système de réponse
étatique à l'infraction, l'autodéfense et la vengeance
privée ne sont pas admises. Cela suffit à justifier la
réglementation des sociétés de gardiennage (Loi
n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fond, J.O.,
13 juillet 1983, p.2155). Les modèles étatiques s'expriment par
référence au droit pénal. Néanmoins, les
modèles sociétaux de politique criminelle se manifestent comme
une substitution du corps social à l'Etat ; soit que celui-ci ne joue
pas le rôle de régulateur des conflits que la
société attend de lui, soit qu'à l'inverse, le groupe
social ou une partie du groupe social s'interpose entre le
phénomène criminel et l'Etat ; soit que celui-ci ne joue pas le
rôle de régulateur des conflits que la société
attend de lui, soit qu'à l'inverse, le groupe social ou une partie du
groupe social s'interpose entre le phénomène criminel et l'Etat ;
soucieux de gérer lui-même tout ou partie des comportements de
refus des normes. V. DELMAS-MARTY (M.), Modèles et mouvements de
politique criminelle, Ed. Economica, Paris, 1983, p. 129 et s. ; LAZERGES
(C.), « Les conflits de politique criminelle » A.P.C.,
n°7 , 1984, p.39 et s. ; WEBER (M.) Economica y sociedad,
Mexico, Fondo de cultura Economica, 1987. p. 292.
240
d'appel et choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre
sexe âgées de trente ans qui se sont signalées par
l'intérêt qu'elles portent aux questions relatives à
l'enfance et par leurs compétences576. Contrairement au
tribunal de simple police, le tribunal pour enfants peut prétendre
à l'étiquette de « juridiction spécialisée
» en ce sens qu'il est présidé par un juge des enfants
assisté par des assesseurs présentant les garanties de la
spécialisation. Les assesseurs qui composent le Tribunal pour enfants en
Côte d'Ivoire, sont choisis dans les mêmes conditions que leurs
homologues français, à la différence qu'ils sont au nombre
de cinq577. En plus des assesseurs titulaires, le tribunal pour
enfants comprend également cinq assesseurs suppléants
nommés pour quatre ans par le Ministre de la justice. Certes,
l'importante représentativité des assesseurs au sein de cette
juridiction n'a pas pour effet immédiat de réduire les pouvoirs
de décision du juge des enfants, étant donné que c'est
à ce magistrat que revient la décision finale prise à
l'égard du mineur. Mais, l'avis des assesseurs au moment des
délibérations peut influer sur le choix de la sanction. Mieux,
l'originalité de cette juridiction consiste dans le fait que les
assesseurs du juge des enfants sont des ressortissants ivoiriens non-magistrats
mais ayant des compétences dans le domaine de
l'enfance578.
En droit ivoirien, le tribunal pour enfants ne connait que des
délits commis par les mineurs de 18 ans et des crimes commis par les
mineurs de moins de 16 ans579. Il en est de même dans le
système juridique français. Par contre, toutes les contraventions
relèvent de la compétence du tribunal de simple
police580. L'une des difficultés liées à la
saisine de la juridiction compétente est celle qui résulte de la
détermination de l'âge du mineur. En clair, il s'agit de savoir si
l'âge à prendre en compte est celui au moment des faits ou
plutôt celui
576 STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), BOULOC (B.),
Procédure pénale », op.cit., pp.393-394 ; art.L
522-3
C. org. Jud. ; art.5, Ord. 22 déc.
1958 mod. Loi 1er juillet 1965.
577 Art.780 nouveau C.P.P.iv. (Loi n°69-371 du
1er août 1969).
578 B.I.C. E, Recueil sur la minorité, Analyse et
commentaire de la législation applicable aux mineurs, 2010,
p.66.
579 Les diligences effectuées, le juge des enfants peut
renvoyer le mineur devant le Tribunal pour enfants (art.772-10 nouveau C.P.P.,
.n°69-371 du 12 Août 1969, art.756 C.P.P.) . En cas de crime, il
rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un
mineur de 16 ans (art. 772-2° nouveau C.P.P.). Lorsque le tribunal pour
enfants décide d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont
il a été saisi sous une qualification correctionnelle, il
ordonne, dans ce cas, un supplément d'information et
délègue pour ce faire un juge à cette fin (art.78 al.4
nouveau C.P.P., L.n°69-371 du 1er Août 1969).
580 En France, le Tribunal pour enfants peut connaitre des
contraventions de 5e classe commis par le mineur de 18 ans passible
d'une amende n'excédant pas 5000 francs (art.21-1, Ord. 2 février
1945, mod.L.10 Juillet 1989).
241
au moment du jugement. La jurisprudence est favorable à
la première proposition. L'âge au moment des faits est
déterminé par le temps écoulé depuis la naissance
du mineur, calculé d'heure à heure581. Pour les
personnes étrangères, l'âge réel peut être
rapporté par tous les moyens, aucun texte ne donnant une force probante
irréfragable aux actes de l'état civil des pays
étrangers582. Mais, la preuve de l'âge n'est pas
toujours facile à rapporter en l'absence de tout document
délivré par une autorité. Ainsi, il arrive que le parquet
et les juridictions de jugement soient en désaccord à propos de
l'âge du jeune prévenu.
Dans un arrêt en date du 6 avril 1992583, la
Cour d'appel d'Abidjan a rejeté l'appel interjeté par le
Ministère public contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel
d'Aboisso qui, dans une décision rendue le 28 juin 1980, s'est
déclaré incompétent pour connaitre du chef des
délits de vol et d'usurpation de titre reproché à E.D. en
raison qu'il était âgé de moins de 18 ans au moment des
faits. Pour la Cour, le jugement rendu par le premier juge est conforme
à la loi : « considérant qu'il apparait (...) que le
prévenu né le 14 août 1962, était âgé
de moins de 18 ans au moment des faits ; qu'il s'ensuit qu'il n'était
justiciable que du tribunal pour enfants, par application des dispositions de
l'article 756 du code de procédure pénale, qu'il y a lieu de
confirmer la décision du premier juge (...) ». La prise en
compte de l'âge au moment des faits paraît tout à fait
logique. Mais encore, faut-il en rapporter la preuve. La preuve de l'âge
est établie au vu de la production d'un acte d'état
civil584. En fait, la détermination de l'âge des
prévenus pose souvent quelques problèmes en raison de la
défectuosité de l'état civil concernant en particulier les
individus nés avant les indépendances. L'état civil est
une création récente dans les Etats d'Afrique Noire
francophone585. Non seulement, les déclarations de naissance
se font de moins en moins surtout dans les campagnes isolées,
dépourvues de toute structure de santé publique ou administrative
(maternité, sous-préfecture ou préfecture), et où
les populations ne sont pas suffisamment sensibilisées à cette
procédure. Aussi, même lorsqu'elles sont faites, elles sont
parfois entachées d'erreurs.
581 Cass. Crim., 3 septembre 1985 : Bull. crim. 1985,
n°283.
582 Cass. Crim., 13 octobre 1986 : Bull. crim. 1986,
n° 282 ; ég. BOULOC (B.), Pénologie. Exécution
des sanctions adultes et mineurs , Précis Dalloz, 2e
éd., Paris, 1998., p.296.
583 C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt, n° 698 du 6
avril 1982, Ministère Public c/E.D.
584 Art. 760 al. 1er nouveau C.P.P. iv. (L.
N°69-371 du 12 août 1969).
585 MANGIN (G.) « La délinquance juvénile
en Afrique Noire francophone », A.P.C., Ed. Pedone, 1975,p. 229
et s.
242
En tout état de cause, le juge a le pouvoir
d'apprécier souverainement l'âge du mineur
déféré devant lui, lorsque cet élément n'a
pas été transcrit à l'état civil. L'article 760
alinéa 2 nouveau du code de procédure pénale ivoirien
énonce à ce propos qu'« en cas de
contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement
l'âge du délinquant ». Le juge peut requérir
l'aide de l'officier d'état civil en vue de la délivrance d'un
extrait d'acte de naissance. Ce dernier est tenu de s'exécuter sous
peine d'une amende de deux mille à vingt mille francs586. A
défaut d'un acte de naissance, la preuve de la minorité du
prévenu peut résulter d'un jugement supplétif de naissance
rendu par un juge d'après le témoignage de deux personnes.
Cependant, la valeur probante de ce document n'est pas certaine, car souvent
les parents le font établir à des fins scolaires pour retarder
par exemple la limite d'âge scolaire ou la période à
laquelle l'enfant n'aura plus droit aux allocations familiales587.
Cette pratique est très répandue en milieu urbain où les
conditions sociales et scolaires des jeunes sont en général
précaires.
Par ailleurs, il est fréquent que le juge se retrouve
face à des jeunes délinquants « officiellement mineurs
», mais dont le physique s'apparente vraisemblablement à celui
de jeunes adultes. Il faut noter que l'âge du mineur est calculé
à la date à laquelle l'infraction a été commise. Si
l'acte d'état civil ne précise que l'année de la
naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue
le 31 décembre de ladite année. Si le mois est
précisé, l'infraction sera considérée comme
étant intervenue le dernier jour dudit mois588. Quelques
fois, on retrouve inscrite sur l'acte d'état civil la mention «
...né(e) vers... » au lieu de « ... né(e)
le... » ; Ce qui complique la détermination de l'âge
exact de l'intéressé. En l'absence de toute précision, la
jurisprudence soutient parfois que le doute bénéficie au
prévenu. C'est en tout cas ce qui ressort d'un arrêt de la Cour
d'Appel d'Abidjan du 20 mars 1980589 : « (...)
considérant qu'il est reproché au prévenu, courant
novembre 1973, d'avoir volontairement exercé des violences et voies de
fait sur la personne de N'. D.M ; considérant qu'il résulte des
pièces du dossier que le prévenu est né vers... ; qu'en
conséquence, par application de l'article 760 alinéa 2 du code de
procédure pénale, il était mineur de 18 ans justiciable
du
586 Art.761 al. 1er C.P.P. iv.
587 MANGIN (G.) op.cit. p.230.
588 Ibid.
589 C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt, n° 722 du
20 mars 1980, Ministère public c/ Y.E.G., R.I.D., n°3-4/1986,
Jurisp.3.2, Pp. 170-171.
243
tribunal pour enfants ; considérant que donc c'est
à tort qu'il a été traduit devant le tribunal
correctionnel de droit commun, qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris
(...) ».
Toutefois, le doute ne profite pas toujours à
l'accusé, lorsque le document établissant l'âge du jeune
délinquant émane d'une autorité étrangère.
La jurisprudence française estime dans ce cas qu'il appartient aux
juridictions de s'assurer de la force probante de l'acte d'état civil
émis par une autorité étrangère590. En
l'espèce, poursuivi pour assassinant et tentative d'assassinat, un jeune
ressortissant turc prétend justifier de son âge par un acte de
naissance qu'ont délivré les autorités de son pays, acte
duquel il résulte qu'il était âgé de seize ans au
moment des crimes qu'on lui reproche. Seulement, le document ne concordait pas
avec l'aspect physique de l'inculpé qui apparaissait sensiblement plus
vieux que l'acte d'état civil turc ne l'affirmait. Ce faisant, le juge
d'instruction ordonna une expertise et une contre-expertise qui, toutes deux,
parvinrent à la même conclusion. En réalité, le
jeune inculpé devait avoir environ dix-sept ans et demi lors des faits.
Il fut donc renvoyé, non pas devant le tribunal pour enfants comme
l'aurait exigé l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 et
comme l'aurait souhaité l'intéressé, mais devant la Cour
d'assises des mineurs où, bien entendu, il risquait d'être
condamné comme un majeur. Finalement, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé contre l'arrêt de mise en accusation.
Cette espèce assez particulière ne remet pas en
cause le principe selon lequel le mineur de 18 ans reste justiciable du
tribunal pour enfants en matière délictuelle. La jurisprudence
ivoirienne conserve une position constante sur ce principe. Aussi, la Cour
d'appel n'hésite pas à censurer les décisions des
juridictions du premier degré prises en violation de l'article 756 du
code de procédure pénale. Dans un arrêt du 24 avril
1979591, elle a infirmé un jugement du tribunal correctionnel
pour incompétence : « ...(...) considérant qu'il
résulte du dossier que K.O. né le 2 mars 1959 à
Ahiégbé-Koffikro (Aboisso), selon l'acte de naissance n°359
du 22 juillet 1959 du registre des actes d'état civil pour
l'année 1958 du centre d'Aboisso, a été renvoyé
suivant l'ordonnance du 2 février 1976 du juge d'instruction d'Abidjan
devant le tribunal correctionnel de cette ville pour avoir à Abidjan,
Treichville le 30 juin 1975 soustrait frauduleusement un sac à main au
préjudice du sieur L.E. qui en était
590 Cass. Crim. 13 octobre 1986 : Bull. crim. 1986, n°282,
Gaz.pal., 25-26 février 1986, note DOUCET.
591 C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt, n°875 du
24 avril 1979, Ministère public c/K.O. ; C.A. d'Abidjan, Ch.
Corr., Arrêt n°1524 du 11 novembre 1981, Ministère public
c/L.A. ; C.A.d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt n°542 du 15 avril
1975, Ministère Public c/K.Y.J.
244
propriétaire ,
· considérant qu'il
apparait de ce qui précède que le prévenu était
âgé de moins de 18 ans au moment des faits ,
· qu'il
s'ensuit qu'il était justiciable du tribunal pour enfants par
application de l'article 756 du code de procédure pénale
,
· qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris (...)
».
S'il est affirmé dans cet arrêt que les
juridictions de droit commun ne peuvent connaître des délits
commis par les mineurs de 18 ans592, de même, les juridictions
pour enfants doivent se déclarer incompétentes s'il est
établi que le prévenu déféré devant elles,
est âgé de 18 ans au moins. Dans un arrêt en date du 3 mars
1975593, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé un jugement
rendu par le tribunal pour enfants de Bouaké au terme duquel ledit
tribunal s'est déclaré incompétent pour connaitre du chef
d'escroquerie commis par Y.D.E., et ordonné la levée du mandat de
dépôt au motif que le prévenu était majeur. En
l'espèce, un mineur, par des manoeuvres frauduleuses s'est fait remettre
diverses sommes d'argent, de vivres et un poste de radio courant 1973. Lors de
l'enquête préliminaire, le prévenu a déclaré
être né en 1955, avant d'être renvoyé devant le
Tribunal pour enfants de Bouaké par le juge des enfants le 18 janvier
1974. Ledit tribunal, par un jugement n°11 du 11 mars 1974, s'est
déclaré incompétent au motif que le prévenu
était âgé de plus de 18 ans au moment des faits. Dans ces
considérants de l'arrêt du 3 mars, la Cour relève que
« pendant l'information faite par le juge des enfants, le
prévenu avait précisé qu'il était né en 1944
et non en 1955 ,
· que par ailleurs, l'expert nommé par le
magistrat instructeur pour déterminer l'âge du prévenu a
fixé cet âge entre 26 et 28 ans, suivant certificat médical
en date du 13 avril 1973 ». Pour la Cour, « c'est à
bon droit que le tribunal pour enfants s'est déclaré
incompétent ,
· le prévenu étant bel et bien
majeur à la date des faits ,
· qu'il y a lieu de confirmer le
jugement déféré en toutes ses dispositions (...)
».
S'agissant de la procédure d'appel devant le tribunal
pour enfants, il convient de noter que les audiences du T.P.E594
sont assujetties à la règle de « la publicité
restreinte »595. Seuls sont admis à assister aux
débats, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur
ou le
592 La règle selon laquelle les mineurs
échappent aux juridictions de droit commun est d'ordre public (Cass.
Crim. 9 mars 1973 : Bull. crim. 1973, n°128).
593 C.A d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt n°244 du 3
mars 1975, Ministère public c/Y.D.E. ; C.A. d'Abidjan, Ch.
Corr., Arrêt n°542 du 15 avril 1975, Ministère public
c/K.Y.J.
594 Entendre par T.P.E, tribunal pour enfants.
595 RENUCCI (J.-F.), « Droit pénal des mineurs.
L'actualité du droit pénal des mineurs », R.I.D.P.
,1992. p.201 et s.
245
représentant légal du mineur, les membres du
barreau, les représentants des sociétés de patronage et
des services ou institutions s'occupant des enfants, les
délégués de la liberté
surveillée596. Le président du T.P.E peut ordonner, si
l'intérêt du mineur l'exige, que ce dernier se retire pendant tout
ou partie des débats. Dans un objectif de protection, et
conformément aux articles 40.2.b. de la CDE et 8.1 des règles de
Beijing, est interdite toute diffusion par voie médiatique (la
publication du compte rendu des débats dans les livres, la presse, la
radiophonie, la cinématographie, d'informations extraites des
débats ou de quelque manière que ce soit qui pourraient nuire au
mineur en permettant son identification )597, sous peine de
sanctions pénales; ce qui serait attentatoire à sa vie
privé et risquerait de le stigmatiser et d'hypothéquer ses
chances de réinsertion; Le jugement est rendu en audience publique en
présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le
nom du mineur puisse être indiqué598. Le principe de la
publicité restreinte est l'une des caractéristiques de la
procédure de jugement des mineurs. Commune à toutes les
juridictions répressives statuant en matière de minorité,
elle est considérée comme l'une des conditions essentielles de la
validité des débats599. La publicité faite
autour des audiences du T.P.E. peut avoir des conséquences sur la
personnalité de l'adolescent qui est jugé par un tribunal surtout
pour la première fois. Le passage devant le juge et la diffusion
à grande échelle de cet évènement peut le conforter
dans son attitude de déviance, créer en lui des sentiments
négatifs de honte, d'humiliation ou de vengeance contre la
société. Cela peut également compromettre les
possibilités de sa rééducation600. La
publicité des audiences des tribunaux est une garantie fondamentale pour
les libertés publiques. Mais, l'étalage sans
nécessité des drames intimes risquerait de le stigmatiser,
d'hypothéquer ses chances de réinsertion et d'affecter le mineur
d'autant plus cruellement qu'il n'est pas indispensable et qu'une
publicité abusive serait plutôt de nature à compromettre la
solution recherchée. C'est pourquoi, le législateur veille
à ce que la discrétion soit la plus grande601.
596 Art.782 al.2, C.P.P. iv.
597 Art.782 al.3 et 4, C.P.P. iv. ; ég. Art.13, 14 et
14-1, Ord. 2 février 1945.
598 Art.782 al.6, C.P.P. iv.
599 Cass. Crim. 11 mai 1988, Gaz. Pal. 1988 ;
Dr.enf.fam.1989-2, p.135, note RENUCCI (J-F) Cass. Crim. 1er février
1989, J.C.P. , 1989, IV, 144.
600 En ce sens V. RENUCCI (J-F), op.cit., p.202.
601 BAUDOUIN (J-M), « Le juge des enfants. Punir ou
protéger ? », Coll. La vie de l'enfant, Ed. ESF, Paris,
1990, p.52.
246
Qui plus est, le principe de protection de la vie
privée de l'enfant en conflit avec la loi ne s'applique pas seulement
lors des audiences de jugement, mais tout au long de la procédure,
dès le début de l'enquête préliminaire. Toute
violation de cette interdiction est sanctionnée pénalement par
une peine de deux (2) ans d'emprisonnement et une peine d'amende pouvant
être comprise entre 36.000 à 3.000.000 FCFA602.
C. LE JUGE DES ENFANTS
Dans le système pénal ivoirien, inspiré
du système pénal français, le juge des enfants est la
seule autorité judiciaire compétente à la fois pour
instruire et juger les affaires de mineurs603. Ce cumul des
fonctions répond à l'exigence de la connaissance de la
personnalité du mineur et de l'efficacité de l'intervention
judiciaire : le juge des enfants doit connaitre le mineur, c'est-à-dire
« pénétrer sa personnalité mobile et complexe
»604 en vue de prendre des mesures appropriées
à sa rééducation et sa réinsertion. Cela montre
à quel point le principe de l'individualisation de la sanction a
pénétré le droit pénal des mineurs605.
Il est l'organe central de la prise en charge judiciaire des mineurs
délinquants. En tant que juridiction de jugement, il préside les
audiences du T.P.E606. Il peut également juger le mineur en
Chambre de conseil.
Le juge des enfants dispose de pouvoirs
étendus607. Cependant l'élargissement de ses pouvoirs
mérite quelques remarques. Lorsque le juge des enfants intervient en
tant que juridiction de jugement, le problème qui se pose est celui de
la répartition des compétences entre ce magistrat et le tribunal
pour enfants608. A l'analyse, on remarque que le juge des enfants et
le T.P.E ont des compétences identiques et se rejoignent quant aux
mesures à prendre à l'égard du mineur609. La
similitude est d'autant plus évidente que le T.P.E est
présidé par le juge des enfants et que dans la pratique, le
renvoi du mineur devant le T.P.E.
602 Art. 782. A al.4,5 et 6. C.pén.
603 RENUCCI (J-F.), op.cit., p.152. ; art.768 al.4, C.P.P.iv.
604 CHAZAL (J.) « Le juge des enfants » colloque,
XXe anniversaire de la revue de science criminelle, R.S.C., 1956,
p.780 et s. ; MAZEROL (M.-Th.), « Le juge des enfants. Fonction et
personne », CRIV, 1986
605 RENUCCI (J-F.), op.cit., p.150.
606 Art.772-1° nouveau C.P.P. iv. (Loi n°69-371 du 12
août 1969).
607 BAUDOUIN (J. M.), op.cit., p.47 et s.
608 En ce sens V. RENUCCI (J-F), op.cit., p.153.
609 Art.783, C.P.P.iv . rappr. Art. 7770 nouveau C.P.P.iv
247
est décidé par ordonnance du juge des
enfants610. Toutefois, en cas d'infractions très graves
telles que les atteintes à l'intégrité physique, le trafic
des stupéfiants ou les vols aggravés ou encore en cas de crime,
le tribunal pour enfants sera exclusivement saisi, si le prévenu a moins
de 16 ans611. Le juge des enfants et le T.P.E. ont une mission
explicite de fonder leurs décisions sur l'intérêt du mineur
et ont, à cet effet, un devoir de protection envers ce dernier.
Seulement, il manque à la protection du mineur
l'organisation d'un système de défense efficace devant la
justice. Celle-ci passe bien entendu par la présence de l'avocat
à toutes les phases du procès du mineur, conformément au
principe du contradictoire qui garantit la transparence et
l'équité de tout procès612. Or,
l'expérience montre que les audiences de cabinet ou les jugements en
Chambre du conseil se déroulent en pratique entre le juge des enfants et
le mineur accompagné parfois de ses parents ou d'un éducateur du
service de l'éducation surveillée ou du SEAT613. Le
droit à l'assistance d'un avocat dans toutes les procédures
concernant le mineur a été affirmé par la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant614 ainsi que par la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant615. Ce
droit ne peut être effectivement garanti que si l'avocat assiste le jeune
prévenu durant la procédure dirigée contre lui.
L'assistance du conseil est le seul moyen pour assurer sa défense.
Dès lors, il importe que la justice des mineurs soit dotée
d'avocats professionnels ou spécialisés aux questions relatives
à l'enfance délinquante.
Entendre et défendre n'est pas une tâche simple.
Elle ne peut être effectuée sans une formation spécifique
préalable portant non seulement sur le droit pénal des mineurs,
mais aussi sur la psychologie de l'enfant. L'avocat appelé à
défendre le mineur doit écouter, prendre en compte et transmettre
la parole de son client. Il doit aussi expliquer à l'enfant le processus
judiciaire, la procédure dont il est l'objet, le conseiller, le rassurer
du bien-fondé
610 Art.772 nouveau C.P.P.iv.
611 Art.774 al.2, art. 772-2° nouveau, art.781 al.4 nouveau
C.P.P.iv.
612 GLON (C.), « L'avocat des mineurs », in
Enfance et délinquance. XIe journées de l'Association
française de droit pénal, Travaux et recherches de la
Faculté des sciences juridiques de Rennes, Paris, Économica,
1993, p. 135.
613 Entendre par SEAT, le Service Educatif auprès du
Tribunal, l'équivalent du service de l'éducation
surveillée.
614 Art. 40, Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant de novembre 1989.
615 Art.17, Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant de 1991, Doc. CAB/LEG/153/ rev.2.
248
249
de l'action à engager pour garantir ses
intérêts. En un mot, il s'agit d'organiser une défense qui
reflète la conception moderne de la protection des droits de
l'enfant616.
Au problème de la formation des avocats de mineurs,
s'ajoute celui de la rémunération617 qui reste la
seule source de motivation des avocats attirés par les affaires
présentant un intérêt financier. En Côte d'Ivoire,
les honoraires de l'avocat ayant en charge la défense des mineurs
près le tribunal de grande instance d'Abidjan, sont payés par le
Bureau international catholique pour l'enfance (BICE). En principe, l'Etat ne
peut se désengager du financement de la justice. La
rémunération des juges ainsi que des avocats accomplissant des
missions d'intérêt public devrait en principe relever de sa
compétence. Accessoirement, peut être associé à
cette mission, le concours financier des organisations privées ou celui
des collectivités locales.
L'expérience de financer la défense a
été tentée en France avec la loi n°91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique618. La loi contient
des dispositions concernant la rémunération des avocats, bien
qu'elle s'avère imprécise pour certains
observateurs619. L'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 dispose
en substance qu'il est créé dans chaque département, un
conseil départemental de l'aide à l'accès au droit et
laisse à cette structure le soin d'en fixer le domaine, l'étendue
et les effets, d'évaluer la qualité du fonctionnement des
services organisés à cette occasion, de rechercher et recevoir
les fonds de toute mesure destinée au financement de sa politique, de
répartir les fonds reçus.
Outre ces juridictions, l'existence de la Cour d'assises des
mineurs explique aussi le privilège de juridiction accordé aux
mineurs au regard de sa compétence à l'égard du mineur,
auteur de crimes.
§ 2. LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, UNE
JURIDICTION SPECIALE COMPETENTE EN MATIERE CRIMINELLE
La nécessité d'une spécialisation des
juridictions pour mineurs a conduit le législateur à modifier les
règles de droit commun de la Cour d'assises en instituant une Cour
d'assises
616 GLON (C.), op. cit., p.135 et s.
617 BENHAMOU (Y.) « Réflexions en vue d'une
meilleure défense en justice de l'enfant », op. cit., p.103 et
s.
618 J.O. Rép. Franç., 13 juillet 1991, p.9170.
619 BENHAMOU Yves, op. cit., p.105.
des mineurs. En principe, la Cour d'assises des mineurs doit
présenter les caractéristiques d'une juridiction
spécialisée. Créée pour connaitre des crimes commis
par les mineurs de plus de seize ans, la Cour d'Assises des Mineurs
(C.A.M.).620 se distingue des autres juridictions pour mineurs par
le fait qu'elle n'est pas une juridiction permanente, et par le fait qu'elle
peut, contrairement au tribunal pour enfants, juger les mineurs et majeurs
impliqués dans la même cause. Examinons donc sa
particularité manifeste au regard de sa composition (A)
et sa compétence (B).
A. LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS
Certes, la Cour d'assises des mineurs est une juridiction
spéciale. Pourtant, sa composition diffère très peu de
celle de la Cour d'assises de droit commun. A l'image de la Cour d'assises des
adultes, elle est composée d'un président, de deux conseillers et
de six jurés tirés au sort pour la session de la cour
d'assises621. En France, le jury comprend neuf jurés
tirés au sort également. Il ne présente donc aucune
spécificité en fonction de l'âge des personnes
poursuivies622. Contrairement au tribunal pour enfants, la Cour
d'assises des mineurs n'est pas présidée par un magistrat de la
jeunesse. Le président est désigné et remplacé dans
les mêmes conditions que celles prévues pour le président
de la Cour d'assises623. C'est un président de Chambre ou un
conseiller de la Cour d'appel qui préside la C.A.M624. Non
seulement, le président de la C.A.M n'est pas un magistrat
spécialisé, mais en plus le délégué à
la protection de l'enfance qui aurait pu être mieux indiqué pour
présider cette cour est écarté625.
Le principe de la séparation des fonctions de justice
pourrait expliquer la désignation d'un juge qui n'a pas instruit
l'affaire, ni siégé comme président du tribunal pour
enfants. Si le respect de ce principe est essentiel à
l'impartialité de la Cour, les raisons qui consacrent l'exception
à ce principe auraient pu inciter le législateur à
admettre la possibilité pour un magistrat de la jeunesse de la
présider. Le législateur ivoirien a tenté de combler
cette
620 Entendre par CAM, Cour d'Assises des Mineurs.
621 Art.776 al.1 et 3 nouveau, C.P.P. iv. (Loi n° 69371 du
12 août 1969).
622 RENUCCI (J-F.) « Droit pénal des mineurs »,
op.cit., p.138 ; art.512,
C.Org.Jud.
623 Art. 776 al.2 nouveau, C.P.P. iv. ; art.20 al. Ord. 2
février 1945 ; art.244 à 246, C.P.P. fr.
624 Art.244 C.P.P. Iv.
625 RENUCCI (J.-F.), op.cit., p.140.
250
insuffisance liée à la spécialisation de
la Cour d'assises des mineurs626. Eu égard à la
gravité des décisions, il serait préférable que la
C.A.M. soit présidée par un juge des enfants, bien que ce soit
aux jurés que revient l'honneur de se prononcer sur la
culpabilité et la peine applicable au mineur. La non
spécialisation du président de la Cour d'assises des mineurs est
tempérée627 par la présence de magistrats de la
jeunesse siégeant en tant qu'assesseurs. Le non-respect de cette
disposition entraine la nullité de l'arrêt de la
C.A.M.628 Toutefois, cela n'empêche pas la Cour de
siéger même en l'absence de magistrats spécialisés.
Cette éventualité a été expressément
prévue par l'article 776 alinéa 3 nouveau du code de
procédure pénale ivoirien à travers l'expression «
sauf impossibilité (...) les deux membres magistrats sont pris parmi
les juges des enfants du ressort de la cour d'assises et désignés
dans les formes des articles 248 à 252 ».
L'inconvénient de la présence obligatoire du conseiller
délégué à la protection de l'enfance à la
Chambre d'accusation est qu'il ne peut en aucun cas présider la Cour
d'assises des mineurs629.
Il faut souligner que l'institution d'un
délégué à la protection de l'enfance
siégeant comme membre de la Chambre d'accusation, lorsque celle-ci
statue sur une affaire dans laquelle le mineur est impliqué, est une
avancée de poids du droit pénal français des mineurs. En
droit ivoirien, un magistrat de la Cour d'appel est désigné par
arrêté du Garde des Sceaux pour présider l'audience
spéciale de la Cour d'appel. Il siège comme membre de la Chambre
d'accusation quand celle-ci statue sur une affaire dans laquelle un mineur est
mis en cause soit seul, soit avec des coauteurs ou complices
majeurs630. Aussi, bien qu'il dispose en cause d'appel des pouvoirs
du juge des enfants631, la loi ne dit pas qu'il doit être
nécessairement choisi parmi les magistrats de la jeunesse. Par
conséquent, le problème de la présidence de la Cour
d'assises des mineurs assurée par un magistrat spécialisé
est résolu : il n'est pas besoin que la C.A.M. soit
présidée par un juge spécialisé, encore moins par
un juge des enfants. Comment justifier ce choix ? Est-ce par
nécessité de respecter le principe de la
626 Art.776 al.2 nouveau, C.P.P. iv.
627 Art.20 al.2, Ord. 2 février 1945.
628 Cass. Crim. 8 décembre 1971 : Bull. crim.1971,
n°344, p.864.
629 LAZERGES-ROTHE (C.) , La Cour d'assises des mineurs et
son fonctionnement. Etude sociologique et juridique, Thèse paris
II.,1969/L.G.D.J.1973, p.224.
630 Art.795 al 1eret 2, C.P.P.iv.
631 Art. 795 al.3, C.P.P. iv.
251
séparation des fonctions judiciaires ? Doit-on
considérer que le législateur ivoirien en a décidé
ainsi dans le but de garantir l'efficacité répressive de la cour
d'assises ?
L'article 253 du code de procédure pénale
ivoirien et français dispose que « ne peuvent faire partie de
la cour en qualité de président ou d'assesseurs, les magistrats
qui, dans les affaires soumises à la cour d'assises, ont soit fait acte
de poursuites ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de
mise en accusation ou à une décision sur le fond relative
à la culpabilité de l'accusé. » Pour certains
auteurs, rien ne s'oppose à ce que le délégué
à la protection de l'enfance siège deux fois dans la même
cause, étant donné qu'il n'y a pas d'incapacité ou
d'incompatibilité sans textes, et ceux qui en établissent ne
sauraient être étendus à des hypothèses qu'ils ne
prévoient pas632. Or, justement l'article 253 fait opposition
à cette thèse dans la mesure où ledit article se
présente comme étant le texte de base faisant
référence à ces incapacités et
incompatibilités. En dépit de ces restrictions, les assesseurs de
Cour d'assises sont choisis impérativement parmi les juges des enfants.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé plusieurs
arrêts de la C.A.M. rendus en violation de l'article 20 alinéa 2
de l'ordonnance du 2 février. Pour la Cour de cassation, « la
composition étant d'ordre public, doit être annulé
l'arrêt rendu par une cour d'assises des mineurs, lorsqu'il n'est pas
constaté que l'un des assesseurs avait la qualité de juge des
enfants de l'un des tribunaux du ressort de la cour d'appel ou qu'il avait
été désigné en raison de l'indisponibilité
de tout magistrat du ressort ayant cette qualité
»633. A l'évidence, la composition de la C.A.M. par
des membres non spécialisés est contraire aux principes
directeurs de la justice pénale des mineurs. Cependant, force est de
reconnaitre que ce qui importe le plus ce n'est pas tant la composition de
cette juridiction, mais plutôt la décision prise à
l'encontre du mineur.
La C.A.M est une juridiction répressive qui juge les
infractions recouvrant la qualification la plus grave, c'est à-dire les
infractions qualifiées « crimes », et sanctionnées par
les peines les plus graves, réclusion à temps ou à
perpétuité, même si des peines d'emprisonnement ou
632 LAZERGES-ROTHE (C.), op cit.p.224.
633 Cass. Crim. 15 novembre 1951: Bull. crim. 1951,
n°289; Cass. Crim.5 Avril 1954 : Bull. crim.1954, n° 142,n°246,
Cass. Crim. 8 décembre 1971 : Bull. crim. 1971, n°344.
252
amende, le cas échéant avec sursis, peuvent
aussi être prononcées634. Entre son caractère
répressif et l'état de minorité des individus qu'elle
juge, il faut s'interroger sur l'opportunité de la saisine d'une Cour
d'assises pour connaitre des affaires de mineurs. L'idée de former une
juridiction composée du tribunal pour enfants assorti d'un
jury635 était séduisante en ce sens qu'elle aurait
permis aux magistrats de la jeunesse de s'impliquer davantage dans le
fonctionnement de la Cour d'assises des mineurs. Malheureusement, elle a
été abandonnée. L'idée ayant été
écartée, il reste maintenant à savoir si la
présence d'assesseurs (juges des enfants) sera exigée pour la
composition de la C.A.M. Sur cette question, les textes n'apportent pas de
réponse précise. L'on sait seulement qu'après la
clôture des débats, les magistrats de la Cour ainsi que les
jurés se retirent pour délibérer636. Ils votent
sur la culpabilité et la peine637. Enfin, la C.A.M. n'est pas
une juridiction permanente. Elle se réunit durant les sessions de la
Cour d'assises des majeurs. Dans le système pénal ivoirien, la
tenue des assises a lieu tous les trois mois638. Le président
de la Cour d'appel peut, après avis du procureur général,
ordonner qu'il soit tenu au cours d'un même trimestre une ou plusieurs
sessions supplémentaires639. La date de l'ouverture de chaque
session d'assises ordinaires ou supplémentaires est fixée,
après avis du président de la cour d'appel640.
B. LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES DES
MINEURS
Les règles qui répartissant les
compétences entre les différentes juridictions sont d'ordre
public étant donné qu'elles sont liées à
l'organisation judiciaire641. L'une d'elles veut que toutes les
infractions qui, en vertu du code pénal, sont qualifiées de
crimes soient déférées à la cour d'assises ou
à la cour d'assises des mineurs642, quand il s'agit de faits
commis par
634 FAYOLLE (B.) « La procédure criminelle entre
permanence et réforme », in La cour d'assises. Bilan d'un
héritage démocratique, Ass. Franç. Pour l'histoire de
la justice (AFHJ), Coll. Histoire de la justice »,n°13, La Doc.
Franç., Paris, 2001, p.65.
635 Cf. LAZERGES-ROTHE (C.), op.cit., p.213 et s.
636 Art.350, C.P.P. iv.
637 Art.351, C.P.P.iv.
638 Art.235, C.P.P.iv.
639 Art.236, C.P.P.iv.
640 Art.237, C.P.P.iv.
641 Cass. Crim. 7 août 1851, D.1851, p.278. ; Cass.
Crim. 6 août 1977 : Bull.crim.1977, n°276 ; Cass. Crim.4 janvier
1978, Gaz.pal. 1978-II-397 ; C.A. Reims, 9 novembre 1978, D.1979, p.42, note
J.PRADEL.
642 LAZERGES-ROTHE (C.), Op. cit., p.216.
253
des jeunes de 16 à 18 ans643. Pour
répartir les compétences entre les différentes
juridictions, la loi prend en compte trois éléments644
: le lieu où l'infraction a été commise (la
compétence ratione loci), la situation personnelle du
délinquant (compétence ratione personae), la nature de
l'infraction (compétence ratione materiae).
1. La Compétence ratione
loci
»645.
Cette compétence ne soulève pas de
problème majeur. La loi pénale prend en compte d'abord le lieu
des activités délictueuses ou criminelles. A ce propos, l'article
759 du code de procédure pénale ivoirien dispose que «
sont compétents, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des
mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses
parents ou du lieu où le mineur aura été trouvé ou
du lieu où il a été placé, soit à titre
provisoire, soit à titre définitif
2. La compétence ratione
personae
Le mineur âgé de seize ans au moins accusé
de crime est jugé par la Cour d'assises des mineurs646. A
l'instar des droits béninois et français, en droit ivoirien, la
Cour d'assises des mineurs connait des crimes commis par le mineur de 16
à 18 ans647. Mais en fait, elle partage cette
compétence avec le tribunal pour enfants qui est la juridiction
compétente en cas de crime commis par un mineur de 16 ans. Par ailleurs,
en droit pénal français des mineurs, la pratique de la
correctionnalisation reste très en vogue. Cette atteinte au principe de
la légalité s'explique par des raisons liées à la
personne du criminel648. En droit pénal ivoirien où la
correctionnalisation judiciaire est légalisée649, elle
se justifie par des raisons d'opportunité de la répression
pénale. L'article 214 du code de procédure pénale ivoirien
prévoit que lorsque les faits retenus à la charge des
inculpés constituent une infraction que la loi qualifie de crime, la
Chambre d'accusation prononce le renvoi des inculpés devant la cour
643 Art. 20 Ord. 2 fév. 1945 ; art.776 nouveau
C.P.P.iv.
644 RENUCCI (J-F.), Droit pénal des mineurs ,
Masson, 1994, p.216.
645 Rappr. Art.3, Ord.2 février 1945.
646 Art.776 nouveau C.P.P.iv. (Loi n°69-371 du 12 août
1969) ; art.774, C.P.P.iv.
647 Art. L.511-2,
C.org. Jud. ; Loi du 24 mai 1951.
648 RENUCCI (J-F.), Droit pénal des mineurs,
Masson, 1994, p.142.
649 BONI (A.), « Une correctionnalisation légale
judiciaire : l'article 214 alinéa 3 du code de procédure
pénale », Bull. Cour suprême, R.C.I., n°1,
1964.p.2.
254
d'assises650. Toutefois, « si la chambre
d'accusation estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer qu'une peine
correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt
motivé, et sur réquisitions conformes du ministère public,
renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, lequel ne pourra
décliner sa compétence »651.
Le mineur de 16 ans n'est justiciable que du tribunal pour
enfants et ne peut donc être renvoyé devant la cour d'assises des
mineurs652.
En principe, seuls les mineurs de 16 à 18 ans sont
justiciables de la cour d'assises des mineurs, les mineurs de 16 ans reconnus
coupables de crime étant jugés par le tribunal pour enfants. Or,
la Cour d'assises des mineurs est soumise au principe de la plénitude de
juridiction. Selon l'article 231 du code de procédure pénale
ivoirien, « la Cour d'assises a plénitude de juridiction pour
juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en
accusation (...) ». La Cour d'assises des mineurs ne peut donc
logiquement se déclarer incompétente pour juger les individus
âgés de plus de 18 ans déférés devant elle.
Aussi, est-elle compétente pour juger les éventuels coauteurs ou
complices majeurs. En effet, lorsque le mineur a agi en complicité ou en
coaction avec des majeurs, en cas de poursuite, la Chambre d'accusation peut,
soit renvoyer tous les accusés âgés de plus de 16 ans au
moins devant la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites
concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit
commun653. Pour éviter les contrariétés de
jugement654, la Chambre d'accusation évite autant que faire
se peut, de disjoindre les causes.
Que se passe-t-il quand le mineur de moins de 16 ans est
renvoyé devant la C.A.M. avec des complices ou des coauteurs de plus de
16 ans (16 à 18 ans) ? Dans ce cas, deux hypothèses sont
envisageables. La première est celle émanant de la
loi655 qui prévoit que seuls les mineurs d'au moins 16 ans
sont justiciables de la cour d'assises des mineurs. Ce faisant, le mineur de
moins de 16 ans sera traduit seul devant le tribunal pour enfants. Il ne
650 Art.214 al. 1er , C.P.P. iv.
651 Art. 214 al.3, C.P.P. iv.
652 Cass. Crim.23 janvier 1989 : Bull. crim., n°26 ;
art.772-2° nouveau C.P.P.iv. (Loi n°69-371 du 12 août 1969).
653 Art.774, C.P.P.iv.
654 Exemple : Arrêt « Ravenel » : le
mineur a été relaxé pour vol par le tribunal pour enfants,
alors que son père est condamné pour recel des sommes
volées par son fils : Cass. Crim. 9 février 1956, J.C.P., 1956,
II, 9574, note J.LARGUIER, D.1956-501.
655 Art.20, Ord.2 février 1945 ; art.774 C.P.P.iv.
255
sera donc pas possible d'évoquer la plénitude
qui, d'ailleurs, ne prévoit aucune exception. Aussi, il arrive que la
plénitude de juridiction soit refusée à la cour d'assises
des mineurs dans le cas où un mineur de moins de 16 ans est coauteur ou
complice d'un crime commis par un mineur âgé de 16 à 18
ans. La jurisprudence de la Cour de cassation qui consacre cette solution
estime que les règles édictées par l'ordonnance du 2
février 1945 sont impératives et ne comportent pas
d'exception656.
La seconde hypothèse est tirée d'une
jurisprudence très ancienne qui soutient qu'on ne peut accorder la
plénitude de juridiction à un tribunal pour connaitre des crimes
commis par les mineurs de 16 ans. La Cour d'assises des mineurs est tout
à fait indiquée pour juger les crimes commis par un mineur de
moins de 16 ans avec des coaccusés de plus de 16 ans657.
3. La compétence ratione
materiae
La Cour d'assises des mineurs est une juridiction
spéciale qui dispose de larges compétences ratione
materiae, puisqu'elle peut juger aussi bien les complices et coauteurs
majeurs des mineurs criminels de 16 à 18 ans658. Elle se
distingue ainsi des autres juridictions pour enfants. Mais, l'étiquette
de « juridiction spécialisée » que la
littérature de droit pénal des mineurs tend à lui
attribuer est de plus en plus contestée dans la mesure où elle
s'apparente dans son fonctionnement à une juridiction de droit commun.
De prime abord, la compétence de la C.A.M. semble relativement
limitée aux crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans. Mais,
elle est également compétente pour connaître des
délits ou des contraventions connexes aux crimes commis par des mineurs
de 16 à 18 ans659, non en raison de la plénitude de
juridiction, mais pour une raison simple. En effet, de même qu'un
tribunal pour enfants saisi de délits ou de contraventions connexes doit
se déclarer compétent660, de même une cour
d'assises des mineurs doit se déclarer compétente pour juger des
délits et contraventions connexes661.
656 Cass.crim.21 mars 1957 :Bull. crim. 1957, n°281. ;
Cass.crim.29 novembre 1963 : Bull. crim.1963, n°268.
657 Cass.crim. 5 juillet 1832 : Bull.crim.1832, n°24,
p.541.
658 LAZERGES-ROTHE (C.), op. cit., p.220.
659RENUCCI (J-F.) « Juridictions pour mineurs
», J.Cl. Pén., 1995, art. 122-8, Fasc. 30, p.8.
660 C.A. Angers, 1er avril 1954, JCP., 1954,
éd. G.V., 8186.
661 LAZERGES-ROTHE (C.), op. cit., p.221; RENUCCI (J.-F.)
« Droit pénal des mineurs », Op. cit. p.143 et «
Juridictions pour mineurs », op. cit.p.8.
256
Compte tenu de la spécificité de la
délinquance des mineurs, et dans l'intérêt de
l'accusé, le jugement devant la C.A.M. est entouré d'une
formalité particulière prescrite à peine de
nullité. En effet, la Cour doit statuer
spécialement662 :
- Sur l'application à l'accusé d'une sanction
pénale ;
- Sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de
l'excuse atténuante de minorité.
Lorsqu'il sera décidé que le mineur de 16 ans au
plus ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, la Cour devra
statuer sur les mesures éducatives à prendre conformément
aux articles 783 et 784 du code de procédure pénale ivoirien. Les
choses se compliquent au niveau du « jeu des excuses
atténuantes » entre la situation du mineur de 13 ans et ceux
de 16 à 18 ans. Si les premiers bénéficient de plein droit
de l'excuse atténuante de minorité ou de l'excuse absolutoire de
minorité, tel n'est pas le cas pour ceux de plus de 16 ans. Certes,
l'article 116 du code de procédure pénale dispose qu'ils peuvent
bénéficier de l'excuse atténuante de minorité, mais
le même article précise que : « (...) dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale663
». A l'évidence, la Cour peut décider qu'il n'y a pas lieu
de retenir l'excuse atténuante664. Il en résulte que
l'excuse atténuante de minorité est obligatoire pour les mineurs
de 13 ans et facultative pour ceux de 16 à 18 ans. Par
conséquent, la C.A.M. peut soumettre le mineur coupable de crime
à un traitement identique à celui des criminels adultes.
La récente réforme de la procédure
pénale française contient un aspect qui permettra probablement de
soustraire le mineur traduit devant une Cour d'assises de la
sévérité des condamnations prononcées par cette
juridiction. Il s'agit de la possibilité offerte désormais
à l'accusé de faire appel de l'arrêt de la cour le
condamnant avant qu'il ne soit exécutoire. L'article 81 de la loi du 15
juin 2000, introduisant après l'article 380 du code de procédure
pénale un nouvel article (art.380-1), prévoit que les
arrêts de condamnation rendus par la Cour d'assises peuvent faire l'objet
d'appel665. Toujours selon cet article, la faculté
d'appeler
662 Art.778 C.P.P. iv.
663 Art. 116 al. 4 C.P.P. iv.
664 Art. 758 al.1er C. P.P.iv.
665 Désormais, les arrêts de condamnation rendus
par les cours d'assises, à l'exception des arrêts d'acquittements,
pourront faire l'objet d'un appel, portés devant une autre cour
d'assises désignée par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation et composée de douze jurés ( articles 231, 296 et 380-I
et s. C.P.P.). L'appel pourra être formé, non seulement par le
condamné, mais aussi par le parquet qui pourra former appel. Le terme
« appel » employé par la loi du 15 juin 2000 ne doit pas
être confondu avec l'appel correctionnel. La
257
appartient à l'accusé, au ministère
public666, à la personne civilement responsable, aux
administrations publiques (art.380-2). L'appel en révision du
procès introduit dans la procédure criminelle est entre autres un
moyen de réduire au minimum les erreurs judiciaires667. Il
permet par exemple d'éviter que de simples suspects ou
présumés coupables soient condamnés à tort. Par
cette réforme, le principe de la présomption d'innocence
s'attache inévitablement d'une garantie supplémentaire. Les
peines criminelles pouvant s'élever au seuil de trente années
incompressibles d'emprisonnement, comment ne pas accorder à celui qui
est condamné à une telle peine de demander à être
rejugé ?668
Comment ces juridictions compétentes
protègent-elles à travers leurs décisions les enfants ?
La protection de l'enfant par les décisions judiciaires
s'observe d'une part, à travers la décision de relaxe ou la
mesure éducative669 prononcées par le juge des enfants
et d'autre part, par la prééminence des mesures éducatives
et le caractère exceptionnel des mesures privatives de
liberté670 prononcées par le tribunal pour enfants et
de la cour d'assises des mineurs.
Le niveau d'engagement de l'Etat étant loin
d'être satisfaisant, on observe un engagement salutaire d'acteurs non
gouvernementaux. Ainsi, observe-t-on, l'action des institutions d'appui et de
contrôle ayant une importance variable.
cour d'assises statuant en appel ne devra pas infirmer ou
confirmer la première décision, mais elle devra réexaminer
l'affaire. Il reste que certains principes généraux de l'appel
tels que l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel ont
été maintenus. En ce sens, voir, « la Cour d'assises. Bilan
d'un héritage démocratique », Ass. Franç. pour
l'histoire de la justice (AFHJ), op. cit., p.144.
666 La loi exclut cependant l'appel du parquet contre les
décisions d'acquittement.
667 CHASSAING (J-F) « L'appel des arrêts des cours
d'assises : le poids de l'histoire », Ass. Franç. pour l'histoire
de la justice (AFHJ), Ibidem., p.138 ; ég. Dans le même ouvrage,
voir « La réforme de la cour d'assises dans la loi du 15 juin 2000
» , p.144.
668 TEMIME (H.) « L'appel des arrêts d'assises »,
R.S.C., n°1, 2001, p.85.
669 Article 772 du CPP ivoirien.
670 Article 757 du CPP ivoirien ; articles 37.b de la CDE et
de l'article 11 des Règles de Beijing ; Article 783 du Code de
Procédure pénale.

259
Chapitre II :
L'IMPORTANCE VARIABLE DES INSTITUTIONS D'APPUI ET
DE
CONTROLE
La communauté nationale et internationale a, de nos
jours pris conscience de l'importance des mécanismes de «
protection et de promotion » à l'intérieur d'un
système juridique donné. Aux procédures traditionnelles
étatiques, se juxtaposent aujourd'hui une grande variété
de mécanismes non étatiques et supra étatiques en vue de
protéger les enfants. Ainsi, en marge de la relation entre le pouvoir et
la personne, principaux locuteurs et acteurs de la discussion internationale
des droits de l'enfant, d'autres acteurs tendent de faire entendre leur voix,
qu'il s'agisse d'associations de promotion et de défense des droits de
l'enfant, de groupes de lobbying représentants divers
intérêts, de cliniques juridiques universitaires ou de groupes
d'experts, de juridictions ou des quasi-juridictions régionales ou
universelles.
Le terme générique ANE est très large et
inclut, selon les termes de Philip Alston « tout ce qui n'est pas un
Etat, qu'il s'agisse d'IBM, du FMI, de shell ou d'Amnesty international.
»671. Les ANE incluent des groupes tels que : les organisations
non gouvernementales (ONG), les groupes religieux, la société
civile, les individus, les organisations internationales, les
sociétés transnationales (STN), les entreprises, les groupes
rebelles, les organisations terroristes, les entrepreneurs militaires, les
groupes armés d'opposition. Les ANE guident les politiques, entament les
guerres, nuisent aux gouvernements et aident les citoyens, en même temps
qu'ils leur portent atteinte. Dans ce cas, ils sont détenteurs d'un
pouvoir et de ressources (économiques, militaires et de conviction)
égaux ou supérieurs à certains Etats672.
Toutefois, ici, seuls seront envisagés les ANE
exerçant un appui ou un contrôle de l'effectivité des
droits. Ainsi, à l'examen du rôle d'appui des institutions
internationales et privées (Section 1), succédera, l'analyse du
rôle mitigé des organes de contrôle (Section 2).
671 ALSTON (P.), « the `Not-a-Cat' Syndrome : Can
international Human Rights Regime Accomodate Non State Actors ? » in
Non-State Actors and Human Rights, Philip Alston, dir., New York :
Oxford University Press, 2005, p.4. ; JESSICA LAWRENCE (C.), Les droits de
l'Homme, institut de formation aux opérations de paix, 2014,
p.346.
672 JESSICA LAWRENCE (C.), Les droits de l'Homme,
institut de formation aux opérations de paix, 2014, p.346.
260
SECTION I. LE ROLE D'APPUI DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES ET PRIVEES
Les institutions d'appui n'exercent que des
velléités de contrôle en matière de promotion et de
protection des droits de l'homme. Et leurs actions n'aboutissent qu'à
des pressions d'ordre moral. Le rôle d'aiguillon des institutions
internationales compétentes en matière de droits de l'enfant,
à travers la coopération internationale (Paragraphe
1), conjugué à l'appui des institutions de la
société civile (Paragraphe2), participent tant
bien que mal à la garantie des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire.
§ 1. LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES COMPETENTES
EN MATIERE DE DROITS DE L'ENFANT
Au sens de l'article 57 de la Charte de l'ONU, l'expression
« institutions spécialisées » désigne
les organisations universelles qui sont reliées à l'ONU par des
accords spéciaux, ont été créées par des
traités intergouvernementaux et dont le statut leur confère
« des attributions internationales étendues dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes
».
Malgré les tentatives de coordonner les
activités des quinze institutions
spécialisées673 avec celles de l'ONU, des programmes
concurrents continuent d'exister, alors que des problèmes de
coordination se posent au niveau des Etats membres à propos des
politiques qu'ils préconisent dans les différentes
enceintes674.
Il est toutefois opportun de nuancer ces critiques, puisqu'une
certaine dose d'incohérence dans les relations existantes au sein de la
famille onusienne dépend de la philosophie même de l'Organisation
mondiale : les Nations Unies sont construites sur une union
d'indépendance et de diversité, plutôt que de fusion et de
centralisation, et il y a de bonnes raisons pour laisser les domaines de
coopération fonctionnelle aux mains d'institutions
spécialisées, dotées d'une personnalité, d'un
membership et d'un budget distincts de ceux de l'ONU675.
673 Si on considère les cinq institutions
financières séparément, au lieu du Groupe de la Banque
mondiale, on comptera 19 institutions.
674 Voy. à ce propos les considérations de
BERTRAND (M.), L'ONU, 5è éd., Paris :
Découverte, Collections Repères, 2004, p.55.
675 KOLB (R.), An Introduction to the Law of the United
Nations, Oxford: Hart Publishing, 2010, § 103. L'auteur y
résume aussi les raisons principales de ce système
décentralisé: crainte d'une centralisation
261
Comme il a été justement observé, les
fonctions remplies par ces organisations se rapprochent de celles des organes
subsidiaires des Nations Unies oeuvrant pour la coopération
économique et sociale, mais leurs relations avec l'ONU sont de nature
paritaire et non pas hiérarchique676.
Un grand nombre d'institutions spécialisées
donnent une contribution substantielle au système onusien de protection
des droits de l'enfant et seront mentionnées dans la présente
étude. Trois d'entre elles, pour le rôle qu'elles jouent dans la
lutte pour la réalisation des droits de l'enfant, méritent
d'être rappelées. Il s'agit de l'Unicef, de l'OIT, de l'Unesco.
Dans ce paragraphe, nous aborderons la problématique de
la coopération ponctuée par le rôle d'aiguillon joué
par nombre d'institutions spécialisées de l'Onu dans la mise en
oeuvre effective des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire ; cela se fera,
non sans épuiser la liste des organisations onusiennes oeuvrant de
façon directe ou indirecte à la réalisation des droits de
l'enfant, par l'examen du rôle essentiel joué par le Fonds des
Nations unies pour l'enfance (A) et l'action
complémentaire des autres institutions internationales, notamment, l'OIT
et l'UNESCO (B).
A. LE ROLE ESSENTIEL DE L'UNICEF
Seront abordés dans un premier temps le rôle
général de l'UNICEF dans la protection des enfants (1),
et dans un deuxième temps, ses actions en Côte d'Ivoire
(2).
1. Présentation du rôle de l'UNICEF dans la
protection des droits de l'enfant
Mandaté par l'Assemblée générale
des Nations Unies pour défendre les droits des enfants et
répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein
épanouissement677, l'UNICEF agit plus de 60 ans après
sa création comme une «agence spécialisée» des
Nations Unies dans le domaine de l'enfance678 ; de ce fait, elle
apparait comme la seule organisation des
excessive, expérience tirée de la
Société des Nations, risqué de politisation et questions
liées au statut de membre.
676 CONFORTI (B.), Le Nazioni Unite, 6e
éd., Padova : Cedam, 2000, pp.242-244.
677
http://www.unicef.org/french/media/media_35908.html
(consulté le 10 novembre 2015).
678 DUMERCQ (M.M), Mise en perspective des
ambiguïtés de la communication des organisations
intergouvernementales humanitaires : le cas de l'UNICEF dans les
stratégies de recherche de fonds , Université Bordeaux 3-
Michel Montaigne, Thèse de doctorat, 2009, 322 p., p.138.
262
263
Nations Unies qui se consacre uniquement à la cause des
enfants dans le monde. Indépendante sur le plan politique et
confessionnel, l'UNICEF élabore et finance des projets de
développement et vient en appui aux pays en
difficulté679. Dans la mise en oeuvre de ses actions,
l'Organisation fonctionne sur la base d'un découpage du globe en huit
(8) régions, dont celle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette
dernière zone regroupe 24 pays680 dont la Côte
d'Ivoire.
Depuis l'adoption de la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant en 1989, l'UNICEF s'appuie sur cette dernière pour
mener sa mission. Elle concentre ses objectifs sur la protection et le
développement des enfants dans le monde avec des axes prioritaires
qu'elle a regroupés en cinq domaines d'intervention681 :
- Survie et développement de l'enfant, basé sur
des services basiques à prix accessible pour sauver la vie des enfants
;
- Éducation de base, égalité des sexes,
basés sur une éducation gratuite et de qualité pour tous
;
- VIH/SIDA et les enfants, basés sur la
prévention, la transmission parent-enfant, les soins
pédiatriques, les enfants affectés par le SIDA ;
- Protection de l'enfant, qui consiste à bâtir un
environnement protecteur pour les enfants ;
- Et enfin, l'analyse de politiques et partenariat, qui
consiste à axer la politique publique sur les droits de l'enfant.
En Côte d'Ivoire, les priorités de l'UNICEF sont
axées sur : la survie, l'éducation et la protection de
l'enfant.682
Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs, l'UNICEF
a nécessairement besoin de moyens. Il se pose donc la question des
sources de financement de l'Organisation et des autres moyens qui lui sont
nécessaires.
679 BELLO (S.), La traite des enfants en
Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux droits de
l'enfant en République du Bénin, L'Harmattan 2015,
.272-274.
680 Outre la Côte d'Ivoire, on a : le Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo, RDC, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liberia,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Rép. Centrafricaine, Sao
Tomé- et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo.
681 Ces cinq domaines d'intervention de l'UNICEF sont
disponibles en ligne sur le lien
http://www.unicef.org/french/whatwedo/index.html
(consulté le 06 juillet 2015).
682 Source :
http://www.unicef.org/french/infobycountry/cotedivoire.html
(consulté le 06 Juillet 2015).
En abordant la question des moyens d'action de l'UNICEF, nous
voulons mettre ici un accent particulier sur les sources de financement de
l'Organisation. Mais avant cela, nous allons brièvement faire le tour
des diverses ressources dont l'organisation se sert pour accomplir sa
mission.
Nous retiendrons que l'UNICEF dispose d'un réseau de
plus de 100.000 bénévoles683 à travers le monde
et d'un réseau de plus de trois cents trente (330) ambassadeurs (de
bonne volonté) parmi lesquels on compte des artistes
célèbres, des acteurs du cinéma, des sportifs de haut
niveau etc. qui prennent position pour la cause des droits de l'enfant dans le
monde684. Parmi ces ambassadeurs, on compte environ une trentaine
d'ambassadeurs internationaux dont le footballeur britannique David Beckham, le
footballeur Argentin Lionel Messi, l'acteur chinois Jackie Chan, la chanteuse
béninoise Angélique Kidjo, la chanteuse colombienne Shakira
Mebarak , le prestigieux orchestre philharmonique de Berlin685
(Berliner Philharmoniker); une douzaine d'ambassadeurs régionaux et
environ 290 ambassadeurs nationaux.
Au-delà de ces personnalités qui mettent leur
notoriété au service de l'organisation, l'UNICEF compte plus de
dix mille (10.000) employés dont environ 88% travaillent directement sur
le terrain et le reste au siège686.
Au plan financier, le budget annuel de l'UNICEF dépasse
les trois (03) milliards de dollars USA depuis 2007.687 Les recettes
de l'organisation s'élevaient en 2009 à 3.256.118
683 DUMERCQ (M.), « Mise en perspective des
ambigüités de la communication des organisations
intergouvernementales humanitaires : le cas de l'UNICEF dans les
stratégies de recherche de fonds », op.cit. p.42. voir
aussi
http://www.unicef.org/french/about/employ/index_volunteers.html
(consulté le 29/10/2015).
684 Source :
http://www.unicef.org/french/people/people_ambassadors.html
, (consulté le 13-04-2014).
685 Comptant plus de 120 membres, l'orchestre philharmonique
qui déjà en 2002 est devenu une fondation charitable a
été nommé en 2007 comme ambassadeur itinérant de
l'UNICEF.
686 DUMERCQ (M.), « Mise en perspective des
ambiguïtés de la communication des organisations
intergouvernementales humanitaires : le cas de l'UNICEF dans les
stratégies de recherche de fonds », op.cit. p.42.
687 En effet, en 2007 le budget annuel de l'organisation
s'élevait à 3 013 millions de dollars US, en 2008 il
s'élevait à 3 390 million de dollars US et en 2009 il
s'élevait à 3 256 millions de dollars US. Ces données sont
disponibles dans le rapport annuel 2008 de l'UNICEF publié par la
division de communication de
l'organisation en 2009 et en ligne sous lien :
www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2008_FR_072709.pdf(
consulté le 10 Novembre 2013).
Et le rapport annuel 2009 publié par le même
service et disponible sous le lien :
http://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2009_FR_061510.pdf
264
448 USD, en 2010 à 3.681.890.741 USD, et en 2011
à 3.711.086.493 USD.688 En 2014, le total des dépenses
s'élevait à 4868 milliards de dollars689. Comme on
peut le constater, les dépenses de l'organisation ces dernières
années ne cessent de progresser. Ceci peut s'expliquer par le besoin
sans cesse croissant de moyens pour financer ses actions. Et on peut donc
supposer que les problèmes liés à l'enfant dont
l'organisation s'occupe dans le monde ont une tendance à progresser. Le
budget d'UNICEF « est entièrement financé par des
contributions volontaires » 690 qui proviennent, selon la
classification de l'organisation : des gouvernements, du secteur privé
et des organisations non gouvernementales, autres recettes, et des accords
inter institutions691. Les États membres des Nations Unies
sont les principaux contributeurs du budget de l'organisation.
L'organisation des Nations unies pour l'enfance intervient
aussi en appui humanitaire dans les cas d'urgence692. Dans ce cadre,
elle intervient dans plus de 250 cas dans le monde chaque
année693.
Mais comment fonctionne l'UNICEF sur le terrain et quel
rôle joue-t-elle en pratique en faveur des enfants en Côte d'Ivoire
?
688 Ces données sont disponibles dans les rapports
d'UNICEF des années correspondantes et sont disponibles sur le site
http://www.unicef.org/french/publications.
689
http://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2014_French-2.pdf
(consulté le 2 novembre 2015).
690 Selon le rapport 2008 de l'UNICEF, les recettes de
l'organisation « sont divisées en ressources « ordinaires
» et « autres » ressources. Les ressources ordinaires ne font
l'objet d'aucune restriction et elles servent à financer les programmes
de pays, l'appui aux programmes et les activités de gestion et
d'administration approuvées par le Conseil d'administration de l'UNICEF.
Les autres ressources sont sujettes à des restrictions et sont
affectées à des activités spécifiques
approuvées par le Conseil, dans le cadre des programmes de pays. Ces
ressources se subdivisent en contributions « ordinaires » et
contributions affectées aux « opérations d'urgence
».
691
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/informations-complementaires/partenaires-multilateraux-et-nationaux-du-centre-de-crise/article/unicef
(consulté le 2 novembre 2015).
692 Selon la procédure d'activation d'urgence, les
interventions humanitaires sont classées en trois catégories : du
niveau 1 au niveau 3. Cf. doc. «Appui global de l'UNICEF disponible sur
http://www.unicef.org/french/hac2012/files/HA012_FR_global.pdf(consulté
le 18/12/2015).
693
http://www.unicef.org/french/hac2012/hac_global.html
(consulté le 14 Juillet 2013).
265
2. Les actions de l'Unicef en Côte
d'Ivoire
Pour mener à bien sa mission sur le terrain, le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance signe des accords de coopération avec
les États ou territoires où elle désire
opérer.694 Ainsi, avec le gouvernement de l'État en
question, ils « préparent conjointement les programmes dans les
différents secteurs pour le bien-être des enfants dans un document
appelé «Programme de Coopération». Chaque partie
détermine son rôle, ses responsabilités et sa contribution
dans le Programme de Coopération. L'UNICEF apporte l'assistance
technique, matérielle et financière et le gouvernement
exécute le programme à travers les différents
ministères ». 695 Sur ce plan, son travail se
trouve facilité par le fait que pratiquement tous les États au
monde ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Ainsi,
le Fonds des Nations unies pour l'Enfance apparait comme un
élément clé dans l'application de la CIDE et de ce fait,
il doit jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les
violations des droits de l'enfant et contribuer ainsi à une
effectivité optimale des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.
L'UNICEF collabore avec les États parties à la
Convention et plaide pour la défense des droits de l'enfant tout en
contribuant au développement de cadres juridiques et de politiques
internes en matière de droits de l'enfant. Dans le même temps, il
« soutient aussi le Comité des droits de l'enfant qui surveille
l'application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs par les
États parties. La Convention lui confère un rôle
particulier dans le processus de surveillance. En plus des conseils et de
l'assistance qu'il apporte au Comité, il appuie la tenue de vastes
consultations au sein des États pour améliorer la
précision et l'impact des rapports qui sont soumis au Comité
».696
Dans la pratique en Côte d'Ivoire, le Fonds des Nations
unies pour l'enfance collabore autant avec le gouvernement que les
Organisations non gouvernementales dans la lutte pour un cadre national propice
à la mise en oeuvre des droits de l'enfant.
694 Elle est présente dans 191 pays et
territoires.
V. www.unicef.org/french/infobycountry/index.html (consulté le
14 Juillet 2013).
695
www.unicef.org/drcongo/french/about_1054.html
(consulté le 14 Juillet 2013).
696 Cf. UNICEF en action sur :
http://www.unicef.org/french/crc/index_action.html
(consulté le 06/02/2017)
266
Au niveau du gouvernement, le principal partenaire du fonds
reste le ministère de la famille et de l'enfant697,
même si d'autres ministères tels que le Ministère de
l'intérieur, le Ministère de la justice et des droits de l'homme
bénéficient de l'appui de l'UNICEF.
En ce qui concerne la collaboration avec le gouvernement, nous
avions relevé sur le terrain que l'UNICEF a équipé en
mobilier de bureau et matériel roulant, les directions
départementales des ministères de la famille, de la santé,
et de l'intérieur698. De même, nous avions
constaté, lors notre passage à la direction départementale
du ministère de la famille des départements de Yamoussoukro et
d'Agboville, l'enregistrement informatique des données statistiques sur
les OEV699 dans ces départements, effectué par deux
jeunes opératrices de saisie, qui n'étaient pas agents de la
direction. Selon les informations recueillies, ce travail de collecte de
données fait partie d'un programme initié et financé par
l'Unicef.
De même, en 2010, l'UNICEF a réussi à
faire des progrès pour les femmes et les enfants touchés par les
situations d'urgence en Côte d'Ivoire en 2010 : près de 9000
enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont
été traités dans des unités de soins ambulatoires
et 1200 dans des centres d'alimentation thérapeutiques; plus de 5,5
millions d'enfants de moins de cinq ans ont reçu des traitements
vermifuges et environ 6,1 millions ont bénéficié de
compléments de vitamine A; au moins 12 000 personnes ont pu avoir
accès à l'eau potable, 28 villages ont été
déclarés officiellement « villages d'où la
défécation à l'air libre a été bannie
», et 1400 foyers ont pu avoir accès à des
latrines700. L'UNICEF a aidé à améliorer la
préparation aux situations d'urgence au sein du secteur de
l'éducation grâce au renforcement des capacités de 30
gestionnaires de l'enseignement. Plus de 60 rescapés de violences
sexuelles, des filles pour la plupart, ont reçu une assistance
médicale et psychosociale ainsi que des conseils d'ordre
juridique701.
697 Au dernier remaniement ministériel en 2012, le
ministère de la famille se dénomme, « Ministère
ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant
».
698 Ce constat est fait à travers le nom du donateur
inscrits sur les matériels en questions lors de nos visites dans les
directions et confirmé par les agents rencontrés.
699 Orphelins et Enfants Vulnérables.
700
https://www.unicef.org/french/hac2011/hac_cote_divoire.php(consulté
le 20/11/2015). 701
http://www.unicef.org/french/hac2011/hac_cote_divoire.php
(consulté le 20/11/2015).
267
Ce bref aperçu des actions de l'UNICEF montre que cette
organisation oeuvre autant que faire se peut en faveur des enfants ivoiriens
pour atteindre les objectifs d'un «Monde digne des
enfants702«. Ses actions sur le terrain ont sans aucun
doute un impact positif sur les gouvernants en ce qu'elle les interpelle sur la
nécessité d'accorder un intérêt particulier à
la cause des enfants. Cependant, malgré les moyens matériels,
financiers et humains dont elle dispose, tout porte à croire que le
chemin à parcourir est encore long pour l'atteinte de ses objectifs.
A côté de l'UNICEF, d'autres organisations des
Nations Unies oeuvrent, dans une certaine mesure, pour la protection des droits
de l'enfant. Parmi celles-ci, nous nous intéresserons à l'action
complémentaire que jouent l'Organisation International du Travail (OIT)
et le Fonds des Nations Unies pour l'Education la Science et la Culture
(UNESCO) en matière de protection et de respect des droits de
l'enfant.
B. L'ACTION COMPLEMENTAIRE DES AUTRES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES : CAS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET DE
L'UNESCO
Ici, il sera question de montrer respectivement les actions
décisives de l'OIT703 (1) et de
l'Unesco704 (2) en matière de lutte contre
le travail des enfants et du droit des enfants à l'éducation.
1. L'OIT, une structure de coopération efficace
dans le domaine du travail des enfants
L'efficacité de l'OIT en Côte d'Ivoire
découle de ses missions générales qu'il faudra
découvrir et analyser, d'abord, pour pouvoir ensuite montrer ses
manifestations par le biais de ses actions en Côte d'Ivoire.
- Présentation générale de
l'OIT
702
http://www.unicef.org/french/publications/files/Un_monde_digne_des_enfants_072808.pdf
(consulté le 20/11/2015).
703 BELLO (S.), La traite des enfants en
Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux droits de
l'enfant en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.279.
704 BELLO (S.), La traite des enfants en
Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux droits de
l'enfant en République du Bénin, L'Harmattan 2015,
p.284-286.
268
L'OIT a été fondée en 1919 sous
l'égide du Traité de Versailles705, qui a mis fin
à la Première Guerre mondiale. Sa Constitution fut
élaborée entre janvier et avril 1919 par la Commission de la
législation internationale du travail706.Elle oeuvra
particulièrement en Afrique entre 1919 et 1946. Le 02 Octobre 1946, la
Conférence générale approuve à l'unanimité
l'accord conclu avec les Nations Unies (NU), qui accorde à l'OIT le
statut d'institution spécialisée, au titre de l'article 63 de la
Charte. Cet accord est entré en vigueur le 14 décembre 1946,
après approbation par l'AG des NU. Le siège de l'OIT est
établi à Genève, où ses organes permanents exercent
leurs activités.
Les buts de l'OIT sont très étendus ; ils sont
énoncés dans la Déclaration de Philadelphie et dans sa
Constitution. Les principes fondamentaux de l'organisation qui figurent dans
ladite Déclaration sont les suivants :
« a) le travail n'est pas une marchandise, b) la
liberté d'expression et d'association est une condition indispensable
d'un progrès soutenu, c) la pauvreté, où qu'elle existe,
constitue un danger pour la prospérité de tous, d) la lutte
contre le besoin doit être menée avec une inlassable
énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu
et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des
employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des
gouvernements, participent à de libres discussions et à des
décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir
le bien commun, e) tous les êtres humains, quelle que soit leur race,
leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès
matériel et leur développement matériel et leur
développement spirituel dans la liberté et la dignité,
dans la sécurité économique et avec des chances
égales »707.
Outre ces principes, l'OIT a pour mission spécifique de
seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de
programmes propres à réaliser :
« a) la plénitude de l'emploi et
l'élévation des niveaux de vie, b) l'emploi des travailleurs
à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la
mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le
mieux au bien-être commun...h) la protection de l'enfance et de la
maternité, i) un niveau adéquat d'alimentation, de logement et de
moyens
705 HANOTAUX (G.), Le Traité de Versailles du 28
juin 1919 : l'Allemagne et l'Europe, Librairie Plon, 1919, 410p.
706
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--fr/index.htm(consulté
le 10/11/2016).
707 Section II, point a), de la Déclaration de
Philadelphie.
269
de récréation et de culture, j) la garantie
de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel
»708.
Ces extraits de la Déclaration suffisent, même si
nous n'avons pas repris dans leur intégralité les objectifs de
l'OIT, pour se rendre compte combien cette institution a une mission
étendue et élevée dans le monde du travail. Ses moyens de
travail sont essentiellement la préparation de conventions
internationales et de recommandations approuvées par la
Conférence générale et adressées aux gouvernements.
Les unes comme les autres visent non seulement à établir une
législation internationale uniforme dans le domaine du travail, mais
aussi à contribuer à la réalisation concrète des
objectifs que poursuit l'institution.
Avec l'accroissement de ses membres, l'organisation à
très vite évolué et compte à ce jour, 187
États membres.709 Ses activités sont centrées
autour de quatre objectifs principaux710 que sont :
- Promouvoir et faire appliquer les normes du travail ainsi que
les principes et droits fondamentaux du travail ;
- Accroitre les possibilités pour les femmes et les hommes
d'obtenir un emploi et revenu décents ;
- Etendre le bénéfice, l'efficacité et la
protection sociale pour tous ; - Et renforcer le tripartisme et le dialogue
social.
Autour de ces quatre principaux objectifs, l'OIT
développe des programmes importants tels : l'élimination du
travail des enfants, la sécurité socio-économique, le
dialogue social, la législation du travail et l'administration du
travail, la sécurité et la santé au travail,
etc711.
Dans le domaine du travail des enfants, l'OIT a mis en place,
depuis sa création, plus d'une dizaine de normes. Parmi elles, figurent
la Convention n°138 de 1973 portant sur l'âge minimum du travail et
la Convention 182 de 1999 sur l'élimination des pires formes du
708 Section II de la Déclaration de Philadelphie.
709 OIT, L'OIT, ses origines, son fonctionnement, son
action», document PDF en ligne sur le site officiel de
l'organisation:
www.ilo.org, 59 p., pp.4-8.
710 Idem, p.12.
711 Infos disponibles sur le site de l'organisation :
www.ilo.org.
270
travail des enfants. Ces deux normes, de par leur contenu,
devraient être en mesure de protéger les enfants contre la traite
des enfants qui a pour corollaire leur exploitation dans des conditions
quasi-inhumaines712.
La Côte d'Ivoire étant partie à ces deux
normes, leur effectivité sur son territoire devrait être de mise.
Conscient que cette effectivité recherchée appelle la
mobilisation de tous les acteurs, l'OIT se voit obliger d'agir pour apporter un
soulagement aux enfants victimes en Côte d'Ivoire.
- Les actions de l'OIT en faveur des enfants en
Côte d'Ivoire
Comment agit l'OIT pour protéger les enfants victimes
d'exploitation ? Ces actions sont-elles efficaces sur le terrain, en Côte
d'Ivoire ?
Ces points seront abordés à travers la
présentation de deux programmes IPEC713 et
LUTRENA714 puis à travers l'examen du projet pilote de
Système de suivi du Travail des enfants (SSTE).
Le Programme international pour l'élimination du
travail des enfants (IPEC) est un programme mis en place par l'OIT en 1992 pour
renforcer son activité en faveur de l'abolition du travail des enfants
dans le monde715.
Présent dans 92 pays716 dont le
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger, le
Togo, le Nigéria, etc., le Programme IPEC apparaît comme le plus
important programme opérationnel de l'OIT717. Il a pour
objectif d'oeuvrer pour l'élimination du travail des enfants à
travers le renforcement des capacités des États parties aux
normes de l'OIT en la matière afin que ces derniers puissent, au mieux,
oeuvrer dans la lutte contre le travail des
712 Voir Infra.
713 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.281
714 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.282-283.
715 BELLO (S.), La traite des enfants en
Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux droits de
l'enfant en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.281. ;
BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, Dissertation, zur Erlangung des
Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Bayr, 2013, 425p.
716 Voir « IPEC dans le monde », disponible sur le
site :www.ilo.org/ipec/areas/lang--fr/index.htm (consulté le
10/10/2015).
717 Idem.
271
enfants sur leur territoire. De même, le programme vise
à promouvoir un mouvement mondial de lutte contre le travail des
enfants, qui a pour cible prioritaire les pires formes du travail des enfants,
conformément aux dispositions de la Convention 182.
Depuis la mise en place du programme mondial en 2006, qui
appelle les États membres de l'organisation à s'engager à
éliminer les pires formes du travail des enfants d'ici 2016, le
programme IPEC soutient les États dans leurs actions. En effet, pour
faire face à ces défis, l'IPEC s'était fixé en
2008, pour objectifs jusqu'en 2013718 de : consolider sa position de
centre d'excellence de la connaissance et de l'expertise en matière de
lutte contre le travail des enfants, auquel les gouvernements, les employeurs,
les travailleurs et les acteurs internationaux, entre autres, peuvent demander
des services consultatifs ou un renforcement de leurs capacités ;
maintenir et renforcer sa capacité de recherche et de collecte de
données, sur laquelle s'appuient aussi bien les actions ciblées
que les services consultatifs ; demeurer le principal programme de
coopération technique pour la lutte contre le travail des enfants ;
faciliter la coopération technique entre pays de différents
continents ; renforcer et redynamiser le mouvement mondial de lutte contre le
travail des enfants et jouer, au nom de l'OIT, un rôle moteur dans ce
mouvement ; et enfin, poursuivre l'intégration des activités de
l'IPEC dans la programmation du BIT, et surtout dans les programmes par pays de
promotion du travail décent.
A travers ces objectifs ambitieux, le Programme IPEC a le
mérite de vouloir jouer un rôle déterminant dans la lutte
contre la traite des enfants. Mais compte tenu de la gravité et de
l'ampleur du phénomène, un programme spécifique a
été mis en place pour renforcer la lutte contre la traite des
enfants, à savoir, le projet LUTRENA.
Mise sur pied pour appuyer les mandats de l'OIT dans la mise
en oeuvre de la Convention 182, le Programme de lutte contre la traite des
enfants à des fins d'exploitation de travail en Afrique de l'Ouest et du
Centre (LUTRENA) est un programme sous régional qui a été
créé par l'OIT avec le soutien financier du Ministère du
travail des États-Unis d'Amérique. Il a pour rôle de
faciliter le processus d'élimination de la traite des enfants d'une
part, et d'agir
718 OIT, Intensifier la lutte contre le travail des enfants,
document PDF en ligne,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_136696
.pdf1 p.19 (consulté le 10 septembre 2014).
272
à travers les principaux acteurs719
intervenant dans le domaine en renforçant leurs capacités,
d'autre part.
Géographiquement, il couvre neuf pays qui sont : le
Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte-d'Ivoire, le Gabon,
le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Togo720. Lancé pour sa
première phase en 1999, il devait faire le point de la situation de la
traite des enfants, déterminer les problèmes régionaux, et
développer des stratégies nationales et régionales
à mettre en oeuvre pendant sa deuxième phase. Cette
deuxième phase, qui fut lancée en juin 2001, prévoyait
entre autres, des projets de protection au niveau communautaire, la
construction de capacités garantissant l'application des lois, la
promotion des accords frontaliers multilatéraux et bilatéraux
entre les pays de la région, l'établissement d'un réseau
entre les principaux acteurs, de programmes de réhabilitation et de
réintégration des enfants victimes, ainsi que la mise en place
d'activités génératrices de revenus.
La création au niveau national d'un environnement
juridique plus favorable et le renforcement des capacités nationales des
acteurs concernés par la traite des enfants, la mise en oeuvre des
programmes d'action directe ayant pour but la prévention et la
réhabilitation des enfants victimes de traite, l'accroissement des
connaissances relatives à la traite des enfants dans sa zone
d'intervention et le renforcement des réseaux de lutte contre la traite
des enfants et la formation des exécutants des programmes qui s'y
rapportent, et enfin la mise en place d'un modèle de coopération
afin de prévenir la traite des enfants à travers un
mécanisme de retrait et de réintégration des enfants, dans
les pays sélectionnés sont, de façon
détaillée, les objectifs que vise le projet LUTRENA dans sa
mission en Afrique de l'Ouest et du Centre.
En Côte d'Ivoire, les actions du projet LUTRENA, au
regard du constat sur le terrain, ont un résultat assez mitigé.
La principale certitude de la réussite des actions menées reste,
le cas de l'amélioration du cadre normatif et la coopération
régionale. Sans oublier que cela rentre également dans le domaine
d'actions d'autres organisations telles que l'UNICEF.
719 Ces acteurs comprennent, outre les principaux acteurs de
l'OIT que sont le gouvernants, les employeurs et les travailleurs, les ONG et
associations qui interviennent dans le domaine de la lutte contre la traite des
enfants.
720 OIT, LUTRENA, document PDF en ligne sur le site
officiel de l'
OIT. www.ilo.org ; ou
encore, voir
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_4077/lang--fr/index.htm
( consulté le 06/03 /2017).
273
Cependant, le résultat insatisfaisant du programme
LUTRENA ne justifierait-il pas la création de nouveaux projets tel le
Projet pilote de Système de suivi du Travail des enfants ?
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la
convention n°182 de l'OIT, ratifiée par la Côte d'Ivoire en
février 2003, tout Etat qui l'a ratifiée, doit mettre en place un
mécanisme de suivi efficace et durable de l'exécution des actions
menées dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des
enfants.
A l'effet de soutenir les Etats à bien mener une telle
entreprise, l'OIT à travers le programme BIT IPEC, fournit une
assistance technique aux acteurs gouvernementaux. Cette assistance se traduit
par la mise en place d'un système crédible, compréhensible
et réalisable dénommé Système de de suivi du
Travail des Enfants (SSTE). Ce système est un mécanisme, qui
permet d'orienter les enfants vers des initiatives louables et décentes
telles que l'éducation et la formation qualifiante. Pour atteindre son
but, le SSTE doit: « être multisectoriel ; avoir un mandat
légal et placé sous la supervision de l'autorité
administrative locale ; être inclus dans la politique nationale de lutte
contre la traite et les pires formes de travail des enfants ; prendre en compte
tous les mécanismes de collectes de données existants ;
être durable et mesurable ; avoir des informations vérifiables ;
impliquer tous les acteurs intervenant dans le processus de lutte contre les
pires formes de travail des enfants. »721
L'analyse du SSTE permet de réaliser que de son
fonctionnement, se dégage des acquis importants mais aussi des limites
importantes.
En 2004, le BIT à travers le programme sous
régional de lutte contre le travail abusif des enfants dans la
cacaoculture et l'agriculture commerciale (WACAP) a mis en oeuvre un projet
pilote de Système de suivi du Travail des enfants (SSTE) dans six
départements ivoiriens à forte production cacaoyère. Ce
sont les départements de Soubré, San Pédro, Daloa,
Oumé, Adzopé et Abengourou. Ce projet a eu pour objectif
essentiel de prévenir le travail et l'exploitation des enfants dans la
cacao-culture, dans 14 localités desdits
départements722.
721 SOSTECI, Document cadre du système
d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire,
Février 2013, p.13.
722 Ibid.
274
Dans cette phase considérée comme une
étape pilote, le projet s'est limité au secteur de la production
du cacao, excluant du coup les autres secteurs d'activités.
Les interventions du projet WACAP ont permis d'apporter un
appui à la réinsertion de 24961 enfants dans les circuits de
l'éducation et de la formation qualifiante. Elles ont permis
également de développer un réseau d'acteurs par le biais
de Comités installés dans les régions
bénéficiaires. Ces comités qui étaient
installées au niveau villageois (Comités villageois de lutte
contre le travail des enfants), au niveau sous-préfectoral
(Comités sous-préfectoraux de lutte contre le travail des
enfants) et au niveau national (cellule focale de lutte contre le travail des
enfants) ont assuré la mobilisation communautaire723.
Ce programme WACAP a permis aussi à la Côte
d'Ivoire d'élaborer une ébauche de base de données dont la
durabilité et l'efficacité devaient être élargies et
renforcées progressivement.
Comme on peut le remarquer, le programme IPEC-WACAP a permis
de mener plusieurs actions de lutte contre la traite et les pires formes de
travail des enfants. Cependant, l'action nationale en matière du SSTE a
connu des limites dont les plus notables sont les suivantes : activité
mono sectorielle (car basée uniquement sur la culture du cacao),
insuffisance de coordination, absence d'un système de
référence, faible appropriation des actions de lutte par la
population, financement basé pour la plupart sur l'appui
extérieur, non pérennisation des actions de mise en oeuvre.
En définitive, en dehors de l'expérience WACAP,
aucune autre initiative n'a véritablement permis de poursuivre
l'exécution et le développement de ce système. L'approche
sectorielle de la réponse apportée à la
problématique des pires formes de travail des enfants, ayant
constitué une limite importante dans le cadre de ce projet, il est
apparu nécessaire d'élaborer une nouvelle stratégie
basée sur la multisectorialité.
A côté de l'Unicef et de l'OIT, l'Unesco apparait
aussi comme une institution jouant un rôle majeur dans la
réalisation du droit à l'éducation des enfants en
Côte d'Ivoire.
723 SOSTECI, op.cit. p14.
275
2. L'Unesco, une structure de coopération efficace
au niveau du droit à l'éducation
En 1942, neuf pays élaborent un projet de statut d'OI
de coopération intellectuelle et scientifique. L'avant-projet est soumis
à la Conférence internationale de Londres en novembre 1945,
à laquelle le texte de la Constitution de l'UNESCO est
préparé724. Celle-ci entre en vigueur le 4 novembre
1948 et sera modifié à plusieurs reprises par la
Conférence générale. Il est convenu aussi d'établir
son siège à Paris. L'accord conclu entre les NU et l'UNESCO, par
lequel l'organisation devient une institution spécialisée, est
adopté en novembre 1946 par la première Conférence
générale de l'UNESCO et approuvé le 14 décembre
1946 par l'AG des NU.
L'institution se propose de « contribuer au maintien
de la paix et de la sécurité en resserrant , par
l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations,
afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies
reconnait à tous les peuples »725 ; pour
réaliser cette tâche, l'Organisation :
a) « Favorise la connaissance et la
compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux
organes d'information des masses » ;
b) « Imprime une impulsion vigoureuse à
l'éducation populaire et à la diffusion de la culture en
collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider
à développer leur action éducatrice ; en instituant la
collaboration des nations afin de réaliser graduellement l'idéal
d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de
race, de sexe ni d'aucune condition économique ou sociale.
»726 ; en suggérant des méthodes
d'éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier
aux responsabilités de l'homme libre ;
c) « Aide au maintien, à l'avancement et
à la diffusion du savoir » en veillant à la
conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art
et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en
recommandant aux peuples intéressés des conventions
internationales à cet effet ; en encourageant la
724
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/history/
(consulté le 02/05/2016).
725 Cf.
www.unesco.org/archives/new2010/fr/histoire_unesco.html
(consulté le 02/05/2016).
726 Cf.
www.unesco.org/archives/new2010/fr/histoire_unesco.html
(consulté le 02/05/2016).
276
coopération entre nations dans toutes les branches de
l'activité intellectuelle, l'échange international de
représentants de l'éducation, de la science et de la culture
ainsi que celui de publication, d'oeuvre d'art, de matériel de
laboratoire et de toute documentation utile appropriés à
l'accès de tous les peuples à ce que chacun d'eux publie.
».
L'UNESCO compte aujourd'hui 195727 États
membres dont la République de Côte d'Ivoire qui y a
adhéré le 18 octobre 1960. A travers la signature de sa
Convention, les États s'engagent « à assurer à
tous le plein et égal accès à l'éducation, la libre
poursuite de la vérité objective et le libre échange des
idées et des connaissances, décident de développer et de
multiplier les relations entre leurs peuples en vue de mieux se comprendre et
d'acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs
coutumes respectives »728. Ainsi, à travers son
engagement pour l'éducation, l'UNESCO devrait jouer un rôle
déterminant dans la mise en oeuvre du droit à l'éducation
des enfants dans de nombreux pays.
En matière d'éducation, l'UNESCO a pour mission
principale d'oeuvrer pour faire de l'éducation pour tous, une
réalité.
Aujourd'hui, à travers sa mission
générale, elle oeuvre dans le domaine de protection des enfants,
à travers les normes du système des Nations Unies et à
travers des normes juridiques qu'elle a adoptées en son sein.
La protection des enfants par l'UNESCO729 est
indéniable. L'UNESCO à travers ses normes offre, sans doute, une
protection juridique aux enfants. Dans ce cadre, nous nous
référerons d'abord à la Convention concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée par
la Conférence générale de l'UNESCO le 14 décembre
1960 et à laquelle la Côte d'Ivoire est partie depuis le 09
juillet 1963, la Recommandation sur l'éducation pour la
compréhension, la coopération et la paix internationale et
l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, adoptée par la Conférence générale
à sa 18ème session le 19 novembre 1974 à Paris,
le Cadre
727 Ce nombre prend en compte, le territoire palestinien qui a
été reconnu par l'organisation et le l'Etat du Sud Soudan.
728 Déclaration des Etats dans la Convention instituant
l'UNESCO.
729
www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/normative-action/standard-setting/(consulté
le 02/05/2016).
277
d'action de « L'Education pour tous : tenir nos
engagements collectifs 730», adopté par le Forum
mondial sur l'éducation tenu à Dakar, Sénégal, du
26 au 28 avril 2000.
A travers ces normes, et particulièrement la Convention
concernant la lutte contre toute discrimination, les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures pour éliminer toutes les
formes de discrimination dans l'enseignement et oeuvrer pour que l'accès
à l'éducation pour tous sur leur territoire soit une
réalité. Mais, conscient que la non scolarisation des enfants est
un facteur qui favorise la traite des enfants et le travail des enfants,
l'organisation entend contribuer à freiner ce phénomène.
Car, comme il est écrit sur son site :
« L'éducation est la clé de la
prévention du travail des enfants, alors qu'à l'inverse, le
travail des enfants est un obstacle à l'éducation. L'accès
universel à l'éducation - plus particulièrement à
une éducation de bonne qualité, gratuite, obligatoire et
assurée jusqu'à l'âge minimal d'admission à l'emploi
- est un facteur critique de la lutte contre l'exploitation économique
des enfants. À travers ses programmes, l'UNESCO aide les enfants
à acquérir une éducation de base et à les
scolariser dans le primaire et le secondaire, afin qu'ils soient moins
vulnérables et ne soient une proie pour le travail des
enfants.731 »
Mais malgré son engagement en matière
d'éducation, et la reconnaissance de son importance dans la lutte contre
l'exploitation des enfants, l'UNESCO ne peut à elle seule contribuer
à rendre effectif le droit à l'éducation ou tout autre
droit nécessaire à l'épanouissement des enfants en
Côte d'Ivoire.
En somme, les actions menées par les organisations du
système des Nations Unies en Côte d'Ivoire bien qu'importantes
sont très loin de venir à bout de la mise en oeuvre effective des
droits de l'enfant dans ce pays. Cette situation découle du fait que
d'une part, les actions menées ne répondent pas souvent aux
mesures nécessaires pour lutter efficacement contre
l'ineffectivité de nombre de droits des enfants et d'autre part, aux
actions dispersées des acteurs sur le même problème. En ce
qui concerne l'inadéquation des actions menées sur le terrain,
nous pouvons relever par exemple, le processus de rapatriement et de prise en
charge et de réinsertion des enfants victimes , le financement des ONG
pour la prise en charge des enfants victimes , ou le financement de
construction de centres d'accueil pour les ONG, etc.
730
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147f.pdf
(consulté le 02/05/2016).
731
www.unesco.org/new/fr/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-education/child-
workers/(consulté
le 02/05/2016).
278
279
Ce mode de fonctionnement met les ONGs au coeur de la
protection des enfants, au point où l'on a l'impression que c'est
plutôt les actions des ONG qui sont accompagnées au
détriment de celles de l'État dans la mise en place de mesures
durables de protection de l'enfant. En effet, sur ce point, l'organisation des
Nations Unies pour l'enfance, avec les autres organismes des Nations Unies,
auraient pu être efficaces :
- s'ils accompagnaient les gouvernants dans la construction de
Centres d'accueil publics et en formant le personnel adapté pour le
fonctionnement de ces centres. Ainsi, outre l'existence de cadre adéquat
pour recueillir les enfants vulnérables, cette démarche aurait
pour avantage de responsabiliser progressivement le gouvernement dans la prise
en charge et la gestion desdits centres dont les personnels seront, à
terme, des agents publics ;
- Orienter les actions avec les ONG locales vers les
situations d'urgence ou les formations et sensibilisation. En effet, les
Organisations non gouvernementales ont l'avantage d'être souvent plus
proches des populations, et elles seront plus efficaces pour les actions
à court terme.
Ces suggestions nous semblent à même d'apporter
des solutions plus efficaces aux actions de ces organisations.
Mais nous le savons bien, cette démarche n'appelle pas
de résultats immédiats. Elle nécessite du temps, de la
patience pour obtenir des résultats durables, et mettre effectivement
les enfants à l'abri des problèmes liés à la non
réalisation de leurs droits. Et c'est là, justement, ce qui
semble poser problème aux organisations de protection sur le terrain.
Elles préfèrent les actions à résultats
immédiats pour contenter les donateurs dans leurs rapports. Or,
l'obtention de résultats rapides les amène à agir en
surface et laisser le mal qu'elles veulent guérir s'aggraver en
profondeur.
Dès lors, on est en droit de se poser la question de
savoir ce qui, réellement, importe. Est-ce la satisfaction des donateurs
au détriment de la résolution des problèmes sur le terrain
?
Notre position est claire, mieux vaut avoir des donateurs qui
vous permettent de résoudre un pan de votre problème, que d'avoir
des partenaires qui ne vous laissent pas prendre le temps et les mesures pour
régler, ne serait-ce qu'un pan de ce problème. Ceci est d'autant
valable pour le système des Nations Unies, les partenaires techniques et
financiers, que pour
les États « bénéficiaires »
dont les populations, dans le besoin, ne tirent presque rien des accords de
coopération. C'est donc à juste titre que Ban Ki-moon
déclarait que: «The true measure of the success for the United
Nations is not how much we promise, but how much we deliver for those who need
us most.»732
Mais au fond, l'Organisation les Nations Unies n'ignore pas le
malaise que posent les actions de ses organismes sur terrain. En effet, dans le
document final du sommet mondial à New York en 2005, les États
membres des Nations unies ont « reconnu la nécessité de
saisir l'occasion offerte par les réformes en cours pour assurer dans
les pays une présence des Nations Unies qui soit plus efficace et
cohérente et qui produise de meilleurs résultats. » 733
Dans ce contexte, un groupe « d'experts de haut niveau » a
été mis en place sous la coprésidence de trois premiers
ministres734 désignés par le SG. Suite au travail
accompli par le groupe des « experts de haut niveau », le rapport
intitulé Unis dans l'action ou One UN a
été transmis au SG des Nations Unies, Koffi Annan, le 9 novembre
2006735. Ce rapport a mis en évidence les forces et les
faiblesses du système des Nations Unies, et appelle à
d'audacieuses réformes qui sont incontournables si l'on veut que le
système des Nations Unies exécute ses mandats avec plus
d'efficacité et réagisse mieux face à l'aggravation des
problèmes existants et aux nouveaux qui surviennent736.
Ainsi, cinq recommandations ont été faites dans le
rapport :
- Cohérence et regroupement des activités
des Nations Unies à tous les niveaux (pays, régions,
sièges), conformément au principe de la prise en main des
programmes par les pays ;
732 « Ce n'est pas à ce que nous promettons que se
mesure notre réussite, mais à ce que nous faisons pour ceux qui
ont le plus besoin de nous. » (Traduction française des NU)
Déclaration de Ban Ki-moon à l'AG lors de son élection au
poste de Secrétaire général des Nations Unies.
733 Extrait de la note du Secrétaire
général de Nations Unies, Koffi Annan, v.Doc Nations Unies,
Assemblée Générale, A/6/583 du 20 novembre 2006, p.1.
734 Les trois premiers ministres désignés
étaient : celui de la Norvège, Jens Stoltenberg ; celui du
Mozambique, Luísa Dias Diogo et le celui du Pakistan, Shaukat Aziz. Le
« groupe de Hauts experts » étaient composé d'anciens
Présidents et chefs de gouvernement, de responsable d'agences et
d'organismes de développement, etc.
735 V. le rapport: «Delivering'as One. Report of the
Secrettary-General's High-Level Panel», disponible sur le site des
Nations Unies
http://www.un.org/events/panel/resources/pdfs/HLP-SWC-FinalReport.pdf
( consulté le 10 juillet 2015).
736 V. lettre des coprésidents du « groupe de haut
niveau ». Doc. Doc Nations Unies, Assemblée Générale,
A/6/583 du 20 novembre 2006, p.6.
280
- Création de mécanismes appropriés
de gouvernance, de gestion et de financement rendant possible et facilitant ce
regroupement, et subordination du financement des organismes à
l'efficacité de leur action et à leurs réalisations
,
·
- Révision complète des pratiques de
fonctionnement, visant à centrer l'attention sur les effets
escomptés, l'adaptation aux besoins et la production de
résultats, le tout mesuré à l'aune de la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement ,
·
- Recherche d'autres possibilités
intéressantes concernant le regroupement des activités et
l'application effective du principe de l'unité d'action, grâce
à une étude approfondie de la question ,
·
- Passage à l'action sans retard, mais non à
la hâte ou sans préparation, sans quoi les changements
risqueraient de ne pas être réels et de ne pas durer. 737
Mais où en est-on aujourd'hui, neuf (9) ans
après ce rapport avec le projet One UN ? Une chose est
certaine, il n'est pas encore effectif en Côte d'Ivoire.
A côté des institutions
spécialisées onusiennes, les organisations de la
société civile sont devenues une partie indispensable du
système non juridictionnel de protection des droits de l'enfant dans le
territoire des Etats parties. En Côte d'Ivoire, ces organisations de la
société civile apparaissent comme des acteurs volontaires et
solidaires malgré la précarité de leurs moyens.
§ 2. LES INSTITUTIONS DE LA SOCIETE
CIVILE
Selon ABEGA (S.C), la société civile est la
fraction de la société globale située en dehors des
structures de l'Etat et agissant à travers les structures de types
associatives, coopératives ou associations de défense des droits
et des intérêts, hors du cadre des partis
politiques738. En matière de promotion, de protection et de
mise en oeuvre des droits de l'enfant, les acteurs de la société
civile, notamment les ONG jouent un rôle particulièrement
important. Les limites inhérentes à l'action étatique en
matière de protection des droits des personnes justifient à elles
seules le bien fondé des actions des organismes privés qui
entendent suppléer et compléter les activités humanitaires
de l'Etat ou dénoncer les aspects nocifs de
737 Doc. UN, op cit. p.9.
738 Voir ABEGA (S.C), cité par BOUKOUNGOU (J.D.),
« Prolégomènes sur la contribution de la
société civile à la promotion de la dignité humaine
au Cameroun », Cahier africain des droits de l'homme n°8,
Dynamiques citoyennes et dignité humaine en Afrique centrale, Presses de
l'UCAC, 2002, p.19.
281
telles activités739. Dans un sens pratique,
la création d'organisations privées de défense des droits
de l'homme s'inscrit dans l'idée de combler une lacune inhérente
à l'action étatique. Le manifeste de la Charte 77740
est, à cet égard, évocateur : les signataires de la Charte
font remarquer qu'il existe une responsabilité des organes
étatiques mais aussi une responsabilité partagée par
chaque individu pour faire respecter les engagements relatifs aux droits de
l'homme ; après quoi, ils déduisent : « c'est le
sentiment de cette coresponsabilité, la croyance en la valeur de
l'engagement civique..., ainsi que le besoin de lui donner une nouvelle
expression, plus efficace, qui nous ont amenés à l'idée de
créer la Charte77 »741.
En Côte d'Ivoire, les associations sont régies
par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Les
associations ou organisations non gouvernementales (ONG) oeuvrant dans le
domaine des droits de l'enfant peuvent se focaliser soit sur les droits de
l'homme en général, soit sur les droits de l'enfant, soit une
question particulière relative aux droits de l'enfant telle que le droit
la santé ou à l'éducation. Elles peuvent être
locales, nationales, régionales ou internationales à la fois en
termes de focalisation, mais aussi de leur structure et de leur
présence742. Leur travail et leur dévouement à
la cause ont reçu beaucoup d'éloges, elles ont été
nommées « le porte-parole de la conscience du monde
»743.
Comme dans toutes les sociétés en crise, on
observe en Côte d'Ivoire une inflation des associations de promotion et
de protection des droits de l'enfant. Pour mieux saisir leurs actions, il
importe de préciser le rôle indispensable des ONG (A),
d'une part, avant de mettre en lumière les limites
afférentes à leurs actions (B), d'autre
part.
739 MELEDJE (D.), La contribution des organisations non
gouvernementales à la sauvegarde des droits de l'homme,
Thèse de doctorat d'Etat en droit public, Université d'Amiens,
1987, p.25.
740 La Charte 77 est une ONG créée en
Tchécoslovaquie en 1977. Sur les conditions de sa formation.
741 Text of the Charter 77 Manifesto. Vanderbilt Journal of
transnational law. Vol. 13, 1980. P.650 ( traduction non officielle); MELEDJE
(D.), La contribution des organisations non gouvernementales à la
sauvegarde des droits de l'homme, Thèse de doctorat d'Etat en droit
public, Université d'Amiens, 1987, pp.186-188.
742 Victor CONDE (H.), Handbook of international Human
Rights Terminology, University of Nebraska Press, 2e ed. , 2004, p.175.
743 CASSESSE (A.), Human Rights in a changing world,
Temple Univ Pr , December 1990, p.173.
282
A. UN ROLE INDISPENSABLE DES ONG
Les Organisations non gouvernementales (ONG)744
opèrent sous différents mandats et se focalisent sur un large
éventail de différentes questions. Leur taille varie de quelques
personnes à des opérations internationales majeures et elles
emploient différents types de professionnels. Elles travaillent sur un
niveau international, régional, national ou local. De façon
générale, il existe de nombreux moyens pour les organisations non
gouvernementales et autres membres de la société civile de
s'engager et de soutenir d'autres systèmes mondiaux, régionaux et
nationaux de suivi et d'application des droits de l'enfant. Ces derniers
incluent : «
- La promotion du développement de l'adoption et de la
ratification des traités ;
- La pression auprès des Etats afin qu'ils mettent en
oeuvre les obligations imposées par le traité ;
- La surveillance de la conformité des Etats concernant
leurs obligations ;
- La soumission d'informations et de rapports écrits
aux organes de la charte des traités internationaux et régionaux
;
- La participation et la contribution aux sessions des organes
de la charte et des traités internationaux et régionaux, le cas
échéant ;
- La soumission de plaintes individuelles aux organes de
traités, au Conseil des droits de l'homme et aux cours régionales
des droits de l'homme ;
- L'éducation des individus concernant leurs droits
humains ;
- Attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme
et de couvrir de honte les pays afin qu'ils prennent des mesures ;
- La mobilisation de soutien pour l'application des droits de
l'homme745. »
744 A propos du rôle des ONG en matière de droits
humains, lire : MELEDJE (D.), La contribution des organisations non
gouvernementales à la sauvegarde des droits de l'homme,
Thèse de doctorat d'Etat en droit public, Université d'Amiens,
1987, 556p.
745 JESSICA (C.), LAWRENCE (J.C.), Les droits de
l'homme, Harvey J.Langholtz , Peace operations trainig institute,
Williamsburg, 2014, p.137.
283
En Côte d'Ivoire, les actions menées par les ONG
peuvent être classées en trois groupes. Tout d'abord, la
sensibilisation et le plaidoyer, ensuite l'assistance juridique et enfin
l'assistance matérielle et psychologique.
1. La sensibilisation
La sensibilisation représente l'une des
activités prépondérantes des ONG en matière de
lutte contre le phénomène de la violence à l'égard
des enfants. Les activités consistent en des causeries,
conférences, des émissions radiophoniques. Des campagnes
intensives concentrées sur une période donnée sont
également réalisées.
Une attention est également accordée à la
production d'outils et de supports divers tels que les affiches, les
dépliants, les sketches sur cassettes vidéos et sur cassettes
audio. Des scénettes, des sketches et des pièces de
théâtre sont présentés dans divers milieux pour
traiter publiquement de la question de la violence, susciter le débat
dans le but d'exhorter les victimes à dénoncer les actes de
violences et à rechercher de l'aide et d'amener les différents
acteurs par lesquels passe une solution au problème, à prendre
leurs responsabilités. Des réformes à cet effet sont
exigées de la part des autorités nationales.
En Côte d'Ivoire, les organisations non gouvernementales
sont de plus en plus sollicitées par les services gouvernementaux en
charge de la promotion des droits de l'enfant. Elles interviennent en
qualité d'experts et de techniciens et sont parfois
intégrées à des comités de lutte contre certaines
formes de violences faites aux droits de l'enfant. Par exemple, la coalition
ivoirienne pour les droits de l'enfant qui comprend des ONG de promotion de
l'enfance est membre du Comité national de lutte contre le travail des
enfants. La présence d'une coalition des organisations de la
société dans ce comité lui permet d'atteindre et de
mobiliser plus facilement les populations.
Par souci d'efficacité, comme c'est le cas en
matière d'excision, les ONG associent parfois aux activités de
sensibilisation, un appui pour la réalisation d'activités
génératrices de revenus. Ainsi, l'action de certaines ONG a
permis la reconversion d'une centaine d'exciseuses dans les activités
génératrices de revenus telles que le tissage, la teinture, la
poterie, la fabrication de briques cuites et l'aviculture. Par leurs pressions,
les associations peuvent pousser le Gouvernement à initier et faire
adopter une législation beaucoup plus
284
protectrice des droits de l'enfant746. Elles ont
remporté de nombreuses grandes victoires ; par exemple, la convention
2006 relative aux droits des personnes handicapées, résulte
principalement du lobbying des ONG. Cette importante augmentation du pouvoir et
de la présence des ONG a conduit les observateurs à parler de
deux dernières décennies comme le début d'une «
révolution du plaidoyer »747.
2. L'assistance juridique
La Commission Internationale de Juristes (CIJ) définit
l'assistance juridique748, les services juridiques ou encore les
cliniques juridiques comme étant « des dispensaires de services
juridiques à l'instar des dispensaires de santé publique. Ils
dispensent une instruction juridique, ...informent les populations de leurs
droits et leur montrent comment elles peuvent les faire valoir et les garantir
». En Afrique, cette activité a démarré à
titre expérimental à Dakar à l' l'initiative de la
CIJ749. Elle consistait en la formation de para juristes qui sont
des personnes qui vulgarisent le droit dans leur communauté. Devant le
succès enregistré par cette démarche, de nombreuses ONG de
différents pays ont adopté la méthode et l'ont
centrée sur la problématique des droits de l'enfant.
Concrètement, les cliniques ou services juridiques sont
des lieux où les enfants peuvent trouver des spécialistes du
droit qui leur donnent des conseils juridiques, les assistent et font des
médiations en vue de résoudre les problèmes auxquels elles
sont quotidiennement confrontées.
Des exemples tirés de l'expérience des centres
d'assistance juridiques démontrent que les enfants victimes de violences
consultent peu ces centres pour y chercher une solution. L'essentiel des
activités d'assistance juridique consiste à écouter les
plaignants, à les informer du contenu de la législation et des
recours dont elles disposent, à les introduire au besoin devant les
tribunaux par la rédaction d'une requête ou d'une plainte et
à suivre leur
746 Il y a eu lieu de mentionner le rôle
éminemment déterminant des ONG dans l'élaboration, la
signature et la ratification de la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant.
747 IGNATIEFF (M.), « Human Rights as Politics »,
In. Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (2001),
p.8.
748 Pour plus d'infos sur l'assistance juridique
adaptée aux enfants, lire avec intérêt, Unicef, Undoc,
l'assistance juridique adaptée aux enfants en Afrique,
Juin 2011 disponible sur
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison
(consulté le 23 octobre 2015).
749 https://www.icj.org/ (consulté le 18 septembre
2015).
285
dossier. Certaines ONG comme l'Organisation Nationale pour
l'enfant, la femme et la famille (Onef) 750 organisent des
consultations mobiles et sillonnent le pays pour apporter l'information et le
conseil juridique aux enfants. Dans l'ensemble des pays, ces prestations sont
gratuites. Cependant, dans certaines localités du pays, l'assistance
juridique commence à être rémunérée de
façon très modique. Ces associations aident également les
enfants à se faire établir des certificats de
nationalité751 et, à la demande des victimes, invitent
les personnes violentes à l'égard des enfants pour leur exposer
la loi et discuter avec eux pour arrêter les violations et abus des
droits de l'enfant.
3. L'assistance psychologique et
matérielle
La prise en charge psychologique et matérielle des
enfants en difficulté est un volet important de la lutte contre les
violences car il convient d'éloigner les enfants victimes et leur
domicile et de les aider à reprendre confiance en eux-mêmes. Des
centres d'accueil existent à cet effet pour héberger les enfants
accusés de sorcellerie, les jeunes filles victimes de mariages
précoces ou de violences conjugales. Certains centres comme ceux du
Centre espoir de Grand-Bassam, créé par l'association Enfance
Meurtrie Sans Frontières (EMSF)752, offrent en plus de
l'hébergement, une prise en charge psychologique, médicale,
alimentaire et scolaire aux enfants. Il en va de même de l'ONG
Dignité et Droits de l'enfant en Côte d'Ivoire
(DDECI)753. Cette organisation mène de nombreuses
activités, dans le cadre de la protection des enfants handicapés
et des enfants en conflit avec la loi. Les enfants handicapés
bénéficient d'un centre de rééducation
appelé Centre d'Eveil et de Stimulation des Enfants Handicapés
(CESEH) tandis que de nombreuses autres interventions de DDECI aboutit à
la libération de nombreux enfants souvent incarcérés
à la brigade de protection des mineurs ou au centre d'observation des
mineurs (COM). Cette ONG rédige souvent des projets de propositions de
lois qu'elle soumet à certains parlementaires.
750
http://www.onef-riof.org/executes.html
(consulté le 18 septembre 2015).
751 L'importance du certificat de nationalité
réside dans le fait qu'il est un moyen de preuve de possession de la
nationalité ivoirienne : Voir Articles 97, 98, 99 et 100 de la Loi
n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant code
de la nationalité ivoirienne.
752 Pour plus de détails sur EMSF, voir
http://www.emsf.org/(consulté
le 21/11/2017).
753
http://bice.org/fr/dde-ci/
(consulté le 21/11/2017).
286
Pour renforcer les capacités de leurs membres à
assumer ces différents types d'assistance, certains réseaux ou
ONG organisent à leur intention des formations ou mettent à leur
disposition des outils pouvant les guider dans l'exercice de leurs
activités. On citera ici, l'exemple du guide de prise en charge des
enfants victimes de violences, réalisé par le BICE.
Comme on le voit, les actions des organisations non
gouvernementales représentent sans aucun doute une contribution
importante à la lutte pour une effectivité optimale des droits de
l'enfant en Côte d'Ivoire. Toutefois, plusieurs tares ou limites
caractérisant l'action de ces ONG méritent d'être mis en
lumière.
B. LES LIMITES DE CES ACTIONS
L'observation des ONG offre de constater, qu'il s'agit pour la
plupart d'entre elles, d'organisations matériellement pauvres et
dépendantes (1) mal organisées du point de vue administratif et
financier (2) diversifiées ou cacophoniques (3)
concentrées à Abidjan (1) avec une inégale
répartition géographique et un déficit de ressources
humaines qualifiées (4).
1. Des organisations pauvres et
dépendantes
A l'instar des ONG africaines, la première limite des
ONG ivoiriennes est liée au contexte socio-économique que
connaît beaucoup de pays africains depuis des années, à
savoir la pauvreté754. Celle-ci est manifestement le premier
goulot d'étranglement des ONG. Plus concrètement, à
l'exception de celui de leurs dirigeants, les ONG d'origine nationale sont
incapables d'afficher des moyens capables de les rendre crédibles, et
crédibiliser derechef, leurs actions et leur
représentativité755. Pour être matérielle
et financière, cette pauvreté perceptible jusqu'aux structures
d'organisation (bâtiments abritant les sièges, matériels de
bureaux adéquats, moyens de transport rapides et efficaces...) constitue
la première limite et en même temps, le premier obstacle au
développement respectable des ONG ivoiriennes. Il en résulte que
les ONG ivoiriennes, fonctionnant dans ce contexte de pauvreté
généralisée,
754 NGONDANKOY NKOY-EA-LOONGYA, Droit congolais des droits
de l'homme, Academiia Bruylant,, 2004, p.327.
755 Ibidem.
287
ne peuvent échapper ni à la corruption, ni a
fortiori, à l'aliénation de leur propre
indépendance.
La conséquence immédiate de cette
pauvreté affectant les ONG est que la plupart de ces ONG, sinon toutes,
reçoivent l'essentiel de leur financement de l'extérieur ;
l'extérieur renvoyant ici soit au Gouvernement ou aux bailleurs de fonds
extérieurs. On voit ainsi la plupart de ces ONG sillonner les capitales
occidentales ou inonder les administrations des « partenaires
» extérieurs de différentes demandes d'interventions
financières qui, pour organiser une « session de formation
», qui pour tenir une simple « conférence de presse
», qui parfois, pour vilipender le Gouvernement en
place756.
Bien que leurs démarches ne soient pas en principe
condamnables, il faut cependant craindre une certaine perte
d'indépendance, d'impartialité et de dignité de la part de
ces représentants de la société civile du fait
précisément de ces demandes extérieures757. En
dehors de cette situation de dépendance et de pauvreté, ces
associations se présentent également comme des structures ayant
une organisation administrative et financière aléatoire.
2. Des associations à organisation administrative
et financière aléatoire
Sauf quelques exceptions confirmant la règle, la
plupart des ONG de défense des enfants accusent également des
carences criantes au niveau de leur organisation administrative et
financière. La plupart de leurs bailleurs extérieurs
n'hésitent pas, du reste, à le leur rappeler ou, même,
à en faire une véritable condition d'octroi
d'aide758.
Peu ou certaines seulement des ONG disposent, en Côte
d'Ivoire, de sièges administratifs identifiables (un siège
véritable, une adresse postale, des coordonnées
téléphoniques ou électroniques fiables, un compte en
banque lisible, etc.). Peu ou certaines seulement font
756 NGONDANKOY NKOY-EA-LOONGYA, Droit congolais des droits
de l'homme, Academia Bruylant,, 2004, p.328.
757 NGONDANKOY NKOY-EA-LOONGYA, Droit congolais des droits
de l'homme, Academiia Bruylant,, 2004, p.328.
758 NGONDANKOY NKOY-EA-LOONGYA, Droit congolais des droits
de l'homme, Academia Bruylant,, 2004, p.328.
288
preuve d'une pratique saine et courante de tenue et de
reddition des comptes. Bref, on assiste à une organisation
administrative et financière encore embryonnaire759.
Il en résulte un manque de confiance et de
crédibilité certain de ces ONG ivoiriennes aux yeux, notamment,
de certains « partenaires » officiels et de leurs bailleurs de fonds
étrangers760.
Pour certaines associations, l'enfant devient comme un
élément clé d'un fonds de commerce, qui de par l'empathie
qu'il inspire, sert à séduire les donateurs
généreux au bénéfice quasi exclusif des fondateurs
desdites associations. Les enfants servent de décor ou d'appât
qu'on enlève aussitôt le bailleur de fonds parti. Certaines de ces
associations officiellement sans but lucratif battent monnaie avec la
misère des enfants qu'elles prétendent défendre et
protéger, ce qui assure à leur personnel un certain niveau de vie
: rémunération, emplois pour leurs proches, moyens de
déplacement, missions à l'étranger... exploitant ainsi
sans vergogne les associations prétendument fondées pour le bien
des enfants à des fins mercantiles.
C'est entre autres, pour cette raison, qu'on n'observe pas
assez d'amélioration sensible des conditions de vie en
général et de l'enfant, en dépit du nombre impressionnant
d'associations qui prétendent exister pour le seul intérêt
de l'enfant. Une autre limite de ces associations réside dans le fait
qu'elles se présentent comme des structures non
spécialisées et cacophoniques manquant de coordination.
3. Des structures non spécialisées et
cacophoniques manquant de coordination
Le manque de coordination, et la non spécialisation des
actions des ONG de protection des droits de l'enfant, limite
l'efficacité de leurs actions. En effet, en Côte d'Ivoire, comme
dans divers autre pays africains, aucune initiative véritable n'est
prise en vue de rationaliser, de fédérer ou d'organiser une
complémentarité entre les efforts et activités des
diverses ONG en la matière. Les actions restent donc pour la plupart
éparses et parcellaires, en l'absence de concertation pour créer
un cadre de travail permettant une synergie efficace et un impact minimum.
759 Ibid.
760 NGONDANKOY NKOY-EA-LOONGYA, Droit congolais des droits
de l'homme, Academia Bruylant,, 2004, p.328.
289
Si l'on s'en tient uniquement à leur nombre important,
on est frappé par un déséquilibre criant entre les
associations qui ont pour objet la protection générale des droits
de l'enfant et celles ayant un domaine d'intervention spécifique. Ainsi
par exemple, parmi la multitude d'associations dont l'objet social est la
défense et la protection des droits de l'enfant, rares sont celles qui
s'occupent exclusivement de la défense des droits des mineurs en conflit
avec la loi ou du droit à l'éducation ou encore tout autre droit
particulier considéré.
La conséquence en est que nombre d'entre elles vont
mener les activités au profit des mêmes enfants.
L'absence de spécialisation des associations dans leurs
activités compromet ainsi gravement leur efficacité et leur
rentabilité.
Pour mieux remplir leurs missions de défense et de
promotion des droits de l'enfant, ces associations devraient « s'associer
» elles-mêmes en collectifs, recadrer leur mode d'intervention afin
de ne pas disperser leurs efforts, ce qui leur permettrait de faire face au
travail combien immense de la défense des droits de l'enfant, car «
l'union fait la force ».
Pire, la nébuleuse des ONG présente sur la
scène sociale et politique du pays fait que la plupart d'entre elles, au
lieu d'axer leurs actions sur la défense réelle des
intérêts de la population, passent le clair de leur temps,
à se combattre ou à « se mettre les bâtons dans les
roues ». D'autres vont jusqu'à se disputer les faveurs des
bailleurs ou à vouloir exercer un certain leadership politique sur les
autres.
Cette situation a rongé la crédibilité de
ces associations, à l'instar du déficit de personnel
qualifié et de la forte concentration dans la capitale économique
du pays.
4. De l'insuffisance du personnel qualifié
à une forte concentration des activités des ONGs à
Abidjan
L'insuffisance du personnel qualifié est
également un problème auquel font face les Ong761.
Ainsi par exemple, certaines ONG, dont l'action d'assistance juridique est
d'envergure nationale, ne dispose que de bénévoles. Selon Ferrand
BECHMAN, « Est bénévole, toute action qui ne comporte
pas de rétribution financière et s'exerce sans
761 HERVE (E.), Contraintes et pouvoir des ONG
contemporaines, Mémoire de recherche Institut
d'Études Politiques de Toulouse, 2010, pp.21-24.
290
contrainte sociale ni sanction sur celui qui ne
l'accomplit pas ; c'est une action dirigée vers autrui ou vers la
communauté avec la volonté de faire le bien, d'avoir une action
conforme à de nombreuses valeurs sociétales ici et maintenant
»762 . Or, le bénévolat apparait comme une
limite en matière de ressources humaines, les bénévoles
n'ayant souvent pas une disponibilité suffisante en marge de leur
activité professionnelle. Certaines ONG disposent de personnes n'ayant
souvent aucune compétence ou qualification en matière de droits
humains ou droits de l'enfant. Cette absence de professionnalisme retentit,
logiquement sur l'efficacité des ONG de défense des droits de
l'Homme763. Ainsi pour le Professeur Martin BLEOU, la LIDHO, qui
n'échappe pas à ce triste constat, doit « se renouveler
en passant de l'amateurisme au professionnalisme (...). Cela signifie que la
LIDHO doit recruter du personnel permanent et techniquement qualifié,
qui doit, à partir des instructions reçues du Bureau
Exécutif National, préparer les dossiers, assurer le
fonctionnement de la ligue au quotidien, prendre des initiatives, mener une
politique agressive dans le sens d'un mieux-être des droits en Côte
d'Ivoire »764.Pire, certains ne font aucun effort pour
renforcer leurs compétences en la matière ; la conséquence
est que souvent leurs interlocuteurs sont surpris du manque criard de
connaissances dans le domaine prétendument donné comme celle
justifiant l'existence de l'ONG.
Une autre limite de l'action des ONG réside
également dans la faible couverture géographique des actions
menées. On observe ainsi que ces ONG locales et internationales
s'implantent quasi systématiquement à Abidjan, même si leur
compétence s'étend théoriquement à tout le pays ;
ce qui, à n'en point douter, handicape leur efficacité : la
plupart d'entre elles, étant ainsi loin de leurs nombreux
bénéficiaires. Nous pensons que ces associations serviraient
davantage la cause de l'enfant si elles étaient présentes sur
toute l'étendue du pays, ce qui leur permettrait d'intervenir en faveur
de l'enfant en temps réel.
Faute de s'implanter de façon pérenne en
province, elles devraient se déployer selon un calendrier
préétabli et connu de la population et des services judiciaires
pour faciliter l'accès des enfants à leurs services. A ce sujet,
la méthode d'Avocats sans frontières mérite
d'être
762 BECHMAN (F.), Bénévolat et solidarité,
Paris, Syros, Alternatives, 1992, p.35.
763 KOFFI KONAN (E.), Les droits de l'Homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Tome 2, Thèse de doctorat-Université de
Cocody 2008, p.299.
764 Voir Martin BLLEOU, Allocution prononcée à
la cérémonie d'ouverture du 4e congrès
ordinaire de la LIDHO.
291
292
soulignée. Cette ONG internationale de droit belge
organise des consultations juridiques à l'intérieur des pays
où elle intervient, à travers ce qu'elle appelle la «
boutique du droit » et à des endroits et selon le
calendrier préalablement annoncés.
Bref, les caractéristiques fondamentales des ONG
contribuent de beaucoup dans le faible développement du mouvement et
dans sa décrédibilisation. Comment, ne pas dès lors,
déplorer son manque de puissance et d'efficacité !
Toutefois, en dépit de ce tableau peu reluisant, il
faut avouer que la contribution des ONG ivoiriennes et internationales,
notamment dans le domaine de l'éducation civique de la conscientisation
des populations et des enfants, de la défense de leurs droits, de prise
en charge matérielle des enfants ainsi que dans l'avancement du
processus de démocratisation, est, objectivement indéniable. Il
reste cependant à rationaliser le mouvement et à coordonner les
actions en vue des meilleurs résultats, d'une certaine cohérence
dans l'action, de lisibilité des interventions et de
crédibilité des ONG nationales vis-à-vis de
l'extérieur.
Tels sont les gages premiers de l'efficacité de ces
mécanismes dans la défense des droits de l'enfant.
Le rôle d'appui des institutions internationales et
privées ainsi analysé, il importe d'examiner le rôle des
organes de contrôle qui apparaît incontestablement
mitigé.
SECTION II. LE ROLE MITIGE DES ORGANES DE CONTROLE
Il serait vain de les énumérer tous ici. Il
importe, sans risque de s'égarer, d'insister, sur les organes qui nous
paraissent le mieux à même d'assurer un contrôle idoine et
effectif des droits de l'enfant aussi bien au niveau universel qu'africain..
Pour appréhender au mieux leur rôle, il convient de
détacher les garanties quasi-juridictionnelles peu sollicitées
(Paragraphe 1) des garanties judiciaires peu exploitées
(Paragraphe 2).
§ 1. DES GARANTIES QUASI-JURIDICTIONNELLES PEU
SOLLICITEES
La protection quasi-juridictionnelle internationale de
l'enfant en Côte d'Ivoire est dévolue aux organes
dédiés à cet effet tant au niveau universel que
régional. De façon générale,
institués par des traités, les organes
intervenant dans le domaine des droits de l'homme au niveau universel sont au
nombre de neuf765, contre un nombre plus restreint au niveau
régional africain. Les mécanismes de mise en oeuvre et de
surveillance peuvent être classés en deux catégories
fondamentales, l'une conventionnelle et l'autre extra conventionnelle. Les
mécanismes extra conventionnels sont constitués des
différents rapporteurs spéciaux, les experts indépendants
et groupes de travail crées par des commissions des droits de l'homme et
repris par le conseil des droits de l'homme. Dans cette partie, il s'agira
d'étudier certains mécanismes conventionnels chargés de
suivre l'application des traités par les Etats parties et veiller
à leur respect. Concernant le contrôle des droits de l'enfant, ce
sont les articles 44 et 32 respectivement de la CIDE et de la CADBE qui
instituent ces organes de surveillance. Il y a plusieurs méthodes de
contrôle qui sont adoptées, celles des rapports étatiques
et de la procédure individuelle qui donnent aux organes de
contrôle le pouvoir de mener des investigations. Si la plupart des Etats
sont peu ou prou respectueux des procédures élaborées par
ces organes non juridictionnels, tel n'est pas le cas pour le Côte
d'Ivoire qui brille par l'irrégularité des recours à ces
organes (A) accentuée par leur inefficacité
(B).
A. L'IRREGULARITE DES RECOURS
La Côte d'Ivoire étant partie aux instruments
tels la CIDE, la CADBE, elle doit soumettre à cet effet un rapport selon
les procédures élaborées par chaque organe de
contrôle. Aussi, ces organes sont compétents pour se prononcer sur
d'éventuelles plaintes individuelles ou étatiques.
Cependant, l'absence de la Côte d'Ivoire, au jeu de
contrôle international entraine la quasi inexistence du recours universel
(1) et l'inertie du recours africain (2).
765
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
Le Comité des droits de l'homme (CCPR), Le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (CESCR), Le Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale (CERD) ,Le Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
(CEDAW) Le Comité contre la torture (CAT), le Sous-Comité pour la
prévention de la torture (SPT), Le Comité des droits de l'enfant
(CRC) , Le Comité des travailleurs migrants (CMW), le Comité des
droits des personnes handicapées (CRPD, le Comité des
disparitions forcées (CED).
293
1. La quasi inexistence du recours universel
Cette quasi inexistence du recours se traduit par le retard
excessif de la Côte d'Ivoire dans la soumission de rapports
périodiques et de la non ratification du troisième protocole
relatif à la présentation des communications.
- Le retard excessif des rapports
périodiques
La ratification de la CIDE et de ces deux premiers protocoles
engage l'État partie à soumettre un rapport au Comité des
droits de l'enfant766, d'abord dans les deux premières
années qui suivent la ratification des normes (rapports initiaux), et
ensuite tous les cinq ans (rapports périodiques). Ainsi, tous les
États, exception faite des USA et de le Somalie, doivent
présenter au Comité des droits de l'enfant un rapport initial,
deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention et ensuite
tous les cinq ans, un rapport périodique.
Deux documents ont été élaborés
par le Comité dans le cadre de la présentation des rapports : Les
Directives générales concernant la forme et le contenu des
rapports initiaux767 et les Directives générales pour
les rapports périodiques768.
À travers les Directives générales
concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, le Comité des
droits de l'enfant explique l'importance et la finalité de la
présentation de rapports par les États parties sans oublier les
informations attendues par le Comité dans le rapport initial. Tous les
droits de la CIDE doivent être pris en compte dans le rapport, mais le
Comité les a regroupés en sept (07) en points :
- Les mesures d'application générales ;
- La définition de l'enfant ;
- Les libertés et droits civils ;
- Le milieu familial et la protection de remplacement ;
- La santé et le bien-être ;
- L'éducation, les loisirs et les activités
culturelles ;
766 Art. 44 de la CIDE, art. 12 du Protocole facultatif
relatif à la vente des enfants et art. 8 du Protocole facultatif relatif
à l'implication des enfants dans les conflits armés.
767 Doc. Nations Unies, CRC/C/5 du 30 octobre 1991, 8 p.
768 Doc. Nations Unies, CRC/C/58 du 20 novembre 1996, 51 p.
294
- Les mesures spéciales de protection de l'enfance.
Des informations concernant le cadre législatif, les
données statistiques, les mesures prises ou à envisager pour le
respect de la CIDE, etc.769sont aussi contenues dans les
Directives.
En ce qui concerne les Directives générales pour
les rapports périodiques, le même regroupement des droits de
l'enfant, en sept points, a été effectué. Ce qui nous
amène à en déduire que c'est le modèle à
suivre pour la présentation des rapports étatiques au niveau du
Comité. Ceci étant, le document relatif à la
présentation des rapports étatiques est beaucoup plus
détaillé et plus volumineux (51 Pages) que celui des rapports
initiaux (08 pages). Pour cause, il est plus explicite sur les points
spécifiques qui doivent être abordés par les États
dans les rapports. Ainsi par exemple, il est demandé aux États de
fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux
Observations finales du Comité à l'étude d'un
précédent rapport soumis par l'État770.
Il ressort de ces deux documents, que le Comité des
droits de l'enfant, a mis en place le canevas pouvant lui permettre de
recueillir des informations à même de l'amener à pouvoir
évaluer la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.
Mais ce cadre de déroulement du suivi de mise en oeuvre de la CIDE
semble insuffisant pour assurer une protection effective des enfants dans les
États, qui n'avaient pas un système protecteur des droits de
l'enfant avant leur engagement à la Convention.
Il pèse sur chaque Etat partie à la CIDE, une
obligation de présenter des rapports conformément à ces
modèles. Cette obligation contenue dans l'article 44 alinéa 1 de
la CIDE oblige les Etats parties à soumettre au comité des «
rapports sur des mesures prises qu'ils auraient adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente convention ». La
Convention est entrée en vigueur le 2 septembre 1990,
conformément au paragraphe 1er de son article
49.771 Ayant ratifié la CIDE en date du 4 février
1991, le dépôt du rapport initial de ce pays, était
prévu pour le 05 mars 1993. Mais force est de constater que celle-ci a
attendu six (6) ans pour soumettre son rapport initial, c'est-à-dire le
22 janvier 1999. Depuis le dépôt
769 Cf. doc. Nations Unies, CRC/C/5, op.cit. Pour plus de
détails sur chaque rubrique.
770 Cf. point 6 du document portant directives.
771 Il ressort du paragraphe 1er de l'art.49 que la
Convention entre en vigueur trente jours après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
295
de son rapport initial, la Côte d'Ivoire n'a pas
veillé au dépôt constant de ses rapports
périodiques. La Côte d'Ivoire a de sérieux retard dans la
production de rapports périodiques au Comité des Droits de
l'Enfant. Le retard accumulé par la Côte d'Ivoire est le
dépôt de 3 rapports périodiques mais elle a la
possibilité de compiler ses rapports. Le rapport prévu pour 2005
a été déposé en 2014. Ce retard excessif de la
Côte d'Ivoire limite les actions du Comité des droits de l'enfant
dans le cadre de la protection des enfants vivant en Côte d'Ivoire. Ce
retard des États dans la transmission des rapports entraine ipso
facto le retard dans l'examen des rapports par le Comité. La
Côte d'Ivoire n'est pas le seul Etat à être
irrégulier dans ce domaine. En effet, si nous prenons par exemple le cas
du Bénin, qui devrait soumettre son rapport initial en 1992, il y a lieu
de constater que ce rapport n'a été transmis que le 22 janvier
1997772 . Pour ce qui est du rapport périodique devant
être soumis en 1997, il ne l'a été que le 20 avril
2005.773 Outre les retards de transmission des rapports par les
États, le Comité des droits de l'enfant peine à
étudier les rapports à temps. Selon le rapport 2012 du
Comité774, les difficultés liées à
l'examen des rapports ont été mentionnées. Ainsi
pouvons-nous lire aux paragraphes 40, 41 et 42 dudit rapport que, suite aux
difficultés liées à l'examen des rapports, le
Comité avait demandé, en 2008, à l'Assemblée
générale de l'ONU, l'autorisation de se réunir en deux
chambres pendant quatre sessions775. L'autorisation reçue
avait permis, selon le rapport, d'accélérer l'examen des rapports
pour réduire le nombre de rapports en souffrance. Mais depuis la fin des
deux chambres lors des sessions, en 2010, le Comité craint que le nombre
de rapports en souffrance ne s'accentue.776
Cette situation met en évidence les difficultés
du Comité à jouer efficacement son rôle d'examen des
rapports des États parties à la CIDE. Ce qui, si la situation
perdure, pourrait avoir un impact négatif profond sur le respect des
obligations conformément à l'article 44 de la CIDE.
De ce qui précède, il résulte que
l'Assemblée générale prenne des mesures qui s'imposent
pour donner au Comité, les moyens pour jouer efficacement son rôle
en matière d'examen
772 Voir doc. Nations Unies, CRC/C/3/Add.25 du 4 juillet 1997.
773 Voir doc. Nation Unies, CRC/C/BEN/2 du 24 novembre 2005.
774 Doc. Nations Unies, A/67/41, New York, 2012, 59 p.
775 Para.40 rapport 2012 CRC.
776 Para.41 rapport 2012 CRC.
296
des rapports. Ne pas le faire s'apparenterait à un
encouragement aux États à ne pas prendre au sérieux le
rôle du Comité sur cette question très importante.
De même, la non ratification du troisième protocole
relatif à la présentation de communications individuelle et
étatique, constitue une cause d'inexistence du recours. - La
non ratification du troisième protocole relatif aux
communications
La non ratification du troisième protocole relatif aux
communications individuelles et étatiques explique aussi la quasi
inexistence du recours universel à l'égard des enfants victimes
de violations de leurs droits sur le territoire ivoirien. En effet, il n'y a
pas de disposition dans la CIDE, qui prévoit les procédures de
plaintes pour les individus. Les individus ne peuvent donc pas, en principe, en
cas de violations de leurs droits, déposer leurs plaintes auprès
du Comité onusien des droits de l'enfant. Cette carence a
été récemment corrigée avec l'adoption du Protocole
facultatif relatif aux droits de l'enfant établissant la
procédure de présentation des communications devant le
Comité des droits de l'enfant.
Adopté en date du 19 décembre 2011 par la
Résolution A/RES/66/138 de l'Assemblée générale des
Nations Unies777, le Protocole facultatif relatif aux droits de
l'enfant établissant la procédure de présentation des
communications devant le Comité des droits de l'enfant requérait,
pour son entrée en vigueur, dix (10) ratifications.778 Le 14
janvier 2014, avec la ratification de l'État du Costa Rica, le protocole
est entré en vigueur le 1er avril 2014.
Mais, il apparait intéressant d'examiner
concrètement les apports et les faiblesses de ce nouvel instrument dans
l'univers de la justiciabilité des droits de l'enfant au niveau de
l'ONU.
A travers ce troisième protocole, le Comité des
droits de l'enfant peut recevoir des communications, c'est-à-dire des
requêtes, individuelles779 et
interétatiques780 sur des cas de violations
présumées des droits reconnus dans la Convention des droits de
l'enfant et ses deux premiers Protocoles.
777 Cf. le site
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/138
(consulté le 15 novembre 2015)
778 Conformément à l'art. 19 alinéa 1 du
Protocole « Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt du dixième instrument de
ratification ou d'adhésion. ».
779 Articles et 5 et svts du Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant établissant une
procédure de présentation de communication.
780 Article 12 et svts du Protocole op.cit.
297
En effet, le Protocole facultatif n°3 de la CIDE, depuis
son entrée en vigueur, ouvre sans doute la voie de l'effectivité
de la justiciabilité des droits de l'enfant au niveau de l'ONU. Il est
le moyen par lequel les violations des droits de l'enfant par les parties
à la CIDE et ses deux premiers Protocoles facultatifs pourront faire
l'objet de recours auprès de l'organe de suivi et de mise en oeuvre
qu'est le Comité des droits de l'enfant. Au-delà de cet apport
important, l'élément primordial à la faveur des enfants,
est la possibilité qui leur est offerte de saisir directement, par une
requête, le Comité pour une violation supposée de leurs
droits reconnus par la Convention et ses deux premiers
Protocoles.781 C'est dire que, dans un avenir proche, il sera
possible d'avoir des décisions du Comité des droits de l'enfant,
statuant sur des questions de violations des droits de l'enfant par un
État partie aux normes concernées. Cependant, plusieurs
conditions draconiennes doivent être respectées pour que la
plainte soit considérée comme recevable :
- L'enfant ou ses représentants doivent
déjà avoir porté plainte devant une juridiction nationale.
Si elle n'a pas abouti, l'enfant pourra alors se tourner vers le Comité
;
- la plainte doit alors être déposée
devant le Comité dans l'année qui suit la fin de la
procédure devant la juridiction nationale ;
- la plainte ne doit pas être anonyme, ni
infondée et ne doit pas constituer un abus de droit ;
- la plainte doit être formulée par écrit.
De plus, l'enquête du Comité sur le territoire de l'Etat
présumé violateur dépend de l'accord de l'Etat
partie782.
Ces conditions limitent ainsi l'utilisation de ce recours,
notamment celle relative aux délais pour introduire la plainte devant le
Comité.
781 L'article 5 en son alinéa 1er ouvre voie
à des communications individuelles en disposant que :
« Des communications individuelles peuvent être
présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou
au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction
d'un Etat partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet
Etat partie de l'un quelconque des droits énoncés dans l'un
quelconque des instruments suivants auquel cet Etat est partie :
La Convention ;
Le Protocole facultatif à la Convention, concernant
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants ;
Le Protocole facultatif à la Convention, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés. ».
782 Article paragraphe 2 du Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant établissant une
procédure de présentation de communications.
298
299
Mais, au regard des nouvelles prérogatives du
Comité, un réaménagement du rôle et du
fonctionnement de l'organe onusien de suivi des droits de l'enfant s'impose.
Ainsi, comme on peut le constater à l'article 3 du Protocole, obligation
est faite au Comité des droits de l'enfant d'adopter un règlement
intérieur relatif à ces nouvelles fonctions.
En dépit des avantages du Protocole facultatif portant
sur les procédures de communication, nous constatons, avec regret, que
le nouvel instrument a vu le jour avec un handicap non moins important. En
effet, comme son nom l'indique, le Protocole facultatif à la Convention
des droits de l'enfant établissant la procédure de
présentation des communications, est un instrument qui n'est pas
obligatoire aux États parties.
En effet, dire que le Protocole est
``facultatif'» revient à le laisser au gré des
États parties783 à la CIDE (et ses deux premiers
Protocoles) qui sont libres de le ratifier ou non. Or, le troisième
Protocole établissant la procédure de communication, n'est rien
d'autre qu'un instrument qui vient compléter les insuffisances de la
CIDE. Dès lors, il nous semble qu'il aurait été plus
judicieux de préférer l'appellation de «Protocole
additionnel» à «Protocole facultatif». Le Protocole
additionnel ayant pour avantage de s'imposer aux États
déjà parties à la Convention principale qui se trouve,
dans notre cas, être la Convention des Nations unies relatives aux droits
de l'enfant. Et comme nous le constaterons, les communications ne pourront
être introduites au Comité des droits de l'enfant, uniquement que
contre les États qui ratifieraient le troisième Protocole. Ainsi,
il n'est pas possible pour les enfants ressortissants d'un État partie
à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui ne l'aurait pas
ratifiée, et dont les droits sont violés, d'introduire une
requête au Comité contre cet État.784 Mais dans
tous les cas, rendre le Protocole relatif à la procédure de
communication obligatoire aux États parties à la CIDE n'aurait
pas été une première pour un mécanisme de
protection des droits de l'enfant, dans la mesure où l'Union Africaine
avait déjà introduit une telle procédure dans la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant au niveau
régional africain.785
783 Pour la notion de «facultatif», Cf. CORNU (G.),
Vocabulaire juridique, 10e édition, 2014, p.444.
784 Art. 1er al.3 du 3ème Protocole «Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat
qui n'est pas partie au présent Protocole. ».
785 Art.44 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant.
Outre cette faiblesse, on note à l'article 10 du
Protocole, que la particularité des droits économiques, sociaux
et culturels refait surface. En effet, l'article 10 dispose en son
alinéa 4 que : « Lorsqu'il examine des communications faisant
état de violations des droits économiques, sociaux et culturels,
le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures
prises par l'État partie conformément à l'article 4 de la
Convention... » sans compter qu'à l'issue de l'examen des
communications, le Comité ne peut, dans le meilleur des cas, faire des
recommandations, en cas de violation des droits de l'enfant
établie.786
De plus, comme le relève à juste titre, l'ONG
« HUMANIUM787 », la possibilité
d'introduire une plainte collective n'a pas été retenue dans le
Projet Final du 3ème Protocole. Mais l'article 5 dispose que
: « des communications peuvent être présentées par des
particuliers, ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers, ou au
nom de particuliers ou de groupes de particuliers. ». Une ONG peut donc
parfaitement déposer une communication au nom d'un enfant ou d'un groupe
d'enfants.
Au total, l'adoption de ce protocole présente une
avancée considérable. Encore, faut-il que les membres du
Comité international des droits de l'enfant ne soient pas trop abruptes
dans l'examen des conditions de recevabilité, notamment lorsque la
violation apparaît évidente. Il faut souligner à cet
égard que le Protocole reprend la jurisprudence établie par la
Cour Européenne des droits de l'homme ou par la Cour
interaméricaine s'agissant des exceptions au principe de
l'épuisement des voies de recours internes par exemple788.
C'est dire que malgré ses apports possibles dans
l'effectivité des droits de l'enfant, le troisième Protocole
relatif aux droits de l'enfant établissant la procédure de
communication, présente des faiblesses, qui nous l'espérons,
n'entameront pas pour longtemps la justiciabilité des droits de l'enfant
au niveau du système de contrôle onusien.
Après avoir signé ce protocole en 2013, la
ratification par la Côte d'Ivoire de ce troisième protocole
facultatif à la CIDE de 2011, serait un gain pour la protection de
l'enfant et ses
786 Art.10 al.5 3ème Protocole « Après
avoir examiné une communication, le Comité transmet sans
délai aux parties concernés ses constations au sujet de cette
communication, éventuellement accompagnées de ses
recommandations. ».
787 Pour plus d'infos sur Humanium, consulter
http://www.humanium.org/fr/presentation/
788 Sultani c/ France, 20 septembre 2007, para. 50 ; Tomasi
c/France, 27 août 1992, parag.79 ; Selmouni c/ France, 28 juillet 1999,
para. 74 s.
300
droits. Il est en conséquence, impérieux que
l'Etat ivoirien puisse ratifier ce protocole dans les meilleurs
délais.
De toute façon, si la Côte d'Ivoire conserve sa
position en ne ratifiant pas ce protocole, il est laissé la
possibilité à la victime de se tourner vers le recours
régional via la Comité africain des experts et du bien-être
de l'enfant qui fait face à une inertie.
2. L'inertie du recours régional
Dans la procédure des rapports ou des plaintes, force
est de constater l'inertie du recours régional au niveau ivoirien,
contrairement à certains Etats africains. Il serait intéressant
de montrer la tardive remise des rapports périodiques de la Côte
d'Ivoire au Comité des experts africains des droits et du
bien-être de l'enfant, avant d'envisager l'absence des communications
individuelles et étatiques.
- La tardive remise des rapports
périodiques
La tardive remise des rapports périodiques
adressés au Comité des experts des droits et du bien-être
de l'enfant montre le relâchement de la Côte d'Ivoire contrairement
à certains pays africains. La procédure des rapports
périodiques au niveau africain, est pratiquement la même que celle
universelle. Pour évaluer l'état des droits de l'enfant dans les
États parties à la Charte des enfants, il faut avoir une
connaissance de la situation qui prévaut sur le territoire de
l'État concerné. Pour le faire, l'UA à travers la CADBE, a
mis en place le même modèle que les Nations Unies en ce qui
concerne la CIDE : soumission de rapports initiaux puis
périodiques789.
Ainsi, l'article 43 de la CADBE dispose :
« 1. Tout État partie à la
présente Charte s'engage à soumettre au Comité par
l'intermédiaire du Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente
Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice
de ces droits : CAB/LEG/153/Rev.2
a) dans les deux ans qui suivront l'entrée en
vigueur de la présente Charte pour l'État partie concerné
;
789 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.299-304.
301
b) ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent
article doit :
a) contenir suffisamment d'informations sur la mise en
oeuvre de la présente Charte dans le pays considéré
,
·
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs
et les difficultés qui entravent le respect des obligations
prévues par la présente Charte.
3. Un État partie qui aura présenté
un premier rapport complet au Comité n'aura pas besoin, dans les
rapports qu'il présentera ultérieurement en application du
paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les
renseignements de base qu'il aura précédemment fournis.
»
De la soumission du rapport, en passant par son examen et les
recommandations ou observations finales, le processus de soumission des
rapports au niveau du CADBE s'effectue essentiellement en six points, comme
suit :
1- L'État partie fournit son rapport au Comité
,
·
2- Un rapporteur est nominé parmi les membres du
Comité ,
·
3- Le rapport de la société civile est fourni
au Comité ,
·
4- Un groupe de travail, en pré-session, est tenu
durant lequel le Comité établit les thèmes à
discuter avec l'État partie ,
·
5- Une session plénière (publique) est tenue
durant laquelle le Comité établit les thèmes à
discuter avec l'État partie ,
·
6- Le Comité produit des observations finales et
recommandations qui devraient être mises en oeuvre par l'État
partie. »
Les rapports soumis par les États doivent se faire
conformément aux directives relatives à la soumission des
rapports initiaux et des rapports périodiques790. Dans le
même temps, les États parties à la CADBE semblent avoir du
mal à se conformer aux exigences de l'article 43 de ladite Charte, qui
leur fait obligation de soumettre un rapport initial deux ans après
l'entrée en vigueur de la Charte (à l'égard de
l'État partie) et ensuite un rapport périodique chaque trois ans.
Ainsi, à sa dix-neuvième session en 2012, et sur les quarante-six
(46)
790 Pour plus d'infos sur les directives, voir :
http://acerwc.org/?wpdmdl=8694
( consulté le 01/12/2015).
302
ratifications des États791, seuls quinze
États792 parties s'étaient conformés
entièrement ou partiellement aux exigences de l'article 43. Et parmi les
15 États ayant soumis un rapport, on note que si tous ont soumis le
rapport initial, seul le Burkina Faso avait soumis un rapport
périodique. Et au nombre des rapports initiaux soumis, seuls neuf (09)
rapports avaient fait l'objet d'observations finales et de recommandations de
la part du Comité.793. Plus récemment, lors de sa
26ème session ordinaire qui s'est déroulée
à Addis-Abeba, en Ethiopie, du 16 au 19 Novembre 2015794,
l'Algérie, le Congo, le Gabon et le Lesotho ont tous
présenté leurs rapports initiaux sur la mise en oeuvre de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant au Comité
d'experts, augmentant ainsi le nombre d'Etats ayant présenté
leurs rapports initiaux.
A l'heure actuelle, seuls 10 Etats ont soumis tous leurs
rapports, 18 Etats sont en retard par un ou deux rapports, 20 Etats accusent un
retard d'au moins trois rapports, tandis que 6 Etats ayant ratifié n'ont
jamais soumis de rapports795. La Côte d'Ivoire, quant à
elle, se distinguait toujours par son absence de rapport. Au titre de l'article
43 portant soumission des rapports périodiques, 15 pays796
ont soumis leurs rapports initiaux qui ont été examinés
par le comité des experts797. Parmi ces pays, figure son
voisin du Burkina Faso qui a déjà adressé ses
1re et 2e rapports périodiques contrairement
à la Côte d'Ivoire qui se démarquait par son inertie. Bien
qu'elle soit partie à la charte depuis le 1er mars 2002, elle
n'avait cependant déposé aucun rapport au comité des
experts des droits et du bien-être de l'enfant. Heureusement en date du
04 juillet 2012, elle a soumis son rapport initial et cumulé portant sur
la période de 1994 à 2012 ; mieux, le 28 juin 2016, la Côte
d'Ivoire a soumis son rapport portant sur la période 2012-2015. On ne
peut qu'espérer que cette dynamique se poursuive afin que ce pays soit
en phase avec ses engagements internationaux.
791 Etat de ratification à la date de 06 novembre
2012. www.acerwc.org
(Consulté le 06 novembre 2012).
792 Burkina-Faso, Cameroun, Egypte, Kenya, Libye, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie,
Togo, et Ouganda.
793 Ce point a été fait, le 06 novembre 2012, sur
la base des données disponibles sur le site du Comité.
794
http://www.ihrda.org/fr/2015/11/26e-session-ordinaire-de-la-caedbe-examine-les-rapports-initiaux-de-
lalgerie-le-congo-le-gabon-et-le-lesotho/(Consulté
le 21/12/2015).
795
http://www.achpr.org/fr/states/reports-and-concluding-observations/
( Consulté le 01/05/2018)
796 Ces pays sont : l'Algérie, le Nigeria, le Kenya,
l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso, la Tanzanie, le Rwanda, le Togo, le Niger,
le Sénégal et le Cameroun.
797
http://www.achpr.org/fr/sessions/51st/speeches/cyprien_adebayo_yanclo/
(consulté le 05/05/2015).
303
D'ailleurs, la CAEDBE vient de publier le 18 mai dernier ses
recommandations et observations sur ce rapport initial de la République
de Côte d'Ivoire. On y lit :
« - Inexistence de l'enfant
- Accélérer le processus d'adoption du code. Au
cours de l'adoption dudit code, le comité recommande que le gouvernement
harmonise les questions relatives aux droits de l'enfant conformément
à ses obligations mondiales et régionales ;
- Encourage le gouvernement à allouer suffisamment de
ressources financières et humaines pour la mise en oeuvre
intégrale de la PNPE ;
- Le comité recommande au gouvernement au gouvernement
de développer un mécanisme de coordination entre ses acteurs des
droits de l'enfant ;
- Le comité demande au gouvernement de la Côte
d'ivoire de concevoir un système dans lequel l'allocation
budgétaire est évaluée en fonction des différents
facteurs qui reflètent les besoins des enfants, comme la croissance
démographique des enfants et leurs besoins spéciaux ;
- Le comité encourage également la diffusion de
ces observations finales et recommandations, ainsi que le rapport de l'Etat
partie parmi les nombreux acteurs.
Le Comité recommande fortement à l'Etat partie
d'examiner son âge minimum de mariage pour les filles et de le fixer
à 18 ans sans aucune exception.
Le Comité recommande par conséquent au
gouvernement de mener des campagnes de sensibilisation contre les
sévices et la violence envers les enfants, notamment la violence
sexuelle ; de former ses forces de police, ses juges et procureurs sur la
gestion des cas d'abus d'enfants ; de sensibiliser la communauté sur
l'importance du fait de signaler les cas d'abus au système juridique
formel ; de former les chefs traditionnels et religieux sur la gestion de cas
et les renvois à la police ; et d'apporter un soutien psychosocial aux
victimes d'abus sexuels et d'abus de toutes sortes, de former les enseignants
sur les conséquences de tels actes. Le Comité exhorte l'Etat
partie à mettre en oeuvre l'Arrêté qui interdit les
châtiments corporels dans les écoles et interdit légalement
les châtiments corporels à la maison.
S'agissant des cas de viol, le Comité demande à
l'Etat partie de définir clairement et de punir le viol dans le code
pénal, en vue d'accélérer les procédures
judiciaires des cas de viol,
304
et afin de réduire le coût des procédures
judiciaires et la production de preuves en matière de viol et autres
violences sexuelles.
Le Comité recommande également à l'Etat
partie de prendre des mesures contre le harcèlement et tout abus sexuel
dans les établissements scolaires et d'engager des poursuites fermes
contre les enseignants auteurs de ces faits, car cette situation encourage la
déperdition scolaire et les grossesses précoces.
»798.
A travers ce constat, on peut noter la volonté de
l'Etat de Côte d'Ivoire de rectifier le tir et rattraper son retard dans
la soumission des rapports périodiques.
On note aussi malheureusement l'absence des communications
individuelles et étatiques. - De l'absence de communications
individuelles et étatiques à l'absence d'enquêtes à
l'égard de la Côte d'Ivoire
L'absence de communications individuelles et étatiques
couplée à celle d'enquêtes entraine une inertie du recours
ivoirien vers le comité d'expert africain des droits de l'enfant.
En fait, les plaintes ou communications sont soumises par les
individus ou les Etats qui entendent dénoncer les violations commises
par un Etat partie ; le comité africain d'experts sur les droits et le
bien-être de l'enfant a une compétence exclusive pour recevoir des
communications sur toutes les questions émanant de toute personne,
groupe de personnes, organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par
l'Union Africaine (UA), par un Etat membre de l'UA ou par l'organisation des
Nations Unies799.
Dans cette initiative de communications, la CADBE a
devancé la CIDE, en permettant très tôt aux individus la
faculté de saisir le Comité800.
Les directives pour l'examen des communications prévues
à l'article 44 de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant, n'influence guère801, étant
donné
798 OBSERVATIONS FINALES ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
AFRICAIN D'EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT (CAEDBE)
SUR LE RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE SUR LE
STATUT DE MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS ET LE
BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT
799 Article 11 CADBE.
800 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.299-304.
801 Déclaration d'IHDRA ( Institute for Human Rights
and development in Africa) sur la procédure de plainte ( communications)
auprès du CAEDBE, 12eme session du Comité africain d'experts sur
les droits et le bien
305
l'imprécision et le caractère des conditions de
recevabilité et d'examen des communications individuelles. Cependant, la
moisson est bien maigre pour l'ensemble du continent et ne concerne aucunement
pas directement les enfants vivant en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce
jour, le Comité a reçu 4 communications contre les États
parties et a rendu 3 décisions.
La première communication a été
déposée en 2005 par Michelo Hunsungule en faveur des enfants dans
le Nord de l'Ouganda contre le gouvernement de l'Ouganda et a été
déclarée recevable par le Comité. Le Comité a rendu
sa décision802. La deuxième communication est
liée au droit à la nationalité de l'enfant. Il a
été reçu en Avril 2009 à l'initiative de l'Institut
pour les droits de l'homme et le développement en Afrique (IHRDA) et
l'Open Society Justice Initiative (OSJI) au nom des enfants de Nubian Descente
au Kenya contre le gouvernement du Kenya. Le Comité a aussi rendu une
décision803 sur cette communication804.
La troisième communication traite de la
mendicité des enfants et a été déposée par
le Centre pour les droits de l'homme et La Rencontre Africaine pour la
Défense des Droits de l'Homme contre le gouvernement du
Sénégal. Une décision805 a été
rendue sur cette affaire.
La quatrième communication est en suspens pour examen.
Ici, à défaut d'examiner toutes les
décisions rendues , nous nous pencherons sur la décision relative
à l'affaire l'Institut pour les droits de l'homme et le
développement en Afrique (IHRDA) et l'Open Society Justice Initiative
(OSJI) au nom des enfants de Nubian Descente au Kenya contre le gouvernement du
Kenya. Le choix de cette affaire se justifie par le fait qu'elle pourrait
inspirer les défenseurs des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire
être de l'enfant (CAEDBE) 3-5 novembre 2008, Addis
Abeba, Ethiopie , consulté sur
http://ihrda.org/fr/2008/11/3091/
le 16/10 /2014.
802 Communication N°1/2005 examinée lors des
sessions du 15-19 Avril 2013 publiée sur
http://acerwc.org/?wpdmdl=8687
(Consulté le 02/12/2015).
803 Décision du 22 Mars 2011 relative à la
Communication N°.com/002/2009 disponible sur
http://acerwc.org/?wpdmdl=8690(Consulté
le 02/12/2015).
804 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.313-314.
805 Décision No 003/Com/001/2012 disponible sur
http://acerwc.org/?wpdmdl=8689
(consulté le
02/12/2015).
306
d'autant plus qu'une récente étude
publiée par l'Unicef fait état de plus 500.000 enfants apatrides
dans le pays806. De quoi s'agissait-il en l'espèce ?
En avril 2009 et conformément l'article 44 de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant, les deux organisations
IHRDA et OSJI ont introduit une communication au Comité de l'enfant
portant sur la violation du droit à la nationalité des enfants
d'ascendance nubienne.
Selon la décision du Comité,
Les plaignants invoquent une violation principalement de
l'article 6, en particulier les paragraphes (2), (3) et (4) (le droit d'avoir
un enregistrement de naissance et d'acquérir une nationalité
à la naissance), de l'article 3 (prohibition de discrimination
illicite/inéquitable) et, résultant de ces deux violations
alléguées, une liste de « violations indirectes », y
compris celle de l'article 11 (3) (égalité d'accès
à l'éducation) et de l'article 14 (égalité
d'accès au soin). 807
Après étude de la recevabilité de la
communication conformément aux dispositions de l'article 44 de la Charte
des enfants, et aux directives relatives à l'examen des communications,
le Comité déclare la communication recevable.808
Quant au fond après examen, le Comité des droits
de l'enfant a rendu, le 22 mars 2001, la décision suivante :
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Comité
africain constate de multiples violations des articles 6 (2), (3) et (4), de
l'article 3, de l'article 14 (2)(b) et de l'article 11(3) de la Charte
africaine des droits et bien-être de l'enfant par le gouvernement du
Kenya, et :
1- Recommande que le gouvernement du Kenya prenne toutes
les mesures législatives, administratives et autres mesures
nécessaires afin de garantir que les enfants d'ascendance nubienne au
Kenya, qui sont sans cela apatrides, puissent acquérir la
nationalité kényane et la preuve de cette nationalité
dès la naissance.
2- Recommande que le gouvernement du Kenya prenne toutes
les mesures pour garantir que les enfants d'ascendance nubienne dont la
nationalité kényane n'est pas
806 Nous reviendrons sur ce cas d'apatridie en Côte
d'Ivoire dans la deuxième partie de notre travail.
807 Paragraphe 7 de la décision.
808 Paragraphe 35 de la Décision.
307
reconnue puissent systématiquement
bénéficier de ces nouvelles mesures à titre
prioritaire.
3- Recommande que le gouvernement du Kenya applique son
système d'enregistrement des naissances de manière non
discriminatoire et prenne toutes les mesures législatives et
administratives et autres mesures nécessaires afin de garantir que les
enfants d'ascendance nubienne soient enregistrés immédiatement
après leur naissance.
4- Recommande que le gouvernement du Kenya adopte un plan
à court terme, moyen terme et long terme, comprenant des mesures
législatives administratives et autres mesures pour garantir le respect
du droit au meilleur état de santé possible et du droit à
l'éducation, de préférence en consultant les
communautés bénéficiaires concernées.
5- Recommande au gouvernement du Kenya d'adresser un
rapport sur la mise en application des présentes recommandations dans
les six mois à compter de la date de notification de la présente
décision : Conformément aux Règles de procédure, le
Comité désignera un de ses membres pour assurer le suivi de la
mise en application de la présente décision.
Comme on peut le constater, cette toute première
décision depuis sa création en juillet 2001, représente
une étape importante en faveur des enfants nubiens et pour les enfants
apatrides du continent comme ceux vivant en Côte d'Ivoire. En outre, elle
représente pour les ONG et associations de défense des droits de
l'enfant, un outil stratégique pour la promotion et la défense
des droits des enfants. Toutefois, le Comité africain des experts des
droits et du bien-être de l'enfant a rendu sa décision en termes
de recommandations. Et on s'aperçoit que ces recommandations sont
présentées en termes vagues, qui rappellent la formulation
adoptée dans la rédaction de la Charte africaine des droits et
bien-être de l'enfant. Or, comme on le sait, les recommandations n'ont
pas de caractère obligatoire et donc ne s'imposent pas
impérativement à l'État partie mis en
cause.809
809 VIRALLY (M.), « La valeur juridique des
recommandations des organisations internationales », in Annuaire
français de droit international, volume 2, 1956, pp.66-96.
308
Il en découle donc deux difficultés majeures.
D'abord, le caractère non obligatoire des recommandations
formulées, fait reposer l'exécution de ces recommandations sur la
bonne volonté de l'État kényan, qui s'il désire
peut les ignorer. En effet, comme il est mentionné dans la
décision du Comité africain, les Comités des Nations unies
avaient auparavant attiré l'attention de l'État kényan sur
cette situation. Et si le cas est demeuré jusqu'à l'introduction
de la requête, c'est bien parce que l'État kényan n'a pas
pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation des
enfants nubiens. Ensuite, le caractère vague des recommandations faites
par le Comité, alors qu'elles s'adressent à un État
spécifique et pour un cas spécifique, donnent trop de marge de
manoeuvre à l'État kényan, qui pourrait avancer des
arguments de mesures prises pour régler sans pour autant la
régler.
En définitive, malgré la satisfaction morale que
peut offrir la reconnaissance de violations de droits de l'enfant par les
organes de protection tel le Comité des experts africains, ce
mécanisme est insuffisant pour dissuader les États comme la
Côte d'Ivoire à ne plus les violer.
En plus de ses prérogatives de recevoir des
communications, le Comité peut, dans certains cas, effectuer des
investigations sur le territoire d'un État partie. Sur ce point, c'est
l'article 45 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant qui en érige les règles. Ainsi dispose-t-il en son
alinéa 1er que :
Le Comité peut recourir à toute
méthode appropriée pour enquêter sur toute question
relevant de la présente Charte, demander aux États parties toute
information pertinente sur l'application de la présente Charte et
recourir à toute méthode appropriée pour enquêter
sur les mesures adoptées par un État partie pour appliquer la
présente Charte.
L'avantage d'une telle disposition pour les membres du
Comité des experts est la possibilité d'aller au-delà du
contenu des rapports étatiques, pour constater la réalité
sur le terrain. Les lignes directrices810 sur la conduite des
enquêtes fournissent le cadre régissant la conduite des
enquêtes
810 Pour les lignes directrices, voir
http://acerwc.org/?wpdmdl=8668
(consulté le 02/12/2015)
309
Mais, la difficulté majeure pour une telle
démarche reste les moyens à la mettre en oeuvre811. A
ce jour, le Comité a effectué une seule mission d'enquête
dans un État partie, notamment en Tanzanie. En effet, le CAEDBE a
mené une mission d'enquête dans ce pays, suite à une
demande d'enquêter sur les allégations de violations des droits
des enfants atteints d'albinisme. La requête a été
introduite en Novembre 2013, par une organisation non gouvernementale, sous le
même soleil (UTSS), attirant l'attention du Comité sur les
conditions alarmant d'enfants atteints d'albinisme soumis à des
violations de leurs droits en Tanzanie. Le Comité a examiné le
rapport de cette mission lors de sa 24 ème session ordinaire
tenue le 01-06 Décembre 2014, à Addis-Abeba, en Ethiopie.
Étant donné que la demande relève de son mandat et
était également en ligne avec les objectifs de missions
d'enquête comme indiqué dans l'article 2 des lignes directrices
enquête CAEDBE812.
Malheureusement, pour les enfants de Côte d'Ivoire, il
n'y jamais eu de communications individuelles ou étatiques ni
d'enquêtes allant dans le sens d'une plainte aux violations des droits de
l'enfant dirigées contre l'Etat de Côte d'Ivoire. Devrait- on pour
autant croire que ce pays affiche un traitement séduisant à
l'égard des enfants ? Nous y répondrons dans la deuxième
partie de notre travail.
Toutefois, au regard de ce qui précède, l'on
pourrait de ce fait croire à une inefficacité des recours
universel et régional exercées devant les deux comités
envisagés.
B. L'INEFFICACITE DES RECOURS
Ces recours non contentieux institués en vue d'aboutir
à un contrôle efficient, même s'ils semblent aller dans le
sens de la protection des droits de l'enfant, s'avèrent inefficaces par
la nature de ces organes (1) et la portée de leurs
décisions (2).
1. Une inefficacité tenant à la nature des
organes de contrôle
La nature des organes de contrôle peut constituer un
frein dans la mise en oeuvre de leur mission. En fait ces organes sont
dépourvus de véritables pouvoirs, étant
investi d'une fonction simplement consultative :
811 Le Comité dépend, même, pour
l'organisation de ses sessions, du financement des organisations
internationales non gouvernementales et gouvernementales.
812
http://acerwc.org/investigation/
(consulté le 02/12/2015).
310
- Des organes dépourvus de véritables
pouvoirs
Les deux organes de contrôles examinés sont de
simples organes dépourvus de véritables pouvoirs. Le rôle
de ces deux Comités de contrôle des droits de l'enfant est de
veiller à ce que les parties respectent leurs engagements.
Pour exercer cette mission, le Comité doit disposer de
renseignements complets et détaillés. Si le gouvernement en cause
ne fournit pas les justifications requises, comme il en a l'obligation, il ne
pourra faire l'objet d'aucune sanction. De plus, les plaintes et communications
qui sont déférés vers les comités de droits de
l'enfant, ne transforment guère lesdits comités en instances
juridictionnelles ayant compétence pour rendre des décisions
obligatoires. En effet, en ce qui concerne leur fonction dans la
procédure des plaintes, l'avantage semble trouver uniquement sa raison
dans le caractère quasi juridictionnel. Mais au-delà du
rôle actif que va jouer le particulier dans sa confrontation avec l'Etat
présumé violateur, lors d'un procès dans lequel le
principe général audi alteram paterm est utilisé
et du règlement à l'amiable qui peut ressortir de cette
procédure, l'absence de sanction judiciaire vient nous ramener à
la triste réalité de l'inefficacité de tels
mécanismes non contentieux.
Par ailleurs, la violation même flagrante des droits
reconnus est sujette à une procédure de sanction peu
élaborée dans la majorité des cas, contrairement au
tableau angélique peint par Monsieur Ibrahima FALL, à cet effet
en 1994813. En effet, le modèle reconnu et admis par les
Etats est celui de la constitution des comités. Ces organes n'ont pas un
véritable pouvoir de sanction. Ils ne font que promouvoir et inciter les
Etats à respecter leurs obligations814. Il s'agit, remarque
la doctrine pour ces organes de « parvenir à une
amélioration de la situation, par l'exercice d'une pression politique et
morale utilisant la force de l'opinion publique »815
813 FALL (I.), « Les mécanismes de protection et
de promotion des droits de l'homme développés au sein du
système des Nations Unies », R.A.D.H., vol.4 1994,
pp.11-19.
814 DHOMMEAUX (J.), « La contribution du comité
des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à
la protection des droits économiques, sociaux et culturels »,
A.F.D.I. , 1994, pp.633 et ss., PASTOR RIDRUEJO (J.A), « Les
procédures publiques spéciales de la Commission des droits de
l'Homme des Nations Unies », R.C.AD.I., vol 228, 1991,
pp 183 et ss ; RODLEY (N.S), The Evolution of United Nations Charter-Dased
Machinery for the protection of Human Rights, EHRLR, 1997, pp.4 et ss.
815 WACSHMANN (P.), Les droits de l'homme, Dalloz, 2008,
p.154.
311
Cependant, bien que dépourvu de véritable
pouvoir de sanction, ces organes ont une importance et celle-ci ressort de leur
fonction consultative ou de leur rôle d'accompagnateur aux
côtés des Etats.
- Des organes investis de simple fonction
consultative et du rôle d'accompagnateur des Etats
Les mécanismes conventionnels non contentieux sont
investis de simple fonction consultative. Comment amener les États
parties aux instruments internationaux pertinents protecteurs des enfants,
à respecter leurs engagements ? Sûrement pas par la force. Ne se
sont-ils pas engagés librement pour la mise en oeuvre de ces normes sur
leurs territoires ? Dans tous les cas, la ratification des normes relatives aux
droits de l'enfant le leur impose. Dès lors, comment ne pas comprendre
le choix d'un mécanisme non contentieux pour le respect des droits de
l'enfant par les Nations Unies et au niveau continental africain ?
Les Comités des droits de l'enfant, en tant qu'organe
de suivi et de mise en oeuvre des normes qui relèvent de leurs
compétences816, n'ont pas pour mission de jouer les gendarmes
derrière les États parties. Ils les accompagnent dans le
processus de mise en oeuvre à travers une relation de dialogue et
d'évaluation de l'état des normes sur leur territoire : la
présentation de rapport. Dans le cadre du contrôle sur rapport,
les organes de traité utilisent une procédure non contentieuse.
En effet, les organes de contrôle peuvent utiliser le dialogue avec les
Etats. Un dialogue qui consiste à encourager les Etats parties à
déposer régulièrement leurs rapports afin que les
comités prennent connaissance des progrès ou des
difficultés de la mise en oeuvre des obligations de protection des
droits de l'enfant. Même si cette procédure semble
présenter une démarche compréhensive, elle souffre d'une
absence de garantie d'efficacité en termes de protection des enfants.
Aussi, pour promouvoir l'application des droits de l'enfant
par les États parties, les Comités des droits de l'enfant,
conformément à la mission à eux assignée,
accompagnent les États dans la mise en oeuvre des normes qui
relèvent de leurs compétences. L'exemple du comité onusien
mérite d'être relevé. Dans le cadre de son rôle
d'accompagnateur, il explique et clarifie le contenu de la CIDE de façon
à amener les États à comprendre telle ou telle autre
disposition de la Convention. Ainsi ont été
élaborées des «Observations Générales»
sur des
816 Référence est faite ici à la CIDE et ses
trois protocoles.
312
mesures d'application de la CIDE. Nous prendrons ici l'exemple
de l'Observation Générale (OG) n°5 portant sur les mesures
d'application générales des articles 4, 42, et 44 de la CIDE,
établie par le Comité lors de la trente-quatrième session
en 2003.817
Le choix porté sur l'OG n°5 découle du fait
qu'elle a levé le voile sur des points importants de la CIDE. D'abord,
le Comité a clarifié les obligations des États parties sur
les mesures à prendre pour l'application de la Convention818,
ensuite il a tranché en ce qui concerne la problématique de la
justiciabilité de tous les droits de l'enfant819 et par
conséquent, il pose la règle de la justiciabilité des
droits de l'enfant, y compris les droits sociaux, économiques et
culturels.820
De façon générale, le Comité des
droits de l'enfant a, à travers les OG n° 5 livre aux États
le contenu des dispositions abordées, et la portée des notions
clés tout en leur indiquant les mesures et démarches à
adopter pour accomplir les obligations qui découlent de la ratification
de la CIDE et de ses deux premiers protocoles facultatifs.
Cette démarche du Comité, que nous qualifions
ici de pédagogique, a pour avantage de clarifier le contenu de la CIDE,
dont nous avons montré le caractère vague et trop
général de certains points qui servent de prétexte pour la
méconnaissance de sa justiciabilité. De même, la question
de la coopération internationale dans le cadre de la CIDE n'a pas
été occultée. Il est rappelé aux États d'en
faire un outil pour l'effectivité des droits de
l'enfant821.
Dans un tel contexte, avoir un dialogue constructif avec les
États revient à les convaincre de l'importance de la mise en
oeuvre des droits de l'enfant, non pas pour la communauté
internationale, mais pour leur propre avenir. Le Comité des droits de
l'enfant, n'ayant pas de pouvoir coercitif, ne peut donc jouer ce rôle en
espérant trouver une oreille attentive auprès des dirigeants des
pays où les enfants subissent encore aujourd'hui de graves violations de
leurs droits. Cette mission, dans la pratique, se traduira essentiellement par
le suivi de la mise en oeuvre de la CIDE et ses deux premiers Protocoles
facultatifs à travers une démarche de présentation des
rapports par les États parties.
817 Cf. doc. Nations Unies, CRC/GC/2003/5 du 27 novembre
2003, 23 p.
818 V. point introductif du doc. CRC/GC/2003/5, p.2 et
svtes.
819 Cf. point V du doc. CRC/GC/2003/5, p.8.
820 V. pour exemples, les arrêts (France): Cour cass.
Chambre civ. N° 02-16336 du 18 mai 2005 et Cour cass.,Chambre
soc. N°05-40876 du 16 décembre 2008.
821 V. point sur la coopération avec la
société civile, p.15 et svtes, doc, CRC/GC/2003/5.
313
De ce qui précède, s'interroger sur la
portée des décisions des organes de traité dans la
protection de l'enfant, devient alors nécessaire.
2. Une inefficacité tenant à la
portée de ses décisions
La portée des décisions des organes de
surveillance contribue fortement à rendre efficace ou non leur saisine.
L'on constate avec désolation que le contrôle des comités
des droits de l'enfant est inefficace. Cela est relatif aux décisions
prises par les Comités qui ne sont que de simples recommandations devant
la réaction réfractaire des Etats tels la Côte d'Ivoire
:
- De simples recommandations
Les mesures prises par les organes de traités que l'on
appelle aussi les comités sont de simples recommandations.
Après l'examen des rapports par le Comité des
droits de l'enfant, des recommandations sont faites aux États, à
travers les «observations finales», pour remédier aux
insuffisances relevées par le Comité dans les rapports
examinés. Mais le problème qui se pose avec cette démarche
est que les recommandations n'ont aucun caractère obligatoire pour
l'État à qui elles sont faites. En effet, la recommandation est
définie comme une invitation à agir dans un sens
déterminé sans pour autant avoir de caractère
contraignant822. C'est aussi une note invitant son destinataire
à agir d'une manière spécifique et lorsqu'elle s'adresse
à l'État, elle n'a pas de force obligatoire823. Ainsi,
les recommandations faites par le Comité des droits de l'enfant,
à l'issue de l'examen des rapports étatiques ne seront prises en
compte que si l'État en question en a la volonté. Les organes ne
peuvent donc contraindre un Etat violateur à se plier face à ces
recommandations qui ne bénéficient que de l'autorité de
« la chose interprétée ».
Cependant, une large diffusion des recommandations pourrait
favoriser leur application. Ceci étant, si ces mesures sont
confidentielles dans le cas de la Commission africaine, elles
bénéficient d'une large diffusion quand elles émanent du
Comité d'expert africain des droits de l'enfant et du Comité des
droits de l'enfant des nations unies.
822 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10eme
ed. 2014, p.860.
823 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 10eme
ed. 2014, p.860.
314
Même s'il est vrai que le consentement de l'Etat pour la
conclusion du traité fait foi, et pourrait entrainer par là
même son application, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'abstient
de respecter les recommandations édictées. L'absence de force
contraignante entraine la liberté des Etats face à l'application
des traités d'où leur négligence face aux
recommandations.
- La négligence des recommandations par les
Etats
Devant la faiblesse des décisions des organes de
protection de l'enfant, on se demande bien ce qu'il faut attendre de la
réaction des Etats. Le droit international ayant pour base fondamentale
la volonté des Etats, elle en souffre parfois dans sa mise en oeuvre. A
en croire ce propos de Michel VIRALLY, « la recommandation constitue
une proposition qui ne produira ces effets qu'après avoir
été acceptée »824. Ce qui
amène à conclure que c'est l'acceptation de la recommandation par
l'Etat, qui sera une condition sine qua nun de son application, sinon,
elle reste lettre morte.
De lourdes conséquences découlent de l'absence
de contraintes des organes de traités. Il résulte du
caractère non obligatoire des décisions, une liberté pour
les Etats d'agir ou de ne pas agir. Cette lacune concerne non seulement les
deux comités sus-évoqués, mais aussi l'ensemble des
organes quasi-juridictionnels de contrôle des droits humains qui font
face à des gouvernements souvent réfractaires. Les comités
de contrôle des droits de l'enfant ne peuvent obliger les Etats à
suivre leurs recommandations ; aussi, tout repose sur la « bonne
volonté » de chaque Etat. La mesure ultime à la
portée de ces deux Comités en cas de non-respect, consiste
à envoyer des lettres ou des rappels aux Etats en leur demandant de
respecter leurs obligations en vertu des de la CIDE ou de la CADBE.
Il est à noter qu'au-delà des recommandations,
ces comités usent de moyens de pression. Ces moyens utilisés par
l'intermédiaire des organisations internationales, peuvent être
financiers, politiques et même diplomatiques. Ce sont ces moyens qui pour
la plupart du temps font plier les Etats qui n'envisagent pas de respecter
leurs recommandations.
Dans tous les cas, à défaut d'avoir
trouvé pleine satisfaction devant les mécanismes non contentieux,
notamment, les mécanismes quasi-juridictionnels qui apparaissent
inefficaces,
824 VIRALLY (M.), Le droit international en devenir:
Essais écrits au fil des ans, Nouvelle Edition internationale, PUF,
Paris, 1990, p.176.
315
l'opportunité est offerte aux victimes ou aux personnes
compétentes de recourir à une protection judicaire plus favorable
à l'enfant victime, en recourant aux mécanismes contentieux de
protection de l'enfant au niveau universel et régional africain qui
restent malheureusement peu exploités.
§ 2. DES GARANTIES JUDICIAIRES PEU
EXPLOITEES
A l'instar du cadre interne, en matière de protection
des droits, les garanties judiciaires semblent être la voie, la seule,
pouvant ou devant offrir une protection optimale des droits de l'enfant au
niveau international. Mais, s'il est vrai que ces garanties sont des voies
efficaces, il n'en demeure pas moins que celles concernant l'enfant ivoirien ou
africain, se donne à succès par l'absence de juridictions
spécialisées, et, lorsqu'il en existe à travers le recours
aux juridictions à compétence générale (A),
celles-ci se faisant remarquer par leur inaccessibilité
(B).
A. LA SEULE OPTION DES ORGANES JUDICIAIRES A
COMPETENCE GENERALE : UNE VOIE PEU SOLLICITEE
Les recours contentieux se manifestent par la seule option des
organes judiciaires à compétence générale tant au
niveau régional africain qu'universel. L'opportunité offerte
à l'enfant ivoirien victime découle de leurs compétences
(1) et de la nature de leurs décisions marquées
au coin de l'obligatorieté (2).
1. Une opportunité au regard de leurs
compétences
Sera successivement analysée le caractère
opportun des compétences des juridictions judiciaires au niveau africain
et au niveau universel.
- Au niveau africain : de l'utilité des
compétences de la Cour africaine des droits de l'homme et de la Cour de
justice de la CEDEAO pour les enfants victimes en Côte
d'Ivoire
316
Pour assurer la protection des droits de l'homme, l'individu
en Afrique n'a qu'un seul recours judiciaire au niveau continental, à
savoir, la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples825.
Premier organe judiciaire établi à
l'échelle du continent africain, la Cour constitue effectivement la
consécration de « l'option juridictionnelle de la protection
des droits de l'homme »826. Pourtant, cette
consécration de l'option judiciaire n'allait pas de soi. Bien que
formulé dès 1961 lors du congrès africain sur la
primauté du droit organisé à Lagos et formellement
transcrit dans l'illustre Acte de Lagos, le projet de création d'une
Cour africaine ne trouvera un apathique début de concrétisation
que vingt ans plus tard avec la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, qui institua une Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples827. Le constat ultérieur des limites de ce
mécanisme quasi-juridictionnel828 conduira à franchir
une nouvelle étape829 : l'adoption, dans le cadre de l'OUA,
du Protocole dit de Ouagadougou, le 10 juin 1998, va consacrer
formellement830 la volonté des Etats africains de
créer un mécanisme concret de sanction des violations des droits
humains en Afrique.
825
www.african-court.org
826 QUILLERE-MAJZOUB (F.), L'option juridictionnelle de la
protection des droits de l'homme en Afrique-Etude comparée autour de la
création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : une
approche juridique des droits de l'homme entre tradition et
modernité, Paris, PUF, 1993, 479p.
827 Sur cet organe, cons. Notamment OUGUERGOUZ (F.), « La
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : présentation
et bilan d'activités (1988-1989) » A.F.D.I., vol.35, 1989,
pp.557-571.
828 L'organe a pu être qualifié de toothlless
bulldog. Cons. A ce propos, UDOMBANA (N.J), « Towards the African Court on
Human and Peoples' Rights :better late than never », Yale Human Rights
and Development Law Journal, 2000 pp.45-111, sp. p.64. Pour un bilan
global, cons. Not. DOUMBE-BILLE (S.), « Un quart de siècle de
protection des droits de l'homme en Afrique », in Mélanges en
l'honneur du Professeur Petro Pararas, Bruxelles, Bruylant, 2009,
pp.133-141 ; MURRAY (R.), The African Commission on Human and peoples's
rights and international law, Oxford, Hart Publishing, 2000, 316 p.,
spéc.p.22.
829 C'est la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA qui avait « invité le secrétaire
général de l'OUA à convoquer une réunion d'experts
gouvernementaux chargés de réfléchir, en étroite
collaboration avec la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, sur les moyens de renforcer l'efficacité de celle-ci, en
examinant en particulier la possibilité de création d'une Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples » (Doc.OUA/CCEG,
« Résolution sur la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples, AHG/Rés.230 (XXX) », 30e session de la
Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement, 13-15 juin 1994, Tunis
(Tunisie), p.2§4).
830 Le long chemin vers l'élaboration et l'adoption de
cet instrument est décrit avec force détails par KAMTO (M.),
« Préambule » in KAMTO (M.) (dir.), La Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant
création de la Cour africaine des droits de l'homme - Commentaire
article par article, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp.1210-1211.
317
L'entrée en vigueur du Protocole, six ans plus tard,
soit le 25 janvier 2004, va libérer le processus
d'opérationnalisation de la Cour, pour lequel il aura fallu attendre
près de deux ans pour sa mise en place, notamment par l'élection
des premiers juges831. Il fallut trois années
supplémentaires avant que la Cour, confrontée à des
problèmes de siège d'installation832 et
d'élaboration de son règlement intérieur833, ne
rende enfin son premier arrêt, le 15 décembre 2009834.
De cette dernière date à celle rétrospective de l'Acte de
Lagos, il aura donc fallu attendre près d'un
demi-siècle835 pour que l'Afrique à son tour rejoigne
les deux grands systèmes régionaux déjà en vigueur,
à savoir ceux de la Convention européenne des droits de l'homme
et de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
Elle peut être saisie en cas de violations des
dispositions de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant. Elle est une option pour la défense et la protection de
l'enfant africain, victime, et les Etats qui veulent dénoncer
d'éventuelles violations. En cela, c'est une opportunité offerte
pour l'intérêt de l'enfant victime, étant donné que
ces décisions ont une force contraignante, à l'instar de la Cour
de justice de la CEDEAO836, qui se présente comme un nouveau
recours offert aux enfants victimes au niveau de l'espace ouest-africain.
831 Doc. UA/Conference de l'Union, Décision sur
l'élection des membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples, Assembly/AU/Dec.100 (VI) , 6e session ordinaire de la
Conférence de l'Union, 23-24 janvier 2006, Khartoum (Soudan).
832 Doc. UA/Conf. De l'Union, « Activity report of
the court for 2006, Assembly/AU/8 (VIII) », 8e session de
la conférence de l'Union, 29-30 janvier 2007, Addis-Abeba, Ethiopie, 9
p. ; Doc.UA/CE, « Rapport provisoire de la Cour Africaine des droits
de l'homme et des
peuples. EX.CL/363
(XI) » 11e sesion ordinaire du Conseil exécutif,
25-29 juin 2007 Accra, Ghana, 6p., voy. Spéc.§§ 14-28,
pp.2-5.
833 Doc.UA/CE, « Rapport d'activités de la
cour africaine des droits de l'homme et des peules pour l'année 2008,
Ex.CL/489 (XIV) », 14e session ordinaire du conseil
exécutif, 26-30 janvier 2009, Addis-Abeba, Ethiopie, spéc.
§§ 42-44.
834 NTWARI (G-F.), « Note sur le premier arrêt de
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », R.A.D.I.C.,
vol.18, n°2/2010, pp.233-237.
835 Des auteurs comme le Professeur MOUANGE KOBILA (J.) ont
regretté cette longue gestation de la Cour Africaine des droits de
l'homme et des peuples, de manière plus inspirée : « si
dans les Ecritures, la parole divine suffit à tirer
instantanément les créatures du néant, l'avènement
d'institutions de promotions et de protection des droits de l'homme en Afrique
est loin de correspondre à ce schéma de soudaineté
créatrice » MOUANGE KOBILA (J.), « Article 1.
Création de la Cour », in M. KAMTO (dir.), op. cit.,
p.1215).
836 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.315-318.
318
La cour de justice de la CEDEAO837 est
habilitée par le protocole additionnel de 2005 à connaître
de toutes les violations des droits de l'homme sur le territoire de la
communauté838. Aux termes de l'article 3 de ce protocole,
« la Cour est compétente pour connaitre des cas de violation
des droits de l'homme dans tout Etat membre de la communauté
».
Cette orientation nouvelle achève d'étonner au
regard de la nature de la CEDEAO. Pour être une organisation de nature
économique, la question des droits humains n'était point
évoquée dans son fondement. On passe ainsi d'une CEDEAO
axé uniquement sur les intérêts économiques à
une CEDEAO donnée comme un creuset d'un droit en construction avec pour
innovation majeure la protection des droits humains839.
Déjà, en 2001, un important pas est franchi vers
la consolidation de la Cour de justice comme organe de protection des droits
humains. En effet, les membres de la CEDEAO adoptent un protocole sur la
démocratie et la bonne gouvernance840. A l'article 39 du
protocole, il est précisé que la cour de justice est
habilitée à connaître de tout cas de violation des droits
humains après épuisement des voies de recours au niveau national.
Malgré cette déclaration péremptoire, ce sera par un refus
de connaitre d'un litige relatif aux droits individuels que les attributions de
la Cour dans ce domaine seront confirmées et définitivement
établies. Le protocole de 1991 excluait en effet les citoyens des pays
membres de l'accès à la cour841. Si un citoyen d'un
pays de la communauté avait un quelconque grief lié à
l'interprétation du traité ou à son application par les
institutions de la CEDEAO, la seule voie possible était d'en
référer aux autorités nationales. Seules celles-ci
pouvaient se présenter devant la Cour, en tant que représentant
de leur ressortissant. Un cas de droit allait
837 NDIAYE (M.), La protection des droits de l'homme par
la cour de justice de la CEDEAO, Mémoire de Master Recherche,
Université Montesquieu de Bordeaux IV, 2014, 112p.
838 ALTER (K.), HELFER (L.), MCALLISTER J. (Dir.), « A
new international human rights court for the west Africa: The ecowas community
court of justice» , In The international journal of international
law, 2013, vol.107, n°4, pp.737-779.
839 Précisons que l'acuité de
l'édification d'institutions visant à protéger les droits
de l'homme est fondé sur le fait que les évènements
malheureux ayant conduit à la violation de la dignité humaine ont
fait foison dans la dernière décennie du millénaire
passé.
840
http://www.comm.ecowas.int/sec/fr/protocoles/Protocole-additionnel-sur-la-Bonne-gouvernance-et-la-
democ.pdf
(consulté le 12 Mai 2015).
841 Article 9 du Protocole A/P.1/7/91 de 1991 libellé
ainsi « un Etat membre peut, au nom de ses ressortissants, diligenter
une procédure contre un autre Etat membre ou une institution de la
Communauté, relative à l'interprétation et à
l'application des dispositions du Traité, en cas d'échec des
tentatives de règlement à l'amiable ».
319
permettre l'application de ce principe et en même temps,
étendre la compétence de la cour de justice :
« Un ressortissant nigérian, Olajide Afolabi,
avait conclu un contrat de vente au Bénin. Seulement, la livraison de
ces marchandises s'avéra impossible du fait de la fermeture par le
Nigéria de sa frontière avec le Bénin. Afolabi
allégua alors une violation de la liberté d'aller et de venir,
consignée dans le traité révisé de la CEDEAO.
L'affaire arriva devant la cour en 2003.
Le Nigéria prétendit que le protocole de 1991 ne
donnait pas droit aux nationaux d'ester devant la Cour de justice, ce qui
était justifié. Seulement, Afolabi argua qu'il était
possible qu'un national se fasse représenter devant la cour par son Etat
d'origine.
Il entendait donc que le Nigéria fasse remonter
l'affaire devant la cour de justice. Le second argument est que les termes du
protocole n'excluaient pas le recours des individus. En effet, le texte
précise juste que l'Etat « peut » effectuer un
recours devant la Cour. Selon son interprétation, cette disposition
n'était pas exclusive d'un recours individuel.
Afolabi fut débouté par la Cour qui
considère que l'article 9 du protocole était entièrement
clair dans l'exclusivité du recours étatique. De plus, la Cour
reconnaissait qu'elle ne pouvait disposer que des instruments mis à sa
disposition par les textes et excluait le recours individuel. Le juge excluait
aussi le jugement en équité qu'Afolabi invoquait. Il se
déclarait donc incompétent pour juger le recours individuel ainsi
présenté842. ».
Ainsi, la Cour entendait promouvoir une interprétation
stricte des textes fondateurs de sa compétence.
Cet arrêt de la Cour allait soulever les protestations
des associations de droits de l'homme de la sous-région ainsi que de
l'étranger843. Qui plus est, certains juges de la Cour
pointèrent du doigt les manquements du système légal de la
communauté. On ne voyait pas bien comment on pouvait interdire le
recours aux individus alors que les textes de la CEDEAO s'appliquent
directement à eux. Ainsi, une rencontre entre les associations de
défense des droits de l'homme, les juges de la Cour et les associations
des barreaux d'Afrique de l'ouest
842 Cour CEDEAO, Arrêt Afolabi c/ République du
Nigéria, 2004.
843 ALTER (K.), HELFER (L.), MC ALLISTER (J.): « A new
human rights international court for West Africa:ECOWAS community Court of
justice », In. American Journal of International
Law737-779 (2013).
320
se tint à Dakar en Octobre 2004. Cette rencontra fut
couronnée par la publication d'un document appelant à l'adoption
d'un nouveau protocole ouvrant la compétence de la Cour aux questions de
droits de l'homme. Cette action porta ses fruits et un protocole A/SP1/01/05
fut adopté en 2005, lequel protocole étendait le mandat de la
cour844. Il est certain qu'en droit international, une cour de
justice ne peut avoir qu'une compétence d'attribution et non la
compétence de sa compétence. En effet, la
délégation de souveraineté acceptée par les Etats
est le fondement de l'existence de ces cours internationales qui ne peuvent se
mouvoir que dans l'aire préalablement définie845.
Contrairement au tribunal arbitral846, la Cour de
justice847 se voulait être permanente.
Cette révolution opérée par le texte de
2005 entrainera un tournant dans la vie de l'organisation en en faisant un
espace de défense et des droits humains. Le contenu du mandat est
mentionné à l'article 3 du protocole qui dispose in fine : «
la Cour de justice a compétence pour déterminer tout cas de
violation des droits de l'homme dans les Etats membres ».
Ceci soulève une grande question. La CEDEAO n'avait pas
vocation à être un espace de défense des droits de l'homme
et à ce titre, aucune déclaration n'a été prise
à cet effet. Il n'y a donc pas de texte fondateur de droits de l'homme
dont la Cour peut se déclarer gardienne exclusive, à l'inverse
des autres cours des droits de l'homme, en Europe, en Afrique ou en
Amérique. Ainsi, la détermination du mandat n'est pas
précise et laisse une grande place à l'incertitude.
Il nous semble que cet énoncé évasif
concernant le mandat de la Cour est fait à dessein. En effet, le
protocole ainsi adopté ouvre une grande perspective au juge.
D'abord, le mandat s'étend à tous les Etats
membres sans exception. L'aire géographique ainsi
déterminée suppose que la Cour a la primauté au niveau des
questions de droits de
844 Aux termes du protocole additionnel de 1991, la cour de
justice était chargée de l'interprétation et de
l'application du traité et des instruments légaux de la
CEDEAO.
845 Arrêt CIJ, réparation des dommages subis au
service des Nations Unies, 11 avril 1949.
846 Bien que prévu par les textes, ce tribunal n'a
jamais fonctionné ; Elle avait théoriquement pour mission
d'arbitrer les différends entre les Etats membres ou entre les
institutions de l'organisation.
847 L'existence de la Cour de justice va acquérir
valeur conventionnelle avec son inscription comme institution de la
Communauté dans le traité révisé de 1993. En
réalité la cour n'entra en existence officielle qu'en 1996, quand
enfin les sept Etats membres eurent tous ratifié le protocole de 1991.
Les juges eux ne seront choisis et installés qu'en Janvier 2001.
321
l'homme. Si en effet, la Cour reçoit une
compétence exclusive de connaître de ce sujet, elle chapeaute
dès lors les juridictions nationales et devient leur institution de
référence. Dans la pratique, cette idée est-elle
appliquée ? Rien n'est moins sûr.
Le deuxième élément à souligner
est le caractère évasif de la compétence accordée
à la Cour. Le protocole se borne à lui donner la
compétence de « déterminer toute violation des droits de
l'homme ». Ceci est la consécration d'une très large
autonomie du juge.
En effet, le protocole laisse au juge le soin de
déterminer ce qu'est une violation des droits de l'homme. Le rôle
du juge ne sera pas seulement donc d'appliquer les textes internationaux, mais
il devra aussi user d'un pouvoir prétorien pour extraire de nouveaux
droits à protéger. Cela implique aussi, selon nous, une nouvelle
donne dans le rapport avec les juridictions nationales. La Cour se voit
accorder un droit de création de normes juridiques par le biais de cet
énoncé évasif. Cela implique que les nouveaux droits et
libertés qu'elle découvrira auront effet dans l'ordre juridique
interne. Ce nouvel ajout de règles aura forcément des
répercussions dans l'agencement des normes nationales et pourrait rendre
effectif la primauté de la Cour de justice sur les autres tribunaux en
matière de droits de l'homme.
Mais, la question du mandat ainsi traitée, laisse
ouvrir une brèche sur les fondements de l'action judiciaire. La Cour
n'est pas la garante exclusive d'un ordre juridique établi. Les sources
de ses décisions ne sauraient donc qu'être
hétéroclites. Bien entendu, cela est de nature à
protéger davantage les particuliers et notamment les enfants comme ce
fut le cas dans une décision848 historique rendue par la Cour
de justice dans l'affaire dame Hadijatou Mani Koraou c.
Niger849 .
Le cas dame Hadijatou Mani Koraou contre l'État du
Niger perçu comme une décision historique d'une juridiction
africaine condamnant un État pour esclavage par inaction ne
relève pas d'une juridiction de l'Union africaine mais d'une juridiction
judiciaire sous régionale qui à l'origine, n'a pas pour
rôle premier de juger la violation des droits humains850.
848 Arrêt n°ECW/CCJ/JUD/06/08.
849 La décision complète est disponible en ligne
sur :
http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/ecw.ccj.jud.06.08
850 Conformément à l'article 3 (1) de son
traité, la CEDEAO « vise à promouvoir la
coopération et l'intégration dans la perspective d'une union
économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de
vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité
économique, de renforcer les relations entre les Etats Membres de
contribuer au progrès et au développement du continent africain
». Mais, la Cour de la justice de
322
Un bref rappel des faits et la procédure s'impose pour
voir comment cette juridiction pourrait désormais contribuer à
protéger à travers cette décision les droits des enfants
dans l'espace CEDEAO, et donc en Côte d'Ivoire.
« En 1996, alors qu'elle n'avait que douze (12) ans,
la requérante, dame Hadijatou Mani Koraou, de coutme Bouzou a
été vendue par le chef de la Tribu Kenouar au Sieur El Hadj
Souleyman Naroua âgé de 46 ans, pour la somme de deux cent
quarante mille (240.000) francs CFA [...] Pendant environ neuf (9) ans,
Hadijatou Mani Koraou a servi au domicile d'El Hadj Souleymane Naroua, en
exécutan toutes sortes de tâches domestiques et en servant de
concubine à celui-ci. De ces relations avec son maître, sont
nés quatre (04) enfants dont deux ont survécu [...].
La requérante, de nationalité nigérienne,
après avoir saisi sans succès les juridictions internes de son
pays pour recouvrer sa liberté totale, décide de saisir le 14
septembre 2007, la Cour de Justice de la CEDEAO pour :
a) Condamner la République du Niger pour violation
des articles 1, 2,5 et 18 (3) de la Charte africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples ,
·
b) Requérir des autorités
nigériennes qu'elles introduisent une nouvelle législation qui
protège effectivement les femmes contre les coutumes discriminatoires en
matière de mariage et de divorce ,
·
c) Demander aux autorités Nigériennes de
réviser la législation relative aux Cours et Tribunaux de
manière à ce que la justice puisse jouer pleinement son
rôle de gardienne des droits des personnes qui sont victimes de pratiques
de l'esclavage ,
·
d) Exiger de la République du Niger qu'elle
abolisse les coutumes et pratiques néfastes et fondées sur
l'idée d'infériorité de la femme ,
·
e) Accorder à Hadijatou Mani Koraou une juste
réparation du préjudice qu'elle a subi pendant ses 9
années de captivité»851.
la CEDEAO tire sa compétence à connaitre des
violations des droits de l'Homme de l'art. 4 (g) qui pose comme principe
fondamental de l'organisation, « le respect, la promotion et
protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux
dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
» d'une part, et des articles. 15 du traité et 9 du protocole
relatif à la Cour de Justice.
851 Cf. Paragraphe 28 décision ECWCCJ/JUD/06/08 de la Cour
de Justice de la CEDEAO.
323
À la requête de la demanderesse, l'État du
Niger (partie défenderesse) souleva deux exceptions
d'irrecevabilité:
a) La requête n'est pas recevable, pour défaut
d'épuisement des voies de recours internes ;
b) La requête n'est pas recevable, du fait que
l'affaire portée devant la Cour de Céans est encore pendante
devant les juridictions Nationales Nigériennes852
Après examen des moyens des parties et leurs arguments,
la Cour de justice de la CEDEAO853 rendit sa décision le 27
octobre 2008.
Sur la forme, elle « Rejette les exceptions
d'irrecevabilités de la requête soulevée par le
République du Niger en tous ses points» et «
Reçoit dame Hadijatou Mani Koraou en sa qualité à agir
» :
Sur le fond, la Cour
1. Dit que la discrimination dont a été
l'objet dame Hadijatou Mani Koraou n'est pas imputable à la
République du Niger ;
2. Dit que dame Hadijatou Mani Koraou a été
victime d'esclavage et que la République du Niger en est responsable par
l'inaction de ses autorités administratives et judiciaires ;
3. Reçoit dame Hadijatou Mani Koraou en sa demande
de réparation des préjudices subis et lui accorde une
indemnité forfaitaire de dix millions de francs CFA (10.000.000)
;
4. Ordonne le paiement de cette somme à dame
Hadijatou Mani Koraou par la République du Niger ; [...J
»854
De cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO,
nous nous attarderons sur deux de ses points, à savoir la reconnaissance
de l'esclavage subi par la requérante et la condamnation de
l'État du Niger à réparer le préjudice causé
par l'inaction à dame Hadijatou Mani Koraou à hauteur de dix
millions de francs CFA. A travers ces deux points, la décision de la
Cour de la CEDEAO a été perçue par plus d'un observateur
comme étant historique.
852 Paragraphe 29 décision op.cit.
853 La Cour était constituée du juge Aminata
Mallé SANOGO (Présidente), du juge Awa Daboya NANA (Membre), du
juge El-Mansour TALL (membre) et de Me Athanase ATTANON (Greffier).
854 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.315-316.
324
Historique du fait que, pour la première fois, une
organisation africaine condamne un État africain pour esclavage par
inaction et lui impose la réparation financière du dommage ainsi
causé. Le terme inaction employé ici par les juges de la Cour
vient donner un sens, dans le contexte africain, aux responsabilités des
États parties à l'égard des normes internationales,
notamment en droits de l'Homme, à la prise de mesures
nécessaires au plan interne par les parties aux traités.
Ainsi, la responsabilité de l'État se voit engagée pour
des abus causés par un particulier, car il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour empêcher cet abus et de surcroit admet cet abus
sur son territoire.
A travers ce cas intéressant, on ne peut
qu'espérer que la CJCEDEAO poursuive son action dans cette dynamique
afin qu'elle puisse demeurer un recours efficace pour les enfants qui verront
leurs droits violés par les Etats parties.
Comme on peut le constater, au niveau régional, il
n'existe pas non plus de juridictions spécialisées dans la
protection de l'enfant. Depuis, les Cours européenne, américaine,
jusqu'à celles africaines, il n'existe pas de Cour spéciale qui
traite de la question de l'enfant.
Une importante faiblesse de ces cours régionales
africaines, réside dans l'omission des cas de violations graves au droit
international humanitaire dans le cadre de la protection des enfants.
Heureusement, qu'en pareil cas, les enfants victimes peuvent à travers
leurs Etats se tourner vers la Cour pénale internationale au regard des
compétences de celle-ci.
- Au niveau universel : La CPI, une juridiction
internationale compétente en matière d'infractions graves
commises à l'égard des enfants
Le vingtième siècle a été de
mémoire d'homme, l'une des périodes de l'histoire où ont
été commis les crimes les plus atroces. C'est dans cette logique
que Winston Churchill dans une déclaration faite devant la chambre des
communes du Royaume-Uni le 25 Octobre 1941 affirmait : « ces
exécutions d'innocents, faites de sang-froid ne pourront que retomber
sur les sauvages qui les ordonnent et sur les exécutants (...)
»855. Cet appel lancé par Churchill a commencé
par se matérialiser à travers les tribunaux
d'après-guerre. Ce faisant, la vision de tous était de mettre en
place une juridiction impartiale capable de prévenir et de
réprimer
855 SZUREK (S.) « La formation du droit international
pénal », ASCENSIO (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), (dir.),
Droit International pénal, Paris, Cedin, Ed. A. Pedone, 2000,
p.7.
325
tout crime d'atteinte aux droits de l'homme. Cela a conduit,
plusieurs décennies plus tard, à la création de la CPI,
malgré les différentes contradictions soulevées par les
différents acteurs, en présence à Rome ; la
communauté internationale a franchi une étape historique le 17
juillet 1998856 en adoptant le statut de Rome. L'article
1er du statut de Rome est libellé comme suit : « il
est créée une Cour pénale internationale en tant
qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à
l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale, au sens du présent statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales
».
Comme toute juridiction, la CPI a une compétence
attributive ou matérielle qui se retrouve à deux niveaux. Elle
permet, tout d'abord, à travers une politique de sensibilisation de
prévenir tous les actes constitutifs de violations massives des droits
de l'homme, et corrélativement des droits de l'enfant. Sa mission de
prévention se traduit à travers un volet de sensibilisation, sur
la fin de l'impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant et
obérant la sensibilité de la communauté internationale.
Ensuite, elle est instituée pour réprimer tous
les présumés auteurs de violations de ces droits. Son rôle
est donc non seulement préventif mais aussi répressif.
Basée à la Haye, la Cour pénale
internationale est une juridiction permanente chargée de juger les
personnes accusées de génocide, de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre857, et ce à compter
du 1er juillet 2002 ,donnée comme date d'entrée en
vigueur du statut de Rome.
A ce jour, 123 États sur les 193 membres de l'ONU ont
ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la
CPI858. Au nombre de ces Etats, figure la Côte d'Ivoire qui a
signé le statut de Rome le 30 novembre 1998 et ratifié le 15
février 2013859.
856 En effet, cent soixante (160) Etats ont participé
à la « Conférence diplomatique des plénipotentiaires
des Nations Unies sur la Création d'une Cour criminelle internationale
». Le statut de la CPI a été adoptée dans la nuit du
17 au 18 juillet 1998 par cent vingt (120) voix pour, sept (7) contre (Chine,
USA, Inde, Israel, Barhein, Qatar, et Vietnam) et vingt et un (21) abstentions
(notamment les pays arables). De plus, douze (12) pays n'ont pas pris part au
vote.
857 Statut de la cour pénale internationale, article 1.
858
https://www.icccpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20ro
me%20statute.aspx( consulté le 10/11 /2015).
859
https://www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/states%20parties/african%20states/Pages/Cote_d_Ivoire.aspx(
consulté
le 24/11/2015).
326
Relativement à la Côte d'Ivoire, notons qu'en
date du 18 avril 2003, sous la Présidence de Monsieur Laurent GBAGBO, la
Côte d'Ivoire, par le truchement de son ministre des affaires
étrangères, a fait une déclaration de reconnaissance de la
Compétence de la CPI conformément à l'article 12-3 du
Statut de Rome, par laquelle l'Etat de Côte d'ivoire donnait pouvoir
à la CPI d'identifier, de poursuivre et de juger les auteurs et
complices des actes commis sur le territoire ivoirien depuis les
évènements du septembre 2002860. Aussi ,par une lettre
datée du 14 décembre 2010, l'actuel Président de la
République , Monsieur Alassane OUATTARA , dit confirmer la
déclaration datée du 18 avril 2003.Toutefois, contrairement, au
contenu de cette lettre antérieure, la lettre de confirmation
précise que « ...j'engage mon pays la Côte d'Ivoire,
à coopérer pleinement et sans délai avec la cour
pénale internationale, notamment en ce qui concerne tous les crimes et
exactions commis depuis mars 2004... »861. A
première vue, l'on peut se réjouir de l'engagement de la
Côte d'Ivoire au statut de Rome car cela permettrait de faire la
lumière sur les atrocités commis dans ce pays durant la crise
ivoirienne. Toutefois, une analyse à froid des deux lettres offre
matière à interrogation. En effet, l'on observe non sans
inquiétudes que le point de départ donné comme
période devant couvrir la compétence de la CPI diverge ; alors
que le premier courrier vise la date de septembre 2002, la seconde lettre
limite cette période à compter de mars 2004. Pourquoi une telle
divergence ? En bonne logique juridique fondée sur
l'intérêt des victimes, il serait indiqué que l'on remonte
à la période de septembre 2002 pour la simple raison que la
seconde lettre entend à travers son objet, confirmer, la lettre
datée du septembre 2003. Mieux cela permettrait à toutes les
victimes de la crise ivoirienne débutée depuis le 19 septembre
2002 et notamment les enfants d'avoir droit à une justice impartiale.
Par ailleurs, la Chambre préliminaire III a, le 4
octobre 2011, fait droit à la requête du Procureur d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative concernant la situation en Côte
d'Ivoire862. L'évolution de cette enquête a conduit au
transfèrement de M. Laurent GBAGBO et Charles BLE GOUDE à la CPI,
à l'exclusion des autres présumés auteurs de violations
à l'encontre des enfants. En tout Etat de cause, nous pensons qu'il
serait mieux
860
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/CBE1F16B-5712-4452-87E7-4FDDE5DD70D9/279779/ICDE1.pdf
(consulté le 09/11/2015).
861
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804F/0/ReconCPI.pdf
(consulté
le 09/11/2015).
862
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/
(consulté le 09/11/2015).
327
indiqué de mener un procès à
l'égard de toute personne soupçonnée de crimes commis
à l'égard des enfants durant la crise ivoirienne. Cela
permettrait d'aboutir à une justice impartiale, complète et
bénéfique à toute la Côte d'Ivoire. Ces
différents procès pourraient s'inspirer de celui ayant
impliqué M. Thomas LUBANGA dans le cas des crimes commis à
l'égard des enfants en République démocratique du Congo.
Cela dit, il apparait opportun d'analyser l'affaire Thomas Lubanga dans
laquelle le juge de la CPI a entre autres, déclaré coupable le
prévenu pour crimes commis à l'égard des enfants.
En effet, le 14 mars 2012, M. Lubanga a été
déclaré coupable, en qualité de co-auteur, des crimes de
guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins
de 15 ans dans la Force patriotique pour la libération du Congo (FPLC),
et les faire participer activement à des hostilités, dans le
cadre d'un conflit armé ne présentant pas un caractère
international du 1er septembre 2002 au 13 août 2003 et ce, sur la base de
l'article 8-2-e-vii du Statut de Rome. Le 10 juillet 2012, Thomas Lubanga Dyilo
a été condamné à une peine totale de 14 ans
d'emprisonnement de laquelle sera déduit le temps qu'il a passé
en détention à la CPI863. Au cours du procès,
le témoin n° 10, une fille, ancien enfant soldat, a
témoigné qu'elle avait été conscrite à
l'âge de 13 ans et avait été, à plusieurs reprises,
agressée sexuellement par ses commandants. Un autre témoignage
entendu au procès a montré que certaines jeunes filles
étaient tombées enceintes et avaient été
contraintes à avorter et à utiliser des herbes locales comme
traitement864.
En dehors de la situation des enfants soldats, la CPI a pour
rôle de juger les différentes violations des droits de l'enfant
survenues lors des conflits, donc en violation des Conventions de
Genève. Ainsi, concernant le crime de génocide, l'article 6 du
statut incrimine tout « transfert forcé d'enfants du groupe
à un autre groupe »865commis « dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux »866. Ce crime va donc
à l'encontre des mesures des conventions de Genève
prévoyant le maintien de la cellule familiale et le rapprochement des
familles, mesure défendue par nombre d'organisations humanitaires dont
le C.I.C.R.
863
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/
sepSituations/Situation+ICC+0104/ (consulté le 09/11/2015).
864
http://www.soros.org/sites/default/files/lubanga-proces-20120302.pdf
consulté le 09/11/2015).
865 Article 3 paragraphe e du Statut de Rome du 17 juillet
1998.
866 Article 6 du statut de Rome du 17 juillet 1998.
328
Autre violation du DIH pour laquelle la Cour pénale
Internationale intervient, la réduction en esclavage de mineurs
caractérisant un crime contre l'humanité au sens de l'article 7
paragraphe 2c du statut867. Réduire en esclavage un enfant
reviendrait à violer l'article 49 de la Convention III de Genève
de 1949 prévoyant l'interdiction de faire réaliser des travaux
à des personnes n'ayant pas l'âge et la condition physique de les
réaliser.
A l'analyse, on observe que de par leurs compétences,
ces juridictions judiciaires apparaissent comme une réelle
opportunité offerte aux enfants de Côte d'ivoire à l'instar
leurs décisions.
2. Une opportunité au regard de leurs
décisions à caractère contraignant
Respectant le principe « res judicata pro veritate
habetur » qui signifie que la chose jugée doit être
tenue pour la vérité, l'autorité de chose jugée
exclut que ce qui a été jugé puisse être
méconnu ou contesté. De ce fait, les décisions des Cours
judiciaires régionales et de la CPI sont contraignantes. Leurs
décisions ont valeur de loi et s'imposent à tous. Ces Cours
étant des juridictions judiciaires, leurs décisions ont une force
obligatoire incontestable.
Ainsi, « les Etats parties... s'engagent à se
conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où
ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le
délai fixé par la Cour »868. De même,
les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à
l'égard des Etats Membres, des Institutions de la Communauté, et
des personnes physiques et morales869.
Les décisions sont applicables uniquement pour les
parties au litige. En cela, certains parlent de l'autorité relative de
chose jugée et non erga omnes. La Côte d'Ivoire a
ratifié le Protocole à la Charte Africaine des droits de l'Homme
et des Peuples portant création de la Cour870, entrainant
ipso facto, le respect par cet Etat, des décisions que la Cour prendrait
à son endroit.
867 Par « réduction en esclavage », on entend
le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs
liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la
traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
»
868 Article 30 du protocole de la Charte africaine instituant une
Cour.
869 Article 15 paragraphe 4 du traité révisé
de la CEDEAO.
870 La Côte d'Ivoire a ratifié cet instrument en
date du 07 janvier 2003.
329
Si de façon apparente, la Côte d'Ivoire est tenue
de se conformer aux décisions de ces différentes Cours, il n'en
reste pas moins que la saisine de ces cours obéisse à certaines
règles draconiennes qui rendent les recours inaccessibles.
B. DES RECOURS DIFFICILEMENT ACCESSIBLES
Les recours sont difficilement accessibles du fait des
obstacles aux communications individuelles (1) et de ceux liés à
leur recevabilité, particulièrement l'épuisement des voies
de recours internes (2).
1. Les obstacles aux communications individuelles devant
la Cour africaine
Les obstacles aux communications sont nombreuses, mais celles
qui sont plus pertinentes et méritent une attention particulière
concernent la déclaration spéciale et le pouvoir de la Cour.
- La déclaration spéciale ou la clause
d'option
La déclaration spéciale ou la clause d'option
est une condition initiale de saisine de la Cour africaine. A travers elle,
cette Cour fait une discrimination entre les personnes publiques et les
personnes privées. En effet, pour la dernière catégorie de
personnes, l'accès à la Cour nécessite que les Etats
parties mis en cause ou violateurs des droits de l'enfant, aient fait une
déclaration spéciale pour reconnaitre la compétence
juridictionnelle de la Cour.
Au niveau africain, pour qu'une personne privée puisse
saisir la Cour africaine, l'Etat mis en cause doit avoir préalablement
« fait une déclaration acceptant la compétence de la
Cour »871. En d'autres termes, le consentement du
présumé responsable des violations des droits de l'enfant est
exigé pour qu'il puisse être attrait devant cette Cour. Le
protocole reste strict et ferme sur cette condition. Il précise que
« la Cour ne reçoit aucune requête en application de
l'article 5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle
déclaration ».
L'exemple de la clause d'option qui peut, du reste, être
faite « à tout moment de la ratification... » suffit
à elle seule à fermer l'accès du prétoire au
justiciable. Les Etats en général et les Etats africains en
particulier acceptent difficilement, voire mal d'être attraits
871 Article 34 par.6.
330
par des particuliers et, qui plus est, devant une juridiction
internationale. Certes, l'admission du recours individuel devant cette Cour
constitue, un progrès certain. En cela, le système africain
devance son homologue américain872, qui ne prévoit pas
un tel recours. Mais, donner d'une main et reprendre de l'autre ne vaut
absolument rien. Aussi, reste-t-il en retrait par rapport au système
européen qui, tout en instituant le recours individuel, ne reprend pas
la clause d'option873
Ainsi, les personnes privées, les organisations non
gouvernementales observatrices auprès de la Commission, sont
limitées dans la saisine de la Cour africaine par cette
déclaration spéciale. Sans cette déclaration, l'Etat qui
aurait commis une violation, ne peut être attrait devant cette
juridiction, même après avoir ratifié le Protocole
instituant la Cour.
Pourtant, sur vingt-six (26) Etats parties au Protocole,
seulement sept ont déposé leur déclaration
spéciale, pour permettre aux individus de saisir la Cour en cas de
violations de leurs droits. L'absence de déclaration serait un frein
à l'exercice de recours judiciaire. L'enfant des pays non parties
à ce protocole et n'ayant pas fait de déclaration se trouve ainsi
privé de recours judiciaire à même de protéger
efficacement ses droits au niveau continental. Ainsi, l'enfant se trouve face
à un recours judiciaire difficilement accessible.
Il convient en outre d'espérer qu'un Etat puisse
attraire un autre devant la Cour pour d'éventuelles violations des
droits de l'enfant ou que la victime elle-même puisse la saisir par
l'intermédiaire de la Commission. Passé l'obstacle de la
déclaration spéciale, la victime doit faire face au pouvoir de la
Cour.
- Le pouvoir de la Cour
Le pouvoir de la Cour, ici, s'entend du privilège
accordé à celle-ci. Ce pouvoir semble très large,
étant donné qu'il donne la possibilité ou non à
l'individu de déposer des requêtes. De sorte que celui-ci, en plus
de la déclaration spéciale, est confronté à un
autre obstacle, contenu dans le protocole de la Charte instituant la Cour
Africaine, notamment en son article 5, paragraphe 3 qui dispose : « La
cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations
non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès
de la
872 Art.44, 45, 46 de la Convention américaine des droits
de l'homme.
873 Art. 3 du protocole n°9 du 6 novembre 1990 et art.34
de la convention européenne telle qu'amendée par le protocole
n° 11 du 11 mai 1994 et entré en vigueur le 1er novembre
1998.
331
Commission d'introduire des requêtes directement
devant elle conformément à l'article 34 (6) de ce Protocole.
».
Cet obstacle, pour le Professeur DEGNI-SEGUI, réside
dans l'appréhension du verbe « peut » qui est
renforcée par le verbe « permettre ». Pour lui, ces
deux verbes, viennent durcir les conditions d'accès à la Cour,
par « une autorisation préalable »874. La
Cour investie de ce pouvoir semble tout mettre en oeuvre ou du moins cherche
des astuces pour décourager le particulier qui entend revendiquer ses
droits.
Mais espérons avec le Professeur que ce raffermissement
des conditions de saisine en cas de violation des droits de l'enfant ne mettra
pas à mal l'intérêt supérieur de celui-ci. Aussi,
convient-il de révéler que l'inaccessibilité de cette Cour
réside également dans les obstacles liés à la
recevabilité, notamment dans le cas d'épuisement des voies de
recours internes.
2. Les obstacles liés à la
recevabilité : l'épuisement des voies de recours
internes
Diverses conditions données comme cumulatives sont
exigées pour la saisine de la Cour africaine des droits de l'Homme et
des peuples. Mais, c'est la condition tenant à l'épuisement des
voies de recours qui fera l'objet d'un intérêt particulier ; cette
condition, bien qu'elle soit contraignante peut être contournable.
- Une condition contraignante
Suivant le droit international coutumier, l'épuisement
préalable des recours internes subordonne l'action
internationale875. La règle s'applique également en
droit international des droits de l'homme et conforte l'idée selon
laquelle il est souhaitable que toute controverse relative aux droits de
l'homme soit portée à l'attention des autorités internes,
en particulier judiciaires876. En d'autres termes,
l'épuisement des voies de recours, c'est-à-dire
874 DEGNY-SEGUY(R.), Les droits de l'homme en Afrique
Noire francophone, Théories et réalités,
2ème ed. CEDA, Avril 2001, p.193.
875 Voy. notamment CIJ, Interhandel, (Suisse c.
Etats-Unis), arrêt sur les exceptions préliminaires du 21
mars 1959, Rec., 1959, p.27 : « La règle selon laquelle les recours
internes doivent être épuisées avant qu'une
procédure internationale puisse être engagée est une
règle bien établie du droit international coutumier ; elle a
été généralement observée dans les cas
où un Etat prend fait et cause pour son ressortissant dont les droits
auraient été lésés dans un autre Etat en violation
du droit international. Avant de recourir à la juridiction
internationale, il a été considéré en pareil cas
nécessaire que l'Etat où la lésion a été
commise puisse y remédier par ses propres moyens, dans le cadre de son
ordre juridique interne. ».
876 Pour un rappel, vo. Cour interam. Dr. h., Velasquez
Rodriguez c. Honduras, arrêt du 29 juillet 1988, fond, Série
C n°4, §61.
332
la saisine des juridictions doit être exercée au
plan interne, et n'avoir pas aboutie877. Elle vise avant tout
à préserver la souveraineté des Etats en leur permettant
de régler en interne les litiges qui les concernent. Elle se justifie
davantage par des considérations politiques que par des
impératifs juridiques liés au droit international des droits de
l'homme878. Elle fait ainsi écho à la logique de
subsidiarité du contentieux international des droits de l'homme et
à l'idée selon laquelle le premier garant des droits de l'homme
doit être le juge interne879. Les organes judiciaires
internationaux de protection n'interviennent pour leur part qu'afin de pallier
d'éventuelles déficiences de ce dernier. La Cour
Européenne rappelle l'importance de ce principe en soutenant qu'il est
« est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré
par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux
systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a la
charge de surveiller le respect par les Etats contractants de leurs obligations
au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux Etats
contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et
libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient
respectés et protégés au niveau interne. La règle
de l'épuisement des voies de recours internes est donc une partie
indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection
»880.
La règle relative à l'épuisement des
voies de recours est le plus souvent l'une des conditions qui demande le plus
d'attention aussi bien pour la saisine de la Cour africaine que pour les
comités des droits de l'enfant, au niveau universel et régional.
Cette condition semble être la plus contraignante, à en croire aux
garanties juridictionnelles accordées à l'individu dans les
juridictions nationales, notamment ivoiriennes, surtout quand il s'agit
d'attraire l'Etat devant le juge administratif. En effet, le requérant
est le plus souvent confronté à des nombreux obstacles qui
rendent cette condition très contraignante. Comme obstacle, le
coût élevé des frais judiciaires, la lenteur des
procédures judiciaires, et même la dépendance des juges
peuvent être un blocage, un frein à l'épuisement des voies
de recours.
877 HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), Traité de
droit international des droits de l'homme, Editions A. Pedone, 2016,
pp.499-514.
878 En ce sens, I. Brownlie, Principles of public
international law, Oxford : OUP, 1998, 5e éd., p.497.
879 En ce sens : Comité dr. h., T.K. c. France,
décision d'irrecevabilité du 8 novembre 1989, communication
n°220/1987, §8.3.
880 Cour eur. dr.h. , (GC), Demopoulos et autres c.
Turquie, décision d'irrecevabilité du 1er mars
2010, req. n°46113/99 et al., §69.
333
Ce blocage entraine le plus souvent, l'individu à
recourir vers un autre moyen qui lui permettra de défendre ses droits.
Ce genre de situations peuvent amener le justiciable à tourner le dos
aux juridictions nationales car les lenteurs de la justice ne sont rien d'autre
que les dénis de justice qui amène les justiciables à s'en
défier. Le justiciable qui compte exercer un recours devant la Cour
continentale ou régionale, pourrait se voir pris au piège, par
les juridictions nationales. Cependant, il semblerait qu'une marge de manoeuvre
est laissée au requérant, celui-ci pourrait contourner les
juridictions nationales.
- Une condition contournable
L'épuisement des voies de recours, condition cumulative
avec d'autres conditions tout aussi importante, peut être
contournable.
L'opportunité est accordée au requérant
qui ne peut obtenir de recours au niveau interne. Dans le cadre de la Cour
africaine, c'est l'article 56 paragraphe 5 de la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples qui tout en fixant une condition de recevabilité,
en pose ses limites. En effet, la requête doit être
postérieure « à l'épuisement des recours internes
s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission
que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale
». Cette impossibilité doit être due à un
prolongement anormal de la procédure judiciaire ou autre susceptible de
réparer le tort par lui subi.
Il en va ainsi des cas, où il n'existe pas de recours
internes, ou si ces recours sont inefficaces et illégaux. Comme exemple
topique, l'affaire Internationale Pen c/le Nigeria datée du 31 Octobre
1998 : il a été déclaré recevable, une
communication contre l'Etat du Nigeria, qui n'avait pas épuisé
des voies de recours internes. En fait, dans celle-ci, il était question
des décrets qui interdisaient aux tribunaux ordinaires d'examiner en
appel les décisions des tribunaux spéciaux. Cette interdiction
était assortie de sanctions pour quiconque tentait de le faire.
L'impossibilité d'épuiser les voies de recours internes, n'a eu
aucune incidence sur la recevabilité de la communication.
334
Aussi, la Commission africaine a clairement affirmé que
« la règle de l'épuisement des recours internes ne
s'applique que dans les situations où lesdits recours sont disponibles
et accessibles »881.
Par ailleurs, la Cour de Justice de la CEDEAO se
démarque particulièrement au niveau de ses règles de
procédure. En effet, celles-ci se distinguent des autres
procédures classiquement connues au niveau régional. Comme
l'affirme KANE Thierno, pour être audacieuse et précieuse, cette
innovation se veut totalement différente du dispositif institué
pour les Cours régionales en Europe et en Amérique : « ni
commission de filtrage des requêtes individuelles, ni exigence de
l'épuisement de voies de recours internes à l'image de ses
ainés »882. Dans ces conditions, ce système apparait
manifestement efficient, le requérant étant dispensé de
démontrer la preuve préalable de l'épuisement des voies de
recours internes.
La célérité de la procédure est
gage d'administration d'une bonne justice et non un handicap pour une garantie
effective des droits de l'enfant. Ce verrou procédural se trouve ainsi
levée par l'effet de cette technique, et entraine en conséquence
un afflux massif de requêtes auxquels se trouve confrontée la Cour
de la CEDEAO depuis 2005883.
Mieux, la Cour de Justice de la CEDEAO dans l'affaire «
Dame Hadijatou Mani Koraou c/ la République du Niger
»884 tout en admettant le caractère subsidiaire de
sa juridiction, ne manque pas non plus de désavouer la partie
défenderesse qui arguait que « « la saisine de la
juridiction communautaire est subordonnée à l'épuisement
des voies de recours internes »885. Ainsi pour KANE
Thierno, c'est donc à juste raison que la Cour de la CEDEAO affirma que
la protection des droits de l'homme par des mécanismes internationaux
tout en demeurant subsidiaire peut s'accommoder avec une interprétation
très
881 CoADHP, Affaire 54/91, 61/91, 164/97, 2010/98- Malawi
African Association, Amnesty International, Mme Sarr DIOP, Union Internationale
des droits de l'Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayant droits,
Association Mauritanienne des droits de l'Homme c. Mauritanie
882 KANE (T.), La Cour de justice de la CEDEAO à
l'épreuve de la protection des droits de l'homme, Université
Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, mémoire de maitrise
en sciences juridiques, 2012, disponible sur :
https://www.memoireonline.com/02/14/8706/La-Cour-de-Justice-de-la-CEDEAO--l-epreuve-de-la-protection-des-Droits-de-l-Homme.html
883 Ibidem
884 CJ CEDEAO Dame Hadijatou Mani Koraou c/ République
du Niger du 27 octobre 2008.
885 Ibid.
335
souple de la règle de l'épuisement des voies de
recours internes.886 Cette position semble d'ailleurs avoir été
déjà affirmé par la Cour Européenne des Droits de
L'Homme dans l'affaire Wilde, Ooms et Versyp c/ la Belgique du 18 juin
1971 , en ces termes : « conformément à
l'évolution de la pratique internationale, les Etats peuvent bien
renoncer au bénéfice de la règle de l'épuisement
des voies de recours internes »887. La lecture des
décisions de la Cour de justice de la CEDEAO offre de constater que ce
principe demeure une constante, quoique des Etats incriminés, ne cessent
de brandir et d'opposer l'argument tenant au non épuisement des voies de
recours internes par des requérants.
Il ressort de de cette analyse que le mécanisme de
protection institué par la CEDEAO pour préserver les droits de
l'homme est à bien des égards révolutionnaire et peut
constituer un mécanisme efficace de protection des droits de l'enfant.
Celui-ci tient principalement à la simplicité, à la
lisibilité de l'édifice institutionnel.
3. Les handicaps propres à la CPI inhibant son
efficacité
L'examen de la CPI révèle l'existence de nombre
d'handicaps susceptibles d'inhiber son efficacité dans la protection des
droits de l'enfant. Ces handicaps peuvent être recherchés au
niveau des limitations statutaires de compétence tenant aux pouvoirs du
procureur, celle tenant à la déclaration d'incompétence
fixées à l'article 124 du statut de Rome ainsi qu'à une
limite fonctionnelle tenant au manque d'instruments coercitifs.
S'agissant des limitations statutaires de compétence
tenant aux pouvoirs du Procureur, le statut de Rome confère au procureur
la mise en oeuvre de l'action répressive internationale. Ceci va
au-delà de son pouvoir d'agir « propio motu » et de
diligenter des enquêtes d'initiative. Cette faculté rend son
travail politiquement sensible. Son pouvoir discrétionnaire pose alors
problème888. Cette liberté de choix du procureur
découlant du pouvoir d'appréciation contenu aux articles 15 et 53
du statut de Rome suppose que le procureur peut engager des poursuites
lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux termes
886 KANE (T.), La Cour de justice de la CEDEAO à
l'épreuve de la protection des droits de l'homme, Université
Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, mémoire de maitrise
en sciences juridiques, 2012, disponible sur :
https://www.memoireonline.com/02/14/8706/La-Cour-de-Justice-de-la-CEDEAO--l-epreuve-de-la-protection-des-Droits-de-l-Homme.html
887 Cit. Par le juge de la CEDEAO dans l'arrêt, Dame
Hadjijatou Mani Koraou c/ la République du Niger.
888 Article 53 du statut de Rome.
336
du Statut de Rome ; mais cela n'a aucun caractère
obligatoire ou impératif à son égard. Ce qui apparait
somme toute dommage car en principe, le Procureur devrait engager des
poursuites dès lors qu'il existe des faits incriminés par le
Statut de Rome. Au regard des enjeux inhérents à l'action de la
CPI, juger dans un contexte politique, le pouvoir discrétionnaire du
Procureur ne peut que faire l'objet de controverses. Le procureur,
autorité compétente pour enclencher l'action répressive
bénéficie d'une large marge de manoeuvres dans la mise en oeuvre
de son pouvoir décisionnel. Cette faculté est contestable dans la
mesure où elle est présentée comme non respectueuse du
principe de l'égalité devant la justice et l'indépendance
des juridictions car elle permet à l'autorité poursuivante le
pouvoir de classement d'une affaire et ne reconnait pas aux seules juridictions
de jugement, le pouvoir de mettre fin à un procès. S'il refuse de
diligenter une enquête d'initiative, il ne peut y être contraint
même pas, par la chambre préliminaire. Il se doit juste d'aviser
ceux qui lui ont fourni les renseignements de son refus d'enquêter sans
qu'aucun recours ne lui soit accordé. Les critiques apportées aux
pouvoirs du Procureur sont motivées par la politisation de cette
fonction. Cela tient tout d'abord au fait que le plus souvent les vainqueurs
d'un conflit se servent de lui afin d'obtenir une sanction pénale contre
les perdants. En d'autres circonstances, ce pouvoir aurait constitué une
garantie d'efficacité contre la politisation de la juridiction à
supposer que le Procureur soit indépendant.
Le statut de Rome ne prédétermine pas les
situations justifiant l'ouverture d'une enquête ou des poursuites. Ce
pouvoir de choix de la nécessité de l'ouverture d'une
enquête entraine des reproches et des suspicions quant à ses
préférences à agir contre un individu ou dans le cas d'un
pays.
L'efficacité de la CPI dans la défense des
droits de l'enfant et la mise en oeuvre des exigences profondes de
l'humanité dépend aussi en grande partie de son pouvoir d'exercer
efficacement la compétence que lui confère son statut.
Toutefois, le statut de Rome recèle en lui-même
des clauses limitatives de compétence au nombre desquelles l'exemption
de compétence fixée à l'article 124 qui nuit, à
n'en point douter aux droits des enfants victimes de crimes de guerre.
Le statut de Rome recèle en lui-même plusieurs
clauses limitatives de la compétence de la CPI. Les Etats ont la
faculté de refuser la compétence de la CPI en matière de
crimes de
337
guerre selon les termes de l'article 124 du statut de Rome.
Cela veut dire que l'article 124 du statut de Rome prévoit qu'un Etat
partie au statut de Rome a la possibilité d'exclure, pour une
période de sept (7) ans à partir de son entrée en vigueur
la compétence de la CPI. Cela revient à instaurer pour les crimes
de guerre un régime différent de celui qui est applicable aux
autres crimes relevant de la compétence de la CPI. Cette disposition de
l'article 124 renverse le principe d'acceptation automatique de la
compétence de la CPI en introduisant une exemption spéciale pour
les crimes de guerre.
Cette situation soulève des interrogations :
existe-t-il une hiérarchisation parmi les crimes ? Pourquoi a-t-on
prévu un tel privilège au profit des Etats et au mépris
des droits des victimes à la réparation ? Le principe de
complémentarité des juridictions nationales déjà
exploitées machiavéliquement par des Etats comme la Côte
d'Ivoire n'est pas déjà un gros avantage au profit des Etats ? A
vrai dire, cela remet en question l'engagement d'un Etat à ne pas
commettre des crimes de guerre et donne l'impression que les crimes de guerre
sont moins graves que les autres crimes mentionnés dans le statut de
Rome. De plus cette disposition dite temporaire est susceptible de s'inscrire
dans une plus grande durée puisque loin d'être
considérée comme automatiquement caduque au bout des sept (07)
années. En effet, il est simplement prévu que l'assemblée
des Etats parties doit réexaminer cette disposition lors d'une
conférence ultérieure de révision du statut de Rome. Bien
que le statut de Rome ait interdit aux signataires de faire des
réserves, on constate que les réserves susceptibles d'être
faites y ont été déjà intégrées, et
nuisent aux droits de certains enfants et aux droits de toute autre personne
victime de crimes de guerre. La raison sur laquelle s'appuie un Etat partie au
Statut de Rome pour exclure la compétence de la CPI en matière de
crimes de guerre consiste souvent dans la volonté de protéger ses
militaires au cours de leurs missions à l'étranger. Ce faisant,
on légifère sur le droit de tuer sans être jugé
durant sept ans et restreint largement la compétence de la CPI.
Une limite fonctionnelle tenant au manque d'instruments
coercitifs inhibe également l'efficacité de la Cour pénale
internationale.
Comme les tribunaux spéciaux, la CPI a besoin de la
coopération des Etats pour mener à bien des enquêtes et
poursuites. C'est pourquoi, le statut de Rome consacre un chapitre à
338
cette nécessaire coopération des Etats à
son action889. Même si les Etats ne font pas obstruction aux
activités de la CPI, cette dernière est dans
l'impossibilité de mener directement des investigations. Par ailleurs,
elle ne dispose pas d'une force de police pour exécuter ses
décisions. Elle devient ainsi impuissante et incapable de
protéger les enfants victimes quand les Etats refusent de collaborer
avec elle.
La CPI ne peut mener des investigations qu'avec le
consentement des Etats qui l'autorisent donc à le faire sur le
territoire. Du fait d'ailleurs qu'elle ne dispose pas d'un effectif assez
conséquent pour mener à bien ses investigations, elle recourt
toujours aux structures étatiques pour l'accompagner dans cette
tâche. Ce faisant, elle est parfois limitée dans les informations
qui lui sont transmises car les Etats sont amenés à faire une
rétention d'informations pour diverses raisons. Si la CPI avait la
possibilité de mener directement ses investigations, elle pourrait
rentrer en possession de certaines informations sans forcément recourir
aux Etats. Non seulement la CPI se retrouve dans l'impossibilité de
mener directement des investigations, mais elle ne dispose pas également
d'une force d'exécution de ses décisions.
En principe, en s'inspirant des difficultés auxquelles
étaient confrontés les tribunaux pénaux internationaux
l'ayant précédé, on aurait dû penser à la
dotation d'une force de police ou d'exécution de ses décisions.
On ne devrait pas seulement miser sur la coopération avec les Etats. Si
la CPI disposait de sa propre force de police, elle la lancerait à la
recherche des présumés auteurs de violations graves des droits de
l'enfant, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. La force de police ici
souhaitée, est une force en vue d'exécuter les ordres de la
juridiction. C'est pour lui permettre de faire preuve de
célérité dans les dossiers qu'il est nécessaire
qu'elle se dote d'une telle force. Avec cette force, les auteurs
présumés savent qu'ils seront traqués et ne pourront plus
bénéficier de la complicité passive des forces de police
des Etats qui auraient initialement pour mission de les appréhender. A
défaut d'une force de police propre, la CPI peut recourir à des
forces multinationales relevant directement du Conseil de
sécurité et qui sont déployées dans le cadre
d'opérations internationales de restauration de la paix. La CPI se doit
de modifier la donne. Une force de paix déployée dans un Etat en
crise interne ou en conflit avec un voisin pourrait se voir confier par le
CSNU, explicitement, la tâche de rechercher et d'arrêter des
auteurs de crimes relevant de la
889 Article 86 intitulé « obligation
générale de coopérer ».
339
compétence de la CPI, si ce n'est pas le CSNU qui
l'aurait saisie. Cette proposition pourrait trouver son fondement dans
l'alinéa 6 de l'article 87 du statut de Rome. Tout dépend de la
volonté des Etats membres du CSNU. La résolution datée du
28 mars 2013, du CSNU sur la République Démocratique du
Congo(RDC)890 en est une illustration. Cette résolution a
décidé le déploiement « à titre exceptionnel
et sans créer de précédent » d'une « brigade
d'intervention » chargée de « neutraliser » et de
désarmer les groupes menaçant l'autorité de l'Etat et la
sécurité des civils dans l'est du pays. Si ce n'est pas le cas,
elle risque de ne jamais mettre la main sur certains présumés
auteurs de crimes relevant de la compétence de la CPI, au nombre
desquels les infractions graves portant sur les enfants.
CONCLUSION DU TITRE 2
Conscient que l'enfant ne peut limitativement contribuer
à la garantie de ses propres droits, la détermination des droits
à lui reconnus entraine une modulation supplémentaire du
rôle des acteurs du système de protection, d'application et de
contrôle des droits de l'enfant. Dès lors, des structures
politiques, judiciaires et sociales de base ont été mises en
place pour garantir à l'enfant, l'effectivité de ses droits.
L'appréciation sur le fonctionnement de ses structures au profit de
l'enfant offre de voir les nombreuses limites et défis qui entourent
leur efficacité dans la réalisation de leurs missions. En effet,
en l'état actuel, l'encadrement de l'enfant par la famille est encore
insuffisant, pendant que l'implication de l'Etat reste inefficiente
comparativement à son rôle sans cesse croissant tant au niveau des
organes internes qu'internationaux, et les moyens restent parfois
inadaptés. Les organes anciens et nouveaux de protection et de
contrôle des droits de l'enfant au niveau national comme international
offrent de noter que les mesures anciennes et nouvelles sont certes des
réponses apportées par ces organes dans l'exercice de leurs
fonctions respectives dans la réalisation des droits de l'enfant mais,
elles mettent aussi en lumière les difficultés réelles des
organes nationaux et internationaux, et notamment celles de l'Etat ivoirien
qui, incontestablement apparait comme le dernier recours possible des familles
et de l'enfant.
890 28 mars 2013-conseil de
sécurité-Résolution 2098.
340
Somme toute, les mécanismes nationaux, internationaux
de promotion, de protection et de contrôle des droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire, apparaissent comme des instruments généreux
dans la proclamation des droits précis qui puissent permettre
d'anéantir le venin de leur faiblesse. Malgré ses limites, ce
stade de l'embellie juridique et institutionnelle est franchi. Mais l'ultime
étape reste l'effectivité de ces droits proclamés au
regard des faits. Sur ce plan des incertitudes demeurent au regard de
l'effectivité de la protection des droits de l'enfant à
l'épreuve des réalités locales.
341
Seconde partie :
L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES
DROITS DE L'ENFANT A L'EPREUVE DES
REALITES LOCALES
Il ne s'agira pas ici de reprendre des considérations
théoriques relatives aux droits de l'enfant, qui au demeurant, ont
été analysées dans la première partie.
L'utilité de cette partie ne peut être réellement ressentie
que si et dans la mesure où il s'attache à éclairer la
spécificité de l'état des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire au regard des réalités locales. Nous nous assignons, en
conséquence, de montrer ce que les faits offrent au regard. En d'autres
termes, ici plus qu'ailleurs, il convient d'aller au-delà de ce que
suggère le texte pour tenir compte du contexte, qui ne s'accorde pas,
toujours, tant s'en faut, avec les règles qui sont
réputées le régir. Le texte, en bien des cas sert
d'habillage, voire de camouflage à des réalités dont on
voudrait cacher la nudité891. L'expression «
paradoxe édifiant892 » usité par Claire
Brisset, apparait approprié au regard des faits. En effet, pour
être utile, cette expression oppose la réalité des
conditions de vie de nombre d'enfants en Côte d'Ivoire aux
indéniables progrès du droit. La situation des enfants non
déclarés, des enfants non scolarisés, des enfants
abusés sexuellement, des enfants soldats, etc... en est une
illustration. Il en va de même des droits économiques, sociaux et
culturels reconnus aux enfants. Ce paradoxe est stupéfiant en raison du
décalage parfois notoire qu'il met en exergue mais aussi, en raison de
l'effet de tolérance devant l'inacceptable. C'est donc un truisme
d'affirmer que la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombre de pays
africains est le théâtre des atteintes plurielles aux droits de
l'enfant. Ces atteintes revêtent des formes diverses et précises
qu'il importe d'examiner avant de tenter d'en rechercher des remèdes
appropriées.
Ainsi après avoir mis en lumière les
manifestations préoccupantes de l'ineffectivité (Titre
1), nous proposerons d'identifier les conditions d'une
effectivité améliorée (Titre2).
342
891 WODIE (F.), Institutions politiques et droit
constitutionnel en Côte d'Ivoire, PUCI, 1996, p.29.
892 BRISSET (C.), Un monde qui dévore ses
enfants, Liana Levi, Paris, 1997, p.46.
343
Titre I : DES MANIFESTATIONS PREOCCUPANTES DE
L'INEFFECTIVITE
344
L'ineffectivité se traduit par des manifestations
préoccupantes et multiformes portant atteinte aux droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire. Par l'expression « manifestations
préoccupantes de l'ineffectivité », on se
réfère ici aux violations et abus inhibant l'effectivité
optimale des droits de l'enfant.
On le sait : les «violations des droits de
l'homme» recouvrent des transgressions par les États, des
droits garantis par le droit national, régional et international et les
actes et omissions directement imputables à l'État comportant un
manquement à la mise en oeuvre d'obligations légales
dérivées des normes concernant les droits de
l'homme893. Les violations interviennent lorsqu'une loi, une
politique ou une pratique contrevient délibérément
à, ou ignore délibérément, des obligations
incombant à l'État, ou lorsque l'État s'abstient d'une
norme de conduite requise ou d'un résultat requis. Des violations
supplémentaires interviennent lorsqu'un État déroge
à ou supprime des protections des droits de l'homme existantes. Tous les
droits humains (civils, culturels, économiques, politiques et sociaux)
imposent aux États trois types d'obligations distinctes : respecter,
protéger, et faire. Le manquement d'un État à l'une
quelconque de ces obligations constitue une violation des droits de l'homme.
Bien que la réalisation entière de certains aspects de certains
droits ne soit possible que de manière progressive, cela n'altère
pas la nature des obligations légales des États, et ne signifie
pas non plus que tous les droits comportent des composantes qui sont toujours
sujettes à une application immédiate.
Pour ce qui concerne spécifiquement les droits
économiques, sociaux et culturels, des violations peuvent intervenir
aussi lorsque l'État manque à satisfaire « les niveaux
minimums essentiels des droits » énoncés par le
Comité international des droits économiques et sociaux (ICESCR),
et donc un État où « toutes personnes en nombre
significatif sont privées d'aliments essentiels, de soins de
santé primaires essentiels, d'abri et de logement de base, ou des formes
les plus élémentaires de l'éducation, se trouve, à
première vue, en violation de l'ICESCR ». Ces obligations
minimales de base s'appliquent sans égard à la
disponibilité de ressources dans le pays concerné, ni à
quelque autre facteur ou difficulté.
Toute discrimination fondée sur l'allégation de
la race, la couleur, le sexe, la langue, l'opinion politique ou autre,
l'origine nationale ou sociale, la richesse, la naissance ou tout
893 Haut-commissariat aux droits de l'homme, Série sur
la formation professionnelle n°7, Manuel de Formation sur le
Monitoring des droits de l'homme, 2004, p.38.
autre statut ayant pour effet d'annihiler ou d'altérer
l'égale jouissance ou exercice de tout droit de l'homme est constitutive
d'une violation des droits de l'homme.
L'expression « abus des droits de l'homme »
qui se veut plus large que violations, recouvre les atteintes aux droits
humains commises par la conduite des acteurs non étatiques (Individus,
entreprises...)894.
Dans ce titre premier, nous essayerons donc d'analyser les
atteintes aux droits de l'enfant en période de paix (Chapitre 1)
avant d'analyser le cas particulier des atteintes en situation
d'urgence ou de guerre (Chapitre 2).
345
894 Ibid.
346
Chapitre I :
LES ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT EN PERIODE DE
PAIX
A l'image des Nations dites développées qui sont
confrontées à de grandes questions touchant la dignité
humaine, la vie, et qui préoccupent actuellement toute l'humanité
à savoir le clonage humain, l'euthanasie, l'avortement..., la Côte
d'Ivoire, à l'instar de nombre de pays africains a aussi ses
préoccupations du fait de sa culture. Ici, il s'agira d'évoquer
quelques tares de la culture ivoirienne, qui ont résisté
malheureusement au temps et qui compromettent son intégration dans le
processus d'universalisation et d'unification des cultures par la
mondialisation, en entamant sa contribution à la tradition universelle
des droits de l'enfant. Comme on l'a constaté plus haut, l'arsenal
normatif et institutionnel en Côte d'Ivoire est relativement dense. Il
existe une véritable prise de conscience ; mais quelle est la
réalité de la situation des enfants sur le territoire ivoirien ?
Suffit-il de proclamer des droits pour qu'ils soient effectifs ? En Côte
d'Ivoire comme ailleurs dans le monde, les réalisations ont
été inversement proportionnelles aux promesses comme l'affirmait
le Secrétaire général Koffi Annan dans son rapport sur les
enfants895. Les droits de l'enfant continuent
toujours à faire l'objet de violations qui ne sont souvent pas
sanctionnées. Ces violations existent dans toutes les
sociétés, mais prennent une ampleur grave en Afrique, et
singulièrement en Côte d'Ivoire. A défaut de mettre en
lumière toutes les formes d'atteintes aux droits de l'enfant, nous
mettrons l'accent sur celles qui nous paraissent les plus importantes au regard
de leur gravité. Ainsi, analyserons-nous successivement les atteintes
liées à la survie, au développement personnel et à
la participation de l'enfant (Section 1) avant de nous
appesantir sur les atteintes aux enfants contre toute forme d'abus
(Section 2).
895 ONU, Rapport du Secrétaire
général « Nous, les enfants : examen de fin de
décennie de la suite donnée au Sommet mondial pour les enfants
» (A/S-27/3) du 4 mai 2001, examiné par le Comité
préparatoire de la session extraordinaire de l'Assemblée
générale consacrée aux enfants, lors de sa
troisième session, en juin 2001.
347
SECTION I. DES ATTEINTES LIEES A LA VIE ET AU
DEVELOPPEMENT PERSONNEL DE L'ENFANT
Les manifestations des violations affectant l'existence et la
survie de l'enfant (Paragraphe 1), une diversité
d'atteintes au droit à l'éducation et au développement
personnel des enfants (Paragraphe 2) et les atteintes aux
formes de participation des enfants (Paragraphe 3) seront
successivement mises en exergue.
§ 1. DES MANIFESTATIONS DES VIOLATIONS AFFECTANT
L'EXISTENCE ET LA SURVIE DE L'ENFANT
Elles sont manifestes à travers les atteintes au droit
à l'identité et à la nationalité des enfants
(A) mais aussi via celles afférentes à la
santé de l'enfant (B).
A. LES ATTEINTES AU DROIT A L'IDENTITE ET A LA
NATIONALITE DES ENFANTS, UNE NEGATION DU DROIT A L'EXISTENCE
JURIDIQUE
La négation du droit à l'existence juridique des
enfants s'explique par l'existence d'enfants non déclarés
(1) et d'enfants apatrides (2).
1. Des enfants non déclarés
L'enregistrement des naissances consiste à faire
enregistrer par les autorités administratives, la naissance des enfants.
Le deuxième paragraphe de l'article 24 du PIDCP ajoute le droit de
l'enfant d'être enregistré immédiatement après la
naissance et d'avoir un nom, dans le but de réduire les risques
d'enlèvement, de vente ou de traite d'enfants et les autres traitements
contraires aux droits prévus dans le Pacte896.
Consacrée par la Convention relative aux droits de
l'enfant en son article 7897, l'obligation de déclaration des
naissances est affirmée depuis 1964 par la loi ivoirienne et stipule que
la déclaration est gratuite, et doit se faire dans les trois mois qui
suivent la naissance898.
896 HENNEBEL (L.), La jurisprudence du Comité des
droits de l'homme des Nations Unies, Bruxelles : Bruylant, 2007, p.290.
897 Article 7 alinéa 1 CIDE : « L'enfant est
enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaitre ses parents et d'être
élevé par eux. ».
898 Article 41 loi 99-691 ; voir aussi BROU KOUAKOU (M.),
Cours de droit civil, droit des personnes, droit de la famille, Les
éditions ABC, 2013, p.123.
348
Dès la naissance, les parents ont le devoir de
déclarer le nom, le prénom et la date de naissance du
nouveau-né auprès des autorités. La déclaration de
naissance est un support préalable à la réalisation des
droits de l'enfant car elle atteste de son existence officielle899.
Déclarer un enfant, c'est implicitement actionner en sa faveur tous les
mécanismes de protection : accès à des services de base,
dont la vaccination, les soins de santé et l'inscription dans un
établissement scolaire900.
En enregistrant la naissance, l'État reconnaît
officiellement l'existence de l'enfant et officialise son statut au regard de
la loi. Par ailleurs, grâce à cet enregistrement sur les registres
de l'état civil, un enfant pourra établir sa filiation,
c'est-à-dire les liens de parenté qui l'unissent à son
père et à sa mère.
L'identité permet l'intégration de chaque enfant
au sein de la société. L'enregistrement de la naissance de
l'enfant et l'attribution de sa nationalité lui octroient sa
capacité juridique ou sa capacité de jouissance901.
Cela signifie que, comme toute personne, il sera officiellement reconnu en tant
que membre de la société et qu'il sera titulaire de droits et
obligations. Le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et la
nationalité de la personne sont nécessaires à la
compréhension du droit à l'identité. Grâce à
ces informations, une personne devient un sujet de droit (détenteur et
obligataire de droit).
Cette identité permettra aussi à l'enfant de
bénéficier d'une protection juridique par le biais de ses parents
et de l'État. Il pourra ainsi bénéficier du régime
de protection des mineurs de son pays, qui le protégera notamment contre
les diverses formes de maltraitance et d'exploitation.
Par ailleurs, les enfants délinquants
bénéficieront du régime des peines pour mineurs qui est un
régime de peines adapté à leur âge, leur
discernement et leur maturité.
À l'inverse, un enfant sans identité sera
invisible aux yeux de la société et ne bénéficiera
pas d'une protection et des services sociaux essentiels à son
développement.
899 KOMAN (Y.G.), La convention relative aux droits de
l'enfant : vers une évolution des droits d'expression et de
défense des intérêts de l'enfant en Côte d'Ivoire ?
, Mémoire de fin de cycle, E.N.A Côte d'Ivoire, p.14.
900 Ibidem.
901 Dans ce sens, ABACACI (A.), VIORICA (D.) HAGEANU (C.),
Droit civil. Les personnes. Maison d'Edition All Beck, Bucarest, 2004,
p.41. ; COCA-COZMA (M.), GRACIUNESCU (C.M.), LEFTERACHE ( L.V.), La justice
pour les mineurs, Etudes théoriques et de jurisprudence. L'analyse des
modifications législatives dans le domaine, maison d'édition
Universul Juridic, Bucarest, 2003, p.371.
349
Malheureusement, de nombreux enfants sont toujours non
déclarés en Côte d'Ivoire. Ainsi, en 2000, deux tiers des
naissances des enfants de moins de 5 ans étaient encore non
enregistrés902. En 2006, cette proportion avait reculé
pour atteindre un peu plus de la moitié des enfants, soit
55%903. Suivant les conclusions de l'EDSCI-III 2011-2012, 35 % des
enfants de moins de 5 ans et 24% des enfants de 0-17 ans n'existaient pas
légalement, faute d'avoir été enregistrés à
l'état civil904 ; on estime que 65% des enfants de moins de 5
ans ont été déclarés à l'état civil,
mais seulement 45% avaient un acte de naissance. Le taux d'enregistrement est
plus élevé chez les enfants de 15 à 17 ans (85%).
Aujourd'hui, on estime à 2.800.747 le nombre d'enfants de 0 à 17
ans non enregistrés, dont près de 1, 3 millions de moins de 5 ans
et 1.552.236 enfants en âge de scolarisation (5-17 ans)905.
Malheureusement, ce report de la déclaration entraine les parents dans
des procédures judiciaires complexes et couteuses, pour l'obtention d'un
jugement supplétif.906
L'amélioration de la situation globale entre 2006 et
2012 cache de grandes disparités entre les enfants selon la
région où ils habitent, le milieu dans lequel ils vivent (urbain
84%, rural 47%) et le niveau de vie (plus pauvre 36% plus riches
90%)907. En milieu rural, le problème de l'enregistrement des
naissances se pose avec acuité : trois enfants sur cinq de moins de 18
ans sont enregistrés par rapport à neuf sur dix en milieu urbain.
Dans ces régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Nord, seulement un
enfant sur cinq de moins de 18 ans possède l'extrait de naissance. Des
disparités énormes sont observées entre les zones rurales
ou urbaines. Les femmes en milieu rural accouchent au village alors qu'en
milieu urbain elles peuvent plus facilement avoir accès à des
maternités où la déclaration est facilitée.
902 UNICEF, Analyse de la situation de l'Enfant en
Côte d'Ivoire 2014 « vers une société plus
équitable dans pays émergent », Octobre 2014, p.55.
903 UNICEF, Analyse de la situation de l'Enfant en
Côte d'Ivoire 2014 « vers une société plus
équitable dans pays émergent », Octobre 2014, p.55.
904 Idem.
905 Idem.
906 Voir articles 82 à 84 de la loi ivoirienne relative
à l'état civil ; aux termes de l'article 82 : « le
défaut d'acte de l'état civil peut-être supplée par
jugement rendu sur simple requête présentée au tribunal ou
à la section du tribunal du lieu où l'acte aurait dû
être dressé » ; Pour une déclaration de naissance
à l'état civil non faite dans le délai : TPI Gagnoa,
jugt n°139 du 10/08/2005, inédit).
907 UNICEF, Analyse de la situation de l'Enfant en
Côte d'Ivoire 2014 « vers une société plus
équitable dans pays émergent », Octobre 2014, p.55.
350
Ces nombreux enfants non déclarés n'existent pas
aux yeux de la loi. Puisqu'on ne connait pas leur âge, ils n'auront pas
la protection minimale conférée aux mineurs, contre les mariages
précoces, le travail des enfants, la détention et les poursuites
judiciaires, l'enrôlement dans les forces armées. Ils ne
bénéficient d'aucune protection, contre l'abus et l'exploitation.
Un enfant non enregistré sera une marchandise plus attirante pour un
trafiquant d'enfants. L'invisibilité des enfants non enregistrés
fait que la discrimination, l'abandon et les abus dont ils sont victimes auront
plus de risque de passer inaperçus. Plus tard, il leur sera impossible
d'obtenir un passeport, de solliciter un emploi reconnu, d'ouvrir un compte en
banque, de contracter un mariage légal, de se présenter à
des élections, ou de voter. En un mot, cette frange de la population se
trouve donc potentiellement exclue du bénéfice de certains
services sociaux de base y compris la protection spéciale due aux
mineurs. Les enfants non enregistrés d'aujourd'hui, qui deviendraient
des adultes de demain, seraient en marge de la vie économique,
au-delà de la compromission de leur participation citoyenne. Il en va
ainsi de l'apatridie qui frappe nombre d'enfants vivant en Côte d'Ivoire.
Pour être une éventuelle conséquence de la non
déclaration des naissances, la situation des enfants apatrides constitue
manifestement un déni de leur droit à la nationalité.
2. Des enfants apatrides
Au sens juridique, la nationalité des personnes
physiques présente un double caractère interne et
international908.
D'une part, de ce premier point de vue, il appartient à
tout Etat souverain de régler par sa propre
législation909, l'acquisition de sa nationalité et au
demeurant, de déterminer qui sont ses nationaux, et quelles
règles s'appliquent à eux910, indépendamment du
fait qu'ils se trouvent sur son territoire911, et distinctes de
celles applicables aux étrangers. Du fait que le droit international
laisse à chaque Etat le soin de régler l'attribution de sa
propre
908 DUPUY (P-M) et KERBRAT (Y.), Droit international
public, 13e édition, Dalloz, 2016, p.94.
909 Affaire Nottebohm, (Lichtenstein C. Guatemala),
Arrêt de la Cour Internationale de Justice, 6 avril, 1955,
Recueil 1955, p.20.
910 GUTMAN (D.), Droit international privé,
4e édition Dalloz, 2004, p.308 et 310.
911 DUPUY (P-M) et KERBRAT (Y.), Droit international
public, 13e édition, Dalloz, 2016, p.94.
351
nationalité912, a fortiori, il en
fait un attribut exclusif de l'Etat, à savoir le lien juridique de
rattachement effectif de l'individu à un Etat913.
D'autre part, de ce second point de vue, s'il revient à
chaque Etat de déterminer sa nationalité conformément
à son droit interne, le droit international lui impose cependant des
limites à l'octroi de sa
nationalité914. C'est ainsi que selon la
résolution A/RES/55/153 de l'Assemblée générale des
Nations Unies relative à la nationalité des personnes physiques
en relation avec la succession d'Etats, elle « relève
essentiellement du droit interne, dans les limites tracées par le droit
international »915. Aucun Etat, quel qu'il soit, ne peut
donc imposer sa nationalité de manière arbitraire ou en violation
des règles coutumières916. Ce qui signifie que si la
nationalité est essentiellement régie par la législation
nationale, en revanche, la compétence de l'Etat n'est en la
matière, ni exclusive, ni totalement discrétionnaire, puisqu'il
ne peut, ni ignorer, ni contrarier les conventions existantes dans ce domaine.
Il n'existe pas, au profit de toute personne, un droit à la
nationalité917. Plus précisément, le droit
à la nationalité, s'il existe, n'appartiendrait qu'aux seuls
nationaux, conformément aux législations en vigueur.
Cette tautologie compréhensible veut simplement dire
que le droit né de l'appartenance nationale est un droit
intrinsèquement lié à la nation et, pour y
prétendre, il faut au préalable réunir les conditions
d'appartenance à cette nation et, donc les conditions de jouissance de
la nationalité procédant de cette appartenance. C'est que le
principe de la souveraineté de l'Etat, complété par des
velléités de nationalisme, domine tout le régime de la
nationalité.
912 Affaire Nottebohm, Arrêt
précité, p.23.
913 Ibidem, p.23.
914 SFDI, Droit international et nationalité,
Colloque de Poitiers, Paris, Pedone, 2012, 528p. (Ouvrage collectif portant sur
l'ensemble des aspects du droit à la nationalité en droit
international).
915 Sur le rapport de la sixième commission (A/55/610,
l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté la
résolution 55/153 relative à la nationalité des personnes
physiques en relation avec la succession d'Etats, voir documents officiels de
l'Assemblée générale, cinquante quatrième session,
supplément n°10 et rectificatif (A/54/10 et corr.2).
916 Reuter (P.), Institutions Internationales, P.U.F,
1955, p.114.
917 Sauf à donner un caractère obligatoire
à l'article 15 de la DUDH qui péremptoirement, affirme, sans en
donner les moyens de réalisation, que « Tout individu a droit
à une nationalité » et que « Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité », DE SCHUTTER (O.), TULKENS (F.) et VAN DROOGHENBROECK
(S.), Code de droit international des droits de l'homme,
Bruxelles-Avers, Bruylant-Maklu, 2000, 526p (rééd.2003, 767
p.).pp.15-16 ; voir aussi, FULCHIRON (H.), « Les enjeux contemporains du
droit français de la nationalité à la lumière de
son histoire », Pouvoirs, 1/2017 (n°160), p.717.
352
Sans préjudice des « droits acquis
», ce principe domine en effet tout le régime juridique
ivoirien de la nationalité et conduit à constater qu'en droit
ivoirien, il n'existe pas un droit « à », mais
plutôt un droit « de » la nationalité.
L'état actuel du droit de la société internationale
encourage également ce genre de régime918. La
nationalité est le lien juridique et politique qui rattache un individu
à un Etat. Elle est le lien le plus fréquent entre un Etat et sa
population. Selon la Cour internationale de justice (CIJ), la
nationalité est l'expression juridique du fait que l'individu auquel
elle est conférée est plus étroitement rattaché
à la population de l'Etat qui la lui confère qu'à celle de
tout autre Etat919. La CIJ la définit ainsi dans
l'arrêt Nottebohm : « La nationalité est un lien
juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une
solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments
jointe à une réciprocité de droits et de devoirs.
»920. Chaque Etat détermine et désigne librement
ses nationaux. Les conditions d'acquisition de la nationalité sont
déterminées, de façon discrétionnaire et sous
réserve des engagements internationaux921, par le droit
national. Elles peuvent ainsi différer d'un Etat à l'autre. C'est
là une question que le droit international laisse à la
compétence discrétionnaire de chaque Etat ; et cette question de
nationalité peut être réglée soit par la
Constitution, soit par une loi.
Pour les personnes physiques, la nationalité est
conférée soit initialement par la filiation (Jus
sangunis) et/ou le lieu de naissance (Jus soli), soit
ultérieurement par le mariage, l'adoption, la naturalisation ou le choix
qui est exceptionnellement possible.
Manifestant à cet égard son entière
souveraineté et son indépendance, le droit positif ivoirien
organise son droit de la nationalité en définissant non seulement
ce qu'il entend par
918 Il est faux à cet égard, d'affirmer qu'un
certain droit international ferait obligation aux Etats d'accorder, nolens
volens, la nationalité à certaines catégories
spécifiques. Aux termes, en effet, de la Convention sur la
réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961, texte
généralement évoqué au soutien d'une telle
thèse, les Etats parties à cette convention internationale
avaient convenu, certes, qu' « ...il (était) souhaitable de
réduire les cas d'apatridie par voie d'accord international »
et d'accorder, dans ce cadre, la nationalité à des personnes qui,
nées, sur leur territoire, ne pourraient autrement obtenir une autre
nationalité que celle à laquelle elles peuvent prétendre.
Mais, cette attribution de la nationalité se fait nécessairement
aux conditions souverainement posées par chaque Etat à
l'acquisition de sa nationalité. Pour le texte de cette convention,
consulter
http://www.unhcr.fr/53be5ad09.html
(consulter le 15/03/2016).
919 BESSON (S.), Droit international public,
abrégé de cours et résumés de jurisprudence,
Stampfli Editions, 2011, p.34.
920 Rec. CIJ 1955 p. 4/23.
921 Cf. Avis consultatif sur les décrets de
nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, 1923, CPJI
Série B n°4 p.7.
353
ivoirien c'est-à-dire en édictant les
critères d'attribution de la nationalité ivoirienne, et d'autre
part, en posant les conditions d'acquisition de la nationalité
ivoirienne.
En Côte d'Ivoire, la question de la nationalité
est régie par la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant
Code de la nationalité ivoirienne modifié par la loi du 07
octobre 1964 et la loi n°72-852 du 21 décembre 1972. L'article
1er, alinéa 1er de ce code énonce : «
La loi détermine quels individus ont à leur naissance la
nationalité ivoirienne à tire de nationalité d'origine
». Le problème fondamental qui se pose, ici, est celui de
savoir comment s'acquiert cette nationalité : par le sol ? Ou par le
sang ? Ou encore par le sang et par le sol, à la fois ?
Se prononçant sur la question, Monsieur Koménan
Roland ZAKPA soutient que l'Etat de Côte d'Ivoire ne retient que la
nationalité par le sang car « si le législateur dans la
loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 avait prévu dans
l'acquisition de la nationalité ivoirienne le principe du droit du sol
(jus soli) , il faut se rendre à l'évidence que
le choix a été clair avec la modification législative du
21 décembre 1972 qui a exclu le principe du jus soli dans notre
nationalité »922. Au soutien de sa thèse, il
allègue : « en effet, les articles 17 et suivants de la loi
prévoyaient des cas de nationalité ivoirienne au
bénéfice des étrangers en raison de leur naissance et de
leur résidence sur le sol ivoirien. Ainsi donc l'enfant mineur
né en Côte d'Ivoire, de parents étrangers, pouvait
réclamer la nationalité ivoirienne par déclaration si,
à la date de sa naissance, il avait en Côte d'Ivoire sa
résidence habituelle depuis au moins cinq années
consécutives et si la preuve de sa naissance résultait d'une
déclaration à l'état civil. Dans la même veine, les
enfants nés en Côte d'Ivoire d'agents diplomatiques ou de consuls
de carrière de nationalité étrangère pouvaient
également réclamer la nationalité ivoirienne. Il en
était de même de l'enfant né en Côte d'Ivoire de
parents étrangers, de l'enfant confié depuis cinq années
au moins à un service public ou privé d'assistance à
l'enfance et enfin de l'enfant qui, ayant été recueilli en
Côte d'Ivoire, y a été élevé par une personne
de nationalité ivoirienne. Toutes ces règles qui consacraient
dans la législation ivoirienne, la nationalité par le droit du
sol ont été abrogées comme pour indiquer que notre pays ne
reconnait que la nationalité par le jus sanguinis923.
».
922 ZAKPA (R.K.), Code de la nationalité et code
électoral, in Réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire.
La question de l'éligibilité, Actes du Séminaire
international de l'ADIR, PUCI, Janvier 1999, p.114.
923 Idem. p.115.
354
On ne peut le nier : ce raisonnement comporte quelques
vérités. Toutefois, on ne peut y adhérer sans
réserve.
Au fond, la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 qui
modifie celle du 15 décembre 1961 ne reconnait pas un seul
système. Plutôt, elle retient les deux systèmes que sont :
le jus soli (droit du sol), et le jus sanguinis (droit du
sang). Tout d'abord, en vertu de son article 6, est ivoirien, l'enfant
né en Côte d'Ivoire (jus soli), sauf si ses deux parents
sont étrangers (jus sanguinis). Ensuite, aux termes de son
article 7 « est ivoirien l'enfant né à l'étranger
(jus soli) d'un parent ivoirien (jus sanguinis) ».
Il ressort ainsi clairement de la loi de 1972 une
consécration expresse, à la fois, du jus soli et du
jus sanguinis. Mais, un constat s'impose : il apparait dans cette loi
précitée, une prééminence patente du jus
sanguinis sur le jus soli : celui-là prime celui-ci, car
tout enfant qui naît d'un parent ivoirien est ipso facto
Ivoirien ; en d'autres termes, l'Ivoirien ne peut naitre que d'un
Ivoirien. D'où le fait de naître d'un parent ivoirien est une
condition nécessaire et suffisante pour que l'enfant acquière, de
manière originaire, la nationalité ivoirienne.
Contrairement à l'opinion du Professeur Komenan Roland
ZAKPA qui n'est guère satisfaisante, ni soutenable, celle du Doyen
Francis Vangah WODIE mérite pleine adhésion car il affirme :
« L'article 6 de la loi ivoirienne dispose que tout individu né
en Côte d'Ivoire est ivoirien, sauf si ses deux parents sont
étrangers. L'article 7 ajoute : est ivoirien l'individu né en
Côte d'Ivoire d'un parent ivoirien). C'est la nationalité
d'origine successivement et émulativement régie par le jus soli
et le jus sanguinis924 ».
Pareillement, cette position a été retenue par
les accords de Linas Marcoussis. En effet, c'est du 15 au 23 janvier 2003 que
s'est tenue à Linas-Marcoussis (France) une Table Ronde des forces
politiques ivoiriennes, à l'invitation du Président de la
République française. Ont pris part à cette rencontre : le
Front Populaire Ivoirien (FPI), le Mouvement des Forces d'Avenir (MFA), le
Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI), le Mouvement Populaire
Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO), le Parti Démocratique de Côte
d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain ( PDCI-RDA), le Parti
Ivoirien des Travailleurs (PIT), le Rassemblement Des Républicains
(RDR), l'Union Démocratique et Citoyenne
924 WODIE (F.), Institutions politiques et droit
constitutionnel en Côte d'Ivoire, op. cit.p.65.
355
(UDCY) et l'Union pour la Démocratie et la Paix en
Côte d'Ivoire (UDPCI). Les travaux ont été
présidés par Monsieur Pierre MAZEAUD. Ce dernier était
assisté du juge Kéba MBAYE, de l'ancien Premier Ministre Seydou
Diarra et de facilitateurs désignés par l'ONU, l'Union Africaine
et la CEDEAO.
La Table Ronde de Linas-Marcoussis a estimé que la loi
n°61-415 du 14 décembre 1961 portant code de
nationalité925 ivoirienne modifiée par la loi
n°72-852 du 21 décembre 1972 est « fondée sur une
complémentarité entre le droit du sang et le droit du sol
»926. Au fond, il s'agit de la nationalité
d'origine acquise de plano dès la naissance, par le fait d'un
parent ivoirien.
Cette nationalité se dissocie nettement de la
nationalité octroyée par décret après
enquête, à savoir : la naturalisation. Aux termes de l'article 26
de la loi du 21 décembre 1972, la naturalisation ne peut être
accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence
habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui
précèdent le dépôt de sa demande.
La loi ivoirienne n'interdit pas le cumul de la
nationalité ivoirienne avec une autre nationalité. Cette
circonstance peut entrainer des cas de plurinationalité. Un même
ivoirien peut, par conséquent, avoir une double nationalité ou
une triple nationalité, voire au-delà. Et, cela apparait un peu
comme anormal ; c'est même contraire à la lettre de l'article 15
de la Déclaration universelle de 1948 qui dispose que « tout
individu a droit à une nationalité ». C'est pourquoi,
selon l'analyse du Doyen WODIE, « chaque individu ne devrait jamais
avoir qu'une nationalité, l'acquisition d'une nationalité devant
entrainer la perte d'une autre nationalité ; c'est par le respect de ces
exigences que la Nation pourra fortifier son unité, par le jeu de la
naturalisation ; car, elles seules permettent de découvrir et
d'organiser le degré d'attachement à la Nation à laquelle
on voudrait appartenir ; personne n'a réellement une double
nationalité, une nationalité l'emporte toujours sur une autre et
tend à la chasser. Accorder « généreusement » la
nationalité, l'octroyer avec un certain laxisme, c'est conduire vers
l'abaissement du statut national, en rendant de plus en plus lâche
le
925 La Table Ronde a trouvé que ce code de
nationalité comporte des dispositions ouvertes en matière de
naturalisation par acte de pouvoirs publics, et constitue un texte
libéral et bien rédigé. Cf. Annexe du Programme du
gouvernement de réconciliation nationale des Accords de
Linas-Marcoussis, Point 1.
926 Voir l'Annexe du Programme du gouvernement de
réconciliation nationale des Accords de Linas-Marcoussis. Point 1.
356
noeud de la solidarité nationale. La
nationalité doit être la manifestation d'un attachement affectif
et effectif à la collectivité ; ainsi, se trouvera
favorisée la construction de la Nation »927.
Ces différences d'interprétation des lois
relatives à la nationalité sont susceptibles de donner naissance
à des cas d'apatridie928 de nombre de personnes, notamment
les enfants. Être un « apatride », c'est être
sans nationalités929, voir, donc sans pièces
d'identité. Or, sans pièce d'identité, on ne peut pas par
exemple s'inscrire à l'école, ouvrir un compte dans une banque ou
encore se marier ou voter. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR), il y a 10 millions d'apatrides dans le monde.
Le HCR a récemment lancé une campagne qui s'appelle «
J'appartiens »930 pour tenter d'améliorer la
situation d'ici dix ans.
Selon le HCR, il existerait 700 000 apatrides931 en
Côte d'Ivoire. Justifiant le nombre élevé d'apatrides en
Côte d'Ivoire, Mohamed Touré, le représentant du HCR en
Côte d'Ivoire affirme : « La raison fondamentale de l'apatridie en
Côte d'Ivoire est historique. La colonisation a rapporté dans
le territoire ivoirien des centaines de milliers de gens pour travailler dans
les plantations de cacao. A l'Indépendance, en 1960, ces personnes ne
sont pas retournées en Haute-Volta (Burkina Faso). Elles sont
restées en Côte d'Ivoire et n'ont pas
bénéficié à l'époque de la
nationalité, ou elles n'ont pas pris la nationalité, et n'avaient
pas pris non plus la nationalité burkinabè puisqu'elle n'existait
pas. Donc on estime le chiffre à peu près à 400 000
personnes »932. De plus, poursuit-il, « A
côté de cela, il existe aussi un autre chiffre qui est un chiffre
de 300 0000 personnes, qui sont à l'origine des enfants
abandonnés, parce que simplement la loi en Côte d'Ivoire,
malheureusement, ne donne pas de nationalité à un enfant qui a
été trouvé sans parents. Donc, la Côte d'Ivoire
s'est engagée depuis à rectifier cette erreur juridique, qui
permet à tout un ensemble de
927 WODIE (F.), Institutions politiques et droit
constitutionnel en Côte d'Ivoire, PUCI, 1996, pp. 65-66.
928 Ibid.
929 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF, 10eme
édition, 2014, p.70.
930 Lancé le mardi 4 novembre 2014 par l'UNHCR, la
campagne dénommée « I Belong » (J'appartiens) a un
objectif ambitieux mais nécessaire : celui de mettre fin à
l'apatridie au cours des 10 prochaines années.
931
http://www.rfi.fr/afrique/20141109-cote-ivoire-apatrides-hcr-700-000-lancement-campagne-enfants-
abandonnes-(consulté
le 04/11 /2015).
932
http://www.rfi.fr/afrique/20141109-cote-ivoire-apatrides-hcr-700-000-lancement-campagne-enfants-
abandonnes-
(consulté le 04/11/2015).
357
personnes aujourd'hui de pouvoir se présenter
devant un juge, de pouvoir démontrer qu'effectivement, elles remplissent
toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la
nationalité ivoirienne ». Ainsi, il ressort de l'argumentaire
du représentant du HCR, que de nombreux enfants abandonnés
dès leur naissance en Côte d'Ivoire n'ont pu voir leur naissance
déclarée ; ce qui a eu pour effet de faire d'eux des
apatrides.
Dépourvus d'une nationalité, ils sont aussi non
bénéficiaires des droits qui s'y rapportent, car comme le
mentionne la lettre ouverte du HCR, « L'apatridie peut signifier une
vie sans éducation, ni soins de santé ou emploi formel, une vie
sans liberté de mouvement, sans espoir ni perspective d'avenir
»933.
A côté du droit à l'existence qui est
ainsi malmené, le droit à la survie se trouve aussi compromise eu
égard aux atteintes au droit à la santé et à un
environnement sain dont sont victimes nombre d'enfants en Côte
d'Ivoire.
B. LES ATTEINTES AU DROIT A LA SANTE ET A UN
ENVIRONNEMENT SAIN DE L'ENFANT
La constitution de l'OMS définit, dans son
préambule, la santé comme étant : « un
état de complet bien-être physique, mental, et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité934». Le droit à la santé
est un droit individuel corollaire du droit à la vie car il a pour
finalité de servir le droit à la vie. Le droit à la
santé en tant que droit de la « conservation de l'espèce
humaine935 » est un droit créance. Il est garanti
par l'article 24 de la CIDE qui dispose que « l'enfant a le droit de
jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier des services médicaux ». L'article 14
alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant a été plus explicite en reconnaissant à l'enfant,
le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et
spirituel possible.
933
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33654#.VtXpxPnhDIU
(consulté le 04/11/2015).
934 Préambule de la Constitution de l'Organisation
mondiale de la Santé, adoptée lors de la Conférence
internationale de la santé, tenue à New-York du 19 au 22 juillet
1946, (entrée en vigueur le 7 avril 1948) disponible sur
www.who.int/governance/eb/constitution/fr/. (Consulté le
04/11/2015).
935 RAKOTOARISON (J.), Introduction au droit à la
santé, in Rapport des deuxièmes journées des
responsables des Chaires et Instituts d'Afrique de l'Ouest et Centrale
travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la
démocratie, Cotonou du 28 au 31 juillet 2003, p.174.
Cf. Observation Générale IV° 14 du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations
Unies en son paragraphe 33 (1999).
358
Le droit à la santé est un droit inclusif. Le
droit au meilleur état de santé possible nécessite donc la
mise en oeuvre de plusieurs autres droits économiques, sociaux et
culturels936. P. HUNT, dans son tout premier rapport en tant que
rapporteur spécial sur le droit qu'à toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale possible affirme que :
« le droit à la santé est un droit global dans le champ
duquel entrent non seulement les prestations de soins de santé
appropriées en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux
déterminants de la santé tels que l'accès à l'eau
salubre et potable et à des moyens adéquats d'assainissement,
l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à
l'éducation et à l'information relatives à la
santé, notamment la santé sexuelle et génésique
»937. Ainsi, conformément à
cette approche, on comprend combien d'autres droits tels que le droit à
l'eau, à l'alimentation, au logement ou à l'environnement sont
consubstantiels au droit à la santé, car la santé est
à la fois conditionné par la jouissance de certains droits tout
autant qu'elle est bien souvent la condition de jouissance d'autres droits dont
le droit à la vie938.
En tant qu'idéal visant à atteindre, pour
chacun, « le meilleur état de santé physique, mentale et
sociale possible », le droit à la santé suppose la
réalisation d'un certain nombre d'exigences sanitaires qui apparaissent
comme ses véritables dérivés. Ces droits
dérivés constituent, en même temps, les contours exacts de
ce droit. Il s'agit ainsi, d'abord, du droit à une alimentation saine et
équilibrée. Il s'agit ensuite, du droit à un environnement
sain et propice au développement. Il s'agit, enfin, du droit à un
logement décent, trois droits de portée autonome certes, mais qui
peuvent tout autant être rattachés au droit à un meilleur
état de santé physique, mentale et sociale.
Il est souvent lié à l'accès aux soins de
santé et à la construction d'hôpitaux. Toutefois, il a une
portée bien plus large et il englobe un grand nombre de facteurs qui
peuvent nous aider à mener une vie saine. Le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, les appelle les « facteurs
déterminants pour la santé »939.
936 LAVALLEE (C.), La protection internationale des droits
de l'enfant : entre idéalisme et pragmatisme, Bruylant, 2015,
p.210.
937 Rapport du Rapporteur spécial, le droit de
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale susceptible d'être atteint, 13 février 2003,
E/CN.4/2003/58,§23.
938 HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), Traité de
droit international des droits de l'homme, Editions A. Pedone, 2016,
pp.1257-1274.
939 HCDH-OMS, Le droit à la santé, Fiche
d'information n°31, p.3.
359
Ils comprennent l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement ; une alimentation saine ; une alimentation suffisante, et un
logement décent ; des conditions de travail et environnementales saines,
une éducation à la santé et la diffusion d'information,
l'égalité entre les sexes940. Le droit à la
santé garantit des droits, notamment, le droit à un
système de protection de la santé offrant à tous, la
possibilité de bénéficier du meilleur état de
santé possible, le droit à la prévention et au traitement
ainsi qu'à la lutte contre les maladies, l'accès aux
médicaments essentiels, la santé maternelle, infantile et
procréative ; un accès égal et en temps voulu aux services
de santé de base ; la fourniture d'une éducation à la
santé et d'informations y relatives ; la participation de la population
au processus de prise de décisions sur les questions de santé aux
niveaux national et communautaire.
Les services de santé, les biens et infrastructures
doivent être disponibles, accessibles, acceptables et de bonne
qualité. Des infrastructures, des biens et des services
opérationnels et en nombre suffisant doivent être disponibles au
sein des Etats. Tel n'est pas le cas en pratique car nombre d'enfants vivant
sur le territoire ivoirien n'arrivent pas à se soigner faute
d'infrastructures ou de spécialistes ou en raison de
l'inaccessibilité des services de santé.
Les autorités dirigeantes ont constamment violé
le droit à la santé et à la sécurité
sociale, On peut l'illustrer en se référant à une
enquête diligentée par la LIDHO dans les CHU qui a
révélé des atteintes graves au droit à la
santé, Il ressort de cette enquête les résultats poignants
suivants941 :
« 1° en dépit de leur architecture
imposante, et somptueuse pour certains, ces établissements connaissent
un état de délabrement avancé. Ainsi, bien des salles
d'hospitalisation, lorsqu'elles peuvent encore recevoir des malades, sont
dépourvues de climatisation, d'eau, de literie propre
,
·
2° des services complets et non des moindres, sont
partiellement ou totalement fermés. Il s'agit des services de
radiologie, exploration fonctionnelle, réanimation, de la banque de sang
et de la néonatalogie du CHU de Yopougon. L'institut de cardiologie
d'Abidjan, le service des maladies infectieuses tropicales du CHU de
Treichville connaissent la même infortune ,
·
940 HCDH-OMS, Le droit à la santé, Fiche
d'information n°31, p.3.
941 KOFFI KONAN (E.), Les droits de l'Homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, thèse de doctorat unique de droit public,
Université de Cocody-Abidjan, UFR-SJAP, 2008, p.87.
360
3° dans ces centres, ceux des services encore
fonctionnels sont totalement engorgés, surpeuplés et
dépassés. Il n'est donc pas rare que des malades s'entendent
conseillés de délaisser un service donné, pour s'orienter
vers un autre centre qui ne peut non plus les accueillir, faute de
disponibilité ou d'infrastructures ,
·
4° le sous-effectif du personnel, notamment
paramédical ne laisse pas de surprendre, au regard du nombre de
médecins et d'infirmiers diplômés d'Etat, en attente de
leur intégration à la fonction publique ,
·
5° du matériel de soins et
d'équipements tout aussi précieux qu'en grand nombre, se trouve
dans un triste état de vétusté et est parfois hors d'usage
,
·
6° dans les services d'urgence, il est exigé
des patients, de jour comme de nuit, une redevance, avant toute intervention,
De ce fait, des malades meurent, dans l'attente du paiement de cette redevance
et, par conséquent, sans les soins attendus ,
· cela parfois en
dépit des engagements formels des parents de ces malades
»942. Bien que portant sur un état des lieux
opéré en 2000, cette description faite par la LIDHO demeure
d'actualité au regard de la situation actuelle des établissements
hospitaliers ivoiriens tant au niveau quantitatif que qualitatif.
Il est déplorable, voire choquant, de constater que les
pouvoirs publics ne prennent guère de mesures significatives
adéquates de nature financière, technique et humaine pour rendre
fonctionnels les services et équipements des centres hospitaliers de la
Côte d'Ivoire.
Agissant ainsi, ils portent gravement atteinte au droit
à la santé qui est un droit fondamental reconnu à tout
individu et garanti943 par les grands instruments internationaux
relatifs aux droits de l'enfant auxquels la Côte d'Ivoire est
partie944.
942 Voir la Déclaration de la LIDHO relative
à la situation des centres hospitaliers universitaires (CHU), du 30
août 2000, à Abidjan.
943 Le droit à la santé est aussi garanti par
l'article 7 de la constitution ivoirienne du 1er Août 2000.
944 L'article 16 de la Charte africaine dispose :
« 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur
état de santé physique et mentale qu'elle soit capable
d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte
s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de
protéger la santé de leurs populations et de leur assurer
l'assistance médicale en cas de maladie. » ;
L'article 12 du pacte énonce « les Etats parties
au présent pacte reconnaissent le droit qu'à toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre... ».
L'article 25 de la déclaration prescrit : « toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille... ».
361
A la vérité, il est souvent difficile, pour les
pays pauvres de satisfaire à ces nombreuses obligations consistant
à protéger la santé des populations, notamment des
enfants, et de leur assurer une assistance médicale en cas de maladie.
Mais, en Côte d'Ivoire, des efforts certains ont été
consentis, en ce domaine, par les pouvoirs publics. Il n'empêche que de
nombreux enfants font face à d'énormes problèmes de
santé faute d'accès aux médicaments, d'insuffisances
d'infrastructures ou d'éloignement des centres de santé. Qui plus
est, certains ne mangent pas à leur faim. Avant le déclenchement
de la crise politico-militaire ivoirienne945, le système de
santé ivoirien avait atteint un niveau de performance parmi les
meilleurs d'Afrique sub-saharienne. Mais, durant la récente crise qu'a
connue ce pays, ce système s'est trouvé de façon notable
fragilisé. L'Etat n'arrivait plus à répondre aux besoins
sanitaires élémentaires des populations, notamment dans les zones
rebelles. On notait alors et continuons de noter une résurgence de
toutes sortes de foyers d'épidémies : choléra, rougeole,
fièvre jaune, paludisme, méningite, etc. Ce qui n'a pas
manqué de retentir négativement sur l'état de santé
des enfants.
Heureusement, grâce à l'appui de l'OMS et
d'autres partenaires, le Gouvernement ivoirien a pu réaliser dans divers
domaines, des urgences sanitaires. A titre illustratif, dans la
prévention contre le paludisme, l'OMS a appuyé le
ministère de la Santé « dans la distribution de
moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes et enfants de moins
de 5 ans »946. En outre, de février 2004 à
décembre 2005, grâce à l'appui de l'OMS, de l'Unicef et
d'autres partenaires, l'Etat de Côte d'Ivoire a pu organiser neuf (9)
campagnes de vaccination de rattrapage contre la rougeole : d'où, «
plus de 5 millions d'enfants, âgés de 0 à 5 mois, ont
pu être vaccinés à chaque passage des journées
nationales de vaccination contre la poliomyélite, et plus de 9 millions
d'enfants de 9 mois à 14 ans l'ont été contre la rougeole
»947. On le voit : malgré la crise
politico-militaire, des efforts constants ont été
945 Cette crise présentée à tort comme
une opposition des chrétiens du sud contre les musulmans du nord a
été déclenchée le 19 septembre 2002 par une
rébellion armée qui attaqua plusieurs casernes militaires du pays
avec des armes lourdes. Pour nous, la crise ivoirienne ne saurait être
réductible à une opposition entre un nord musulman « rebelle
» et un sud chrétien « loyaliste ». Au recensement de
1998, sur les 15,4 millions d'habitants, 39% se déclarent musulmans, 30%
chrétiens, 12% animistes. Seuls 29% des musulmans de Côte d'Ivoire
résident dans le Nord, et Abidjan, capitale économique et
capitale de la « zone gouvernementale », abritait 20% des musulmans
du pays. Mieux le secrétaire général de la
rébellion, M. Guillaume SORO est chrétien et même ancien
séminariste, alors que l'ancien Président de l'Assemblée
Nationale, Mamadou KOULIBALY, sous le régime de Laurent Gbagbo, est
musulman.
946 Voir Reflets Nations Unies n°4, Juin 2006,
p.11.
947 Idem, p. 12.
362
déployés par le Gouvernement ivoirien et des
partenaires onusiens et européens afin que le droit à la
santé ne soit pas une utopie totale en Côte d'Ivoire.
De même, il existe des obligations étatiques
découlant des droits dérivés du droit à la
santé. Dans le domaine de l'environnement, l'Etat a d'abord l'obligation
urgente, entre autres, d'assurer l'hygiène publique et de veiller
à son respect par toute la population. L'Etat a, ensuite, l'obligation
de bien entretenir tout ce qui concourt à la santé et au
bien-être des enfants et, partant de toute la population. L'Etat a,
ensuite, l'obligation de bien entretenir tout ce qui concourt à la
santé et au bien-être de la population (l'eau,
l'électricité, la voirie...) et de créer notamment des
aires publiques de stationnement, de divertissement et/ou de repos, de
manière à contribuer au confort vital de la population.
Malheureusement, le droit à l'environnement sain des enfants, apparait
comme un droit souvent malmené en Côte d'Ivoire.
Consacré non seulement par la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples948, mais aussi par le Protocole
additionnel relatif aux droits des femmes949 , l'environnement se
loge au coeur des grandes préoccupations contemporaines de l'être
humain. Et, parce que toutes les personnes humaines ont un droit fondamental
à un environnement approprié pour leur santé et leur
bien-être , il pèse sur tous les Etats, une obligation
fondamentale, à savoir : « conserver l'environnement et les
ressources naturelles au profit des générations présentes
et futures, maintenir l'écosystème, dispenser les règles
écologiques, établir les priorités
948 L'article 24 de cette Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples dispose : « Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement ».
949 Article 18 Protocole additionnel relatif aux droits des
femmes en Afrique : «
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain
et viable.
2. Les États prennent les mesures nécessaires
pour:
a) assurer une plus grande participation des femmes à
la planification, à la gestion et à la préservation de
l'environnement ainsi qu'à l'utilisation judicieuse des ressources
naturelles à tous les niveaux;
b) promouvoir la recherche et l'investissement dans le
domaine des sources d'énergies nouvelles et renouvelables et des
technologies appropriées, y compris les technologies de l'information,
et en faciliter l'accès et le contrôle aux femmes ;
c) favoriser et protéger le développement de la
connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes.
d) réglementer la gestion, la transformation, le
stockage et l'élimination des déchets domestiques ;
e) veiller à ce que les normes appropriées
soient respectées pour le stockage, le transport et l'élimination
des déchets toxiques. ».
363
relatives à l'environnement, en tout état de
cause, coopérer de bonne foi en vue de la mise en oeuvre de leurs droits
et obligations relatifs à l'environnement et au développement.
»950.
On comprend dès lors, que se pose sur tous les points
de la planète, un problème majeur, à savoir : «
l'écodéveloppement »951 qui est
l'indispensable conciliation du développement et de l'environnement. Et,
cela se justifie par ceci que la question de l'environnement est née des
effets des avancées technologiques et industrielles des
sociétés modernes, et que l'on a senti, ou ressenti, la
nécessité de gérer les ressources naturelles sans les
dilapider, ou les gaspiller, et aussi de préserver l'environnement qui
semble, partout, fort menacé. Ainsi, en 1972, le Programme des Nations
Unies pour l'Environnement (PNUE) a établi le principe «
pollueur-payeur »952.
Curieusement, chez les Etats africains, qui n'ont pas de
moyens techniques et financiers suffisants pour la reconversion de leurs
industries, et qui sont généralement pauvres et
sous-développés, le développement n'a pas de prix : on y
constate alors un désir ardent et effréné au
développement ou à la croissance économique, et ce, quel
que soit le sacrifice ou le prix écologique à payer.
Dans ces circonstances, l'Afrique est devenue, aujourd'hui, le
théâtre de problèmes environnementaux : nuisance
d'activités industrielles polluantes, absence d'assainissement des eaux
usées et des eaux d'égouts, mauvaise gestion des ordures
ménagères et des déchets industriels. Plus grave,
l'Afrique est devenue le dépotoir, ou la « poubelle »
des pays industrialisés ou développés qui viennent y
déverser leurs produits toxiques. L'affaire du Probo Koala en Côte
d'Ivoire l'illustre éloquemment. En voici les faits :
950 MBAYE (K.), Les droits de l'Homme en Afrique, op.
cit, p.211.
951 SACHS (I.), « Ecodéveloppement : une approche
de planification », In : Economie rurale. n°124, 1978,
pp.16-22. ; BERR (E.), « L'écodéveloppement comme fondement
d'une économie politique du développement soutenable », In.
Revue Francophone du Développement Durable, n°2, octobre
2013, 20 p. ; BERR (E.), « Le développement soutenable dans une
perspective post keynésienne : retour aux sources de
l'écodéveloppement », Économie
appliquée, tome LXII, n°3, 2009, p.221-244.
952 OCDE- Direction de l'environnement, Le principe
pollueur-payeur, Analyses et Recommandations de l'OCDE, Paris 1992,
p.1-56. ; TRUDEAU (H.), « La responsabilité civile du pollueur : de
la théorie de l'abus de droit au principe du pollueur-payeur
», In. Les cahiers du droit, vol.34, n°3, 1993,
pp.783-802. ; BELANGER (M.), « La faute civile en matière de
responsabilité pour dommages environnementaux », dans
FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUEBEC, Développements
récents en droits de l'environnement, Cowansville, Editions Yvon
Blais, 1991, pp. 149-161. ; PREVOST (A.), Les dommages en droit de
l'environnement, dans Formation permanente du Bareau du Québec, Op.
cit. , pp.205-221.
364
Le 17 Aout 2006, un affréteur dénommé
Jorge Marrero, de la société néerlandaise Trafigura
LTD, s'adresse au représentant de Puma
Energy953 à Abidjan, pour lui trouver, dans la capitale
ivoirienne, une société capable d'enlever et de traiter les
« slops954 » d'un navire battant
pavillon panaméen : le « Probo Koala ».
Le Capitaine NZI KABLAN, représentant local de Puma,
transmet cette requête à l'agent consignataire WAIBS-CI (West
African International Business Services-Côte d'Ivoire) qui, à son
tour, choisit la compagnie TOMMY955 qui venait, fraichement,
d'être agréée en qualité d'avitailleur
spécialisé dans le vidange, l'entretien et le soutenage des
navires par arrêté N°0016MT/DGAMP/DTMFL du 12 juillet 2006 du
Ministre des Transports.
Le vendredi 18 aout 2006, à 17 heures, au Port Autonome
d'Abidjan (quai Petroci), le Probo Koala accoste et procède, pendant 30
heures, au déchargement de son contenu : 528 m3 de produits chimiques
(chimicals slops), c'est-à-dire « 400 tonnes de boues issues du
raffinage pétrolier, riches en matière organique et en
éléments soufrés très toxiques956
(hydrogène sulfuré, H2S et mercaptans) ».
Des camions citernes affrétés par la compagnie
TOMMY ont, ensuite pris ces produits puants et polluants, hautement toxiques,
pour aller les déverser dans la nature, de façon
disséminée, dans la quasi-totalité des communes d'Abidjan.
En effet, en plus de la décharge d'Akouedo, une multitude de sites ont
été découverts au fil des jours : Plateau-Dokoui,
Vridi Canal, Ndotre, forêt du banco, Abobo-Baoulé, ravin de
Coquivoire à Abobo Anador,
953 PUMA ENERGY est une filiale ( à 100%) de Trafigura
LTD.
954 Les slops sont des quantités importantes de
résidus huileux qui s'apparentent à des boues de type «
mayonnaises ». Ils sont des émulsions inverses très stables
d'eau dans le pétrole brut contenant des éléments solides.
Voir LUCENA (E.), VERDUN (P.) AURELLE (Y.) SECQ (A.), « Nouveau
procédé de valorisation des « slops » de raffineries et
déchets huileux par distillation hétéro
azéotropique », in Oil& Gas Science and
Technology-Rev. IFP, Vol.58 (2003), n°3, p.353.
955 Petite société à
responsabilité limitée, dotée d'un capital de 2,5 millions
de FCFA, et fondée fraichement, Tommy semble avoir été
spécialement créée pour piloter l'opération.
956 Contrairement aux « slops » ordinaires qui sont
de simples eaux souillées, ces slops du « Probo Koala » sont
des produits chimiques très toxiques comprenant notamment : l'anhydride
sulfureux (SO2), l'hydrogène sulfureux (H2S), la soude caustique (NAOH).
Dans le fax adressé le 17 Aout 2006 à M. NZI Kablan de Puma
Energy, M. Jorge MARRERO a donné les précisions suivantes :
« veuillez noter que les eaux usées à bord sont une mixture
du gasoil avec la soude caustique et une forte concentration de sulfure. En
raison de cette forte concentration en sulfure, la mixture a une forte odeur et
doit être retirée du navire et stockée convenablement pour
éviter les problèmes environnementaux et des problèmes
avec des autorités (...) En raison du taux qui dépasse 2000 mg/l,
ces eaux ne doivent pas être considérées comme des eaux
Marpol mais des eaux usées chimiques ». Voir
Fraternité Matin n°12556, du mercredi 13 septembre
2006.
365
derrière le corridor de Gesco (sur la route
d'Alépé), route d'Anyama957. Le
déversement de toute cette quantité de `slops' à Abidjan,
intra-muros et extra-muros, autorise à dire que la Côte d'Ivoire
est devenue une « poubelle ».
A la vérité, ces déchets de haute
toxicité, « qui émettent des vapeurs irritantes,
suffocantes et asphyxiantes »958 ont eu des incidences
extrêmement négatives sur l'environnement, la santé et la
vie des populations.
En particulier, il y a eu pollution de l'air et de l'eau,
destruction de la faune et de la flore, contamination des sols et des produits
agricoles proches des sites de déversement. En outre, les populations
ont été atteintes de maladies et de douleurs de divers genres :
toux sèches, diarrhées, troubles respiratoires, brulures,
démangeaisons, rougeurs et éruptions cutanées, maux de
gorge, douleurs thoraciques, irritations de poumons, conjonctivites ,
convulsions, ballonnements de ventre, saignements du nez, picotements des yeux,
céphalées, troubles gastriques, larmoiements, etc. Il en est
résulté des évanouissements, des comas et des
morts959. L'extrême fétidité et nocivité
des odeurs émanant des produits toxiques ont aussi provoqué la
fermeture de nombreux domiciles et lieux de travail, des déplacements de
population à l'intérieur de la ville d'Abidjan, des zones
très touchées vers les quartiers les moins infectés,
c'est-à-dire plus sains et plus viables.
On le voit, dans cette affaire, « Probo Koala
»960, les Ivoiriens, et en particulier, les enfants se
sont vus gravement, voire, massivement, atteints dans leurs droits
fondamentaux, notamment : droit à un environnement sain, droit à
la santé, droit à la vie, droit à
l'intégrité physique, droit au travail, droit à la paix.
Et nul ne sait à ce jour, les effets actuels, continus
957 Communes et sous quartiers ayant été victimes
du déversement des déchets toxiques.
958 Voir Fraternité Matin n°12556 du
mercredi 13 septembre 2006, p.3.
959 Selon le quotidien « Le Jour Plus », il
y eu quinze morts et cent mille (100.000) personnes intoxiquées. Voir le
Jour Plus n°1064, du Jeudi 29 mars 2007, p.3.
960 Cette affaire de « Probo Koala », ou de
catastrophe écologique ivoirienne, a entrainé de multiples
interpellations, arrestations ou détentions dont celles de : Kouassi
YAO, Théophile YOBOUE et Anne-Marie TETIALOU (douaniers en poste, au
Port Autonome d'Abidjan, le 19 Aout 2006) ; Kablan NZI (de Puma Energy) ; Nolia
Amoakon ( de Waibs-ci) ; Ibrahima Konaté et Ugborugbo Salomon Amejuma (
de Tommy), Colonel Tibé Bi Balou (Directeur des Affaires maritimes et
portuaires). Le 14 septembre 2006, le Premier Ministre Charles Konan BANNY a
suspendu certaines autorités politiques et administratives de leurs
fonctions, motif pris de ce qu'elles auraient pris part au trafic des
déchets toxiques. Ce sont : Marcel GOSSIO (Directeur
Général du Port Autonome d'Abidjan) ; M. GNAMIEN Konan (Directeur
Général des Douanes ivoiriennes) ; M. Pierre Djédji
AMONDJI (Gouverneur du District d'Abidjan). Voir jeune Afrique
n°2384, du 17 au 23 septembre 2006.
366
et futurs de ces déchets sur les enfants, et les
habitants de la Côte d'Ivoire en général. Bien que non
souhaitables, ces conséquences inconnues affecteront,
inéluctablement la vie et la santé des enfants d'aujourd'hui et
de demain, eu égard à la nature de ces déchets
déversés en Côte d'Ivoire ; ce faisant les droits à
la santé et à un environnement sain des enfants se trouvent
compromis à l'instar de leurs droits à l'éducation et au
développement personnel qui sont en proie à une diversité
d'atteintes.
§ 2. LES ATTEINTES AU DROIT A L'EDUCATION ET AU
DEVELOPPEMENT PERSONNEL DE L'ENFANT
Nous aborderons ici les atteintes au droit à
l'éducation (A), un faible développement des activités
d'éveil (B) avant d'envisager la question du mariage forcé ou
précoce qui se présente comme une pratique traditionnelle
néfaste (C).
A. LES ATTEINTES AU DROIT A L'EDUCATION
Le concept d'éducation revêt plusieurs acceptions
mais pour les besoins de la présente étude, nous retiendrons que
l'éducation est « (...) l'action de développer les
facultés morales, physiques et intellectuelles des individus appartenant
à une société961 ».
L'éducation est la pierre angulaire du développement de tout
être humain en général et de l'enfant en
particulier962. Le droit à l'éducation peut être
considéré comme « le pivot des droits de
l'enfant963» étant entendu que « c'est
l'éducation qui donne, en fait, à l'enfant toute son
humanité et toute sa dignité964 ».
La CDE, en proclamant en son article 28, le droit à l'éducation,
est allée plus loin en mettant en exergue les objectifs à
atteindre par l'éducation. Elle doit en effet viser à favoriser
l'épanouissement de la personne de l'enfant et le développement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de
leur potentialité. Ce droit à l'éducation a
été repris par la Charte Africaine des Droits et
961 MENGUE (F.), « Introduction au droit à
l'éducation », in Rapport des deuxièmes journées
des responsables des Chaires et Instituts d'Afrique de l'Ouest et Centrale
travaillant dans le domaine des droits de l'homme et de la
démocratie, Cotonou du 28 au 31 juillet 2003, p.174.
962 Cf. Observation Générale n° 13
du Comité des droits économiques sociaux et culturels des
Nations Unies de 1999 en son paragraphe 1 (vingt et unième session) :
« l'éducation est à la fois un droit fondamental en soi et
une des clefs de l'exercice des autres droits inhérents à la
personne humaine. » .
963 UNICEF, La voix des jeunes, disponible sur :
www.unicef.org/voy/frenc/explore/education/(consulté
le 04/11/2015).
964 AGOSSOU (C.), op.cit, p.13.
367
du Bien-être de l'enfant en son article 11. Le
rôle de l'éducation dans le devenir de l'enfant n'est donc plus
à démontrer.
Selon la Cour interaméricaine des droits de l'homme
dans l'affaire Villagran Morales c/ Guatemala (paragraphe 84), «
l'éducation favorise la possibilité de jouir d'une vie digne
et contribue à prévenir des situations défavorables au
mineur et à la société965».
Si on emprunte à la psychologie de l'enfant, sa réflexion n'est
pas encore développée, son corps aussi et ses agissements sont
instructifs, voire naïfs, sinon maladroits. C'est une créature au
départ sans culture, que la société à travers la
famille et l'école, doit élever et éduquer966.
Cette éducation est destinée à favoriser
l'épanouissement moral et personnel de l'enfant. Dès lors, s'il
est un impératif pour la société d'éduquer
l'enfant, l'éducation est pour ce dernier, un droit
fondamental967.
Sur le plan de l'épanouissement moral,
l'éducation de l'enfant vise, au sens de l'Article 29 de la CDE,
à le préparer moralement et intellectuellement à s'assumer
une fois devenu majeur. Pour ce faire, l'éducation scolaire doit
être à même d'inciter le développement de ses
aptitudes intellectuelles. Il s'agit dans l'ensemble, d'inculquer à
l'enfant pendant sa formation intellectuelle et multidimensionnelle, un
ensemble de valeurs morales, sociales, culturelles et politiques
nécessaires à la compréhension du monde.
L'épanouissement intellectuel se trouve donc au bout de la transmission
à l'enfant, d'un savoir positif graduellement développé,
qui favorise son développement mental, la culture de son raisonnement et
la perception spontanée mais profonde du sens des questions de la vie
quotidienne voir existentielles968. L'épanouissement
intellectuel de l'enfant conduit à la formation de sa
personnalité. Cette personnalité est la base rationnelle de
l'affirmation des caractères de l'adulte qui sommeillent en
lui969. La personnalité acquise sera simplement
renforcée et soignée au fil du temps pour lui permettre de se
réaliser dans tous les maillons
965 MARTIN-CHENUT (K.), « La conciliation juridique
de l'enfant dans la jurisprudence interaméricaine des droits de l'homme
» in RSC, Paris, Dalloz, N° 2, avril-juin 2008, p.426.
966 MONTAIGNE, De l'institution des enfants, Essais.
Livre premier, Paris, Nouveaux Classiques Larousse, 1965, pp.49-81.
967 Article 28 CDE ; Article 11 CADBE.
968 En ce sens, l'Art 11-2a de la CADBE est explicite :
« l'Education de l'enfant vise à : a) promouvoir et
développer la personnalité de l'enfant, ses talents ainsi que ses
capacités mentales et physiques jusqu'à son plein
épanouissement(...) ».
969 MONTAIGNE, De l'institution de l'enfant, opcit.,
pp.50-61.
368
de la chaîne sociale et de devenir autonome. C'est
pourquoi, Monsieur Alain SERIAUX affirme à propos de l'enfant que «
l'éducation qu'il a reçu...a justement pour objet de l'aider
à conquérir cette autonomie »970.
Suivant la Convention relative aux droits de l'enfant «
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation..., rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous, ...encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire...et prennent des mesures appropriées, telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une
aide financière en cas de besoin »971.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en
pleine égalité à tous, en fonction de leur mérite.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
En application de ces obligations, l'Etat de Côte
d'Ivoire s'efforce de réduire le taux d'analphabétisme qui
atteint un seuil inquiétant. Le taux brut de scolarisation est
passé de 2,8% en 2000/2001 à 6,9% en 2013-2014972. Ces
résultats restent largement en deçà des prévisions
à cause de la mobilisation insuffisante des ressources publiques pour ce
secteur et la faible capacité des communautés à soutenir
financièrement les encadreurs pour ce qui est des initiatives
communautaires. Par ailleurs, la préscolarisation demeure un
phénomène urbain (83%)973. Les défis à
relever sont le développement intensif du préscolaire en
général et singulièrement en zone rurale qui n'enregistre
à ce jour que 17% des effectifs scolarisés. La mise en oeuvre de
la politique « une école, une classe primaire » sera d'un
apport appréciable974.
970 SERIAUX (A.), « Tes père et
mère honoreras : Réflexions sur l'autorité parentale en
droit français contemporain » in R.T.D.C., 1986,
p.268.
971 Article 28, alinéa.1a§b. (CDE).
972 Ministère de l'éducation nationale et de
l'enseignement technique, Examen national 2015 de l'Education pour tous,
Rapport-Bilan de mise en oeuvre de l'EPT en Côte d'Ivoire, novembre
2014, p.12.
973 Ibid.
974 Ministère de l'éducation nationale et de
l'enseignement technique, Examen national 2015 de l'Education pour tous,
Rapport-Bilan de mise en oeuvre de l'EPT en Côte d'Ivoire, novembre
2014, p.13.
369
La pauvreté étant le premier obstacle au droit
à l'éducation, différentes mesures ont été
prises par les autorités ivoiriennes en vue d'en atténuer les
effets sur l'exercice du droit à l'éducation des enfants. Ainsi,
ont été prises, des mesures d'accompagnement tels que le
recrutement massif d'enseignants, la distribution gratuite de kits et manuels
scolaires, la construction et la réhabilitation des salles de classes et
des cantines scolaires, la valorisation des initiatives communautaires
(écoles communautaires, écoles islamiques), l'assouplissement des
conditions d'accès à l'école975.
Par exemple, sous la première
République976, le Gouvernement ivoirien a instauré,
dans l'enseignement primaire, le prêt-location d'ouvrages scolaires. Et,
eu égard à la modicité du loyer à payer, les
populations de plus de soixante-deux (62) sous-préfectures,
considérées comme faisant partie des régions les plus
pauvres de la Côte d'Ivoire (pour la plupart dans le Nord) ont pu
bénéficier d'ouvrages scolaires à moindre coût. En
1999, 823000 manuels scolaires, sur un total de 1 134 000 acquis par l'Etat
leur ont été gratuitement offerts977. En 2016, des
Kits scolaires ont aussi été distribués dans plusieurs
régions du pays. Ainsi, dans la région du Haut Sassandra, le
Ministre de l'Education Nationale a pour cette année scolaire offert
270950 kits scolaires aux différentes écoles primaires dans le
village de Gouagnani dans la sous-préfecture de Bédiala, en
présence des acteurs du système éducatif, du corps
préfectoral et des leaders politiques978.
Et, la mise en oeuvre des différents programmes a
permis, entre 1963 et 2001, la multiplication par 6,5 du nombre de classes dans
l'enseignement primaire : de 7725, ce nombre est passé à 47554.
Dans l'enseignement secondaire, le nombre de classes a été
multiplié par 20, passant, par là même, de 587 à
11800. Quant à l'effectif d'élèves dans le primaire, il a
été multiplié par 60, passant ainsi de 33551 à
2102852, tandis que dans le secondaire général, il a
été multiplié par 31, soit de 22229 à 687000. Le
taux brut de scolarisation en 1999/2000 est, en matière
d'accessibilité, estimé à 73,4 %. Le taux de scolarisation
des garçons est de 53% contre 44,3% chez les filles. En milieu rural,
ces taux
975 Ibid.
976 La première République ivoirienne a
existé de 1960 à 2000.
977 KOFFI KONAN (E.), Les droits de l'Homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Tome 1, thèse de doctorat unique de droit
public, Université de Cocody-Abidjan, UFR-SJAP, 2008, p.152.
978 KOUADIO (E.), « 270950 Kits aux écoliers
», in Fraternité Matin n°15539, cité par le
service de Communication de la documentation et des archives-Ministère
de l'éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire,
Revue de presse du mardi 27 septembre 2016, p.2.
370
sont respectivement de 43,5% chez les garçons et 34,31%
chez les filles. Entre 1999 et 2000, l'effectif des filles scolarisées a
augmenté de 3,6% contre 3,2% chez les garçons979.
De même, sous le régime actuel, le projet
d'instauration de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire pour les
enfants de 6 à 16 ans a été adopté au cours d'un
séminaire gouvernemental qui a eu lieu le 01er avril 2015 au
Palais présidentiel980.
Il découle de tout ce qui précède que
l'Etat de Côte d'Ivoire déploie quelques efforts afin que tout
enfant vivant sur son territoire puisse pleinement jouir du droit à
l'éducation. Toutefois, des incertitudes demeurent quant à
l'effectivité optimale de ces droits.
Avant la crise politico-militaire ivoirienne, des efforts ont
été déployés de façon notable, par l'Etat
ivoirien pour favoriser la mise en oeuvre du droit à l'éducation
: ce qui a permis de réduire, par là même, le taux
d'analphabétisme. Ainsi, pour l'année scolaire 2001-2002, le
979 KOFFI KONAN (E.), Les droits de l'Homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Tome 1, thèse de doctorat unique de droit
public, Université de Cocody-Abidjan, UFR-SJAP, 2008, p.160.
980 « L'objectif, donc, de ce séminaire, est de
réfléchir et de discuter sur toutes les conditions qui vont
permettre à ce projet présidentiel d'être un succès.
Nous avons beaucoup parlé de statistiques, des tranches d'âge
concernées, le nombre de classe à construire, quel peut
être l'apport du secteur privé, le nombre et le type d'enseignants
qu'il faut. Ce sont toutes ces discussions qui vont faire l'objet d'une
présentation formelle au chef de l'Etat lundi prochain... » Propos
du Premier ministre Daniel Kablan DUNCAN. Le ministre de l'éducation
nationale, Madame Kandia CAMARA, a renchéri pour indiquer que ce sont 5%
des enfants du primaire qui ne sont pas scolarisés pour 95, 5% de taux
de scolarisation. Pour elle, cela reste un défi à
révéler : « Dans les années à venir, ce sont
14.000 salles de classes qui seront nécessaires pour accueillir tous les
enfants en âge d'être scolarisés. Pour ce faire, il va
falloir recruter des enseignants, continuer la politique sociale du
Président de la République qui est la gratuité de
l'école. Il faut prévoir des kits scolaires, des manuels, des
cantines. C'est de cela que nous avons parlé à ce
séminaire. Mais, il y en aura un second présidé, cette
fois-ci par le président lui-même. Après, nous irons devant
l'Assemblée Nationale pour présenter le projet. Et ce que nous
attendons des Ivoiriens, c'est qu'ils s'approprient ce projet. Parce qu'aucun
pays au monde, n'a pu atteindre l'émergence sans une politique
éducative, concernant la scolarisation universelle, c'est-à-dire
100% d'enfants scolarisés », a-t-elle révélé
avant de poursuivre : « c'est un défi pour le pays, mais c'est un
défi qui peut être réalisé au vu des acquis. Il faut
savoir que pour que le programme puisse démarrer à la
rentrée prochaine, il faudra 3.855 salles de classes. A ce jour, nous
avons lancé la construction de 3000 salles de classes. Et le Premier
ministre nous a indiqué que des dispositions seront prises pour que le
programme démarre dès la rentrée prochaine. ». La
première responsable du ministère de l'éducation nationale
est revenue sur les troubles que le système éducatif a connus.
Elle s'est voulu rassurante : « Les salaires seront bel et bien
débloqués, le Président Ouattara l'a confirmé.
C'est le Président lui-même qui a pris la décision de
débloquer, après 27 années, tous les salaires des
fonctionnaires seront revalorisés. Il maintient sa décision et je
confirme ici que les salaires seront bel et bien débloqués. Ce
que nous souhaitons, c'est que l'ensemble des syndicats lève son mot
d'ordre de grève, et que tous les enseignants et les
élèves reprennent le chemin de l'école dès la fin
des vacances de Pâques, pour que nous puissions poursuivre l'année
scolaire, mais aussi bien préparer les examens, dont les dates ont
été annoncées. Et cela, afin que nous puissions tous
ensemble obtenir de bons résultats de fin d'année aux
différents examens pour le bonheur de nos enfants et de
nous-mêmes, leurs parents. Et, ce dans l'intérêt de la
Côte d'Ivoire », a exhorté Kandia Camara.
371
taux brut de scolarisation était-il de 89,3% pour les
garçons et 67,1% pour les filles, soit 73,8% pour les deux
sexes981. Mais eu égard au conflit armé qui a
éclaté le 19 septembre 2002, le système éducatif
ivoirien a connu un recul : il fut même particulièrement
sinistré : des écoles détruites, des enseignants
assassinés, des enfants enrôlés pour la guerre. Dans la
zone anciennement sous contrôle gouvernementale, en raison des
déplacements massifs des populations, la demande en matière
éducative, excédait largement « les capacités
d'accueil des établissements scolaires »982
déjà insuffisantes avant la crise. En zone ex-rebelle, «
la détérioration des infrastructures scolaires et le manque
d'enseignants titulaires-80% des enseignants sont des bénévoles,
ont gravement affaibli le système éducatif et le nombre d'enfants
scolarisés a considérablement baissé
»983. Du fait de la crise politico-militaire, le nombre
d'enfants privés de la scolarité primaire a été
estimé, pour l'année 2002, à « plus de 700000
». Mais après trois années, « ce chiffre est
passé à plus d'un million, sans compter les enfants, qui
même sans la crise, étaient hors du circuit scolaire ou n'y
accédait pas en raison de l'inadéquation entre l'offre et la
demande sociale d'éducation et/ou en raison des autres freins à
la mise en oeuvre d'une politique d'éducation pour tous. Les filles
restent l'un des groupes les plus vulnérables...
»984 ; Ce triste constat du système éducatif
ivoirien n'est point l'apanage de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest.
C'est d'ailleurs, ce qui ressort des résultats d'une étude
réalisée par l'Enseignant-Chercheur Chrysal KENOUKON qui affirme
sans ambigüité que le droit à l'éducation n'est pas
véritablement réalisé au Benin et au Togo. Selon lui,
«le système éducatif au Benin et au Togo ne tient pas
compte de leurs réalités sociologiques, culturelles et de leurs
besoins de développement. L'école primaire ne donne qu'une
connaissance théorique et l'enseignement secondaire et celui
universitaire accusent également des faiblesses de même nature,
liées notamment au déséquilibre
numérique985».
A l'instar du droit à l'éducation, le droit aux
loisirs se veut quasi ineffectif en Côte d'Ivoire à travers un
faible développement des activités d'éveil.
981 Voir Reflets Nations Unies n°4, juin 2006, p.16.
982 Ibidem.
983 KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, idem, 2008, p.252.
984 Ibidem.
985 KENOUKON (C. A.), Effectivité et
efficacité des normes fondamentales et prioritaires de l'OIT : cas du
Bénin et du Togo, Genève BIT, 2007, p.132.
372
B. UN FAIBLE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
D'EVEIL
L'un des pôles d'épanouissement et de
développement de l'enfant est sa participation à des
activités récréatives ainsi que le reconnaît la
convention relative aux droits de l'enfant. C'est pourquoi, elle fait
obligation aux Etats parties, de mettre à la disposition des enfants
« les moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.986 »
Le jeu, les loisirs et activités
récréatives ne se limitent pas à la simple activité
de distraction et de divertissement. Bien au-delà et ce, d'un point de
vue physiologique, il s'avère être une panacée au maintien
d'une bonne santé physique et mentale de l'enfant. Les premiers pas des
enfants en bas âge sont le plus souvent obtenus par la pratique de
certains jeux. De même, certains enfants frappés de handicaps
corporels ou psychiques recouvrent la santé à l'exercice de
certains jeux à caractère rééducatif. Ainsi, des
activités comme la lecture et le sport ont pu permettre à bon
nombre d'enfants, d'afficher des aspects plus gais et de se soustraire des
conditions délétères dans lesquelles ils vivent.
Aussi, doit-on reconnaître au jeu, aux loisirs un
puissant vecteur de socialisation de l'enfant. A cet effet, par le jeu, le
sport, les loisirs, les enfants apprennent à comprendre la
société et sa dynamique, à développer l'esprit
d'initiative et de créativité. Quant aux activités
collectives, elles suscitent des rapports d'interaction, favorisant l'esprit de
communion, d'entraide et de compréhension. Le jeu devient un support de
formation et de détection des qualités intrinsèques de
chaque enfant. L'importance des jeux et autres activités d'éveil
pour le développement de la petite enfance n'est plus à
démontrer. En effet, le jeu stimule l'épanouissement des
capacités sensorielles, psychomotrices et mentales chez le petit enfant.
Et tous les enfants de 0 à 8 ans devraient avoir droit au jeu à
travers des espaces aménagés à cette fin, accéder
à des jouets appropriés à leur âge et sous la
vigilance de parents attentifs ou de personnel spécialisé, etc.
De nombreux parents ne parviennent pas à offrir un cadre de vie oisif et
stimulateur à leurs enfants. Et de nombreux enfants n'ont jamais eu la
chance de posséder entre leurs mains des jouets leur appartenant. Ce qui
les conduit souvent à rechercher chez les voisins et très souvent
dans la rue, avec d'autres enfants de leur âge, des occasions de jeu qui
comportent parfois des dangers pour eux-mêmes. Qui plus est, les rares
986 Article 31 CIDE.
373
espaces collectifs de jeux aménagés pour les
enfants ont aujourd'hui disparu, les sites les abritant se sont mués en
lieux d'habitations ou de commerce.
Justifiant le non réalisation de ce droit aux loisirs
en Côte d'Ivoire, le Professeur Francis WODIE, en sa qualité de
candidat à l'élection présidentielle affirme : «
Une société où le droit au travail n'existe pas, le
droit aux loisirs risque de n'être que pure illusion. Le loisir, en
effet, n'est possible que si les besoins vitaux sont satisfaits ; or, le loisir
reste une activité nécessaire, créatrice et enrichissante,
qui demande à être organisée et rendue accessible, ce temps
libéré est essentiel si l'on veut rendre à l'homme sa
véritable dimension d'homme total. Culture, art et loisir constituent
trois composantes essentielles de la vie de la Nation comme de chaque
être, parce que la vie a besoin de cette dimension ludique pour atteindre
le meilleur de la créativité et de l'épanouissement
individuel et collectif »987. C'est pourquoi, l'Etat de
Côte d'Ivoire se doit de créer des aires de jeux pour enfants,
soutenir les activités qui s'y dérouleront afin de donner
à chaque enfant, sans discrimination, la joie de vivre. Cette joie de
vivre est malheureusement une pure vue de l'esprit pour nombre d'enfants
engagés dans les liens d'un mariage forcé ou précoce qui
apparait manifestement comme une pratique traditionnelle néfaste.
C. LE MARIAGE FORCE ET/OU PRECOCE : UNE PRATIQUE
TRADITIONNELLE NEFASTE
La notion de mariage forcé doit s'entendre comme
étant un mariage conclu sans le consentement valable des deux parties.
En d'autres termes, l'un comme l'autre « futurs époux
» n'a pas eu ou n'ont pas eu le choix de se soustraire à la
contrainte exercée par la famille. L'article 3 de la loi ivoirienne sur
le mariage énonce que « chacun des futurs époux doit
consentir personnellement au mariage. Le consentement n'est pas valable s'il a
été extorqué par la violence ou s'il n'a été
donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique ou
civile de la personne ». Or, dans ce type de mariage, l'absence de
consentement personnel est claire. Le plus souvent, la future épouse
subit des violences indicibles de la part de sa famille dont la priorité
est de conclure « une affaire ». La Convention
internationale des droits de l'enfant interdit et condamne le mariage
d'enfants988. En outre,
987 WODIE (F.), 100 questions-100 réponses pour la
Côte d'Ivoire nouvelle, Programme de gouvernement du P.I.T, 2009,
p.30.
988 Voir Article 12 CIDE :
374
l'alinéa 2 de l'article 16 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes dispose que les fiançailles et les mariages
d'enfants n'ont pas d'effets juridiques989. La Charte africaine sur
les droits de l'enfant se prononce également sur le mariage
précoce en interdisant les mariages et les fiançailles d'enfants.
De plus, selon la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le
libre consentement est une condition fondamentale de validité du mariage
; le « oui » donné doit être exempt de vice,
libre et éclairé. Nier ce principe entrainerait une atteinte
à un droit fondamental énoncé dans les textes nationaux
comme internationaux.
Malgré son interdiction juridique formelle, cette
pratique ancestrale demeure encore ancrée dans les usages dans certains
milieux en Côte d'Ivoire, violant ainsi, les droits de l'enfant. Selon
l'Unicef « Le mariage d'enfants a pour conséquences probables
la grossesse et la maternité chez ces adolescentes, ce qui entraine des
risques non négligeables pour la
« 1. Les Etats parties garantissent
à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement
son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à
l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation
approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale. »
989Article 16 Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes :
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures
nécessaires pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage
et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage ;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et
de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement ;
c) Les mêmes droits et les mêmes
responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution ;
d) Les mêmes droits et les mêmes
responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans
tous les cas, l'intérêt des enfants sera la considération
primordiale ;
e) Les mêmes droits de décider librement et en
toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et
d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux
moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en
matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou
d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la
législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des
enfants sera la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la
femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d'une
profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en
matière de propriété, d'acquisition, de gestion,
d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à
titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'auront
pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des
dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge
minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur
un registre officiel.
375
santé de la mère et du bébé.
Les jeunes filles, une fois mariées, sont censées effectuer la
majeure partie des tâches ménagères. Leur jeunesse et leur
manque d'expériences les expose à la violence familiale et aux
sévices sexuels, y compris à des rapports sexuels non
désirés avec leur mari. Il y a peu de chances que celui-ci les
protège en utilisant un préservatif, ce qui les expose au risque
de contracter des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH
»990.
En effet, le mariage forcé entrave le
développement de l'enfant, le prive de son éducation, de sa
santé et de son avenir et représente un risque particulier pour
la santé des jeunes filles. En effet, celles-ci sont trop jeunes, d'une
part, pour avoir des relations sexuelles et, d'autre part, pour supporter les
conséquences d'une grossesse. Ainsi, elles meurent donc très
souvent en couches ou survivent avec de graves séquelles sur le plan de
leur santé. De plus, les enfants victimes de mariages forcés sont
privés de leur droit à l'éducation et, par
conséquent, du droit d'accès à un avenir meilleur. En
Côte d'Ivoire, le mariage précoce reste une pratique
coutumière qui nuit gravement au développement et à
l'avenir des enfants et demeure donc une problématique grave et
d'actualité. En effet, il est par exemple estimé que 35% des
femmes entre 20 et 24 ans ont été mariées avant 18 ans, et
8% avant 15 ans991.
Le mariage précoce992 est une pratique
violant les droits humains universellement reconnus mais également les
lois ivoiriennes. Nombreux sont les instruments internationaux qui interdisent
et condamnent le mariage d'enfants. L'article 12 de la Convention relative aux
droits de l'enfant se rapporte d'une certaine façon au mariage
précoce en stipulant que l'enfant a le droit d'exprimer librement son
opinion pour toute décision qui le concerne. La Convention interdit
également toute sorte de brutalité, de violence sexuelle et
d'exploitation préjudiciables au bien-être de l'enfant. En outre,
l'alinéa 2 de l'article 16 de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dispose
que les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets
juridiques. La Charte africaine sur les droits de l'enfant se prononce
également sur le mariage précoce en interdisant les
990 UNICEF, Progrès pour les enfants, Un bilan de
la protection de l'enfant, New York, septembre 2009, p.11.
991 Girls not brides, where does it happen? :
http://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/
(consulté le 25 novembre 2014).
992 Le mariage précoce est le mariage des enfants ou
adolescents âgés de moins de 18 ans .Si un tel mariage est
contesté par la suite, il est assimilé à un
détournement de mineur, qui est une faute pénalement
sanctionnée à travers les articles 355 à 359 du Code
pénal ivoirien.
376
mariages et les fiançailles d'enfants. En effet, la loi
n°64-375 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-800 du 2
Août 1983 relative au mariage énonce en son article premier que :
« l'homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans
révolus, ne peut contracter mariage » sauf si le Procureur le
leur accorde pour motifs graves. Les motifs graves, c'est notamment lorsque la
jeune fille porte une grossesse ou s'est déjà volontairement
établie sous le même toit que son futur époux. En dehors
donc de ces motifs, nul n'a le droit de donner en mariage une mineure de moins
de 18 ans. Cela est valable tant pour le mariage légal que pour le
mariage coutumier. La loi dans ce cadre est donc particulièrement
protectrice à l'égard des enfants, favorisant ainsi leur
liberté d'exercer leur droit de choisir. De plus, si consentement il y
a, sa valeur et sa validité peuvent être remise en cause compte
tenu du jeune âge des deux parties, notamment en ce qui concerne leur
capacité.
En Côte d'Ivoire, les principales données
existantes sur la question sont fournies par des enquêtes de
démographie et de santé (EDS CI III) réalisées en
2012. Ainsi, l'EDS 2012 montre que : 20,7% d'adolescentes de 15 à 19 ans
sont mariées ou en union, 36% des femmes mariées ou en union ont
moins de 18 ans ; 12% avait déjà atteint l'âge de 15 ans
lors du mariage. En revanche, seuls 6% des hommes sont en union avant les 18
ans. Le phénomène de mariage précoce est pratiqué
dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec une plus grande
propension au Nord et au Nord-Ouest. En effet, dans ces deux régions,
50% des femmes âgées de 25-49 ans se sont mariées avant
l'âge légal qui est de 18 ans. L'âge médian au
mariage varie considérablement entre les milieux urbain et rural et les
chiffres disponibles confirment que c'est dans ce dernier milieu rural que le
mariage précoce est plus important. Les résultats de l'EDS-CI III
montrent qu'en Côte d'Ivoire, les adolescentes issues d'un milieu rural
ou défavorisé (45%) sont quatre fois plus exposées
à une union précoce que celles issues d'un milieu urbain ou
aisé (11%).
Or, ces grossesses prématurées contribuent
à des taux de mortalité maternelle et infantile
élevés. En outre, un mariage précoce expose beaucoup plus
les filles à de graves risques pour leur santé liés
à la grossesse et à l'accouchement. En effet, elles sont
exposées à des pathologies dont elles gardent parfois des
séquelles à vie telles que la stérilité ou les
fistules obstétricales993. A cette réalité
macabre, s'additionne le fait que de nombreuses adolescentes,
993 La fistule obstétricale est la constitution d'une
communication anormale (une fistule) entre la vessie et le vagin (fistule
vésico-vaginale) ou entre la vessie et le rectum (fistule
vesico-rectale) survenant à la suite d'une
377
contraintes à des mariages précoces, sont
victimes de violences domestiques prolongées et parfois d'abandons ; ce
qui plonge ces jeunes filles dans une extrême pauvreté et
accroît le risque de les voir basculer dans la prostitution ou le
suicide.
Depuis quelques années, des actions de sensibilisation
et des actions de prévention ont été menées pour
lutter contre ce fléau994. Cependant, malgré les
impacts positifs de ces actions, beaucoup reste encore à faire, car
elles ont été parcellaires et ne s'inscrivent pas dans des
actions programmatiques ciblant la lutte contre les mariages précoces.
Ces actions sont limitées dans la mesure où elles ne prennent pas
en compte tous les aspects liés à certaines problématiques
(économique, culturel, communautaire...).
En tout état de cause, qu'il soit forcé ou
précoce, le mariage des enfants en Côte d'Ivoire constitue une
atteinte au droit au mariage librement consenti et à la famille. En
effet, « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage et lors de sa dissolution. Le mariage
ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et a le droit à la protection de la
société et de l'Etat »995. Quoique libre, le
mariage996 obéit, dans le droit positif ivoirien, à
certaines conditions de fond et de
grossesse compliquée. Elle survient d'ordinaire pendant
un accouchement prolongé, quand une femme n'obtient pas la
césarienne qui serait nécessaire. La fistule est un
problème mondial, mais elle est surtout commune en Afrique.
http://www.who.int/features/factfiles/obstetric_fistula/fr/
(consulté le 20/06/2017) ;
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/FR-SRH%20fact%20sheet-Fistula.pdf
( consulté le 20/06/2017).
994 L'édition 2012 de la Commémoration de la
Journée Internationale de la Fille organisée par la Côte
d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique d'appui aux initiatives du Gouvernement,
de la Société Civile et des organisations religieuses dans les
activités de sensibilisation de masse sur le phénomène du
mariage précoce. Des campagnes de sensibilisations ont été
menées par des ONG nationales et internationales comme ODAFEM, ONEF,
IRC... et par les partenaires internationaux. Face à la situation
spécifique des mariages précoces, les réponses
apportées s'inscrivent dans le cadre des engagements régionaux et
internationaux. Grâce à ces actions conjuguées plusieurs
leaders religieux et communautaires sont engagés dans la lutte contre le
phénomène du mariage précoce.
995 Article 16 alinéa 1 D.U.D.H.
996 Selon le Professeur Anne Marie ASSI-ESSO, « Dans le
droit traditionnel africain, le mariage est une convention par laquelle deux
groupes parentaux (clan, lignage) consentent à l'union d'un homme et
d'une femme. Par-delà les époux, le mariage traditionnel est
l'union de deux familles. Cette conception traditionnelle a été
abandonnée par le législateur ivoirien pour une conception
occidentale.
Le mariage moderne est l'union d'un homme et d'une femme qui
consentent seuls à se prendre désormais pour époux selon
un certain rituel ».
378
forme. Les conditions de fond, qui sont au nombre de six, sont
fixées par la loi n°64-375 du 07 octobre 1964 relative au mariage,
modifiée par la loi n°83-800 du 2 août 1983.
Initialement, la différence de sexe997
signifiait que les futurs époux doivent être de sexes
différents ou opposés. Par conséquent, le mariage
homosexuel998 est formellement interdit en Côte d'Ivoire et
est assimilé à un acte inexistant. En ce qui concerne l'âge
matrimonial, la déclaration universelle de 1948 ne fixe pas un âge
précis pour le mariage. Elle se borne à affirmer que l'homme et
la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille à partir de
l'âge nubile. Quant à la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant adoptée en juillet 1990 à Addis-Abeba
(Ethiopie), elle dispose que les mariages d'enfants sont interdits et que
« l'âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans
»999. Mais, la loi ivoirienne du 07 octobre 1964
modifiée par celle du 2 août 1983, énonce que le mariage
est de vingt (20) ans révolus pour l'homme et dix-huit (18) ans
révolus pour la femme. Ainsi, l'âge matrimonial est donc
différent de celui de la majorité civile qui est de vingt et un
(21) ans pour les deux sexes. Pourtant, le Comité a
considéré que l'âge nubile « devrait être
fixé en fonction de la capacité des futurs époux de donner
leur libre et plein consentement personnel »1000 et «
selon les mêmes critères pour les hommes et pour les femmes
(...) de façon à permettre à la femme de prendre une
décision en toute connaissance de cause et sans contrainte dans les
formes et les conditions prescrites »1001.
Voir ASSI-ESSO (A.-M.), Précis de droit civil. Les
personnes- La famille, L.I.D.J, Abidjan, 2e édition,
2002, p.239.
997 Articles 1 et 4 de la loi sur le mariage.
998 La question du mariage homosexuel rentre dans le cadre de
la problématique des LGBT qui fait désormais l'objet de
débat au niveau des Nations Unies ; Voir à ce sujet, la
Déclaration des Nations Unies sur l'orientation sexuelle et
l'identité de genre ; CCPR/C/50/D/488/1992 (31 Mars 1994)
Toonen c. Australia, Communication n°. 488/1992, paragraphe 8. 2
(établissant que la pénalisation des comportements
homosexuels en Tasmanie était une violation du droit à la vie
privée garanti par l'art. 17 du PIDCP) ; De la même façon,
la Cour européenne des droits de l'homme interprète les
dispositions relatives à la vie privée et à la
discrimination prévues par la Charte européenne des droits de
l'homme comme s'appliquant aux LGBT. Voir : C.E.D.H., Salguero da Silva
Mouta (1999) App n° 33290/96, paragraphe.34-36 (retenant que le
déni de droits parentaux fondé sur l'orientation sexuelle
constituait un cas inacceptable de discrimination) ; C.E.D.H., Dudgeon v.
UK (1983) App n° 7525/76, ECHR, séries A, n° 45 (retenant
que la loi interdisant les pratiques homosexuelles en Irlande du Nord viole le
droit à la vie privée du plaignant) ; voir aussi les Principes de
Jogjakarta sur l'application du droit international des droits humains en
matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre.
999 Voir Article 21 de la Charte africaine des droits et du
Bien-être de l'enfant.
1000 CCPR, Observation générale n°19 :
La protection de la famille, le droit au mariage et l'égalité
entre époux (article 23), 27 juillet 1990, par.4.
1001 CCPR, Observation générale n°28 :
Egalité des droits entre hommes et femmes (article 3), 29 mars
2000, par.23.
379
En tout état de cause, l'âge matrimonial,
l'âge nubile ou encore âge de puberté ne fait que
présumer l'aptitude physiologique au mariage. C'est pourquoi, en dessous
de cet âge, l'homme et la femme peuvent, exceptionnellement, contracter
mariage s'ils obtiennent une dispense d'âge accordée par le
procureur de la République, et ce pour des motifs graves, comme
l'hypothèse de la grossesse qui constitue une preuve patente de leur
aptitude physiologique.
La troisième condition est le consentement personnel
des époux1002, soit l'expression de la volonté
manifeste de l'homme et la femme d'être uni par le lien conjugal. Un tel
consentement doit être sérieux et exempt de vice. En effet, «
consensus non concubitus facit nuptias »1003 dit
l'adage. Dès lors, c'est à bon droit que le consentement est
exigé par l'article 16 précité de la Déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose : « Le mariage
ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux ». Quant à l'article 21 de la Charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant, il interdit « la
promesse de jeunes filles et garçons en mariage ».
Aux termes de l'article 3 de la loi ivoirienne sur le mariage,
les futurs époux1004 doivent consentir personnellement
à leur mariage, et ce, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Cependant,
lorsqu'ils sont encore mineurs, le consentement des futurs conjoints doit
être complété soit par celui des père ou
mère, qui exerce les droits de la puissance paternelle, soit celui du
tuteur1005 ou soit par celui du juge. Ce même mariage
prévoit deux vices du consentement au mariage, savoir la violence et
l'erreur sur l'identité physique ou civile de la personne. Par
application de cette nécessité du consentement libre et
éclairé, un enfant ne peut être contraint par ses parents
à épouser une personne contre son gré.
1002 Article 3de la loi ivoirienne du 07 octobre 1964
modifiée par celle du 2 août 1983.
1003 « C'est le consentement, non le coucher, qui fait le
mariage ». ROLAND (H.), Lexique juridique des expressions
latines, 6e édition, 2014, p.57.
1004 Pareillement, l'article 6 (a) du Protocole à la
charte africaine et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique
énonce que : « Aucun mariage n'est conclu sans le plein et libre
consentement des deux époux ». 1005 Aux termes de l'article 8,
alinéa 2 de la loi sur le mariage, le droit de consentir au mariage du
mineur revient au tuteur lorsque les père et mère sont morts,
inconnus ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté,
s'ils n'ont pas de résidence connue ou s'ils sont l'un et l'autre
déchus des droits de la puissance paternelle. A défaut de tuteur,
l'autorisation échoit au juge : elle est demandée par
requête au président du tribunal ou de la section de tribunal de
la résidence du mineur.
380
Toutes les conditions susmentionnées sont des
conditions de fond1006 auxquelles s'ajoutent des conditions de forme
comme la célébration du mariage par un officier de l'état
civil. En effet, aux termes de l'article 19 de la loi relative au mariage,
« seul le mariage célébré par un officier de
l'état civil a des effets légaux »1007. Tel
n'est pas le cas de ces mariages précoces et/ou forcés qui se
pratiquent clandestinement au mépris des lois de la République
ivoirienne.
Outre cela, l'on constate une atteinte plurielle au droit des
enfants à la participation.
1006 Les autres conditions de fond sont les suivantes :
La prohibition de la bigamie : ayant opté pour le
mariage monogamique, le législateur ivoirien a prohibé la bigamie
en ces termes : « nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la
dissolution du précédent... » . Cette prohibition
expresse de la bigamie entraine, en bonne logique, celle de la polygamie et de
la polyandrie. Il s'ensuit qu'il est interdit à un même homme
d'avoir simultanément plusieurs épouses, et à une
même femme d'avoir simultanément plusieurs maris. C'est dire que
le mariage présuppose que les futurs conjoints soient
célibataires, divorcés ou veufs.
Dans la pratique, les femmes mariées soutiennent avec
hargne l'interdiction de la polygamie prescrite par la loi car elles
n'aimeraient pas partager leurs époux avec d'autres femmes. A
contrario, les femmes célibataires ont toujours contesté et
vilipendé la loi prohibant la polygamie qu'elles trouvent inique, en ce
sens que cette loi réduit sérieusement leur chance d'avoir un
mari.
Quant aux hommes, ils contournent, par des manières
diverses cette prohibition de la polygamie. Certains contractent plusieurs
unions coutumières, et vivent sous le même toit avec leurs «
épouses coutumières » optant ainsi
délibérément de vivre en marge du droit moderne. D'autres
contractent un mariage légal, puis entretiennent une ou plusieurs «
illégitimes », c'est-à-dire des maitresses, cela, en dehors
du domicile conjugal, et au mépris du droit interne et international.
La prohibition de l'inceste : S'inspirant de l'anthropologie,
la loi ivoirienne sur le mariage interdit, pour des raisons de moralité
et de santé, l'union conjugale entre certains parents. Ainsi, aux termes
de l'article 10, le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous
les ascendants et descendants et les alliés de la même ligne.
Autrement dit, le mariage est interdit entre père et fille, mère
et fils, grand-père et petite fille, grand-mère et petit-fils,
entre arrière-grands-parents et leurs petits-enfants.
Selon l'article 11, le mariage est prohibé, en ligne
collatérale, entre frère et soeur. Il est, en outre,
prohibé entre oncle et nièce, tante et neveu et entre
alliés au degré de beau- frère et belle-soeur, lorsque le
mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce.
Exceptionnellement, certains parents peuvent être autorisés
à se marier entre eux s'ils obtiennent une dispense du procureur de la
République, et ce, pour des causes graves. Le respect du délai de
viduité : le délai de viduité est de trois cent (300)
jours ; ce qui correspond à la durée maximale d'une grossesse. Ce
délai est fixé par l'article 9 de la loi sur le mariage selon
lequel la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois
cents (300) jours révolus depuis la dissolution du mariage
précédent. Ce délai peut être abrégé
dans deux hypothèses : d'une part, il prend fin de plano en cas
d'accouchement ; d'autre part, il prend fin par décision du juge
à la demande de la femme, lorsqu'il est évident que depuis trois
cents (300) jours révolus, le mari n'a pas cohabité avec elle. Au
fond, le respect du délai de viduité permet d'éviter la
confusion de paternité.
1007 Il procède de là que le législateur
ivoirien n'accorde point de valeur juridique aux mariages coutumiers et aux
mariages religieux.
381
§ 3. DES ATTEINTES AUX FORMES DE PARTICIPATION DE
L'ENFANT
La participation peut être définie comme l'action
de prendre part à quelque chose, par le fait d'être
impliqué dans le processus de décision qui nous concerne ou qui
concerne la communauté au sein de laquelle nous vivons1008.
Toutefois la participation ne se limite pas à donner son avis ou son
opinion sur une question, une situation ou une institution, définies par
quelqu'un d'autre ; elle implique de pouvoir contribuer à
l'élaboration de la question, à la détermination des
objectifs et à la structure de l'organisation ou de
l'institution1009. Ce droit de participation des enfants est
affirmé à l'article 12 de la Convention des Nations Unies en ces
termes : « 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité...
»1010. La reconnaissance du droit de l'enfant de
participer aux décisions qui sont prises en son nom ou à son
sujet nous force à sortir du discours concernant le pouvoir d'agir de
l'adulte pour assurer le bien-être de l'enfant, via le principe de
l'intérêt de l'enfant, pour envisager également le pouvoir
d'agir de l'enfant lui-même en tant que gardien de ses propres
droits1011. Il s'agit d'un changement important dans la
manière de concevoir les droits de l'enfant. Le droit de participation
s'apparente au droit à l'autonomie1012 ; Ce changement de perspective ne
pouvait qu'entrainer son lot de critiques1013. Malgré ces
1008 LAVALLEE (C.), La protection internationale des
droits de l'enfant : entre idéalisme et pragmatisme, Bruylant,
2015, p.66.
1009 LAVALLEE (C.), La protection internationale des
droits de l'enfant : entre idéalisme et pragmatisme, Bruylant,
2015, p.66.
1010 ZANI (M.), 1996, La convention internationale des
droits de l'enfant : Portée et Limites, Lyon Publisud, pp.225-239,
voir annexe 3 pp.97-107.
1011 LAVALLEE (C.), « La parole de l'enfant
devant les instances civiles ; une manifestation de son droit de participation
selon la Convention internationale relative aux droits de l'enfant »,
in V. FORTIER et S. LEBREL-GRENIER (dir.), La Parole et le droit,
Rencontres juridiques Montpellier-Sherbrooke, éd. R.D.U.S.,
2009, pp. 121-137.
1012 LAVALLEE (C.), La protection internationale des
droits de l'enfant : entre idéalisme et pragmatisme, Bruylant,
2015, p.65.
1013 THOMAS (N.), « Toward a theory of
Children's participation », Int'l J. Child. Rts., vol.15, 2007,
pp.199-218, spéc. p.202.
382
critiques, désormais, dans une société
démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, y compris
les enfants. Leur donner l'information adéquate à leur âge,
les écouter, les associer aux prises de décisions, à la
maison, à l'école, au village, dans leur quartier, est de la
responsabilité de tous les Etats ayant ratifié la Convention
internationale des droits de l'enfant qui place la participation comme l'un de
ses quatre principes fondamentaux1014.
Malgré cette reconnaissance juridique de la
participation des enfants, en Côte d'Ivoire, on observe une
quasi-inexistence du droit à la participation au niveau familial et
scolaire (A) et une négation du droit à la participation à
la vie publique et socio-économique (B).
A. LA QUASI INEXISTENCE DU DROIT A LA PARTICIPATION AU
NIVEAU FAMILIAL ET SCOLAIRE
Elle se traduit par un faible niveau de participation à
la vie familiale ainsi qu'à la vie scolaire.
1. Un faible niveau de participation à la vie
familiale
La reconnaissance du droit de l'enfant à la prise de
parole modifie théoriquement les relations traditionnelles entre les
enfants et leurs parents. Ces derniers ne sont plus simplement
considérés comme des prestataires de services ou des titulaires
d'obligations parentales exercées dans un but de protection, ils doivent
désormais agir de manière à donner aux enfants un espace
pour exprimer leur opinion et ainsi prendre une part active aux
décisions qui les concernent1015. En pratique, les enfants et
les jeunes participent rarement aux débats sur les problèmes
ainsi qu'à la prise de décisions qui se rapportent à eux.
Les parents sont dans la plupart des cas, les premiers et les derniers à
décider à leur place. Et les enfants sont presque toujours
informés après coup, de ce qui a été
décidé pour eux. Souvent, quand ils expriment leur volonté
ou leurs décisions (choix en matière d'éducation,
liberté de sortir, choix religieux, etc.), ils se heurtent à
l'incompréhension et à la réprobation de leurs parents.
Relativement au débat relatif à la notion «
d'intérêt supérieur de l'enfant », et de la
capacité de ce dernier à pouvoir l'apprécier par
lui-même, « Peu d'auteurs se sont lancés
1014 UNICEF, Fiche Thématique, Unicef-France,
2010, p.1.
1015 MEUNIER (G.), L'application de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans le droit interne des Etats
parties, coll. « Logiques juridiques », Paris, L'Harmattan,
2002, p.66.
383
dans cet exercice périlleux car le flou et la
géométrie variable qui entourent le concept rendent la chose
difficile1016 ». Au départ, les enfants ont
été exclus du monde réel. L'argument invoqué de
manière récurrente par ceux qui sont opposés à
l'idée d'accorder des droits autonomes aux enfants est que «
les enfants ne sont pas assez mûrs physiquement, intellectuellement
et émotionnellement, et n'ont pas l'expérience nécessaire
pour porter un jugement rationnel sur ce qui est ou n'est pas dans leur
intérêt 1017».
Il s'ensuit que la liberté de participation tout comme
la liberté de religion, est théoriquement exerçable
directement par l'enfant ; l'interprétation qui en découle l'est
surtout sur le fondement du droit des parents1018 . Cette attitude
des parents peut se justifier sur la base de la Déclaration sur
l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction1019 qui
prévoit le droit des parents d'élever l'enfant selon leurs
préceptes religieux ou leurs croyances. En définitive, les
enfants sont privés de leur droit d'exprimer leur opinion sur toute
question les intéressant, surtout lorsqu'il s'agit de leur propre
personne, encore moins de leurs parents (accusation à tort, intention de
séparation ou de divorce des parents, etc.) ; Ainsi, continuent-ils
à subir les choix et décisions imposés et souvent
inappropriés de leurs parents et de leurs frères et soeurs plus
âgés.
Il en va aussi du faible niveau de participation à la vie
de l'école.
2. Un faible niveau de participation à la vie
scolaire
Les enfants peuvent demander à être entendus sur
l'élaboration de certaines politiques publiques1020. Tel
n'est pas le cas au niveau du secteur éducatif. Au niveau
éducatif, la participation des enfants souffre d'un ensemble de conflits
allant de la cellule familiale
1016 ZERMATTEN (J.), « L'intérêt
supérieur de l'enfant, de l'analyse littérale à la
portée philosophique », in Working report de
l'Institut International des Droits de l'Enfant : Children Rights and
Burma, IDE, 2003, p.15.
1017 VERHELLEN (E.), « Evolution et développement
historique de l'éducation de l'enfant et de la participation des enfants
à la vie familiale », in Conseil de l'Europe,
évolution du rôle des enfants dans la vie familiale :
participation et négociation, Strasbourg, actes de la
Conférence de Madrid, 1994, p.5.
1018 VAN BUEREN (G.), The international Law on the Rights of
the Child, op. cit. cit., note 64, p.151.
1019 Déclaration sur l'élimination de toutes
formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction, Doc. Off. A.G.N.U.,36e sess., Doc. N.U.
A/RES/36/55( 25 novembre 1981).
1020 ANG (F.) et al., « Participation rights in
the UN Convention on the rights of the child » , Participation Rights
of Children, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2006, p.17.
384
jusqu'à l'école. Il existe souvent un gouffre
entre le désir des enfants et les préoccupations des parents. Les
parents ont en général un modèle qu'ils veulent imprimer
à leurs enfants sans tenir compte du caractère propre de ceux-ci
et donc des opportunités qui seraient les meilleures pour eux en
matière d'éducation1021. Cette situation conflictuelle
est malheureusement exacerbée par le système éducatif
ivoirien actuel qui ne favorise pas la flexibilité en ce qui concerne
les démarcations que pourraient faire certains enfants avant même
d'avoir complété leur formation scolaire. En effet, certains
enfants ont des prédispositions soit littéraires, soit
technologiques, soit artistiques, qui les poussent à ne
s'intéresser qu'à ces seuls aspects de la vie éducative et
à en négliger les autres. Toutefois, aucune structure
socio-éducative ou pédagogique ne permet la prise en compte de
l'opinion des élèves sur les différents curricula
véhiculés à l'école ainsi que sur la qualité
de l'enseignement.
L'un des moyens susceptibles d'impliquer les enfants aux
programmes scolaires est l'institution des coopératives scolaires. Une
coopérative scolaire est un regroupement d'adultes et
d'élèves qui décident de créer un projet
éducatif en s'inspirant de la pratique associative et
coopérative1022. Malheureusement, les coopératives
sont désormais inexistantes, notamment en milieu urbain. De même,
les modules de formation introduisent des notions sur l'hygiène et
l'environnement sans toutefois associer réellement les enfants à
la perception de leur contenu. En conséquence, on relève un
certain désintérêt pour certains enseignements chez de
nombreux élèves, lorsque leurs prédispositions ne sont pas
encouragées.
Pour favoriser la mise en oeuvre du droit des enfants à
la liberté d'association, le Comité des Nations Unies encourage
les Etats à favoriser l'établissement d'organisation d'enfants
1021 A la vérité, au moment de décider
choix des orientations relatives aux filières proposées pour la
première année du Lycée (classe de seconde), une bonne
partie des parents imposent souvent à leurs enfants le choix des
filières scientifiques présentées à tort ou
à raison comme celles pouvant assurer un avenir professionnel certain
à l'enfant, alors que celui-ci est parfois doué pour une
série littéraire au regard de ses résultats scolaires et
de son projet professionnel. Qui plus est, certains parents imposent à
leurs enfants d'embrasser des filières conformes au projet professionnel
non abouti des parents, de sorte qu'à terme ces enfants puissent
accomplir le métier ou la fonction que le père ou lé
mère n'ont pu exercer pour diverses raisons. Ce constat ressort des
entretiens réalisés auprès de certains
élèves du Lycée Sainte Marie d'Abidjan, le Lycée
Mixte de Yamoussoukro, du Collège secondaire protestant de Dabou.
1022 CATTIER (F.), « Les Coopératives scolaires
», In. Revue des Etudes Coopératives n°25
Octobre-Décembre 1927, pp.1, 2 et 3 ; BERTHELOOT, La
mutualité scolaire CNDP, Orléans 1910, p.10 ; MABILLEAU
(L.), Guide de la Coopération scolaire, INRP, Paris, 1961,
p.15.
385
dans les écoles et dans les municipalités. La
nécessité d'être majeur pour siéger au Conseil
d'administration de certains organismes ou pour exercer des activités
politiques peut également devenir une limite aux droits des enfants
à la participation. Le Comité se dit préoccupé par
certaines de ses limites et encourage les Etats à les revoir dans le but
de faciliter l'exercice du droit d'association pour les personnes
mineures1023.
Au-delà du cadre familial et scolaire, les enfants sont
aussi exclus de toute participation à la vie publique et
socio-économique.
B. L'EXCLUSION DE TOUTE PARTIPATION A LA VIE PUBLIQUE
ET SOCIO-ECONOMIQUE
Une approche cohérente de la Convention induit que la
parole de l'enfant constitue l'un des éléments permettant de
déterminer son intérêt1024. Malheureusement on
note une négation du droit à la participation à la vie
publique et socio-économique ; cette négation est ponctuée
par une faible participation à la vie publique politique et
associative(1), une participation à la vie économique comme
obligation familiale (2) et une faible participation aux services sociaux de
base (3).
1. Une faible participation à la vie publique
politique et associative
L'organisation traditionnelle du pouvoir présente de
fortes rigidités qui excluent les enfants notamment les filles de la
prise de décision. En effet, l'exercice du pouvoir est
réservé aux ainés de sexe masculin. Et même quand il
arrive que certains enfants soient au centre des litiges familiaux à
caractère communautaire, le règlement des conflits impose la
représentation de leurs parents. Ou alors quand ceux-ci sont entendus,
leurs opinions traduisent plus le bon vouloir de leurs parents que leur intime
conviction.
Il existe un lien étroit entre le droit à la
liberté d'expression et le droit à la liberté
d'association et de réunion pacifique, bien qu'ils ne soient pas
prévus au même article. En
1023 HODGKIN (R.) et NEWELL (P.), Implementation Handbook
for the Convention on the Rights of the child, 3eéd.,
New-York, United Nation Publication, 2007, p.198.
1024 LUCKER-BABEL (M.-F.), « L'écoute de l'enfant
devant les tribunaux civils : lecture de la Convention sur les droits de
l'enfant et de quelques législations nationales », in P.D.
JAFFE (dir.), Défier les mentalités. La mise en oeuvre de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant,
Université de Genève, 1998, p.253.
386
effet, ces droits visent l'un comme l'autre à favoriser
la participation de l'enfant au sein de différents
groupes1025. L'article 15 de la CIDE se borne à reprendre
succinctement ce que prévoient déjà les autres instruments
internationaux1026 . Il en va ainsi de l'article 20 de la DUDH et
des articles 21 et 22 du PIDCP qui, eux, sont orientés davantage vers la
protection des droits syndicaux. Cependant, une interprétation large
s'avère nécessaire dans le cas des enfants. En effet, si le droit
d'association vise nécessairement les organisations d'enfants
travailleurs, il comprend aussi les organisations d'étudiants dans le
cadre scolaire et les groupes communautaires militant pour diverses causes. En
outre, la vie politique et administrative moderne est également
dominée par les adultes. Toutefois, sous l'influence des mutations
socio-politiques, on assiste de plus en plus à un nombre croissant de
jeunes dans les associations à caractère
politique1027. En effet, les structures politiques des partis
semblent permettre une réelle participation des jeunes (enfants) aux
activités militantes. Cependant, la prise de décision est, en
général, très centralisé au niveau de l'organe de
décision ultime. Même à ce dernier niveau, le
secrétariat ou le cabinet du président du parti, reste le lieu de
la dernière prise de décision et relève des adultes. Les
statistiques disponibles ne permettent malheureusement pas de
différencier la participation effective des jeunes de moins de 18 ans
selon le sexe afin de saisir le poids de leur participation effective.
Cependant, l'observation empirique montre que les enfants sont
généralement confinés au rôle de faire-valoir
(mobilisation sociale, campagne électorale, etc.) dans les organes de
jeunes des partis politiques, alors que les adultes tendent à être
prédominants à tous les autres niveaux. Même si aujourd'hui
la constitution du Parlement des enfants1028 traduit la
reconnaissance du droit à la participation des enfants, il apparait plus
comme une structure de promotion qu'une institution dont les actions et
propositions se traduiraient concrètement dans les choix et
décisions politiques.
Quant aux associations de jeunes, elles existent tant en
milieu urbain que rural. Ce sont par exemple, les associations de jeunes
handicapés, les associations de jeunesse
1025 VAN BUEREN (G.), The international Law on the Rights
of the Child, coll. « International Studies in Human Rights »,
vol.35, Dordrecht-Boston-London, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p.144.
1026 Voir Article 20 de la DUDH, les articles 21 et 22 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 8 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
1027 On peut citer entre autres, la Jeunesse du Parti
Démocratique de Côte d'Ivoire (JPDCI), la Jeunesse du Front
Populaire Ivoirien (JFPI), la Jeunesse du Rassemblement des Républicains
(JRDR).
1028 Le parlement des enfants a été institué
par décret n°2013-857 du 19 décembre 2013.
387
confessionnelle ou laïque telles que le
scoutisme1029, la jeunesse estudiantine catholique, les associations
de jeunesse musulmane et les associations de jeunes ressortissants de
localités ou de régions. Ces associations sont souvent
regroupées au sein de la fédération des mouvements et
associations de jeunesse et l'enfance (FEMAJECI). Mais leur vocation reste, la
plupart du temps, récréative ou socioculturelle ou dans quelques
rares cas socioprofessionnels. Aussi, elles se trouvent très souvent
confrontées aux problèmes financiers et organisationnels qui
limitent leur champ d'intervention.
2. Une participation à la vie économique
comme obligation familiale
La participation à la vie économique pour la
plupart des enfants apparaît plutôt comme un ensemble d'obligations
envers la famille, qu'une capacité de décider du type d'emploi ou
du moment où il faut exercer cet emploi. En effet, les adolescents et
les jeunes de certaines régions rurales les plus pauvres, ont
l'obligation d'aider les parents dans les activités champêtres,
surtout pendant les périodes critiques du calendrier cultural, qui
demandent une forte main d'oeuvre. Lorsque les enfants refusent de se soumettre
aux activités champêtres, ils peuvent être privés de
nourriture et de sortie. Ce phénomène s'observe aussi en milieu
urbain où certains adolescents sont obligés de travailler au sein
de l'entreprise familiale pour assurer la continuité de leur
scolarisation. Certains enfants sont parfois obligés de faire de
l'école à temps partiel. Dans les familles pauvres, chaque membre
doit contribuer aux charges familiales. Cependant, les enfants travaillent plus
sous l'influence des pratiques traditionnelles et des décisions des
parents plutôt que sur leur réelle initiative ; En outre, ils ne
bénéficient pas souvent des fruits de leur travail, car les
revenus de leurs différentes activités reviennent bien souvent
aux parents ou aux employeurs.
3. Une faible participation aux services sociaux de
base
S'agissant de l'accès aux services sociaux de base tels
l'éducation et la santé, les enfants n'ont pour la plupart pas le
choix de l'initiative, même si ces enfants contribuent aux charges
familiales dans la mesure où ces derniers vivent encore chez les
parents. Une analyse des déterminants socio-économiques de la
demande des soins de santé à Abidjan révèle que
dans
1029 SCOUTS, Le Scoutisme : éducation pour la
vie, pp.1-36 ; SAVARD (P.), « L'implantation du scoutisme au
Canada français », In. Les cahiers des dix, n°43, 1983,
p.207-262.
388
la majorité des cas, le choix des types de recours pour
les enfants étaient dicté par les parents. Les raisons
évoquées résultaient du fait que le père est le
chef de famille et donc la première personne habilitée à
prendre ce genre de décision. Dans les autres cas, la famille
était en droit de le faire. L'accès aux services sociaux de base
par les enfants est déterminé, non seulement par la
capacité économique dont peuvent disposer les jeunes pour
s'offrir les avantages y afférant, mais plus, par leur implication
effective dans la gestion de ces services. Mais, en réalité, les
enfants sont absents des différents organes de gestion et de
décision des services sociaux de base. En effet, tant au niveau des
centres de santé, des programmes d'eau, assainissement, d'insertion
socioprofessionnelle, de jeux-loisirs et activités
récréatives, etc, les jeunes ne sont pas associés à
la prise de décision, encore moins à la gestion de ces
différents programmes sectoriels. En outre, ces programmes qui se
limitent souvent à quelques enquêtes de routine, sont
conçus et imposés aux enfants sans une réelle implication
de ceux-ci quant à la prise de décision sur les questions
relatives à leur accès à ces services sociaux ainsi
qu'à leur fonctionnement mais également aux perspectives d'avenir
qui s'offriront à eux. Et cette restriction se radicalise davantage pour
les enfants des campagnes issus de familles analphabètes ou
défavorisés au sein desquelles le poids de la tradition se
conjugue avec les contraintes économiques pour priver les enfants de
leur droit à la parole. On le sait, les gens s'adaptent à leurs
conditions socio-économiques ; ils ne revendiquent que ce à quoi
ils pensent pouvoir accéder. Comme le souligne Pierre Bourdieu, il
existe une corrélation très étroite entre les «
probabilités objectives », scientifiquement construites
(par exemple les chances d'accès à tel ou tel bien, telle ou
telle formation universitaire...) et les « espérances
subjectives » que constituent précisément les besoins
et les motivations qui y sont liés pour les satisfaire1030.
Un besoin social n'est donc pas « naturel », il est
construit socialement dans l'interaction entre un individu et son
environnement. Les personnes intègrent dans l'expression de leurs
besoins les dispositions qui sont les leurs, en l'occurrence celles qui sont
inculquées par les possibilités et les impossibilités, les
libertés et les nécessités, les facilités et les
interdits1031. Ce sont ces dispositions qui engendrent
1030 BOURDIEU (P.), Le sens pratique, Paris Editions
de Minuit, 1980, p.81.
1031 La somme de ces dispositions, explique Bourdieu,
génère des conditions objectives que la science appréhende
à travers des régularités statistiques (écarts
entre les territoires, représentation de tel groupe dans telle
filière scolaire...). Cf. HBILA (C.), « La participation des jeunes
des quartiers populaires : un engagement autre malgré des freins »,
In. Sociétés et jeunesse en difficulté (en ligne
N°14) (Printemps 2014)
http://sejed.revues.org/7608
(consulté le 22 novembre 2016).
389
d'autres dispositions en matière de besoins en quelque
sorte pré-adaptés à leurs exigences. Ainsi, chez une
partie des jeunes des quartiers populaires, les pratiques les plus improbables
se trouvent exclues, très souvent avant même tout examen, au titre
d'impensables. Là où des jeunes, de par leur environnement de
socialisation et leurs parcours socio-éducatifs, sont en capacité
de penser des projets culturels, sociaux et humanitaires, etc., d'autres, au
contraire, ils en sont malheureusement exclus par les décideurs ; Or,
l'une des premières conditions fixées à la participation
des enfants , aussi bien par les décideurs locaux que les professionnels
de jeunesse, implicitement plus qu'explicitement, est celle du
dépassement de leurs intérêts particuliers et
immédiats. Il leur est demandé de se projeter en situant l'objet
auquel se réfère la participation au plus haut niveau de
généralité. Comme le note Régis Cortesero, il
s'agit d'amener les jeunes gens à changer d'échelle pour se
comporter comme des « vrais citoyens », visant
l'universalité d'un « bien commun », celui que les
pouvoirs publics auront définis et pour lequel ils en attendent une
légitimation1032. Le fait de ne pas les associer peut
être perçu comme un renvoi à leurs intérêts
privés et communautaires, et correspond à une forme classique de
délégitimation que l'on observe dans toutes les scènes
délibératives où il est question de discréditer des
acteurs1033.
Outre les atteintes afférentes à la survie et au
développement, en Côte d'Ivoire, les enfants sont également
victimes de toutes sortes d'abus.
1032 CORTESERO (R.), « La participation en débat
» In. HBILA (C.) et BIER (B.), Conduire un projet expérimental
en direction des jeunes des quartiers populaires, Nantes, éditions
de Réso Villes, 2014, p.107. 1033 HBILA (C.), « La
participation des jeunes des quartiers populaires : un engagement autre
malgré des freins », In. sociétés et
jeunesse en difficulté (en ligne N°14) (Printemps 2014)
http://sejed.revues.org/7608
(consulté le 22 novembre 2016).

391
SECTION
II. LA PROTECTION
DES ENFANTS CONTRE TOUTES FORMES D'ABUS
Les Etats parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de
violences, d'atteintes ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon, de violences sexuelles, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou de ses représentants légaux
ou de toute autre personne à qui il est confié1034.
Les Nations Unies ont invité les Etats à «
renforcer les mécanismes et programmes nationaux et internationaux
de défense et de protection des enfants, en particulier, des filles, des
enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d'une
exploitation économique et sexuelle, à des fins notamment de
pornographie ou de prostitution ou pour la vente d'organes des enfants victimes
de maladies, dont le SIDA, des enfants réfugiés et
déplacés, des enfants en détention, des enfants
mêlés à des conflits armés, ainsi que des enfants
victimes de famine et de la sécheresse ou d'autres situations d'urgence
»1035. En dépit de cette invite, en Côte
d'Ivoire, on observe trois situations insoutenables : d'une part, les abus
touchant les « enfants des rues » (paragraphe 1), les pires formes de
travail des enfants qui constituent un traitement inhumain de l'enfant
(paragraphe 2) et enfin, la situation des enfants victimes de traite et le
trafic regardée comme une négation de l'existence humaine de
l'enfant (paragraphe 3).
§ 1. LES ABUS TOUCHANT LES ENFANTS DES
RUES
Pour mieux comprendre les divers abus portés aux
enfants dans les rues (B), il apparait important de préciser la notion
d'enfants des rues (A) qui traduit un certain échec de la
responsabilité parentale et étatique.
1034 Article 19, alinéa 1 CDE.
1035 Déclaration adoptée à la
Conférence Mondiale des Nations Unies sur les Droits de l'Homme tenue
à Vienne du 14 au 25 juin 1993.
392
A. DEFINITION DE LA NOTION D'ENFANTS DES RUES
La notion d'enfant des rues ne désigne pas une
catégorie stable ; Il convient en premier lieu de souligner que la
notion d'enfant des rues désigne un phénomène très
hétérogène : certains enfants vivent en permanence dans
les espaces publics ; d'autres y passent la journée pour y travailler,
mais rentrent dormir chez eux le soir ; d'autres, au contraire, font des
apparitions très irrégulières au domicile familial.
Certains enfants ont été chassés de chez eux, d'autres se
sont enfuis, souvent attirés par une bande qui vit déjà
dans la rue, certains sont accusés de sorcellerie1036,
d'autres encore ont subi des sévices...Pour tenter de saisir ces
différentes situations, les acteurs de terrain emploient le plus souvent
des catégories : ils parlent ainsi d'enfants de la rue, d'enfants dans
la rue, voire parfois même d'enfants à la rue. Cette notion est
relativement récente, puisqu'elle a été
systématisée dans le milieu des années 1980. C'est ainsi
que, pour l'Afrique, les participants au Forum de Grand-Bassam1037
(en mars 1985) décidèrent de rompre avec des termes comme «
délinquants » et pire «
prédélinquants », pour adopter les notions plus
neutres d' « enfants de la rue » (en permanence) et d'
« enfant dans la rue » (le jour seulement
»)1038. En France, les travailleurs sociaux
préfèrent parler de mineurs isolés ou de jeunes en
errance, mais le phénomène reste similaire : il s'agit bien
d'enfants en rupture avec leur cellule familiale, qui vivent et dorment dans
les espaces urbains1039. En Côte d'Ivoire, ces appellations
désignent en réalité deux situations : La première,
et de loin celle qui regroupe la majorité de ces jeunes, vise les
1036 En Côte d'Ivoire comme dans nombre de pays
africains, les accusations de sorcellerie semblent être également
l'un des facteurs importants d'augmentation du phénomène des
enfants de la rue. Pour plus d'infos, voir, Alexandre CIMPRIC, Les enfants
accusés de sorcellerie, Etude anthropologique des pratiques
contemporaines relatives aux enfants en Afrique, Unicef, Avril 2010, 66 p.
; Les autorités d'une ville au Nord d'Angola ont identifié en en
2007, 432 enfants vivant dans les rues à cause d'une accusation de
sorcellerie (La Franière, 2007). Cf. The impact of accusations of
Witchcraft against Children in Angola. An Analysis From The Human Rights
Perspective, UNICEF.
1037 Ville historique et ancienne capitale de la Côte
d'Ivoire (1893-1900),Grand-Bassam est située à 43
kilomètres à l'est d'Abidjan, ; Classée au patrimoine
mondial de l'Unesco, elle fait partie des départements composant la
région du Sud-Comoé.
1038 Le Forum de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire),
organisé par le BICE et l'UNICEF, fut la première rencontre
consacrée au phénomène des enfants de la rue en Afrique
subsaharienne. Il rassembla près d'une centaine de participants, venus
de 14 pays d'Afrique francophone, ainsi que des représentants
d'organisations internationales et d'ONG européennes, et élabora
des documents d'une grande richesse (Cf. MARGUERAT (Y.) , POITOU (D.), dir.,
A l'écoute des enfants de la rue en Afrique noire, Paris,
Fayard/Marjuvia, 1994, pp.91-152.
1039 Il ne s'agit pas ici seulement du cas des mineurs
isolés roumains, phénomène récemment très
médiatisé, mais bien de jeunes tout à fait français
(voir par exemple le témoignage recueilli par Jean-Claude Alt, «
En France aussi...Trois ans dans la rue à Paris »,
Jeunesses marginalisées n°2, 2003, pp. 85-86.
393
enfants qui passent la journée dans la rue mais ont un
endroit où passer leurs nuits. La seconde situation regroupe les enfants
qui évoluent et dorment dans la rue, où ils résident.
Les perceptions que le commun des mortels peut avoir des
enfants des rues sont souvent nourries de fantasmes et d'idées
préconçues : « deux modalités coexistent pour les
rendre visibles : la violence qu'ils exercent à l'égard des
classes moyennes, (...) et les médias qui s'emparent avec un immense
talent de leur image pour l'agiter aux yeux du monde, soit comme
épouvantails, soit encore comme victimes pitoyables...
»1040. Quoi qu'il en soit, ces enfants des rues vivant en
Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, font l'objet de divers abus dans
les rues.
B. LES DIVERS ABUS PORTES AUX ENFANTS DANS LES
RUES
S'inspirant des différents travaux menés par
Varindra Tarzie VITTACHI, Richardo LUCCHINI distingue cinq catégories de
besoins dont la satisfaction concerne en particulier, l'enfant1041 :
- 1°) Les besoins liés à la survie et au
maintien de la vie (air, eau nourriture, chaleur, sécurité morale
et matérielle...) ;
- 2°) les besoins liés à la protection de
la vie (abri, sécurité, hygiène, soins préventifs
ou curatifs...) ;
- 3°) les besoins liés à l'enrichissement
de la vie (éducation, prise de conscience de son identité,
sentiment d'appartenance...) ;
- 4°) les besoins d'agrément et de divertissement
(développement des dons innées, formation professionnelle...)
;
- 5°) Les besoins liés à
l'épanouissement (développement des dons innés, formation
professionnelle).
De 1 à 5, l'ordre d'urgence dans la satisfaction de ces
besoins est décroissant, que ce soit d'ailleurs pour les enfants comme
pour les adultes. En ce qui concerne, les enfants des rues,
1040 TESSIER (S.) « Distances, ponts, liens et
chausse-trappes », in S. Tessier, dir.,A la recherche des enfants des
rues, Paris, Karthala, collection Questions d'enfances, 1995, p.16.
1041 VITTACHI (V.T.), « Droits de l'enfant, devoirs
envers l'enfant », in Tribune internationale des droits de
l'enfant, Volume 3, n° 3, 1986, p. 14, cité par R. Lucchini,
Enfant de la rue, pp.13- 14.
394
la satisfaction de ces différents besoins est
évidemment plus ou moins précaire, et elle ne les touche pas tous
de manière uniforme. Les enfants devront ainsi surtout « lutter
1042» afin de satisfaire en priorité les besoins de
la première et deuxième catégorie (survie et protection) ;
ils attachent aussi généralement beaucoup d'importance aux
besoins relevant de la quatrième catégorie (jeux et
divertissements)1043.
Les besoins primaires des enfants des rues ne sont pas
satisfaits. En effet, les enfants n'ont pas accès à
l'éducation, aux soins de santé, à la nourriture, à
un logement décent et sécurisant. Et ces enfants ne sont ni assez
grands pour travailler. Les enfants en déshérence vivent en
rupture atténuée ou prononcée avec leurs familles. La rue
devient le lieu privilégié de socialisation : l'apprentissage des
comportements non-conformistes (violence, drogue, VIH, délinquance), les
stratégies de survie.
De plus en plus dans la rue, les enfants sont plus
vulnérables et n'ont ni les ressources physiques et morales pour
résister aux agressions extérieures (environnement malsain,
violences). Ils sont exposés à de nombreux risques tels que les
accidents de la circulation, les abus et sévices sexuels (prostitution,
pédophile, viol, etc.) et toutes sortes de violences et d'exploitation
économique. Ces enfants sont en situation extrêmement difficile.
Ils ne bénéficient d'aucune mesure de protection et quelques-uns
parmi eux sont obligés d'élire domicile dans les habitations
inachevées, bars, restaurants ou coins de rue, s'exposant ainsi aux
nombreuses maladies et autres intempéries. La rue peut être aussi
un lieu de travail cruel et dangereux, menaçant souvent la vie
même des enfants1044. Beaucoup d'enfants travaillent dans les
rues pour s'assurer leur survie ou celle de leur famille. Ils cirent les
chaussures, lavent et gardent les voitures, portent des colis, ramassent des
objets recyclables. Ce sont des enfants dans la rue, pas nécessairement
des enfants des rues1045. Une forme spécifique du travail des
enfants dans/ de la rue est celle de la mendicité.
1042 C'est le mot fréquemment employé par les
enfants de la rue en Côte d'Ivoire pour décrire leurs conditions
de vie.
1043 PIROT (B.), Enfants des rues d'Afrique Centrale,
Ed. Karthala, 2004, p.50-51.
1044 Voir l'Affaire dite des enfants de la rue ou affaire
Villagrán Morales et autres, arrêt du 19 novembre 1999,
op.cit.
1045 L'UNICEF a établi une distinction entre enfant de
la rue et enfant dans la rue, le premier étant l'enfant qui ne vit que
dans la rue, celui qui a perdu tous liens familiaux, le deuxième, celui
qui passe beaucoup de temps dans la rue, souvent celui qui travaille dans la
rue et qui rentrent quotidiennement dans leur famille, mais qui a gardé
des liens familiaux.; voir à ce sujet : SALMON (L.),, « Les enfants
de la rue à Abidjan », Socio-
395
Au total, l'existence du phénomène des enfants
en déshérence ou de la rue traduit l'échec collectif de la
famille et de la société. Ce faisant, elle met en lumière
la vulnérabilité et l'impuissance des enfants puis leur
accès limité aux services sociaux de base. Cette situation des
enfants des rues est en contradiction avec les articles 181046 de la
Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) sur le droit à
la protection familiale et 201047 du même texte et relatif aux
droits privés de famille. Les risques qu'ils encourent dans la rue sont
en contradiction avec les prévisions de la Convention internationale des
droits de l'enfant (CIDE), notamment, en son article 19 sur le droit des
enfants à la protection contre les mauvais traitements, toutes les
formes de violence et abus sexuels, son article 32 relatif à leur
protection contre l'exploitation économique, en son article 33 sur la
protection contre la consommation et le trafic de stupéfiants, de
même qu'avec son article 39 sur le droit à la réadaptation
et à la réinsertion des enfants.
Les enfants de la rue constituent un véritable
problème national et l'accroissement du phénomène
inquiète la communauté et appelle les autorités publiques
et la société civile ainsi que les familles à des
réponses pressantes. Car, ces enfants sont des personnes en devenir
anthropologie [En ligne], 1 | 1997, disponible sur
:
http://journals.openedition.org/socio-
anthropologie/76#quotation ( consulté le
12/11/2016).
1046 Article 18 CIDE :
« 1. Les Etats parties s'emploient de
leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au
premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les Etats parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur
incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le
droit de bénéficier des services et établissements de
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
».
1047Article 20 CIDE
« 1. Tout enfant qui est temporairement
ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a
droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la
forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de
l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une
certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de
son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. ».
396
qui nécessitent de la part des adultes, une meilleure
protection à l'image des enfants victimes des pires formes de travail
des enfants considérés comme un traitement inhumain de
l'enfant.
§ 2. LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS : UN
TRAITEMENT INHUMAIN DE L'ENFANT
Tout d'abord, il s'agira ici, de mettre en exergue les formes
classiques de travail des enfants qui menacent considérablement
l'intérêt de l'enfant (1) ; ensuite, il conviendra d'analyser
l'épineuse question de l'exploitation sexuelle des enfants qui constitue
manifestement, une forme particulière de travail inhumain et
dégradant (2).
1. Les formes classiques de travail des
enfants
La protection des enfants contre l'exploitation de leur force
de travail se fonde sur l'article 32 de la CIDE mais également, sur
l'Article 19 qui affirme le droit de l'enfant d'être
protégé contre les mauvais traitements. Un enfant est ainsi
considéré au travail ou exploité, dans le sens de la CIDE,
lorsque le travail exercé est incapacitant ou constitue un obstacle
à la jouissance des autres droits qui sont reconnus à l'enfant
dans la Convention sur les Droits de l'Enfant, notamment les droits à la
santé, à l'éducation, et aux loisirs. Mieux, l'enfant peut
être considéré économiquement actif quand bien
même son travail n'est pas rémunéré1048.
Il peut être économiquement actif au sein d'une entreprise, que
celle-ci soit familiale ou non, à la condition que le produit ou le
service soit destiné au marché. Cette manière de concevoir
le travail de l'enfant fait en sorte que les jeunes qui travaillant à
l'extérieur de leur famille comme employés domestiques sont des
enfants économiquement actifs, alors que ceux qui travaillent au sein de
leur famille ne sont pas considérés comme tel. Le travail doit
donc générer un revenu même si l'enfant n'est pas celui qui
en bénéficie directement. Pour déterminer quels sont les
enfants économiquement actifs, le BIT a établi quatre
catégories d'enfants : ceux qui se consacrent à temps plein
à l'école, ceux qui se consacrent à temps plein au
travail, ceux qui combinent les deux types d'activités, et ceux qui ne
sont ni à l'école ni au travail1049. Le BIT qualifie
ces derniers de « no where children », des enfants
invisibles dont le statut n'est pas bien défini. Cette dernière
catégorie est très large. Elle inclut les
1048 BHUKUTH (A.), « Le travail des enfants : limites de
la définition », In. Mondes en développement, t.37,
vol. 2, n°146, juin 2009, pp. 27-32, spéc. p.28.
1049 Ibid.
397
enfants qui exercent une activité domestique familiale
ainsi que les enfants de la rue. Or la majorité des enfants de la rue
exercent un travail pour survivre. Ce travail constitue la plupart du temps une
activité marchande, mais ils ne sont pourtant pas comptabilisés
par le BIT.
La définition de l'OIT, fondée sur la notion
d'économie, ne fait pas l'unanimité. D'autres organisations ont
choisi une définition plus large. Par exemple l'ONG Save the
Children définit le travail des enfants dans un sens beaucoup plus
large, c'est-à-dire comme : « (...) des activités que
les enfants effectuent pour contribuer à la vie économique de
leur famille ou à la leur. Cela englobe donc le temps passé
à des corvées d'entretien de la maison ainsi que des
activités génératrices de revenus, à la maison ou
à l'extérieur. Les activités agricoles non
rémunérées que de nombreuses filles et garçons
accomplissent dans les fermes familiales, ainsi que les corvées
domestiques que font beaucoup d'enfants chez eux sont donc englobées
dans cette définition. Le travail peut être à temps plein
ou à temps partiel1050 ». Cette définition a
le mérite d'inclure les enfants de la rue et les enfants qui sont
engagés dans les activités illicites1051.
Traditionnellement, en Côte d'Ivoire comme en Afrique,
le travail des enfants constitue : un mode d'acquisition des connaissances ;
une responsabilité, parfois à valeur économique,
confiée à l'enfant dans la division des tâches familiales
et communautaires, un facteur d'intégration sociale. Les garçons
accompagnent leur père dans ses activités productives, tandis que
les filles vont rejoindre leur mère pour les seconder tant dans les
travaux domestiques que dans les activités productives que celles-ci
mènent, conformément à la division sexuelle des
tâches au sein de la famille traditionnelle. Ce schéma reste
particulièrement prégnant dans les sociétés rurales
ivoiriennes, où chaque membre de la famille se voit assigner non
seulement un statut et des responsabilités sociales, mais aussi un
rôle productif dans l'économie domestique. Dans ce contexte, le
travail de l'enfant, en fonction de sa capacité, participe tout autant
d'un processus éducatif que d'une reconnaissance de son statut, en tant
qu'être social mais aussi comme un élément de la chaine de
production, au sein de la famille. L'oisiveté ou la paresse est ainsi
souvent considérée
1050 L'ALLIANCE INTERNATIONALE SAVE THE CHILDREN, Position de
Save the Children sur les
enfants et le travail, Londres, mars 2003, disponible
sur
http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/4566_0.pdf(consulté
le 11/11/2016) 1051 BHUKUTH (A.), « Le travail des enfants : limites de la
définition », In. Mondes en développement, t.37,
vol. 2, n°146, juin 2009, p.28.
398
comme un des pires maux qui menace l'enfant dans son
développement physique et moral. Le travail constitue ainsi un des
principaux moyens d'intégration et de reconnaissance de l'enfant aussi
bien à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur
de celle-ci.
Cependant, depuis longtemps déjà, et cela dans
un contexte de paupérisation tant des couches urbaines que rurales, les
logiques économiques de rentabilité et de profit, du
côté de la demande, et de survie du côté de l'offre
de main d'oeuvre enfantine, sont venues supplanter la symbolique de
participation de l'enfant à la vie professionnelle et économique
des parents, pour ne retenir que la valeur marchande de son travail. De travail
éducatif et socialisant, on est passé au travail exploitant et
marginalisant.
En Côte d'Ivoire, les résultats d'une
étude menée en 2008 par le SIMPOC rapportent qu'un quart environ
des enfants de 5-17 ans sont économiquement occupés.58% de ces
enfants sont utilisés dans l'agriculture, 23 % dans le commerce et 10%
dans l'industrie. Environ 1/5 des enfants travaillant dans l'agriculture ont
été identifiés comme travailleurs dans les secteurs de
café et de cacao. Ces enfants économiquement actifs travaillent
plus de 42 heures par semaine1052. Selon d'autres sources, plus
récentes, 19, 7% des enfants âgés de 10 à 14 ans
sont considérés comme des enfants au travail en Côte
d'Ivoire.
Les enfants qui travaillent en Côte d'Ivoire le font, la
plupart du temps, sous la tutelle d'un adulte, souvent chargé d'en
assurer la protection et l'éducation. On retient quatre types de statut
pour les enfants travailleurs. La majorité des enfants qui travaillent
le font surtout comme :
- Aides familiaux : ce statut concerne la majorité des
filles domestiques1053, mais aussi la majorité des enfants
travaillant en zone rurale, filles comme garçons ;
- Apprentis : ce statut concerne surtout les garçons du
secteur informel urbain, mais peut viser aussi les filles ;
Mais on peut également trouver des enfants qui travaillent
comme :
1052 KONE (K..S.), Du travail des enfants au travail
décent des jeunes en Côte d'Ivoire. Eléments de politique
pour l'action publique, BIT, 2010, p.13.
1053 Le travail domestique est une activité très
répandue et socialement acceptée bien que comportant à
elle seule tous les facteurs de risque aggravé pour les jeunes filles
employées comme domestiques.
399
- Indépendants : c'est le cas des enfants de la rue, en
particulier les garçons (les filles travaillant dans la rue sont le plus
souvent sous tutelle adulte) ;
- Salariés : c'est le cas des enfants en particulier de
nationalité étrangère, qui travaillent comme ouvriers
agricoles dans les plantations, mais aussi de certaines filles domestiques (les
plus âgés).
Outre la situation à risque des enfants de la rue,
où on assiste notamment à la progression de deux activités
particulièrement dangereuses pour l'enfant, que sont la collecte des
ordures ménagères et la mendicité1054, la
situation des apprentis n'en est pas moins dangereuse pour la santé et
le bien-être de l'enfant. Les conditions qui entourent désormais
l'apprentissage professionnel posent le problème :
- Du développement psychologique, dans un contexte,
où l'apprentissage met directement le jeune enfant dans un
système commandé par d'évidents rapports de production,
où on attend du jeune apprenti docilité et mimétisme ;
- Du mode d'acquisition des connaissances, dans un contexte
où le maitre mot est souvent analphabète et l'apprentissage se
fait par observation ;
- Des conditions dangereuses de travail, dans les locaux
insalubres, sans aucun respect des normes de sécurité et
d'hygiène, du fait le plus souvent d'une occupation
irrégulière des sols ;
- De l'exploitation de la force de travail de l'enfant, dans
un contexte où les objectifs de production marchande l'emportent sur
ceux de la formation.
Les enfants travaillant en zone rurale constituent la plus
grande proportion des enfants travailleurs. Les enfants qui travaillent dans
l'agriculture, essentiellement comme aides familiaux, sont
particulièrement exposés en raison de l'utilisation de produits
parfois toxiques et l'usage, sans protection ni formation de matériel
archaïque ou non adapté à leur petite taille.
Par ailleurs, les enfants qui travaillent dans les mines ne
courent pas moins de dangers que ceux qui évoluent dans l'agriculture
même si le secteur minier ne concerne encore
1054 HUMAN RIGHTS WATCH, Sénégal « Sur
le dos des enfants » Mendicité forcée et autres mauvais
traitements à l'encontre des talibés au
Sénégal, Avril 2010, p.19.
400
qu'une minorité d'enfants travailleurs en Côte
d'Ivoire. Les enfants qui encourent le plus de risques sont ceux qui
travaillent à plein temps, compte tenu de la nature des tâches
à accomplir ; ils accomplissent seuls toutes les étapes de la
recherche des minerais, notamment, le creusage et l'extraction. L'existence
d'enfants travaillant dans les mines en Côte d'Ivoire, compte tenu de son
extrême visibilité, est parfaitement connue. Et pourtant, aucune
action vigoureuse, qu'elle soit gouvernementale ou non gouvernementale n'a
été déployée en leur direction afin de les
soustraire à des conditions de vie dangereuses et
particulièrement compromettantes pour leur développement physique
et mental. La situation des enfants n'a jusqu'à présent, fait
l'objet d'aucune étude scientifique rigoureuse destinée à
mesurer l'ampleur du phénomène, analyser ses ramifications
économiques et sociales ainsi que les besoins et opportunités
d'avenir pour les enfants qui y vivent et/ou y travaillent. Toutefois, plus
récemment, l'ONG de défense des droits humains
dénommée Actions pour la Protection des Droits de l'Homme
(APDH)1055 a produit un rapport en mettant en
exergue les conséquences nuisibles de ces activités d'extraction
des mines sur bien de droits humains1056et notamment sur les
enfants.
Outre les conditions de travail qui exposent les enfants
à des risques pour leur santé et leur développement, il
importe d'examiner, le cas particulier des enfants exploités
sexuellement qui, pour être préoccupant, constitue manifestement,
une forme de traitement inhumain et dégradant.
2. Le cas particulier de l'exploitation sexuelle des
enfants
Les pratiques liées à l'exploitation sexuelle
des enfants sont difficiles à définir juridiquement. Selon
l'auteur Geraldine Van Bueren, l'exploitation sexuelle des enfants peut se
définir comme étant : « the use of children to meet the
sexual needs of others, at the expense of the children's emotional and
physical »1057. Cette définition inclut une
multitude d'activités à caractère sexuel telles que la
pornographie infantile, la prostitution juvénile, la
1055 http://www.apdhci.org/ (consulté le 18/12/2016).
1056 APDH, Côte d'Ivoire-HIRE, Mine d'or ou mine de
malheur, Plaidoyer pour le respect du droit des populations à un
environnement sain, édition 2015,pp.42-51.
1057 VAN BUEREN (G.), «The international Law on
the Rights of the Child », coll. International Studies in Human
Rights, vol.35, Dordrecht-Boston-London, Martinus Nijhoff Publishers,
1995, p.275.
401
traite et le tourisme sexuel impliquant des
enfants1058. Bien que ces activités aient en commun
l'exploitation de la sexualité des enfants à des fins
commerciales, il est possible de les distinguer de l'abus et de l'agression
sexuelle en ce sens que ceux-ci n'impliquent pas nécessairement un
caractère commercial1059. En effet, l'abus sexuel peut se
définir plutôt comme : « the involvement of dependent,
developmentally immature children and adolescents in activities they do not
truly comprehend, to which they are unable to give informed consent, or that
violate the social taboos of family roles1060 ». Ainsi,
l'exploitation sexuelle peut, dans certaines situations, inclure
également l'abus et l'agression sexuelle. Dans le présent travail
et afin de s'accorder avec les textes internationaux en vigueur, la
définition la plus restrictive de l'exploitation sexuelle,
c'est-à-dire celle incluant un caractère commercial, est retenue.
La vulnérabilité des enfants se trouve accentuée dans les
pays où la commercialisation de l'industrie du sexe est souvent
fleurissante1061. Et la Côte d'Ivoire fait incontestablement
partie de ces pays.
La pornographie infantile est définie comme «
toute représentation, par quelques moyens que ce soit, d'un enfant
s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles
ou assimilées, ou toute représentation des organes sexuels d'un
enfant, à des fins principalement
sexuelles»1062.
L'exploitation du corps des enfants dans la prostitution et
dans la production de matériel pornographique est
considérée comme une forme d'esclavage moderne. L'ampleur de ce
type d'exploitation est extrêmement difficile à mesurer, mais
l'OIT estimait, en 2005, qu'environ 1,39 millions de personnes étaient
victimes d'exploitation sexuelles dans le
1058 MUNTARBHORN (V.), « Article 34 : Sexual exploitation
and Sexual Abuse of Children », in A. ALEN et al. (dir.), A commentary
on the United Nations Convention on the Rights of Child, Leiden-Boston,
Matinus Nijhoff Publishers, 2007, p.2.
1059 VAN BUEREN (G.), «The international Law on the Rights
of the Child», op. cit., note 177, p.275. 1060 IRELAND (K.),
Wish you weren't here : The sexual exploitation of Children and the
Connection with Tourism and International Travel, Overseas Department
working paper n°7, London, Save The Children Fund, 1993, p.2, cité
in MUNTARBHORN (V.), « Sexual exploitation of Children » In.
Human Rights Study Series, n°8, New-York-Genève, United
Nations publication, 1996, p.1.
1061 SVENSSON (N.L.), « Extraterritorial Accountability :
An Assessment of the Effectiveness of Child Sex Tourism Laws », In.
Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev., vol.28, n°3, 2006,
p.641-664, spéc. p. 643.
1062 L'article 2 c du protocole facultatif à la CIDE.
402
monde. Les enfants représentaient environ 43% des
victimes et 98 % de celles-ci seraient de sexe féminin1063.
Les études font état de graves troubles psychologiques pour les
enfants1064.
Un autre canal par lequel l'exploitation sexuelle des enfants
se développe et prend une envergure incontrôlable est le tourisme
sexuel impliquant des enfants. C'est une notion relativement nouvelle qui se
réfère au cadre touristique au sein duquel les abus de mineurs
ont lieu1065. « La dégradation de la situation des
enfants du fait de la pratique généralisée du tourisme
sexuel et de l'instauration des réseaux de pédophiles à
travers le monde interpelle les consciences1066».
Les adeptes du tourisme sexuel sont, dans environ 95% des cas, des hommes
qui proviennent majoritairement des pays industrialisés et qui voyagent
vers des pays défavorisés1067. L'Unicef estime
qu'environ 30 à 35 pour cent des travailleurs du sexe sont
âgés de 12 à 17 ans1068. L'industrie du sexe
est, pour les pays industrialisés et pour les pays en voie de
développement, un marché très lucratif. Certains y voient
un frein à la volonté réelle des Etats à
réduire ce type d'industries1069. Les fournisseurs de
pornographie infantile et de prostitution juvénile peuvent donc
répondre plus facilement à la demande puisque la globalisation de
l'économie et le perfectionnement des réseaux du crime
transnational organisé facilitent grandement la perpétuation de
ces infractions1070.
1063 BIT, Rapport du Directeur général, Une
alliance mondiale contre le travail forcé. Rapport global en vertu du
suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail (Raport I (B), présenté lors de la
quatre-vingt-treizième session de la Conférence internationale du
Travail, Genève,
2005, pp.1-16, disponible sur :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_082333.p
df (consulté le 04/05/2018).
1064 2ème congrès mondial contre l'exploitation
sexuelle des enfants, Etude thématique sur la pornographie enfantine,
p.13.
1065 UNICEF, La situation des enfants dans
le monde, 2006, p.41.
1066
http://www.libertzone.org/bis.htm
: « L'affaire Dutroux » est une affaire criminelle qui a eu lieu en
Belgique dans les années 1990, et a connu un retentissement mondial. Le
protagoniste de l'affaire, Marc Dutroux, était, entre autres,
accusé de viol et de meurtre sur des enfants et de jeunes adolescentes,
ainsi que d'activités communément associées à la
pédophilie, et fut condamné pour ces faits.
1067 POULIN (R.), « La prostitution des enfants, la
notion de consentement et la Convention relative aux droits de l'enfant
», in T. COLLINS et al. (dir.), Droits de l'enfant : actes de
la Conférence internationale, Ottawa 2007, Montréal Wilson
& Lafleur, 2008, p.187-203, spéc. p. 191.
1068 UNICEF, Protection de l'enfant contre la violence et les
mauvais traitements. La traite des enfants, 5 mai 2009, disponible sur
www.unicef.org/french/protection/index_exploitation.html.
(Consulté le 05/04/2015) 1069 SVENSSON (N.L), « Extraterritorial
Accountability: An Assessment of the Effectiveness of Child Sex Tourism Laws
», In. Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev., vol.28, n°3,
2006, p.622.
1070 HIGGINS-THORNTHON (S.), « Innocence
Snatched: A Call for a Multinational Response to Child Abduction that
facilitates Sexual Exploitation », In. GA. J. Int'L &Comp.
L., vol.31, 2003, pp.619-648, spéc.p.621.
403
L'exploitation sexuelle constitue une violation de plusieurs
des droits fondamentaux des enfants car elle entraine souvent d'autres types
d'atteintes à leur santé et à leur sécurité.
En particulier, les enfants sexuellement exploités présentent un
risque accru de développer une dépendance à la drogue.
Dans un tel contexte, se livrer à la prostitution ou à la
production de matériel pornographique devient un moyen de satisfaire
cette dépendance. Outre les atteintes psychologiques, la santé et
la survie des enfants peuvent être compromises, notamment par le virus du
VIH/SIDA. Les enfants exploités sexuellement doivent répondre
à la demande d'un grand nombre de clients et sont soumis à des
pratiques sexuelles à risques, accentuant la probabilité qu'ils
contractent la maladie. L'exploitation sexuelle des enfants repose
également sur une croyance erronée selon laquelle les enfants,
à cause de leur jeune âge ne peuvent pas être porteurs du
virus. Ce mythe contribue à augmenter la demande pour des enfants de
plus en plus jeunes1071.
En Côte d'Ivoire, de nos jours, de plus en plus
d'enfants, en particulier, les jeunes filles, sont victimes à
l'école ou ailleurs, de sévices et d'exploitation sexuelle. Ces
souffrances constituent dans les médias, des faits divers. Les jeunes
filles sont abusées sexuellement en famille, violées,
poussées à la prostitution et au commerce sexuel ; les jeunes
garçons sont les victimes de pédophiles pervers. Les
sévices sexuels sont des sujets tabous, de telle sorte qu'il n'y a pas
de données statistiques disponibles. Les auteurs sont des membres de la
famille vivant en promiscuité, les employeurs des jeunes filles en
domesticité, les enseignants, les clients occasionnels, ou encore des
personnes travaillant dans les institutions. Quelques faits l'attestent
clairement :
En cours 1997, deux fillettes K.A. âgée de 9 ans
(en classe de CE1) et G.A, âgée de 10 ans (en classe de CE2) ont
subi les « assauts sexuels » de Félix ZOKOU,
directeur d'école primaire dans le village d'Obregón (Gagnoa).
Sollicitées pour effectuer des travaux dans son bureau, les deux gamines
ont été déflorées, violées à
plusieurs reprises par le directeur qui apparait comme un obsédé
sexuel. Ce dernier a alors, été poursuivi pour viol et attentat
à la pudeur devant le tribunal (correctionnel) de Gagnoa, et
condamné « à 5 ans d'emprisonnement ferme et 200 mille
francs CFA d'amende »1072.
1071 DORAIS (M.) « L'exploitation sexuelle des enfants :
des situations et des réflexions », In. L. LAMARCHE et P.
BOSSET (dir.), Des enfants et des droits, Sainte-Foy, PUL, 1997,
pp.60-63.
1072 Voir Actuel n°420 du mardi 30 décembre
1997, p.8.
404
Le 18 mars 2002, la petite K.A.A., âgée de 12 ans
élève en classe de 6° au collège municipal de
Hiré, a été aussi violée par l'abbé
Jean Marc TAYORO, curé de la paroisse Saint François d'Assise de
Hiré. Sollicitée par ce dernier pour balayer sa chambre,
la fillette accepta humblement et s'exécuta. Mais le curé la
rejoignit dans la chambre, ferma la porte et l'entraina dans son lit.
Malgré les cris de K.A.A., rien n'y fit ; le prêtre abusa d'elle.
Saisi par les parents de la victime, le tribunal de Divo a condamné
« l'homme de Dieu à 24 mois d'emprisonnement ferme et à
75000 francs d'amende»1073. A la vérité, ce
viol ou attentat à la pudeur a encore soulevé le problème
crucial de la crise de valeurs morales et religieuses et celui du déclin
de l'éthique religieuse.
A côté des abus sexuels commis sur les enfants de
sexe féminin, il y en a d'autres commis sur enfants de sexe masculin.
A titre illustratif, en mars 2000, un pédophile
impénitent dénommé ZAMBI a été
appréhendé après avoir sodomisé sa neuvième
(9ème) victime qui était le petit garçon C.N.J.
Louis, âgé de 12 ans, et élève en classe de
5ème. 1074 Après son assouvissement, sexuel
immoral, ZAMBI a menacé le petit C.N.J. Louis de mort, au cas où
il divulguerait ce qui s'est passé. Indignés devant le piteux
état, ses parents l'ont conduit « au CHU de Treichville ou le
docteur Kouadio KOFFI a attesté la sodomie perpétrée
»1075 sur le gamin. Les parents ont ensuite porté
plainte au 16e arrondissement de Yopougon.
Tous ces faits ci-dessus rapportés constituent,
à l'évidence de graves atteintes à
l'intégrité physique et morale de l'enfant. Ils sont
condamnés par les instruments nationaux, et internationaux de protection
des droits de l'homme auxquels la Côte-d'Ivoire est partie.
En effet, la Constitution ivoirienne de 2016 dispose que la
personne humaine est sacrée1076 ; de sorte qu'elle interdit les
violences physiques1077. En outre, le Code pénal ivoirien
punit le viol1078, l'attentat à la pudeur1079 et
l'outrage public à la pudeur1080. Ensuite,
1073 Voir Fraternité Matin du mercredi 22 mai
2002, p.12.
1074 Voir Soir Info n°1677 du mardi 14 mars 2000,
p.12.
1075 Ibid.
1076 Article 2Constitution de 2016.
1077 Article 5 Constitution de 2000 ; Article 5Constitution de
2016.
1078 Article 354 du code pénal ivoirien.
1079 Articles 355, 356,357 ,358 et 359du code pénal
ivoirien.
1080 Article 360 du code pénal ivoirien.
405
406
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
énonce que la personne humaine est inviolable. Et, il en tire les
conséquences en disposant que tout être humain a droit au respect
de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa
personne1081. Quant à la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, elle interdit les pratiques négatives ou
préjudiciables à la santé et au bien-être, voire
à la vie de l'enfant1082 . A cet égard, elle invite
les Etats parties à prendre des mesures tendant à protéger
l'enfant contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements
sexuels1083 .
De même, l'article 19 de la Convention Onusienne
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 invite les Etats parties
à prendre toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation y compris la violence sexuelle.
Malgré cette protection expresse et diverse, par des
textes nationaux et internationaux, on constate, aujourd'hui, que les affaires
de viol, d'attentat à la pudeur, d'outrage public à la pudeur
commis avec violence, ou brutalité, bref, d'abus sexuels dont les
enfants sont victimes en Côte-d'Ivoire, notamment en milieu scolaire,
demeurent nombreuses et fréquentes.
Selon une étude effectuée et publiée en
décembre 2002 par l'ONG « SOS violences sexuelles »,
il ressort que sur un échantillon de 500 élèves issus de
plusieurs établissements d'Abidjan et ses banlieues (248 garçons
et 252 filles), il y a 136 cas d'abus sexuels, soit un taux de
prévalence de 27,2%1084. Il s'agit de cas de viols (33,09%),
de tentatives de viol (14,7%), d'attouchements (41,18%), de harcèlement
(11,03%). Les statistiques révèlent aussi que les victimes de
sexe masculin représentent 25,73% contre 74,27% chez les filles. Les
lieux de commission de ces abus sexuels sont divers : l'acte se passe chez la
victime (26%) ; chez l'agresseur (14,70%) ; en milieu scolaire (10,29%) ; dans
des lieux non précisés (35,3%).Relativement aux agresseurs, les
hommes apparaissent en tête avec74,26%1085 contre 13,97% de femmes
(agresseurs).Ces agresseurs proviennent tantôt de l'extérieur
de
1081 Article 4 Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples. 1082 Article 21 Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant. 1083 Article 27 Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant. 1084 Voir Le Jour n°2297 du jeudi 12 décembre
2002, p.8.
1085 Voir Le Jour n°2297 du jeudi 12
décembre 2002, p.8.
la famille (61,77%), tantôt de l'intérieur de la
famille (27,20%). L'âge des enfants les plus touchés se situe
entre 10 et 14 ans1086.
Plus récemment, une étude effectuée entre
2016 et 2017, intitulée « analyse situationnelle de l'exploitation
sexuelles des enfants à des fins commerciales en Côte d'Ivoire
»1087 a été publiée par l'ONG SOS
Violences sexuelles. Cette étude portant sur les villes d'Abidjan, de
Man, de Bassam et Korhogo concernait 251 jeunes filles et
garçons1088. Il ressort de cette étude que la
prostitution est la principale cause des ESEC. Mieux, 62% des victimes
interrogées ont été exploitées dans la prostitution
par le biais d'un intermédiaire quand l'exploitation sexuelle des
enfants dans le voyage et le tourisme (ESEVT) concerne 16% des enfants
enquêtés1089. L'étude indique,
également, une vulnérabilité particulièrement
élevée à l'ESEC chez les mineurs autour de l'âge de
16 ans. 47,93% des filles victimes sont analphabètes, contre 9,23% des
garçons parmi la population
enquêtée1090.
Les enfants interrogés dans le cadre de cette
étude, affirment, avoir recours à l'ESEC pour subvenir à
leurs propres besoins (primaires ou secondaires) ainsi qu'à ceux de leur
famille avec une forte proportion d'enfants victimes de nationalité
ivoirienne (79,2%)1091.
L'étude témoigne d'une pluralité de
contextes familiaux parmi les 251 enfants interrogés. En effet, 13,5%
d'entre eux affirment vivre avec leurs deux parents biologiques, 13,6% chez
1086 Voir Le Jour n°2297 du jeudi 12
décembre 2002, p.8.
1087 SOS violences sexuelles, Analyse situationnelle de
l'exploitation sexuelles des enfants à des fins commerciales en
Côte d'Ivoire, 2016, 82p ; ECPAT France, KOIDIO KROUWA (A.L.) et
MESNER (D. C.), Analyse situationnelle de l'exploitation sexuelles des
enfants à des fins commerciales en Côte d'Ivoire, 2016,
82p.
1088
https://www.ffnews.info/2017/06/22/cote-divoire-sos-violences-sexuelles-publie-son-etude-sur-
lexploitation-sexuelle-des-mineurs/
(Consulté le 16/12 //2017).
1089
https://www.ffnews.info/2017/06/22/cote-divoire-sos-violences-sexuelles-publie-son-etude-sur-
lexploitation-sexuelle-des-mineurs/
;
http://geopolis.francetvinfo.fr/abus-sexuels-des-fillettes-enceintes-par-milliers-dans-les-ecoles-ivoiriennes-141883(Consulté
le 16/12 //2017).
1090
https://www.ffnews.info/2017/06/22/cote-divoire-sos-violences-sexuelles-publie-son-etude-sur-
lexploitation-sexuelle-des-mineurs/
(Consulté le 16/12 //2017).
1091
https://www.ffnews.info/2017/06/22/cote-divoire-sos-violences-sexuelles-publie-son-etude-sur-
lexploitation-sexuelle-des-mineurs/ (Consulté le
16/12 //2017).
407
un des deux parents, 32,8% chez d'autres membres de leur
famille, 22% avec des personnes sans lien de parenté et 9,7% disent
vivre seuls1092.
La prostitution gagne de plus en plus les jeunes filles dont
l'âge se situe entre 12 et 15 ans. Elle se développe
principalement en milieu urbain, notamment dans les grandes
agglomérations à foyer industriel, portuaire et
économique. La prostitution enfantine est soit régulière
ou occasionnelle, informelle. Une nouvelle forme du commerce sexuel impliquant
les enfants est la migration des filles prostituées de ville en ville
(vers Abidjan, San Pedro, Bouaké) des villages vers les villes selon les
flux monétaires liées aux activités saisonnières.
Dans les quartiers périphériques et les bidonvilles de San Pedro,
les jeunes filles se livrent à la prostitution dans la zone portuaire.
Les enfants victimes d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle sont
vulnérables aux MST. La santé physique des enfants victimes est
préoccupante. Ils sont pour la plupart sous-alimentés, et
beaucoup de filles prostituées souffrent de maladies
vénériennes. Le SIDA revêt une importance
particulière pour les enfants victimes d'abus sexuels, de viols et les
enfants prostitués. Les complications gynécologiques et une
santé fragile sont d'autres problèmes auxquels sont
confrontés les enfants victimes.
En un mot, quelle que soit sa forme, le travail des enfants
entre directement en conflit avec deux des dispositions fondamentales de la
CIDE, que sont l'interdiction de la discrimination1093 et
l'intérêt supérieur de l'enfant1094. En
entretenant la spirale de la pauvreté et de l'exclusion, le travail des
enfants est une conséquence des inégalités d'aujourd'hui
et une cause des inégalités de demain. Le travail des enfants
procède d'un choix, qui sacrifie l'intérêt de l'enfant
à celui des parents et/ou des employeurs. Le travail forcé,
défini par l'article 2 alinéa 1 de la convention n° 29 de
l'OIT comme tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace
d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de
plein gré, prive l'homme de sa liberté. Il se distingue des
autres formes du travail des enfants par une certaine restriction des
mouvements de l'enfant, une violence mentale ou physique, l'absence de
consentement et ou/ une forme de contrôle au-delà de la
normale1095. Le travail forcé en tant que régime de
servitude affecte gravement le
1092
https://www.ffnews.info/2017/06/22/cote-divoire-sos-violences-sexuelles-publie-son-etude-sur-
lexploitation-sexuelle-des-mineurs/ (Consulté le
16/12 //2017).
1093 Article 2 CIDE.
1094 Article 3 CIDE.
1095 Article 2 alinéa 1 de la Convention n° 29 de
l'OIT sur le travail forcé de 1930.
408
corps physique du travailleur ; pire, il viole les droits
fondamentaux de l'enfant, notamment, le droit à la dignité,
à la liberté, le droit d'aller et de venir, la liberté
contractuelle. Le travail forcé concerne environ 5,7 millions d'enfants
dans le monde. Il a été estimé qu'entre 10000 et 15000
enfants du Mali travaillent dans les plantations de la
Côte-d'Ivoire1096. C'est l'intérêt
supérieur de ces enfants qui est ainsi sacrifié à l'autel
d'un travail indigne et inhumain qui ne va pas sans conséquence sur la
réalisation de nombre de droits fondamentaux de l'enfant.
Le travail de l'enfant, à l'instar de toute forme
d'exploitation économique des enfants, les place dans une situation
d'activité imposée ou non et dont une tierce personne tire une
satisfaction ou un profit matériel, économique, moral ou
financier. Elle a pour effet de « compromettre à plus ou moins
brève échéance le développement physique, mental,
moral, spirituel et social de l'enfant». Elle suppose aussi
«trop d'heures consacrées au travail, des atteintes à la
dignité et au respect de soi des enfants»1097. Ce
faisant comme l'a démontré Mme BELLO Sakinatou dans sa
thèse, le travail des enfants porte atteinte à leurs droits
civils1098 et à leurs droits économiques et
sociaux1099.
Tout comme l'intérêt de l'enfant serait un
indicateur de protection de l'enfance contre le travail, l'interdiction du
travail des enfants serait également considérée comme le
ferment de la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Toutes ces
formes d'exploitation constituent des terres fertiles pour la violation des
droits les plus élémentaires de l'enfant. L'âge des
enfants, leur vulnérabilité et les conditions hideuses dans
lesquelles ces activités se mènent ne contribuent aucunement
à la sauvegarde de leur intérêt. Il convient alors de les
supprimer non seulement légalement mais aussi en pratique par la mise en
oeuvre de mesures
1096 UNICEF, Rapport de l'Atelier sous régional sur
le trafic des enfants domestiques, en particulier des filles domestiques, dans
la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Abidjan, 1999,
cité par BIT, Halte au travail forcé, rapport global en vertu
du suivi de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail, Genève, 2001, p.22.
1097 UNICEF, op.cit., p.26.
1098 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, Dissertation, zur Erlangung des
Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Bayr, 2013, 425p. ;
1099 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, Dissertation, zur Erlangung des
Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Bayr, 2013, 425p.
409
vigoureuses et de lever toute ambiguïté sur la
question du travail des enfants aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs
dans le monde.
A l'instar du travail des enfants, la traite des enfants est
également un déni de la nature d'être humain de
l'enfant.
§ 3. LA TRAITE DES ENFANTS, UN DENI DE LA NATURE
D'ETRE HUMAIN DE L'ENFANT
Après avoir précisé le sens de la notion de
traite des enfants (A), nous exposerons les différentes formes de traite
(B) .
A. DEFINITION DE LA NOTION DE TRAITE DES ENFANTS
«La traite des enfants» est la nouvelle
formule consacrée pour désigner ce qu'on appelait dans un
passé récent, «le trafic des
enfants»1100 . Ce changement de
terminologie de l'appellation du phénomène dans la pratique des
organisations internationales de protection des droits de l'enfant, n'est sans
doute pas fortuit1101. En effet, le mot «trafic»
fait référence au « commerce », et il est
défini comme un « Commerce immoral ou illicite, fait de
monnayer des choses non vénales »1102 ; Ce qui implique une
vente. Donc parler de «trafic d'enfants» reviendrait
à parler de «commerce des enfants»,
c'est-à-dire de la vente des enfants. Quant au mot
«traite», son étymologie nous renvoie aux mots latins
«trahere, tractus» qui veulent dire
«tirer», «trainer»1103, et
seraient composés de «abstrahere» qui veut dire
« traîner loin de » ou « séparer
» et de «abstractio» qui veut dire
«enlèvement »1104.
Dès le XVIIe siècle, on peut noter que la traite signifiait
« action de
1100 En effet, c'est ce qui ressort de la pratique des
organisations internationales, des Nations-Unies de protection des enfants
Comme le Fond des Nations Unies pour l'enfance, et l'Organisation
Internationale du Travail.
1101 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, 425p.
1102
http://www.cnrtl.fr/etymologie/trafic
(consulté le 12/11/2017).
1103 ROBERT (P.), Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, Le Robert, Paris, 1972, p.618. ;
http://www.cnrtl.fr/etymologie/traite
(consulté le 12/11/2017).
1104 Ibid.
410
retirer de l'argent » et faisait
référence à la «traite des nègres
» et à partir du XXème siècle, elle faisait
référence à la «traite des
blanches»1105. Ainsi, la notion
«de traite des enfants » signifierait une « action
de tirer de l'argent des enfants » soit par leur travail, soit par
leur exploitation de quelque manière que ce soit1106.
Il ressort de ce qui précède que l'appellation
«la traite des enfants» convient mieux pour désigner
la pratique visée par les normes internationales de protection des
enfants.
Selon le Dictionnaire des Droits de l'Homme, la traite
trouverait « son origine dans un arrangement international du 18 mai
1904 qui réprimait la «la traite des blanches» puis, en 1921,
le champ d'action est élargi aux femmes, sans autre précision, et
aux enfants. Comme les droits de l'homme, le second conflit mondial fait
apparaître des formes nouvelles de traite, notamment en matière de
travail obligatoire ;...»1107. On note
donc que le phénomène n'est pas récent, même si sa
conception a évolué dans le temps.
Aux termes de l'article 3- a) du Protocole de Palerme, la
« »traite des personnes» désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la
menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes
de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité
ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou
l'acceptation de paiements ou d'avantage pour obtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.
L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui
ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services
forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la
servitude ou le prélèvement d'organes » . Trop vague et
trop générale, cette disposition de l'article 3 alinéas
a), ne permet pas d'avoir une idée précise de la notion de
traite. A la limite, nous avons l'impression qu'elle énumère un
certain nombre de critères pouvant entrer dans la définition de
la «traite des personnes». Cependant, il précise
à l'alinéa b), que « le consentement d'une victime de la
traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle
qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article,
est indifférent lorsque l'un
1105 ROBERT (P.), Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, Le Robert, Paris, 1972,
p.618.
1106 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, 425p.
1107 ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres, Dictionnaire des
Droits de l'Homme, Paris, PUF, 2008, 864 p., p.741.
411
quelconque des moyens énoncés à
l'alinéa a) a été utilisé ». A
l'alinéa c) le protocole précise que « Le recrutement,
le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux
fins d'exploitation sont considérés comme une «traite des
personnes» même s'ils ne font appel à aucun des moyens
énoncés à l'alinéa a) du présent article.
»
Toute analyse faite de ces dispositions, il ressort de la
notion de traite retenue par le Protocole de Palerme, trois
éléments essentiels. D'abord, la traite des personnes implique le
déplacement d'une personne ; par une autre personne ; et elle doit
impliquer l'exploitation de la personne déplacée. En ce qui
concerne le premier élément : «le déplacement
d'une personne», elle implique que la personne victime soit
déplacée d'un point de départ vers un autre point de
destination. Le deuxième élément quant à lui,
implique l'intervention d'une tierce personne dans le déplacement ; ce
qui implique un intermédiaire (le trafiquant) qui ferait usage de
tromperie, de la force, de la fraude, d'enlèvement, d'abus
d'autorité etc. sous réserve des dispositions de l'alinéa
c) ; et enfin, le troisième élément implique
«l'exploitation de la personne déplacée» (la
victime de la traite). Cette dernière condition implique l'exploitation
sexuelle de la personne déplacée, le travail ou service
forcé, la servitude de la personne exploitée et le
prélèvement d'organes sur son corps, sous réserve de
l'alinéa `b'.
Ainsi donc, aux termes du Protocole de Palerme, la traite des
personnes désignerait, le déplacement contraint ou non d'une
personne par une autre en vue de son exploitation forcée ou non. Or
l'alinéa d) de l'article 3 du Protocole stipule que
«l'enfant« « désigne toute personne âgée
de moins de 18 ans. » Par conséquent, la traite des enfants
désignerait le déplacement de toute personne âgée de
moins de 18 ans par une autre personne sous la contrainte ou non en vue de son
exploitation forcée ou non. Relevons cependant que la Convention des
Nations Unies relatives aux droits de l'enfant et la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant n'ont pas défini la notion de
la traite des enfants. Mais elles l'ont
412
abordée aux articles 351108, pour la
Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, et 291109 pour
la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
Les circonstances de la traite des enfants sont les suivantes
: Il s'agit de personnes de moins de 18 ans ; d'un processus de recrutement
contraint et forcé ; d'un transport entre ou hors les frontières
nationales ; La situation finale, dans laquelle se retrouve la victime
après la traite, est celle du sans droit se trouvant dans l'obligation
d'exécuter des travaux inhumains ou dangereux.
Dans ce système, l'enfant apparaît comme une
marchandise ou un objet d'échanges1110. Le but de la traite
dépend de l'âge et du sexe de l'enfant : les garçons sont
généralement destinés pour le travail forcé dans de
grandes plantations ou le trafic de drogue tandis que les filles sont
plutôt destinées à l'exploitation sexuelle ou domestique.
Les enfants peuvent aussi être exploités dans des réseaux
de mendicité organisés, envoyés pour des réseaux
d'adoption illégaux ou pour des mariages forcés. Les traites
s'opèrent aussi bien à l'intérieur des pays qu'entre
différents pays ainsi qu'à l'échelle mondiale. Il convient
donc d'étudier ces différentes formes de traite.
B. LES DIFFERENTES FORMES DE TRAITE DES ENFANTS
En Afrique, on observe une nouvelle forme d'esclavage des
enfants que traduit bien Joëlle Billé : « l'esclavage et
la traite de Noirs existent encore en Afrique, mais, cette fois-ci, les
négriers sont les Africains eux-mêmes, et leurs marchandises, des
enfants Africains 1111». Compte tenu de l'attraction
économique qu'elle continue d'exercer sur les pays de la sous-
1108 La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant en son article 35 dispose en effet que : « Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que
ce soit et sous quelque forme que ce soit ».
1109 Quant à l'article 29 de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant il dispose que : « Les
États parties à la présente Charte prennent les mesures
appropriées pour empêcher : a) l'enlèvement, la vente ou le
trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce
soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur
légal [...] »
1110 UNICEF, Le travail international des enfants dans le
Sud du Benin, diagnostic, ampleur et analyse des mécanismes, une
étude préliminaire, Cotonou, 1997, p.20 cité par
Flavien TINPKO, op.cit., p. 19.
1111 BILE (J.), « L'esclavage : le bateau de la honte
», In. L'Autre Afrique, 19 décembre 2001-8
janvier 2002. ; BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique, L'application
des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant en
République du Bénin, L'Harmattan 2015, 465p.
413
région, la Côte d'Ivoire figure parmi les pays
récepteurs d'enfants dans le cadre de traite transfrontalière
(2), mais elle connait également un phénomène de traite
interne (1) d'enfants qu'il convient d'analyser au préalable.
1. Existence d'une traite interne d'enfants
La traite interne est celle qui se pratique à
l'intérieur des frontières d'un même État. Autrement
dit, lorsqu'on parle de traite interne, on sous-entend que le point de
départ et la destination finale de la victime de la traite se situent
tous deux sur le territoire du même État1112. Dans ce
cas, les enfants victimes de la traite au plan interne sont souvent
déplacés des villages et campagnes du pays vers les grandes
villes du même pays. Comme l'a souligné le rapport de Human
Rights Watch, les enfants victimes de la traite interne sont souvent
destinés à travailler sur les marchés et comme
domestiques1113.
Selon les connaissances actuelles, cette forme de traite
consisterait en un mouvement d'enfants du Nord-Est de la Côte d'Ivoire,
notamment la région de Bondoukou, et ne concernerait que les filles,
afin de répondre à une demande domestique de main d'oeuvre
infantile à Abidjan. Elle repose sur les réseaux internes de
migration des communautés, et s'appuie à l'origine sur les
réseaux traditionnels d'entraide et de solidarité. L'enfant est
déplacé, en Côte d'Ivoire, par des adultes unis par des
liens familiaux, communautaires ou ethniques. Cette forme de traite concerne
beaucoup les enfants issus de l'ethnie « Koulango » qui sont
déplacés vers Abidjan. Elle vise surtout les petites filles, et
relève d'une véritable activité économique
menée par des femmes originaires de la région de Bondoukou. Mais
les avis sont partagés sur le degré de responsabilité de
la communauté elle-même dans ce trafic.
Le problème de traite des jeunes filles Koulango
qu'on utilise comme filles domestiques à Abidjan existe et
préoccupe l'ensemble de la communauté koulango de
Bondoukou. Ce trafic ne bénéficie pas de la caution des membres
de la communauté koulango de Bondoukou. « Comment
peut-on accepter de faire des sacrifices pour inscrire sa fille
à
1112 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.45.
1113 RAPPORT HUMAN RIGHT WATCH, Aux frontières de
l'esclavage. Traite des enfants au Togo, Mars 2003, Vol.15, N°8 (A),
p.1.
414
l'école et accepter plus tard de la remettre
volontairement à quelqu'un pour qu'on aille l'utiliser comme une machine
et qu'à chaque passage au village, votre fille ne vous rapporte que
trois ou quatre morceaux de pagne de piètre qualité ? »
interroge d'ailleurs un père de famille issu de cette de
communauté Koulango.
En réalité, c'est plus par contrainte
financière que par volonté manifeste de remettre les enfants
à des esclavagistes que certaines familles assistent de façon
impuissante au départ de leurs filles vers Abidjan. Selon ce père
de famille, « La culture du Koulango ne cautionne pas ce type de
trafic. Nous ne sommes pas contents de ce qui se passe mais nous sommes
obligés de les laisser partir puisque nous ne sommes pas certains de
leur réserver un meilleur avenir en les maintenant ici (à
Bondoukou). C'est le niveau de pauvreté dans la région qui oblige
donc certains parents à ne rien faire pour empêcher le
départ de ces enfants ».
Les auteurs de cette forme de traite sont des femmes
originaires de la région de Bondoukou et installés à
Abidjan. « Il y en a même qui ont fait de la traite ou du trafic
de jeunes filles leur plantation de café, c'est à dire leur
principale source de revenus. Dire qu'il existe des personnes d'autres
régions qui s'adonnent à cette pratique est une
contrevérité. Ce sont nos propres filles de la région, nos
propres parents qui prennent ce trafic ou traite de jeunes filles Koulango
comme leurs plantations de cacao ; elles considèrent ce trafic comme
leurs entreprises. Elles s'enrichissent sur le dos de ces pauvres filles et de
leurs familles » soutient un autre chef d'une communauté
Koulango que nous avons interrogé.
Comme on le voit à travers les affirmations
précitées, en général, les enfants victimes de la
traite sont manipulés par des personnes issues de leurs familles ou de
leur région.
A Côté de cela, les filles de plus de 15 ans
décident, en général, de leur propre gré de se
rendre à Abidjan ou dans les autres grandes villes du pays pour chercher
du travail. Toutefois, il n'est pas exclu que ces jeunes filles soient
happées dans des réseaux professionnels de placement. Cependant,
avec le développement de certaines cultures de rente telle la culture de
l'anacardier dans la région de Bondoukou, la migration des filles, et
par conséquent les perspectives de traite, a été peu ou
prou freinée. L'introduction de cette culture de rente a quelque peu
amélioré la situation financière de nombreuses
familles.
415
Au Bénin, le phénomène est aussi courant.
En effet, selon une étude menée par le gouvernement
béninois avec la collaboration de l'Unicef en 20061114,
« environ 40.317 enfants étaient victimes de la traite au
moment de l'enquête. Au plan interne, les filles victimes de la traite
sont surtout utilisées à des fins de travaux domestiques et
d'exploitation sexuelle, tandis que les garçons sont exploités
comme travailleurs dans les plantations, vendeurs ambulants, ouvriers sur les
chantiers de construction et dans le secteur de l'artisanat. »1115
A côté de la pratique de la traite interne des
enfants, d'autres enfants victimes de traite sont amenés hors de leur
territoire national pour être exploités en Côte d'Ivoire.
2. La traite transfrontalière d'enfants vers la
Côte d'Ivoire
A l'instar de quelques grandes routes de trafic
international1116 identifiées dans le passé par l'OIT,
il existe aujourd'hui, une véritable traite transfrontalière des
enfants vers la Côte d'Ivoire. Du fait de sa stabilité politique
d'antan, de sa prospérité économique relative, et de sa
légendaire hospitalité et ce malgré les accusations
injustes de pays xénophobe, la Côte-d'Ivoire est
confrontée, depuis environ deux décennies, au trafic
transfrontalier d'enfants. Des individus peu recommandables de la
sous-région, appâtés par le gain facile, se livrent
à ce commerce humain humiliant, qui rappelle étrangement
l'esclavage. Et, la Côte d'Ivoire est devenue un pays d'accueil pour des
enfants issus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du
Nigéria et du Togo.
En ce qui concerne la traite internationale, nous
distinguerons la traite régionale ou transnationale (sur le même
continent) et la traite inter- continentale ou
transatlantique1117.
1114 UNICEF, Note d'information La traite au Bénin
: des chiffres et des faits. Ce document peut être consulté
sur le site :
www.unicef.org/wcaro/WCARO_Benin_Factsheet_Fr_TraiteDesEnfants.pdf(
consulté le 10 décembre 2014). ; BELLO (S.), La traite des
enfants en Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux
droits de l'enfant en République du Bénin, L'Harmattan 2015,
p.45.
1115 US EMBASSY, Rapport 2009 sur la traite des
personnes, peut être consulté sur le site :
http://cotonou.usembassy.gov/utils/
(consulté le 10 décembre 2014).
1116 OIT, Le mal insupportable au coeur des hommes : le
trafic des enfants et les mesures d'éradication, Genève,
BIT, 2003.
1117 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.45.
416
Dans le premier cas, les enfants victimes sont recrutés
dans un État et sont conduits dans un autre État destinataire ;
les deux États sont du même continent. Dans ce processus, les
enfants peuvent traverser un ou plusieurs État(s) de transit avant la
destination finale1118.
La Côte d'Ivoire est surtout connue, dans ce domaine,
comme un pays récepteur1119. Cinq
réseaux ont, jusqu'à présent été
identifiés :
- Le réseau togolais qui achemine essentiellement des
garçons dans le secteur informel abidjanais1120, plus
particulièrement les menuiseries de Yopougon ;
- Les réseaux ghanéen et béninois qui
acheminent essentiellement des filles vers Abidjan, pour le travail
domestique1121 ;
- Les réseaux maliens et burkinabés qui
acheminent les garçons, en majorité des adolescents, vers les
plantations. Les villes de Korhogo et de Bouaké constituent les
carrefours de cette traite, les enfants sont ensuite dispersés vers les
plantations de coton, mais et de riz dans la région de la
Marahoué (notamment dans les environs des villes de Bouaflé,
Zuénoula, Gohitafla), mais également vers les plantations de
café et de cacao et ce dans les régions forestières du
pays1122.
La traite d'enfant est une réalité vivante sur
le territoire ivoirien. A preuve, en avril 2000, 158 enfants maliens ont
été « victimes d'un trafic de main d'oeuvre à bas
prix1123 » en Côte-d'Ivoire. Exploités par des planteurs
burkinabés et maliens, ils faisaient de pénibles travaux
agricoles. Découverts par les autorités ivoiriennes, ils ont
été rapatriés aussitôt au Mali. De même, le 26
février 2002, neuf (9) enfants (8 filles et 1 garçon), dont
l'âge variait entre 13 et 17 ans, ont été
interceptés à Niellé (au nord de la Côte-D'ivoire),
puis « rapatriés sur leur
1118 Cf. Le Rapport de Human Rights Watch, op. cit.
1119 Bureau International du Travail (BIT-OIT) / Programme
International pour l'Abolition du Travail des Enfants (IPEC), 2004 -
Itinéraires transfrontaliers de la traite des enfants en Afrique de
l'Ouest et du Centre. In : Projet LUTRENA, Genève,
mars, 2004, 17 p. ;
http://geopolis.francetvinfo.fr/trafic-d-enfants-en-cote-d-ivoire-dans-l-enfer-des-plantations-de-cacao-150983
(consulté le 10/10/2015).
1120
http://www.rfi.fr/emission/20140824-togo-sokode-lutte-trafic-enfants
(consulté le 10/11/2015).
1121 ANTI SLAVERY, Rapport de recherche sur le trafic des
enfants entre le Gabon et le Bénin, Avril 2000, pp.8-9.
1122
http://geopolis.francetvinfo.fr/trafic-d-enfants-en-cote-d-ivoire-dans-l-enfer-des-plantations-de-cacao-150983(consulté
le 10/10/2015). ; TANO (M. A..), « Crise cacaoyère et
stratégies des producteurs de la sous-préfecture de Méadji
au sud-ouest ivoirien », In. Économies et finances,
Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2012 ; BASIC, La face
cachée du chocolat, mai 2016, p.47.
1123 Voir l'Inter n°607 du mercredi 3 mai 2000,
p.8.
417
terre natale 1124». Le
trafiquant de ces enfants, Yacouba TOGOLA, ressortissant malien qui faisait
fortune en vendant ses petits compatriotes, et cela, sous le couvert de
convoyeur dans des cars de transport CTB assurant la ligne sous
régionale Sikasso-Bouaké. Par cette pratique
scélérate, il faisait entrer, depuis 1997, ses victimes sur le
territoire ivoirien contre des sommes de quinze mille (15000) à vingt
mille (20000) F CFA remis à leurs parents ; puis il les `revendaient',
à cinquante mille (50000) F CFA chacun, à des Maliens ou
Burkinabé, exploitants agricoles de café et de cacao en
Côte-d'Ivoire1125.
Dans sa politique de lutte contre ce phénomène
pernicieux, l'Etat de Côte-d'Ivoire a arrêté près
d'une centaine de trafiquants en 2001, qui ont été
condamnés à des peines lourdes (entre 5 et 10 ans de
prison)1126. Au cours de la même année, cinq cent
cinquante (550)1127 enfants victimes de trafic, ont
été interceptés par les forces de l'ordre, et
rapatriés dans leur pays d'origine, pays pourvoyeur.
Selon une étude du Bureau International du Travail
(BIT), la majorité des enfants victimes de la traite transnationale sont
convoyés du Bénin vers le Nigeria et le Gabon, bien que certains
soient également envoyés au Cameroun, au Togo, en Côte
d'Ivoire, au Ghana, au Congo, en République Centrafricaine, et
probablement en Guinée Bissau. Un petit nombre d'enfants victimes de
traite vivant au Bénin proviennent d'autres pays, surtout du Togo, du
Niger et du Burkina Faso1128.
Dans le second le cas, les enfants victimes de la traite sont
convoyés d'un continent vers un autre1129. On se souvient
ainsi des scandales de l'Etireno, ce « bâteau de la honte
» avec comme cargaison des enfants1130, de la mort
tragique de la petite Victoria Climbé de nationalité
ivoirienne, « bonne à tout faire », en février
2000, à peine âgée de huit ans. En général,
« chaque année, quelque deux cents mille enfants des
régions les plus pauvres
1124 Voir Soir Info n°2240, du lundi 11
février 2002, p.12.
1125 KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Thèse unique de doctorat en droit
public, Université de Cocody, UFR SJAP, 2008, Tome 2,
p.138.
1126 Voir Rapport sur la situation générale du
trafic des enfants, janvier 2001, op. cit.
1127 Idem.
1128 US EMBASSY, Rapport 2009 sur la traite des
personnes.
1129 UNESCO, La traite des personnes au Togo: facteurs et
recommandations, Document stratégique Série pauvreté
n° 14.4 (F) Paris 2007, p.22.
1130 OLENKE (F.), « Trafic d'enfants africains, Etireno,
le bateau de l'esclavage », In. Courrier International,
n°580, 13-19 décembre 2001, p.66.
418
d'Afrique sont vendus comme esclaves1131 » ;
« Au niveau transatlantique, il est établi que les pays du
golfe arabo-persique (Liban, Arabie Saoudite) et les pays d'Europe (Italie,
France, Allemagne, Belgique) accueillent des victimes de traite en provenance
du Bénin. Ces régions attirent les personnes à la
recherche de meilleures opportunités.»1132.
Cependant, l'on assiste quelques fois à des mouvements
de migration simple ou illégale impliquant les mineurs et il est
important de distinguer ces migrations de la traite pour éviter tout
amalgame. Si la migration peut être considérée comme le
déplacement de population d'un pays à un autre, pour s'y
établir1133, il faut noter qu'elle peut être interne ou
internationale. Tout comme la traite, la migration interne se déroule
à l'intérieur d'un même État et celle internationale
va au-delà des frontières étatiques (régionale et
transatlantique). Elle peut être légale ou illégale. Dans
le premier cas, la migration s'effectue dans le respect des normes en vigueur
du pays de départ et du pays de destination. Par contre, la migration
illégale se fait en toute clandestinité au mépris des lois
réglementant les migrations. Les clandestins prennent fréquemment
des risques importants pouvant mettre leur propre vie en péril afin de
rejoindre des pays présentant des conditions de vie qu'ils
espèrent meilleures. Ils n'hésitent donc pas à tout
abandonner pour tenter l'aventure souvent par l'intermédiaire des
passeurs peu honnêtes qui leur font payer un prix exorbitant et tout
ceci, dans des conditions très dangereuses qui dans certains cas,
peuvent leur coûter la vie.
Selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
« Le phénomène migratoire compte parmi les grandes
questions mondiales qui jalonneront le XXIème siècle, tant il est
vrai que les personnes en mouvement de par le monde sont aujourd'hui plus
nombreuses qu'elles ne l'ont jamais été. On estime à
environ 192 millions de personnes qui se trouvent aujourd'hui hors de leur pays
de naissance, ce qui représente à peu près 3 % de la
population mondiale. »1134 et il semble qu'aujourd'hui,
près de 200 millions de personnes vivent de manière temporaire ou
permanente hors de leur pays d'origine.1135
1131 OLENKE (F.), « Trafic d'enfants africains, Etireno, le
bateau de l'esclavage », In. Courrier International,
n°580, 13-19 décembre 2001, p.66.
1132 UNESCO et le Programme Intersectoriel Élimination de
la Pauvreté, op.cit. p.23.
1133
http://www.cnrtl.fr/etymologie/migration
(consulté le 13/12/2016).
1134 V. A propos de migrations, sur le site:
www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/lang/fr (consulté le
13/12/2016).
1135 Voir
www.encyclopedie-dd.org/Migrations-Pour-un-Pacte-mondial
(consulté le 13/12/2016).
419
De tout ce qui précède, il ressort qu'en ce qui
concerne les migrations légales, elle se fait par un libre choix des
personnes et très souvent, l'on ne l'associe pas à la traite. Par
contre, la migration clandestine ou illégale impliquant les enfants,
même si en apparence, elle se fait librement, peut déboucher sur
la traite des enfants. En effet, il arrive que les candidats à
l'immigration illégale ou clandestine soient pris au piège par
leurs intermédiaires qui les exploitent. C'est dire que les migrations
et la traite ont des points communs en ce qui concerne la mobilité des
personnes et que les migrations clandestines peuvent être source de
traite.
Cependant, que ce soit la traite ou la migration
illégale, les personnes victimes sont souvent à la recherche d'un
avenir meilleur, soit de leur propre volonté ou de la part de leurs
géniteurs.
Outre les risques liés à leur exploitation
économique, les enfants victimes de traite, sont confrontés aux
dangers et conséquences néfastes suivantes :
- Perte de l'identité et des origines familiales, en
particulier lorsqu'il y a franchissement de frontière et/ou que l'enfant
est jeune ;
- Clandestinité et mise en servitude ;
- Aggravation des mauvais traitements liés à
l'isolement relationnel induit par le déplacement.
A côté de ces formes d'atteintes d'ordre
général, dont tout enfant peut être victime, se trouvent
des formes d'atteintes aux droits de l'enfant qui prennent un accent de
gravité en certaines circonstances particulières, notamment de
guerre ou d'urgence.
420
Chapitre II :
DES ATTEINTES D'UNE GRAVITE PARTICULIERE EN SITUATION
DE
GUERRE OU D'URGENCE
Déjà difficiles à réaliser en
temps normal, l'état des droits de l'enfant s'aggrave non seulement pour
les enfants en conflit avec la loi mais aussi ces droits ont vécu un
véritable enfer durant le conflit armé ivoirien.
A l'origine, les prisons n'étaient conçues que
pour y enfermer des individus dans l'attente de châtiments aussi divers
et effrayants que l'écartement, la potence, la décapitation, les
galères ou le bannissement, le poing ou la langue coupée, la
marque au fer rouge, l'aveu public du crime, le pilori ou le
carcan1136.Aujourd'hui, même si la prison reste le lieu
où la société enferme les individus qu'elle
considère comme dangereux, il reste que la conception de la
détention a évolué1137. Dans l'esprit des
législations pénales modernes, elle n'est plus conçue
comme la maison des supplices effroyables tels qu'ils sont décrits de
façon poignante dans le célèbre ouvrage «
Surveiller et punir » de Michel FOUCAULT1138. Sous
l'influence de l'idée fondamentale de respect des droits de l'homme, la
prison essaie de s'humaniser1139. On retrouve dans les instruments
relatifs aux droits de l'homme, les fondements essentiels de l'humanisation de
la privation des libertés connue sous le nom « d'emprisonnement
».
1136 FAVARD (J.), Les prisons, Dominos/Flammarion, 1994,
p.10.
1137 FAUGERON (C.), « Réformer la prison »,
In. Les cahiers de la sécurité intérieure,
n°3, Paris, 1998, p.5 et s. FAVARD (J.), Les prisons, op. cit.,
p.64 et s.
1138 FOUCAULT (M.), Surveiller et punir, Ed. Gallimard,
1975, p.41 et s.
1139 Concernant l'humanisation de la privatisation de
liberté, voir Bernard BOULOC « Pénologie. Exécution
des sanctions adultes et mineurs », op.cit.., n°217.
421
Comment ne pas admettre que les rédacteurs des deux
déclarations sur les droits de l'homme (1789 et 1948) ont
été inspirés par la philosophie humaniste de la
répression pénale dont les bases ont été
jetées par le fameux Traité des délits et des peines
(1764) de C. BECCARIA, lorsqu'elles affirment que « nul ne doit
être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels ou dégradants »1140, ou encore « la
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires (...) »1141 ? Quoi qu'il en soit, il
est une vérité irréfutable : les droits de l'homme ont
fait une remarquable incursion dans le champ pénal au point qu'ils
influencent l'exécution des sentences et le fonctionnement des prisons.
Conscient du fait que la privation de liberté peut concerner aussi bien
les personnes adultes (hommes et femmes) que les enfants (mineurs), le Pacte
s'est également intéressé au traitement
pénitentiaire des mineurs. Aussi, pour éviter tout processus de
contamination, il est indiqué que le régime pénitentiaire
auquel sont soumis les condamnés à l'emprisonnement doit tenir
compte de la nécessité de séparer les adultes des
mineurs1142, de prévoir un régime
particulièrement adapté aux jeunes délinquants à
leur âge et à leur statut légal1143, et dont le
but est de favoriser leur amendement et leur reclassement
social1144. Les instruments internationaux relatifs à
l'enfant contiennent également quantité de dispositions se
rapportant aux modalités de détention des mineurs dans les
législations qui connaissent la privation de liberté en
matière de minorité. Plus proche du droit des mineurs, la
Convention internationale des droits de l'enfant énonce que : «
Les Etats s'engagent à ce que tout enfant privé de
liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. (...)
»1145. Qu'en est-il au plan national ivoirien ? Ces principes
coïncident-ils avec la situation des mineurs incarcérés en
Côte d'Ivoire ? Pour y répondre, on examinera la violation des
droits du mineur en conflit avec la loi (Section 1).
Aux termes de l'article 38 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, « les Etats parties s'engagent à respecter
et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont
la protection s'étend
1140 Art.5, Déclaration universelle des droits de l'Homme
adoptée le 10 décembre 1948.
1141 Art.7, Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789.
1142 Art.10-3, Pacte international relatif aux droits civils et
politiques adopté le 16 décembre 1966.
1143 Ibid.
1144 Ibid.
1145 Art.37, Convention internationale relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989.
422
aux enfants (...) »1146 . Cet article
renvoie aux règles du droit international humanitaire protégeant
les enfants dans les conflits armés1147. Il y a
malheureusement peu de pays où beaucoup d'enfants peuvent
s'épanouir dans un climat de paix : nombreux sont les enfants
conditionnés par une culture de guerre1148. Cette
militarisation des enfants, qui envahit de plus en plus nos
sociétés, préoccupe de plus en plus les Etats et les OI
car malgré les dispositions du droit international humanitaire, qui
accorde une protection particulière aux enfants, ces derniers sont les
victimes directes ou indirectes des conflits armés. Durant la crise
ivoirienne, les droits de l'enfant ont fait l'objet de diverses atteintes par
les différents belligérants. Cela a été
confirmé par le Secrétaire Général de l'Onu en ces
termes : « En Côte d'Ivoire, les enfants sont exposés
à un certain nombre de violations graves, notamment meurtres ou
mutilations, recrutement et utilisation d'enfants soldats, viols et autres
sévices sexuels (en particulier s'agissant des filles),
enlèvements et attaques dirigées contre des écoles et des
hôpitaux»1149. Pour être
pluriformes suivant les régions où elles ont été
perpétrées, ces violations se sont traduites par des atteintes
graves aux droits de l'enfant pendant le conflit armé ivoirien
(Section 2).
1146 Art. 38 § 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant, 1989.
1147 Voir KRILL (F.), « Convention des nations unies
relative aux droits de l'enfant. Article 38 sur les enfants
dans le conflits armés contesté »,
Diffusion, n° 12, août 1989, pp. 11-12.
1148 DAVID (E.), Principes de droit des conflits
armés, 3e éd., Bruylant, 2002, 994 p.
1149Rapport du Secrétaire
général de l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en
Côte d'Ivoire", Doc.
ONUS/2006/835, p.4
423
SECTION I. LA VIOLATION DES DROITS DU MINEUR EN
CONFLIT AVEC LA LOI
Durant l'exercice des missions de police nationale de l'Etat,
les enfants en conflit avec la loi bénéficient d'une protection
insuffisante (Paragraphe 1) ; cette situation de déni
des droits devient alarmante pour les enfants détenus ou
incarcérés (Paragraphe 2).
§ 1. UNE PROTECTION INSUFFISANTE DU MINEUR LORS
DE L'EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE NATIONALE DE L'ETAT
La Côte d'Ivoire comme tous les Etats modernes reconnait
deux types de missions dans l'activité administrative de l'Etat : une
mission de police administrative, essentiellement préventive, et d'autre
part, une mission de service public à caractère industriel et
commercial. C'est dans l'exercice de ses missions de service administrative que
la police dans les différents contrôles qu'elle opère dans
la rue en vue d'assurer le maintien de l'ordre public est amené à
opérer des contrôles d'identité. Ce contrôle reste
problématique pour la garantie de la liberté d'aller et venir des
citoyens du fait d'un exercice parfois arbitraire de ses pouvoirs, notamment
par un contrôle au faciès. En France comme ailleurs, mais plus
particulièrement en Côte d'Ivoire, objet de l'étude, les
personnes errantes, comme les enfants de la rue sont particulièrement
menacés. Les contrôles dont ils font l'objet en dehors des
situations de risque, entrainent souvent des retentions administratives (A) ou
rétentions judiciaires (B) illégales.
A. DANS LE CADRE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
L'opération de contrôle et vérification
d'identité peut être définie comme l'acte d'un agent de
l'autorité publique consistant à demander à un
particulier, sous les conditions posées par la loi, de justifier son
identité aux fins de l'examen du justificatif fourni, en tout lieu
où cet agent se trouve légalement1150. En
l'état actuel du droit français, les agents de l'autorité,
qu'ils agissent dans le cadre de leurs activités de police
administrative1151 ou
1150 BUISSON (J.), « Contrôles et
vérifications d'identité », In. J-CI, proc. Pén.
;, 1998, Fasc. 10, art. 78-1 à 78-5.
1151 PICARD (E.), La notion de police administrative,
LGDJ, 1984, 445p.
424
judiciaire1152, disposent de pouvoirs contraignants
que l'on peut résumer sous deux aspects. Tout d'abord, ils ont la
possibilité, lorsque certaines conditions sont réunies, d'inviter
une personne déterminée à justifier, par tout moyen, de
son identité. Ensuite, à défaut de justification, ils ont
la faculté de la retenir sur place ou dans les locaux de la police pour
un maximum de quatre heures1153. Ces deux opérations qui se
déroulent dans l'ordre chronologique, sont pour la première le
contrôle d'identité et pour la seconde, la vérification
d'identité1154.
Il existe également en droit ivoirien deux types de
contrôles d'identité de nature judicaire et administrative. Et, la
question de la distinction entre police judicaire et police administrative sur
laquelle la jurisprudence française s'est souvent prononcée, se
pose également en droit ivoirien. Nous n'entrerons pas dans le
détail des observations faites sur les critères de distinction
entre les deux types de police1155. Toutefois, contrairement au
droit français, le législateur ivoirien n'attribue pas de
compétences de police administrative aux officiers de police judicaire
bien que parfois, « la complexité des opérations de
police et le dédoublement fonctionnel de certaines autorités
1156» rendent difficile la distinction entre les
1152 Il y a police judiciaire si les actes ou les faits
juridiques à qualifier sont en relation avec une infraction
pénale déterminée (CE Sect., 11 mai 1951, Consorts
Baud, Rec.265, S 1952.3.13, concl. J. Devolvé, note Drago, mort
d'un tiers dans la recherche de personnes ayant commis des infractions) ; A
l'inverse, en l'absence de relation avec une telle infraction, les mesures
appartiennent à la police administrative (TC, 7 juin 1951, Dame
Noualek, Rec.636, concl. J. Devolvé, S 1952.3.13., note Drago,
blessures occasionnées par une arme à feu à un tiers lors
d'une opération de maintien de l'ordre ; TC, 26 mars 1990,
Devossel, Dr. adm. 1990.331). 1153 LASSALLE (J-Y), « Enquête
préliminaire », In. J-CI, proc. Pén. 1990, art.75
à 78.
1154 Ibid.
1155 Cependant, il n'est pas impossible que les mesures et les
opérations de police changent de nature et donc de qualification en
raison de l'évolution de la situation. Une opération de police
administrative peut ainsi devenir une opération de police judiciaire :
Voir en ce sens Affaire Demoiselle Motsch (TC, 5 décembre
1977, Demoiselle Motsch, Rec.671, AJDA 1978.444, chr.) ; Dans des cas plus
complexes à régler comme l'affaire Le Profil (TC, 12 juin
1978, Soc. Le Profil, Rec.648, concl. Morisot, AJDA 1978.444, chr., D
1979. IR.50, obs. Moderne) , le Tribunal des conflits adopte un principe
unificateur destiné à simplifier la matière ; ainsi dans
une espèce où le Tribunal des conflits reconnait la
compétence de la juridiction administrative au motif que le
préjudice, intervenu au cours d'une opération, qui, de police
administrative ( protection des personnes et des biens), est devenue une
opération de police judiciaire (infraction constituée, inaction
des policiers dans la poursuite), résulte essentiellement des conditions
d'organisation de la police administrative. Il est donc inutile d'exercer deux
actions en réparation en séparant ce qui relèverait de la
police administrative et de la police judiciaire. La nature de
l'opération a changé mais on n'en tient pas compte : la
réparation relève pour l'ensemble de la juridiction
administrative. La solution ainsi adoptée se résume au principe
que la compétence est établie en considération de la
nature de l'opération de police dans laquelle le dommage trouve sa
cause. 1156 En ce sens, V. l'ouvrage du Professeur DEGNY SEGUY (R.),
L'administration et le droit administratif, Ed.N.E.A., Abidjan, 1996,
p.198 et s.
425
deux types de police. Pour le professeur René DEGNI
SEGUI1157, la police administrative relève de la
compétence de l'administration qui s'assigne deux grandes missions : la
mission de prestation qui s'incarne dans le service public et la mission de
prescription. Selon lui, « la mission de prescription se
réalise dans la police administrative qui consiste pour l'administration
à maintenir l'ordre public1158 ». Aussi, il
définit la police administrative comme « une activité
destinée à prévenir un trouble à l'ordre public
exercée exclusivement par l'administration1159». En
droit ivoirien, l'administration détient donc l'exclusivité des
compétences en matière de police administrative «
destinée à prévenir le désordre, à
empêcher que l'ordre public a été déjà
troublé et si celui-ci est troublé, à le rétablir
1160». Il s'ensuit que l'officier de police judicaire ne
peut effectuer des opérations que dans le strict cadre de la police
judiciaire. Il n'intervient que lorsque l'ordre public a été
déjà troublé pour en réprimer les auteurs. Il n'est
autorisé à intervenir que « lorsqu'une infraction
à la loi pénale a été commise, pour la constater,
rassembler les preuves, appréhender les auteurs et les livrer aux
autorités judiciaires 1161». La police judiciaire a
pour objet « la recherche d'une infraction précise »,
non « la surveillance générale1162
». Pour éviter toute confusion entre les compétences de
police administrative et celles de police judicaire, le législateur
ivoirien, par la loi n°63-2 du 11 janvier 19631163, a
supprimé les pouvoirs de police judiciaire auparavant reconnus aux
préfets et aux sous-préfets. Ces derniers étant des
autorités administratives, ils ne peuvent exercer de compétences
en matière pénale.
Du point de vue du maintien de l'ordre public, ces
contrôles ont pour but premier, non la recherche de l'auteur d'une
infraction déjà commise, mais la prévention de
l'infraction. Cependant, ils posent quelques problèmes liés
à l'exercice des libertés individuelles. Raison pour laquelle, en
raison du caractère contraignant des pouvoirs de police, il est utile
que le législateur impose des limites qui tiennent compte à la
fois du respect de la légalité, des
1157 Ibid.
1158 Ibid. p.197. 1159 Ibid. p.198. 1160
Ibid. p.198.
1161 Ibid., p.199.
1162 C.E., 11 mai 1951, Consort Baud S.1952.313. 1163
Art. 30. C.P.P. iv.
426
libertés publiques et du contrôle juridictionnel
1164: « il s'agit de concilier la nécessité de maintenir
l'ordre public avec le respect des libertés de citoyens
»1165.
Qu'il s'agisse de contrôles d'identité à
caractère judiciaire ou de contrôles d'identité
préventifs, ces différentes opérations s'appliquent aussi
bien aux majeurs qu'aux mineurs. Le droit ivoirien ne fait pas de distinction
entre mineurs et majeurs en matière de contrôle d'identité.
Ce qui rend la question de la protection du mineur délicate au regard
des principes directeurs de la justice des mineurs et au regard des instruments
protecteurs des droits de l'enfant. En effet, il est paradoxal que l'on veuille
protéger le mineur contre la rigueur du système pénal tout
en admettant la possibilité de le soumettre à des mesures de
police en dépit du caractère contraignant de celles-ci. L'article
61 du code de procédure pénale ivoirien relatif aux
contrôles d'identité ne fait état d'aucune garantie majeure
quant au respect des droits et libertés reconnus aux mineurs, même
lorsque ces opérations se déroulent dans le cadre d'une
enquête judiciaire. Le mineur est traité dans les mêmes
conditions de rigueur que l'adulte.
Pourtant, la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant énonce très clairement que « Dans toute
action concernant un enfant entreprise par une quelconque autorité,
l'intérêt de l'enfant sera la considération
primordiale1166 », avant d'ajouter que « Tout
enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi
pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le
sens qu'à l'enfant de sa dignité et de sa valeur (...)
»1167. Le régime général des
contrôles d'identités institué par l'article 61
alinéa 2 du code de procédure pénale ivoirien est peu
conciliable avec l'intérêt de l'enfant qui, pour être
efficacement défendu, nécessite que le mineur soit soumis dans
toute procédure à un traitement particulier ou
spécifique1168 comme le recommande la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant. A vrai dire, l'article 61 du code de
procédure pénale ivoirien multiplie les occasions d'atteinte
à la liberté d'aller et venir dans la mesure où les
contrôles et vérifications d'identité sont parfois suivis
d'une rétention des individus contrôlés. Certes, le texte
n'évoque pas
1164 Ibid., p.218.
1165 Ibid.
1166 Art.4 §1 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant.
1167 Art.17§1 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant.
1168 DUPONT-BOUCHAT (M.-S.), PIERRE Eric (Dir.), Enfance et
justice au XIX siècle , Coll. Droit et
Justice, Ed. P.U.F., Paris, 2001, p.12 et s.
427
l'éventualité d'une rétention dans
l'hypothèse d'un contrôle d'identité. Mais, en pratique les
vérifications auxquelles se livre la police ne peuvent avoir lieu sans
recourir à cette mesure. L'élaboration d'un cadre juridique
permettant aux policiers de mener leurs opérations dans la
légalité s'avère donc utile.
Aussi, en raison du manque de moyens et d'un effectif
suffisant pour la mise en oeuvre d'une politique de prévention et
d'assistance, la brigade des mineurs se contente de sa mission
répressive : effectuer des rafles dans certains quartiers
réputés dangereux, déférer les mineurs auteurs
d'infractions dont elle se saisit par le biais des commissariats de police,
l'administration ou par des particuliers. Si l'intervention des services de
police dans le cadre d'une enquête judicaire n'a rien d'illégale
au regard des dispositions du code de procédure pénale, en
revanche les missions de prévention en dehors de toute infraction ne
vont pas sans poser quelques problèmes.
Le concept de « police de proximité
»1169 ou de « l'îlotage
»1170 n'apparaît pas de façon officielle dans
le discours des autorités ivoiriennes chargées de la
sécurité. Cependant, la sécurité comme enjeu pour
le développement n'en reste pas moins une priorité pour l'Etat
ivoirien. Dans les pays africains où la rue est devenue le dernier
refuge pour les adolescents en situation d'exclusion, il est évident que
la présence policière dans les quartiers difficiles semble
être le seul moyen pour prévenir les actes de délinquance
commis sur la voie publique. A Abidjan et dans la majorité des villes
ivoiriennes, il est constant de rencontrer la plupart des enfants
abandonnés à la rue. Il s'agit d'adolescents issus de quartiers
périphériques très pauvres. Regroupés en bandes,
ils exercent toutes sortes de petits métiers : cireurs, vendeurs
à la sauvette, porteurs de bagages etc. mais, sous le couvert de «
petits boulots », certains s'adonnent à des
activités illicites (abus et revente de stupéfiants,
1169 FRANCOPOL, Guide : La police de proximité, un
concept appliqué à la francophonie, collection d'ouvrages
FRANCOPOL, Montréal 2015, 74p. ; sur les principes d'une police
démocratique voir : Centre pour le Contrôle Démocratique
des Forces Armées, Standards internationaux relatifs aux forces de
police-Guide pour une police démocratique, (DCAF)- Genève,
2008, pp.11-31. ; Par cette plus grande proximité, la police cherche
à gagner le respect du public, afin d'obtenir sa coopération pour
faire respecter les lois CHALOM (M.), « La police communautaire de PEEL
à GOLDSTEIN, détours et détournements », ,In. Les
cahiers de la sécurité intérieure, n°37,
3e trimestre 1999, p.216. ; voir aussi MAFART (J.) « La
gendarmerie nationale et la proximité », in. Revue de la
gendarmerie nationale, n°192 et 193, Paris : ADDIM, 1999-3-4,
juillet-décembre 1999, p.37.
1170 MOUHANNA (C.), « Une police de proximité
judiciarisée », In. Déviance et
Société 2/2002 (Vol.26), p.163-182 disponible sur
www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2002-2-page-163.htm.
(Consulté le 15/02/2016).
428
dégradations de biens publics ou privés etc.).
Une étude menée par l'Institut de criminologie de
l'Université d'Abidjan1171 a montré que le «
travail » des enfants de la rue n'a rien de valorisant. Il ne
permet pas à ces jeunes d'échapper à la
précarité. Mais en réalité, il servirait
plutôt de rempart à des activités délictueuses.
Certes, les services de sécurité ont acquis par expérience
que la montée de la délinquance dans les villes est le fait
d'adolescents agissant sans la moindre crainte de l'autorité. Mais, cela
suffit-il à prendre les jeunes des quartiers dits à haut risque
comme la cible privilégiée des opérations de police ? Les
contrôles de police constituent-ils un moyen efficace de lutte contre la
délinquance des enfants ? Vraisemblablement, ils permettent de retrouver
de petits délinquants recherchés. Leur caractère dissuasif
est réel et leur capacité à sécuriser certaines
zones n'est pas négligeable. Mais, à moins d'être
permanentes, ces opérations ne produisent qu'une efficacité
passagère.
La réalité est que les contrôles
effectués lors des rondes policières dont on ignore, a
priori, dans quel cadre elles s'inscrivent, se soldent par des
rétentions de mineurs quand ceux-ci ne disposent pas de documents
administratifs permettant de les identifier. Les adolescents interpellés
sont retenus dans les locaux de la police, le temps selon les policiers,
d'établir leur identité et de prévenir, si besoin en
était, les parents. Mais, en pratique il est difficile de parvenir
à cette fin, car bien souvent, il s'agit de mineurs qui n'ont plus
d'attaches familiales, rejetés, orphelins ou immigrés
clandestins. A l'évidence, les contrôles d'identité suivis
d'une rétention non assortie de garanties, quelle que soit leur nature,
sont incompatibles avec la lettre et l'esprit de la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant qui dispose : « Tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'avoir commis une infraction
à la loi pénale a droit à une assistance juridique,
à la présomption d'innocence, à une procédure
spéciale, à être entendu par une autorité ou une
instance judiciaire compétente »1172. La violation
de cette disposition devient effective dès l'instant où la police
ivoirienne décide de retenir un mineur dans ses locaux sans en
référer à l'autorité judiciaire, tombant ainsi sous
le coup d'une détention illégale. C'est pourquoi, la Côte
d'Ivoire devrait s'inspirer du système français en la
matière. En effet, compte tenu du caractère contraignant des
contrôles et vérifications d'identité pour les
libertés individuelles, le législateur français s'est
résolu à élaborer un cadre juridique réglementant
ces opérations. Le dispositif tente de concilier
1171 SISSOKO (A.), « Abidjan : une situation relativement
bien maîtrisée », op. cit. p.253.
1172 Art.40 de la Convention internationale relative aux droits
des enfants du 20 novembre 1989.
429
l'ordre social et le respect des droits de l'homme et aux
prévisions de l'article 5 de la Convention européenne des droits
de l'homme1173.
En effet, par défiance vis-à-vis des
rétentions policières, la législation française
organise au profit de la personne retenue, une garantie par des prescriptions
immédiatement protectrices des libertés individuelles. Ainsi, les
mineurs tout comme les majeurs incapables de justifier de leur identité
lors d'un contrôle d'identité peuvent être retenus dans les
locaux de la police pour une durée qui ne peut excéder quatre
heures ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle
effectué1174. La loi du 03 septembre 19861175
prévoit que le procureur de la République doit être
informé lorsque la mesure s'applique à un mineur. Par ailleurs,
dans l'hypothèse où l'individu interpellé est un mineur,
l'officier de police judiciaire doit informer son représentant
légal afin que « sauf impossibilité »,
celui-ci puisse l'assister1176. Les parquets sont invités
à donner « toutes instructions utiles pour que soit
évité un recours systématique aux contrôles
d'identité concernant les mineurs1177 ». En
théorie, le système est favorable à la protection du
mineur. Mais l'objectif recherché ici est peu réalisable. En
effet, comment peut-on protéger efficacement un individu quand on ignore
tout de sa personne ? Les garanties offertes aux mineurs ne peuvent fonctionner
réellement que si les policiers parviennent sans difficulté
à les identifier lors des contrôles. La situation se complique
lorsque les individus contrôlés ne peuvent justifier de leur
identité par la présentation d'un document officiel (carte
d'identité, carte d'étudiant, passeport etc.). Dans ces
conditions, il est évident que les garanties précédemment
évoquées interviendront un peu plus tard, c'est-à-dire
quand les policiers auront terminé leur mission de vérification :
vérifier qu'il s'agit d'un mineur, relever les empreintes, effectuer des
prises photographiques, prévenir le procureur de la République,
prévenir les parents etc. Il s'agit d'une opération
1173 L'article 5 de la Convention européenne des droits
de l'Homme reconnaît à toute personne arrêtée le
droit d'être informée, dans le plus bref délai, des raisons
de son arrestation et des accusations portées contre elle (§2),
d'être présentée à un magistrat habilité et
au besoin d'être libérée durant la procédure
(§3). Le principe étant la liberté, le texte prévoit
également que toute personne privée de sa liberté par une
arrestation a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne éventuellement sa libération si cette
détention s'avère illégale.
1174 Art.78-3 al.3, C.P.P. franc.
1175 Art.78-3, Loi n°86-1004 du 03 septembre 1986, J.O.
Rép. Franç., 4 septembre 1986, p.1074. ; modifiée par la
loi n°2006-911 du 24 juillet 2006- art. 114 JORF 25 juillet 2006.
1176 Art.78-3 al.3, C.P.P. franc.
1177 Circ. Minist. just. 15 octobre 1991.
430
délicate qui exige une certaine compétence et
nécessairement un temps pouvant excéder le délai de quatre
heures imposées par l'article 78-3 alinéa 3 du code de
procédure pénale. Bien évidemment, le temps ou la
durée réelle des opérations joue en faveur de la police,
le tout se soldant par des rétentions prolongées assimilables
à des gardes à vues déguisées.
Il est regrettable que le législateur ivoirien de son
côté n'ait pas prévu des dispositions particulières
pour les mineurs concernant les contrôles et vérifications
d'identité. Les mineurs appréhendés au cours des
contrôles de police ne bénéficient d'aucune protection
juridique au mépris des recommandations de la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant. Tout dépend du bon vouloir des
policiers qui décident de leur sort. Ceux qui n'ont pas
d'antécédents judiciaires sont généralement
relâchés. Par contre, ceux bien connus des services de police
comme étant de petits délinquants, seront retenus plus longtemps.
Ces derniers subissent le même traitement que les jeunes
délinquants interpellés à la suite d'un dépôt
de plainte. Les contrôles et vérification d'identité des
mineurs en Côte d'Ivoire, ne sont accompagnés d'aucune garantie
particulière visant à protéger le mineur contre la rigueur
et les abus attachés à ce type d'opération. Cette
situation s'aggrave en matière de garde à vue qui s'assimile en
pratique à une véritable privation illégale de
liberté.
B. DANS LE CADRE DES RETENTIONS JUDICIAIRES
La garde à vue est une mesure restrictive de
liberté, décidée par la police judiciaire ou la
gendarmerie afin de maintenir à leur disposition, dans des locaux
prévus à cet effet, et pour une certaine durée, une
personne dont la rétention est nécessaire au bon
déroulement d'une enquête judiciaire1178. A l'instar
des contrôles et vérifications d'identité, la garde
à vue est une mesure coercitive suivant laquelle, des individus sont
retenus dans les locaux de la police pour une durée variable selon le
type d'infraction et qui, tout en n'étant ni prévenus, ni mis en
examen, doivent cependant rester à la disposition des autorités
de police ou de gendarmerie pour les nécessités de
l'enquête1179. Il s'agit d'une mesure très grave dans
la
1178 LEROY (J.), « Garde à vue », J.-
CI., 1995, art.53 à 73, p.4. ; GIUDICELLI (A.), « La garde
à vue après la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 »,
AJ Pénal, 2004, p.261. ; GUINCHARD (S.) et BUISSON (J.),
Procédure pénale, 3ème éd., Litec, 2005,
n°1965. ; DELAGE (P-J), « La sanction des nullités de la garde
à vue : de la sanction juridictionnelle à la sanction «
parquetière » », Archives de politique criminelle,
vol. 28, n°1, 2006, pp.135-152.
1179 GIUDICELLI (A.), « La garde à vue
après la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 », In. AJ
Pénal 2004, p.261. ; BUISSON (J.), La garde à vue dans la
loi du 15 juin 2000, RSC 2001, p.28-30.
431
432
mesure où elle a parfois pour effet de priver la
personne qui en fait l'objet de sa liberté au-delà du
délai légal.
En dépit de l'atteinte qu'elle porte aux
libertés individuelles, la garde à vue reste l'un des outils de
travail des policiers agissant au nom de la loi ou sous les ordres de
l'autorité judiciaire. Dans la procédure pénale ivoirienne
ainsi que celle de nombre de pays africains francophones, tout comme en droit
français, la garde à vue peut être ordonnée dans
trois cas de figure. En premier lieu, en cas de crime ou de délit
flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les personnes se trouvant sur les
lieux de l'infraction, les personnes susceptibles de fournir des renseignements
ainsi que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices
faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre
l'infraction peuvent être pour les nécessités de
l'enquête, placées en garde à vue pendant vingt-quatre
heures en droit français1180, pendant quarante-huit heures en
droit ivoirien1181. En second lieu, l'officier de police judiciaire
peut, dans le cadre d'une enquête préliminaire et pour les
nécessités de l'enquête, placer en garde à vue, une
personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction1182. Enfin, l'officier de police judiciaire peut placer
une personne en garde à vue pour les nécessités de
l'exécution d'une commission rogatoire du juge
d'instruction1183. Cependant, le législateur ivoirien et son
homologue français n'ont pas accordé les mêmes garanties
aux personnes gardées à vue. Dans le premier cas,
c'est-à-dire en droit français, les droits des personnes
placées en garde à vue ont été renforcés par
une succession de lois1184. En revanche, en droit ivoirien,
très peu de garanties accompagnent le placement en garde à vue.
Quelles sont ces garanties et quelle est la part réservée aux
mineurs faisant l'objet d'une procédure judiciaire ?
En droit ivoirien, l'exemple de la procédure
pénale ivoirienne est à cet effet patent. La garde à vue
peut s'étendre sur une période excessivement longue et atteindre
quarante-huit heures avec des possibilités de reconduite. En mettant
l'accent sur la répression, le système pénal ivoirien a
quelque peu négligé, la nécessité de la protection
des libertés individuelles.
1180 Art.61, 62 et 63, C.P.P. fr.
1181 Art.63 et 64, C.P.P. Iv.
1182 Art.154, C.P.P. fr. ; art.76, C.P.P.Iv.
1183 Art.154, C.P.P. fr.; art.154 nouveau C.P.P. iv. (Loi
n°69-371 du 12 août 1969). 1184 Les lois du4 janvier 1993, 24
août 1993, 1er février 1994 et 15 juin 2000.
La défense pénale notamment durant la phase non
juridictionnelle du procès pénal a été purement et
simplement éludée. Or, les principes directeurs de toute
procédure pénale dans un Etat de droit s'appuient essentiellement
sur la recherche d'un équilibre entre la nécessité de la
répression des comportements tombant sur le coup de la loi pénale
et le respect des droits et des libertés fondamentaux durant toutes les
phases de la procédure1185. Et, le rôle de l'avocat
dans la quête de ce juste milieu est déterminant. Au-delà
de la défense de l'intérêt du suspect, de l'accusé
et de la victime, l'avocat a pour rôle de protéger les droits de
l'homme. En effet, il lui appartient de renforcer la légalité et
l'égalité devant la justice pénale. Aussi, sert-il de
contre-pouvoir de l'Etat afin d'atteindre un équilibre entre la fonction
répressive de l'Etat et les exigences propres aux droits des
individus1186. Ainsi, la loi du 15 juin 2000 a prévu
l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue
avec la possibilité d'une seconde intervention à la
vingtième heure1187.
Contrairement au droit français, la garde à vue
des mineurs en droit ivoirien n'est pas entourée de garanties
particulières s'inscrivant dans la logique de la protection des
intérêts des mineurs faisant l'objet d'une procédure
judiciaire comme le souhaite la Convention internationale des droits de
l'enfant ou la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
Le droit ivoirien ne fait pas de distinction entre mineur et majeur en garde
à vue. Force est de reconnaitre que les rédacteurs du code de
procédure pénale ivoirien ont eu une timide réaction quant
à l'intérêt que représente la protection des droits
fondamentaux durant la phase policière du procès pénal.
En pratique, durant sa garde à vue, le mineur est
astreint au régime classique du droit pénal ivoirien. A l'image
des procédures pénales africaines, la durée de la garde
à vue à proprement parler est excessive. Elle est portée
à quarante-huit heures1188 avec la possibilité d'une
reconduction d'un nouveau délai de quarante-huit heures avec l'accord du
procureur
1185 Interview de Guang Zhong CHEN « Essors à la
fin de siècle. Démocratie, légalité et
rationalité », In. Chinese Lawyers, n°5, 1996, p.16,
cité par Ping SUN et Haifeng ZHAO « Le rôle de l'avocat dans
la politique criminelle chinoise », R.S.C.,
n°4, 1999, p.795.
1186 SUN (P.) et ZHAO (H.) « Le rôle de l'avocat dans
la politique criminelle chinoise », Op.cit., p.804. 1187 Article 114 de la
loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes concernant l'instruction, la
détention provisoire, le juge des libertés et de la
détention et le jugement correctionnel ; Cette intervention de l'avocat
a été confirmée par la Loi n° 2011-392 du 14 avril
2011 portant réforme de la garde à vue ; Article 63-3-1 du code
de procédure pénale français.
1188 Art.63 et 64, CPP iv.
433
de la République ou du juge d'instruction. La seule
garantie prévue par la loi est la possibilité offerte au
gardé à vue de se faire examiner par un médecin. Mais, il
faut préciser ici qu'il ne s'agit pas d'un droit proprement dit puisque
la désignation du médecin relève en fait du pouvoir
discrétionnaire du procureur de la République : « s'il
l'estime nécessaire, même à la requête d'un membre de
la famille de la personne gardée à vue, le procureur de la
République peut désigner un médecin qui examinera cette
dernière à n'importe quel moment des délais prévus
par l'article 63 »1189.
L'absence de régime spécial pour les mineurs est
contraire à la lettre et à l'esprit des instruments
internationaux fondateurs des droits de l'enfant et aux principes directeurs de
la justice des mineurs. La ratification de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant par l'Etat de Côte d'Ivoire aurait pu
inspirer une réforme de la procédure pénale dans la
perspective d'une bonne administration de la justice des mineurs.
En ce qui concerne la question relative à
l'administration de la justice des mineurs, la Charte part du principe que tout
enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi
pénale a droit à un traitement spécial. Elle invite les
Etats signataires à faire prévaloir l'intérêt de
l'enfant dans toute action le concernant1190. L'appel à la
prise en compte des spécificités de l'enfance est
accompagné d'un certain nombre de garanties juridiques. En ce sens, les
Etats parties à la Charte doivent veiller en particulier à ce que
tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale
bénéficie de la présomption d'innocence1191,
qu'il soit informé dans le détail des accusations portées
contre lui, qu'il bénéficie des services d'un interprète
s'il ne peut comprendre la langue utilisée1192, et
reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour
préparer sa défense1193. Le problème de la
défense du mineur devant la justice, notamment devant les instances
répressives telles que la police est très important, car non
seulement il met en scène la liberté du jeune prévenu qui
peut être entravée, mais aussi son avenir qui risque d'être
compromis par l'expérience négative d'un passage devant un juge
ou d'une condamnation pénale. En procédure pénale
ivoirienne, la question de la défense du
1189 Art.64 al. 1er, CPP iv.
1190 Art.17-1 et art.4-1 de la charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant. 1191 Art.17-2 c.i de la charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant. 1192 Art.art.17-2c-ii de la charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant. 1193 Art.art.17-2c-iii
de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
434
mineur n'apparaît qu'à la phase du jugement. Ce
qui est fort regrettable et contraire aux prescriptions internationales.
L'exemple ivoirien constitue une renonciation implicite
à un droit essentiel : le droit à un procès
équitable reconnu à tout individu. En matière
pénale, l'évocation de l'idée largement défendue de
« procès équitable » renvoie automatiquement
à une autre, à savoir : le respect des droits fondamentaux. Et,
c'est ici que l'on retrouve toute la portée de la présomption
d'innocence1194 et les prérogatives de la
défense pénale dont les exigences se conjuguent avec la garantie
plus générale du procès équitable1195.
La question de savoir si les personnes gardées à vue ont droit
aux garanties du procès équitable s'est souvent posée.
Certes, il est vrai que les droits de la personne gardée à vue se
situent sur le terrain très controversé de la privation de
liberté avant le jugement. Mais, on ne comprend pas pourquoi une
privation de liberté avant tout jugement doit empêcher celui qui
n'est encore qu'un suspect de revendiquer le droit à un procès
équitable1196.
Les violences corporelles sont également des moyens
fréquemment utilisés par la police ivoirienne pour obtenir des
aveux de culpabilité. Les mineurs délinquants
arrêtés lors des opérations de police judiciaire en
Côte d'Ivoire sont placés en garde à vue parfois durant des
semaines dans les locaux insalubres des commissariats ou des cellules
infestées de la préfecture de police. Ils ne
bénéficient d'aucune assistance médicale, ni juridique. La
plupart des adolescents qui arrivent au cabinet des juges des enfants
présentent un état physique marqué par les coups de
matraque. En somme, l'officier de police judiciaire en droit ivoirien dispose
d'une importante marge de manoeuvre dans la conduite des enquêtes, sans
doute par souci de renforcer l'efficacité de la police sur le terrain de
la répression des infractions. Il n'est pas rare que des enfants servent
de main-d'oeuvre gratuite utilisée par des agents peu scrupuleux pour
accomplir certaines tâches : nettoyer les locaux des commissariats, etc.
Au total, on note en Côte d'Ivoire, plusieurs irrégularités
lors de la garde à vue des mineurs
1194 LAZERGES (C.), « La présomption d'innocence
en Europe », In. Archives de politique criminelle, vol.26,
n°1, 2004, pp.125-138.
1195 ALLIX (D.), « Le droit à un procès
équitable. De l'accusation en matière pénale à
l'égalité des armes », In. Justices, n°10,
1998, p.21. ; AMNESTY INTERNATIONAL, Pour des procès
équitables, Les Editions francophones d'Amnesty International,
Paris, 2001, pp.87-89. ; HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), Traité de
droit international des droits de l'homme, Editions A. Pedone, 2016,
pp.1304-1360.
1196 ALLIX (D.), « Le droit à un procès
équitable. De l'accusation en matière pénale à
l'égalité des armes » In. Justices, n°10,
1998, p.21, p.25.
435
(non-assistance du mineur par un médecin,
rétentions abusives, exactions physiques et morales) qui ne sont pas
malheureusement pas sanctionnées. Contrairement à cette
réalité ivoirienne, en France, l'inobservation des règles
relatives à la garde à vue peut entrainer l'annulation des actes
irréguliers1197.
Il revient donc à l'enfant victime d'exactions lors de
sa garde à vue ou de sa rétention ou bien lésée par
un acte d'en invoquer l'irrégularité devant la Chambre
d'accusation. La chambre d'accusation est la seule juridiction du second
degré compétente pour se prononcer sur la nullité de
l'acte entaché, la responsabilité et la sanction à
l'encontre de ou des officiers de police judiciaire mis en
cause1198. Aussi, toute partie peut invoquer la nullité
devant les juridictions correctionnelles et les juridictions de simple police.
Celles-ci peuvent, après avoir entendu le Ministère public et les
parties, prononcer l'annulation des actes qu'elles estiment atteints de
nullité et décider si l'annulation doit s'étendre à
tout ou partie de la procédure ultérieure1199.
Une autre situation qui achève de choquer est la
situation des enfants incarcérés ou détenus dans des
prisons.
§ 2. LA SITUATION DU MINEUR INCARCERE
S'interroger sur la situation des mineurs
incarcérés, revient à se demander d'une part, si les
normes internationales relatives aux droits de l'enfant sont prises en compte
par les législations nationales dans l'élaboration du
régime d'exécution des condamnations des mineurs à la
peine d'emprisonnement et, si d'autre part, ces règles sont
réellement appliquées. Le premier point à examiner dans ce
paragraphe concerne le cadre juridique de la détention des enfants
délinquants parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent,
le droit est rentré dans les prisons1200. En ce sens, les
détenus qui, dans l'imagerie populaire, ne sont soumis qu'à des
obligations, se voient reconnaitre aussi des droits1201. Cependant,
il
1197 DUMONT (J.), « Nullités de l'information »,
In. J.-Cl. Proc. Pén., 1997, comm. Art.170-174.
1198 Art.224 et s. C.P.P. iv.
1199 Art.174 al.1er C.P.P.iv.
1200 KIEKEN (A.), Le droit en prison, Mémoire de
DEA droit et justice, mention justice, Université de Lille
II, 2001, 77p.
1201 FAVARD (J.), « Les prisons », op. cit.,
p.64 et s.
436
ne suffit pas d'élaborer des règles pour les
voir appliquer. Encore faut-il les faire respecter, créer les conditions
de leur application effective.
Sur le plan purement théorique, le droit ivoirien et le
droit français se rejoignent en ce qui concerne les conditions de
détention des mineurs de 18 ans. En Côte d'Ivoire, le
décret n° 69-182 du 12 mai 1969 rappelle que « les mineurs
incarcérés sont soumis à l'emprisonnement collectif. La
séparation des mineurs et des adultes doit être
réalisée aussi complètement que possible. Ils
bénéficient, quant au couchage, à la nourriture et
à l'habillement, d'un régime spécial dont les
modalités sont fixées par arrêté du Garde des
Sceaux, ministre de la justice »1202.
Quand bien même les mineurs incarcérés
peuvent faire l'objet d'une punition de cellule disciplinaire1203
pour le non-respect du règlement intérieur de
l'établissement, conformément aux articles 52, 53 et 54 du
même décret, ils doivent avoir accès autant que faire se
peut à un espace situé en plein air, tant que les conditions
atmosphériques et les nécessités du service le
permettent1204. Selon le texte, ils doivent faire l'objet d'une
attention particulière durant leur détention. Aussi, «
leur surveillance directe est assurée par des éducateurs
spécialisés qui dirigent leur activité et observent leur
comportement pour en faire rapport au juge des enfants »1205.
Mais dans la réalité, elles ne sont guère
respectées comme en témoignent les conditions carcérales
généralement précaires ou difficiles des mineurs
incarcérés (A) et le cas particulier des jeunes filles
incarcérées (B).
A. DES CONDITIONS CARCERALES GENERALEMENT PRECAIRES ET
DIFFICILES
La surpopulation, l'insalubrité des
locaux d'emprisonnement, la malnutrition et la permanence des maladies
constituent les caractéristiques des prisons accueillant les enfants en
Côte d'Ivoire.
1202 Art.33, Décr.n°69-182 du 12 mai 1969. 1203
Art.35 al.2, Décr. n°69-182 du 12 mai 1969. 1204 Art.35 al.1,
Décr. n°69-182 du 12 mai 1969. 1205 Art.36, Décr. n°
69-182 du 12 mai 1969.
437
1. La surpopulation
L'Afrique détient un palmarès inégalable,
notamment en matière de violations des normes pénitentiaires et
des droits de l'enfant1206. En Afrique, peu de pays disposent
d'établissements pénitentiaires destinés à recevoir
les mineurs condamnés par les juridictions
répressives1207. Quand ils existent, ils sont
vétustes, insalubres et surpeuplés. Les enfants qui y sont
placés subissent des multiples violences physiques (tortures, coups,
abus sexuels, etc.). Ces exactions sont exercées sur la personne des
mineurs par les codétenus adultes et par certains gardiens de
prison1208. Manifestement, la surpopulation carcérale se
combine bien avec la précarité. Elle affecte la prise en charge
des jeunes détenus. La vie carcérale comporte des contraintes
insupportables surtout par une population carcérale de plus en plus
jeune1209.
A Abidjan, les mineurs condamnés à des peines
d'emprisonnement sont confiés, au même titre que les adultes
délinquants, à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan
(M.A.C.A). Grâce à un stage de recherches effectué au BICE,
nous avons eu accès à cet établissement
pénitentiaire, interrogé le régisseur, les surveillants et
les mineurs détenus. Pour avoir une idée exacte des conditions de
vie des enfants incarcérés, il a fallu parfois confronter les
propos des responsables et ceux des mineurs afin d'évaluer la pertinence
des propos recueillis pour n'en retenir que l'essentiel.
On le sait : les prisons en Afrique sont essentiellement
caractérisées par leurs effectifs pléthoriques. Il est en
effet rare de voir une prison dont les effectifs correspondent à sa
capacité d'accueil. Il y a généralement un rapport de
disproportionnalité entre les capacités d'accueil des
établissements et le nombre de prisonniers. Une des
caractéristiques
1206 OLINGA (D.-A.), « La Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant. Essai de présentation », op.
cit., p.53 et s.
1207 NIZIGIYIMANA (P.C.), L'amélioration des
conditions sanitaires dans les prisons du Burundi, Mémoire Master
of Advanced Studies en Action Humanitaire, Juin 2012, 79p. ;
AHONTO (L.), « Mineurs en prison. Des conditions de vie
déplorables », In. L'autre Afrique, n°56 du 14 au 21
juillet 1998, p.33. ;
https://bice.org/fr/les-enfants-oublies-des-prisons-ivoiriennes/(consulté
le 18/01/217) ;
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/27/dans-l-enfer-de-la-prison-pour-mineurs-d-
abidjan_4602568_3212.html(18 /01/2017);
http://geopolis.francetvinfo.fr/ces-prisons-africaines-
transformees-en-couloirs-de-la-mort-72809(
consulté le 20/01/2017)
1208 Ibid.
1209 ONUCI, Situation des établissements
pénitentiaires de Côte d'Ivoire, Juillet 2005-Avril 2006,
Aout 2006, p.3.
438
439
fondamentales des milieux carcéraux ivoiriens est,
ainsi que nous pouvons l'observer, la surpopulation. En Côte d'Ivoire, la
maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qui abrite le COM
n'échappe pas en effet à cette triste réalité d'une
démographie pénitentiaire toujours en hausse.
Cette inadéquation, entre les capacités
d'accueil des prisons et la population carcérale infantile toujours en
inflation, est génératrice d'autres problèmes qui
contribuent de façon essentielle à rendre précaires les
conditions d'existence dans les centres de détention des mineurs. Il
s'agit par exemple de la promiscuité avec ce que cela comporte d'effets
pervers. La promiscuité a pour effet de rapprocher des
délinquants de diverses catégories les uns des autres et,
par-là, augmenter les risques de corruption des détenus peu ou
pas du tout dangereux au contact de grands délinquants ou criminels.
Pire encore, la promiscuité, fruit de la surpopulation, favorise la
formation de véritables bandes de délinquants. Il ne s'agit pas
seulement en effet, pour les détenus moins dangereux d'apprendre,
d'autres détenus récidivistes et dangereux, des méthodes
pour mieux commettre des infractions pénales, mais il s'agit aussi dans
certains cas de former avec eux des groupes d'amis qui auront pour
finalité de continuer, après remise en liberté, dans la
voie de la délinquance.
La surpopulation comme nous le voyons, constitue un
véritable problème à la MACA : elle contribue souvent
à faire du COM, un lieu d'apprentissage et de formation à la
délinquance, un lieu criminogène. Elle rend la vie
carcérale insupportable pour les enfants et favorise des violences de
toute espèce non seulement entre détenus mais encore entre
détenus et personnel pénitentiaire. Elle ne permet donc pas un
meilleur suivi des détenus par le personnel. C'est alors qu'il revient
à chacun de se débrouiller. En plus, la surpopulation ne permet
pas de tenir les locaux de détention en bon état.
2. La question de l'insalubrité des locaux
d'emprisonnement
L'hygiène individuelle et collective sur laquelle
insistent certains instruments juridiques est quasi-absente des COM et prisons
ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, la législation pénale
organise en théorie un système pénitentiaire qui accorde
une place importante à l'hygiène des détenus dans les
prisons. L'article 154 du décret 69-189 du 14 mai 1969 portant
réglementation des établissements pénitentiaires
énonce que : « les locaux de détention et en particulier
les dortoirs doivent répondre aux exigences de l'hygiène (...)
». Dans le même
ordre d'idées, l'article D. 349 du code de
procédure pénale français dispose que : «
l'incarcération doit être subie dans des conditions
satisfaisantes d'hygiène et de salubrité (...) ».
Malheureusement dans les faits, l'hygiène dans les prisons pâtit
de la vétusté et de l'encombrement1210.
En un mot, il manque, en plus une organisation émanant
de l'administration pénitentiaire, qui permette aux détenus de
nettoyer plus ou moins régulièrement leurs cellules. Ainsi, les
cellules se transforment progressivement en dépotoir ou porcherie. Par
manque de contrôles exigeants du personnel pénitentiaire,
l'hygiène ne constitue en aucun cas, une préoccupation majeure.
Il appartient généralement à chaque détenu de
rendre son petit espace de vie propre. C'est alors que certaines cellules sont
moins sordides que les autres. Dans le cas où les détenus
apparaissent négligents, parce que dégoûtés de leurs
conditions de détention, les cellules sont incontestablement sales,
insalubres. C'est dans cette insalubrité des locaux que nombre de
prisonniers vivent, avec ce que cela comporte de risques.
Le premier choc, c'est l'odeur. Celle des excréments,
engluée dans une humidité poisseuse impossible à chasser
dans des couloirs sans lumière. Ces odeurs nauséabondes
s'expliquent par la défaillance du système de canalisation et
d'évacuation des eaux usées et de pluie1211. Durant la
saison des pluies, le rez-de-chaussée du bâtiment est
inondé par des eaux émanant des fosses septiques1212.
Chaque semaine pourtant, les bénévoles de certaines ONG tels la
fondation Amigo, des religieux catholiques pour la plupart, aident les enfants
à balayer leur dortoir et à récurer les sanitaires,
constamment bouchés. Les détenus volontaires sont nombreux,
visiblement heureux de s'acquitter d'une corvée qui leur permet de
retrouver quelques millimètres de propreté là où la
crasse semble s'être inexorablement incrustée. La tâche est
éreintante : au premier étage, celui des dortoirs, il n'y a pas
d'eau courante. L'unique robinet, qui ne fonctionne que quelques heures par
jour, se trouve dans la cour au rez-de-chaussée. Qui plus est, selon des
enfants détenus, le cadre insalubre crée un cadre
1210 ONUCI, « Situation des établissements
pénitentiaires de Côte d'Ivoire, Juillet 2005-Avril 2006
», Aout 2006, p.3.
1211 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.38.
1212 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.39.
440
propice à la présence de rats ou souris qui se
font le plaisir de leur manger la corne des pieds pendant leur sommeil.
Une autre triste réalité achève de
choquer : Une situation vraisemblable à la vue des rares moustiquaires
installées dans les dortoirs, qu'aucun crochet n'a été
prévu pour tendre : les quelques protections vertes sont nouées
aux néons cassés ou aux barreaux des fenêtres, dans un
enchevêtrement fébrile de fils qui menace de s'effondrer. Ce qui
ne manque pas d'inquiéter vu que ces fils conduisent certainement de
l'électricité. Pour ceux des enfants privés du
bénéfice de moustiquaires, leur peau noire s'efface presque sous
les marques roses laissées par les piqûres. Les moustiques n'ont
pas à chercher loin pour se reproduire, car la cour et ce qui
ressemblait un jour, à un terrain de basket, sont partiellement
noyés sous les flaques d'eau stagnante, sans parler des eaux
usées qui remontent après chaque pluie.
Mais, nous constatons une violation du droit au logement dans
les établissements pénitentiaires. En prison, outre le droit
à la nourriture, les conditions d'hygiène et le droit à la
santé constituent un autre droit inaliénable de tous.
L'accès à l'eau est une condition essentielle
pour la propreté et le bien-être des mineurs détenus. Les
règles de la Havane recommandent que dans « Tout
établissement (...), chaque mineur doit disposer en permanence d'eau
potable1213 ». Au Centre d'observation des mineurs d'Abidjan,
les détenus n'ont pas à leur disposition de l'eau de façon
permanente1214 . Il y existe un seul point d'eau à faible
débit1215. Pour bénéficier d'eau dans les
dortoirs et les sanitaires, les mineurs sont obligés de transporter
l'eau depuis le rez-de-chaussée jusqu'aux dortoirs1216.
Contrairement aux mineurs du COM d' Abidjan, les mineurs internés au MAC
de Dabou disposent d'un point d'eau d'accès
facile1217. Il convient de noter que les mineurs de
ces deux centres ne reçoivent aucune dotation en savon, éponge et
serviette pour
1213 Point 37 des Règles de la Havane.
1214 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.39.
1215 Ibid.
1216 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.39.
1217 Ibid.
441
assurer leur propreté corporelle et l'hygiène de
leurs vêtements, facteurs d'une bonne santé.1218
L'insalubrité est ainsi une autre
caractéristique des établissements pénitentiaires en
Côte d'Ivoire. Vivre sale parait être normale, aussi bien pour les
responsables en charge des prisons en Côte d'Ivoire que pour les
détenus qui finissent par l'intérioriser inconsciemment. De ce
point de vue, il n'y a pas lieu de s'étonner de l'état de
sordidité affectant les prisons. Les choses se passent comme si, de
manière spontanée, les pouvoirs publics choisissent que les
prisons soient sales ; ce pour mieux corriger, sinon punir les enfants
délinquants. Cependant, cet état d'insalubrité
pénitentiaire avancée contribue de façon essentielle
à l'apparition de maladies susceptibles de mettre la vie des enfants
détenus en danger de mort. Nous comprenons alors pourquoi la prison est
présentée comme un mouroir.
Au total, toute cette situation est contraire aux
règles de la Havane qui recommandent en leur point 31 que « les
mineurs détenus doivent être logés dans des locaux
répondant aux exigences de l'hygiène et de la dignité
humaine ». Contrairement au COM d'Abidjan, il y a lieu de noter que
le quartier des mineurs de la MAC de Dabou est quant à lui bien
entretenu et est d'une propreté satisfaisante1219.
3. De la malnutrition à la permanence des
maladies
Tout établissement est tenu de veiller au respect de
l'alimentation du mineur, qui doit être convenablement
préparée et présenté aux heures usuelles des repas,
et satisfaisant en qualité et en quantité1220.
Le problème lié à l'alimentation est la
malnutrition, en raison de la qualité douteuse et l'insuffisance des
vivres. En effet, la malnutrition représente une peine
supplémentaire, un surplus d'injustice. Le droit à la nourriture
est le premier des droits à garantir, étant
1218 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.39.
1219 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.39.
1220 HCDH, Les droits de l'homme et les prisons. Manuel de
formation aux droits de l'homme à l'intention du personnel
pénitentiaire, série sur la formation professionnelle
n°11, New York et Genève, 2004, pp.59-61.
442
essentielle à la survie. Selon le dernier rapport de
l'ONUCI sur les prisons ivoiriennes1221, la malnutrition serait la
cause principale de la mortalité en prison et ce en raison des moyens
dont disposent les prisons de Côte d'Ivoire.
Chaque prisonnier reçoit en moyenne une ration
alimentaire par jour d'une valeur de 120 francs CFA1222, qui
représente moins de la moitié du budget des pays voisins pour
l'alimentation des détenus. Quant aux repas, il n'y a pas de
petit-déjeuner, et à midi, on livre aux mineurs d'énormes
marmites, réparties entre du riz compact et une sauce aux morceaux de
viandes rares et douteux. D'après les bénéficiaires,
« Il y a des cailloux, du sable, c'est immangeable » ; cette
affirmation est souvent relayée par la presse et le commun des mortels
en Côte d'Ivoire. Et de façon irresponsable, les éducateurs
n'hésiteraient pas à cacher les marmites lors des visites des
juges des enfants pour éviter que ces derniers ne constatent
l'état piteux de la nourriture servie aux enfants. Pour notre, part,
nous estimons que de tels agissements sont de nature à être
assimilés à des traitements inhumains et
dégradants1223.
Il est encore plus difficile de comprendre la manière
dont le budget du Centre d'Observation des Mineurs (COM) est réparti
quand on sait que tous les repas viennent de la Maison d'Arrêt et de
Correction d'Abidjan (MACA) voisine. Un lien qui brouille davantage la
frontière censée séparer les deux établissements.
Cependant, grâce à l'action charitable des ONG et notamment le
BICE1224, le MESAD et la communauté musulmane, on constate
une légère amélioration dans les conditions
d'alimentation. Ces ONG n'hésitent pas à offrir une fois par
semaine une nourriture de qualité acceptable qui est effectivement
servie aux enfants.
En définitive, le décret relatif à la
ration alimentaire quotidienne des prisonniers qui remontent à 1952,
n'est pas respecté, et presque pour ainsi dire tombé en
désuétude. Cependant les gouvernants doivent porter une attention
particulière à l'amélioration de l'alimentation des
détenus.
1221 ONUCI, « Situation des établissements
pénitentiaires de Côte d'Ivoire, Juillet 2005-Avril 2006
», Aout 2006, p.3.
1222 Ibid., p.3.
1223 HCDH, Les droits de l'homme et les prisons. Manuel de
formation aux droits de l'homme à l'intention du personnel
pénitentiaire, série sur la formation professionnelle
n°11, New York et Genève, 2004, p.37. 1224 Durant le stage par nous
effectué au BICE, nous avions participé à cette
opération de distribution de repas qui avait lieu tous les jeudis
à 12h, et ce dans le cadre des actions du programme Enfance Sans
Barreaux (ESB).
443
Les différents lieux d'emprisonnement des enfants en
Côte d'Ivoire sont également des réservoirs de multiples
maladies. Dans ces lieux, les détenus sont exposés aux maladies
telles que le paludisme, les maladies pulmonaires comme les bronchites, les
pneumopathies, la tuberculose...les diarrhées, les dermatoses, les
troubles de vision et les conjonctivites. Ces maladies, ainsi que nous pouvons
le remarquer sont liées aux conditions de détention qui sont dans
l'ensemble précaires. Dans le cas du paludisme, il faut noter que les
prisonniers ne se protègent pas efficacement contre les moustiques qui
en sont les agents vecteurs. Ils ne dorment pas en effet sous moustiquaire. Il
n'est donc pas surprenant, dans ces conditions où aucune mesure n'est
prise pour se protéger, que des détenus tombent
régulièrement malades de paludisme. Les conditions sanitaires des
mineurs sont de plus en plus dégradées : Nombreux souffrent de
maladies cutanées, de paludisme et autres infections microbiennes. Ils
prétendent ne recevoir aucun soin médical. Or, pour banal que
cela puisse apparaître, la santé dans les prisons touche
également au domaine des droits de l'homme et la promotion des droits
des détenus. B. BULTHE écrit à ce propos : « En
raison de sa fonction et des qualités humaines que celles-ci requiert,
la médecine est un des garants du respect des droits de l'homme tant
dans la société que dans les établissements
pénitentiaires (...). Si au siècle dernier, le régime dans
les prisons était celui d'un minimum jugé indispensable, pour
l'entretien de la santé et des forces des détenus, c'est d'un
droit à la santé qu'il s'agit aujourd'hui1225
».
En principe, il appartient à l'Etat, principal
organisateur du système pénal et à l'administration
pénitentiaire, de maintenir l'état de santé physique et
mentale des détenus. La privation que constitue l'incarcération
devrait être mise à profit pour assurer un dépistage
complet des infections dont ils peuvent être atteints et de les
traiter1226. Cela suppose bien entendu que les établissements
pénitentiaires disposent d'infirmeries équipées et que la
présence médicale et para médicale soit
renforcée1227.
1225 BULTHE (B.), « Rapport à la 2e
session d'étude du centre international de recherches et d'études
sociologiques pénales et pénitentiaires de Messine »
In.
Rev. Dr. pén. et
crim., n° 4, 1982, p.299. cité par BERNARD (F.) « Pour un
véritable statut de la médecine pénitentiaire »,
Rev. Pénit. et dr. pén., 1981, pp.29-30.
1226 Rapport présenté au Conseil
supérieur de l'administration pénitentiaire par M. AYMARD,
1er au 10 novembre 1977, Rev. Pénit. et dr. pén.,
1978, p.61.
1227 Ibid.
444
Les diarrhées sont dues principalement à
l'alimentation qui est de mauvaise qualité. Quant aux dermatoses et aux
maladies pulmonaires, la raison est à trouver dans des conditions
hygiéniques déjà évoquées qui laissent
singulièrement à désirer. Nous ne le dirons jamais assez,
l'écrasante majorité de la population carcérale mineure du
COM d'Abidjan dort presque à même le sol, c'est-à-dire sur
de simples nattes dans des cellules insalubres. Cette population
carcérale est donc, ainsi qu'il apparait, régulièrement en
contact avec la poussière, la saleté. Il faut également
noter que, si les détenus ont un peu d'eau à leur disposition,
ils manquent cependant dans la plupart des cas de savons. Dans ce sens, il est
difficile pour eux de prendre véritablement soin de leur corps et de
tenir en permanence leurs vêtements propres. Ainsi, se comprennent les
multiples maladies dermiques comme la gale. Pour les troubles de vision et les
conjonctivites, il faut seulement rappeler ici que les prisonniers n'ont pas le
bénéfice de promenades journalières dans l'enceinte de la
prison. Il en résulte logiquement des problèmes de vision pour la
simple raison qu'ils sont constamment enfermés dans les cellules
où l'éclairage est défectueux, où la
pénombre est souvent la règle.
Il convient par ailleurs de souligner, un aspect peu ou prou
positif : le COM et le nouveau centre d'observation des mineurs disposent d'un
personnel soignant ; mais malheureusement, là où il y a une
présence de quelques infirmiers ou médecins, il n'y a souvent pas
de médicaments qui permettent d'administrer les premiers soins aux
détenus souffrants. Ainsi, le personnel soignant est parfois
désarmé en face des enfants malades. Les instruments juridiques
nationaux et internationaux disposent que tout mineur a le droit de recevoir
des soins médicaux, tant préventifs que curatifs1228.
Les visites dans les établissements pénitentiaires
révèlent l'intervention partielle des infirmiers d'Etat. L'action
menée par les infirmiers s'analyse essentiellement par la prescription
d'ordonnances médicales, sans pouvoir véritablement faire
bénéficier aux mineurs détenus des soins
appropriés.
Comme on le voit, les mineurs incarcérés sont
détenus dans des situations précaires en raison de l'absence
d'hygiène et de soins de santé appropriés ; ce qui ne
manque pas de retentir négativement sur leur état de
santé.
1228 Art.12 PIDESC, Art. 25 D.U.D.H., Principe 9 des Principes
fondamentaux relatifs au traitement des détenus ; Règles 23 et 25
de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
445
Enfin, notons que certains détenus peuvent avoir
importé des maladies dans les prisons. En effet, à leur
entrée en prison, ils ne font pas l'objet de visites médicales :
de ce point de vue, ils représentent un risque de contamination majeur
pour les autres. Il y a donc une nécessité de faire quelque chose
pour les prisons qui deviennent de plus en plus des milieux à haut
risque. Nous le voyons : les prisons pour mineurs en Côte d'Ivoire sont
des lieux plus ou moins oubliés, des lieux qui ne paraissent pas attirer
de façon particulière l'attention des autorités
publiques.
Au terme de la comparaison entre les recommandations des
divers instruments juridiques et la réalité carcérale, on
peut s'autoriser à affirmer que les droits de l'enfant trouvent
difficilement une application effective dans les centres de détention
des mineurs car la réalité pénitentiaire est plus ou moins
éloignée des textes qui ont, eux, pour visée le souci de
la sauvegarde de la dignité humaine. Mais, cet écart est
susceptible d'être réduit, il peut être comblé. C'est
dans cette perspective que nous pouvons comprendre pourquoi la gestion des
espaces carcéraux en Côte d'Ivoire laisse une part trop belle
à la négligence.
Au-delà des conditions générales
précaires caractéristiques des conditions de détention des
enfants, il importe de relever le cas particulier des enfants de sexe
féminin qui vivent aussi dans des conditions extrêmement
précaires.
B. LE CAS PARTICULIER DES JEUNES FILLES
INCARCEREES
La direction de l'administration pénitentiaire,
chargée de la gestion et du contrôle des établissements
pénitentiaires n'a jusqu'à ce jour créé de cellule
propre ou appropriée pour l'incarcération des mineurs de sexe
féminin ou pour leur réinsertion sociale.
Les visites dans les maisons d'arrêt et de correction
d'Abidjan, de Dabou et de Bassam révèlent que les filles mineures
sous mandat de dépôt ou sous ordonnance de garde provisoire
demeurent dans les mêmes geôles que les femmes
adultes1229.
A la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le
bâtiment femme est appelé « KREMLIN » par les
prisonniers eux-mêmes, parce qu'il est difficile d'accès. Ce
bâtiment regroupe tous les prisonniers de sexe féminin, enfant ou
adulte ayant commis toutes sortes
1229 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME DE COTE
D'IVOIRE, L'Etat des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Rapport
annuel 2015, p.35
446
d'infractions. Néanmoins, les filles mineures sont
approximativement séparées des femmes. Elles sont logées
dans une cellule à elles réservée, mais restent en contact
avec celles-ci car partageant les mêmes espaces de
loisirs1230. Cette situation est alarmante car il
faut se préoccuper de leur réintégration sociale : A la
MACA, les jeunes filles comme les femmes évoluent dans un même
environnement sans égard à leur statut et à la
gravité des infractions commises par chacune d'entre elles. Cette
organisation présente des risques pour la resocialisation car elle met
dans un même espace des prévenues et des condamnées dont
certaines sont des récidivistes. Seule une bonne séparation
permet d'éviter de transformer le bâtiment F en une «
école du crime » où les plus aguerries forment les
novices. Durant la journée, tout le monde se côtoie. Les mineures
qui sont censées rejoindre le Centre d'Observation des mineurs (COM), y
demeurent faute de dispositions particulières, le COM n'accueillant en
pratique que les mineurs délinquants de sexe masculin.
Les mineures sont de deux ordres : les délinquantes
présumées ou condamnées et les enfants vivant avec leurs
mères délinquantes détenues. Ceux-ci doivent en principe
être remis aux services sociaux ou à l'orphelinat (cas des femmes
enceintes ayant accouché en prison ou arrêtées alors
qu'elles étaient en compagnie de leur progéniture). Cette
solution est adoptée lorsque la femme n'a pas un parent prêt
à assumer la tutelle de l'enfant. Du fait des défaillances des
services de l'assistance sociale et du refus des mères de se
séparer de leurs enfants, ces derniers sont contraints de demeurer en
prison, alors qu'aucun fait ne leur est reproché. Certains enfants
vivent avec leur mère en prison. En théorie, cet état de
choses ne dure pas ; dans la plupart des juridictions, il existe des lignes
directrices qui stipulent l'âge maximum auquel un enfant peut demeurer en
prison, variant de quelques mois à quelques années. Cependant,
ces lignes directrices ne sont pas toujours respectées parce que les
enfants n'ont personne pour les prendre en charge ; en Inde par exemple, des
enfants de 15 ans seraient demeurés en prison avec leurs parents parce
que personne n'était venu les chercher1231. Certaines
juridictions, notamment dans certains pays développés tels la
1230 Ibid.
1231 JANS (2007) «No takers for children of jailed
parents» In. PxPG news, sur le site
http://www.rxpgnews.com/india/No-takers-for-children-of-jailed-parents_11779.shtml
(consulté en mars 2007).
447
Norvège, le Danemark ne permettent pas que des enfants
vivent en prison, quel que soit leur âge1232.
Des recherches indiquent que le fait de laisser de jeunes
enfants (en âge préscolaire) en prison avec leur mère peut
renforcer le lien entre la mère et l'enfant et éviter à
quelques-uns, des effets nuisibles de la séparation. Toutefois, les
enfants devront vivre dans les mêmes conditions que les parents
emprisonnés, ce qui souvent ne convient pas. Certains pays tels que le
Cambodge ou l'Inde1233 ne prévoient pas toujours des
allocations supplémentaires de nourriture pour les enfants, ce qui
signifie que les parents doivent partager avec leurs enfants des repas (souvent
insuffisant et/ou inadéquats)1234. C'est aussi le cas en
Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région ouest
africaine tels le Togo, le Bénin, le Burkina où les enfants
vivant en Prison avec leur mères détenues, ne
bénéficient d'aucun régime alimentaire adapté
à leurs spécificités. Toute personne se trouvant au sein
de ces lieux de détention, doit se satisfaire de la nourriture commune,
faite pour tout le monde, sans aucune considération tenant à
l'âge ou même à l'état de santé de de
certaines personnes détenues.
En outre, les mères dont les enfants sont en prison
avec elles trouveront difficile de ne jamais avoir aucun répit et ne
seront donc pas en mesure de profiter des possibilités de formation ou
de travail offertes par la prison si aucune disposition n'existe pour la prise
en charge des enfants1235. Cela peut nuire à leurs chances
d'une bonne réinsertion dans la société à leur
sortie de prison ; ce qui peut avoir des répercussions sur leurs
enfants.
Selon une étude en provenance du Cambodge, sept femmes
prisonnières sur dix ayant des enfants ont dit qu'elles ne pouvaient pas
allaiter et/ou n'avaient pas suffisamment de lait pour leur
bébé1236. Nul doute que ce constat fait au Cambodge
est le même en Côte d'Ivoire
1232 SALGADO (A.), BARJONNET (F.), TEBOL (N.) et MOEMERSHEIM
(M.), Le régime juridique du mineur dans les pays scandinaves,
Rapport de recherche Master 2, 2015, pp.20-25.
1233 RAKESH (S.) (2006), «Looking after children of women
prisoners» sur le site Infochange analysis
http://www.infochangeindia.org/analysis128.jsp
(consulté en mars 2007).
1234 HILLARY (M.) (2002), Innocent Prisoners: a LICADHO
report on the rights of children growing upin prisons, pp.15-16.
1235 ANN (C.), «Forgotten Families - the impacts of
imprisonment» In. Family Matters Winter 2001, p.36. D'un autre
côté, la qualité de la relation mère-enfant peut
être meilleure s'il existe un soutien dans la prise en charge des enfants
(par exemple de la part d'autres prisonniers ou des cours d'éducation
disponibles en prison), ou du fait que la mère est peu sollicitée
par ailleurs.
1236 HILLARY (M.), Innocent Prisoners: a LICADHO report on
the rights of children growing upin prisons, 2002, p.17.
448
au regard de la qualité de la nourriture servie aux
jeunes filles mères vivant derrière les barreaux. Les
autorités carcérales ivoiriennes devraient veiller à ce
que les femmes enceintes et celles qui allaitent reçoivent une
alimentation adéquate, leur assurant, à elles et à leurs
enfants, un développement sain.
Le cadre de vie de la mineure délinquante offre peu de
perspectives. S'il est propre, il ne réunit pas pour autant toutes les
conditions d'hygiène requises à cause de la gale, des puces et
des chiques qui nécessitent que les locaux soient
déparasités régulièrement. En outre, la nourriture
constitue un problème car elle se résume à un repas unique
peu à propos. Pour l'essentiel, l'alimentation des détenues vient
de l'extérieur, de la part des parents et amis qui, par des dons de
repas ou d'aliments frais, contribuent à l'entretien du
délinquant.
Evidemment, les conditions de détention et la nature
des dispositions possibles pour la garde des enfants ailleurs doivent
être prises en compte. Il y a cependant accord sur le fait que pendant la
durée de leur séjour en prison avec leurs parents, la vie des
enfants doit être aussi semblable que possible à celle qu'ils
mèneraient à l'extérieur et ils ne devraient pas
être sujets aux restrictions de liberté auxquelles les autres
résidents de la prison sont soumis.
La Côte d'Ivoire gagnerait à s'inspirer de
plusieurs prisons étrangères offrant des installations
spéciales pour les enfants vivant avec leurs parents. Dans certains
pays, des logements pour mères et enfants sont souvent
fournis1237 et certaines prisons disposent de crèches ou
d'écoles pour les enfants de détenus comme c'est le cas de celle
de Pul-i-Charki en Afghanistan1238.
Les mauvais traitements infligés aux détenus
mineurs ou majeurs constituent bien une réalité de l'univers
carcéral. Malheureusement, de l'extérieur, il n'est pas facile de
les repérer en raison de « la loi du silence » qui
règne dans les prisons et de l'esprit de solidarité entre les
gardiens. Cela est possible seulement grâce à un contact direct
avec les détenus concernés ou encore grâce à des
enquêtes réalisées par des organismes indépendants
tels que le
1237 PENAL REFORM INTERNATIONAL, Annual Report
2005,2006, p.22.
1238 BRINLEY (B.) «22 to a cell - life in a notorious Afghan
prison» In. The Guardian, London, 2007, p8.
449
C.P.T1239., l'Observatoire International des
Prisons (O.I.P.)1240 ou les organisations de défense des
droits de l'homme1241, et les organisations
onusiennes1242.
Au-delà de la sphère pénitentiaire, la
souffrance infligée aux enfants en Côte d'Ivoire s'est
amplifiée à travers des atteintes graves aux droits de l'enfant
durant le conflit armé ivoirien.
1239 Le Comité contre la torture est un organe des
Nations Unies composé d'experts indépendants, qui est
chargé de surveiller l'application par les Etats parties de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 10 décembre 1984.
Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
Comité contre la torture,
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cat/
(consulté le 10 /11/2017).
1240 « L'Observatoire international des prisons (OIP) a
pour objectifs la surveillance des conditions de détention des personnes
privées de liberté et l'alerte sur les manquements aux droits
humains dont la population carcérale peut faire l'objet. Son objectif
principal est donc de « briser le secret » qui entoure les lieux de
détention. Avec comme références les droits de l'homme et
le respect de la personne humaine, l'OIP considère que chacun a droit,
en tous lieux, à la reconnaissance de sa personnalité juridique
et que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. L'OIP agit en dehors de toute
considération politique et se positionne en faveur de l'application des
textes nationaux et internationaux relatifs aux droits humains quel que soit le
motif qui a présidé à la détention de la personne
considérée. » L'Observatoire international des prisons
(OIP), Notice 2016, Pour le droit à la dignité des personnes
détenues, p.11 disponible sur :
http://oipbelgique.be/fr/wp-content/uploads/2017/01/Notice-2016.pdf
(consulté le 10/11/2017).
1241 Voir la thèse du Professeur MELEDJE DJEDJRO F.,
La contribution des organisations non gouvernementales à la
sauvegarde des droits de l'homme, Thèse pour le doctorat de droit
public, Faculté de droit et des sciences politiques et sociales,
Université d'Amiens, 23 octobre 1987, 553p.
1242 ONUCI-Division des droits de l'homme, Rapport sur la
situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire Janvier- Février
2005, Mars 2005, pp.10-11 ; Département des opérations de
maintien de la paix, « Une paix durable par la justice et la
sécurité », In. Actualités
pénitentiaires, Volume 3, Septembre 2011, pp.10-11.

451
SECTION II. LES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS DE
L'ENFANT EN PERIODE DE CONFLIT ARME
La préservation des enfants contre les
conséquences dramatiques des effets des conflits armés constitue
un impératif moral, une responsabilité juridique et une question
relevant de la paix et de la sécurité internationale. En outre,
le Conseil de sécurité a défini les crimes contre les
enfants en temps de guerre comme une « menace potentielle pour la paix et
la sécurité internationales » ; le Conseil laisse ouverte la
possibilité d'imposer des sanctions sévères, voire
d'intervenir en vertu du Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies en
réponse à ces crimes. Ainsi, pour le Conseil de
sécurité, la protection des enfants durant les conflits
armés constitue un aspect majeur de toute stratégie
complète de règlement des conflits armés, et devrait
être une priorité pour la communauté
internationale1243 . C'est dans cet esprit que l'Assemblée
générale des nations unies et nombre d'organismes du
système des Nations Unies, ont à plusieurs reprises,
préconisé l'octroi d'une protection spéciale aux enfants
par toutes les parties en conflit1244. L'Onu par le biais de son
Secrétaire général a repéré six violations
graves commises durant les conflits armés1245, selon la
possibilité de les suivre et de les vérifier, leur
caractère flagrant et leur gravité sur la vie des
enfants1246. La qualification juridique de ces violations se fonde
sur le droit international pertinent : droit humanitaire international, droit
international des droits de l'homme et droit pénal international. Durant
les conflits armés, le droit international humanitaire et le droit
international des droits de l'homme doivent être respectés, une
attention spéciale étant accordée aux enfants souvent
privés de toute défense contre les violences1247 .
1243 Voir, par exemple, les résolutions du Conseil de
sécurité 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460
(2003) 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) et 2068
(2012).
1244 Voir par exemple, la Déclaration de
l'Assemblée Générale « Un monde digne des enfants
», en annexe à la résolution A/RES/S-27/2 (2002)
adoptée à l'unanimité. Voir aussi A/RES/62/141 (2008) et
A/RES/63/241(2009).
1245
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/lessixviolationsgraves.pdf
(Consulté le 10/06/2015).; Bureau du Représentant spécial
du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), 32p.
1246 S/RES/1612 (2005).
1247 Le droit des traités relatifs aux droits de
l'homme s'applique à tout moment, mais certaines dispositions des
traités prévoient des dérogations en période
d'urgence. Voir par exemple, art. 4 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (1966).
452
En effet, la Cour internationale de justice (CIJ), ainsi que
plusieurs traités fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de
l'homme établissent clairement que le droit relatif aux droits de
l'homme n'est pas complètement supplanté par le DIH, et peut
toujours s'appliquer directement au cours d'un conflit : « La
protection offerte par les conventions régissant les droits de l'homme
ne cesse pas en cas de conflit armé, si ce n'est par l'effet de clauses
dérogatoires du type de celle figurant à l'article 4 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies. Dans
les rapports entre le droit international humanitaire et le droit relatif aux
droits de l'homme, trois situations peuvent dès lors se présenter
: certains droits peuvent relever exclusivement du droit international
humanitaire ; d'autres peuvent relever exclusivement du droit relatif aux
droits de l'homme ; d'autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux
branches du droit international1248 ».
Cependant, la rébellion armée,
déclenchée dans la nuit du mercredi 18 juin au jeudi 19 septembre
20021249, a provoqué, sans nul doute, les plus graves
violations de droits que la Côte d'Ivoire ait connues depuis son
indépendance. Cette nuit-là, les Ivoiriens s'étaient
réveillés sous les détonations de mitrailleuses, les
éclats d'obus, les secousses des rafales de kalachnikovs, d'armes
lourdes et automatiques. Ce qui était supposé être une
mutinerie des « zinzins » et «
Bahéfouè »1250 était en
réalité, une tentative de coup d'Etat qui s'était
muée
1248 CJI, « Legal consequences of the Construction of
a wall in the Occupied Palestinian Territory », Advisory Opinion, ICJ
Reports 2004, 9 juillet 2004. Voir CIJ, « Activités
armées sur le territoire du Congo (République démocratique
du Congo v. Ouganda) », jugement, Rapports CIJ 2005, 19
décembre 2005 ; CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), Comité des droits
de l'homme, commentaire général 29, states of Emergency (art.4) ;
E/C.12/1/Add.69, Observations finales du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels : Israel, 2001
1249 Au moment où cette rébellion armée
avait éclaté dans son pays, le Président Laurent GBAGBO
était en visite officielle en Italie. Rentrée
précipitamment, il prononça le discours suivant :
« Je suis rentré pour reprendre ma place à
la tête de l'Etat et à la tête des forces armées de
Côte d'Ivoire (...). Chers amis, ne vous y trompez pas, c'est la
Côte d'Ivoire qui est attaquée. Mon pays est attaqué. Mon
devoir est de faire front. Je suis donc rentré pour continuer la
bataille que les forces de l'ordre, de défense, de
sécurité ont entamée (...). Malgré toute notre
bonne volonté, on engage la guerre. Contre notre bonne foi, on engage la
guerre. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui : quiconque vient vers moi avec un
rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser, et je
l'embrasserai. Mais quiconque vient avec une épée, je sortirai
une épée et nous nous battrons (...). J'engage toutes les forces
de défense et toutes les forces de sécurité (...). Et que
la bataille commence (...). L'heure du patriotisme a sonné. L'heure du
courage a sonné. L'heure de la bataille a sonné. On nous impose
une bataille. Menons-la avec courage, avec détermination et honneur.
» Laurent GBAGBO, « Que la bataille s'engage », in
Le Patriote, Hors-Série, Edition Spéciale n°5.
Septembre 2003, p.3.
1250 Quand le général Robert GUEI était
devenu Chef de l'Etat, chef de la junte militaire, à la suite du putsch
de décembre 1999, il a rappelé dans l'Armée, pour sa garde
personnelle, environ 500 anciens militaires qui avaient été
déjà démobilisés. Ce sont ceux-là qu'on a
appelés les « Zinzins « et les Bahéfouès ».
Et, ces derniers auraient pris les armes pour manifester contre leur
démobilisation prévue au mois de décembre 2002. «
Zinzin »
453
en une rébellion armée soutenue par des
mercenaires et des puissances étrangères. Cette crise «
sans précédent »1251 a été
ponctuée par l'exploitation militaire des enfants (Paragraphe 1), ainsi
que des violations graves aux droits fondamentaux de l'enfant (paragraphe
2).
§ 1. L'EXPLOITATION MILITAIRE DE L'ENFANT DURANT
LE CONFLIT ARME IVOIRIEN
L'exploitation militaire des enfants au cours d'un conflit
n'est pas un phénomène nouveau ou spécifique à la
Côte d'Ivoire. Elle existait déjà en Europe et est
désormais interdite grâce aux législations internes des
pays1252. Malheureusement, elle ne fait que progresser dans les pays
en développement1253. Il en a été ainsi durant
le conflit ivoirien marqué par l'enrôlement des enfants (A)
à qui sont confiés des activités dont la nature et les
conséquences méritent d'être analysées (B).
A. L'ENROLEMENT DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES
Dans les années 1990, de nouveaux conflits ont vu le
jour, ainsi qu'une prolifération de nouveaux Etats revendiquant un
rôle à part entière sur le plan
international1254. Le nombre croissant des conflits de longue
durée qui affectent certains pays, notamment ceux de l'Afrique, causant
la perte de soldats adultes, les avancées technologiques en
matière d'armement, la prolifération d'armes
légères et faciles à manipuler sont autant de facteurs qui
ont contribué à un accroissement du recours aux enfants
soldats1255. Le plus souvent, les enfants soldats sont
âgés de 15 à 18 ans, mais le recrutement peut avoir lieu
dès l'âge de 10
est un mot français qui sert à qualifier un
individu bizarre, un peu fou. « Bahéfouè est un mot Akan,
utilisé tantôt comme nom, tantôt comme adjectif, et qui
signifie « sorcier ».
1251 GBAGBO (S.), « Adresse aux ivoiriens et Ivoiriennes
» In. Fraternité-Matin n°11388, du lundi 21 octobre
2002, p.10.
1252 BADIANE (S.), Les enfants aux deux bouts du fusil :
un défi majeur pour le système des Nations Unies et la
communautéì internationale, Presses
Universitaires de Dakar (PUD), 2004, 453p.
1253 C'est en Afghanistan, en Birmanie, en Afrique, Soudan au
Cambodge, en Colombie, au Guatemala, au Libéria, au Pérou, la
Birmanie, le Cambodge, le Guatemala, le Pérou et le Soudan, au Sri Lanka
et en Turquie que l'on utilise de façon massive les enfants dans les
conflits.
1254 AHLSTROM (C.), Victimes de conflits : rapport
destiné à la campagne mondiale pour la protection des victimes de
guerre, Département de recherches sur la paix et les conflits,
Université d'Uppsala, 1991, pp. 615.
1255 Constatation d'Olara OTTUNU, représentant
spécial du secrétaire général de l'Onu, lors du
débat sur la résolution 1260 du conseil de
sécurité, dans la nuit du mercredi 25 à jeudi 26
Août 1999, à New York. Voir
www.un.org (consulté le 20/05
/2012).
454
455
456
ans, voire même plus jeune : au Cambodge, en Sierra
Leone et en Ouganda, des enfants soldats avaient 5 ans1256. En
Côte d'Ivoire, de nombreux enfants endoctrinés ont pris part
volontairement aux hostilités tandis que d'autres sont enlevés
à leur famille pour être recrutés de force ou
obligés de rejoindre les forces armées1257.
1. L'embrigadement ou endoctrinement
idéologique et le recrutement volontaire des enfants
La conscription consiste à inscrire sur les rôles
de l'armée, des jeunes gens qui ont l'âge légal pour le
service militaire.1258 La conscription ou l'engagement
d'enfants de moins de 15 ans ou leur utilisation pour participer activement aux
hostilités tant dans des conflits armés non internationaux est
qualifiée de crime de guerre par le Traité de Rome instituant la
Cour Pénale Internationale1259. Selon le dictionnaire Robert,
l'action d'embrigader vise à « rassembler, réunir un
certain nombre de personnes sous une même autorité et en vue d'une
action commune ». L'embrigadement en soi n'est pas
nécessairement mauvais, sauf s'il accompagne d'une idéologie qui
l'éclaire, lui sert de motivation, de support ou de guide1260. Il ne
pose donc aucun problème lorsqu'il tend à réaliser les
principes inscrits dans la charte des Nations Unies, notamment dans son article
1er selon lequel, l'un des buts de l'ONU est de «
réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes d'ordre économique, social, intellectuel et
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion »1261.
L'embrigadement idéologique apparaît sous la
forme négative lorsqu'il empêche une éducation saine et
harmonieuse de l'enfant1262. Il y a embrigadement idéologique
de l'enfant
1256 Voir
www.savethechildren.org
(consulté le 15/02/2015).
1257 BADIANE (S.), Les enfants aux deux bouts du fusil :
un défi majeur pour le système des Nations Unies et la
communautéì internationale, Presses
Universitaires de Dakar (PUD), 2004, 453p.
1258
www.cntrl.fr/definition/conscription
(consulté le 15/02/2015).
1259
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1260 TORELLI (M.), La protection internationale des droits
de l'enfant , travaux du centre d'études et de recherche de droit
international et de relations internationales de l'Académie de droit
international, la Haye, 1979, PUF, 1983, p.147.
1261 PISIER-KOUCHNER (E.), « Protection de la jeunesse et
contrôle des publications », In. Revue internationale du droit
d'auteur, 1973, pp.55-159.
1262 Voir la Déclaration des droits de l'enfant des
Nations Unies, 20 déc. 1959.
chaque fois qu'une politique ou une pratique contraire
à un principe des Nations Unies tend à provoquer, à
maintenir ou à consolider un ordre social donné, ce qui peut
conduire à un esprit d'intolérance et d'incompréhension
pouvant être source de conflits sociaux majeurs1263.
Beaucoup d'enfants de moins de dix-huit ans rejoignent
volontairement les forces armées nationales ou les milices, pensant
trouver une meilleure sécurité1264. En effet, l'enfant
choisit de s'engager pour des raisons économiques, il considère
son engagement comme une opportunité financière, un moyen de
gagner sa vie, voire de s' « élever dans l'échelle
sociale et de parvenir ainsi à une certaine position sociale
», mais aussi pour des raisons sociales1265. La plupart
d'entre eux sont soit séparés de leur famille ou orphelins et
souhaitent venger leur famille après avoir été
eux-mêmes maltraités ou avoir été témoins de
mauvais traitements, soit sont issus de milieu pauvre et encouragés par
leurs parents à intégrer les forces armées1266.
Ces enfants sont les plus exposées à l'enrôlement, ils sont
souvent guidés par la recherche d'une stabilité et par l'espoir
de sortir de la pauvreté, d'autant que les groupes armés, pour
les attirer, promettent nourriture, un endroit où dormir, et un
réseau social1267. Pour les parties en conflit, l'enfant est
une proie facile à manipuler en raison de son incrédulité,
de son incapacité à comprendre la gravité de ses
actes1268.
En Côte d'Ivoire, le rapport du Secrétaire
général de l'ONU reconnait sans ambages que : «Toutes
les parties ont enrôlé ou utilisé des enfants lors du
conflit armé».1269
Amnesty International, dans un rapport publié en
20051270, reconnait que « dans l'Ouest de la Côte
d'Ivoire, depuis le début du conflit interne en septembre 2002,
plusieurs
1263 TORELLI (M.), « La protection internationale des
droits de l'enfant », op. cit., p.148.
1264 Voir rapport MACHEL (G.), « Impact des conflits
armés sur les enfants », Document ONU A/51/306, New York, 1996.
1265 ICRC, « Protocole facultatif à la Convention
des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des
enfants dans les conflits armés », Argumentaire du comité
international de la Croix-Rouge, Genève, 27 oct. 1997,
R.I.C.R., n°829, pp.113-132.
1266 Amnesty International, « L'engagement
volontaire dans les forces armées nationales des enfants n'ayant pas
atteint l'âge de 18 ans », in
www.amnestyinternational.be
(consulté le 15/02/2015).
1267 Voir rapport MACHEL (G.), op.cit.
1268 Amnesty International, « La République
démocratique du Congo : enfants en guerre », 9 sept. 2003, in
www.amnestyinternational.be
(consulté le 15/02/2015).
1269 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU "Les enfants et les conflits armés", DOC. ONU A/58/546-
S/2003/1053, p.11.
1270 Amnesty international, Rapport AFR 31/003/2005.
organisations non gouvernementales de défense des
droits humains ainsi que l'ONU ont signalé à de nombreuses
reprises des cas de recrutement et d'utilisation d'enfants-soldats par toutes
les parties au conflit ». Les parties au conflit ici visés,
sont notamment les forces gouvernementales d'une part et les forces rebelles
regroupées au sein des Forces Nouvelles, d'autre part.
De même, l'article 4(3) (c) du Protocole II relatif aux
conventions de Genève, qui gouverne les conflits armés non
internationaux, stipule que « les enfants qui n'ont pas atteint
l'âge de quinze ans ne doivent jamais être recrutés dans les
forces armées ou groupes armés ni être autorisés
à prendre part aux hostilités».
Malgré cette interdiction formelle des normes de droit
international, la conscription a malheureusement été une pratique
qui a toujours existé sur tous les continents ; une analyse historique
offre de noter que le recrutement de jeunes enfants ne concerne pas que les
pays en développement. En effet, des pays d'Europe, le Canada et les
Etats-Unis acceptent des enfants de moins de 18 ans1271. Par
exemple, des enfants soldats de 17 ans recrutés par la Grande Bretagne
sont morts à l'occasion de la guerre des Malouines en 1982, de la guerre
du Golfe en 1990/1991, et de la mission internationale de maintien de la paix
au Kossovo (KFOR)1272 en 1998 et 1999, malgré l'interdiction
des Nations Unies de recourir aux personnes de moins de 18 ans dans de telles
opérations.
Avant la Côte d'Ivoire, des campagnes d'enrôlement
des enfants, par le biais de la presse, des médias, mais aussi par
l'enseignement ou dans des mouvements de jeunesse1273 ont
été mis en oeuvre au Congo. Par exemple, le 7 août 1998, un
communiqué officiel diffusé par la radio nationale du Congo,
avait appelé les enfants et jeunes âgés de douze à
vingt ans à rejoindre l'armée congolaise, en réaction aux
récents mouvements de révolte contre le gouvernement
d'alors1274. Au Congo, les principales parties qui ont
recruté les enfants dans
1271
www.amnesty.asso.fr
(consulté le 15/02/2015).
1272 DORLHIAC (R.), « La supervision internationale
à l'épreuve du Kosovo indépendant », In. Bulletin
du maintien de la paix, Bulletin n° 95 Septembre 2009, pp.3-4.
1273 Voir Human Rights Watch, in
www.hrw.org/french
(consulté le 18 janvier 2015).
1274 Voir la condamnation de Human Rights Watch de
l'enrôlement des enfants dans les conflits armés et l'appel
à leur démobilisation, New York, 11 août 1998, in
www.hrw.org/french
(consulté le 20 Janvier 2015).
457
les conflits armés sont le RCD1275-Goma,
l'armée du gouvernement congolais, les Maï Maï, le
RCD-ML et les groupes armés en Ituri1276.
Les responsables militaires dans la crise ivoirienne ont aussi
eu recours à la conscription. En 2006, le HCR avait signalé
qu'une vingtaine d'enfants membres de la force supplétive du
LIMA1277 opérant aux côtés des FANCI, avaient
été recrutés dans le camp de réfugiés
libériens de Nicla, à l'ouest de la Côte
d'Ivoire1278. En effet, le conflit militaire ayant endeuillé,
ensanglanté et détruit le Liberia voisin à partir de
décembre 1989, avait forcé des milliers de Libériens dont
des enfants à fuir les combats et les exactions des factions en conflit.
Ce faisant, ces libériens fuyant la guerre ont trouvé refuge,
pour la plupart, dans les pays voisins avec qui, ils partagent d'ailleurs une
communauté de langue1279. Au nombre de ces Etats voisins,
figure en bonne place, la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour ces
1275 Rassemblement congolais pour la démocratie
(RCD).
1276 Voir Amnesty international, « Les principaux
partis qui recrutent les enfants soldats », 9 sept. 2003, in
www.amnestyinternational.be(
20 Janvier 2015).
1277
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1278 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU, sur"Les enfants et les conflits armés", DOC ONU
A/61/529- S/2006/826, p.6. ;
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1279 En effet, les GIO (ethnie libérienne) et les
Yacouba de Côte d'Ivoire parlent la même langue ; C'est le cas
également pour les Krahn (ethnie libérienne) et les
Guéré (Ethnie ivoirienne) parlent aussi la même langue ;
Avant de commencer sa révolution, Charles Taylor a recruté deux
cents hommes dans le Nimba qu'il a transformés en Forces
Spéciales. C'est dans la même province qu'il a
débuté sa guerre, avec un mouvement dont la composition
était à 90% constituée de Gio. C'était alors
l'heure de la vengeance contre les Krahn qui ont longuement été
leurs bourreaux. Après la mort de Doe, les Krahn se sont
regroupés au sein de l'Ulimo pour combattre Taylor. Le NPFL
majoritairement Gio et l'Ulimo majoritairement Krahn se sont ainsi
affrontés pendant sept ans sans qu'il y ait de vainqueur. Mais
après le recours aux urnes, c'est finalement Taylor qui l'a
emporté. Après les élections, les jeunes Krahn ont
massivement quitté le Liberia pour se réfugier dans la
région des Guéré dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Les Krahn et les Guéré parlent la même langue. De la
Côte d'Ivoire, les jeunes Krahn ont été recrutés en
grand nombre pour former la rébellion du LURD. Quand les jeunes Yacouba
ont formé le MPIGO pour venger Robert Gueï, ils ont
été épaulés par les Gio. Les Krahn, eux, sont alors
allés épauler les forces loyalistes pour stopper
l'évolution du MPIGO vers la région guéré. Comme
quoi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ainsi la rivalité Krahn-Gio
s'est déplacée en Côte d'Ivoire à une grande
échelle cette fois, avec d'un côté les Krahn et les
Guéré, et de l'autre, les GIO et les Yacouba. C'était donc
un nouveau volet de la crise ivoirienne car les forces libériennes
déployées dans l'ouest de la Côte d'Ivoire
échappaient au contrôle de leurs parrains respectifs. Celles du
côté du MPIGO n'acceptent pas les ordres de Félix Doh. Ils
n'hésitent d'ailleurs pas à ouvrir le feu sur les
éléments du MPIGO qui cherchent à les rappeler à
l'ordre. Quand ils rentrent dans un village ou une ville guéré,
c'est la terreur qu'ils y sèment. De même dans le camp des jeunes
Krahn qui combattent aux côtés des forces loyalistes : lourdement
armés, ils détruisent tout ce qui est Gio. Voir ZOOM DOSSO, RFI,
Le conflit tribal libérien resurgit en Côte d'Ivoire in RFI
20/03/2003 disponible sur :
www1.rfi.fr/actufr/articles/039/article_20889.asp
(Consulté le 20 Juillet 2016).
458
réfugiés libériens, au plus fort du
conflit ivoirien, les camps de réfugiés ont servi de viviers pour
les différentes forces en conflit en Côte d'Ivoire.
2. Le recrutement forcé ou obligatoire des
enfants
Alors que des enfants prennent volontairement part aux
hostilités, d'autres sont enrôlés de force par les
différents belligérants. Le recrutement des enfants peut en effet
se faire de façon violente tant par les armées
régulières que par les groupes d'opposition
armée1280. Le recrutement forcé et violent consiste
à enrôler, sous la menace, voir la violence, les nouvelles recrues
ou soldats : « Un grand nombre d'enfants sont embrigadés
après avoir été menacés. Les groupes armés
les enlèvent dans les rues, dans les villages qu'ils attaquent ou dans
leurs écoles»1281. En Côte d'ivoire, ce
procédé fut particulièrement usité par les groupes
rebelles ivoiriens, catégorie à laquelle appartiennent les Forces
Armées des Forces Nouvelles (FAFN)1282. Ainsi, dans un
rapport publié en 2002 sur la Côte d'Ivoire, Amnesty International
révélait que « des centaines de jeunes gens y compris
des enfants âgés d'à peu près quatorze ans avaient
été enrôlés dans les forces armées du
Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI) qui contrôle le nord
de la Côte d'Ivoire depuis le soulèvement armé de septembre
2002 »1283. Cette allégation a
été confirmée par l'ONG Human Rights Watch : «
Dans chaque unité libérienne de cinq ou six combattants
liée au MPIGO, il y avait habituellement au moins un enfant soldat,
souvent de dix à douze ans seulement, armé d'une mitraillette
». Mieux, cette ONG précise qu' :« En Côte
d'Ivoire, les rebelles se sont livrés à des exactions
généralisées à l'encontre des civils dans certaines
zones sous leur contrôle.
1280 La coalition belge contre l'utilisation des enfants
soldats, « Qui recrute les enfants soldats ? », in
www.enfant (Consulté le 22 janvier 2015).
1281 DHOTEL (G.), Les enfants dans la guerre, Edit.
Essentiels n°154, 1999, Milan Eds, p.38.
1282 Les Forces armées Forces Nouvelles est la
nouvelles appellation des différents mouvements rebelles nés
à l'origine et au cours du conflit mais qui se sont ensuite
fusionnés. Il s'agit notamment du :
MPCI : né de la crise qui a débuté le 19
septembre 2002, il est majoritairement formé d'éléments
originaires du nord musulman, mais ne se réclame pas d'une appartenance
ethnique et l'ensemble de la population ivoirienne y est
représentée. Bénéficiant du soutien d'officiers
supérieurs, et fort d'une dizaine de milliers de combattants, le
mouvement contrôlait la moitié nord du pays et une partie du
centre, soit 40% du territoire. MPIGO : Apparu le 28 novembre avec la prise de
la ville de Danané, près de la frontière
libérienne, il est majoritairement composé
d'éléments Yacouba, ethnie commune au Liberia et à la
Côte d'Ivoire.
MJP : Apparu conjointement le 28 novembre 2002 en revendiquant
la prise de la ville de Man, à l'ouest du pays, le MJP est limité
au grand ouest. Voir PIGEAUD (F.), France - Côte d'Ivoire, une
histoire tronquée, Vents d'ailleurs, 2015, pp.33-37.
1283 Amnesty International, Rapport AFR 31/003/2005.
459
Exécutions extrajudiciaires, massacres, tortures,
cannibalisme, mutilations, recrutement et utilisation d'enfants
soldats»1284.
L'enrôlement forcé d'adolescents était une
pratique courante au Guatemala, que ce soit dans les rangs de l'armée ou
des patrouilles de défense civile1285. De même, au
Congo, face à une recrudescence des attaques par les milices
maï maï, le RCD-GOMA avait lancé une campagne
intensive de recrutement au cours de laquelle, de nombreux enfants dont les
plus jeunes avaient 8 ans, ont été enrôlés souvent
contre leur gré : au Congo, des soldats du RCD-Goma, soutenus par le
Rwanda, ont enlevé de jeunes enfants sur le chemin de l'école ou
de l'église, voire dans leur propre maison, pour les amener dans des
camps d'entrainement militaire et les envoyer se battre au front aux
côtés des forces rebelles1286. En Ethiopie, les milices
ou la police parcouraient les rues pour recruter de force, le moindre jeune. Au
Burundi, un grand nombre d'élèves ont été
enlevés par les Forces pour la Défense de la Démocratie
(FDD) afin qu'ils servent comme soldats dans la guerre que le mouvement menait
contre le gouvernement du Burundi1287.
De peur de voir leurs enfants kidnappés, les parents
refusent de les envoyer à l'école ; d'autres
préfèrent faire diversion à l'arrivée des soldats
recruteurs pour permettre à leurs enfants de
s'échapper1288. Lors d'un communiqué de presse, la
conseillère principale pour la Division africaine de Human Rights
Watch (HRW), Alison Des Forges, a précisé que « les
soldats qui sont censés protéger ces enfants les enlèvent
et les envoient au front(...) »1289. A la suite de HRW, Amnesty
International constate que des milliers d'enfants sont enlevés et
contraints à se battre. Il cite l'exemple en Sierra Leone du groupe
armé d'opposition Revolutionary United Front (RUF, Front
Révolutionnaire Uni) créé par Foday Sankoh en 1989, et
l'Armed Forces Revolutionary Council (AFRC, Conseil Révolutionnaire des
forces armées) : plus de 10 000 enfants ont été
enlevés pour être soit utilisés comme esclaves
1284 HUMAN RIGHTS WATCH, "Prise en deux guerres : violence
contre les civils dans l'ouest de la Côte d'Ivoire", Août 2003
Volume 15, Rapport No. 14 (A), p.41.
1285 Voir
www.amnestyinternational.be
(consulté le 23 janvier 2015).
1286 HUMAN RIGHTS WATCH, « Congo : des enfants
enrôlés de force par un groupe rebelle », New York, 29
mai 2001, in
www.hrw.org( 23 janvier 2015).
1287 HUMAN RIGHTS WATCH, « Burundi :
enlèvement d'enfants pour des actions militaires », New York,
13 déc.2001.
1288 UNICEF, « Des milliers d'enfants se
réfugient en Guinée pour tenter d'échapper aux guerres qui
déchirent l'Afrique de l'Ouest », Genève, 4 nov.
2003.
1289 HUMAN RIGHTS WATCH, « Congo : des enfants
enrôlés de force par un groupe rebelle », op.cit.
460
sexuels, soit recrutés de force comme
soldats1290. Depuis 1991, les troupes de Foday Sankoh avaient
déclenché une guerre civile dans l'est du pays et
enrôlé les enfants pour faire main basse sur les diamants
sierra-léonais1291. En 1998, la Commission des droits de
l'Homme, dans sa résolution 1998/75 a dénoncé les
enlèvements d'enfants perpétrés dans le Nord de l'Ouganda
par l'Armée de résistance du Seigneur, et demandé la
libération immédiate de ces enfants
détenus1292.
Au-delà des frontières ivoiriennes et
africaines, de nombreux enfants grandissent avec la guerre et sont soumis au
recrutement forcé par diverses parties, comme en Afghanistan, au
Pakistan, en Sierra Leone, au Sri Lanka où le groupe d'opposition
armé des Tigres de la libération avait constitué des
bataillons composés presque uniquement d'enfants1293.
Que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, plusieurs
raisons peuvent expliquer le recrutement d'enfants. Il s'agit de renforcer les
effectifs, de minimiser les pertes de soldats réguliers et même de
réduire les coûts financiers de la guerre. Remplacer les soldats
tués ou blessés et renfoncer les effectifs est un
impératif pour les forces belligérantes. En effet,
«...plus un conflit dure, plus la probabilité qu'on fasse appel
à des enfants est grande. Il faut bien remplacer, à un moment
donné, les soldats adultes tués ou blessés. La plupart du
temps ces « remplaçants » sont des enfants parfois très
jeunes... »1294. En réalité, certaines familles peuvent
être menacées de confiscation de leurs biens ou de violences
physiques si elles refusent « d'offrir » leurs enfants
à la cause1295.
Cette pratique, quoique contraire aux règles du droit
international humanitaire et au droit des conflits armés,
présente des avantages militaires pour les belligérants :
« Les enfants constituent de la chair à canon bon
marché. On les paye moins cher que des adultes ...Un officier rebelle en
République Démocratique du Congo, opposé au
président Kabila, n'hésite
1290 AMNESTY INTERNATIONAL, « Sierra Leone »,
Bulletin d'information 202/00, 20 oct.2000.
1291 Voir
www.ridi.org ( 23 janvier 2015).
1292 HAUT COMMISSARIAT DES NATONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME,
« Enlèvement d'enfants du Nord de l'Ouganda »,
Résolution de la Commission des droits de l'homme 1998/75,
58e séance, 22 Oct. 1998.
1293 Voir
www.hrw.org/french(consulté
le 23 janvier 2015).
1294 DHOTEL (G.), op cit. p.39.;
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1295 COHN (I.), Goodwin-Gill (G.), « Child soldiers,
the Role of children in armed conflict », Oxford, Clarendon press,
1994, pp.50-51.
461
pas à dire : "Les
kadogos-[enfants-soldats] font de très bons soldats. Ils ne pensent
à rien. Ils obéissent, ne songent pas à retrouver leur
femme ou leurs enfants. Ils n'ont pas peur !...Ils pensent que se battre l'arme
à la main est un jeu, alors ils n'ont pas
peur."»1296
Que le recrutement soit volontaire ou forcé, il
s'avère contraire aux dispositions des instruments internationaux des
droits humains et du droit humanitaire. Une fois recruté, quelle est la
nature et les conséquences des activités de l'enfant
recruté ?
B. LA NATURE ET LES CONSEQUENCES DES ACTIVITES DE
L'ENFANT RECRUTE
L'enfant participe de différentes façons dans
les conflits (1). Mais, les conflits armés ont de graves
conséquences sur les enfants (2), qu'ils soient impliqués
directement ou indirectement.
1. Les différentes formes de
participation
Une fois recrutés de force ou volontairement, les
enfants sont éloignés de leur famille et transférés
dans des camps d'entrainement où ils apprennent à manier les
armes et suivent un entrainement physique intense, ainsi qu'un endoctrinement.
L'enfant participe de manière directe ou indirecte aux conflits.
Selon des commentateurs des Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève, « la participation directe aux
hostilités implique un lien direct de cause à effet entre
l'activité exercée et les coups qui sont portés à
l'ennemi, au moment où cette activité s'exerce et là
où elle s'exerce »1297. La participation directe
aux hostilités se distingue de la participation à l'effort de
guerre qui est souvent demandée à la population, à des
degrés divers1298. Ainsi, la grande majorité des
enfants sont forcés à prendre part aux combats, et sont parfois
amenés
1296 DHOTEL (G.), ibid.;
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016). 1297 SANDOZ (Y.), SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN
(B.) (éd.), « Commentaires des protocoles additionnels du 8
juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, CICR
», Genève, 1986.
1298 Ibid. 633. L'effort de guerre a été
défini comme « étant l'ensemble des activités
nationales qui, par leur nature ou leur but, doivent contribuer à la
défaite militaire de l'adversaire » (Actes XI, CDDH/III/SR.2,
p.15).
462
de force à se placer en première ligne. Leurs
missions consistent notamment à détecter les positions ennemies
et à servir d'appât, de garde du corps des
commandants1299.
En revanche, la participation indirecte comprend les actes
comme la recherche et la transmission d'informations militaires, le transport
d'armes et de munitions, la garde des exploitations de pétrole ou de
diamants, cuisinier, etc1300. Ces enfants insouciants sont
utilisés comme des espions qui traversent les lignes de front pour
recueillir de l'information sans grande difficulté parce que leur trop
grande jeunesse ne laisse soupçonner la mission dangereuse qui leur est
confiée. Et, lorsque leurs bras sont assez forts pour soutenir une arme,
«ils se retrouvent en première ligne ou sur des champs de
mines, souvent sacrifiés»13 ; Mieux, ils
constituent une sorte de sentinelles contre les attaques, parce que leur
réplique aux attaques ennemies alerte les soldats adultes dont l'on veut
préserver la vie parce que ces derniers coûtent chers.
A ces atouts que représente le recrutement
d'enfants-soldats pour les belligérants, l'on doit ajouter qu'ils sont
obéissants et dociles aux consignes et à la discipline
imposée par les adultes. Qui plus est, cet officier congolais justifiant
l'injustifiable énonce que : « Ils sont souvent inconscients
face au danger, ils désertent rarement et ne se plaignent
pas1301». Le témoignage de cet officier rebelle
congolais exprime bien, s'il en est encore besoin, les avantages pour les
forces belligérantes de recruter des enfants, quel que soit le
procédé. Ces enfants insouciants sont utilisés comme des
espions qui traversent les lignes de front pour recueillir de l'information
sans grande difficulté parce que leur grande jeunesse ne laisse
soupçonner la mission dangereuse qui leur est confiée. Cependant,
cette participation a eu un impact sur l'intégrité physique et
morale de l'enfant.
2. L'impact sur l'intégrité physique et
morale de l'enfant
L'enfant qui participe aux hostilités risque non
seulement la mort, mais il expose également à celle-ci les
personnes qui deviennent sa cible, du fait de son comportement
1299 République démocratique du Congo, «
Les enfants font la guerre », Amnesty international,
communiqué de presse du 9 mars 2003, AFR 62/036/2003.
1300 SANDOZ (Y.), SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN (B.) (éd.),
« Commentaires des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
conventions de Genève du 12 août 1949, CICR »,
Genève, 1986, p.925. 1301DHOTEL (G.), ibid.
463
immature. On peut citer l'exemple des enfants utilisés
dans des missions suicides1302. C'est en particulier la violence des
conflits et l'éloignement de leurs proches qui rendent vulnérable
l'enfant sur le plan physique et psychologique.
Les enfants soldats subissent d'abord des souffrances
physiques en raison des lourdes charges qu'ils doivent porter, mais aussi parce
qu'ils sont souvent en contact avec la drogue et l'alcool. Les filles, à
défaut de combattre, sont abusées sexuellement risquant des
grossesses non désirées ou d'être contaminées par le
virus du SIDA, voire dans certains cas données comme « femmes
» aux commandants militaires1303 et autres soldats.
Le peu de nourriture et les conditions dans lesquelles ils
vivent les affaiblissent davantage. Par exemple en Mozambique, entre 1981 et
1988, le conflit armé avait causé la mort de 454 000
enfants1304. Ils subissent non seulement les châtiments
corporels que leur infligent leurs supérieurs, mais ils peuvent
être aussi torturés, maltraités, voire
exécutés lorsqu'ils tombent aux mains de
l'ennemi1305.
L'enfant soldat subit également des traumatismes
psychologiques en raison des enlèvements, parfois violents, et de
l'éloignement de leur famille. De même, lorsque l'enfant est
forcé de commettre des atrocités, de tuer et de mutiler des
personnes, voire les membres de sa propre famille ou des voisins, il lui sera
difficile de retrouver un équilibre et de s'intégrer dans la vie
civile.
En dehors des enfants militairement exploités dans le
conflit ivoirien, le conflit ivoirien a également eu un autre impact sur
les enfants : celui de porter atteinte à leurs droits fondamentaux.
1302 Amnesty international a récemment condamné
l'utilisation d'enfants dans les attentats-suicides et autres attaques visant
des civils imputables aux groupes armés palestiniens, les qualifiant de
crimes contre l'humanité. Le 24 mars 2004, un palestinien
âgé de seize ans transportant des explosifs a été
intercepté, alors qu'il tentait de passer le poste de contrôle de
l'armée israélienne d'Huwara, à l'entrée de la
ville de Naplouse, en Cisjordanie. Voir également la Newsletter de la
coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats, Easy to
forget, easy to exclude, 11 mai 2004, in
www.childsoldiers.org
(Consulté le 21 Mars 2015).
1303 Voir HUMAN RIGHTS WATCH, « Données sur
les enfants soldats », in
www.hrw.org (21 Mars 2015). 1304 Voir
Rapport MACHEL (G.), op. cit. p. 54.
1305 Voir AMNESTY INTERNATIONAL, « Des milliers
d'enfants soldats » , op.cit., p 66.
464
§ 2. LES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS FONDAMENTAUX
DE L'ENFANT DURANT LE CONFLIT IVOIRIEN
Pour une bonne présentation de l'ampleur des exactions
commises à l'égard des enfants durant le conflit ivoirien, il
apparait opportun de distinguer successivement les graves violations des droits
de l'enfant commises en zone sous contrôle des forces rebelles (A) de
celles qui se déroulés en zone sous contrôle des forces
gouvernementales (B).
A. EN ZONE SOUS CONTROLE DES FORCES REBELLES
Dans la zone contrôlée par les rebelles, les
atteintes graves aux droits de l'enfant et au droit international humanitaire
perpétrées relèvent essentiellement des atteintes au droit
à la vie et l'intégrité physique. Il s'agit : des viols,
des traitements inhumains et exécutions sommaires, des charniers. On les
analysera successivement.
1. Des viols massifs
Le viol de guerre est considéré comme
illégal par le droit humanitaire depuis longtemps, les atrocités
sexuelles ont été ignorées par le tribunal de Nuremberg et
soulevées uniquement lors des procès de Tokyo1306.
Reconnaissant ce manquement lié au genre dans les poursuites pour crimes
de guerre, les groupes de défense des droits des femmes ont ardemment
combattu pour que ces crimes soient inclus dans le statut de Rome ainsi que
dans la TPIR et le TPIY. En résultat de ces efforts « le DIH et
le droit pénal international disposent désormais des
règles les plus féministes au monde en matière de punition
des viols et des violences sexuelles1307 »
Les rebelles, hommes sans foi ni loi, violaient
systématiquement et massivement les femmes, qu'elles soient mineures ou
majeures. Et, il convient de déplorer que beaucoup de
1306 MACKINNON (C.) , « Women's September
11th: Rethinking the international Law of conflict », Harvard
International Law Journal, vol.47 (2006), p.15.
1307 HALLEY (J.), « Rape in Berlin: Reconsidering the
criminalisation of rape in the international law of armed conflict », In.
Melbourne Journal of international law, vol.9, 2008, (citant les
propos d'Elisabeth Bernstein « La politique sexuelle des nouveaux
abolitionnistes », Differences : A Journal of feminist cultural
studies, vol.18, n°3, 2007, p.143.
465
filles à bas âge ont été,
déflorées, contraintes à perdre leur virginité.
Bénéficiant du climat d'insécurité et
d'impunité qui caractérise le contexte de conflit et de division
du territoire, les viols et autres violences sexuelles à l'égard
des enfants se sont développés. Plusieurs violations de droits se
trouvent regroupées dans cette énumération. Il y a d'une
part le viol à proprement parler qui est une infraction pénale
criminelle et d'autre part les autres violences sexuelles faites aux enfants
qui sont fermement condamnées par les Nations Unies1308.
Dans le cadre de son mécanisme de protection des
enfants et de suivi des violations des droits des enfants, l'Onuci a
rapporté plusieurs cas de viol commis sur les enfants et constaté
que « l'insécurité rampante et la
détérioration de l'infrastructure sociale et administrative qui
sont la conséquence du conflit ont notablement contribué au
niveau élevé de violence sexuelle à l'encontre des filles
et des femmes enregistrés en Côte d'Ivoire. Le climat
d'impunité des crimes sexuels a en outre exacerbé le
problème ».1309 Ledit rapport relève les cas
ci-après :
« a) Le 17 novembre 2005, une fille de 15 ans aurait
été violée dans un quartier de Belleville II
(Bouaké). Elle faisait partie d'un groupe de cinq filles ayant
confirmé aux spécialistes des droits de l'homme être
employées comme danseuses et prostituées dans le quartier
,
· b) Le 18 décembre 2005, une jeune fille de 17 ans aurait
été sexuellement agressée à Guiglo par neuf hommes
non identifiés. Selon les informations disponibles, l'enquête
ouverte par la gendarmerie n'a pas progressé ,
· C) Le 5 mars
2006, à Alépé, une fille de 15 ans a été
violée à plusieurs reprises par un élément du
Centre de commandement des opérations de sécurité (CECOS).
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie mais il semble
que celle-ci n'ait pas progressé ,
·
d) L'ONU s'est mise en relation avec les FAFN pour
exprimer ses vives préoccupations au sujet du viol d'une fille de 14
ans, survenu en mars 2006 à Bouaké alors que celle-ci
était détenue par les FAFN. L'affaire a conduit les FAFN à
donner un ordre de commandement à l'effet de libérer la fillette,
lequel est cité dans la section VI ci-dessous ,
·
1308 Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), pp.16-17.
1309 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte
d'Ivoire", Doc. ONU S/2006/835, pp. 7 et 8.
466
e) Le 26 juin 2006, les spécialistes des droits de
l'homme de l'ONUCI ont signalé qu'une écolière de 15 ans
aurait été violée par un élément des FAFN
à Danané. Un membre du personnel de l'école a
informé l'ONUCI du fait que les viols étaient courants dans
l'école mais que les parents préféraient garder le silence
par peur de représailles. »
A Bouaké, ville assiégée par les rebelles
depuis le 19 septembre 2002, les filles violées se comptaient par
centaines. Toutefois, le cas de K. Chantal1310, était
particulièrement poignant. Prise en otage par les rebelles, à
Bouaké, du Jeudi 19 septembre au mercredi 02 octobre 2002, elle a connu
l'enfer sur terre, subi les pires atrocités pendant treize (13) jours :
au vrai, elle a été violée à plusieurs reprises par
cinquante (50) hommes. Le témoignage de la victime est attristant et
émouvant : « c'était un calvaire (...). Ils abusaient de
moi à souhait et à volonté. J'ai été
violée par au moins une cinquantaine de personnes au total. A chaque
fois, c'étaient de nouvelles têtes qui abusaient de moi (...) sans
préservatif. C'étaient des personnes qui parlaient soit l'Anglais
soit le Bambara. Durant tout ce temps, je n'ai ni bu ni mangé (...) Les
assaillants ne se lavaient pas, sauf avec des mixtures supposées leur
apporter des forces surnaturelles »1311,
racontait-elle.
A l'Ouest, des jeunes filles qui ont été
violées se comptaient par milliers. Selon le rapport de Human Rights
Watch, autour de Zouan-Hounien, « il y a tellement de viols (...) on
n'en parle pas. Les rebelles commettent le viol devant le mari1312,
le font regarder puis le force à se mettre sur les genoux pour les
remercier »1313. Au regard des mariages précoces,
il apparait certain qu'au nombre des personnes violées, figrent des
enfants au sens du droit international.
A Man, des femmes et filles violées ont
été prises en otage et étaient devenues des «
épouses » des hommes de la rébellion. Ce sont elles
qui leur préparaient à manger. Mais, ce « mariage
forcé » était éphémère. En effet,
après une « vie conjugale » qui ne pouvait
excéder dix (10) jours, la rupture était toujours
consommée car les « maris » devaient aller combattre
ailleurs. Souvent, les mêmes femmes et filles subissaient les assauts
sexuels des hommes appartenant à un autre groupe de rebelles
remplaçant les précédents. C'est
1310 K. Chantal est un nom d'emprunt. Voir Soir Info
n°2440 du lundi 21 octobre 2002.
1311 Voir Soir Info n° 2449, du mardi 22 octobre
2002, p.4.
1312 Le mari était obligé d'assister à la
scène car s'il opposait un refus, il serait immédiatement
exécuté.
1313 Rapport de HUMAN RIGHTS WATCH in L'Inter n°1583
du mardi 19 Août 2003, p.7.
467
pourquoi, les « maris » jaloux tuaient
leurs « épouses » avant d'aller au combat. Ainsi,
dans la ville de Kouibly, des jeunes filles, au nombre de cinquante (50), qui
ont été enlevées et violées par des
rebelles1314 qui en ont fait leurs « épouses
», ont été, par la suite, « passées aux
armes »1315, avant le départ de leurs «
époux ».
Dans la zone rebelle, qui était une véritable
jungle, le viol en réunion exercé sur les filles mineures
était toujours pathétique, voire effroyable. Tel était
l'assaut sexuel subi par une petite fille de douze (12) ans, dans un petit
village situé entre Bangolo et Duékoué, à
l'écart de la route : elle avait été violée par
quatre (4) membres des forces rebelles parlant le Yacouba. Le témoignage
de sa tante est attendrissant : « ils ont violé ma
nièce, elle avait douze ans, une petite fille qui n'avait même pas
de seins. Elle pleurait mais ils l'ont quand même prise. Elle ne pouvait
même pas marcher après »1316, disait-elle.
A Guiglo, dans la sous-préfecture de
Péhé, une femme enceinte qui revenait du marigot, a
été aussi l'objet d'un viol en réunion
perpétré par six rebelles. Et, après l'avoir
violée, ils « ont piétiné son ventre alors
qu'elle portait une grossesse de deux mois, puis, ils lui ont introduit un
bâton dans le sexe. La grossesse est perdue »1317
Tous les faits ci-dessus rapportés sont constitutifs de
graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire. En effet, ce
sont des viols ou attentats à la pudeur accompagnés de prise
d'otages, de tortures, de traitements cruels, inhumains et
dégradants.
Or, aux termes de l'article 4 du 2ème
protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux, sont
prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des
personnes qui ne participent plus aux hostilités, « les
atteintes à la dignité de la personne, notamment, les traitements
humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la
prostitution et tout attentat à la pudeur ». En outre, les
articles 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale (C.P.I.)
disposent que « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité
comparable » constituent des crimes contre l'humanité et
des
1314 Ces rebelles seraient essentiellement des
Burkinabè et des Libériens. Voir Soir Info n°2626
des mercredis et jeudi 29 mai 2003, p.6.
1315 Idem.
1316 Rapport de HUMAN RIGHTS WATCH, In. l'Inter
n°1583, op. cit., p.6. 1317 Idem.
468
469
crimes de guerre en cas de conflit armé interne.
Dès lors, les viols commis de façon systématique et
massive, par les rebelles sont des crimes extrêmement graves, voire
imprescriptibles, relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale. A la vérité, le viol a, de tout temps,
été redoutable et redouté, car les victimes conservent les
séquelles qui en résultent pendant longtemps. Il provoque la
propagation de maladies sexuellement transmissibles, de graves traumatismes,
des grossesses, non désirées, la rupture des liens de
fiançailles et de mariage.
Outre le viol, d'autres violations inqualifiables des droits
de l'homme ont été commises à l'encontre des enfants, en
zone rebelle : ce sont notamment, les traitements inhumains et
exécutions sommaires.
2. Des enfants victimes de traitements inhumains et
d'exécutions sommaires
Les traitements inhumains et exécutions sommaires sont
expressément prohibés par le droit humanitaire.
A cet égard, en cas de conflit armé non
international, les forces gouvernementales et les insurgés sont tenus de
respecter un ensemble de règles minimales, appréhendées
comme des règles d'humanité. Ces dernières sont
principalement contenues dans les quatre conventions de Genève et leurs
protocoles additionnels.
Ces règles minimales régissant les conflits
armés non internationaux, prévues par l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève de 1949, sont complétées par
celles du deuxième protocole de 1977. Aux termes de l'article 4,
paragraphe 1er de ce protocole, « toutes les personnes qui
ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités,
qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect
de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques
religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants
». Son paragraphe 2 ajoute que sont prohibés, en tout temps et
en tout lieu, à l'égard des mêmes personnes : les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien-être
physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que
les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de
peines corporelles ; les punitions collectives ; la prise d'otage ; les actes
de terrorisme ; les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants, le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat
à la pudeur ; l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs
formes ; le pillage ; la menace de commettre tous ces actes
précités.
Quant au paragraphe 3 de l'article 4, il dispose que les
enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin. Notamment, ils
devront recevoir une éducation, y compris une éducation
religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en
l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ; ensuite, les enfants
de moins de quinze (15) ans ne devront pas être recrutés dans les
forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux
hostilités. A cet égard, des mesures seront prises, si
nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement
des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en
vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les
enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur
plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes
responsables de leur sécurité et de leur bien-être.
L'article 7 du même Protocole II de 1977énonce
que « tous les blessés, les malades et les naufragés,
qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés
et protégés. Ils seront, en toutes circonstances, traités
avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les
délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur
état. Aucune distinction fondée sur des critères autres
que médicaux ne sera faite entre eux ». Par ailleurs, les
circonstances le permettront, toutes les mesures possibles seront prises sans
retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les
naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais
traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour
rechercher les morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et
leur rendre les derniers devoirs1318 Le personnel sanitaire et
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires doivent
être aussi respectés et protégés1319
Les ouvrages contenant des forces dangereuses, comme les
barrages, les digues, les centrales nucléaires de production
électrique ne doivent pas être attaquées, lorsque de telles
pratiques peuvent causer des pertes sévères dans la population
civile.
1318 Article 8Protocole II de 1977.
1319 Articles 9 et 11Protocole II de 1977.
470
En vertu de l'article 13 du Protocole II, la population civile
et les personnes civiles jouissent d'une protection1320
générale contre dangers résultant d'opérations
militaires. Pour cela, ni la population civile1321, en tant que
telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont
interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de
répandre la terreur parmi la population civile. Seules les personnes
civiles qui participent directement aux hostilités, et pendant la
durée de cette participation, ne peuvent bénéficier de
cette protection.
L'article 14 dispose, en outre, qu'il est interdit d'utiliser
contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. C'est
pourquoi, il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de
mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la
survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les
zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les
installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation.
Aux termes de l'article 17 du même protocole II, les
déplacements forcés sont interdits. Le paragraphe 1er
de l'article 17 dispose à cet effet : « Le déplacement
forcé de la population civile ne pourra être ordonné pour
des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la
sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires
impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être
effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la
population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de
logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et
d'alimentation ». Quant au paragraphe 2 de l'article 17, il
énonce que « les personnes civiles ne pourront pas être
forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait
au conflit. »
Ces règles claires, expressément
exprimées, par l'article 3 commun aux quatre conventions de
Genève de 1949 et le deuxième protocole additionnel qui forment
le noyau dur du droit humanitaire, en matière de conflit armé non
international, n'ont guère été respectées en
Côte d'Ivoire.
1320 Conformément à l'article 16 du protocole
II, les biens culturels et les lieux de culte bénéficient
également de protection. En effet, il est interdit de commettre tout
acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les
oeuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou
spirituel des peuples et de les utiliser à l'appui de l'effort
militaire.
1321 La population civile est constituée par l'ensemble
des personnes civiles. Les personnes civiles ne sont pas porteuses d'armes et
ne participent pas aux combats ; en cas de doute sur le statut d'une personne,
elle est considérée comme civil.
471
A preuve, certaines régions du pays, qui ont
été occupées depuis le 19 septembre 2002, sont
parsemées d'ossements humains, de crânes et de squelettes humains,
en raison de multiples exécutions sommaires. Cette boucherie humaine en
zone rebelle, a commencé dans les villes de Bouaké et Korhogo
où des gendarmes, policiers et militaires ont été
exécutés sans ménagement. Selon M. Faustin TOHA «
le seul port de treillis était synonyme de mort (...). Pièces
d'identité arrachées, ils sont déshabillés et
ensuite c'est la rafale d'armes automatiques qui fait le reste
»1322. En outre, au centre et au nord de la Côte
d'Ivoire, les rebelles écumaient les villages et enlevaient les jeunes :
ceux qui refusaient d'être enrôlés étaient
automatiquement exécutés. L'enrôlement était
obligatoire, même pour les enfants mineurs de moins de quinze (15) ans :
il y a avait alors des enfants soldats dans les rangs des assaillants.
La situation était, à la vérité,
dramatique dans cette zone. Le culte du mort n'y était point
respecté à cause des nombreuses tueries, et aux
décès dus à la famine, aux intempéries et
endémies. Pire, les exécutions sommaires s'étaient
aggravées à partir du 26 octobre 2002 lorsque les villes de
Korhogo et Bouaké ont été
déclarés « zones de guerre » par le
Gouvernement ivoirien. En effet, outre les corps habillés, des civils y
compris les enfants ont été enlevés à leur
domicile, faits prisonniers puis exécutés par des
rebelles1323.
Pour libérer la ville de Bouaké, les forces
loyalistes ont lancé une offensive contre les rebelles les dimanches et
lundi 7 octobre 2002. Malheureusement, cette tentative de reconquête de
la capitale du centre s'est soldée par une défaite humiliante
pour l'armée régulière. Mais ayant découvert les
corps calcinés de leurs camarades, les rebelles s'en sont pris
violemment aux populations civiles, notamment aux résidents des
quartiers Ahougnansou, Nimbo, Broukro et N'gattakro. Avec des guides,
« ils sont entrés dans des cours où ils ont
exécutés les hommes, laissant les femmes et les enfants (...),
ont obligé plusieurs hommes en armes à se mettre nus et
défiler avec des cordes au cou »1324. A
1322 TOHA (F.), « Comment les rebelles exécutent
et torturent les soldats loyalistes », in La Bombe
n°586, du lundi 9 décembre 2002, p.3.
1323 KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Thèse unique de doctorat en droit public,
Université de Cocody, UFR SJAP, 2008, Tome 2, p.190.
1324 Voir L'Inter n° 130 du vendredi 11 octobre
2002, p.4.
472
Mankono, une famille1325 de treize
personnes a été entièrement exécutée alors
qu'elle célébrait des funérailles.
Le jeudi 26 décembre 2002, les élus et cadres du
Grand Centre1326 ont rencontré le Président Gbagbo
Laurent pour lui dresser le bilan des exactions et exécutions sommaires
perpétrées par les rebelles dans leur région. Il ressort
de ce bilan que de nombreux civils, des autorités traditionnelles et
politiques ont été enlevés, battus,
séquestrés, voire exécutés sans raison apparente.
Il ressort des propos de M. Jean Claude KOUASSI, Président du Conseil
Général de Bouaké, que la situation humanitaire dans le
grand Centre était particulièrement dramatique car les
exécutions arbitraires et extrajudiciaires étaient
aggravées par la famine et les épidémies : «
pénuries de denrées alimentaires et de produits de
première nécessité, de médicaments,
accentuée par la fermeture des banques, pharmacies (...),
l'impossibilité d'accès aux soins »1327.
A la vérité, l'extrême ouest de la
Côte d'Ivoire a payé le lourd tribut de cette « guerre
sale »1328 car, là-bas, l'horreur avait atteint son
paroxysme. En effet, dans cette zone, des torrents de sang ont coulé,
des êtres humains y compris des enfants ayant été
décapités ou égorgés comme des animaux. Il y a eu
des têtes perforées et écrasées, des bras et des
oreilles coupées, des pieds broyés par des roquettes, des organes
sexuels perforés ou arrachés, des langues coupées, des dos
tailladés1329.
A Toulepleu, dans le village de Seizimbly, Mme Vaha
Raymonde « qui portait une grossesse de 7 mois de son mari
Péhé Rigobert, a vu son ventre ouvert (opéré)
à la machette par les assaillants avant de l'égorger
1330». A Toa-Zéo, à six
kilomètres de Duékoué, les rebelles ont
jeté quatre jeunes gens dans un puits avant de les arroser de balles. En
outre, à Duékoué, des couples ont été
découpés à la machette ; et des corps non ensevelis ont
été dévorés par des chiens et des charognards. A
Bloléquin, des crimes effroyables ont été aussi
1325 Il s'agit de la famille de M. Amani TIEMOKO,
sous-préfet d'Anyama, Voir L'Inter n° 130 du vendredi 11
octobre 2002, p.4.
1326 Le Grand centre comprend : Dimbokro, Toumodi, Katiola,
Dabakala, Yamoussoukro, Bouaké, Tiébissou 1327 KOUASSI (J.-C.),
« C'est la faim qui fait fuir les populations », in 24 heures
n°188, du mercredi 16 octobre 2002, p.2.
1328 C'est une expression du Président Laurent GBAGBO.
1329 KOFFI (K. E.), Les droits de l'homme dans l'Etat de
Côte d'Ivoire, Thèse unique de doctorat en droit public,
Université de Cocody, UFR SJAP, 2008, Tome 2, p.192.
1330 Soir Info n°2531, des samedi 1er et
dimanche 02 février 2003, p.8.
473
commis. A titre d'exemple, les rebelles ont ligoté,
dans une case, six personnes avant d'y mettre le feu1331.
A Bohobly, gros village du département de
Toulepleu, déguisés en militaires FANCI, les rebelles ont
demandé au chef dudit village de réunir toute la population pour
un message du Président GBAGBO Laurent. Le Chef a alors convoqué,
avec empressement, tout le village, et ce, sont tous les villageois
réunis que les rebelles ont arrosés de balles, « tuant
près d'une centaine de personnes dont le chef »1332.
A Ziabli, aux environs de Man, les rebelles avaient
ligoté trois membres d'un comité d'autodéfense
composé d'enfants. Puis, à l'aide d'une corde, ils avaient
attaché leurs mains à un véhicule « qui avait
roulé à pleine vitesse pendant trois kilomètres. Puis les
rebelles ont égorgé l'un d'eux, ont décapité un
autre et ont fusillé par balle le troisième »1333.
Dans ces circonstances, l'ouest montagneux était devenu
un vaste cimetière où les cadavres jonchaient les brousses et
campements, les villes et villages, les pistes et routes, les puits et
marigots.
Selon l'agence catholique dénommée Agence
Misna, les atrocités commises par les rebelles sont
assimilables à des crimes contre l'humanité : «
exécutions sommaires, personnes âgées
brûlées vives dans leurs maisons, civils contraints à
enterrer leurs propres parents ou amis, cadavres jetés dans les puits
pour contaminer la source d'eau d'un village et le rendre inhabitable
»1334.
Ces violations graves et massives des droits de l'homme-enfant
et du droit humanitaire ont provoqué un exode forcé et massif des
populations vers les localités sous contrôle gouvernementale.
Hommes, femmes et enfants ont dû affronter les dangers et
intempéries pour échapper aux exactions et exécutions
sommaires quotidiennement et sauvagement perpétrées par les
bandes armées. Mais, certains fugitifs malheureux ont été
rattrapés et exécutés par les rebelles. Des femmes
enceintes ont été éventrées de façon
impitoyable. D'autres ont dû accoucher en pleine brousse, sans aucune
assistance médicale. Dans la
1331 Idem.
1332 KOHON (L.), « Massacre à l'ouest : des villages
incendiés, des habitants tués », in
Fraternité-Matin des
samedi 1er et dimanche 2 mars 2003, p.15.
1333 Rapport de HUMAN RIGHTS WATCH, in L'Inter
n°1583, op. cit., p.6.
1334 Voir Fraternité-Matin n° 11547 du mardi
6 mai 2003, p.14.
474
débandade, des vieillards et enfants ont
été abandonnés sur le chemin de l'exode, et des enfants se
sont égarés dans la forêt : de nombreuses familles
s'étaient ainsi disloquées.
Au fond, à l'Ouest, combattaient des acteurs multiples
: les forces régulières ou loyalistes, le MPIGO, le MJP, le MPCI,
les mercenaires libériens, les mercenaires sud-africains, les
mercenaires sierra léonais, le FLGO, les comités
d'autodéfense villageois luttant contre les pillards et les rebelles,
plusieurs petits mouvements de la rébellion libérienne, etc. Le
Ministre Roger BANCHI, chef rebelle du MPIGO, a alors avoué en mars 2003
: « La situation à l'ouest est hors de contrôle. Personne
ne peut dire exactement ce qui s'y passe »1335. Dans cet
imbroglio, l'ouest était devenu une véritable poudrière
où les morts se comptaient par milliers. La description de cette
situation chaotique dans le grand ouest par le Professeur BLEOU MARTIN est
extrêmement émouvante : « Les populations de l'Ouest de
la Côte d'Ivoire vivent une situation qui se confond en tous points avec
l'enfer (...) des rebelles ivoiriens, fortement appuyés par des
Libériens, pillent, violent, amputent, torturent ou tuent par centaines
et au quotidien les populations civiles. Les personnes qui parviennent à
se réfugier dans les forêts sont repérées
grâce à la fumée qui s'élève des feux
destinés à la cuisson de leur nourriture ; traquées, puis
rattrapées, ces personnes subissent les pires atrocités :
l'extermination. Livrées à elles-mêmes, sans protection ni
défense, les populations de l'ouest, qui n'ont pas réussi encore
à s'éloigner des zones sous contrôle rebelle, sont
aujourd'hui gravement menacées d'extermination »1336.
On le voit : les violations des droits et du droit humanitaire
subies par les populations des zones assiégées, notamment les
enfants, étaient effroyables et graves. Parce qu'elles étaient
sans protection et sans défense, ces populations avaient eu le sentiment
d'être abandonnées et oubliées1337. C'est
pourquoi, l'ex chef de l'Etat avait réagi le 31 décembre 2002 en
ces termes : « non, mes chers compatriotes, oublier les habitants du
nord, du centre et de l'ouest,
1335 Voir Fraternité Matin n°11547, du
mardi 6 mai 2003, p.14.
1336 BLEOU (M.), Déclaration de la LIDHO relative
aux massacres des populations civiles dans l'ouest du pays, le 28
février 2003, Abidjan.
1337 C'est dans l'attente angoissante, les cadres et Elus du
Grand Centre se sont indignés de la hiérarchisation des zones
occupées quant à leur libération : « Sakassou a
été occupée avant Daloa...S'il y a plusieurs Côte
d'Ivoire qu'on nous le dise et nous en tirerons les conséquences »,
ont-ils martelé sans passer par quatre chemins pour exiger du
gouvernement, la libération immédiate de Sakassou comme il l'a
fait pour d'autres villes de l'Ouest. Voir l'Inter n°1375 du
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2002, p.4
475
c'est oublier la Côte d'Ivoire elle-même. La
Côte d'Ivoire demeure une et solidaire (...) ; j'ai reçu ce pays
avec 322463 km2, je le rendrai à mon successeur avec 322463 km2
»1338.
Ce discours exprimant des sentiments de compassion et de
solidarité n'a pas permis aux populations des villes et régions
assiégées de recevoir la protection minimale attendue. Au
contraire, les atteintes au droit à la vie se sont aggravées,
avec la multiplication des charniers et fosses communes.
3. La découverte de charniers
d'enfants
Charniers contre charniers, massacres contre massacres : tel
fut le drame qu'a vécu la Côte d'Ivoire coupée en deux,
depuis le 19 septembre 2002 où des massacres et charniers se sont
multipliées aussi bien dans la zone rebelle que dans la zone
gouvernementale.
Dans la zone sous contrôle rebelle où
l'autorité du pouvoir central a fondu en quelques heures comme du beurre
au soleil, « des fils de ce pays aidés de mercenaires
étrangers et soutenus par des pays voisins et de nébuleuses
puissances financières » ont commis, quotidiennement, de
graves violations des droits de l'enfant. Dans l'offensive menée par les
troupes des FANCI pour faire cesser les exactions sans nom, sont survenues, en
cascade, de nombreux charniers et fosses communes découverts
çà et là.
Ici, nous évoquerons exclusivement le charnier
composé essentiellement des enfants, à l'exclusion des nombreux
autres charniers1339 qui ont été commis par les forces
en présence.
A deux kilomètres d'un village dénommé
BAOUBLI, gisait dans une rivière, un charnier composé
essentiellement d'enfants. Décrivant ces charniers, M. SERY BEAUGOSSE
affirme : « Dans l'eau, des corps sans vie flottent, entamés
par la décomposition et, rejetés par les poissons et toute la
faune carnivore des eaux, plus dégoûtés que repus par la
vue de ce spectacle horrible. Des corps sans visage, sans nom, pratiquement
nus, auxquels personne ne saura jamais donner une identité. Et, qui
n'auront peut-être jamais l'heure d'être enfouis dans une modeste
sépulture sont là, au grand air. Un peu plus loin sur la
terre
1338 Voir le Jour n°2313, du jeudi 2 janvier
2003, p.3.
1339 A Bouaké, un charnier de 86 corps a
été découvert par l'agence MISNA, agence de presse
catholique basée à Bouaké ; Il s'agit de tueries de civils
et de gendarmes commises dès les premiers jours de la rébellion.
Voir « Rapport d'Amnesty International », in L'Inter,
n°1442, du jeudi 27 février 2003, p.3-4 ; pour plus
d'informations sur les différents charniers, voir KOFFI Konan
Elisée, Les Droits de l'Homme dans l'Etat de Côte
d'Ivoire, thèse de doctorat, pp196-203.
476
ferme, apparaissent les squelettes de ceux qui furent
jadis des êtres humains »1340. Par ailleurs, dans la
plupart des villages, les puits ont été transformés en
tombes, des corps humains y ayant été jetés ; ce qui a
posé de sérieux problèmes d'eau potable.
Relativement, aux charniers susvisés, gisant en nombre
indéterminé dans la zone sous contrôle rebelle, et
constituant des violations extrêmement graves des droits de l'enfant et
du droit humanitaire, une question majeure et récurrente se pose,
à savoir : Qui sont les auteurs d'un tel carnage ? Ou encore qui a
causé ce charnier composé d'enfants ? A priori, on pourrait
penser que les rebelles sont responsables de ces tueries
perpétrées en zone rebelle. Or, pour montrer aux yeux de
l'opinion internationale et nationale qu'ils n'ont rien à se reprocher,
ces derniers avaient demandé l'ouverture d'une enquête
internationale, et ce pour situer les responsabilités. De l'autre
côté, les autorités régulières ivoiriennes
d'alors s'étaient dégagées de toute responsabilité
en invoquant que la localité qui a été le
théâtre du carnage était sous la responsabilité des
forces rebelles. A cet égard, le lieutenant YAO YAO, Ex-porte-parole de
l'état-major des FANCI avait affirmé : « les forces
républicaines ne se sentent pas concernées par cette affaire. Ces
tueries ne peuvent qu'être imputées aux assaillants (...) dont les
méthodes sont connues de tous »1341.
Face à cette situation où chacune des parties en
conflit niait sa responsabilité dans ces massacres
perpétrées à l'endroit des enfants, seule une
enquête fouillée, rigoureusement diligentée, permettrait de
déterminer, avec netteté, les responsables de ces nombreuses
tueries et exactions. Malheureusement jusqu'à ce jour, aucune
enquête émanant d'une juridiction nationale ou internationale
comme la CPI n'a pu permettre de situer les responsabilités des auteurs
de ce carnage de nombreux enfants.
1340 SERY (B.), « Un charnier découvert à
Fengolo (Duékoué) », in L'oeil du Peuple
n°337, du lundi 16 juin 2003, p.6.
1341 Voir le Patriote 2002, n°986 du lundi 9
décembre 2002, p.2.
477
Ces crimes sus analysés peuvent être
qualifiés de crimes de génocide1342, de crimes contre
l'humanité1343 ou de crimes de guerre1344.
Il suit de ce qui précède que les graves
violations du droit à la vie et à l'intégrité
physique commises en zone rebelle font partie des crimes les plus graves (qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale) relevant de la
compétence de la Cour pénale internationale.
Dans la zone assiégée où il n'y a ni
police, ni gendarmerie, ni justice, la crise militaro-politique ivoirienne a eu
des effets extrêmement néfastes, avec son cortège de
violations graves et massives des droits fondamentaux des enfants. En zone
gouvernementale, la situation n'a pas non plus été rose : il s'y
est également produit des violations graves des droits ayant
plongé les enfants dans les profondeurs abyssales du
désespoir.
B. EN ZONE SOUS CONTROLE GOUVERNEMENTALE
A l'instar de la zone rebelle, la zone gouvernementale a
été le théâtre d'atteintes graves aux des droits de
l'enfant. Plusieurs personnalités1345 importantes du pays y
compris l'ex
1342 En effet, aux termes de l'article 6 du Statut de Rome, on
entend par crime de génocide l'un des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel :
« Meurtre de membres du groupe; Atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; Soumission
intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle; Mesures visant
à entraver les naissances au sein du groupe; Transfert forcé
d'enfants du groupe à un autre groupe. »
1343 Quant à l'article 7, il dispose « qu'il y a
crime contre l'humanité lorsqu'il est commis, dans le cadre d'une
attaque généralisée et systématique lancée
contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, l'un des
actes suivants : meurtre, extermination, réduction en esclavage,
déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou
autre forme de privation grave de liberté physique en violation des
dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage
sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable, disparitions
forcées de personnes, autres actes inhumains de caractère
analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale... »
1344 Selon l'article 8 du même statut de Rome, il y a
crime de guerre, lorsqu'il a été commis des infractions graves
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, notamment l'un
quelconque des actes suivants visant des personnes protégées par
les dispositions des Conventions de Genève : l'homicide intentionnel, la
torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou
à la santé, etc.
1345 Déjà, au lendemain de cette tentative de
coup d'Etat du 19 septembre, le Ministre d'Etat chargé de la
Défense et de la Protection civile, Monsieur LIDA Kouassi Moise, avait
fait état de plus de deux cent soixante-dix (270) morts, dont
quatre-vingt (80) loyalistes et trois cents (300) blessés. Parmi ces
personnes tuées, il y a : Me Emile Boga DOUDOU (Ministre d'Etat de
l'intérieur et de la décentralisation, fidèle compagnon du
Président Laurent GBAGBO) dont le domicile a été
littéralement bombardé à coups de lance-roquettes ; M.
478
chef d'Etat, le Général Robert
GUEI1346 et des membres de sa famille ont été
exécutées dès les premières heures. Certes, les
atteintes aux droits commises à l'égard des enfants qui y ont
été commises sont d'origines diverses. Mais, il convient de
retenir ici celles perpétrées par les milices privées,
celles résultant des affrontements interethniques ou
intercommunautaires, et celles afférentes à l'opération
dignité qui se sont révélés particulièrement
meurtrières.
DAGROU LOULA (Lieutenant-colonel, commandant de base à
Bouaké) ; M. DALY OBRE ( colonel des FANCI) ; M. ADAMA DOSSO (Capitaine,
chef de sécurité du Président du RDR) ; M. COULIBALY
Fabien (Capitaine, aide de camp du Général Robert GUEI) ; M.
Robert GUEI ( Général, ex-chef d'Etat-Major des FANCI, ex-chef de
la junte militaire, ex-chef d'Etat durant la transition militaire de 24
décembre 1999 au 20 octobre 2000), son épouse GUEI Doudou Rose,
quelques membres de sa famille et une dizaine de gardes rapprochées
furent également tués.
1346 Une semaine avant le jour fatidique du 19 septembre, le
général GUEI a animé une conférence de presse
à Abidjan où il a fustigé le comportement du
Président GBAGBO et du F.P.I. en ces termes :
« Face aux nombreux problèmes des Ivoiriens, le
F.P.I. nous avait promis des solutions miracles. Aujourd'hui, les choses sont
devenues pires qu'auparavant. Les opérateurs économiques sont
écrasés par la pression fiscale. Certains ont même
déjà fui pour aller s'installer dans les pays voisins. Et
pourtant, le F.P.I. criait hier sur tous les toits, promettaient bonheur, bonne
gouvernance, transparence et bien-être à tous, dès la prise
du pouvoir. Les paysans attendent toujours les 3000 FCFA le kg de café.
Dans certaines régions aujourd'hui, le kilogramme est à 75 FCFA
(...). Chaque Ivoirien a quotidiennement (...) sa dose de farine.
Dans les journaux, on lit tous les jours « GBAGBO a
roulé GUEI dans la farine », « GBAGBO a roulé ADO dans
la farine », « GBAGBO a roulé BEDIE dans la farine ».
Quel est donc ce chef d'Etat qui se transforme en boulanger pour pétrir
toujours la farine, et pour rouler tout le monde dans cette farine. Le pain se
fait, vous le savez, avec de la levure. Et ce que le F.P.I. ne doit pas
oublier, c'est qu'un jour, cette même farine sans levure sociale va lui
boucher les narines et la gorge, parce qu'elle sera pétrie par le peuple
qui sait ce que GBAGBO ne sait pas.
Le peuple n'est pas dupe. Les Ivoiriens sont
écrasés par le poids de l'insécurité et de la
pauvreté, ce que le F.P.I. combattait hier. Le pouvoir F.P.I.
arrête des citoyens, les emprisonne, les torture sans l'ombre d'une
preuve et sans égard pour le respect de leurs droits fondamentaux (...).
Aujourd'hui, on invente des scénarios de tueries. Et on tue
réellement pour créer des veuves et des orphelins. Dès
qu'un Ivoirien n'est pas d'accord avec une certaine façon de voir les
choses, il est curieusement agressé quelques jours plus tard. Quel est
ce régime qui ne craint même pas Dieu et pourtant organise
à longueur d'années, séminaires, retraites et groupes de
prières (...). Où allons-nous ? (...) le F.P.I. qui moralisait
hier la société ivoirienne vient d'aggraver la pauvreté
des parents d'élèves. De 6000 FCFA de frais d'inscription, on
passe à 50 000 FCFA, c'est-à-dire une augmentation de 833% (...).
Laurent GBAGBO a déjà oublié qu'il était le
dictionnaire vivant des Ivoiriens. C'est avec lui que les Ivoiriens ont appris
à mémoriser les mots « briser », « casser »,
« tuer », « braiser », « démissionner »,
« bloquer », « marcher », « boycott actif »,
« frapper les professeurs ». Aujourd'hui, c'est le même Laurent
GBAGBO qui n'aime pas le désordre. On interdit les marches (...).
Après avoir critiqué Yamoussoukro et Daoukro,
GBAGBO a transformé Mama en Yamoussoukro et Daoukro bis en moins de deux
ans (...) comme quoi la critique est aisée et l'art difficile (...).
Pendant que les ivoiriens ont faim, pendant que les parents
d'élèves et d'étudiants sont soucieux du sort de leurs
enfants avec des frais d'inscription trop élevés, voilà
que le père de la Refondation est à la plage, ne faisant que
jouer aux cartes, au football et s'offrant des repas copieux. Voilà ce
qu'est devenue la Côte d'Ivoire d'HOUPHOUET (...). Je lance un appel
vibrant à tous les partis politiques de rester vigilants » Voir
Le Jour n°2228 des samedi 14 et dimanche 15 septembre 2002,
p.2.
479
1. Des atteintes aux droits de l'enfant imputables aux
milices privées
La typologie des milices1347 (a)
décrite, on s'attèlera à présenter leur
mode opératoire et son impact sur les droits de l'enfant
(b).
a. La typologie des milices et leurs
caractéristiques durant la crise
Pendant la crise ivoirienne, un autre phénomène,
tout aussi redoutable que répréhensible a vu le jour : les
milices privées. Elles ont poussé comme des champignons :
Groupement des Patriotes (GPP), Front de Libération du Grand Ouest
(FLGO), Alliances des Patriotes Wê (A.P.W.E.), Union Patriotique de
résistance du Grand Ouest (U.P.R.G.O), Mouvement Ivoirien pour la
Libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire (M.I.LO.C.I.), etc.
L'appui aux opérations militaires est le fait de ces milices, en
l'occurrence celles notoirement connues qui bénéficient du
programme de désarmement-démobilisation-réinsertion.
Nées dans les régions où les forces
régulières ont le plus essuyé des défaites au
début des hostilités, ces milices constituent entre autres, une
réserve pour ces forces qui ont démontré leur
incapacité à endiguer seules et repousser les offensives rebelles
de fin 2002.
En 2005, « le FLGO, le MILOCI, l'APWE et l'UPRGO dans
l'ouest (Guiglo) à l'ouest du pays ont libéré 400 enfants.
Toutefois, selon une tendance inquiétante observée dans la
région, les partenaires de la protection de l'enfance au Libéria
et en Côte d'Ivoire ont signalé que des enfants avaient
été recrutés ou ré-recrutés, de l'autre
côté de la frontière qui sépare le Libéria et
la Côte d'Ivoire, par des groupes armés qui opèrent en
Côte d'Ivoire.»1348.
Comme toute milice, ces milices portaient visiblement des
armes. Mieux, elles ont même revendiqué leur prise en charge dans
le processus de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion. Parmi les membres de ces milices, figuraient des
enfants1349. La réinsertion
1347
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(consulté le 10/06/2016).
1348 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et les conflits armés, Doc. ONUA/61/529-
S/2006/826 du 26 octobre 2006, p.7. ;
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(consulté le 10/06/2016).
1349
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(consulté le 10/062016).
480
apparait ici, comme un moment clé qui consiste à
trouver, pour tous les enfants démobilisés, une alternative
viable à la vie militaire. Cela signifie leur donner accès
à l'enseignement, à une formation professionnelle, à un
emploi, etc.1350 « Il faut s'assurer qu'on soit capable de leur offrir
un avenir, que l'on soit capable de rouvrir les écoles. Et donc il faut
investir dès maintenant dans un plan de démobilisation des
enfants. Mais surtout un plan de démobilisation qui va s'accompagner
d'une réinsertion de ces enfants dans la vie active »1351.
A côté de ces milices militaires, ils existaient
aussi de groupements politiques que nous qualifions de « milices
politiques ». Bien qu'elles ne soient pas officiellement
désignées milices, le mode opératoire de ces groupes
amène à s'interroger sur leur typologie. Ces groupes utilisent
des méthodes d'actions violentes à savoir :
- Attaques contre les troupes de maintien de la paix, du
personnel1352 et des biens des Nations Unies ;
- Sabotage des infrastructures et des symboles du pouvoir en
place, ou des partis adverses ;
Toutes ces milices opéraient dans la zone
gouvernementale, parfois au vu et au su de tous, y compris des autorités
nationales politiques et militaires du pays et ce, malgré l'impact
négatif de leurs modes opératoires sur les enfants et leurs
droits.
b. L'impact des modes opératoires des milices sur
les enfants
Les milices utilisaient plusieurs méthodes. Au nombre
de ces modes opératoires figuraient des massacres de populations, des
occupations d'écoles et centres de santé, des
1350 FOFACK (E.-W.), « Les enfants victimes des conflits
armés : pratiques et lutte en Afrique », Note d'Analyse du
GRIP, 3 Aout 2015, Bruxelles, p.12.
1351 HAZARD (E.), cité dans « RCA : entre 6000 et
10 000 enfants soldats dans les groupes armés », RFI,
19 décembre 2014 (consulté le 12 mars 2016).
1352 L'interdiction de diriger une attaque contre les casques
bleus est une règle du droit international humanitaire coutumier, voir
règle 33, droit international humanitaire coutumier, CICR ; Article 8
(2) (b) (iii) du Statut de Rome de la CPI.
481
manifestations violentes et des attaques contre les forces de
maintien de la paix et des blocages des convois du système des Nations
Unies et des ONG1353.
- Les massacres et assassinats des
enfants1354
«L'expansion au sein de l'armée et
l'utilisation de milices mal ou non entraînées se sont
révélées désastreuses pour la population civile,
qui a subi des atteintes quotidiennes aux droits
humains».1355 Ces milices équipées en toutes
sortes d'armes légères identifiaient les présumés
"infiltrés" et les châtiaient. Ces châtiments consistaient
en des exécutions sommaires ou des disparitions forcées.
Plusieurs cas de disparitions ont été à tort ou à
raison imputés à ces milices qui utilisent aussi des enfants
enrôlés dans leurs rangs. En 2005, selon un rapport d'Amnesty
International «...des membres du Mouvement de libération de
l'ouest de la Côte d'Ivoire (MILOCI), une milice progouvernementale ont
lancé une attaque sur la ville de Logoualé (à 450 Km au
nord-ouest d'Abidjan) contre des positions tenues par les Forces
Nouvelles...Parmi les combattants interceptés par l'Opération des
Nations Unies en Côte d'Ivoire, se trouvaient deux enfants,
âgés de dix et onze ans apparemment d'origine
libérienne».1356 Pendant leurs opérations,
ces milices ont enregistré des meurtres et mutilations notamment sur les
enfants en raison de leur fragilité1357.
Les meurtres et mutilations d'enfants interviennent aussi dans
un contexte de tensions intercommunautaires liées au conflit. Des
milices progouvernementales et les forces armées des forces nouvelles
(FAFN) auraient soutenu des ethnies qui s'affrontent violemment sans
épargner les enfants1358 ; Des cas de violations rapportés par
les Nations Unies l'illustrent:
1353
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1354
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-
dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016). ; Bureau du
Représentant
spécial du Secrétaire général pour le sort des
enfants en temps de conflit armé, Les six violations graves commises
envers les enfants en temps de conflit armé : Fondements
juridiques, Octobre 2009 (mis à jour en novembre 2013), pp14-15.
1355 HUMAN RIGHTS WATCH, Côte d'Ivoire : le
coût de l'impasse politique pour les droits humains, rapport du 21
décembre 2005, p.8.
1356 Amnesty International, Rapport AFR 31/003/2005. ;
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1357 Ibid.
1358
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
482
« a) Le 21 avril 2005, plusieurs assaillants non
identifiés ont exécuté une famille de l'ethnie Yacouba
à Petit Logouale (dans la zone de confiance). Deux enfants, un
garçon et une fille, et leur père ont été
tués à la machette, tandis que leur mère a
été abattue ;
b) Le 1er juin 2005, des assaillants non
identifiés ont attaqué les villages de Guitrozon et Petit
Duékoué, où vivent principalement des membres de l'ethnie
Guéré. Il a été signalé que 41 personnes,
dont 3 nourrissons, avaient été tuées dans une maison ;
que le ventre d'une femme enceinte avait été ouvert à la
machette à Guitrozon; et que plusieurs maisons avaient été
incendiées alors que les occupants, dont plusieurs enfants,
étaient encore à l'intérieur. Peu après ces
attaques, le 6 juin 2005, sept membres de l'ethnie Dioula, dont quatre enfants,
auraient été exécutés par des individus non
identifiés dans le quartier de Latif et Cokoma ;
c) Le 16 avril 2006, le bataillon ghanéen a
escorté la police des Nations Unies au village de Bania, dans la zone de
confiance, où des membres de la communauté ont identifié
un individu accusé d'avoir tué deux enfants dans le cadre
d'activités de sorcellerie ;
d) Le 28 juin 2006, six personnes, dont un enfant d'un
an, ont été tuées par des assaillants non
identifiés dans le village de Boho, à 29 kilomètres de
Bangolo. Cette attaque faisait suite à la découverte, le 24 juin
2006, des corps de deux enfants burkinabés dans le village de
Duekpé1359. »
Comme le montre ce rapport, par leurs actions, les milices ont
porté atteinte au droit à la vie de plusieurs enfants ; il en va
de même des droits à l'éducation et à la
santé qui ont été ruinés par une constante
occupation des écoles et centres de santé durant la crise
ivoirienne. - Une occupation des écoles et centres de
santé, une pratique préjudiciable à
l'enfant
Les écoles et les hôpitaux sont des institutions
civiles offrant souvent un abri et une protection aux enfants en période
de conflit1360. Les attaques perpétrées contre les
écoles et
1359 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire", Doc.
ONU S/2006/835 du 25 octobre 2006, pp. 5 et 6.
1360 Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), p.18.
483
hôpitaux1361 contreviennent en principe au
droit international humanitaire, et peuvent constituer des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité1362. La quatrième
Convention de Genève proscrit le ciblage de biens à
caractère civil, mettant l'accent sur l'importance des écoles et
des hôpitaux pour la population civile, en particulier, les
enfants1363. Le ciblage intentionnel des écoles ou
hôpitaux sans impératif militaire est interdit au nom du principe
juridique de distinction, à savoir que les biens à
caractère civil doivent être distingués des objectifs
militaires et protégés contre les conséquences des
opérations militaires. Il s'agit là d'une règle
coutumière du droit international applicable à toutes parties
dans les situations de conflit1364. La protection offerte aux
écoles et aux hôpitaux est globale : selon le droit coutumier
international et le droit des traités, une partie au conflit doit
s'abstenir de cibler ou d'attaquer des écoles et des hôpitaux
situés au sein de ses propres populations civiles ou de celles
situées sous son contrôle1365. Le ciblage ou la
destruction délibérés des écoles ou des
hôpitaux (ou d'autres biens de caractère civil) peuvent constituer
de graves violations du droit des conflits armés1366. La
protection générale accordée aux écoles et aux
hôpitaux comporte une unique exception : « à moins et
aussi longtemps qu'ils constituent des cibles militaires », autrement
dit, s'ils sont utilisés à des fins militaires1367. En
outre, le droit international humanitaire précise que si, dans la
confusion de la guerre, un doute existe quant
1361 Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), pp.19-21.
1362 HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.),
Droit international humanitaire coutumier, tome I : Règles,
Bruylant/CICR, 2006, p46.
1363 Art.11 et 18 de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 48 du
premier protocole additionnel aux conventions de Genève. Ainsi, l'art.
48 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève dispose
que : « ...les Parties au conflit doivent en tout temps faire la
distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu'entre les
biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par
conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs
militaires ».
1364 Art. 48 et 52 du premier protocole additionnel aux
conventions de Genève ; règle coutumière 7, HENCKAERTS
(J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire
coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p. 34. ; Art. 48
et 52 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art.
13, 1) du deuxième protocole additionnel aux conventions de
Genève ; CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires.
1365 Règles coutumières 10 à 22,
HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.), op. cit. p. 46 ; art. 50 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre (pour les puissances occupantes).
1366 Art. 147 de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 85 du
premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; règles
coutumières 10-13, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.),, op.cit.,
p.46.
1367 Ibid. ; art. 52 du premier protocole additionnel aux
conventions de Genève.
484
à savoir si une école ou un hôpital
constitue un objet militaire ou civil, la présomption de base reste
qu'un bâtiment normalement destiné à des usages civils
demeure un bien de caractère civil1368. La Cour
internationale de justice a également déclaré la
protection des civils et des biens de caractère civil d'une importance
primordiale au titre du droit international humanitaire1369. De
même, le TPIY a développé une solide jurisprudence sur la
nécessité de protéger les écoles et les
hôpitaux de toute attaque, par exemple dans les affaires Kupreskic
(2000) et Kordic et Cerkez (2001)1370. Le
statut de Rome étend la responsabilité pénale pour ces
actes, en prévoyant la compétence explicite de la CPI pour
poursuivre ou punir ceux qui dirigent intentionnellement des attaques contre
les écoles ou les hôpitaux lors des conflits armés. Ces
actes constituent des crimes de guerre indépendamment de savoir s'ils se
produisent durant un conflit armé ou non1371. Dans sa
résolution 1998 (2011) adoptée en juillet 2011, le Conseil de
sécurité a demandé instamment aux Etats parties au conflit
de s'abstenir de toutes actions entravant l'accès des enfants à
l'éducation, et a demandé en particulier au Secrétaire
général de poursuivre la surveillance et le suivi concernant
l'utilisation des écoles à des fins militaires1372.
L'utilisation des écoles à des fins militaires expose les enfants
aux attaques et entrave leur droit à l'éducation ; mieux elle,
entraîne des taux élevés d'abandon scolaire, en
particulier, parmi les filles. Elle peut également conduire à la
prise pour cibles d'écoles lors des attaques. En novembre 2012, un
groupe d'experts composé de représentants d'Etats membres,
d'organisations régionales, d'experts militaires, d'acteurs de la
protection de l'enfance, de spécialistes de l' éducation, ainsi
que de juristes du droit international humanitaire et du droit international
des droits de l'homme ont élaboré les Projets de lignes
directrices de Lucens pour la protection des écoles et des
universités contre l'utilisation militaire durant les conflits
armés, en dégageant une
1368 Art. 15 et 52 du premier protocole additionnel aux
conventions de Genève ; art. 9 à 11 et 18 du deuxième
protocole additionnel aux conventions de Genève.
1369 CIJ (1996), Licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires.
1370 Affaires Kupreskic (2000) et Blaskic (2000). Dans
l'affaire Kupreskic, le TPIY a déclaré : « les attaques
délibérées lancées contre les civils ou biens de
caractère civil font l'objet d'une interdiction absolue par le droit
international humanitaire. » Dans l'affaire Blaskic, la Chambre
d'appel du TPIY a déclaré l'accusé coupable d' «
attaques intentionnelles dirigées contre les biens de
caractère civil ».
1371 Art. 8, 2), b et 8, 2), e du Statut de Rome.
1372 S/RES/1998 (2011) ;
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998(2011)
( consulté le 14/02/2016).
485
série de principes soumis à l'aval des
gouvernements1373. Ces lignes directrices visent à
accroître la connaissance et la compréhension, et à
améliorer la surveillance et le suivi, tout en prônant une
législation nationale claire et explicite sur l'interaction des forces
militaires avec les écoles et les élèves, ainsi
qu'à intégrer ces lignes directrices dans la formation et la
doctrine militaires. En dépit de ces interdictions consignées par
les normes internationales, la situation déjà préoccupante
du droit à l'éducation de l'enfant, a été
aggravée par l'occupation des centres scolaires et de santé
à la faveur de la crise par des hommes en armes.
Ainsi, les milices militaires présumés
progouvernementales se sont emparées de certaines écoles et
centres de santé et en ont fait leur base. Le 12 juin 2006, une centaine
d'éléments d'une milice connue sous le nom de Groupe des
patriotes pour la paix (GPP) a occupé un centre pour enfants, le centre
de l'école pilote d'Adjamé, une commune populaire
d'Abidjan ; Cet incident a empêché les enfants de se rendre dans
ce centre en cette période. « L'occupation a duré
jusqu'au 17 juin 2006, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Gendarmerie
nationale intervienne, après de fermes condamnations et des efforts de
sensibilisation concertés des Nations
Unies...»1374. Cette occupation a privé ces enfants
de leur droit à l'éducation. Le Ministère de la famille et
des affaires sociales avait aussi déclaré qu'en 2003, le
même groupe de miliciens avait aussi occupé l'Institut de
formation et d'éducation féminine, un centre de formation
professionnelle pour jeunes filles toujours situé à
Adjamé. L'occupation avait duré jusqu'en 2005,
année durant laquelle, prenant ses responsabilités,
l'armée gouvernementale officielle (FANCI) a expulsé le GPP et
pris possession des locaux1375.
A l'instar des milices proches de l'ancien régime
ivoirien, dans la partie nord de la Côte d'Ivoire,
précisément, dans les zones anciennement sous contrôle des
rebelles appelés forces nouvelles, l'occupation et la destruction des
infrastructures scolaires a empêché pendant plusieurs
années, l'organisation des cours et examens de fin d'année. Ce
n'est qu'en 2006
1373 Global Coalition to Protect Education from Attack ,
Questions et réponses sur les lignes directrices pour la protection des
écoles et des universités contre l'utilisation à des fins
militaires durant les conflits armés, 2014, 11 p.
1374 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte d'Ivoire",
Doc. ONUS/2006/835 du 25 octobre 2006, p.6. ;
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1375
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
486
que l'organisation des examens a été rendue de
nouveau possible dans le nord, après des efforts de sensibilisation
concertés des Nations Unies1376. De même, de nombreux
sites hospitaliers servaient de camps aux forces ex-rebelles ; ce qui
n'était pas sans conséquences sur la qualité et la
quantité de soins à administrer aux enfants vivant sur ces
territoires occupés.
Il s'agit, dans ces différents cas, d'atteintes graves
au droit à l'éducation1377 , au droit aux soins de
santé1378reconnu aux enfants dans la convention relative aux
droits de l'enfant.
Outre cela, des enfants ont été acteurs ou
victimes des manifestations et attaques violentes contre les forces de maintien
de la paix.
- Des enfants acteurs et victimes des manifestations
et attaques violentes contre les forces de maintien de la paix
Les enfants sont souvent utilisés par l'Alliance des
Jeunes Patriotes pour le sursaut national, groupe présumé
favorable au FPI, dans de violentes manifestations de masse organisées
dans les territoires sous le contrôle du Gouvernement, au cours
desquelles ils courent le risque d'être tués ou
blessés1379. Ainsi «...des enfants sont
utilisés comme barricades humaines pour bloquer l'accès des
soldats de la paix des Nations Unies au cours des épisodes de violence,
en particulier dans les territoires sous contrôle du Gouvernement. Le 26
juillet 2005, au lendemain des attaques d'Agboville et d'Anyama, une importante
foule organisée, comprenant plusieurs enfants et des femmes portant un
bébé sur leur dos, a ainsi bloqué un convoi militaire de
l'ONUCI à Petit Yapo, empêchant tout accès à ces
zones.»1380. Parfois, ces méthodes ont conduit
à des incidents qui ont occasionné un bilan humain très
lourd y compris dans les rangs des mineurs. « C'est ainsi aussi qu'en
janvier 2006, une manifestation de masse à Guiglo, au cours de laquelle
des soldats de maintien de la paix des
1376
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1377 Article 28 CIDE.
1378 Article 24 al. 2.b) CIDE.
1379
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2015).
1380 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte
d'Ivoire", Doc. ONUS/2006/835 du 25 octobre 2006, p.3.
487
Nations Unies ont aussi été attaqués,
s'est soldée par la mort de cinq Ivoiriens, dont deux enfants
âgés de 14 et 16 ans »1381.
La protection du personnel humanitaire et de son
équipement constitue l'une des plus anciennes maximes du droit des
conflits armés1382. Le personnel humanitaire, son
équipement et les bâtiments ou autres objets qu'il utilise
bénéficient d'une protection spécifique en vertu des
Conventions de Genève et de leurs protocoles
additionnels1383. Les parties au conflit doivent garantir toute
liberté de circulation au personnel humanitaire autorisé, soumis
aux seuls impératifs militaires1384. Les transports et moyens
médicaux sont spécifiquement fournis avec d'autres protections,
considérées comme faisant partie du droit international
coutumier1385.
- Les blocages des convois humanitaires
destinés aux enfants : le refus d'accorder à un accès
à l'aide humanitaire
Le refus de l'accès à l'aide humanitaire aux
enfants et les attaques contre les travailleurs humanitaires1386
assistant les enfants est prohibé par la quatrième convention de
Genève et ses protocoles additionnels1387. Ce refus de
l'accès ou de ces attaques peuvent constituer un crime de guerre et un
crime contre l'humanité1388. En outre, selon un principe du
droit international coutumier, les parties au conflit doivent autoriser et
faciliter l'aide pour les
1381 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte
d'Ivoire", Doc. ONU A/61/529-S/2006/826, p.7.
1382 Voir, par exemple, art. 15 de la Convention de la Haye
(1907).
1383 Art. 70, 4) et 71, 2) du premier protocole additionnel
aux conventions de Genève ; art. 18, 2) du deuxième protocole
additionnel aux conventions de Genève.
1384 Art. 60 et 61 Genève IV ; art. 71 du premier
protocole additionnel aux conventions de Genève ; art. 18 du
deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève ;
règle coutumière 56, HENCKAERTS (J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir.
Publ.), Droit international humanitaire coutumier, tome I :
Règles, Bruylant/CICR, 2006, p.267.
1385 Règles coutumières 31 et 32, HENCKAERTS
(J-M) et DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire
coutumier, tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p. 267.
1386 Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), pp.23-24.
1387 Art. 23, 142 de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 54, 70
et 77 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève ; art.
14 et 18 du deuxième protocole additionnel aux conventions de
Genève.
1388 Art. 8, 2), b et 8, 2), e du statut de Rome.
488
personnes civiles dans le besoin, soumises à leur
contrôle1389. La fourniture de ces secours doit être
impartiale et conduite sans aucune distinction de caractère
défavorable, par exemple basée sur la race, l'âge ou
l'apparition ethnique1390.
L'autorisation de porter secours à une population
civile, notamment aux enfants, ne saurait être refusée par une
partie au conflit de manière arbitraire. De même, chaque partie
doit s'abstenir de toute entrave délibérée à
l'envoi de secours à des populations civiles dans le besoin dans des
régions tombées sous son contrôle1391. Le
conseil de sécurité, l'Assemblée générale et
le Conseil des droits de l'homme ont condamné à plusieurs
reprises ces entraves1392. L'accès des organismes des Nations
Unies aux enfants touchés par les effets néfastes de la crise
ivoirienne, n'était généralement pas entravé, sauf
dans les zones où des hostilités et des violences
imprévisibles périodiques ont éclaté. C'est ainsi,
par exemple que dans la ville de Guiglo à l'ouest du pays, la prestation
de services aux enfants a été très problématique
pendant plusieurs mois en raison des violents incidents de janvier 2006, lors
desquels le personnel onusien a été évacué
après l'attaque de soldats de la paix des Nations Unies par une foule
nombreuse, dans laquelle se trouvaient des enfants1393. Priver les
enfants de l'accès à l'aide humanitaire peut violer plusieurs
droits fondamentaux, notamment le droit à la survie et le droit
d'être à l'abri de la faim, droits fondamentaux exercés par
tous1394. Mieux le refus d'autoriser l'accès à l'aide
humanitaire engage la responsabilité pénale, même en temps
de guerre.
- Les enlèvements
d'enfants
1389 Règle coutumière 55, HENCKAERTS (J-M) et
DOSWALD-BECK (L.) (dir. Publ.), Droit international humanitaire coutumier,
tome I : Règles, Bruylant/CICR, 2006, p. 34 p.258. Art. 55 de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre.
1390 Ibid ; art. 23 de la convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; art. 70, 2)
du premier protocole additionnel aux conventions de Genève.
1391 Art. 23 et 55 Genève IV ; art. 70, 3) du premier
protocole additionnel aux conventions de Genève.
1392. Voir par exemple, résolution 824 (1993) du
Conseil de sécurité, résolution 55/2 de l'Assemblée
générale, résolution 1995/77 de la Commission des droits
de l'Homme.
1393
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10./06/2015).
1394 Voir par exemple, art. 11 et 12 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; art. 6 de la
Convention relative aux droits de l'enfant.
489
L'enlèvement d'enfant1395 se définit
comme le « fait de déplacer, soit par fraude ou violence, soit
sans ces circonstances des mineurs de l'endroit où elles se trouvaient
ou dans lequel ils avaient été régulièrement
placées, qui constitue, dans ce dernier cas, une soustraction
d'enfant... ».1396 Il s'agit d'un acte
répréhensible prévu et puni par le code pénal
ivoirien en ses articles 370 à 372. L'article 370 en son alinéa
1er dispose : «Quiconque, par fraude ou violence,
enlève sous quelque forme que ce soit des mineurs des lieux où
ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels
ils étaient soumis est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans
et d'une amende de 500 000 à 50 000 000 de francs». La
tentative est également punissable. A l'instar des autres violations
graves des droits de l'enfant, cette pratique a fait l'objet d'une ferme
condamnation dans la résolution 1612 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies1397.
De même, la Convention relative aux droits de l'enfant,
en son article 35 dispose in fine : « Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit ». Dans le contexte de crise ivoirienne, plusieurs cas
d'enlèvements de mineurs ont été enregistrés et
rapportés par les Nations Unies.1398 Le rapport des Nations
unies indique les cas suivants :
1395 Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), pp.21-22.
1396 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF,
10e édition mise à jour, « Quadrige » :
2014, p. 400. ; Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), pp.21-22.
1397 En 2005, la Résolution 1612 du Conseil de
sécurité sur les enfants et les conflits armés a
créé le Mécanisme de surveillance et de communication de
l'information sur six violations graves commises contre des enfants en
situation de conflit armé par des forces ou groupes armés :
recrutement ou utilisation d'enfant, enlèvements d'enfants, meurtres ou
mutilations d'enfants, vols ou autres actes graves de violence sexuelle,
attaques contre des écoles ou des hôpitaux, refus d'accès
à l'aide humanitaire. L'objectif de cette résolution est
d'assurer la collecte systématique d'informations objectives,
précises et fiables sur les violations graves commises contre des
enfants en situation de conflit armé...menant à des
réponses éclairées, concertées et efficaces pour la
protection et la prise en charge des enfants...et pour assurer le respect des
normes et standards internationaux en matière de protection des
enfants.
Voir ég.
https://www.memoireonline.com/12/11/5005/La-protection-de-lenfance-dans-les-pays-africains-sortant-dune-crise-armee--cas-de-la-Cte-dIv.html#_Toc312218851
(Consulté le 10/06/2016).
1398 Rapport du Secrétaire général de
l'ONU sur "Les enfants et le conflit armé en Côte
d'Ivoire", Doc. ONU S/2006/835.
490
« a) Le 15 juin 2005, une fillette de 12 ans a
été enlevée à Korhogo (nord de la Côte
d'Ivoire) et amené au Mali, où elle a été
contrainte à se marier. Son père se serait apparemment rendu au
Mali dans l'espoir de la libérer, mais il aurait été
menacé par les ravisseurs et le mari, qui lui aurait dit qu'il serait
arrêté par les autorités maliennes s'il ne quittait pas le
pays ,
·
b) En avril 2006, un écolier de 8 ans a
été enlevé à Abidjan, dans la commune de Marcory.
Il a eu les yeux arrachés lors de ce qu'on soupçonne être
une pratique rituelle ,
·
c) En juillet 2006, la gendarmerie nationale basée
à Agboville, en zone gouvernementale, a arrêté un certain
nombre d'individus soupçonnés de faire partie d'un réseau
de traite et de vente d'enfants. Trois suspects de sexe féminin ont
été appréhendés dans l'opération et quatre
enfants enlevés, âgés de 2 à 5 ans, retrouvés
séquestrés sur les lieux. Après enquête, la
gendarmerie a arrêté un homme qui semble être le cerveau et
le meneur du réseau. L'affaire est en attente de jugement
».
Ces cas qui témoignent de l'ampleur du
phénomène ont été favorisés par la
porosité des frontières, le climat conflictuel,
l'insécurité et la détérioration des structures
sociales et administratives.
En zone gouvernementale, l'opération dignité a
aussi entrainé de graves violations des droits de l'enfant et du droit
humanitaire.
491
CONCLUSION DU TITRE 1
Il ressort de tout ce qui précède que les droits
de l'enfant sont loin d'être effectifs en Côte d'Ivoire. Ils sont
malmenés aussi bien par les particuliers que par les pouvoirs publics,
aussi bien en temps de paix, notamment dans les centres de détention,
qu'en période de troubles ou de conflit armé. Ces sont des
violations qui portent atteinte à l'intégrité physique et
morale des enfants. Ces violations constituent des atteintes à
l'intégrité physique parce qu'il peut en résulter des
coups et blessures sur la personne du mineur. Elles constituent aussi des
atteintes morales parce qu'elles laissent subsister des séquelles
morales faites de traumatismes au niveau des enfants victimes.
Dans un pays candidat à l'émergence, l'atteinte
portée aux droits de l'enfant suscite une réaction
épidermique1399. La Côte d'Ivoire est un pays où
les droits de l'enfant se portent mal. En effet, la réalité sur
le terrain nous met à l'évidence du fait que la République
de Côte d'Ivoire est loin d'avoir gagné le pari de rendre
effectifs les droits de l'enfant sur son territoire. Quels en sont les causes
profondes ? Et comment y faire face ? Ce sont ces interrogations qui
constitueront la trame de notre analyse dans le point suivant portant sur les
conditions d'une effectivité améliorée.
1399 PHILIPPE(X.), « Le contrôle de
proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative françaises », P.U.A.M., Economica,
1990, p.342. Pour VERDIER (J-M.), Libertés et travail,
Problématique des droits de l'homme et rôle, D. 1998 chron.
p.63, face à une atteinte aux libertés, « le sentiment
est vif de la commission d'un acte grave ». Selon P. ROUBIER au
contraire, « les masses populaires (...) demeurent indifférentes
à la lésion du droit des autres » ; « L'ordre juridique
et la théorie des sources du droit », in Etudes RIPERT (G.),
LGDJ, 1950, p 9s, spéc. p.22). Dans le même sens : LECLERQ
(J.), Leçons de droit naturel, t. I, Le fondement du droit
et de la société, éd. Wesmael, 3e
éd. 1947, n°33), pour qui la plupart des individus « ne
discernent l'injustice que lorsqu'ils en sont victimes, et, en
réalité, ne sont pas mus par la
justice ». ;
https://www.humanium.org/fr/cote-d-ivoire/
(consulté le 17/12/2017) ;
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=5114
(consulté le 17/12/2017).
492
Titre II : LES CONDITIONS D'UNE EFFECTIVITE
AMELIOREE
493
Que faire ? Comment y faire face ? : Telles sont les questions
fondamentales qui se posent face aux manifestations préoccupantes de
l'ineffectivité des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire.
Proposer des solutions, c'est supposer une pluralité de
problèmes minant l'effectivité des droits de l'enfant, et le
problème est celui des droits de l'enfant en crise en Côte
d'Ivoire. La crise de l'effectivité des droits de l'enfant est
multidimensionnelle. C'est-à-dire juridique, politique,
économique, institutionnelle, morale, individuelle et communautaire.
L'État de Côte d'Ivoire n'a jusqu'à ce jour, pas pu
apporter des solutions à tous les problèmes auxquels il aurait
dû apporter des solutions appropriées ; en bien des cas, il les a
aggravés, en accentuant les distorsions, les écarts et les
déséquilibres entre les prescriptions internationales et les
réalités locales. L'évidence est là, qui commande
de réorganiser les actions de l'État. La nécessité
des ajustements est devenue évidente pour espérer aboutir
à une effectivité optimale ou améliorée.
La crise des droits de l'enfant, qui affecte
profondément la Côte d'Ivoire au point d'en constituer une des
caractéristiques au même titre que le sous-développement
auquel elle est d'ailleurs intimement liée, appelle des
préconisations de mesures en faveur d'une effectivité
améliorée (Chapitre 2). Mais, celles-ci
supposent que soient identifiées au préalable, les causes
principales de l'ineffectivité de ces droits fondamentaux de l'enfant
(Chapitre 1).
494
Chapitre I :
L'IDENTIFICATION DES CAUSES D'INEFFECTIVITE DES
DROITS
FONDAMENTAUX DE L'ENFANT
En Côte d'Ivoire, l'ineffectivité des droits de
l'enfant comme des droits de l'homme résulte d'une imbrication de
plusieurs facteurs1400. Certains sont visibles et apparents ;
d'autres sont sournois, mal connus, cachés, détectables seulement
à partir d'études approfondies et rigoureuses. Pour les besoins
de clarté, on aurait pu les regrouper en deux catégories : les
facteurs juridiques et les facteurs extra-juridiques. Toutefois, une telle
option nous aurait conduit à un plan difforme, les données
extra-juridiques étant plus nombreuses. Aussi, aux fins de mieux cerner
les causes d'ineffectivité des droits fondamentaux de l'enfant, nous
aborderons successivement, les causes tenant à la complexité des
règles internationales de protection des droits de l'enfant et à
la conclusion tardive des conventions internationales par la Côte
d'Ivoire (Section 1), les causes de l'ineffectivité du
droit à la survie, au développement et à la participation
des enfants (section 2), avant d'examiner les causes des abus
contre toute forme de protection des enfants (section 3).
1400 MADIOT (Y.), Considérations sur les droits et les
devoirs de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1998, p.166
ss.
495
SECTION I. LES CAUSES TENANT A LA COMPLEXITE DES
REGLES INTERNATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT ET A LA CONCLUSION
TARDIVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Une des difficultés d'application des droits de
l'enfant promus et protégés par les normes internationales et
régionales de protection des droits de l'enfant découle du
caractère conditionné de la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels (DESC)1401. Ce
particularisme des DESC est clairement affirmé à l'article 4 de
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui dispose :
« Les États parties s'engagent à prendre toutes les
mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
disponibles,... ». Quant à la Charte africaine des droits et
du bien-être de l'enfant, elle n'a pas adopté la même
démarche, qui consiste à viser clairement et de façon
générale tous les droits économiques, sociaux et
culturels. Elle y va article par article. Ainsi, peut-on lire par exemple
à l'article 13 alinéa 2 et 3 que : « Les États
parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des
ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé et
à ceux qui sont chargés de son entretien, l'assistance qui aura
été demandée et qui est appropriée compte tenu de
la condition de l'enfant... » ; À l'article 20 al. 2 de la
même Charte, on peut lire ceci :
« Les États parties à la
présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation
nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) Assister les parents ou autres personnes responsables
de l'enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes d'assistance
matérielle et de soutien, ...
b) Assister les parents ou autres personnes responsables
de l'enfant pour les aider à s'acquitter de leurs tâches
vis-à-vis de l'enfant,...
c) Veiller à ce que les enfants des familles
où les deux parents travaillent bénéficient
d'installations et de services de garderie.
1401 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, p.257.
496
Ces deux normes, d'une certaine manière demandent les
efforts des États parties dans la limite « des ressources
disponibles » pour la mise en oeuvre de certains droits de l'enfant.
Cependant, nous allons nous focaliser sur le cas de l'article 4 de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CIDE), non
seulement à cause de son caractère universel, mais aussi à
cause des éléments d'analyse qu'offrent les organes des Nations
Unies comme le Comité des droits de l'enfant et le Conseil
économique et social1402. Nous verrons donc comment l'article
4 de la CIDE pourrait être interprété comme un obstacle
à l'effectivité des droits de l'enfant au regard des
conséquences de l'article 4 de la CDE sur la réalisation des
droits de l'enfant (Paragraphe 1). Aussi, les
réticences de l'Etat ivoirien à l'égard des conventions
internationales relatives aux droits de l'enfant expliquent également
l'ineffectivité partielle de ces droits au regard de la conclusion
tardive des instruments internationaux par le pays (Paragraphe
2).
§ 1. ANALYSE DE L'ARTICLE 4 DE LA CIDE COMME
FACTEUR EXPLICATIF DE L'INEFFECTIVITE DES DROITS DE L'ENFANT
A la lecture de l'article 4 de la Convention des Nations unies
relative aux droits de l'enfant, le premier élément qui
interpelle est la distinction entre la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels et les autres droits. Ainsi, peut-on
lire : «Dans le cas des droits économiques, sociaux et
culturels, ils [États] prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources disponibles,...». Or, nulle part dans la convention, une
distinction claire n'est opérée entre cette catégorie de
droits et d'autres. Les droits civils et politiques ? Sans doute. Car, c'est
à ce jour, les deux principales catégories de distinction en
droits humains matérialisées par les deux pactes de
19661403. Cette distinction de ces droits peut partiellement
expliquer l'ineffectivité des droits sociaux et économiques. De
même, subrepticement, l'article 4 de la CDE n'apparait-il pas comme une
violation du principe de la-non-discrimination, se muant par là
même en vecteur d'ineffectivité des DESC-enfants ?
1402 BELLO (S.), La traite des enfants en Afrique,
L'application des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant
en République du Bénin, L'Harmattan 2015, pp.257.265.
1403 Ibid.
497
La Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant ne distingue pas explicitement entre les droits civils et politiques
et les droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant.
Néanmoins, la spécification faite pour la mise en oeuvre des
droits économiques, sociaux et culturels par les rédacteurs de la
Convention traduit une volonté de distinction entre ces deux
catégories traditionnelles des droits humains. Ceci nous ramène
aux divergences idéologiques et politiques qui ont amené
l'Assemblée des Nations Unies à adopter les droits de
DUDH1404 en deux pactes distincts, caractérisés par
une hiérarchisation des droits humains1405. En effet, les
droits du PIDCP1406 étaient considérés comme
des droits de la première génération alors que les droits
du PIDESC1407 étaient considérés comme les
droits de la deuxième génération, donc secondaires dans
leur mise en oeuvre.
En effet, si d'un côté : « Les
États parties s'engagent à prendre toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour
mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans
le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces
mesures dans toutes les limites des ressources disponibles, [...]
». Cela nous amène à croire que ce deuxième
libellé n'a pas la même portée juridique que la
première phrase de l'article : « Les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la présente Convention. [...] ». Le
caractère impératif et obligatoire de tous les droits reconnus
dans la Convention ne ferait aucun doute dans la première formulation,
tandis que la formulation de l'article 4 de la CIDE laisse apparaitre
subtilement, le caractère conditionné d'une certaine
catégorie de droits contenus dans la Convention : les droits sociaux,
économiques et culturels. Ceci nous confirme la distinction
opérée dans les deux pactes de 1966.
Or, si la doctrine, en matière de droits de l'homme,
est restée unanime sur le caractère obligatoire des droits civils
et politiques contenus dans le pacte relatif aux droits civils et politiques,
il n'en a pas toujours été le cas pour ce qui concerne les droits
économiques,
1404 HENNEBEL (L.), TIGROUDJA (H.), Traité de droit
international des droits de l'Homme, Editions A. Pedone, 2016,
p.164-165.
1405 Pour plus d'informations sur les divergences de position qui
ont marqué l'adoption des deux Pactes, v. le site d'Amnesty
international :
http://www.amnesty.ch/fr/themes/économie-et-droits-humains
(25/02/2015) 1406 Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
1407 Pacte international relatif aux droits économiques
sociaux et culturels.
498
sociaux et culturels contenus dans le pacte de 1966. Ces
derniers se caractériseraient par leur réalisation progressive,
donc «non-immédiate» voire «non
obligatoire» pour les États parties.
Mais, si le caractère obligatoire et non
conditionné des droits reconnus par le Pacte relatif aux droits civils
et politiques ne fait aucun doute, tel n'est pas le cas de la seconde
catégorie des droits humains énumérés dans le Pacte
de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dont le
caractère obligatoire reste conditionné.
Les droits économiques, sociaux et culturels sont
répertoriés dans le pacte international de 1966. Ce pacte, on le
sait, compte au total 31 articles.
Le caractère programmé des droits
économiques, sociaux et culturels trouve sa source à
l'alinéa 1 de l'article 2 du Pacte DESC qui stipule :
« Chacun des États parties au présent
Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance
et la coopération internationale, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en
vue d'assurer progressivement l'exercice des droits reconnus dans le Pacte par
tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de
mesures législatives ».
Cette disposition a été et continue d'être
la justification du non-respect des droits contenus dans le Pacte, notamment
les droits économiques et sociaux. Plusieurs auteurs1408 se
sont déjà penchés sur la question pour montrer le
caractère non-immédiat et difficilement justiciable de ces
droits. En faisant le parallèle entre la disposition de l'alinéa
1er de l'article 24 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et l'article 10 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, on se rend compte que ces deux
dispositions ont la même finalité : la protection
particulière de l'enfant. C'est donc dire que dès
l'élaboration des deux Pactes en 1966, l'importance et le
caractère primordial de la
1408 DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de l'homme en Afrique
noire francophone. Théories et Réalités »,
Abidjan, Imprimob, 1998, 196 p.; BETH (L.), « Discourse in Development : A
Post-Colonial Theory Agenda for the UN Committee on Economic, Social and
Cultural Rights », In. Journal of Gender, Social Policy § the
Law, vol. 10, N°. 3 (September 2002), p.536.
499
protection particulière de l'enfant étaient
déjà reconnus au point de la rendre obligatoire dans le Pacte
relatif aux droits civils et politiques1409.
Ainsi, en reprenant en son article 4 la disposition de
l'alinéa 1er de l'article 2 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant a manqué de se servir de la
disposition de l'article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, pour rendre obligatoires tous les droits de l'enfant.
Pourquoi les droits économiques, sociaux et culturels
dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants doivent
être à réalisation progressive ? A cette question, la
réponse qui revient souvent est : le souci de prendre en compte la
situation économique des pays. A cela, il faut bien entendu ajouter la
recherche de compromis entre les Etats en présence. Or, comme l'a
souligné le Professeur Hugues FULCHIRON, la recherche de compromis ou
d'unité conduit à l'élaboration de règle à
minima, sans manquer de qualifier la Convention internationale relative aux
droits de l'enfant de texte « aux ailes coupés ». 1410. Bref,
tous les pays n'ayant pas le même niveau économique, leurs
obligations relatives aux droits économiques, sociaux et culturels de
l'enfant ne seront pas les mêmes. Mais la volonté d'avoir une
norme universelle de protection des droits de l'enfant ne découle-t-elle
pas de la prise de conscience des besoins particuliers de l'enfant ? Donc, de
la prise en compte de ses droits fondamentaux ? Et quels sont ces droits
fondamentaux ? Est-ce la liberté de réunion et d'association ? Le
respect de sa vie privée ? La liberté d'expression, et le droit
à une religion de son choix ? L'accès à l'information et
aux médias ? Hélas non ! Car, selon nous, pour des millions
d'enfants à travers le monde aujourd'hui et des milliers d'enfants
ivoiriens, ces droits ne devraient aucunement pas être regardés
comme étant plus importants que les DESC des enfants. Et pour cause, que
représentent ces droits pour des enfants qui sont privés du droit
à l'éducation, du droit à l'alimentation, du droit
à la santé, du droit à une famille ou du droit à la
protection sociale ?
1409 Même si nous devons reconnaitre que la reprise du
même droit dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels porte à confusion, et
témoigne d'une certaine indécision des rédacteurs des
Pacte.
1410 FULCHIRON (H.), « Les Conventions internationales.
Présentation sommaires », in L'enfant et les
Conventions internationales, Dir. RUBELLIN-DEVICHI (J.) et FRANK (R.),
Lyon, Presse Universitaire de Lyon, 1996, pp.19-33, p.27.
500
C'est donc dire que les droits fondamentaux de l'enfant ne
sauraient être perçus de la même manière que ceux de
l'adulte, encore que ceux de celui-ci peuvent aussi être sujet à
débat, eu égard aux besoins vitaux de l'être humain. Ainsi,
en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, nous pouvons nous
permettre de donner quelques indications sur ce qui peut être
considéré comme les droits fondamentaux de l'enfant. Ils peuvent
se présenter comme suit : le droit à la famille, le droit
à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à
l'éducation, le droit à la protection sociale, etc. D'ailleurs,
nous retrouverons quelques-uns de ces droits dans la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne1411.
De même, certains auteurs français comme Philippe
ARDANT pensent que dans les pays en développement fondés sur des
valeurs traditionnelles, religieuses et philosophiques propres, les droits
fondamentaux ne devraient pas être conçus à l'exemple des
pays développés1412. L'auteur préconise
plutôt une adaptation des droits fondamentaux à ces pays en tenant
compte des impératifs de consolidation ou de construction de
l'unité nationale et d'un Etat fort1413.
Alors, si tous les enfants ne sont pas en mesure de jouir de
leurs droits fondamentaux, que leur reste-t-il comme droits ? On est bien
tenté de dire, pas grande chose. Et l'article 4 de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant, en prévoyant des mesures
particulières qui enlèvent aux droits économiques et
sociaux leur caractère obligatoire pour tous les États parties,
handicape la jouissance effective des droits fondamentaux de l'enfant, donc ce
qui leur importe le plus. Et cela se ressentira dans la mise en oeuvre de la
Convention dans les pays que l'on considère, à tort ou à
raison, comme des pays «pauvres» ou à
«ressources limitées».
1411 Cf. Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, 7 décembre 2000 (entrée en vigueur le 1er
décembre 2009), in JOCE, 2000/C364/01, 18 décembre 2000, pp.
1-22. ; HENRY (J.) et STEINER et al., International Human Rights in Context
: Law, Politics, Morals (3d éd. 2007), p.1014-1015.
1412 ARDANT (Ph.), « Les problèmes posés
par les droits fondamentaux dans les Etats en voie de développement
», in Association Française des constitutionnalistes, Droit
constitutionnel et droits fondamentaux, Rapports français au II
ème Congrès Mondial de l'Association International de Droit
constitutionnel, Paris-Aix-en-Provence, 31 août-5 septembre 1987,
Economica/PUAM, Paris/Aix-en-Provence, 1987, pp.107-124.
1413 Ibid, p.117 ss.
501
L'égalité des États en droit
international1414, est un principe important des règles de
droit international, même si, pour toute personne avertie et
habituée au fonctionnement du droit international, ce principe
relève plus de la théorie que de la pratique. Mais, il
n'empêche, le principe est posé : « L'Organisation est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine des tous
ses membres. »1415. Ce principe qui signifie que tous les
États membres de l'Organisation des Nations Unies ont la même
capacité d'exercer des droits et d'assumer des obligations en droit
international, nonobstant toutes différences de puissance, de richesse,
de développement, entre autres1416, impose aussi que les
États traitent donc l'ensemble de la population qu'ils
représentent, de la même manière quel que soit leur
développement économique.
Dès lors, dire que les droits économiques,
sociaux et culturels soient mis en oeuvre « ...dans toutes les limites
des ressources disponibles », suppose que chaque État sera
évalué, dans la mise en oeuvre desdits droits au regard de sa
situation particulière. Ainsi, la Convention relative aux droits de
l'enfant pose, dès le départ, une différenciation dans la
jouissance des droits de l'enfant entre les États parties. En d'autres
termes, les enfants vivant dans un pays
«riche1417« ou un pays
«pauvre1418« ne peuvent revendiquer la jouissance
des mêmes droits. D'où une certaine discrimination1419.
On le sait : La discrimination consiste en tout traitement différent qui
tend à refuser à des individus, à des groupes d'individus
des droits ou des avantages qui sont reconnus à d'autres
ailleurs1420. Le principe de la nondiscrimination, présent
dans toutes les normes internationales relatives aux droits humains, refuse
pourtant cette différence de traitement, y compris la Convention
relative aux droits de
1414 BESSON (S.), Droit International
Public-Abrégé de cours et résumés de
jurisprudence, Stampfli Editions SA Berne.2011, p.75. ; Art.2 par.1 Charte
de l'Onu « L'Organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses Membres. » qui reprend
l'article 4 de la Convention de Montevideo : « States are juridically
equal, enjoy the same rights, and have equal capacity in their exercise. The
rights of each one do not depend upon the power which it possesses to assure
its exercise, but upon the simple fact of its existence as a person under
international law ».
1415 Art 2.1 de la Charte des Nations unies.
1416 Cf. CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF,
2011, p.387.
1417 SAUVY (A.), « Le tiers-Monde ».In.
Sous-développement et développement, PUF, 1961, pp.383-393.
; 1418 CLARK (C.), « Population et niveaux de vie » In. Revue
internationale du Travail, août 1953, 68, 2, pp.103-124.
1419 BELLOUBET-FRIER(N.), « Le principe
d'égalité », AJDA, 1998, n° spécial,
p.152. ; BORGETTO (M.), « Le principe d'égalité en droit
public français », In. Définir les
inégalités des principes de justice à leur
représentation sociale, DRESS, collection MIRE, 1999, p.41.
1420 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF,
2011, p.387.
502
503
l'enfant (qui reprend dès le premier paragraphe de son
préambule les principes de la Charte des Nations Unies qui sont ceux
d'égalité et le caractère inaliénable des droits
humains).
On peut alors se demander s'il appartient à une norme
internationale, qui se veut protectrice des droits de l'enfant au plan
universel, de poser ainsi une certaine discrimination, à tout le moins,
une différence au niveau du traitement des enfants quant au
bénéfice des DESC selon qu'ils vivent dans un pays pauvre ou pays
riche. Pourtant, la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant a posé, à travers son article 4, une règle
discriminatoire dans la jouissance des droits économiques sociaux et
culturels entre les enfants par rapport à leur pays d'existence.
Pourquoi l'enfant de Monaco ou de Liechtenstein1421
peut revendiquer son droit d'aller à l'école et de jouir d'une
protection sociale alors que l'enfant de l'Erythrée ou de la
République démocratique du Congo (RDC), ne peut revendiquer le
même droit ?1422 Pourquoi l'enfant du Luxembourg ou de la Suisse doit
revendiquer son droit d'aller à l'école et de jouir d'une
protection sociale alors que l'enfant du Burundi et la République
Centrafricaine ne peut revendiquer le même droit ?1423 Le
Luxembourg et la Suisse sont en tête du classement des pays à
Revenu National Brut (PNB) par habitant élevé en 2015, avec
respectivement 103187 Dollars US et 82178 Dollars1424 US. De
même, la République démocratique du Congo apparaissait dans
un récent rapport de l'Unicef1425 comme le pays qui a le
Produit National Brut (PNB) par habitant le plus faible, 180 Dollars US en 2010
; ce qui faisait de ce pays l'un des plus pauvres du monde. Or la
République Démocratique du Congo est un vaste pays qui regorge de
richesses naturelles, notamment les ressources
1421 Monaco et Liechtenstein étaient en tête du
classement des pays à Revenu National Brut (PNB) par habitant
élevé en 2010, avec respectivement, 197.460 Dollars US et 136.540
Dollars US. Cf. Rapport Unicef, Situation des enfants dans le monde 2012,
pp.110-115.
1422 L'Erythrée et la République
Démocratique du Congo ont les indicateurs PNB les plus faibles, avec
respectivement 340 Dollars US et 180 Dollars US. Rapport Unicef situation des
enfants dans le monde 2012, op cit. ; Le Burundi et la République
Centrafricaine ont les indicateurs PNB les plus faibles, avec respectivement
315 Dollars US et 339 Dollars US.
1423 Luxembourg et Suisse sont en tête du classement des
pays à Revenu National Brut (PNB) par habitant élevé en
2015, avec respectivement 103187 Dollars US et 82178 Dollars US. Cf. Rapport
Unicef, Situation des enfants dans le monde 2015.
1424 Cf. Rapport UNICEF, Situation des enfants dans le monde
2015.
1425 UNICEF, Rapport 2012 sur la situation des enfants dans
le monde.
minières et énergétiques, telles que : le
diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, le pétrole etc., donc l'un des pays
potentiellement plus riches du continent africain1426.
Au regard de ces données, il ne fait aucun doute que la
République démocratique du Congo et la République
centrafricaine, au regard des institutions des Nations unies, apparaissent
comme des États pauvres ou Pays Moins Avancés (PMA) pour nous
conformer à la terminologie de règle. Mais que cache en
réalité cette situation de pauvreté d'un pays,
potentiellement, aussi riche que la RDC et la Centrafrique ? En 2015, les pays
les moins avancés, dans le monde sont au nombre de 501427 et
parmi eux, on dénombre 34 États africains1428, dont la
République Démocratique du Congo et la République
centrafricaine. Mais, si en réalité la corruption1429
et la non valorisation des ressources au niveau des pays
africains1430 ne font plus de doute, la situation la plus
énigmatique est celle de la guerre qui caractérise la grande
majorité des pays africains riches en ressources
naturelles1431.
Cette situation a pour conséquence le pillage des
richesses nationales par les protagonistes et le maintien des populations dans
la misère ; ce qui, en fin de compte, fausse les données sur la
richesse des États1432, donc de leur potentiel
économique à assurer les droits économiques et sociaux
notamment, à leurs populations. En somme, l'article 4 de la Conventions
des Nations unies, permet d'éviter la réalisation optimale des
droits
1426 Info disponible sur le site de l'agence de presse des
nations Unies :
www.relations-nations-unies.agence-presse.net
sur les 10 pays les plus pauvres du monde en 2010. (Consulté le 07
septembre 2012.).
1427 Ils étaient 49 en 2009, à ceux-là
s'ajoute le soudan du sud reconnu comme Etat par les Nations unies en 2011. Cf.
doc. « Les pays les moins avancés » in ligne sur :
http://www.unohr.org (consulté
le 15/02/2015). 1428 Y compris le soudan sud. Car en 2009 le Soudan faisait
partie de la liste. V. doc. « Les pays les moins avancés
», op.cit
1429 Comme l'affirme Michel DOUCIN, « la
Corruption en détournant les modes démocratiques et en privant
les Etats de ressources nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions de base en matière de garanties et production de services de
base, viole indirectement la plupart des droits humains Fondamentaux. » ;
Lire aussi : BLUNDO G., DE SARDAN (J.P. Olivier), La corruption au
quotidien-Politique africaine n°83, Octobre 2001, Karthala.,
CARTIER-BRESSON (J.), « Corruption , libéralisation et
démocratisation-Introduction », In. Revue Tiers
Monde, Janvier 2000, p.21.
1430 Information disponible sur le site de l'agence de presse des
nations Unies :
www.relations-nations-unies.agence-presse.net
sur les 10 pays les plus pauvres du monde en 2010. Consulté le 07
septembre 2012. 1431 Comme le témoigne la publication des Nations Unies
: « Contre les diamants de guerre », les diamants extraits des mines
en Afrique ont rapporté sur les marchés du monde entier des
milliards de dollars servant à financer des insurrections en Angola, en
Sierra Leone et en République démocratique du Congo. Le document
est disponible sur :
http://www.un.org/fr/africarenewal/vol14no4/diamants.htm
. (Consulté le 15/02/2015). 1432 Principe de disposer de leurs
ressources économiques ; ABI-SAAB (G.), « La
souveraineté permanente sur les ressources naturelles »,
In. BEDJAOUI Mohammed (sous dir.), Droit international, bilan et
perspectives, Paris, éd. A. Pedone, t.2, 1991, p.639-661.
504
économiques sociaux et culturels des enfants en
Afrique, à l'instar de l'attitude de la Côte d'ivoire
marqué par la conclusion tardive des conventions internationales de
protection de l'enfant.
§ 2. DES CAUSES D'INEFFECTIVITE TENANT AUX
RETICENCES DE LA COTE D'IVOIRE A L'EGARD DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE
PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT
Les réticences de l'Etat ivoirien à
l'égard des conventions internationales relatives aux droits de
l'homme-enfant ont deux principales justifications.
Jalouse de sa souveraineté, l'Etat de Côte
d'Ivoire manifeste de la réticence vis-à-vis des conventions
internationales touchant les droits de l'homme, notamment à
l'égard de celles qui pourraient fortement restreindre sa liberté
de se gouverner et de s'administrer. En réalité, par cette
réticence, la Côte d'Ivoire protège sa souveraineté
contre les Etats et les individus. Mieux, elle considérait les droits de
l'homme comme une matière relevant des « affaires
intérieures »1433 relevant de la compétence
nationale de chaque Etat. C'est d'ailleurs ce souci de la protection de la
souveraineté nationale qui justifia la longue réticence de la
Côte d'Ivoire à l'égard du statut de Rome instituant la
Cour pénale internationale.
A l'image de nombre de pays au monde. La Côte d'ivoire a
toujours protégé sa souveraineté contre les individus. Eu
égard à cette protection, chaque Etat fait écran entre le
droit international et l'individu ; de sorte qu'il est toujours difficile pour
tout individu d'être directement titulaire de droits et d'être tenu
d'obligations au plan international. Ainsi, dans son avis consultatif du 3 mars
1928, la C.P.J.I. a relevé que « selon un principe de droit
international bien établi, un accord international ne peut, comme tel,
créer directement des droits et des obligations pour les particuliers
»1434. On comprend alors qu'il y ait une grande opposition
des Etats à la saisine des institutions protectrices des droits de
l'homme-enfant par les individus. D'où leur réticence à
ratifier des traités internationaux permettant d'ouvrir à
l'individu, le prétoire des tribunaux internationaux ou des organes
quasi-juridictionnels.
1433 Voir Article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations
Unies qui dispose : « aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat
».
1434 Affaire relative à la compétence des
tribunaux de Dantzig (Pays-Bas c. Etats-Unis d'Amérique), avis
consultatif du 3 mars 1928, CPJI Série B n°15 p.4.
505
Un tel recours apparait aux yeux des pouvoirs publics comme
une atteinte à leur souveraineté.
C'est pourquoi, ce pays a toujours manifesté de la
réticence à conclure les conventions internationales offrant un
recours aux individus au niveau international. Par exemple, elle a conclu
tardivement les conventions suivantes : le protocole se rapportant au PIDCP
auquel elle a adhéré le 5 mars 1997, soit trente et un (31) ans
après son adoption ( 16 décembre 1966) ; la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples à laquelle elle a adhéré
le 27 décembre 1991, soit dix (10) ans après son adoption ( 27
juin 1981) ; la Convention contre la torture et autres peines cruels, inhumains
ou dégradants à laquelle elle a adhéré le 18
décembre 1995, soit onze (11) ans après son adoption ( 10
décembre 1984). Toutes ces conventions autorisent la recevabilité
des requêtes individuelles devant les institutions protectrices des
droits de l'homme. On comprend alors que la Côte d'Ivoire ait
manifesté de la méfiance à l'égard de telles
conventions. Que la Côte d'Ivoire puisse être attraite devant un
organe international de protection des droits de l'homme par une simple
requête individuelle, était là, aux yeux des pouvoirs
publics ivoiriens, comme une atteinte grave à la souveraineté de
leur pays. Ainsi, se trouve justifiée la réticence de la
Côte d'Ivoire vis-à-vis de certaines conventions internationales.
Par une telle réticence, la CI entend protéger sa
souveraineté contre les particuliers.
Eu égard à
l'hétérogénéité de la population ivoirienne
au plan religieux, linguistique et culturel, les hommes se sentaient moins
citoyens d'un Etat que membres d'une tribu. Il fallait alors déployer
tous les efforts nécessaires pour surmonter tous ces clivages tribaux et
régionaux, donc lutter sans complaisance contre le tribalisme et le
régionalisme afin d'obtenir l'unité tangible et infrangible
attendue de la nation ivoirienne, riche de la diversité de ces cultures
complémentaires ; le développement de la Côte d'Ivoire
étant à ce prix. C'est pourquoi, au départ, la Côte
d'Ivoire s'était montré réticente vis-à-vis des
conventions internationales relatives aux droits de l'homme, notamment à
l'égard des conventions qui lui paraissaient inadaptées ou
dangereuses au contexte socio-politique du moment. En tout cas, elle en a
conclu très peu avant 19901435.
1435 Voici quelques conventions internationales auxquelles la CI
est partie avant 1990 : « Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 ( 1961) ;
Conventions de Genève du 12 Août 1949 ( 1961) ;
Protocole de New York relatif au statut des
réfugiés du 31 janvier 1967 (1972) ;
506
La réalité ivoirienne laisse voir que les
réticences de la Côte d'Ivoire à l'égard des
conventions internationales sont aussi justifiées par le souci de la
croissance économique. Après l'indépendance, l'Etat de
Côte d'Ivoire s'est alors lancé dans une politique spectaculaire
de diversification de sa production agricole, afin de parvenir à la
croissance économique recherchée. Dans un tel contexte, les
droits de l'homme étaient considérés comme des
impedimenta à cette croissance économique ; d'où,
ils ont été relégués au second plan : en effet,
leurs promotions étaient aux yeux des pouvoirs publics ivoiriens, comme
un luxe, car selon eux, elle ne s'accommode guère avec la faim, la
sous-alimentation et la malnutrition.
Par conséquent, c'est à juste titre que Monsieur
Kéba MBAYE affirme : « Beaucoup de dirigeants des pays en
développement, partant du fait que leur politique doit essentiellement
être tournée vers les politiques susceptibles de faire progresser
la qualité de la vie des populations, mettent en veilleuse le respect
des droits de l'homme. »1436. Dès lors il n'est pas
étonnant que, au nom de la croissance économique, les droits de
l'homme aient été quotidiennement foulés aux pieds en
Côte d'Ivoire. Pour le Professeur Yves MADIOT, pour un pays
sous-développé (comme la Côte d'Ivoire), « Les
droits économiques et sociaux les plus importants ne peuvent pas
être mis en oeuvre. Le droit à la sécurité sociale,
par exemple, absorberait l'intégralité du budget (...). Le droit
au travail ne peut être garanti (il ne l'est déjà pas dans
les Etats industrialisés) dans une société à
très faible croissance (...). Les libertés traditionnelles ne
sont pas garanties. Les libertés d'association et de réunion, la
liberté de presse ou les libertés individuelles ne peuvent
s'implanter »1437.
A la vérité, il est remarquable et regrettable
qu'en Côte d'Ivoire, à l'exclusion du miracle économique
des années 70, la croissance économique recherchée n'a pu
être atteinte, malgré les réticences vivaces
manifestées à l'égard des conventions internationales sur
les droits de l'homme au lendemain de l'accession à
l'indépendance. Aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont rendus
comptent que les droits de l'homme constituent un facteur essentiel à la
croissance économique et à l'unité nationale, donc au
développement de la Côte d'Ivoire.
Protocole additionnel I aux conventions de Genève du 8
juin 1977 (1989) . »
1436 MBAYE (K.), « Droits de l'homme et pays en
développement », In. Mélanges René-Jean
DUPUY, Op. cit, p.216.
1437 MADIOT (Y.), Droits de l'Homme et Libertés publiques,
op. cit., p.72.
507
En somme, que la volonté de conclure une convention
portant sur les droits fondamentaux de l'être humain n'ait pu être
manifestée de la part de la Côte d'Ivoire depuis des mois, voir,
depuis plus d'une décennie, après son adoption, l'on est en droit
de penser qu'il s'agissait d'un refus de conclure, qui malheureusement,
favorise la non réalisation de certains droits. Car par ces retards dans
la conclusion des conventions internationales, les droits de l'enfant se
trouvaient insuffisamment consacrés au niveau conventionnel et donc loin
d'être effectivement mis en oeuvre.
Les causes liées à la complexité des
normes internationales et à la réticence de l'Etat ivoirien
à conclure des conventions internationales protégeant les droits
humains ayant été examinées, il importe de nous
intéresser à celles relatives à l'ineffectivité du
droit à la survie, au développement et à la participation
des enfants.
SECTION II. LES CAUSES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT A
LA SURVIE, AU DEVELOPPEMENT ET A LA PARTICIPATION DES ENFANTS
Ici, seront analysées successivement, les
résistances au droit à la vie et à la survie de l'enfant
(Paragraphe 1), celles tenant au développement de l'enfant
(Paragraphe2), puis celles afférentes à la participation des
enfants (Paragraphe 3).
§ 1. LES CAUSES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT A LA
VIE ET A LA SURVIE DE L'ENFANT
On analysera dans ce paragraphe, les résistances tenant
aux causes immédiates notamment, le développement des
pandémies accablantes (A) celles afférentes aux causes
sous-jacentes (B), puis celles relatives aux causes structurelles (C).
A. LES RESISTANCES TENANT AUX PANDEMIES ACCABLANTES :
LE DEVELOPPEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES
Quand on sait que les pays en voie de développement
concentrent 90% des épidémies1438, force est de
constater que la prévalence des maladies est révélatrice
de l'inégalité entre pays pauvres et pays riches, et qu'elle est
un obstacle majeur au développement économique et
1438 PIRAGES (D.), « Maitriser les maladies infectieuses
», in Institut worldwatch sur le développement durable, L'Etat
de la planète, Redéfinir la sécurité mondiale,
Rapport, Genève, 2005, p.51-74.
508
social d'un Etat. Pour justifier l'idée suivant
laquelle, les grandes pandémies figurent indubitablement parmi les
handicaps les plus redoutables à la réalisation du droit à
la vie et à la survie, nous évoquerons principalement les
maladies courantes (1) et les autres maladies attentatoires à la survie
de l'enfant (2).
1. Les maladies courantes
Les niveaux de mortalité infanto-juvénile
observés sont liés au développement des maladies
infectieuses, parasitaires et virales. Les affections liées aux
problèmes de santé infantile, telles que le
paludisme1439, les infections respiratoires aigües, le
VIH/SIDA1440, les maladies évitables par la vaccination, la
malnutrition, l'anémie, le faible poids à la naissance sont les
cas les plus fréquents, diagnostiqués au cours des consultations
dans les centres de santé visités.
Selon l'EDS de 1998-1999, plus d'un tiers (36%) des enfants de
moins de 5 ans ont eu la fièvre au cours des deux semaines ayant
précédé l'enquête. Ce qui indique qu'ils peuvent
avoir souffert de paludisme ou d'autres maladies graves. S'agissant du
paludisme, en 2002, on estimait en Côte d'Ivoire, à près de
2 millions de cas de paludisme par an avec une prédilection chez les
enfants de moins de 5 ans1441. En 2014, la prévalence du
paludisme chez les enfants âgés de moins de cinq ans était
de 18%1442.
Les infections respiratoires aigües (IRA) sont aussi
très souvent des maladies diagnostiquées chez les enfants. Ainsi,
parmi les enfants de moins de cinq ans, 4% avaient présenté des
signes d'infections respiratoires aigües (IRA) au cours des deux semaines
ayant
1439 FAKIH (C.), Le paludisme en Côte d'Ivoire. Etat
des lieux, Stratégies de lutte, Thèse de doctorat-pharmacie,
Université de Bordeaux, 2014, 144p.
1440 UNICEF-ONUSIDA-OMS-FNUAP, Enfants et Sida.
Quatrième bilan de la situation- Unissons-nous pour les enfants contre
le SIDA, 2009, 56p. ; WALKER (N.) SCHWARTLANDER (B.) et BRYCE (J.), «
Meeting international goals in child survival and HIV/AIDS » The
lancet, 360 : 9329, 27 juillet 2002, pp.284-288. ; COMITE DES DROITS DE
L'ENFANT, Commentaire général n°3 : Le VIH/SIDA et les
droits de l'enfant, (CRC/GC/2003/1), 2003.
1441 TETCHI (Y.D.), COULIBALY (K.I), OUATTARA (A.) et al.
Evaluation de la prise en charge du paludisme chez les enfants de 0 à 15
ans dans les districts sanitaires du projet Fonds mondial en CI, Mali
médical, 2012, XXVII, 3, pp.17-20.
1442 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, Analyse de la situation
de l'enfant en Côte d'Ivoire : vers une société plus
équitable dans un pays émergent », Septembre 2014,
p.40.
509
précédé l'enquête
démographique et de santé et à indicateurs multiples de la
Côte d'Ivoire portant sur la période 2011-20121443.
De même, l'une des causes immédiates
résulte de la pandémie du SIDA. En effet, on estime, chaque
année à 15000, le nombre de nouveaux cas chez l'enfant, soit un
tiers (30%) des cas notifiés. Les conséquences sociales sont
dramatiques étant donné que de nombreux enfants âgés
de 0 à 5 ans, s'ils ne meurent pas avant l'âge préscolaire,
risquent de ne pouvoir avoir accès à l'éducation. Par
ailleurs, la demande de soins pour les enfants atteints du SIDA connaît
une hausse remarquable. L'ampleur du phénomène résulte
surtout de la transmission du VIH de la mère à
l'enfant1444, l'excision1445, la
circoncision1446 et les scarifications pratiquées avec des
objets non stérilisées.
2. Les autres maladies attentatoires à la
survie de l'enfant (l'anémie, la malnutrition, les maladies
évitables, les maladies diarrhéiques)
Les maladies diarrhéiques constituent la
deuxième cause de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans en
Afrique, au sud du Sahara et plus particulièrement en Côte
d'Ivoire.1447Elles sont à l'origine de
nombreux cas de déshydratation qui représentent, dans
1443 Ministère de la Santé et de la lutte contre
le SIDA (MSLS) et l'Institut National de la Statistique (INS) et ICF
International, Enquête Démographique et de Santé et
à Indicateurs Multiples de la Côte d'Ivoire 20112012 : Rapport de
synthèse. Calverton, Maryland, 2013, p.9.
1444 ONUSIDA, Transmission du VIH de la mère
à l'enfant, Collection Meilleures pratiques de l'Onusida, Mars
1999, pp.2-3 ; Selon l'ONUSIDA, dans la majorité des cas, l'infection
à VIH chez les enfants de moins de quinze ans résulte d'une
transmission mère-enfant (TME).
1445 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) et MINISTERE DE
LA LUTTE CONTRE LE SIDA (Côte d'Ivoire) et ORC Macro. Enquête
sur les indicateurs du Sida, Côte d'Ivoire 2005. Calverton,
Maryland, p.178-179 ; UNICEF, Fiche d'information :
mutilations génitales féminines/excision in Pour chaque enfant.
Santé, Education, Egalité, Protection-Faisons avancer
l'humanité, p.2, disponible sur
www.unicef.org/french/protection/files/Mutilations_Genitales.pdf
( Consulté le 23/04/2016).
1446 La circoncision est une pratique rituelle
réalisée par de nombreuses civilisations depuis
l'Antiquité. On la retrouve dans l'Ancien Testament (Genèse, XVII
: 10-12) et etait pratiquée par tous les juifs et musulmans
de par le monde. Elle a, en revanche, été
abandonné par la religion chrétienne, sous l'égide de Paul
de Tarse,
même si la circoncision où le prépuce
n'est pas retiré, mais simplement incisé latéralement. ;
La première publication suggérant que les sujets circoncis
seraient partiellement protégés contre une infection par le
virus
du Sida par rapport aux sujets non circoncis a
été rapportée par Fink en 1986 dans une lettre
éditoriale au New England Journal of Medicine ;Voir FINK(A.J.), A
possible explanation for heterosexual male infection with AIDS. N. Engl J
Med 1986 ; 315 : 1167. ; SIEGFRIED N., MULLER M., DEEKS J., VOLMINK J., EGGER
M., LOW N. et al. HIV and male circumcision-a systematic review with assessment
of the quality of studies. Lancet Infect Dis 2005. 5/165-73.
(B.), DOUMBIA (M.), SY (I.), DONGO (K.), AGBO-HOUENOU (Y.),
HOUENOU (P.V.),
1447 KONE
FAYOMI (B.), BONFOH (B.), TANNER (M.), CISSE (G.), « Etude
des diarrhées en milieu urbain à Abidjan
510
bien des proportions significatives, des états morbides
et des décès chez les enfants de moins de cinq ans. En 2012,
près d'un enfant de moins de cinq ans (18%) avait eu la
diarrhée1448 au cours des deux semaines ayant
précédé l'enquêté démographique et de
santé de 20112012. Les enfants de 12-23 mois ont été les
plus affectés (29%). Globalement, 22% des enfants souffrant de
diarrhée ont bénéficié d'une thérapie de
réhydratation par voie orale (TRO), c'est-à-dire un sachet de SRO
ou une solution maison ; 49% des enfants ont bénéficié
d'une TRO ou une augmentation des quantités de liquide. Par contre, 27%
des enfants n'ont reçu aucun traitement.1449La pointe de la
prévalence de la diarrhée intervient au cours de la
période de sevrage chez les enfants âgés de 6 à 23
mois avec des taux de 30 à 35% respectivement pour les enfants de 6-11
mois et 12-23 mois1450.
En 1998, l'EDS 2 révèle que la proportion des
enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique (rapport
taille-pour âge) était estimée à 25% contre 24 % en
1994. Selon ces mêmes résultats de l'EDS2, la malnutrition
(qu'elle soit chronique ou sévère) est plus prononcée chez
les filles (27% et 10%) que les garçons (24% et 9%). Suivant l'EDS-MICS
2011-2012, 30% des enfants de moins de cinq ans ont une taille trop petite par
rapport à leur âge, accusant ainsi un retard de croissance ou
souffrant de malnutrition chronique. Selon cette enquête la malnutrition
chronique est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain
(35% contre 21%) et dans les régions du Nord et du Nord-Est (39%
chacune) que dans les autres1451. La prévalence du retard de
croissance varie selon le niveau d'instruction de la mère (32% des
enfants dont la mère est sans aucune instruction ont un retard de
par l'approche écosanté », Vertigo- La
revue électronique en sciences de l'environnement,
Hors-série 19, Aôut 2014, disponiible sur
https://vertigo.revues.org/14976
( consulté le 25/06/2017).
1448 La diarrhée est la plus sérieuse des
maladies liées au manque d'accès à l'eau potable, à
l'hygiène et l'assainissement ; Selon l'Unicef, elle tue à elle
seule 5000 enfants par jour dans le monde. En affaiblissant les enfants, la
diarrhée fait aussi augmenter la mortalité causée par des
maladies qui surviennent quand l'organisme est tellement faible qu'il est
incapable de se défendre : par exemple des maladies comme les infections
respiratoires aigües. ; KONE (B.), DOUMBIA (M.), ADJI FX., Approche
écosystémique à la gestion des maladies
diarrhéiques en milieu périurbain : cas d'un village lagunaire
dans la commune de Yopougon (Abidjan-Côte d'Ivoire). Rapport final du
projet du Centre Suisse de Recherche Scientifique, 2007, 81p. ; DEPEAU
(S.) , RAMADIER (T.), « Les trajets Domicile-Ecole en milieux urbains
: Quelles conditions pour l'autonomie de l'enfant de 10-12 ans?, » In.
Psychologie & société, n°3, 2005, pp. 81-112 ;
1449 Ministère de la Santé et de la lutte contre
le SIDA (MSLS), Institut National de la Statistique (INS) et ICF International,
Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples de la Côte d'Ivoire 2011-2012 : Rapport de
synthèse. Calverton, Maryland, USA, 2013 p.9.
1450 Ibid.
1451 Ibid. p.12.
511
croissance contre 16% des enfants dont la mère a
atteint un niveau secondaire ou plus)1452. Un autre facteur de
différenciation des niveaux de malnutrition est le milieu de
résidence avec une zone rurale où la malnutrition atteint un
niveau très élevé par rapport à celui de la zone
urbaine.
Au-delà des résistances sus analysées, il
importe d'examiner celles de nature sous-jacente qui expliquent
l'ineffectivité optimale du droit à la vie et à la survie
de l'enfant.
B. LES OBSTACLES SOUS-JACENTS A LA REALISATION DU
DROIT A LA VIE ET A LA SURVIE DE L'ENFANT
Les causes sous-jacentes ont trait aux facteurs liés
aux comportements des populations, notamment de la mère (1) et à
des difficultés d'accès aux services sociaux de base (2).
1. Les résistances liées aux comportements
de la mère
Le droit à la vie et la survie de l'enfant peut
être compromis par moult facteurs liés au comportement de la
mère : grossesses à risques, un mauvais suivi sanitaire de la
grossesse et de l'accouchement, la faible pratique de l'allaitement maternel,
l'analphabétisme de la mère.
Les grossesses à risques constituent une des causes des
violations du droit à la survie des enfants en Côte d'Ivoire. Le
niveau élevé de la mortinatalité1453 peut
s'expliquer par les grossesses d'enfants par femme et le rapprochement des
naissances1454. En effet, une femme de 18 ans sur deux, vivant en
milieu rural a déjà eu un enfant ou est enceinte pour la
première
1452 Ibid. p.12.
1453 KOFFI (A.) Mortinatalité : facteur de risque
à propos de 780 cas colligés en 2 ans à la
maternité d'ABOBO SUD à ABIDJAN- Résumé des
rapports et communications au 5ème congrès de la SAGO
à DAKAR, décembre 1998 (inédit) ; Voir aussi,
HENRIPIN (J.), « L'inégalité sociale devant la mort : la
mortinatalité et la mortalité infantile à Montréal
» in Recherches sociographiques, Québec : Les Presses de
l'Université Laval, vol.2, n°1, janvier-mars 1961, pp.3-34.
1454 USAID, La planification et l'espacement idéal
des grossesses pour la santé-Guide de Référence pour le
formateur,Extending Service deliver(esd),2008, p.5. ; voir aussi, Dav
(A.), HALE (L.), RAZZAQUE (A.), RAHMAN (M.), « Effects of
interpregnancy interval and outcome of the preceding pregnancy on pregnancy
outcomes in Martlab, Bangladesh, BJOG, 2007 ; SETTY-VENUGOPAL (V.), MPH et
USHMA (D.), ROBEY (B.), Population Reports-Espacement des naissances.Trois
ans à cinq ans sauvent des vies, in, Série L,
n°13-Questions de santé mondiale, Population Information
Program, Center for Communication Programs, the Johns Hopkings Bloomberg School
of Public Health, USA, Eté 2002, 23p.
512
fois. En outre, l'indice de
fécondité1455 se situe actuellement à 5,2 avec
une tendance à la hausse en milieu rural (6,3 contre 4,02 en zone
urbaine). Or, avant l'âge de 25 ans et au-delà de quatre enfants,
les issues de grossesse présentent des risques de décès
des bébés pendant l'accouchement. Par ailleurs, l'intervalle
intergénésique est court, notamment en milieu rural où il
est moins de deux ans entre deux naissances Ce sont là autant de
facteurs qui rendent difficiles l'accouchement et la survie des nouveaux
nés1456.
De même, un mauvais suivi sanitaire de la
grossesse1457 et de l'accouchement explique aussi les atteintes
à la survie des enfants. Selon les Résultats de l'EDS de 1998,
pour une naissance sur cinq (20%) les mères ne sont pas allées en
consultations prénatales, indispensables pour un meilleur suivi du
foetus. En 2000, selon le MICS ce taux a considérablement baissé
pour atteindre 3,3% des mères, dont 1,2% en milieu urbain et 5% en
milieu rural. Par ailleurs, en 1998, près de la moitié des
enfants de 12 à 23 mois n'étaient pas vaccinés contre les
maladies du PEV. Cependant, en 2000 un enfant de 12 à 23 mois sur onze
(9,6 %) n'a reçu aucun vaccin. On peut, par conséquent affirmer
que 23% des mères n'ont que partiellement ou pas du tout eu recours aux
services de vaccination. En milieu urbain, cette proportion est moins faible
qu'en zone rurale. En somme, la faible surveillance prénatale ainsi que
la non-immunisation ou l'immunisation partielle des enfants contre le
tétanos néonatal (21,4% ne sont pas vaccinés en 2000) et
les maladies du PEV ont constitué des facteurs importants de
décès infantiles.
1455 L'indice de fécondité ou encore taux de
fécondité, peut se définir comme le nombre moyen d'enfants
par femme en âge de procréer (à ne pas confondre avec le
taux de natalité). ; Suivant les chiffres de l'an 2015 estimés
par le WORLD FACTBOOK de la CIA, le taux de fécondité de la
Côte d'Ivoire s'élève à 3, 54.
1456 PRUAL (A.), « Grossesse et accouchement en Afrique
de l'Ouest. Vers une maternité à moindre risque ? »,
Santé Publique 1999, volume 11, n°2, pp.167-185.
1457 DIARRA NAMA (A.J.), ANGBO (O.), KOFFI (M.N.), KOFFI
(M.K.) YAO (T.K.), WELFFENS EKRA (C.), « Morbidité et
mortalité liées aux transferts obstétricaux dans le
districts sanitaire de Bouaflé en Côte d'Ivoire », In
Santé publique, volume 11, n°2, 1999, pp.193-201 : pour
cette étude , les auteurs estiment que la couverture prénatale
effective des femmes enceintes évacuées était faible car
seulement 46,4% des femmes avaient effectuées plus de trois
consultations prénatales. Qui plus est, l'absence de suivi
prénatal est fréquemment associée à la
morbidité et la mortalité maternelle et périnatale car
c'est le rapport quantité-qualité des consultations
prénatales qui permet le dépistage des grossesses à risque
et la référence précoce de celles-ci ; ROONEY (C.),
Soins prénatals et santé maternelle : Etude
d'efficacité. OMS, Programme de Santé maternelle et
maternité sans risque. WHO.MSM/92.4 :72.
513
Quant à l'allaitement maternel, l'OMS et l'Unicef
recommandent un allaitement maternel1458 exclusif jusqu'à
l'âge de 4 à 6 mois afin de garantir un meilleur état de
santé de l'enfant (immunité contre les maladies, croissance
normale, etc.). Cela résulte d'une recommandation de santé
publique de portée mondiale1459. De façon
générale, l'allaitement est quasi-universel en Côte
d'Ivoire ; car en 1998, la majorité (98%) des enfants nés dans
les cinq années ayant précédé l'EDS ont
été allaités pendant un certain temps. Cependant, en 2000,
seulement un enfant de 0 à 3 mois sur huit (11,4%) est seulement nourri
au sein maternel, dont 13,8% en milieu urbain et 9,5 % en zone rurale. Les
raisons souvent évoquées en milieu urbain à l'encontre de
l'allaitement maternel est que celui-ci rend les seins flasques et fait perdre
à la femme sa beauté. D'autres raisons tiennent à un
phénomène de mode qui trouve l'utilisation du biberon une
certaine sorte d'ascension sociale. D'autres raisons tiennent encore à
certaines activités économiques de la mère. Effectivement,
les mères évoluant dans les secteurs modernes de production
semblent interrompre plus rapidement l'allaitement maternel exclusif du fait de
l'emploi du temps que leur impose le monde de l'emploi.
A partir des années 2005, la situation semble avoir
évolué de manière positive. En effet, suivant l'EDS-MICS
de 2011-2012, la quasi-totalité des enfants nés dans les cinq
années ayant précédé l'enquête, soit 97% ont
été allaités1460. Cependant seulement 12% des
enfants de moins de six mois étaient exclusivement nourris au sein et
64% des enfants de 6-9 mois avaient reçu des aliments de
complément. Ce qui amène à dire que 36% des enfants de
plus
1458 L'allaitement au sein exclusif signifie que le nourrisson
ne reçoit pas d'autre aliment ou boisson, pas même de l'eau que le
lait maternel (y compris le lait exprimé de sa mère ou le lait
d'une nourrice) pendant les six (6) premiers mois de la vie, mais qu'il peut
néanmoins recevoir des sels de réhydratation orale, des gouttes
et des sirops ( vitamines, minéraux et médicaments) ;
Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune
enfant-Résolution de l'Assemblée mondiale de la
santé-1er mai 2001 WHA54 A54/INF.DOC./4 ; BIDAT(E.) : «
L'allaitement maternel protège le nourrisson de l'allergie »:
In. Revue Française d'Allergologie. 2010 ; 50(3) : 292-294
; CASTETBON (K.), DUPORT (N.), HERCBERG (S.) : « Allaitement maternel et
santé » In. Revue d'Epidémiologie et de Santé
Publique. 2004 Oct , 52(5) :475-480 ; TURCK (D.) , « Allaitement
maternel : les bénéfices pour la santé de l'enfant et de
sa mère ».In. Archives de pédiatrie. 2005 Dec ;
12(S3) :145-165.
1459 Conformément aux conclusions et recommandations de
la consultation d'experts (Genève, 28-30 mars 2001) ayant
couronné l'examen systématique de la durée optimale de
l'allaitement exclusif au sein (voir le document Organisation mondiale de la
santé-cinquante quatrième assemblée mondiale de la
santé A54/INF.DOC./4 (point 13.1 de l'ordre du jour provisoire
1er mai 2001). Voir aussi la résolution WHA54.2. 1460
Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA (MSLS) et
l'Institut National de la Statistique (INS) et ICF International,
Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples de la Côte d'Ivoire 20112012 : Rapport de
synthèse. Calverton, Maryland, MSLS, INS et ICF International, 2013
p.11.
514
de 6 mois n'ont pas pu recevoir une alimentation de
complément et ce, en violation des recommandations de l'OMS et l'UNICEF
qui indiquent qu'à partir de six mois , tous les enfants devraient
recevoir une alimentation de complément, car à partir de cet
âge, le lait maternel seul n'est plus suffisant pour assurer une
croissance optimale de l'enfant. Il est recommandé que les enfants de
6-23 mois soient allaités et nourris avec au moins quatre groupes
d'aliments différents et que les enfants allaités soient nourris
un nombre minimum de fois par jour selon leur âge1461. Les
enfants de 6-23 mois non allaités devraient consommer du lait ou des
produits laitiers chaque jour ainsi que quatre groupe d'aliments au moins
quatre fois par jour. Les résultats indiquent que ces recommandations
n'ont été appliquées que pour 5% des enfants
allaités et 4% des enfants non allaités1462.
Il existe aussi un rapport étroit entre le niveau
d'instruction de la mère et l'état de santé des enfants.
En effet, les différents indicateurs de morbidité et de
mortalité infantile et infanto-juvénile montrent des valeurs
significatives chez les enfants dont les mères ont un faible niveau
d'instruction1463. Cela se traduit surtout en milieu rural où
le taux d'alphabétisme des femmes1464 reste encore faible. En
effet, le taux de mortalité infantile a plus augmenté en milieu
rural qu'en milieu urbain du fait de la grande majorité des femmes
rurales analphabètes.
1461 Au moins deux fois par jour pour les enfants
allaités de 6-8 mois et, au moins, trois fois par jour pour les enfants
allaités de 9-23 mois.
1462 Ministère de la Santé et de la lutte contre
le SIDA (MSLS) et l'Institut National de la Statistique (INS) et ICF
International, Enquête Démographique et de Santé et
à Indicateurs Multiples de la Côte d'Ivoire 20112012 : Rapport de
synthèse. Calverton, Maryland, USA : MSLS, INS et ICF
International, 2013, p.11.
1463 RAVELOMANANA (T.), RAKOTOMAHEFA (M.), RANDRIANAIVO (N.),
RAOBIJAONA (S.H.), BARENNES (H.), « Education des mères et
gravité de l'état des enfants présentés aux
urgences de l'hôpital Joseph-Raseta-Befelatanana, Madagascar. Quelles
implications ? », Bull. Soc. Patho. Exot., Société
de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2010, 5p. ; Voir
également PANICO (L.), TO (M.) et THEVENON (O.), « La
fréquence des naissances de petit poids : quelle influence a le niveau
d'instruction des mères ? » , In. Population &
Sociétés n°523, Juin 2015, 4p. ; BAYA (B.), «
Instructions des parents et survie de l'enfant au Burkina Faso : Cas de
Bobo-Dioulasso » , Les dossiers du CEPED n°48, Paris,
Janvier 1998, 34p. ; BARBIERI (M.), Les déterminants de la
mortalité des enfants dans le tiers monde, 2ème
tirage, 1991, 40p.
1464 Lors de la cérémonie du lancement de la
campagne de sensibilisation et de lutte contre l'analphabétisme dans la
région du Iffou en date du 05 novembre 2014, Mme Marie-Reine OGOU,
directrice régionale de l'Education nationale et de l'enseignement
technique (DRENET) de Daoukro, au niveau national ivoirien, la population
analphabète est de 51%, avec une proportion de 62% chez les femmes qui
va jusqu'à 70% en milieu rural ; MBOW (P.), Analphabétisme,
pauvreté des femmes : cas du Sénégal, UNESCO-AFRIQUE,
Dakar, Mars 1993, n°6.
515
Les difficultés d'accès aux services sociaux de
base constituent en outre, une autre forme de résistance sous-jacente
qui entame la vie et la survie des enfants en Côte d'Ivoire.
2. Les difficultés d'accès aux services
sociaux de base
Elles se résument au faible accès à l'eau
potable1465 ainsi qu'un déficit d'assainissement
adéquat1466.
En Côte d'Ivoire, une partie importante des
ménages ruraux et les ménages urbains pauvres vivant souvent dans
les quartiers précaires et les bidonvilles1467, n'ont pas
accès à l'eau potable. Selon les résultats de la MICS
2000, un ménage sur cinq n'avait pas accès à l'eau potable
avec de fortes disparités entre le milieu urbain (11,2%) et le milieu
rural (25,8%). Plus récemment, les résultats de la MICS 2012
évaluaient à 78 % le nombre de ménages utilisant des
sources améliorées pour l'eau de boisson1468.
Au-delà de ces chiffres, on constate qu'en zone rurale, le contact et la
consommation directe de l'eau de puits, de marigots, de rivières sans
traitement préalable sont fort répandus malgré quelques
efforts
1465 FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, Côte d'Ivoire :
Stratégie de réduction de la pauvreté Rapport d'Etape au
titre de l'année 2009 du FMI, n°09/156, Juillet 2009,
pp.67-68. ; TIA (L.) SEKA (G.), « Acteurs privés et
approvisionnement en eau potable des populations de la commune d'Abobo
(Côte d'Ivoire) ». Revue canadienne de géographie
tropicale/Canadian journal of tropical geography (en ligne), vol. (2).,
pp.15-28. URL :
http://laurentienne.ca/rcgt
(Consulté le 20 novembre 2015) ; OMS et UNICEF, Atteindre l'OMD
relatif à l'eau potable et à l'assainissement : le défi
urbain et rural de la décennie. Genève, OMS. 2007.
1466 L'assainissement concerne divers domaines tels que
l'évacuation des eaux usées et de ruissellement,
l'évacuation des déchets solides, l'évacuation des
excréta et le traitement de tous ces éléments.
Malgré son importance pour la santé, l'assainissement n'est pas
développé en Côte d'Ivoire. En effet, très peu de
villes disposent de schémas directeurs d'assainissement encore moins de
système d'assainissement ; voir à ce sujet : FONDS MONETAIRE
INTERNATIONAL, Côte d'Ivoire : Stratégie de réduction
de la pauvreté Rapport d'Etape au titre de l'année 2009 du
FMI, n°09/156, Juillet 2009, pp.66-67.
1467 PNUD, Diagnostics et plans d'amélioration des
quartiers précaires des 13 communes du District d'Abidjan, 2014,
155 p. ; YAO, (K. P.), Développement urbain et prolifération
des quartiers précaires à Abidjan : le cas du quartier Banco 1
(commune d'Attécoubé), Institut National Polytechnique
Houphouët Boigny de Yamoussoukro, 2010, 115 p. ; GRISOT (M.), Abidjan
rase les bidonvilles des quartiers à risques , disponible sur :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/03/abidjan-rase-les-bidonvilles-des-quartiers-a-risques_4499834_3244.html
( consulté le 12/10/2015) ; Lire aussi : ONU-HABITAT: Guide pour
l'Evaluation de la Cible 11 : Améliorer sensiblement la vie de 100
millions d'habitants des bidonvilles. Nairobie, 2003, 19 p. ; ONU-HABITAT,
Sortir des bidonvilles : un défi mondial pour 2020, Nairobi,
2012, 75 p.
1468 MINISTEREDE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA (MSLS)
et l'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) et ICF International,
Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples de la Côte d'Ivoire 2011-2012 : Rapport de
synthèse. Calverton, Maryland, USA : MSLS, INS et ICF
International, 2013 p.24.
516
entrepris par les pouvoirs publics. En outre, il est parfois
donné de constater que le recours à l'eau de puits et de marigot
est lié à des jugements de valeur. Ainsi, relativement aux
habitudes de consommation en eau, en milieu rural, certaines populations
accordent la préférence à l'eau de puits ou des sources
tout simplement parce qu'elle aurait un meilleur goût que l'eau de pompe.
Cette eau non potable est utilisée aussi bien pour la cuisine, la
lessive que pour la toilette, notamment des nouveau-nés. Par ailleurs,
les points d'eau existant ne bénéficient d'aucune mesure de
protection particulière et constituent l'endroit idéal pour les
jeux des enfants ou de consommation d'eau pour les animaux
domestiques1469. De telles attitudes et comportements exposent ainsi
de nombreuses populations, notamment les enfants à des risques de
contamination certaine par les maladies hydriques1470 et
liées au manque d'hygiène.
Suivant les estimations du JMP 2014, environ 80% des ivoiriens
ont accès à une source d'eau
améliorée1471. L'accès est plus
élevé en milieu urbain (92%) par rapport au milieu rural (68%).
Néanmoins, il faut noter que peu de progrès véritable
empêchera probablement la Côte d'Ivoire d'atteindre ses cibles de
l'OMD pour ce qui a trait à l'eau potable. Il faut noter que
l'accès à une source dite « améliorée
» ne garantit ni la durabilité, ni la qualité de
l'accès à l'eau potable1472. En effet, la faible
maintenance des systèmes et des points d'eau est l'une des grandes
problématiques du secteur, notamment en milieu rural. Pour ce qui est de
la qualité de l'eau, le système international de monitorage mis
en oeuvre par l'Unicef et l'OMS considère seulement le type
d'infrastructure et non pas la qualité de l'eau à la source. Le
JMP estime que le type d'infrastructure permet d'évaluer la
potabilité de l'eau. Il demeure néanmoins
préférable de tester la qualité de l'eau, un
élément prévu par le système de monitorage
post-20151473. Ici, ce système de monitoring fournit
l'information nécessaire
1469 Ceci est visible dans nombre de lieux du pays, et
même au quartier dioulabougou situé dans la capitale politique du
pays (Yamoussoukro) que nous avons visité en juillet 2017.
1470 LARBI BOUGUERRA (M.), « Eau et santé
»in La Mise en oeuvre du droit à l'eau, Actes du XXIXème
Congrès ordinaire de l'IDEF, Schultess, 2006, p.125.
1471 JOINT MONITORING PROGRAMME (JMP) : Données pour
la Côte d'Ivoire (Links), 2014.
1472 SHAHEED (A.), Why « improved » water
Sources are not always safe. WHO Bulletin, Apr 2014.
http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3967570/
(consulté le 04/03/2015).
1473 WASH, Targets and indicators post-2015:
Recommendations from international Consultations, Avril 2014. WSSCC.
(http: //
www.wsscc.org/sites/default/hles/post-2015_wash_targets_factsheet_12pp.pdf.
(Consulté le 25/06/2015)
517
pour évaluer la marche de tout programme sanitaire et
permet de faire des ajustements pendant son exécution.
Les ménages qui s'approvisionnent aux sources publiques
doivent transporter et stocker l'eau. L'eau potable risque d'être
contaminée par les ménages lors du transport et du stockage de
l'eau puisée aux sources publiques. Le mode de stockage, notamment
l'utilisation de récipients non-nettoyés
régulièrement, serait un grand vecteur1474de la
contamination des eaux. Cette contamination est difficilement évitable
en raison des comportements négatifs persistants. La promotion des
moyens de traitement de l'eau à domicile (filtres et produits
chlorés), la sensibilisation des populations en découlant visent
à remédier à ce problème.
En matière d'assainissement1475, la
majorité des ménages, notamment en zone rurale, ne dispose pas de
systèmes d'égouts, ni de caniveaux de drainage des eaux
usées et pluviales1476. En 2000, seulement,
un ménage sur deux (59,1%) disposait de moyens adéquats
d'évacuation des excréta, dont 80,2% en milieu urbain et 36,8% en
milieu rural. Cela cause des problèmes de stagnation des eaux
usées et pluviales qui constitue des endroits ou les enfants aiment
fréquemment s'amuser. Ce faisant, nombre d'entre eux finissent par
contracter certaines maladies.
Suivant le JMP 2014, seulement 22% de la population a
accès à une installation d'assainissement
améliorée, 33% en milieu urbain et 10% en milieu rural. Le
pourcentage de la population n'ayant pas accès à une latrine et
qui pratique la défection à l'air libre est très
élevé : 28% au niveau national, 6% en milieu urbain et 51% en
milieu rural. Cette situation expose les enfants au risque de contamination par
des parasites tels les vers intestinaux pour lesquels un traitement
médicamenteux n'est efficace qu'à court
terme1477.
1474 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en
Côte d'Ivoire 2014. Vers une société plus équitable
dans un pays émergent, p.53-54.
1475 GUISSE (E.H.), Rapport entre la jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels et la promotion de la
réalisation du droit à l'eau potable et à
l'assainissement, E/CN.4/Sub.2/2002/10 du 25 juin 2002, pp.10-13.
1476 DONGO (K.), KOUAME (F.K), KONE (B.), BIEM (J.) TANNER
(M.), CISSE (G.), « Analyse de la situation de l'environnement sanitaire
des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de Yopougon
à Abidjan, Côte d'Ivoire », Vertigo-la revue
électronique en sciences de l'environnement, Vol. 8, n°3 ?
Décembre 2008, disponible sur
http://vertigo.revues.org/6252
(Consulté le 06 /06/2017).
1477 UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en
Côte d'Ivoire 2014. Vers une société plus équitable
dans un pays émergent, p.53-54.
518
En outre, la mauvaise gestion des ordures
ménagères1478 ou des
déchets1479contribue à accroitre les
risques de maladie des populations, notamment chez les enfants. En effet,
l'accroissement de la population dans les villes a mécaniquement
entrainé celui de la production d'ordures ; cependant, les besoins
exprimés en termes d'évacuation et les systèmes de
collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que des
eaux usées, surtout en milieu urbain, reste encore une
préoccupation pour le Gouvernement et les populations. Par exemple,
à Abidjan, le ramassage des ordures ménagères par camion
qui assurait plus de la moitié des évacuations traverse une crise
de gestion des déchets du fait de la forte croissance
démographique qui impose une demande de plus en plus forte à des
capacités gouvernementales insuffisantes. Ainsi, voit-on se
développer parallèlement, un réseau informel de type
privé pour le ramassage des ordures qui lui-même se heurte au
problème de l'acheminement des ordures collectées vers la
décharge d'Akouédo1480 soumise à un progressif
engorgement. Dans les autres villes, les pratiques sont similaires à
celles du milieu rural. En effet, les décharges y sont mal
aménagées et la nature environnante (caniveaux, broussailles,
ruelles, etc.) se transforme en de véritables
dépotoirs1481.
Cela explique en partie les cas de contamination en
matière fécale chez les enfants de moins de cinq ans. D'où
les morbidités telles que la malnutrition, les maladies
diarrhéiques, la dysenterie, le choléra, etc. chez les enfants de
moins de cinq ans. En ville particulièrement, l'industrialisation
croissante de l'économie et les habitudes quotidiennes engendrent des
déchets toxiques et produisent progressivement une pollution
urbaine1482. Tout ceci concourt
1478 AMANDINE (H.), « Centralisation,
décentralisation et accès aux services urbains : le cas de
l'enlèvement des ordures ménagères à Abidjan
», Belgeo, 3-4, 2009, pp.425-438.
1479 SANE (Y.), « La gestion des déchets à
Abidjan : un problème récurrent et apparemment sans solutions
», In. African Journal of Environmental Assessment and
Management, 4,1, 2002, pp.13-22.
1480 ADJIRI (O.A.), MAFOU (C.K.), KONAN (P.K.), « Impact
de la décharge d'Akouédo (Abidjan-Côte d'Ivoire) sur les
populations : étude socio-économique et environnementale »
In. International Journal of Innovation and Applied Studies, vol.13.
N°4, Déc.2015, pp.979-989. ; SANE (Y.), « La gestion des
déchets à Abidjan : un problème récurrent et
apparemment sans solution », Revue africaine de gestion et
d'évaluation environnementale, vol.4, n°1, 2000, pp.5-10.
1481 ADEPOJU (G.O.) et KUMUYI (A.J.), « Chapitre 1
: La gouvernance et la gestion des déchets en Afrique » dans :
O.G. Adepoju, KUMUYI (J.A.), KOFFI A., A.J.L. MOUGEOT, LUSUGGA K.M.J.,
SWWILLING M.et HUTT D., La gestion des déchets urbains : des solutions
pour l'Afrique, CRDI/Editions Karthala, 2002, pp.5-10.
1482 GBINLO (R.), Organisation et financement de la
gestion des déchets ménagers dans les villes de l'Afrique
Subsaharienne : le cas de la ville de Cotonou au Bénin. Economies
et finances, Thèse de doctorat, Université d'Orléans,
2010, pp.18-21.
519
à une dégradation de plus en plus marquée
du cadre de vie et de l'environnement qui est responsable de nombre de maladies
affectant considérablement la santé des enfants.
C. LES RESISTANCES STRUCTURELLES
Au plan structurel, on relève des causes
d'ineffectivité liées aussi bien à la gestion et
l'inadaptation des politiques sanitaires et à des contraintes
économiques ainsi qu'à des pesanteurs socioculturelles.
1. Les facteurs liés à la gestion et
à l'inadaptation des politiques sanitaires et à des contraintes
économiques
Ces facteurs tiennent au mauvais ciblage des politiques
nutritionnelles, aux inégalités dans la distribution
régionale et intra-ménage des denrées alimentaires.
Un mauvais ciblage des politiques
nutritionnelles1483 apparait comme l'une des causes structurelles
des atteintes à la vie et aux problèmes de survie de l'enfant.
L'un des arguments qui font défaut à cette politique est
l'exécution de transferts bien ciblés envers les enfants les plus
touchés, c'est-à-dire ceux vivant dans les zones rurales les plus
reculées et ceux qui vivent en milieu urbain dans des conditions
d'insalubrité permanente. Aussi, note t'on, le manque de
cohérence avec les habitudes alimentaires des populations surtout celles
du milieu rural. Les programmes nutritionnels sont en effet basés sur la
juxtaposition des principes diététiques modernes aux
systèmes alimentaires des populations. La conséquence est la
mauvaise adoption des nouveaux régimes par les populations, surtout
lorsqu'il s'agit de mères ayant un niveau de scolarisation faible.
Les inégalités dans la distribution
régionale et intra-ménage des denrées alimentaires1484 ont
aussi des répercussions sur les disponibilités alimentaires. Il
en résulte une réduction de
1483 MAIRE (B.), DELPEUCH (F.), PADILLA (M.), LE BIHAN (G.),
« Le ciblage dans les politiques et programmes nutritionnels »,
In. Researchgate, Janvier 1993, pp34- 57. ; MAIRE (B.), DELPEUCH
(F.),TRAISSAC (P.), Aspects statistiques du ciblage des politiques et
programmes nutritionnels dans les pays en développement, pp.79-98.
disponible sur
www.horizon.documentation.ird.fr
(consulté le 15 décembre 2016).
1484 DIRECTION DES STATISTIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DE
L'INFORMATIQUE (DSDI) DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE (INS), Rapport sur la dynamique de la consommation
alimentaire en Côte d'Ivoire, Mars 2011, pp.48-58. ; AKINDES
520
la consommation par tête et une dégradation
automatique du bien-être nutritionnel des groupes les plus
défavorisées et vulnérables que sont les enfants. De
même, avec la crise économique1485, la
raréfaction des ressources étatiques s'est traduite par la
réduction des subventions aux produits alimentaires de première
nécessité pour les ménages urbains. En conséquence,
la réduction du pouvoir d'achat des ménages qui s'en est suivi a
aussi réduit les marges d'amélioration de leurs régimes
alimentaires. Dans de telles conditions, il n'est pas rare de retrouver des
enfants de moins de cinq ans souffrant de carences alimentaires1486 qu'il est
indispensable de combler pour leur garantir une croissance normale. De
même, les cas de malnutrition et d'anémie sont étroitement
liés à la faiblesse de l'allaitement maternel ainsi qu'à
des habitudes et pratiques alimentaires défavorables.
2. Les pesanteurs socio-culturelles
En Afrique, et notamment dans certaines zones rurales
ivoiriennes, il existe certaines conceptions selon lesquelles, il n'est pas
conseillé de donner certains aliments à manger aux enfants car
ceux-ci sont susceptibles de faire des enfants de petits voleurs ou encore des
amorphes. Ainsi, au sein des ménages, la répartition de la
nourriture entre les membres n'est souvent pas à l'avantage des enfants
et surtout lorsqu'il s'agit de ménages ruraux. Les enfants sont souvent
exposés au risque de malnutrition
protéine-énergétique à cause des interdictions qui
pèsent sur leur régime alimentaire en ce qui concerne certains
aliments riches en protéines (viande, poissons, oeufs, ...) qui, pour la
plupart de temps sont réservés aux adultes et aux plus
âgés. Heureusement, ces pratiques commencent à
disparaître.
Les causes de l'ineffectivité du droit à la vie
et à la survie ayant été examinées, il importe de
mettre en exergue celles tenant à l'ineffectivité du droit au
développement des enfants.
(F.), « Dévaluation et alimentation »,
Les Cahiers de la Recherche-Développement (40), CIRAD, Paris,
1995, pp.24-42.
1485 BRICAS (N.), « L'effet de la crise sur
l'alimentation des populations urbaines en Afrique » In Crise et
population en Afrique. Crise économique, politique d'ajustement
structurel et dynamiques démographiques, VALLIN, J. et COUSSY, J.
eds., Les Etudes du CEPED (13), Paris,
EHESS-INED-INSEE-ORSTOM-Université de Paris VI . pp.183-207.
1486 CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRINITION (CNN)-REPUBLIQUE DE
COTE D'IVOIRE, Analyse de la situation nutritionnelle en Côte
d'Ivoire, rapport Juillet 2015, pp.7-12. ; Lire aussi, AGUAYO
(V.M.) ADOU (P.), « La malnutrition en Côte d'Ivoire : un
appel à l'action » In. African Journal of Food and Nutritional
Sciences Vol 2 n°2 ? 2002, pp. 86-91.
521
§ 2. LES CAUSES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT AU
DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT
On examinera successivement les causes intrafamiliales (A) et
les causes extra-familiales de l'ineffectivité du droit au
développement (B).
A. LES CAUSES INTRAFAMILIALES DE L'INEFFECTIVITE DU
DROIT AU DEVELOPPEMENT
L'examen des causes intrafamiliales amène à
distinguer successivement les causes liées à l'environnement
familial et scolaire (1), les autres causes imputables à la famille (2)
ainsi que celles qui sont directement imputables aux enfants eux-mêmes
(3).
1. Les causes liées à l'environnement
familial et scolaire
Les difficultés socio-familiales et affectives, le
surcroît de travail chez les élèves, la faible perception
de l'importance de l'école par les jeunes et les carences alimentaires
sont autant de facteurs explicatifs de l'ineffectivité partielle du
droit au développement.
Les difficultés affectives rencontrées par de
nombreux enfants dans le cadre des familles incomplètes,
dissociées, avec les mères isolées ainsi que les
maladresses d'éducation affective contribuent à consolider les
fixations et les conflits affectifs qui devraient être surmontés
à la fin de la deuxième enfance (entre 3 et 6
ans)1487. C'est ce qu'on observe chez les enfants distraits,
opposants, butés ou chapardeurs ; ces difficultés qui peuvent
conduire à un désintérêt pour l'école,
constituent également des obstacles au développement des
capacités mentales de ces enfants et donc à un faible niveau de
rendement scolaire. Au cours de l'adolescence, les changements physiologiques,
psychologiques, et de comportements contribuent à accentuer les
difficultés des enfants.
De nombreux enfants sont également soumis à un
surcroit de travail tant à l'école qu'à la maison,
notamment dans les familles démunies où les enfants participent
très tôt et de façon active aux différentes
activités domestiques et ou économiques de leur famille. Ainsi,
la charge de travail qu'ils subissent ne leur permet pas toujours d'avoir le
temps nécessaire
1487 LAARABI (S.), Les stratégies publicitaires :
le marché de l'enfant, Mémoire de recherche, Ecole
supérieure de technologie, 2007, p.11.
522
pour apprendre et assimiler les différentes disciplines
enseignées à l'école et peut expliquer les faibles
rendements constatés chez de nombreux élèves issus de
familles pauvres1488.
Quant aux carences alimentaires, pour de nombreux
élèves, le nombre de repas consommés est insuffisant en
quantité à cette période de croissance et de changement
physiologique. En effet, les données recueillies sur le terrain
révèlent que certains élèves ont un repas par jour,
tandis que d'autres ont deux repas ou trois repas par jour suivant leur origine
familiale1489. La qualité nutritive des mets est aussi un
problème en milieu scolaire où se pose déjà le
nombre insuffisant de cantines scolaires sur le territoire
national1490.
2. Les autres causes imputables à la
famille
La faible perception des missions de l'école, la non
déclaration des naissances à l'état civil1491,
le nombre élevé d'enfants à charge1492,
l'utilisation des enfants comme force de travail, une mauvaise
appréhension des rôles éducatifs et de la démission
des parents, la pénibilité des tâches de la mère,
l'absence de communication entre parents et enfants sont autant de causes
imputables à la famille et qui minent également
l'effectivité du droit de l'enfant au développement.
Aujourd'hui, le nombre de jeunes diplômés sans
emploi tend à renforcer les préjugés selon lesquels
l'école ne garantit pas nécessairement une réussite
professionnelle ou sociale. D'où une faible perception des missions de
l'école. Par ailleurs, le nombre important d'analphabètes dans
les hauts niveaux de la vie économique et politique exerce une influence
sur certains parents qui préfèrent intégrer très
tôt leurs enfants à leurs activités agricoles ou
commerciales ou encore à l'apprentissage d'un métier, au
détriment d'une scolarisation
1488 Lire également, SCHLEMMER (B.), « Le BIT, la
mesure du travail des enfants et la question de la scolarisation »,
Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs,
Hors-Série n°1, « Pouvoirs et mesure en éducation
» (A. VINOKUR, coord.), 2005, pp.229-248.
1489 Entretien réalisé avec des
élèves des villes de Yamoussoukro, Abidjan, Bouaké, Taabo,
Daloa
1490 DIRECTION NATIONALE DES CANTIQUES SCOLAIRES MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, Programme d'alimentation
scolaire et du programme intégré de pérennisation des
cantines scolaires, 2017, 23p.
1491 CANTRELLE (P.), L'état civil en Afrique
sub-saharienne : historique d'un malentendu et espoirs pour l'avenir,
Communication préparée pour la Conférence Africaine sur la
Population, Johannesburg, Afrique du Sud, session 61 : L'Etat civil en Afrique
: quelques enjeux, 2015, 34p. ; UNICEF, L'enregistrement à la
naissance : un droit pour commencer. Digest Innocenti, n°9 Mars 2002,
31p. ;
1492 En effet, il est évident que les ménages
pauvres composés de plusieurs enfants, se voient dans l'obligation de
faire un choix quant aux enfants à scolariser.
523
jugée longue, coûteuse et inadaptée au
marché de l'emploi. Cette tendance semble être prononcée
chez les parents analphabètes ou d'un niveau d'instruction faible.
Le nombre élevé d'enfants à charge est
aussi une cause imputable à la famille : Dans de nombreuses familles, le
nombre d'enfants est non seulement élevé mais en plus,
l'intervalle qui sépare deux naissances reste court, notamment en milieu
rural. Chaque année, plusieurs parents se trouvent confrontés
à une forte demande en matière de scolarisation et les parents
n'arrivent pas à assurer convenablement la prise en charge des enfants.
Cette situation est due à la non pratique du planning
familial1493. Pour chaque enfant, les familles devront alors faire
face aux nombreuses dépenses scolaires (frais d'inscription, tenues
scolaires, manuels, cahiers, et autres frais liés à la
scolarisation). Ainsi, les stratégies en matière de scolarisation
sont orientées par les capacités à scolariser un certain
nombre d'enfants ou à privilégier les garçons au
détriment des filles. Ainsi, les autres enfants devront attendre
d'éventuelles opportunités pour accéder à
l'école à un âge avancé, ou être
orientés vers un système d'apprentissage plus ou moins formel,
moins long et engageant moins de frais.
Comme il a déjà été dit,
l'utilisation des enfants comme force de travail compromet aussi le
développement de l'enfant. En milieu rural et dans certaines petites
entreprises ou industries du secteur informel1494, certains
élèves sont des forces de travail quotidiennes et
sollicitées pour les activités économiques. Ils
constituent une main d'oeuvre pratique et corvéable et bon marché
pour les travaux agricoles et les activités ouvrières qui,
répandues sur presque toute l'année scolaire, constituent la
principale source de revenu de nombreux ménages ruraux et urbains
défavorisés. Ainsi, il est fréquent de constater qu'en
pleine année scolaire, de nombreuses familles, principalement agricoles,
retirent leurs enfants de l'école pour les faire participer aux travaux
champêtres, notamment dans les régions du Nord, du Nord-Est et du
Nord-Ouest1495.
Une mauvaise appréhension des rôles
éducatifs et la démission des parents mettent aussi
sérieusement à mal l'éducation des enfants.
1493 ZAKARI (C.), « Les facteurs de la contraception au
Burkina Faso », In. La planification familiale en
Afrique, n°5, 2005, p. 51.
1494 BONNET (M.), « Le travail des enfants en
Afrique », Revue internationale du travail, vol. 132, n/ 3,1993,
pp. 411-430. ; JACQUEMIN (M.), « Travail domestique et travail des enfants
: le cas d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) ». In:
Tiers-Monde, tome 43, n°170, 2002, pp. 307-326. ; GUEU (D.),
« Le travail des enfants dans les marchés de nuit d'Abidjan
», European scientific journal, 2012, 177-186.
1495 Entretien avec des instituteurs à Bondoukou, Korhogo,
Bouna et Odienné.
524
Pour beaucoup d'enfants, comme cela est fréquent chez
les filles-mères, les femmes vivant dans les familles
monoparentales1496, en milieu rural et même dans certaines
familles urbaines biparentales, le père est très souvent
démissionnaire de son rôle éducatif. Car l'on a toujours
considéré que l'éducation des enfants est une fonction
essentiellement dévolue à la femme. Ainsi, même quand ils
sont présents, certains pères ne participent qu'à
l'éducation de leurs enfants que sur le plan économique. Et, les
marques d'attention les plus observées se traduisent souvent en termes
de représailles. Dans ce contexte, la mère presque toujours
occupée et sans moyens, ne peut à elle-seule, assurer une
éducation totale du petit enfant, qui pourtant a besoin d'une
présence paternelle, garante d'une sécurité affective et
émotionnelle. D'autres encore et dans la majorité des cas, sont
convaincues que l'éducation de l'enfant se résume à son
alimentation et aux soins qui lui sont apportés, négligeant ainsi
le champ des relations sociales à travers lesquelles l'enfant, dans la
famille et à l'école où avec d'autres enfants de son
âge s'initie, par le jeu, aux premiers apprentissages de la vie sociale.
Malheureusement, de nombreuses mères sont ignorantes en matière
de suivi sanitaire et nutritionnel de leurs enfants. En matière
d'éducation, la plupart des parents s'impliquent très peu ou pas
du tout dans le suivi scolaire1497 de leurs enfants qu'ils
considèrent comme relevant exclusivement des enseignants et du
système éducatif coupé de la famille ; pourtant, il
revient à la famille de favoriser l'assimilation de l'enseignement
reçu à l'école. Ainsi, au retour de l'école,
certains élèves n'ont pas la chance d'être encadrés
à la maison afin de se faire expliquer les enseignements qu'ils
n'auraient pas compris ; De la sorte, les lacunes s'accumulent et les
résultats scolaires sont peu satisfaisants.
Le contexte socioculturel traditionnel influence dans une
large mesure les comportements des parents et ce, par le biais de l'absence de
communication entre parents et enfants. En
1496 ALGAVA (E.), Les familles monoparentales : des
caractéristiques liées à leur histoire matrimoniale,
DRESS, Etudes et Résultats, n° 218, février 2003 ;
SECHET(R.), DAVID (O.), QUINTIN(P.), « Les familles monoparentales et la
pauvreté », In. La Documentation française, Les
Travaux de l'Observatoire national de la pauvretéì et
de l'exclusion 2001-2002, 2002, pp. 247-290.
1497 Cela est surtout vrai pour les parents
analphabètes et dans une moindre mesure pour nombre de parents instruits
qui faute de temps, n'arrivent pas à encadrer leurs enfants à la
maison. Mieux la plupart d'entre eux attend le résultat final en fin
d'année scolaire pour savoir si oui ou non l'enfant est admis en classe
supérieure ; BERGONNIER-DUPUY (G.) & ESPARBES-PISTRE (S.), «
Accompagnement familial de la scolarité : le point de vue du
père et de la mère d'adolescents (en collège et
lycée) ». In.. Les sciences de
l'éducation-Pour l'Ere Nouvelle, vol.40, n°4, 2007, pp.21-45.
; DESLANDES (R.) & CLOUTIER (R.), « Pratiques parentales et
réussite scolaire en fonction de la structure familiale et du genre des
adolescents ». Revue française de pédagogie, vol. 151,
n°1,2005, pp.61-74.
525
effet, en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays
d'Afrique, les enfants sont soumis à une autorité parentale qui
n'accorde que peu d'importance au dialogue entre parents et enfants. Les
problèmes liés à la sexualité, restent en bien de
lieux, notamment dans les campagnes, encore considérés comme un
tabou.
3. Les causes imputables aux enfants
Entre six (6) et douze (12) ans, la plupart des enfants ne
perçoit pas encore l'utilité de l'école qui apparaît
pour eux comme un endroit de rencontres avec d'autres élèves avec
lesquels ils entretiennent des relations de jeux. L'école n'est pas
encore perçue comme un lieu d'apprentissage devant permettre une
préparation à la vie d'adolescents et d'adultes. Cette perception
de l'école peut constituer chez certains élèves, une
raison suffisante pour la recherche du moindre effort. Ainsi, certains
élèves en milieu rural préfèrent se consacrer
à des activités moins contraignantes et plus oisives telles que
les parties de chasse, de pêche, de baignade. Ce qui peut expliquer le
niveau du taux de redoublement1498 et d'abandon ou de
déperdition scolaire1499.
L'ampleur des problèmes auxquels sont confrontés
les jeunes met également en lumière le faible niveau de
connaissance et de prise de conscience de la gravité des fléaux
actuels.
De nombreux jeunes ignorent encore ou négligent les
dangers auxquels ils s'exposent en adoptant des comportements à risques,
ainsi que leur rôle au sein de la famille et de la société.
Certains jeunes ont une mauvaise perception de la réalité
socio-culturelle et économique du pays. Alors, l'oisiveté
à laquelle ils sont soumis les conduit peu à peu à
s'adonner aux vices liés à la consommation de
tabac1500, d'alcool et à la sexualité à risque.
Les problèmes qui
1498 Ministère de l'éducation
nationale-Direction de l'Informatique, de la Planification, de l'Evaluation et
des Statistiques (DIPES), L'état de l'école en Côte
d'Ivoire. Rapport d'analyse, 2008-2009, pp.57-60. Disponible sur
www.men-dpes.org ; CONFEMEN,
BERNARD (J.-M.), SIMON (O.) VIANOU (K.), Le redoublement : mirage de
l'école africaine ? Programme d'analyse des systèmes
éducatifs de la CONFEMEN, 2005, 100p. ; EISEMON (T.O),
Réduire les redoublements : problèmes et
stratégies, Unesco, Paris, 1997, 59p.
1499 NCHO LAUGBA (A.D.), Déperdition scolaire,
emploi et niveau de vie à Abidjan : cas des jeunes femmes des communes
de Cocody et Yopougon, pp.3-4, disponible sur
www.erudite.univ-paris-est.fr/evenements/colloques
(Consulté le 20/12/2016) ; SAWADOGO (B. J.) et SOURA (A.B.),
L'abandon précoce en milieu scolaire : Analyse et recherche de
modèle explicatif, ROCARE, Décembre 2002, pp.28-44. 1500
Selon l'OMS, le tabagisme tue près de six millions de personnes chaque
année, dont plus de 600000 fumeurs passifs (Source : WHO Global
Health Risks : Mortality and burden of disease attibutable toselected major
risks. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009).
526
minent les enfants et les adolescents persistent et
s'amplifient, très souvent avec la complicité de certains
responsables politiques, administratifs et municipaux ainsi que celle de
certains parents, qui n'hésitent pas à installer leur commerce de
boissons dans les quartiers et aux abords des
écoles1501.
Une autre catégorie de résistances affectant le
développement ou l'éducation de l'enfant relève de
facteurs de nature sous-jacente.
B. LES CAUSES EXTRA FAMILIALES
Seront abordées successivement les causes directes
imputables à la communauté (1),les causes tenant à
l'insuffisance des services sociaux de base (2), les causes tenant à
l'inadéquation des services sociaux de base (3) et les contraintes
socio-économiques et culturelles affectant le développement
optimal de l'enfant (4) .
1. Les causes directes imputables à la
communauté
Les résistances imputables à la
communauté sont de plusieurs ordres : la précarité du
cadre et du niveau de vie, le problème de l'accessibilité
géographique, la libre circulation et l'accès facile aux
excitants, l'influence négative des médias, la faiblesse de la
sensibilisation, un faible accès aux loisirs en milieu scolaire et
familial. On en examinera quelques-unes à titre d'illustration.
S'agissant de la précarité du cadre et du niveau
de vie1502, en Côte d'Ivoire, de nombreux enfants issus de
familles démunies naissent et grandissent dans des conditions
d'existence difficiles. Le nombre de quartiers précaires et leur
augmentation met clairement en lumière la problématique de
l'encadrement de la petite enfance. En effet, le poids des bidonvilles, dans la
population pauvre de la ville d'Abidjan et dans nombre de provinces du pays,
1501 Une simple visite à Abidjan, notamment à
Yopougon , Abobo, Marcory et bien de villes de l'intérieur de pays
amène à observer que bien d'établissements scolaires ont
pour voisinage immédiats, de nombreux bars ou maquis tenus par des
parents d'élèves, des hommes publics et qui fonctionnent aussi
bien durant les heures de cours. Nombre d'élèves censés
être en classe s'y trouvent malheureusement aux heures de cours. Le
silence des autorités étatiques, notamment municipales
achèvent de surprendre, au vu de tous éléments et
notamment de l'âge des enfants fréquentant ces lieux.
1502 MENGOH (B.), Cadre de vie, pauvreté et
santé en milieu rural au Congo. L'exemple de la région de la
Sangha occidentale, In. Rev. CAMES-Série B, vol. 02,
2000, pp.47-58.
527
notamment, San Pedro1503 a grossi ; ce qui traduit
un durcissement ou une détérioration des conditions de logement
déjà précaires d'une partie de la population.
Au-delà de ce type de logements n'offrant pas des garanties de confort
et de sécurité, la précarité découlant de la
forte densité par rapport au nombre de pièces, induit un mode de
vie promiscuitaire défavorable à un encadrement sain de la petite
enfance, notamment dans les ménages pauvres. En outre, il y a le cas des
enfants qui naissent en prison ou en milieu rural où il n'existe aucune
structure d'encadrement de la petite enfance. De même, en matière
de scolarisation, l'on note une nette différence entre pauvres et non
pauvres ; en effet, les taux bruts de scolarisation (primaire et secondaire)
augmentent avec le niveau de revenu ; l'on constate une certaine
précocité dans l'inscription des enfants issus de ménages
non pauvres et un retard quand il s'agit de ceux de familles pauvres. En effet,
le coût total moyen d'éducation constitue une préoccupation
majeure pour bon nombre de parents et va même jusqu'à constituer
un obstacle à la scolarisation des enfants, notamment les filles. Pour
les familles démunies, les dépenses totales d'éducation
représentent parfois la moitié ou le tiers des dépenses
estimées. Et leurs enfants n'ont pas la totalité des fournitures
nécessaires à une scolarisation favorable malgré les
efforts des pouvoirs publics ces dernières années à
travers la distribution des kits scolaires1504.
Aussi, l'épineux problème de
l'accessibilité géographique, explique aussi la crise du droit
à l'éducation de l'enfant. Chaque jour de nombreux
élèves sont obligés de parcourir plusieurs
kilomètres pour avoir accès à l'école. Si à
Abidjan, la plupart des élèves bénéficient de la
quasi-gratuité du transport1505 pour se rendre dans leurs
écoles respectives, dans les autres villes et en milieu rural, les
élèves rejoignent leurs écoles à pied ou par
d'autres moyens de transport suivant la situation financière des
familles. Dans certains villages, ils sont obligés de traverser des
cours d'eau ou des zones de forêt, parce que ne disposant pas
1503 Située dans le sud-ouest de la Côte
d'Ivoire, La ville de SAN PEDRO est le deuxième pôle
économique du pays, en raison notamment du fait qu'elle abrite le
deuxième port du pays. Ce port est considéré comme le
premier port mondial en matière d'exportation de
fèves de
cacao.www.news.abidjan.net/h/527512.html(Consulté
le 15 Novembre 2016).
1504
http://news.abidjan.net/h/599278.html
(consulté le 25/01/2017).
1505 En effet, à Abidjan, les élèves et
étudiants bénéficient d'une subvention de l'Etat leur
permettant d'avoir droit à une carte de transport en bus moyennant
respectivement la somme de 3000 FCFA (soit 4, 573 euros) ou 5000 FCFA ( soit
7,622 euros) selon qu'ils sont inscrits en cours du jour ou cours du soir par
mois ; en revanche, il n'existe pas un tel système dans les autres
villes du pays ; les seuls existant relèvent des entreprises de
transport privé avec des coûts parfois élevés pour
certains parents. Sur les couts des cartes scolaires à Abidjan, voir
www.sotra.ci/www/s3/index.php/2014-10-24-15-43-20
(consulté le 17/06/2017).
528
d'école à proximité. Et durant toute
l'année scolaire, ces milliers d'enfants sont obligés de braver
les dangers de la circulation et les autres intempéries pour pouvoir
bénéficier des bienfaits de l'école. Ce problème
d'accessibilité géographique et ses corollaires conduisent
certains parents à ne pas scolariser leurs enfants ou même,
à pousser certains élèves à abandonner
l'école qui n'est pas toujours perçue dans ces fondements
socio-éducatifs.
S'agissant de la libre circulation et l'accès facile
aux excitants, il est à remarquer qu'en Côte d'Ivoire, la
commercialisation du tabac et de l'alcool est libre et très
étendue, eu égard à la floraison de kiosques à
tabac et de maquis-bars dans toutes les localités du territoire
national, même aux abords des collèges et lycées. Et
l'achat de ces différents produits par les enfants ne constitue aucune
préoccupation, ni pour certains adultes encore moins pour les
commerçants eux-mêmes. Aussi, les actions de promotion de
certaines grandes firmes de cigarettes et de tabac, sans restriction
d'âge ni présentation des dangers auxquels expose l'abus de ces
drogues, contribuent à renforcer leur forte circulation et à
favoriser un accès facile et une forte consommation par les enfants.
L'influence négative des médias1506
explique aussi les problèmes liés au développement des
enfants. Certains programmes proposés par les médias audiovisuels
ivoiriens sont inadaptés aux normes et valeurs prônées par
le système éducatif en général. En effet, de plus
en plus, les films présentés sur les antennes nationales font
l'apologie de la violence, du sexe, de la drogue, du banditisme, etc. Et les
larges diffusions dont ils font l'objet finissent par apparaître chez de
nombreux adolescents comme une norme, l'expression d'une certaine
liberté caractérisant les pays développés qui
continuent de constituer notre seul modèle de référence.
L'existence du phénomène « enfants microbes
»1507 en est une illustration. Le mode opératoire
des « enfants microbes » en Côte d'Ivoire est similaire
à celui des Kaluna ( enfants de la rue agissant principalement
à Kinshassa formant des gangs de jeunes délinquants au
Congo. Toutefois, l'inspiration du mode opératoire provient d'un film
brésilien à succès mettant en scène un gang
d'enfants dans les favelas. Le film en question
1506 LUTANGU SELETI (S-M.), Médias audiovisuels et
dépravation des moeurs. Constat fait aux enfants, adolescents et adultes
de KINSHASSA ; MLA, « Les enfants et les médias »In.
Paediatrics & Child Health. 4.5, 1999, pp.357-362. ; COMMISSION
FAMILLE, EDUCATION AUX MEDIAS, Rapport à l'attention de Madame
Nadine MORANO. Secrétaire d'Etat chargé de la Famille et de la
Solidarité, Juin 2009, p.8 disponible sur
www.ladocumentationfrançaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000516.pdf
(consulté le 14 janvier 2016).
1507
www.rfi.fr/emission/20150515-enquete-microbes-abidjan
(consulté le 17/06/2017).
529
est appelé la Cité de Dieu, film
brésilien, coréalisé par Fernando Meirelles et
Katia Lund sorti en 2002. Il est adapté du roman du même nom
écrit par l'auteur brésilien Paulo LINS en 1997 retraçant
l'histoire de ZEPEKIGNO qui commença une carrière d'enfant de la
rue avant de devenir un redoutable chef de gangs et narcotrafiquant. Cela
signifie que la commission de censure des programmes
télévisés1508 reste elle-même
limitée dans ses actions par une faible appréciation de leur
rôle dans l'information, l'éducation et le divertissement des
populations, notamment des enfants.
Au regard de l'importance des problèmes que rencontrent
les enfants, il est certain que les actions de sensibilisation sont
inexistantes ou insuffisantes ou alors inadéquates tant au niveau
familial, scolaire que des institutions d'information, d'éducation et de
communication. En effet, hormis les campagnes médiatisées et les
actions de certaines associations et Ongs sur les MST-SIDA, qui sont de plus en
plus adressées aux adolescents, aucune politique nationale ne se traduit
concrètement par des actions familiales, scolaires ou communautaires
devant informer les adolescents sur les différents problèmes de
la vie, en général et sur les questions socio-économiques
émergentes afin de les préparer à une vie adolescente et
adulte responsable. Par exemple, le dépistage précoce de
l'infection par le VIH SIDA se trouve encore confronté à quelques
réticences chez les adolescents qui peuvent s'expliquer par un manque
d'informations et de sensibilisation. En effet, la persistance de certains
préjugés (mauvaise connaissance de la maladie et de son mode de
transmission) et l'environnement social peu favorable à l'acceptation de
la maladie du SIDA (exclusion sociale des personnes infectées ou
maladies du sida), constituent autant de facteurs limitant l'efficacité
de la promotion d'un dépistage précoce1509.
A cela, s'ajoute le faible accès aux loisirs en milieu
scolaire et familial. On le sait : Le jeu, le sport et les loisirs ont pour
avantage, à travers les nombreuses occasions d'initiative, d'interaction
et de créativité, de développer chez l'élève
le goût de l'effort, l'amour de la lecture et du calcul, la maitrise du
langage et la stimulation de la mémoire, qui à long terme
1508 Pour plus d'infos sur cet organe, Voir Ordonnance
n°2011-75 du 30 avril portant érection du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle (CNCA) en Haute Autorité de la Communication
Audiovisuelle (HACA) et Décret n°2011-475 du 21 décembre
2011.
1509 UNICEF, Vers une génération sans sida.
Enfants et Sida. Sixième bilan de la situation, 2013, pp.2-3
disponible sur
www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/2013_rapport_vih_numero_6.pdf
(consulté le 03/05/2015); ETCHEPARE (M.), « La lutte contre le sida
en Afrique : perspectives et responsabilités ». Med.
Trop., 2004, pp.579-586.
530
favorise le processus d'intégration sociale non
seulement dans l'école, mais aussi dans la famille et dans la
société toute entière. Cependant, hormis les terrains de
football existant dans la plupart des écoles, il y a un manque
véritable d'équipements socio-éducatifs et sportifs tels
que les bibliothèques1510, les salles de musique ou des
espaces aménagés pour des activités autres que le
football. De la sorte, le champ de distraction et d'apprentissage des
élèves demeure restreint et exclut la possibilité pour
certains d'entre eux, d'avoir accès aux loisirs et aux divertissements
en milieu scolaire. En outre, de nombreux parents peu soucieux de l'importance
du divertissement à l'âge scolaire et/ou plus
préoccupés par les résultats scolaires, n'hésitent
pas à sacrifier le temps de repos et de divertissement de leurs enfants
au profit d'un surcroît d'heures d'études ou de travaux manuels
productifs. En Côte d'Ivoire, et singulièrement à Abidjan,
il n'est pas rare de constater que les habitats collectifs confiés aux
sociétés immobilières sont réalisés sur des
terrains où les risques de glissement et d'effondrement ne sont pas
à négliger1511. Les appartements construits sont
exigus et les plans d'urbanisme ne prévoient pas toujours des espaces
verts ou des salles de jeux nécessaires à l'accès des
jeunes aux loisirs, aux activités récréatives et
culturelles fondamentales à leur plein épanouissement physique et
psychologique1512.
En définitive, plusieurs élèves restent
encore soumis à des stratégies institutionnelles et familiales
qui exercent une pression sur l'instruction à outrance au
détriment du divertissement, pourtant nécessaire au
développement de leurs facultés mentales. Ce qui explique
souvent, la faiblesse des résultats scolaires chez certains enfants.
1510 En effet, il est aujourd'hui rare de voir dans les
lycées et collèges, des bibliothèques ; mieux quand elles
existent, elles sont peu équipées sinon disposent d'ouvrages
d'une ancienneté choquante. ; Face à ce problème, le
Gouvernement ivoirien a décidé en 2015 de construire une
bibliothèque appelée « La Bibliothèque de la
Renaissance africaine d'Abidjan (BRAA)». Elle sera bâtie sur une
superficie d'un hectare et logée dans les locaux de la Direction des
examens et concours (DECO). Se voulant à la fois numérique et
physique, cette bibliothèque figurera parmi les dix plus grandes
bibliothèques d'Afrique et sera la première d'Afrique noire."
http://news.abidjan.net/h/577058.html(consulté
le 12 Janvier 2016) ;
http://www.ppp.gouv.ci/uploads//Projet39.pdf
(consulté le 12 Janvier 2016).
1511 Récemment, l'effondrement de la dalle d'un
immeuble en Construction sur le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing
à Treichville a fait dix-huit victimes à Abidjan ;
déjà en date du mardi 07 janvier 2014, un immeuble s'était
effondré dans la commune de Yopougon au quartier Maroc faisant au moins
6 morts.
1512 MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME :
Législation et Réglementation et matière de Foncier et
d'Urbanisme. Fiches Instrumentales Annexées à la Directive
n° 94-01 du 21 novembre 1994, 56p. ; ALPHONSE (Y.D.), « Baraques et
Pouvoirs dans l'agglomération Abidjanaise », In Ville et
Entreprise, L'Harmattan, 2000, pp.25-63., pp.337/456.
531
532
2. Les causes tenant à l'insuffisance des services
sociaux de base
L'insuffisance et l'inégale répartition des
structures et du personnel, le manque de moyens matériels et logistiques
dans les structures sociales, la démotivation du personnel enseignant et
le faible rendement interne et externe du système éducatif
constituent à n'en point douter autant de résistances d'ordre
structurel qui mettent à mal le développement de l'enfant.
Sur l'ensemble du territoire national, on observe, une
insuffisance et inégale répartition des structures et du
personnel ; on dénombre peu de structures d'encadrement de la petite
enfance dont 40 centres de Protection de la petite enfance (CPPE) et 57 centres
sociaux. Et pour l'enseignement préscolaire, on compte aujourd'hui, 226
écoles et 1456 classes pédagogiques pour l'ensemble de la
Côte d'Ivoire. Au niveau de l'enseignement primaire, le ratio moyen de la
capacité d'accueil des élèves se situe à 43
élèves pour une classe. Cependant, dans certaines régions
et dans les grandes villes comme Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa
etc., il arrive fréquemment que les classes soient surpeuplées et
on peut enregistrer des ratios allant de 50 à 70 élèves
par classe. Ainsi, lors d'une récente cérémonie de remise
de table bancs au Lycée Moderne de Ferkessédougou en date du
samedi 29 octobre 2016 dont le donateur était le Président de
l'Assemblée Nationale, M. Guillaume SORO1513, le Proviseur,
M. GNONOGO Désiré Alala, a indiqué que l'effectif par
classe de sixième s'élevait à 125 élèves
contre un effectif de 105 par classe de troisième1514.
Toujours, selon le proviseur, cette situation pose de réels besoins en
ressources humaines, soit 43 professeurs, des éducateurs, des
inspecteurs d'éducation et d'orientation, mais aussi des besoins en
infrastructures (tables-bancs, bureaux d'enseignants), des problèmes
récurrents d'électricité, de manque de salles de
classe...1515
Au rythme de la croissance démographique de la
population scolarisable, on estime, selon le Ministère de l'Education
Nationale à 1000, le nombre de nouvelles classes qu'il faut construire
chaque année pour assurer l'encadrement des enfants qui ont accès
à l'école.
1513 Monsieur Guillaume SORO est l'actuel Président de
l'Assemblée nationale ivoirienne ; il fut également chef de la
rébellion armée qu'a connu la Côte d'Ivoire ; Il fut
également ministre ivoirien de la communication (Août 2004
à Aout 2005), ministre d'Etat, de la Reconstruction et de la
réinsertion (28 décembre 2005-4 avril 2007) et Premier Ministre
à deux reprises, à savoir du 4 avril 2007 au 6 décembre
2010, puis du 11 avril 2011 au 8 mars 2012.
1514
www.news.abidjan.net/h/603376.html
(consulté le 02/11/2016)
1515 Ibid.
Malheureusement, l'évolution du nombre des
écoles reste très faible et chaque année, plusieurs
enfants se voient refuser l'accès à l'école. Selon des
informations recueillies sur le terrain, de nombreux enfants ont
été refusés au CP1 par manque de place dans les
écoles primaires. Par ailleurs, le taux de redoublement au CM2
s'explique par l'impossibilité pour de nombreux élèves
d'avoir accès à la classe de 6ème. Ainsi comparée
à la population infanto-juvénile, ces structures offrent de
très faibles capacités d'accueil pour une réelle prise en
charge des groupes cibles. En outre, les structures existantes sont
inégalement réparties sur l'ensemble du territoire et
procèdent d'un phénomène urbain. En effet, la
quasi-totalité des structures est localisée dans la région
Sud. De même, les ressources humaines sont également insuffisantes
et inégalement réparties. Dans les zones rurales et la
région Nord du pays, le déficit a été
accentué par le programme de départ volontaire des enseignants de
la fonction publique et de la mise à la retraite automatique des
fonctionnaires après trente années de service
accompli1516. Selon la thèse du Dr Kangah, cinq enseignants
du primaire décèdent par semaine et leur indisponibilité
avant décès a duré 6,2 mois1517. L'auteur
montre que l'absentéisme des enseignants a une incidence sur des
élèves dont les résultats scolaires se sont
avérés mauvais. Tous ces facteurs ont provoqué un
déficit d'enseignants dont les conséquences se traduisent par la
faiblesse de l'encadrement des élèves et les mauvais rendements
scolaires qui en résultent. En outre, la trop grande mobilité du
personnel enseignant contribue à aggraver le déficit dans
certains établissements scolaires. En effet, pour beaucoup de
fonctionnaires et agents de l'Etat, certaines régions, notamment les
régions frontalières du Nord et les localités rurales,
apparaissent comme des terres d'exil. Du coup, l'on assiste très souvent
au niveau du personnel enseignant à une vacance de poste
illustrée généralement par des mutations hors commissions
ou par des certificats médicaux justifiant de nombreuses absences en
pleine année scolaire. L'incapacité des pouvoirs publics face aux
conséquences d'une telle morbidité ou vacance du personnel est
alors préjudiciable à une forte scolarisation et à
l'efficacité du système éducatif, particulièrement
dans les régions et les localités ci-dessus
énumérées.
1516 Voir DIABAGATE (I.), Problématique de la retraite
en Côte d'Ivoire : analyse comparative des systèmes de la CGRAE et
la CNPS, DEA Sociologie du travail et des entreprises, Université
d'Abidjan, 2008, 143p. 1517 KANGAH (A.), Le VIH/SIDA et le corps des
enseignants, quel impact sur le système éducatif ivoirien,
Thèse de doctorat de Médecine. UFR des Sciences médicales,
Université de Cocody, 1999, p.57.
533
La précarité des conditions de travail des
personnels sociaux se traduit également, outre l'absence et
l'insuffisance des structures, par un déficit notoire de moyens
matériels et logistiques. En effet, de nombreux centres sont
sous-équipés en matériel de bureau, en matériel
d'éveil socio-éducatif encore moins en logistique. Cela a pour
conséquence de limiter l'efficacité des actions menées
dans les centres existant dans les grandes villes mais surtout de rendre
limitative, voire, impossible une réelle couverture des autres villes et
des zones rurales où les besoins sont souvent plus accentués.
La crise politique et économique qui frappe le pays
avec ses corollaires comme le chômage, a contraint de nombreux jeunes
à se tourner vers le métier d'enseignant. Pour beaucoup d'entre
eux, ce choix s'est fait sans une connaissance approfondie des problèmes
relatifs à cette profession et sans une réelle motivation ou
encore une vocation pour ce travail. De fait, il existe une véritable
démotivation du personnel enseignant1518. Ainsi,
confrontés à des salaires jugés insuffisants, certains
enseignants se désistaient dans l'accomplissement de leur fonction
éducative1519. En outre, le surpeuplement des classes, le
sous-équipement en matériel pédagogique et didactique,
etc., concourent à démotiver bon nombre d'enseignants dont les
absences répétées, le laxisme et l'indifférence
vis-à-vis de la pratique pédagogique ont une mauvaise influence
sur la qualité des enseignements donnés aux
élèves.
S'agissant du faible rendement interne et externe du
système éducatif, notons que le système éducatif
ivoirien est en proie à certaines contradictions. D'abord, les
infrastructures ne permettent pas d'accueillir tous les enfants ayant
réussi à leur concours d'entrée en sixième ou au
BEPC ; les taux d'admission et de scolarisation des enfants au premier cycle et
au second cycle de l'enseignement secondaire se situent encore à un
niveau très bas. Certes
1518 KOFFI (A.P.), Inégalités
éducatives en Côte d'Ivoire : l'impact des pratiques
éducatives sur la performance des établissements publics
d'enseignement secondaire ivoiriens, 2011, pp.7-8., disponible sur
http://services.univ-rennes2.fr/reso/outils/INEDUC/Koffi-AffouePhilomene_ineduc2015.pdf
(consulté le 15/06/2017).
1519 Des salaires dits « à double vitesse ».
Ces salaires ont été à la base de nombreuses grèves
des enseignants, tant du secondaire que du supérieur au début.
BAMBA (N.), CONTAMIN (B.), DIOMANDE (K.) et KOULIBALY (M.),
Crise économique et Programmes d'ajustement structurel en Côte
d'Ivoire. Dans Crises et Ajustements en Côte d'Ivoire. Les dimensions
sociales et culturelles, 1992, pp. 10-23. ; TOH (A.) et GAUTHIER (C.),
« Impacts des programmes d'ajustement structurel sur le système
éducatif ivoirien : Retour pour une analyse sociologique des conditions
de vie et de travail des instituteurs de l'enseignement primaire public en
Côte d'Ivoire ». In. Journal africain de communication
scientifique et technologique, 2011, pp.1657-1680. ; TOH (A.),
Précarisation de la profession enseignante au primaire en Côte
d'Ivoire. Formation et profession, 2017,25(2).
534
les résultats atteints sont encourageants. Le taux brut
de scolarisation sur la période est passé de 74 % en 2000/2001
à 94,7% en 2013/2014 (MENET/DSPES). Le taux brut d'admission au CP1
s'est également amélioré, atteignant le seuil moyen de
97,8%, soit 100,2% pour les garçons et 95,2% pour les filles en
2013/20141520. Toutefois, des disparités d'accès
à l'éducation persistent entre sexes et entre régions : la
parité filles/garçons n'est pas encore totale, les enfants
à besoins spécifiques tels que les enfants handicapés
(1,8% scolarisés en 2012) ne sont pas encore pris en
compte1521. En outre, le taux brut de scolarisation dans le
secondaire reste encore très faible. Ce qui signifie qu'un nombre non
négligeable d'adolescents ont été privés de leur
droit à l'éducation, notamment les jeunes filles qui
accèdent plus difficilement que les garçons aux niveaux
supérieurs d'instruction. Par conséquent, ces nombreux
adolescents quand ils n'ont pas la chance d'être inscrits par leurs
parents dans un circuit informel d'insertion sociale se retrouvent à la
maison ou dans les rues. Le collège de proximité se
présente comme une réponse à bon nombre de
problèmes qui pèsent sur le développement de cycle
d'enseignement. En effet, le collège de proximité contribue de
façon décisive à l'élargissement de ce cycle
d'enseignement aux groupes défavorisés qui sont notamment les
populations rurales, les filles ; ce type d'établissement participe
aussi à l'atténuation des difficultés existentielles qui
influent négativement sur la rétention et les résultats
scolaires des élèves amenés à poursuivre leurs
études loin de leurs familles. En outre, les programmes de formation
à l'école n'accordent que peu de place aux questions relatives
aux problèmes majeurs et actuels de la jeunesse en général
et de l'enfance en particulier. En plus, les enseignements liés à
l'éducation civique et morale sont essentiellement limités
à l'instruction des élèves plutôt que de se traduire
en véritables séances d'IEC susceptibles de susciter en eux, un
changement de comportements. Ensuite, durant des années, il n'existait
aucune structure éducative formelle d'insertion professionnelle pour ces
nombreux enfants qui n'allaient plus ou n'étaient jamais allés
à l'école afin de garantir leur insertion dans le tissu social.
On peut se réjouir du fait que la situation ait évolué
avec la création de l'AGEFOP et de la récente agence emploi
jeune1522.
1520 MEN, Examen national 2015 éducation pour
tous, p13. 1521 Ibid.
1522 Pour plus d'informations sur cette structure, voir :
www.emploijeunes.com(consulté
le 17/06/2017).
535
Cette situation sus-évoquée a pour corollaire
l'inadéquation des services sociaux de base donnée comme un autre
facteur explicatif de cette ineffectivité du droit au
développement de l'enfant.
3. Les causes tenant à l'inadéquation des
services sociaux de base
La faiblesse des politiques de développement
intégré et de promotion de la jeunesse, les coûts
d'écolage élevé au préscolaire constituent la
traduction de l'inadéquation des services sociaux de base.
L'un des facteurs explicatifs des comportements
déviants des enfants réside dans la faiblesse de la politique de
promotion de la jeunesse. En effet, la politique éducative
extra-scolaire1523 globale et intégrée en faveur des
enfants non scolarisés, déscolarisés ou scolarisés
vise à assurer à ceux-ci, un développement harmonieux
à travers la formation, l'orientation, l'insertion sociale, les loisirs,
les sports, la culture, et la prévention sociale. Cependant, les
activités menées par le canal des départements
ministériels, les collectivités locales et les ONGs sont souvent
limitées en milieu scolaire ou en zone urbaine et dans le temps par des
actions ponctuelles. En outre, s'il est évident que l'un des facteurs
qui favorisent la dépravation chez les jeunes et les adolescents, est
l'inactivité, l'oisiveté, c'est parce que les politiques de
promotion de la jeunesse sont inadaptées aux réalités des
groupes-cibles ou encore parce que les actions entreprises sont peu connues ou
alors les résultats restent peu perceptibles. En effet, les
différents programmes d'aide à la jeunesse ne tiennent toujours
pas compte des disparités régionales, des différents
milieux et niveaux de vie des jeunes et des adolescents, de leurs
capacités de mobilisation et de participation, etc. De la sorte, les
moins instruits et les plus pauvres restent toujours en dehors des circuits
d'accès aux projets qui leur sont destinés. Par exemple, les
bourses d'études et les fonds sociaux octroyés ne vont pas
nécessairement à ceux qui en ont le plus besoin. En milieu rural,
aucune politique ne permet de maintenir les enfants sur place ou de les
intégrer dans les différentes activités économiques
de leur famille ou de leur communauté, car les différentes
interventions visent surtout les adultes en activité. En outre,
même quand ces programmes sont destinés aux adultes,
c'est-à-dire aux parents, ils restent verticaux et ne
développent
1523 SIMKINS (T.), La planification de l'éducation
extrascolaire : stratégies et contraintes, in perspectives, vol.
VIII, n°2, 1978, pp.201-212.
536
aucune approche globale qui favorise le développement
des enfants par les parents eux-mêmes.
Les frais de scolarité apparaissent aussi
élevés au niveau de l'enseignement préscolaire. En
Côte d'Ivoire, les structures de l'enseignement
préscolaire1524 relèvent pour une bonne part, surtout
du secteur privé1525. Les coûts pratiqués
n'obéissent pas à la même logique que dans le secteur
public qui vise le principe d'équité. Et les facteurs tels que la
faiblesse de l'offre par rapport à une forte demande ainsi que la faible
concurrence et le niveau d'intervention limité du secteur public se
conjuguent pour maintenir les frais d'écolage à un niveau non
seulement élevé mais supérieur aux coûts offerts par
l'enseignement primaire public. Par conséquent, de nombreuses familles
à faible revenu se trouvent confrontés à des coûts
d'écolage qui se situent au-dessus de leur pouvoir d'achat et
préfèrent attendre que leurs enfants aient 5 ou 6 ans pour les
inscrire au CP1. Malheureusement, pendant cette période d'attente, rien
de particulier n'est fait pour encadrer et suivre ces enfants avant leur
accès à l'enseignement primaire public.
Un autre facteur expliquant l'ineffectivité partielle
du droit au développement de l'enfant est à rechercher dans les
contraintes socio-économiques et culturelles.
4. Les contraintes socio-économiques et
culturelles affectant le développement optimal de l'enfant
Les contraintes socio-économiques et culturelles
affectant le développement optimal de l'enfant sont plurielles :
l'inefficacité des investissements, l'instabilité du cadre
institutionnel et le manque de coordination ministérielle, les mutations
socio-économiques et le déclin de valeurs traditionnelles
positives, les croyances religieuses, le mariage forcé et précoce
de la jeune fille, la pauvreté des parents.
1524 En 2008-2009, il existait 1069 écoles
préscolaires dont 689 dans le public. Voir Ministère de
l'Education Nationale, Direction de l'informatique, de la planification, de
l'évaluation et des statistiques, L'état de l'école en
Côte d'Ivoire. Rapport d'analyse 2008-2009 disponible sur
www.men-dpes.org/new/FILES/pdf/stats/rapports/rap_ana_20082009.pdf
; TROUILLET (B.), L'éducation préscolaire : quelques aspects
et problèmes internationaux, 1970, p.124.
1525 AIGLEPIERRE (R.), « L'enseignement privé en
Afrique subsaharienne. Enjeux, situations et perspectives de partenariats
public-privé, » In. A Savoir n°22, Août 2013,
pp.45-59.
537
L'inefficacité des investissements apparait
manifestement comme une véritable résistance au
développement et au bien-être des enfants. Au niveau du
financement du secteur de l'Education1526, l'essentiel des efforts
de l'Etat est orienté vers l'éducation primaire. En moyenne, sur
la période 2006-2015, ce secteur éducatif a reçu 36 % du
budget total du système éducatif1527. Viennent ensuite
respectivement le secondaire général premier cycle (22%), le
supérieur avec 17% et enfin le secondaire général avec une
part de 13%. La part dévolue à la formation professionnelle et
technique s'élevait à 8% tandis que le préscolaire et
l'éducation non formelle reçoivent respectivement les faibles
parts de 3% et 1%. Comparée aux années antérieures, on
peut constater une certaine réaffectation budgétaire
(légère toutefois) réalisée au profit du secondaire
et du supérieur. Cette modification des priorités
budgétaires se heurte au besoin de scolarisation sous-tendus par une
forte croissance démographique de la population scolarisable. Les
efforts entrepris n'ont pas permis d'améliorer de façon
significative les structures d'accueil et les capacités d'encadrement ni
de réduire les coûts d'éducation primaire par
élève encore élevé, notamment pour ceux issus de
familles démunies. Les ménages continuent de financer la grande
part des activités connexes mais essentielles à l'enseignement,
à savoir les divers appuis à la scolarité (63%) et surtout
les ouvrages et matériels pédagogiques dont la part des
ménages se situe à 79% de toutes ces
dépenses1528 . Ainsi, le taux de scolarisation reste encore
faible au regard de l'objectif de 100% que s'est fixé la Côte d'
Ivoire.
L'une des principales contraintes du secteur des affaires
sociales réside dans son instabilité institutionnelle et le
manque de coordination ministérielle. Souvent rattaché au secteur
de l'emploi, tantôt au secteur de la santé publique, le secteur
des affaires sociales n'arrive pas à trouver un cadre institutionnel le
mieux approprié pour définir un véritable plan d'action
qui permette une meilleure programmation et planification des activités
à
1526 Pour une bonne compréhension du financement de
l'éducation en Côte d'Ivoire, voir : HALLAK (J.), POIGNANT (R.),
Les aspects financiers de l'éducation en Côte d'Ivoire,
Unesco, Paris, 1966, 43p. ; UNICEF, Analyse de la situation de l'enfant en
Côte d'Ivoire 2014. Vers une société plus équitable
dans un pays émergent, p.53-54.p.75.
1527 Ministère de l'éducation nationale de la
République de Côte d'Ivoire et UNESCO, Le financement de
l'éducation en Côte d'Ivoire, 2006-2015, Sur le modèle des
comptes nationaux de l'éducation volume I : Analyse et Annexe 1, 28
Juillet 2016, p.22.
1528 Ministère de l'éducation nationale de la
République de Côte d'Ivoire et UNESCO, Le financement de
l'éducation en Côte d'Ivoire, 2006-2015, Sur le modèle des
comptes nationaux de l'éducation volume I : Analyse et Annexe 1, 28
Juillet 2016, p.23.
538
mener. Car chaque changement de tutelle ministérielle
entraine une redéfinition des rôles et des attributions qui a pour
conséquence d'accentuer la lenteur des procédures administratives
et l'exécution des activités. A cela, il faut ajouter le manque
de coordination dans la gestion des structures du personnel en charge de la
petite enfance. Cette tranche d'âge implique à la fois, les
ministères de la Santé, de l'Education, de la Famille et des
Affaires sociales. Cependant, la définition des rôles,
attributions et actions à mener ne permettent pas, au niveau global, une
réelle coordination pour la prise en charge et le suivi de la petite
enfance. Ainsi, les champs d'action demeurent restrictifs et les efforts
entrepris par secteur sont limités par l'absence ou le faible niveau
d'intervention des autres secteurs concernés. Pourtant, le
développement de la petite enfance suppose non seulement, un encadrement
médical adéquat mais aussi et surtout des structures qui offrent
de réelles possibilités d'éveil affectif, sensoriel,
cognitif et éducatif. Toutes ces hésitations montrent que l'Etat
ivoirien accordent une priorité à l'enseignement primaire, qui
commence dès l'âge de 6-7 ans, ce au détriment de la petite
enfance.
Un autre facteur explicatif réside dans les mutations
socio-économiques et le déclin des valeurs traditionnelles. Dans
la société traditionnelle, l'organisation et le fonctionnement
social étaient régis par des règles strictes. Et les
structures sociales traditionnelles1529 telles que la famille, les
classes d'âge adulte1530, le conseil des sages ou la
chefferie1531, la religion, les rites d'initiation, etc. avaient
pour rôle d'assurer et de maintenir la cohésion du groupe. La
transgression des normes sociales conduisait à de sanctions graves et le
respect des traditions perpétuait la survie du groupe. Dans cet univers
fortement hiérarchisé, les enfants devaient respect et
considération aux groupes d'âge plus âgés. Le
système éducatif, en général, et l'éducation
sexuelle des jeunes en particulier participe à une intégration
sociale qui s'étend à tous les niveaux de la vie de la
communauté. Or, de nos jours, il semble que ces valeurs fondamentales
sont bouleversées. Sous le poids des mutations socio-économiques
et culturelles, on assiste à un affaiblissement des institutions
traditionnelles.
1529 PAULME (D.), « Structures sociales traditionnelles
en Afrique Noire », In : Cahiers d'études africaines,
vol.1, n°1, 1960. pp.15-27.
1530 SPERBER (D.), PAULME (D.), « Classes et associations
d'âge en Afrique de l'Ouest. » In : L'homme, 1972, tome 12
n°3. P.132.
1531 NDRI (K..), « Recherches sur l'exercice du pouvoir
local en Côte d'Ivoire », In. Cahiers Africains d'Administration
Publique, n°57, pp.4-5. ; Dans une perspective historique, voir, AMON
d'ABY, Le problème des chefferies traditionnelles en Côte
d'Ivoire, Imprimerie Jemmapes, Paris, 1958, p.12.
539
En effet, l'économie de marché, l'instruction,
les médias, les dynamiques familiales, etc. induits par
l'urbanisation1532 offrent un nouveau cadre de
référence aux enfants qui s'opposent aux vertus de la
société traditionnelle. Les enfants sont engagés dans une
évolution des moeurs et l'aspiration à plus de liberté
entrainent très souvent un rejet de la tradition et un manque de respect
envers les adultes. Cependant, cette nouvelle vision de la vie inspirée
par les jeunes traduit bien des formes de dépravation et d'exclusion. En
outre, dans cet environnement citadin caractérisé par un anonymat
urbain, les réseaux de solidarité fragilisés et
reconstruits sur des bases ethniques, religieuses, professionnelles, avec comme
fondement la recherche du profit, finissent par créer plusieurs formes
d'exclusion dont de nombreux enfants sont en définitive les principales
victimes.
Quant aux croyances religieuses, en Côte d'Ivoire comme
dans nombre de pays africains1533, elles
sous-tendent dans une large mesure, les comportements des populations. Dans un
tel contexte psychologique, certains parents croient que les difformités
de leurs enfants sont la résultante de la transgression de lois sociales
et les recours pour rétablir cet équilibre social s'identifient
dans la consultation des guérisseurs1534 et
tradipraticiens1535 au détriment de structures
spécialisées. Par ailleurs, certaines mères, du fait des
préceptes religieux vis-à-vis de l'aumône1536,
trouvent en l'exposition de leurs enfants à la rue (cas de certains
jumeaux handicapés), la solution pour leur offrir des chances de survie.
Et même si ces différents cadres peuvent constituer des solutions
intermédiaires et ponctuelles, ils ne peuvent couvrir toute la dimension
d'une réelle prise en charge.
1532 HAUMONT (N.) et MARIE (A.) (sous la dir.), Politiques
urbaines dans les pays en voie de développement, L'Harmattan, Col.
Villes et entreprises, Paris 1987, Tome I, 342p. ; ROCHEFORT (M.), Le
défi urbain dans les pays du sud, Ed. L'Harmattan, 2000, 184p.
1533 ATSU-DETE (T.), La protection du
mineur et du majeur atteint de troubles mentaux en droit Togolais,
Thèse de doctorat Université Jean Moulin Lyon 3, 2004, 431p.
1534 La médecine traditionnelle a été
officiellement reconnue en Côte d'Ivoire comme faisant partie du secteur
privé de santé par le décret n° 96-678 du 25 octobre
1996 aux articles 1 et 2. Elle est classée au niveau primaire de la
pyramide sanitaire, selon les décrets n°96-876 du 25 octobre 1996,
privés n°96-877 du 25 octobre 1996 portant classification et
organisation des établissements sanitaires. Une direction de promotion
de la médecine traditionnelle a été créée au
ministère de la santé pour organiser et superviser les
activités des tradipraticiens de santé.
1535 Selon l'OMS, 80% des populations rurales vivant dans les
pays en développement utilisent la médecine traditionnelle comme
premier moyen de recours. Voir KROA (E.) et al. Analyse de la collaboration
entre médecines traditionnelle et moderne dans la région du Sud
Bandama (Côte d'Ivoire), Revue CAMES-Série Pharm. Méd.
Trad. Afr., 2014 ; 17 (1) :21-27.
1536 NDIAYE (P.O.), « Aumône et mendicité :
un autre regard sur la question des talibé au Sénégal
», Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs,
14/2012, pp.295-310.
540
La pauvreté des parents reste aussi l'un des facteurs
explicatifs de la crise du droit à l'éducation et au
développement : En effet, la pauvreté a été
aggravée avec la crise. Ainsi, le taux de pauvreté a connu une
progression de 10 points entre 2002 et 2008, soit de 38,4% à
48,9%1537. Suivant le rapport 2011 du PNUD, l'indice de
pauvreté multidimentionnelle se situait à 61,5%. Au niveau de
l'indice du développement humain, le pays occupait le
171ème rang mondial sur 187 avec un IDH qui est passé
de 0,43 en 2010 à 0,45 en 20131538.Mieux, selon la
dernière enquête sur la mesure des niveaux de vie
réalisée par la banque mondiale, l'indice de pauvreté est
de 46% en 20151539 dernier recensement de la population en 2014. Par
ailleurs, les ménages pauvres comprennent un nombre élevé
de personnes. De la sorte, les stratégies familiales privilégient
un certain type de dépenses telles que l'alimentation, et la
satisfaction des besoins sociaux de base des enfants demeurent
préoccupantes pour les parents qui n'arrivent pas à
répondre aux besoins de leurs enfants. Ainsi, de nombreux enfants sont
obligés de trouver les voies et moyens susceptibles de satisfaire aux
exigences de la vie matérielle. Malheureusement, les solutions
adoptées ne sont pas toujours les meilleures, car certains
préfèrent s'adonner à la violence. Compte tenu de la
situation précaire du niveau de revenus de leurs parents, certaines
jeunes filles s'adonnent à la prostitution et des jeunes garçons
au proxénétisme afin de subvenir à leurs besoins vitaux
dont la santé, l'alimentation, et parfois l'habillement,
l'éducation. Et, il arrive parfois que de tels comportements
bénéficient de l'assentiment et de la complicité de
certains parents. Les années de récession économique et de
crise armée qu'a connues la Côte d'Ivoire se sont
caractérisées, au plan social par de nombreux
licenciements1540, la faiblesse du pouvoir d'achat1541
des populations, une faible utilisation des services sociaux de base, etc ; en
d'autres termes, par une forte paupérisation des couches
vulnérables de la population, notamment des femmes. Ainsi, de nombreux
ménages se sont investis dans plusieurs
1537 Ministère de l'éducation nationale et de
l'enseignement technique, Examen national 2015 de l'Education pour tous :
Côte d'Ivoire, novembre 2014, p.7.
1538 Ibid.
1539
www.banquemondiale.org/fr/country/Côtedivoire/overview
(consulté le 26/11/2016).
1540 MULLER (A.), « La législation de protection
de l'emploi à l'épreuve de la crise économique. Une revue
globale de la réglementation des licenciements collectifs pour motifs
économiques », Note d'information de dialogue n°3,
BIT, septembre 2011, p.1.
1541 VERGNE (C.), AUSSEUR (A.), « La croissance de
l'Afrique subsaharienne : diversité des trajectoires et des processus de
transformation structurelle », In. Macro-économie et
développement, mai 2015, pp. 1- 50 ; CHEVALLIER (A.), LE GOFF (M.),
« Dynamiques de croissance et de population en Afrique subsaharienne
», In. Paranoma du CEPII, 2014, pp. 1-17.
541
domaines d'activités informelles à
caractère agricole, industriel ou commercial. Cependant, ces nouvelles
orientations familiales ou féminines impliquent très souvent un
surcroît de travail et ne génèrent que de faibles revenus,
qui n'arrivent pas à bien souvent couvrir les besoins nutritionnels,
sanitaires, éducatifs qu'induit une réelle prise en charge des
enfants.
Tous ces facteurs méritent d'être
considérés individuellement et faire l'objet de mesures
étatiques appropriées en vue de réduire le degré
d'ineffectivité du droit au développement.
Qu'en-t-il des facteurs explicatifs de la faible participation
des enfants ?
§ 3. LES CAUSES LIEES A LA FAIBLE PARTICIPATION DES
ENFANTS
Des facteurs de nature immédiate (A) et sous-jacente
(B) constituent de fortes résistances à la participation
effective des enfants.
A. LES CAUSES IMMEDIATES
La faible implication communautaire (1), l'ignorance par les
enfants de leurs droits (2) l'absence de prise de conscience des jeunes de leur
rôle couplée à la crise de confiance et la recherche du
gain immédiat (3) constituent autant de facteurs explicatifs d'ordre
immédiat à la participation des enfants.
1. Une faible implication communautaire
La participation des enfants à la vie associative se
heurte très souvent à la faible implication des parents et des
collectivités locales. En effet, les associations de jeunes
reçoivent rarement le soutien moral encore moins matériel de
leurs parents. Ainsi, les enfants livrés à eux-mêmes et
sans expérience de la vie associative se trouvent confrontés
à de nombreux problèmes. Aussi, il arrive que certains parents,
en voyant leurs enfants, militer ou s'épanouir dans des associations
à vocation coopérative ou politique, se désengagent de
leurs obligations de prise en charge vis-à-vis de ceux-ci. En outre, les
collectivités locales ne jouent pas toujours leur rôle dans
l'encadrement technique et financier des associations des enfants. Tous ces
facteurs tendent à rendre peu perceptibles de réelles intentions
de création d'association chez les jeunes, encore moins les actions que
celles qui existent
542
entreprennent. A côté d'une faible implication
communautaire, l'ignorance des enfants de leurs droits explique aussi
partiellement leur non-participation.
2. L'ignorance des enfants de leurs droits
Le fait que les enfants ne participent pas aux
différents niveaux de prise de décision au sein de la famille, de
l'école de la vie politique, associative et communautaire résulte
aussi en partie de leur ignorance en matière de droits1542
(droit à la santé, droit à l'éducation, droit au
jeu, droit à participation). En effet, dans les différents
milieux socioculturels africains, en général et ivoiriens en
particulier, la notion de droits des enfants apparait toujours comme une valeur
importée, subversive et inadaptée aux normes traditionnelles.
Ainsi, certains parents restent toujours ancrés dans la survivance des
pratiques coutumières discriminatoires et privatives à
l'égard des enfants. Et même si aujourd'hui, la scolarisation
permet à de nombreux enfants d'apprendre à lire, à
écrire, à s'exprimer, à avoir une vision différente
de la vie et une plus grande ouverture d'esprit, ceux-ci demeurent encore sous
informés de l'existence d'un cadre juridique qui favorise et garantit la
réalisation des droits qui leur sont dévolus. Bien souvent plus
instruits que leurs parents, les enfants ignorent leurs droits parce que les
actions menées (séminaires, ateliers, conférences et
autres) en vue de faire connaitre ces droits, notamment à travers la
vulgarisation de la Convention relative aux droits de l'enfant, sont
ponctuelles, de courte durée et essentiellement orientées vers
des groupes-cibles autres que les enfants eux-mêmes. Les droits de
l'enfant doivent donc sortir du vase clos de l'intellectualisme, descendre des
cimes de l'académisme pour être intériorisés par les
enfants et la population1543. Seule la connaissance des droits de
l'enfant par les enfants et la population pourrait créer une contrainte
morale et politique envers les gouvernants.
En outre, l'absence de prise de conscience des enfants de leur
rôle, leur crise de confiance et la recherche du gain immédiat
entravent aussi l'effectivité du droit à la participation des
enfants.
1542 Préambule de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : «Considérant que l'ignorance
l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des
malheurs publics... ».
1543 NOUROU-TALL (S.), « La problématique du
respect des droits de l'homme en période de conflit armé
», in L'Afrique de l'Ouest et la tradition universelle des droits de
l'homme (dir. Denis MAUGENEST et Théodore HOLO), Les
éditions du CERAP, Abidjan 2006, p.69.
543
3. De l'absence de prise de conscience des enfants de
leur rôle à la crise de confiance et la recherche du gain
immédiat
Les enfants sont en général peu soucieux des
enjeux de la vie politique économique et sociale. Leur engagement dans
des mouvements associatifs est surtout lié au souci de se retrouver pour
s'amuser. La prolifération des clubs de vacances et de manifestations
culturelles1544 en est la preuve. A ce jour, hormis, le Parlement
des enfants qui semble limité à un niveau politique et
centralisé, il n'est pas encore apparu en Côte d'Ivoire, des
associations d'enfants initiées par eux-mêmes qui militent dans le
sens d'une pleine autonomie dans la prise de décision qui les concernent
tant au niveau familial, scolaire que social. En conséquence, la
société ne leur reconnait pas le droit de cité,
étant supposés être moins aptes à discerner par
rapport aux adultes et aux personnes âgées.
De même, très souvent, chez les enfants, lorsque
l'intention de création d'association est assortie d'une mobilisation de
fonds propres nécessaires à la constitution du groupe ou à
la création des activités, celle-ci se heurte à une
méfiance souvent généralisée. Car pour certains, la
constitution de cette association vise essentiellement à rechercher
l'intérêt des initiateurs au détriment de
l'intérêt collectif. Pour d'autres, la motivation exprimée
dans la constitution des associations est sous-tendue par la recherche ou
l'attente de gains immédiats. Ainsi, dès lors que les gains
escomptés ne se font pas sentir, la crise de confiance s'intensifie et
le groupe se disloque. Seuls arrivent à survivre quelques associations
d'obédience politique qui reçoivent de temps à autre
l'appui matériel et financier de leurs organisations politiques.
Quid des résistances sous-jacentes à la
participation effective des enfants ?
B. LES CAUSES SOUS-JACENTES
Le faible niveau d'éducation des parents et une faible
collaboration entre parents et enseignants (1), en passant par l'accès
limité et une faible implication à la diffusion de l'information
(2) ainsi que la faiblesse des réseaux d'association de jeunes (3)
constituent autant de résistances sous-jacentes à une
effectivité satisfaisante du droit à la participation des
enfants.
1544 La plupart des émissions
télévisées ou radiophoniques culturelles
dédiées à la jeunesse portent en général sur
des concours de danse ou de chants ; ce qui nous apparait peu
appropriée.
544
1. Le faible niveau d'éducation des parents et
une faible collaboration entre parents et enseignants
L'analphabétisme de certains parents1545
freine le processus de communication avec les enfants au niveau de la cellule
familiale. Il est généralement constaté que les familles
instruites semblent consacrer un temps non négligeable à la
communication interfamiliale. Les enfants de ces familles ont la liberté
d'exprimer leurs besoins aux parents. Cela est dû à l'accumulation
d'informations et d'opportunités d'échanges dont
bénéficient les parents de ces enfants. En conséquence,
ces parents comprennent que par l'apprentissage de la libre expression à
leurs enfants, ils permettent à ces derniers de libérer en eux,
les forces de l'imagination et de la créativité nécessaire
à leur épanouissement social futur. Les enfants des familles
pauvres dont les parents sont pour la plupart analphabètes n'ont
malheureusement pas cette possibilité car les parents attachés au
culte de la hiérarchie ne comprennent pas qu'il faut laisser aux
enfants, la latitude de s'exprimer et de donner leurs opinions sur certains
évènements familiaux et sociaux les concernant.
En milieu rural, il n'existe souvent pas de comité ou
d'association de parents d'élèves capables de défendre les
droits et devoirs des enfants scolarisés1546. Les parents
ayant pour préoccupation l'utilisation d'une main d'oeuvre gratuite ne
rencontrent pratiquement aucune résistance de la part de l'enseignant
lorsqu'ils viennent retirer leurs enfants des classes, même si cette
pratique devient de moins en moins répandue.
Un accès limité et une faible implication
à la diffusion de l'information explique aussi partiellement la
négation du droit à la participation des enfants.
1545 SEURAT (A.), Contexte d'alphabétisation dans
le contexte africain, thèse, Université de Bourgogne, 2012,
255 p. ; FINK (C.), « L'éducation des femmes et le
développement en Afrique subsaharienne », Economies
and finances, 2011, p. 51.
1546 C'était le cas en France encore au XIXe siècle
et même dans la moitié du XXe siècle.
2. 545
Un accès limité et une faible implication
à la diffusion de l'information
Aujourd'hui, l'information est diffusée à la
fois par la télévision, la radio et internet. En Côte
d'Ivoire, il existe des émissions radio1547 et
télé1548 consacrés aux enfants. Ainsi, au
nombre des nombreuses stations de radio de proximité créés
à Abidjan au cours de ces dernières années, la plupart
d'entre elles s'affichent comme des radios pour jeunes1549. En plus,
il existe plusieurs magazines qui traitent des problèmes de
l'enfance/jeunesse1550. Cependant, cette frange de la population
n'est pas associée aux décisions quant au type d'émissions
et au moment où ces émissions doivent passer. Il n'existe en
effet, pas encore de radio ou de magazine pour enfants et animés par
eux-mêmes, devant leur permettre d'exprimer leurs différentes
opinions sur les problèmes émergents et les concernant. Tout ceci
limite à n'en point douter la participation des enfants à
l'instar de la faiblesse des réseaux d'association d'enfants.
3. La faiblesse des réseaux d'association
d'enfants
Les réseaux d'associations d'enfants existent dans la
plupart des régions de Côte d'Ivoire. Cependant, leurs objectifs
sont pour la plupart peu favorables à la constitution d'un groupe de
pression. Les préoccupations des enfants au niveau des associations sont
surtout de type socioculturel. Ils ont souvent recours à certaines
hautes personnalités ou entreprises pour les sponsoriser à
l'occasion de leurs manifestations culturelles. Certains enfants en profitent
pour tisser des relations solides pour des emplois futurs. Cependant, ces
associations qui pourraient être favorables à la prise du
contrôle des centres de décisions ne sont
généralement pas gérées dans ce sens. Dans le cadre
des partis politiques, il existe des groupements de jeunes/enfants. Cependant,
la segmentation et la hiérarchisation des places qui régit le
fonctionnement de ces partis réduit la marge de participation des jeunes
aux prises de décision. Pire, les leaders de ces jeunes ne sont pas
forcément des enfants au sens du droit international.
1547 Le « Mercredi des enfants »
présenté sur les antennes de la radio Côte d'Ivoire ;
l'émission « droits des enfants » présenté et
animé par les enfants sur les antennes de la Radio Yopougon.
1548 L'émission « Wozo vacances » qui a lieu
chaque année pendant les vacances scolaires sur les antennes de la radio
télévision ivoirienne.
1549 Africa Leaders FM, La voix du Nzi dimbokro , Radio
amitié de Yopougon, Radio Arc-en-ciel d'Abobo, Radio ATM Port-Bouet,
Radio Bia Fm d'Aboisso, Radio Binkadi de Ferké).
1550 Exemples de Magazines dédiés aux enfants en
Côte d'Ivoire : « Kids » et « Planète enfants
».
546
547
Par ailleurs, des causes d'ordre structurel justifient
également aussi la faible participation des enfants.
C. LES CAUSES STRUCTURELLES
Les résistances structurelles à la pleine
réalisation de la participation des enfants sont : l'influence des
structures traditionnelles d'éducation (1) et la faiblesse du cadre
institutionnel (2).
1. L'influence des structures traditionnelles
d'éducation
Les normes sociales sont souvent contraignantes en
matière de participation des enfants à la prise de
décision. La parole est un concept fort complexe dans la culture
africaine et par conséquent, elle se prête difficilement à
une quelconque définition. Cette difficulté est accentuée
par l'extrême complexité de la philosophie du langage qu'il serait
impossible d'affronter ici. La parole représente un pouvoir, un moyen
pour le sujet d'influencer autrui et de transformer le monde1551.
Elle sert à exprimer la pensée1552 ; c'est un outil de
transmission du message. Ainsi entendue, l'usage de la parole requiert que le
sujet ait un discernement suffisant, de nature à comprendre la
portée de ses dires. Il requiert un certain « savoir -parler »
qui reste l'apanage, l'attribut d'une personne en mesure de distinguer le bien
et le mal. En effet, la société traditionnelle est
hiérarchisée et le droit à la parole n'est pas reconnu aux
enfants1553. La prise de parole en assemblée est souvent
regardée comme un manque de respect envers les ainés. En effet,
parce que l'on considère que les enfants ne sont pas aptes à
prendre des décisions importantes, notamment en ce qui concerne la vie
de famille et leur propre avenir alors même que certains enfants prennent
une part active aux travaux domestiques ou dans la constitution des revenus de
certains ménages.
1551 BOURDIEU (P.), Ce que parler veut dire, Paris,
Fayard, 1982, pp. 99 à 102 spécialement p. 101.
1552 GARDINER (A. H.), Langage et acte de langage. Aux
sources de la pragmatique, Lille, Presse Universitaire de Lille, 1989, p.
23.
1553 EZEMBE (F.), L'enfant africain et ses univers.
Paris : Editions Karthala. , 2009, pp. 49-50.
2. La faiblesse du cadre institutionnel
Les structures socio-éducatives ou pédagogiques
chargées de l'élaboration des modules de formation, de la
recherche de la qualité de l'enseignement, de l'octroi des bourses et de
l'orientation des élèves ne fonctionnent sur aucune disposition
qui implique directement les élèves eux-mêmes sur les
problèmes liés à leur environnement scolaire à
telle enseigne que ces derniers apparaissent plus comme des apprenants et non
comme de véritables acteurs de l'école. Toutefois, s'agissant de
l'attribution des bourses, des efforts ont été consentis ces
dernières années avec la participation de la
fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire
(FESCI)1554 au sein des commissions d'attribution
de logements en résidences universitaires.
Au-delà des résistances
sus-évoquées, il persiste de fortes résistances à
l'atteinte d'une effectivité du droit à la protection des
enfants.
SECTION III. LES CAUSES DES ABUS CONTRE TOUTES FORMES
DE PROTECTION DES ENFANTS
Les facteurs explicatifs de l'errance des enfants
décrits (Paragraphe 1), nous évoquerons ceux
relatifs à l'exploitation économique, des sévices et
exploitation sexuels des enfants (Paragraphe 2), pour enfin
mettre en lumière les facteurs explicatifs de la persistance des
violations des droits des enfants en conflit avec la loi et en période
de conflit armé (Paragraphe 3).
§ 1. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA DESHERENCE DES
ENFANTS
La rupture avec la famille et les mauvais traitements des
enfants (A), les mauvaises conditions de vie et la sous-scolarisation des
enfants (B) combinées avec les multiples résistances de nature
structurelle (C) sont les facteurs explicatifs de la déshérence
des enfants.
1554 DAH-DJI (S.W.), Côte d'Ivoire, il faut sauver
le « soldat fesci », L'Harmattan, 2010, 270p ; KONATE (Y.),
« Les enfants de la balle. De la Fesci aux mouvements de patriotes »,
In. Politique africaine, vol. 89, n°. 1, 2003, pp. 49-70.
; OULAGOUE (B.), FESCI, le rêve brisé ? :
Côte d'Ivoire, L'Harmattan, 2017, 144p.
548
A. LA RUPTURE AVEC LA FAMILLE ET LES MAUVAIS
TRAITEMENTS DES ENFANTS
Considérant la rupture avec la famille, notons que le
phénomène des enfants de la rue est lié, en partie,
à la crise d'adolescence chez de nombreux enfants, notamment les
garçons. En effet, à cet âge, les enfants ont tendance
à vouloir s'imposer aux parents, avoir la liberté de faire tout
ce qu'ils veulent. Cette situation entraîne souvent des conflits dont
l'issue finale peut être la fugue1555. L'enfant coupé
de son milieu familial n'a aucune protection et reste particulièrement
vulnérable. La dislocation de la cellule familiale est un facteur
prédisposant à la déshérence chez les enfants de
condition sociale modeste ou pauvre. Elle résulte d'un déficit
profond de communication entre les parents et les enfants. Les enfants sont
dans la rue parce qu'ils n'ont pas rencontré une oreille attentive, un
adulte disposé à les écouter.
De même, la plupart des enfants vivant dans la rue ont
été victimes de mauvais traitements. Les enfants sont
exposés à des sévices corporels1556 et sexuels
de la part de leurs parents ou leurs substituts. Il s'agit des bastonnades ou
corrections paternelles, les punitions, les privations de nourritures et de
soins, les abandons d'enfants. Face à ces souffrances physiques et
morales l'enfant trouve son salut et sa liberté dans la rue. Bien que
réprimés par les textes en vigueur, les mauvais traitements sur
les enfants continuent d'être tolérés dans la pratique.
L'enfance maltraitée est une enfance meurtrie qui n'a plus la protection
familiale et légale. La rue devient alors pour de nombreux enfants
maltraités, le lieu de réalisation de
1555 KARAM (R.), Mieux comprendre la fugue des adolescents
pris en charge en milieu substitut, décembre 2013, 106p. ; MORENO
(F.), « Fugues et dépressions à l'adolescence »
In. Sauvegarde de l'enfance : Adolescence et errance (49 (2),
Revue de l'Association Française pour la sauvegarde de l'Enfance et
de l'Adolescence. Paris, 1994, pp.143-148.
1556 Observation générale n°8 « le
droit de l'enfant à une protection contre les châtiments corporels
et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (art.
19, 28 (par.2) et 37, entre autres ». Cette observation a pour but de
mettre en lumière l'obligation incombant à tous les Etats parties
à la Convention de prendre rapidement des dispositions aux fins
d'interdire et d'éliminer tous les châtiments à
l'égard des enfants et d'exposer les mesures législatives, les
autres mesures de sensibilisation et les mesures éducatives qu'il
appartient aux Etats de prendre. Plus encore, de s'attaquer au problème
de la large acceptation ou tolérance à l'égard des
châtiments corporels contre les enfants et les éliminer, tant dans
la famille qu'à l'école ou dans tout autre contexte.
L'idée fondamentale est que cette interdiction est non seulement une
obligation incombant aux Etats parties, mais aussi un moyen stratégique
déterminant sur la voie de la réduction et de la
prévention de toutes les formes de violence dans la
société. Pour mettre fin aux châtiments corporels, il faut
alors améliorer les lois, procéder à une harmonisation
d'autant que la plupart des Etats ont ratifié le CDE, la CADBE par la
plupart des Etats Africains, faute de quoi, l'idée persistera toujours
qu'infliger une douleur à un enfant au nom de la discipline est normale
et dans son intérêt supérieur.
549
leur personne. Les mauvaises conditions de vie et la
sous-scolarisation des enfants apparaissent aussi comme des facteurs
explicatifs de la déshérence des enfants.
B. LES MAUVAISES CONDITIONS DE VIE ET LA
SOUS-SCOLARISATION DES ENFANTS
Les enfants en déshérence vivent dans des
milieux pauvres et démunis. Nés dans des quartiers
périurbains, les enfants proviennent des habitats modestes et
précaires caractérisés par la promiscuité. Les
enfants de la rue sont sans domicile fixe ou dorment à la belle
étoile. Ils exercent pour la plupart des petits métiers peu
rémunérateurs du secteur informel. La misère et la
pauvreté sont les caractéristiques communes de la situation
socioprofessionnelle précaire de leurs parents.
Quant au phénomène de la sous scolarisation des
enfants, il peut s'expliquer par le fait que dans certaines familles, les
enfants sont non scolarisés ou déscolarisés et très
tôt, ils s'insèrent dans les circuits informels de production. En
effet, notons que la majorité des enfants de la rue ne savent ni lire,
ni écrire. Ceci met bien en lumière le problème de la
sous-scolarisation en Côte d'Ivoire. La défaillance du
système scolaire et l'absence d'alternatives appropriées pour les
enfants non scolarisés et déscolarisés contribuent
à accentuer la présence de plus en plus forte d'enfants dans la
rue et le recours aux activités de subsistance, aux stratégies de
survie. Ainsi, de nombreux enfants exclus du système scolaire et
éducatif se retrouvent dans la rue.
Des résistances de nature structurelle justifient
également la forte présence des enfants dans les rues.
C. LES MULTIPLES RESISTANCES DE NATURE
STRUCTURELLE
L'insuffisance des structures et du personnel d'encadrement,
les difficultés d'insertion socioprofessionnelle, le nombre
élevé d'enfants à charge, l'érosion des valeurs
traditionnelles d'entraide et de solidarité, la pauvreté des
parents, l'urbanisation et les dynamiques familiales apparaissent comme divers
facteurs de nature structurelle encourageant la persistance du
phénomène des enfants de la rue.
550
L'absence ou l'insuffisance des structures appropriées
d'encadrement et d'apprentissage pour recevoir les enfants les place davantage
dans une situation de marginalité permanente. Les services de base
urbains dans les zones marginalisées destinées à
améliorer les conditions de vie de la population sont insignifiants. Il
existe peu de services de base urbains. Les équipes d'assistance
socio-éducative en milieu ouvert n'ont pas été
développées et celles mises en place se sont évanouies
dans les services administratifs.
Aussi, sans qualification et sans niveau d'instruction
élevé, les enfants ont des difficultés d'insertion dans le
tissu économique. Ils ne peuvent donc accéder à un emploi
rémunérateur. D'où la tendance au recours aux
activités de type informel et au travail en domesticité chez les
filles. Les dispositifs publics d'insertion professionnelle des jeunes (AGEFOP,
AGEPE, IFEF) ont montré leurs limites, même si, on note une
croissance dans la sortie de certains enfants en nombre très
réduit de la marginalité. En outre, la contribution des ONGs,
bien que dynamique ne vise qu'une partie des groupes cibles. L'éducation
non formelle1557 et l'alphabétisation
fonctionnelle1558 des jeunes ne sont pas mises en oeuvre par les
autorités publiques, pour rendre les enfants en déshérence
actifs afin de participer à la vie économique et sortir ainsi de
la marginalité. Enfin, le faible appui aux initiatives des jeunes
1559(financement de projets, activités
génératrices de revenus) ne permet pas de façon efficace,
leur intégration sociale et l'autopromotion des enfants en
difficultés.
La taille du ménage est aussi un facteur favorisant la
déshérence des enfants qui ne trouvent pas assez de place dans ce
type de ménage. Les enfants de la rue sont généralement
issus de familles nombreuses. Et dans cette fratrie, ils occupent
généralement les derniers
1557 Selon l'Unesco, l'éducation non formelle (ENF),
peut être définie comme « toute activité
organisée et s'inscrivant dans la durée qui n'entre pas
exactement dans le cadre des systèmes éducatifs formels
composés des écoles, des établissements d'enseignement
supérieur et des universités, ainsi que des autres institutions
éducatives formellement établies » ; BORDES (V.),
L'éducation non formelle, Les dossiers de la science de
l'éducation, 2012, pp. 7-11. ; KERLAN (A.), POIZAT (D.), «
L'éducation non formelle. » In: Revue française de
pédagogie, volume 146, 2004. pp. 201-202. ;
1558 UNESCO, Guide pratique d'alphabétisation
fonctionnelle. Une méthode de formation pour le
développement, Paris, Unesco, 1972, 168p. ; DUMONT (B.),
L'alphabétisation fonctionnelle au Mali : une formation pour le
développement, UNESCO, 1973, 63 p.
1559 Toutefois quelques efforts sont actuellement en cours,
notamment à travers le fonds national de la jeunesse est un
Etablissement public à caractère industriel et commercial de
l'Etat de Côte d'Ivoire créé par décret du 10
octobre 2012 modifiant le décret n°92-154 du 16 mars 1992 portant
création, organisation et fonctionnement du fonds. Ce fonds a pour
objectif principal de soutenir toute initiative des jeunes pouvant contribuer
à leur insertion socio-économique.
551
rangs. Si le nombre important d'enfants est
considéré coutumièrement comme une richesse, dans le
contexte actuel marqué par une récession économique, le
chômage et l'exclusion sociale, il constitue un poids assez lourd pour
des familles de conditions de vie modestes et pauvres.
On observe aussi une érosion des valeurs
traditionnelles : La pression sociale et économique défavorable
est tellement forte et présente qu'on assiste dans la
société ivoirienne à l'érosion et l'effritement des
valeurs sociales de solidarité, d'entraide. Les communautés sont
tellement sollicitées qu'elles ne peuvent plus répondre aux
besoins de leur membre et recourir à la solidarité qui
caractérisait les relations sociales et intercommunautaires.
Involontairement même, la famille devient un espace de tension, du fait
que les droits seront forcément en concurrence et chaque composante de
l'association des individus éprouvera la suppression de ces droits par
rapport à l'autre. Si avant la famille avait le souci d'établir
le bien commun, aujourd'hui elle est confrontée à l'inspiration
démesurée de ses composants à l'autonomie et à
l'individualisation ; ce qui heurte à sa logique d'institution. «
La famille est moins conçue comme un groupe que comme cadre de
l'épanouissement personnel des individus qui la composent, et
particulièrement de l'enfant »1560.
Par ailleurs, les raisons qui ont conduit ces enfants dans la
rue découlent, selon eux, de la volonté de se doter d'une
autonomie financière afin de pouvoir se prendre en charge
eux-mêmes ; Car les parents étant pauvres, ils n'arrivent pas
toujours à subvenir à leurs besoins. En effet, face à la
crise économique qui a engendré une paupérisation
progressive des ménages, beaucoup de familles (ménages) sont
confrontés à l'incapacité de satisfaire la plupart des
besoins sociaux de leurs enfants (alimentation, santé,
éducation). Les réalités sur le niveau de vie en
Côte d'Ivoire révèlent qu'il s'ensuit une réduction
de la quantité et de la qualité des repas, l'aggravation de
certaines maladies ou des décès dans plusieurs ménages, la
déscolarisation ou la non-scolarisation de nombreux enfants, etc. Devant
cette situation alarmante, de nombreux enfants ont eu recours à la rue
pour vendre des produits de consommation ou encore pour être laveurs et
gardiens de véhicules, etc.
1560 FULCHIRON (H.), « De l'intérêt de
l'enfant aux droits de l'enfant » in Une Convention, plusieurs
regards. Les droits de l'enfant : une belle déclaration ! Et
après ? Introduction aux droits de l'enfant, Tome 1, 1997, p.20.
552
S'agissant de l'urbanisation et les dynamiques familiales,
notons qu'en ville, l'industrialisation et ses corollaires induisent des modes
de vie familiaux nouveaux. En effet, l'accentuation des difficultés
économiques au cours de la dernière décennie et surtout
l'absence d'emploi ainsi que le chômage ont mis en évidence le
retard dans la constitution des familles. Le recul de l'âge du mariage et
l'augmentation des ruptures en union1561, conduisent à une
pluralité de situations familiales. Dans ce contexte de profondes
mutations, l'unité familiale traditionnelle, la famille élargie
tend progressivement à faire place à de nouveaux types de
familles où les différents rôles attribués et
exercés par les enfants ainsi que les rapports d'âge et de sexe,
construits par une vision du monde et de la culture occidentale, se sont
modifiés.
Que les enfants soient dans une famille élargie ou
réorganisée, ils y font souvent l'objet de mépris,
d'indifférence ou de mauvais traitements du fait de leur filiation. A ce
propos, on observe que bon nombre d'enfants de la rue sont battus dans leur
nouvelle maison (familles). En outre, la plupart des familles monoparentales a
une femme à sa tête en qualité de chef de ménage.
Bien souvent, cette femme est plus vulnérable sur le plan
économique, car les femmes disposent généralement de moins
de revenus que les hommes1562. Dès lors, les enfants issus de
ce type de famille bénéficient moins ou presque pas de
prestations liées à leur survie et à leur
développement. Cette situation pose bien souvent un problème
d'éducation des enfants car l'autorité paternelle y est absente.
Par ailleurs, les enfants ne vivent pas toujours avec leurs parents. Car,
parfois plusieurs unités familiales alliées se trouvent sous
l'autorité du même chef. Les familles polygamiques font souvent
l'objet de discorde et de rivalité entre les épouses ou leurs
enfants et entre les différentes unités familiales qui les
composent. Et la satisfaction des besoins socio-éducatifs et
médicaux des enfants repose malheureusement sur des choix arbitraires,
parfois à leur détriment. Toutes ces différentes
situations familiales expliquent la déshérence de nombreux
enfants. Par ailleurs, l'exploitation économique et sexuelle des enfants
explique aussi en partie, une ineffectivité du droit à la
protection des enfants
1561 DESROSIERS (H.) et LE BOURDAIS (C.), « Progression
des unions libres et avenir des familles biparentales », In.
Recherches féministes, vol. 9, n° 2, 1996, p. 65-83.
1562 Du fait du poids de nos traditions qui les marginalisent.
Et parce que la majeure partie des femmes ignorent leurs droits. Elles se
contentent de peu.
553
§ 2. LES CAUSES DE L'EXPLOITATION ECONOMIQUE ET
SEXUELLE DES ENFANTS
On peut dissocier les causes du travail et la traite d'enfants
(A) de celles relatives à la persistance des
sévices et exploitations sexuels des enfants (B).
A. LES CAUSES DU TRAVAIL ET DE LA TRAITE DES ENFANTS
On analysera successivement les résistances d'ordre
immédiat (1), d'ordre sous-jacent (2), puis celles d'ordre structurel
(3).
1. Les résistances d'ordre
immédiat
Le travail précoce et le trafic des enfants sont
favorisés par une offre insuffisante d'éducation et de formation,
la forte demande d'une main d'oeuvre enfantine bon marché et soumise, le
désir des enfants de migrer à la recherche d'une promotion
économique et sociale et l'ignorance des risques.
Les enfants sont en situation de travail parce qu'ils sont
exclus du système éducatif. En effet, les enfants qui n'ont pas
été soumis à une obligation scolaire sont obligés
de travailler, d'apprendre un métier manuel avant d'avoir 15 ans. Le
système éducatif ivoirien a une rentabilité relativement
faible, notamment au niveau du primaire étant donné les forts
taux d'abandon et de redoublement1563. En outre, le taux de
scolarisation dans le primaire, ne progresse pas suffisamment et reste encore
caractérisé par une sous-scolarisation des filles malgré
des efforts enregistrés ces dernières
années1564. Les différences s'accentuent selon les
régions. Les études réalisées sur la question
attestent que plus de 3/4 des petites bonnes1565
1563 Le taux net de scolarisation primaire est de 68% et le
taux net de scolarisation secondaire s'élève à 29%. 1564
Voir MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA (MSLS) et l'INSTITUT
NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) et ICF International, Enquête
Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples de la
Côte d'Ivoire 2011-2012 : Rapport de synthèse. Calverton,
Maryland, USA : MSLS, INS et ICF International, 2013, pp.28-29.
1565 KRA KONAN (G. L.), «
Travaux domestiques et activités scolaires des
élèves-filles en milieu urbain : une analyse des effets
», European Scientific Journal November, 2015, pp 242-363. ; INS,
DGT, OIT, IPEC, Enquête nationale sur le travail des enfants
2005, 2008, Rapport Final, 148 p. ; JACQUEMIN (M.), « Travail
domestique et travail des enfants, le cas d'Abidjan (Côte d'Ivoire)
», In Tiers-Monde, Tome 43, n°170, 2002, pp.307-326. ;
JACQUEMIN (M.), « De jeunes travailleuses migrantes si (in)visibles : les
«petites domestiques» d'Afrique de l'ouest : Perspectives
comparatives à partir de l'exemple des fillettes et jeunes filles au
travail à Abidjan », Centre d'Etudes Africaines, Centre for
Migration Studies, Migration,
554
a une base instructive faible en raison de la non
scolarisation et des échecs scolaires, créant ainsi un raccourci
dans le circuit scolaire (déscolarisation). Les enfants victimes de
trafic ou traite présentent les mêmes caractéristiques, car
ils sont constitués essentiellement de populations analphabètes
et déscolarisées. Ils sont donc plus mobiles et susceptibles de
tomber sous le charme de la promesse d'un emploi ou d'une activité
rémunérée. Il convient donc de développer davantage
les opportunités d'éducation et de formation qui sont
actuellement insuffisantes.
L'absence de l'obligation scolaire durant des années a
été un facteur déterminant du travail précoce des
enfants. Le faible accès à l'éducation mettait les enfants
en situation d'oisiveté ou d'inactivité et les rendait plus
vulnérables, compte tenu de leur faible niveau d'instruction.
Aujourd'hui, avec l'institution de l'école obligatoire au niveau du
primaire, il y a lieu d'espérer que la situation évoluera. Encore
faut-il que les modalités du caractère obligatoire et gratuit de
l'école soient mieux définies et précisées, afin de
limiter les manquements à cette obligation.1566
Le travail des enfants correspond en outre, à une
demande de main d'oeuvre croissante. La captation de la main d'oeuvre enfantine
répond aux besoins du marché et des ménages. De plus en
plus, les employeurs marquent leur préférence pour la main
d'oeuvre enfantine qui est à la fois bon marché, mais surtout
soumise et corvéable. En outre, le recours à la force de travail
de l'enfant, notamment de la jeune fille domestique répond aux besoins
du ménage d'accueil1567. En effet, il permet de
libérer d'autres forces de travail au sein du ménage,
essentiellement, celles de la femme et de diversifier les sources de revenu.
C'est ainsi qu'en plus des tâches domestiques, certains enfants se voient
confier des activités manuelles rémunératrices pour le
compte de la famille d'accueil ou de l'employeur ; il s'agit de la vente
ambulante par les « petites vendeuses ».
Globalisation et Poverty, Rockefeller Foundation,
DFID, Paris,2009, 33p. ; SAVE THE CHILDREN, Ca-la, c'est difficile :
L'exploitation du travail des enfants en Côte d'Ivoire, Abidjan,
2009, 84 p.
1566 Ministère délégué à la
famille, Les manquements à l'obligation scolaire, rapport Luc
MACHARD, janvier 2003, 169p.
1567 JACQUEMIN (M.), « Travail domestique et
travail des enfants, le cas d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) ». In:
Tiers-Monde, tome 43, n°170, 2002. Femmes en
domesticité. Les domestiques du Sud, au Nord et au Sud. pp. 307-326
; ANTOINE(P.) et GUILLAUME (A.), Une expression de la solidarité
familiale à Abidjan : enfants du couple et enfants confiés, Les
familles d'aujourd'hui (Colloque international de Genève, 17-20
septembre 1984), Paris, orstom, 1984 13 p. ; BICE, Les petites bonnes
à Abidjan. Travail ou exploitation ?, Abidjan, BICE
Côte-d'Ivoire, 1998, 168 p.
555
Dans le secteur minier d'exploitation artisanale, la main
d'oeuvre enfantine semble plus appropriée pour des raisons
socio-culturelles. L'enfant est perçu comme présentant une
virginité capable de capter le trésor (diamant, or) enfoui dans
les profondeurs du sol, argileux et parfois en dessous des
roches1568. Dans le secteur agricole, la main d'oeuvre enfantine
s'accroit et tend à se substituer aux ouvriers agricoles adultes. Ainsi,
dans certaines plantations de la région forestière du pays, des
enfants de 7 à 17 ans répondent aux besoins exprimés par
les exploitants. La demande est tellement forte que l'on recourt à une
main d'oeuvre enfantine pour satisfaire aux besoins.
Le désir des enfants de migrer à la recherche
d'une promotion économique et sociale est aussi donné comme un
facteur explicatif de la traite et du travail des enfants1569. Les
enfants qui sont dans l'oisiveté et l'inactivité recherchent une
promotion économique et sociale. D'où leur désir de migrer
de la zone rurale vers la ville pour un meilleur être, à la
recherche de sources de revenus. Le désir de l'enfant de migrer
correspond parfois aux projets des parents. Ainsi, les jeunes filles migrent en
zone urbaine, notamment à Abidjan en vue de préparer leur
mariage, et parfois à la recherche de moyens financiers pour subvenir
à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ou petits
frères restés au village ou l'accompagnant. Le travail est
perçu comme un moyen d'ascension sociale. La prestation du jeune
travailleur a pour contrepartie une rémunération, qui constituera
une épargne capitale pour la réalisation de certains projets,
dont l'aide à la famille. Chez les enfants migrants étrangers, le
travail en Côte d'Ivoire est envisagé comme une source de revenus
suffisants pour satisfaire certains besoins parfois personnels : achat d'un
vélo, de tenues vestimentaires et de jouets. Le travail précoce
et la migration des enfants répondent ainsi à des aspirations
économiques et sociales1570.
Malheureusement, les enfants travailleurs sont ignorants des
risques du travail précoce et des conditions de travail. Cette ignorance
s'explique par leur jeune âge et leur faible niveau d'instruction. Au
moment du recrutement ou du placement, les risques du travail ne sont pas
1568 KIHANGI KYAMWAMI (P.), Travail des enfants dans le
site minier d'exploitation artisanale de Bisie en territoire de Walikale. Une
crise oubliée en République Démocratique du Congo,
Anvers, Aout 2013, p.22. 1569 DIALLO (Y.), Les déterminants du
travail des enfants en Côte d'Ivoire, Document de travail n°5
Université Montesquieu-Bordeaux IV, France, 2002, 16 p.
1570 JACQUEMIN (M.), De jeunes travailleuses migrantes si
(in) visibles: les «petites domestiques» d'Afrique de l'Ouest,
perspectives comparatives à partir de l'exemple des fillettes et jeunes
filles au travail à Abidjan, Centre d'études africaines,
Paris, 2009, 33 p.
556
expliqués aux enfants. Et parfois, le ferme
désir de travailler ne permet pas d'appréhender les risques
inhérents au travail sollicité. Se pose aussi la question de leur
maturité. Tout ceci participe de la persistance du
phénomène du travail des enfants à l'instar des facteurs
sous-jacents ponctués entre autres, par le faible niveau de vie des
familles et la prolifération des agences de placement.
2. Les causes sous-jacentes de la persistance du travail
des enfants
Au nombre des facteurs sous-jacents, figurent le faible niveau
de vie des familles d'origine, la prolifération des agences de placement
et d'intermédiaires occasionnels, le statut social des enfants dans la
société traditionnelle et les réseaux de solidarité
et les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe. Tous ces facteurs
contribuent à pérenniser la pratique du travail des enfants.
Le faible niveau de vie des familles d'origine figure en
première ligne de ce catalogue d'arguments. Si certains enfants
s'occupent à exercer un métier pour leur survie, d'autres sont
placés en situation de travail pour des raisons de profit. Les enfants
en situation de travail ou de trafic sont issus de familles pauvres. C'est la
pauvreté1571 des parents qui conduit les enfants au travail.
Et le niveau élevé de pauvreté des parents est source de
motivation pour certains enfants qui les conduit au travail précoce. La
plupart des enfants domestiques sont issus de ménages vivant en zone
rurale ou en zone urbaine pauvre ou périphérique. Dans ces
familles d'origine, la plupart des parents sont sans emploi. Quant aux familles
en zone rurale, le père est planteur ou cultivateur et la mère
est ménagère. Les milieux de résidence d'origine des
parents se caractérisent par un faible accès aux services sociaux
de base. A cela s'ajoute, l'insuffisance et l'inégale répartition
des infrastructures éducatives et sanitaires. Cette situation encourage
la mobilité1572 des enfants vers la ville,
1571 LACHAUD (J.P.), Le travail des enfants et la
pauvreté en Afrique : Un réexamen appliqué au Burkina
Faso, disponible sur
www.ged.u-bordeaux4.fr/ceddt96.pdf
(consulté le 20/11/2016); DIALLO (Y.), « Les déterminants du
travail des enfants en Côte d'Ivoire », Journal of economic
literature, I2, I3, J2, J4. ; DIALLO (Y.). « Les déterminants
du travail des enfants en Côte d'Ivoire. », Journal of economic
literature, I2, I3, J2, J4, Grootaert, C. 1998. «Child labor in Cote
d'Ivoire», in Grootaert C. And Patrinos A.P. (eds), The policy of
child labor: A comparative study, New York: ST. Martin Press.
1572 UNICEF, Quelle protection pour les enfants
concernés par la mobilité en Afrique de l'Ouest ? Nos positions
et recommandations. Rapport régional de synthèse-Projet «
Mobilités »-Projet régional commun d'étude sur les
mobilités des enfants et des jeunes en Afrique de l'Ouest et du
centre, 83p. disponible sur
www.unicef.org/wcaro/french/Rapport_FR-web.pdf
(consulté le 20/11/2016).
557
dans l'espoir de trouver un cadre plus propice à leur
épanouissement, en échange de leur force de travail.
Le niveau d'éducation des parents est un autre facteur
favorisant la précocité dans le travail et la mobilité des
enfants. L'ensemble des études menées sur la question
relève que les parents des enfants placés en domesticité
ou dans d'autres secteurs informels, sont analphabètes. Tous ces
facteurs placent l'enfant dans une situation de vulnérabilité
permanente qui devient une proie facile pour les placeurs d'enfant comme en
témoigne la prolifération des agences de placement1573
et d'intermédiaires occasionnels
Pour répondre à la forte demande de main
d'oeuvre enfantine, certaines personnes fournissent des prestations en
contrepartie d'une commission conséquente. Cet intermédiaire peut
être soit un parent qui prétend rendre service de façon
occasionnelle ou un véritable professionnel qui exerce dans une
structure de placement et de recrutement. Ce dernier est chargé de
recruter les enfants dans leurs villages et les placer auprès d'un
employeur ou d'une famille d'accueil. L'intermédiaire qui recrute dans
les lieux de résidence des enfants est souvent une femme vivant en zone
urbaine, qui apparait comme un modèle de réussite, parfois une
ancienne domestique, faisant jouer les relations familiales et communautaires.
Elle agit la plupart du temps, à la demande des parents.
En zone urbaine, le marché du placement est
dominé par des agences informelles. Ces agences ont pignon sur rue et
alimentent les ménages, les maquis1574 et restaurants en main
d'oeuvre domestique infantile. Nombreux sont les employeurs qui ont recours
à ces agences pour satisfaire leur besoin en domestiques ou petites
bonnes ainsi qu'à des parents qui sont à la recherche d'une
activité salariée pour leurs enfants1575. Pour la
seule ville d'Abidjan, on dénombre une centaine d'agences de placement
d'enfants, lesquelles agences sont pour la plupart informelles et
clandestines1576. Ces agences travaillant dans
l'illégalité occupent des espaces bien connus. On les appelle
communément « marché noir » ou «
marché kunta
1573 ROLLET (C.), « Les placements d'enfants : historique
et enjeux. » In Revue Quart Monde, 2001, 178,
pp.9-13.
1574 Ce terme désigne les bars en Côte d'Ivoire.
1575 JACQUEMIN (M.), Travail domestique et travail des
enfants, le cas d'Abidjan (Côte d'Ivoire). In :
Tiers-Monde, tome 43, n°170, 2002, pp.314-315.
1576 Pourtant, en Côte d'Ivoire, l'ouverture et
l'exploitation d'un bureau de placement payant est soumis à un
agrément, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux
de placement payant.
558
kinté1577 ». Chaque agence
peut placer entre 20 à 30 petites bonnes par jour selon des informations
recueillies durant nos enquêtes de terrain. Ce dynamisme des agences de
placement montre l'ampleur du phénomène de trafic ou de traite
d'enfants à des fins d'exploitation de leur travail. Le placement des
enfants victimes de trafic ou de traite obéit aux mêmes
règles. Ici, le recrutement se fait dans le pays d'origine de l'enfant
par des ressortissants du pays. Les intermédiaires travaillent en
professionnels exerçant en collaboration avec des transporteurs et des
pisteurs1578.
Le statut social des enfants dans la société
traditionnelle et les réseaux de solidarité fournissent aussi des
éclairages à la compréhension à la prégnance
de cette pratique.
En Afrique, le travail des enfants et les pratiques solidaires
apparaissent comme deux réalités sociologiques intimement
liées. En effet, dans la société ivoirienne
traditionnelle, le travail est considéré comme une ressource
pédagogique. L'enfant apprend les règles du métier et les
techniques culturales et agricoles, les règles sociales auprès de
son père ou de sa mère. La socialisation de l'enfant par le
travail productif est donc une nécessité sociale qui tend
aujourd'hui vers une exploitation. En outre, la mobilité infantile
participe aux réseaux de solidarité et d'entraide ainsi qu'au
renforcement des liens de parenté. Dès leur jeune âge, les
enfants sont confiés au lignage, à un parent, pour son
éducation, sa socialisation. Cette pratique de confier les enfants a
favorisé le trafic ou la traite d'enfants. C'est ainsi que dans le cas
du travail interne, le recruteur d'enfants est un membre de la
communauté villageoise ; ce qui instaure auprès des parents de
l'enfant des relations de confiance et de reconnaissance. Les trafiquants
d'enfants abusent de la naïveté et de la pauvreté des
familles pour recruter leurs enfants et les placer dans les réseaux
internes et internationaux de trafic ou de traite d'enfants.
1577 Cette expression « KINTA KUNTE » n'est pas
fortuite ; Il évoque l'histoire d'un personnage de fiction, héros
du roman Racines d'Alex Haley et des films télévisés
dénommés « RACINES ». Dans ce film, KUNTA KINTE
d'origine mandingue fut capturé et amené loin de sa terre natale
à Annapolis où il fut vendu à un planteur en Virginie.
1578 BICE, Les petites bonnes à Abidjan. Travail ou
exploitation ?, Abidjan, BICE, Côte d'Ivoire, 1998, 168p. ; DIOP
(R.), Secteur informel et exploitation du travail des enfants : une
étude de deux réseaux pourvoyeurs d'enfants loués à
Abidjan, Abidjan, Université d'Abidjan, Département de
sociologie, mémoire de maitrise, 1987, 99p.
559
Par ailleurs, les pratiques discriminatoires fondées
sur le sexe1579 justifient aussi le travail des enfants, notamment
de sexe féminin. Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire
(Nord et Nord-Est), les pratiques éducatives sont basées sur la
discrimination à l'égard de la fillette1580. Les
enfants sont au centre de stratégies familiales qui privilégient
le jeune garçon par rapport à la jeune fille. C'est ainsi que les
jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation sont
promises au mariage ou au travail domestique. Non-scolarisés, elles sont
prédestinées aux métiers manuels, très peu
rémunérés. Dans ces situations, le choix des parents est
déterminant pour l'avenir de l'enfant, particulièrement, la
petite fille.
Au-delà des facteurs sus-évoqués, des
facteurs de nature structurelle apparaissent comme une clé de
compréhension de ce triste phénomène de travail des
enfants.
3. Les résistances structurelles à la lutte
contre le travail des enfants
Au niveau structurel, les résistances résident
au niveau du manque d'efficacité de la volonté politique et
l'inadaptation ou l'inexistence d'une législation nationale
spécifique qui a eu cours durant de longues années, ainsi que la
surveillance insuffisante des frontières et la méconnaissance des
droits de l'enfant.
Comme déjà indiqué, la Côte
d'Ivoire a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant
depuis le 04 février 1991, mais elle a attendu plus de 7 ans avant
d'adopter et déposer son rapport initial au comité des droits de
l'enfant. La ratification de la convention n'a pas été suivie
immédiatement de textes d'application. Bien qu'ayant toujours
existé1581, le travail précoce et
l'exploitation des enfants se sont davantage répandus parce qu'il n'y
avait pas de moyens d'inspection appropriés. Les contrevenants à
l'interdiction du travail des enfants n'étaient pas
systématiquement sanctionnés. Le code du travail ivoirien ne
réglementait pas le travail des enfants dans le secteur informel ou
parallèle qui occupait la plupart des enfants concernés. En
outre, le trafic ou la traite d'enfants est une nouvelle criminalité qui
longtemps
1579 Rapport de la direction générale de la
mondialisation, du développement et des partenariats du ministère
français des affaires étrangères, Les violences de
genre en milieu scolaire d'Afrique subsaharienne francophone, 2012, 28p. ;
MBASSA MENICK (D.), « Les abus sexuels en milieu scolaire au Cameroun :
résultats d'une recherche-action à Yaoundé » In.
Médecine tropicale, n° 62-1, p. 58-62, 2002.
1580 Note de situation de la Fédération
internationale des associations des droits de l'homme, Naitre fille, c'est
surmonter beaucoup d'obstacles, 7 mars 2016, 8 p.
1581
http://www.archives18.fr/article.php?laref=482
560
n'a pas été réprimée en tant
qu'infraction spécifique. En un mot, cela traduisait le manque
d'efficacité de la volonté politique et l'inadaptation ou
l'inexistence d'une législation nationale spécifique qui a eu
cours durant des années. Cette situation encourageait les trafiquants et
exploiteurs d'enfants qui se constituaient en réseaux.
De surcroît, la surveillance insuffisante des
frontières1582 encourage encore aujourd'hui la persistance de
ce phénomène. Le trafic transfrontalier d'enfants est
favorisé par la tradition de migration des travailleurs
saisonniers1583 ou agricoles1584 en Côte d'Ivoire.
La perméabilité des frontières a permis aux trafiquants de
développer des réseaux de placement d'enfants. Les enfants
victimes de trafic sont envoyés sur le territoire avec la
complicité ou le laxisme de certains agents chargés de veiller
sur la sécurité aux frontières1585.
La méconnaissance des droits de l'enfant par les
placeurs d'enfants et les employeurs expliquent aussi en partie la pratique. En
effet, ceux-ci ignorent, pour la plupart encore, que le travail précoce
des enfants est contraire au bien-être de l'enfant et constitue une
violation de leurs droits fondamentaux1586. La majorité des
agences de placement et les parents ignorent que l'âge minimum
d'admission à l'emploi est fixé à quinze (15) ans et que
le placement est prohibé dans certains lieux1587. Et lorsque
les droits de l'enfant sont connus des différents acteurs, ils sont
inappliqués. Il n'y a donc pas un programme efficace de vulgarisation
des dispositions de la CIDE et des autres normes pertinentes de protection des
droits de l'enfant à l'intention de cette catégorie de
personnes.
1582 GU KONU (E.), Les frontières en Afrique de
l'ouest, sources et lieux d'information in Hommes et Migrations,
n°1160, décembre 1992, p.24.
1583 OIM, Migration en Côte d'Ivoire-Profil National
, 2009, 114p. ; FALL (P.D.), « Travailler en circulant. La
circulation en Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique
du Sud », In. Migrations-Société 18 (107), 2006 :
pp.233-251.
1584 DIALLO (Y.), Les enfants et leur participation au
marché du travail en Côte d'Ivoire, Thèse de Doctorat
ès Sciences économiques, Université Montesquieu Bordeaux
IV, 355p.
1585 Les forces de l'ordre ivoirienne ont récemment mis
fin aux activités peu recommandable d'un trafiquant d'enfants. En effet,
Yacoub BARI de nationalité togolaise a été mis aux
arrêts, le jeudi 12 juin 2016 à Noé (Villé
Frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana) par la police des
Frontières. Ce trafiquant en compagnie de six enfants (3 filles et 3
garçons) dont l'âge varie de 4 à 16 ans en provenance de
Boaré dans la sous-préfecture de Dapaong au Togo. Après
son arrestation, Yacoub BARI a été déféré au
Tribunal d'Aboisso où il a été condamné à
une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à payer une amende de
cent mille Francs (100.000 Fcfa). Les enfants ont été quant
à eux, mis à la Maison d'accueil Padre Pio de Yaou à
Bonoua avant leur retour dans leur pays d'origine.
1586 PECES (G.)- MARTINEZ (B.), Théorie
générale des droits fondamentaux, Série droit, LGDJ,
2004, pp.34-36.
1587 Débit de boisson, restaurants, sites miniers et
aurifères.
561
Cela dit, il importe d'analyser à présent, les
résistances tenant à la persistance des sévices et
exploitations sexuels des enfants.
B. LES RESISTANCES TENANT A LA PERSISTANCE DES SEVICES
ET EXPLOITATIONS SEXUELS
Outre les mauvaises conditions de vie et une sexualité
précoce non maitrisée (1), seront examinés les
dysfonctionnements familiaux, le travail des jeunes filles en
domesticité, l'influence du milieu de vie (2), et d'autres fortes
résistances d'ordre structurel (3).
1. Les mauvaises conditions de vie et une
sexualité précoce et non maitrisée
On le sait : Les enfants vivant dans des conditions difficiles
sont plus exposés aux sévices et abus sexuels. La plupart des
parents d'enfants victimes de prostitution vivent dans des conditions de
précarité, de misère et parfois des situations
d'extrême pauvreté. La prostitution des filles constitue un moyen
pour améliorer leurs conditions de vie. Dans cette stratégie de
lutte pour la survie, les enfants n'ont pas assez de ressources physiques et
morales pour résister à la pression familiale ou du milieu et ils
sont poussés, sinon, livrés à la prostitution dès
leur puberté. Aussi, certains parents ne se soucient pas de la
provenance de l'argent rapporté à la maison par les enfants, du
commerce sexuel ou même les encouragent à cette
pratique1588.
Une sexualité précoce1589 et non
maitrisée est un autre facteur déterminant de l'exploitation
sexuelle des enfants. De plus en plus, de jeunes filles atteignent la
puberté1590 très tôt. La précocité de
l'âge de la puberté à 10 ou 12 ans place les jeunes filles
dans une situation de besoins physiques. Dans ces circonstances, elles prennent
conscience des potentialités qu'offrent leur corps et le commerce du
sexe en découlant pour pouvoir sortir de la pauvreté. Les
rapports sexuels précoces et non maitrisés moyennant finances,
placent les enfants dans une situation de dépendance dont profitent les
clients et les réseaux de
1588 KOUTOUAN (N.C.), Etude sur la prostitution enfantine
et les réseaux de traite dans les communes de Yopougon et
d'Adjamé, GTZ, 2007, p.30.
1589 BOISLARD PEPIN (M.A.), Précocité
sexuelle et comportements sexuels à risque à l'adolescence :
étude longitudinale des facteurs individuels, familiaux, dans le groupe
d'amis et contextuels associés, Thèse de doctorat en
psychologie, Université du Québec à Montréal,
Février 2010, 249p.
1590 PIENKOWSKI (C.) et GRANDJEAN (S.), La puberté
avant l'âge in Nouveaux aspects, juillet 2009, 42 p.
562
563
prostitution enfantine. Par ailleurs, les dysfonctionnements
familiaux et le travail des jeunes filles en domesticité expliquent
aussi la persistance des sévices et exploitations sexuels des
enfants.
2. Les dysfonctionnements familiaux et le travail
domestique des enfants
Les dysfonctionnements familiaux et le travail domestique des
enfants constituent inévitablement des terreaux fertiles à leur
exploitation économique et sexuelle.
La dislocation de la cellule familiale place les enfants dans
une situation de vulnérabilité certaine. N'ayant pas le soutien
et l'attention d'une famille unie et solidaire, les enfants notamment, les
jeunes filles sont des victimes désignées d'abus sexuels et
d'exploitation sexuelle. En effet, il arrive que le père abandonne sa
famille laissant la mère avec plusieurs enfants à nourrir,
soigner et sans protection. Les enfants issus d'un tel cercle familial sont
plus exposés car fragiles et extrêmement vulnérables.
Le travail domestique des enfants est parfois un paravent
à l'exploitation sexuelle. Les jeunes filles employées de
domiciles privés, de restaurants ou débits de boissons sont plus
exposées aux abus sexuels de la part des hommes, de la famille ou des
clients de l'exploitation commerciale. Selon le Bureau International Catholique
pour l'Enfance (BICE), la plupart des filles employées de maison a
essuyé les avances sexuelles du patron ou ont été victimes
d'abus sexuels et de viol, parfois collectif. Il arrive parfois que sous le
couvert du travail domestique, certaines filles se livrent à la
prostitution occasionnelle ou informelle pour augmenter leur revenu, si elles
ne sont pas initiées par leur employeur qui en tire un profit
économique certain.
Outre cela, des facteurs d'ordre structurel justifient
l'exploitation sexuelle des enfants.
3. Les résistances d'ordre structurel
Pour être nombreuses, ces résistances se
rapportent essentiellement au manque d'efficacité de la
répression, l'effondrement des valeurs traditionnelles, les unions
précoces et forcées et le développement des
réseaux.
S'agissant du manque d'efficacité de la
répression, il est à noter que les enfants victimes de
sévices ou d'abus sexuels éprouvent une gêne à
dénoncer les auteurs. Et lorsque les
auteurs sont dénoncés, on observe une
réticence des autorités de police à identifier les
coupables et à les poursuivre en justice. En tout état de cause,
le système de répression pénale n'est pas efficace car les
faits de viol sont souvent ignorés ou disqualifiés et les auteurs
ne sont pas sévèrement sanctionnés. La crainte de
représailles finit par convaincre les enfants victimes à
abandonner toute poursuite.
Quant à l'effondrement des valeurs
traditionnelles1591, on constate malheureusement que les normes de
bon comportement et les mécanismes traditionnels d'encadrement de la
société (sanctions sociales) s'effondrent. L'on assiste à
une dépravation des moeurs1592 et l'incitation
délibéré des jeunes à la
débauche1593. Cette situation est favorisée par
certaines croyances qui véhiculent l'idée de richesse et de
puissance grâce aux rapports sexuels avec un enfant. La banalisation des
valeurs morales et l'abandon des règles de protection des enfants font
de ces derniers, des objets de plaisirs sexuels.
Quant au développement des réseaux, dans le cas
de la prostitution enfantine et de la pédophilie, la demande s'organise
en cercles fermés et réseaux. Le
proxénétisme1594 se développe et de plus en
plus de jeunes couvrent cette demande croissante. Cette situation est due au
manque de volonté politique pour aborder de front ce problème.
L'indifférence ou la complicité de la police et la puissance des
instigateurs ont contribué à l'organisation du milieu et
l'expression du marché du sexe impliquant les enfants.
En sus, dans la plupart des communautés, le mariage
précoce des filles est un projet social de premier ordre. Dès
l'enfance, la jeune fille est proposée en mariage et elle doit rejoindre
son partenaire, même si elle n'a pas achevé son
développement physique ou même si elle s'y oppose. C'est donc ce
corps frêle qui doit subir des rapports sexuels inopportuns. Le
traumatisme causé à la jeune fille aura des conséquences
sur sa santé physique et son bien-
1591 ACHEBE (C.), Le monde s'effondre, Editions
Présence Africaine, juillet 2000, 250 p.
1592 KOUTOU (N. C.), DOUABELE (A.-C.), KOFFI (A. P.), KANON
(G. L.), ETTIEN (A.M.), Crises et violence en milieu universitaire ivoirien
: impact sur les valeurs de l'Université, 2007, 28 p.
1593 UNICEF, Exploitation et abus sexuels des enfants en
Afrique de l'Ouest et du Centre : Evolution de la situation,
progrès accomplis et défis à surmonter depuis le
Congrès de Yokohama (2001) et la Conférence Arabo-Africaine de
Rabat (2004), novembre 2008, 71 p.
1594 MARON (M.), C'est la prostituée qui fait le
proxénète, Dr. pén. 1990, n°2, chron. 1. ;
PRADEL (J.) et DANTI-JUAN (M.), Droit pénal spécial,
4ème édition 2007/2008, Cujas, n°772 ;
564
être psychologique. Les unions coutumières ou
religieuses précoces cachent les souffrances des
enfants1595.
Une autre forme de résistances qui ne peut être
passée sous silence a trait à celles relatives aux enfants en
conflit avec la loi et ceux en situation d'urgence.
§ 3. LES CAUSES DE LA PERSISTANCE DU PHENOMENE
DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI OU DES ATTEINTES AUX DROITS DES ENFANTS EN
PERIODE DE CONFLIT ARME
Seront successivement analysées, les résistances
tenant à la persistance du phénomène des enfants en
conflit avec la loi (A) puis celles tenant aux graves atteintes aux droits de
l'enfant en période de conflit armé (B).
A. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PERSISTANCE DU
PHENOMENE DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI
Après avoir abordé les résistances
immédiates (1), nous examinerons les résistances lointaines(2)
qui expliquent la situation des enfants en conflit avec loi.
1. Les facteurs immédiats
La dislocation de la cellule familiale et les carences
éducatives, le développement de la délinquance
juvénile, l'influence du groupe et l'ignorance des risques constituent
autant de causes directes qui font perdurer le phénomène des
enfants en conflit avec la loi.
S'agissant de la dislocation de la cellule familiale et des
carences éducatives, notons que la famille est le milieu naturel dans
lequel se forme la personnalité de l'enfant1596. La
dislocation du tissu familial par l'éclatement ou l'éloignement
du couple, la perturbation du cercle familial par l'arrivée d'un nouveau
conjoint sont de nature à déséquilibrer l'enfant qui
cherche des repères sociaux. Dans ce cas, les carences éducatives
qui s'observent chez les enfants en danger moral sont des facteurs aggravant de
la déviance et de la délinquance juvénile. Ainsi, le
processus de socialisation de l'enfant est interrompu et l'enfant qui
1595 Centre de développement de l'OCDE, «
Examen du bien-être et des politiques de la jeunesse en Côte
d'Ivoire », Projet OCDE-UE Inclusion des jeunes, Paris 2017,
pp.108-109.
1596 KARBOWNICZEK (J.), La famille et la
créativité de l'enfant à l'âge préscolaire
Synergies Pays riverains du Mékong n°1-2010, p.196.
565
traverse sa crise d'adolescence est le plus porté sur
la facilité et le passage à l'acte délictuel. Selon les
données recueillies au CREA, alors que certains pensionnaires sont non
scolarisés, d'autres sont d'un niveau primaire et peu d'entre eux ont un
niveau secondaire. C'est dire que si l'ignorance et
l'analphabétisme1597 sont l'une des causes de la
délinquance, l'échec scolaire et l'exclusion sont des facteurs
déterminants dans la marginalité1598 des jeunes.
L'éclatement de la famille contribue à la
déviance1599 des jeunes. Il ressort de nos entretiens que la
plupart de ces enfants provient de famille désunie ; d'autres sont des
orphelins. Ce qui les place dans une situation de précarité,
d'oisiveté et d'exclusion sociale propice à la
délinquance.
La délinquance juvénile1600 est un
phénomène social qui tend à se développer ces
dernières années. Elle se manifeste en milieu urbain, compte tenu
des mouvements migratoires et des concentrations de population dans les villes.
Les mineurs délinquants commettent des délits de subsistance, des
larcins pour leur survie. Ils enfreignent la loi pour couvrir des besoins
vitaux pressants : l'alimentation, l'habillement, les soins
primaires1601... Les attaques contre les biens d'autrui
prédominent et se caractérisent par des délits de
vol1602,
1597 SEURAT (A.), Contexte d'alphabétisation dans
le contexte africain, thèse, Université de Bourgogne, 2012,
255 p. ; FINK (C.), L'éducation des femmes et le d
ìdéveloppement en Afrique subsaharienne,
Economies and finances, 2011, p. 51.
1598 IRITIE (N.D.), Echec scolaire et devenir
comportemental des adolescentes vivant dans les quartiers précaires
à Abidjan : Le cas de YAHOSEI dans la commune de Yopougon,
Mémoire de maitrise criminologie 2005 Université de Cocody-UFR de
criminologie, 2005, 90p. ; VULTUR (M.), « Les jeunes qui abandonnent les
études secondaires ou collégiales : rapport à
l'école et aux programmes d'aide à l'insertion
socioprofessionnelle », Revue des sciences de l'éducation,
vol.35, n°1, pp.55-67 ; VULTUR (M.), « Aux marges de
l'insertion sociale et professionnelle »In. Nouvelles pratiques
sociales, vol 17, n°2, 95-108.
1599 SICOT (F.), « Conflits de culture et déviance
des jeunes de banlieue », Revue européenne des migrations
internationales, vol.23-n°2, octobre 2010, pp.29-56 ; BRION (F.),
TULKENS (F.) « Conflit de culture et délinquance. Interroger
l'évidence », Déviance et société,
vol.22, n°3, pp.235-262.
1600 Ministère de la Justice, « Justice,
Délinquance des enfants et des adolescents. Etat des connaissances Actes
de la journée du 2 février 2015 » In. Justice des
enfants §des adolescents quel projet pour notre société ?,
Mai 2015, 165p.
1601 Article 104 code pénal ivoirien « Il n'y a
pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un
danger grave et imminent la vie, l'intégrité corporelle, la
liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, et
à la condition que le danger ne puisse être écarté
autrement et que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances.
».
1602 Art. 392 et suivants du code pénal ivoirien «
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est
coupable de vol ». ; Vol simple : Art. 393 du CP ; vol aggravé :
art. 394 du CP).
566
les abus de confiance1603,
l'escroquerie1604 et la grivèlerie1605 Les
atteintes contre l'intégrité physique d'autrui (agressions, coups
et blessures volontaires, abus sexuels) représentent aussi un
pourcentage non négligeable des cas. La détention et la
consommation des stupéfiants (drogues) sont reprochées à
une quantité d'enfants non négligeable. Le sentiment
d'insécurité qui est ressenti par la population a suscité
des réactions sociales qui se traduisent par l'emprisonnement des
enfants qui ont enfreint la loi1606.
L'influence du groupe et l'ignorance des risques exposent les
enfants à la commission d'infractions. Les enfants en conflit avec la
loi sont entrainés par leur groupe d'âge, par les mauvaises
fréquentations. Par l'effet de groupe, ils participent à des
actes délictuels avec des jeunes plus âgés et se retrouvent
seuls face aux autorités répressives. Les frustrations
accumulées par l'enfant en famille et les conditions difficiles
d'existence peuvent amener les enfants à trouver réconfort au
sein d'un groupe ou d'une bande. Les nouvelles valeurs
développées par le groupe sont une référence pour
lui. Ainsi, les enfants sont influencés par leur milieu de vie et de
fréquentation et ils ignorent les risques réels des actes
délictuels qu'ils sont amenés à poser. Les enfants en
danger moral développent de nouvelles valeurs qui sont parfois à
l'opposé des normes ou règles de conduite admises en
société.
A ce type de résistances, des causes lointaines
expliquent également la pérennisation des enfants en conflit avec
la loi.
2. Les causes lointaines de la pérennisation des
enfants en conflit avec la loi
Elles sont liées à la pauvreté des
ménages et des conditions de vie des enfants, à l'attitude de
réprobation de la communauté à l'égard des enfants
en conflit avec la loi.
Deux enfants sur trois privés de liberté sont
issus de familles démunies, dans lesquelles l'un ou les deux parents
sont au chômage. Ainsi, le revenu du foyer ne permet pas de subvenir aux
besoins de toute la famille. Les enfants en conflit avec la loi sortent
souvent
1603 Art. 401 du CP ivoirien.
1604 Art. 403 et suivants du Code pénal ivoirien.
1605 Art.398 du code pénal ivoirien.
1606 En Côte d'Ivoire, les mineurs dont l'âge est
inférieur à 13 ans ne peuvent être condamnés
à une peine d'emprisonnement ; Les juges peuvent appliquer aux mineurs
de 13 à 16 ans des peines d'emprisonnement. Mais ces peines doivent
être exceptionnelles. Le juge doit en principe leur
préférer des mesures éducatives.
567
des milieux défavorisés, vivent dans les
habitats précaires. Dans ces milieux de vie, l'enfant n'a presque pas
accès aux services sociaux de base.
Le mépris et l'indifférence de la
communauté attise les actions des enfants candidats à la
commission des infractions. Le sentiment d'insécurité
suscité par les atteintes contre les personnes et leurs biens a
provoqué des réactions de mépris et d'indifférence
de la communauté et des parents à l'égard des enfants en
conflit avec la loi. Les enfants incarcérés sont
abandonnés par leur famille et sont considérés comme des
bons à rien, des parias. Le manque d'attention et de visites familiales
aux enfants détenus contribue à renforcer le sentiment de
solitude, d'incertitude des enfants qui ont transgressé la loi. N'ayant
aucun contact avec l'extérieur, les enfants ont un faible apport
nutritionnel et en soins médicaux. Ils sont plus ou moins oubliés
par la communauté.
B. LES CAUSES DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'ENFANT EN
PERIODE DE CONFLIT ARME
Il s'agit principalement du conflit armé ivoirien et
des crises successives qu'ont connues certains pays de la sous région
africaine.
La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est
gagnée par les conflits armés internes1607 qui
affectent directement les populations civiles, plus particulièrement les
enfants. Depuis son indépendance jusqu'aux récents
évènements de 2002, la République de Côte d'Ivoire
est restée un Etat de paix. C'est ainsi que les populations civiles des
pays limitrophes en conflit armés ont trouvé refuge en Côte
d'Ivoire. Parmi les populations déplacées, la situation des
enfants non accompagnées1608 reste très
préoccupante. Les populations civiles fuyant la guerre civile au Liberia
ont été accueillies par les populations ivoiriennes autochtones
dans les zones d'accueil (Guiglo, Danané, Tabou et Toulepleu). La guerre
civile du Liberia a eu un impact considérable sur la Côte
d'Ivoire, Etat voisin qui a
1607 SATCHE (B.R.), Les conflits armés internes en
Afrique et le droit international, thèse de doctorat en droit,
2008, 482p. ; SCHINDLER (D.), « The different types of armed
conflicts according to the Geneva Convention and protocols »In.
R.C.A.D.I., 1979, volume 163.
1608 COMITE DES DROITS DE L'ENFANT, « Traitement des
enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors
de leur pays d'origine », Observation générale
n°6, CRC/GC/2005/6 (2005) §84. ; « Mineurs non
accompagnés », in La Revue de Rabat, La lettre d'information du
Dialogue Euro-Africain sur la Migration et le Développement
(Processus de Rabat), n°1 Les groupes vulnérables, p.2. ; Au
niveau européen, voir, NISRINE EBA NGUEMA, « La protection des
mineurs migrants non accompagnés en Europe », La Revue des
droits de l'Homme, 7/2005 disponible sur htpp://
revdh.revues.org/1147
(consulté le 15 décembre 2016).
568
déployé des moyens supplémentaires et
subi parfois la dégradation de son environnement dans les zones
d'accueil. Cette situation s'est aggravée avec une décennie de
crise politico-militaire qu'a vécue la Côte d'Ivoire depuis
20021609. Il nous faut donc rêver d'une Côte d'Ivoire
débarrassée de tout conflit et de toute guerre, pour ensuite
vouloir construire un Etat de droit propice à l'effectivité des
droits. Dans la procession de cette Côte d'Ivoire nouvelle, la
trêve du conflit ou de la guerre ne sera que l'annonce du droit de la
paix et le triomphe du droit à la paix1610. Toutefois la paix
tant recherchée doit-elle être obtenue par la guerre ? La
réponse à la question semble négative. L'avènement
de la paix impose une tout autre logique que celle héritée de
l'adage : « si tu veux la paix prépare la guerre ».
En effet, l'histoire nous enseigne que chaque fois que les canons se sont tus,
les hommes ont toujours nécessairement eu recours au dialogue, à
la négociation et à la médiation, seuls moyens
garantissant l'accès à la cité idéale dont nous
aspirons tous à être les citoyens : la société
cosmopolitique1611. Si la maxima civitas1612
doit se faire pour tous les Ivoiriens, elle ne saurait se faire sans eux.
L'Etat de droit procède de la volonté de respect des institutions
républicaines et de restauration de la dignité humaine, par
laquelle le projet de paix1613 devient
réalité1614. Les Ivoiriens doivent donc rompre
définitivement avec la guerre. Cette rupture devrait servir de
référence pour exorciser en chaque ivoirien, notamment, tous les
acteurs politiques, l'amour de la guerre en méditant ces sages paroles :
« Il faut maintenant que je retourne sur mes pas, et que j'ôte
à ceux qui font la guerre, presque tout ce qu'il semble que je leur aie
accordé, (...) car (...), il était certainement plus
honnête et plus louable, selon le sentiment des gens
1609 ACKA SOHUILY (F.), « Conflit et guerre pour la paix
en Afrique : de quel droit », In. L'Afrique de l'Ouest et la tradition
universelle des droits de l'homme, Editions du CERAP, colloque d'Abidjan
13, 14 et 15 mars 2006, p.163 et s.
1610 SOMMAGURA (C.), « Réflexions et convictions
sur l'humanitaire d'aujourd'hui et demain » in Revue internationale de
la Croix Rouge, juin 2000, Vol.82, n°837, p.295.
1611 KANT (E.), Idée d'une histoire universelle
d'un point de vue cosmopolitique(1784), trad. J.M. Muglioni, Bordas,
Paris, 1981.
1612 Civitas maxima est une expression d'origine latine qui
signifie « communauté internationale ». Elle renvoie aussi
à une doctrine juridique qui affirme que tous les êtres humains en
tant que membres de la communauté internationale partageant un certain
nombre de valeurs et s'entendent sur le fait que les violations les plus graves
commises à l'encontre de ces valeurs appellent une réponse
équitable et vigoureuse, sans peur ni faveur pour aucun. Cette doctrine
considère qu'il existe un intérêt individuel et que cet
intérêt commun doit les amener à faire en sorte que les
crimes les plus graves ne restent pas impunis.
1613 KANT(E.), Projet de paix perpétuelle
(1795), trad. J. Gibelin, 6e éd. Vrin, Paris 1988.
1614 ACKA SOHUILY (F.), « Conflit et guerre pour la paix
en Afrique : de quel droit ? » In. L'Afrique de l'Ouest et la
tradition universelle des droits de l'homme, Editions du CERAP, colloque
d'Abidjan 13, 14 et 15 mars 2006, p.163 et s.
de bien, de s'en abstenir »1615. Pour
réconcilier la Côte d'Ivoire avec son humanité et la
créditer de la paix qui lui est nécessaire et propice à
une effectivité des droits de l'enfant, une sagesse nouvelle s'impose
aux ivoiriens, intimant son ordre à la pensée et à
l'action : si tu veux la paix, prépare la paix !
Les causes identifiées, une autre condition essentielle
pour espérer une amélioration de l'effectivité des droits
de l'enfant, consisterait à préconiser des mesures significatives
face à cette crise d'effectivité.
569
1615 GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix,
(1687), Livre III, Chapitre X, Paragraphe 1.
570
Chapitre II :
LES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR D'UNE
EFFECTIVITE
AMELIOREE
Le point le plus critique des droits de l'enfant comme de tout
droit de l'homme constitue à n'en point douter sa mise en oeuvre, sinon
sa réalisation. Dans la réalisation des droits de l'enfant, les
conditionnements d'ordre politique, pragmatique et empirique ont souvent pris
le pas sur les considérations purement juridiques et positivistes.
L'effectivité, la vigueur et la satisfaction d'un droit
s'évaluent à l'aune des modalités, des mécanismes
et des standards de sa mise en oeuvre. C'est pourquoi, eu égard aux
violations constatées et ponctuées par les
phénomènes de violence, abus et exploitation à
l'égard des enfants, il apparait justifié de déterminer
quelques modalités, sinon propositions pouvant contribuer à mieux
protéger les enfants et leurs droits.
Il est évident que la résorption des
problèmes liés aux droits et à la protection de l'enfant,
relève de la conjonction de diverses considérations d'ordre
juridique, sociologique, politique, économique, anthropologique et
autres. Cela ressort de la nature multidimensionnelle même des droits de
l'enfant, en tant que droit de l'homme. Une meilleure protection de l'enfant
devant aboutir à une effectivité optimale des droits à lui
reconnus, sera le résultat d'un ensemble de politiques sociales
efficaces. En effet, la prise en compte des facteurs structurels et subjacents
qui contribuent au phénomène de la violence à
l'égard des enfants et de violations de leurs droits commande que des
solutions spécifiques à chaque forme de résistance
puissent être suggérées. Une telle entreprise apparaitrait
comme une véritable gageure. Des politiques éducatives, de
santé publique, de sécurité et de justice, de lutte contre
la pauvreté sont autant d'éléments qui contribueront de
manière indirecte mais fondamentale à l'atteinte d'une
effectivité optimale. Non sans les négliger, nous proposerons des
solutions de nature transversale qui nous semblent être à
même de contribuer à réduire significativement le
déficit d'effectivité des droits de l'enfant. Ces propositions
viseront à donner un véritable coup d'accélérateur
aux engagements pris lors de la ratification des Conventions internationales
pertinentes relatives aux droits de l'enfant ; mieux elles devraient pouvoir
contribuer à assurer la réalisation pleine, sinon, optimale des
droits de l'enfant et permettre que celui-ci soit protégé contre
toute forme de violences, abus et exploitation. Il apparait donc
impérieux de renforcer le système national de mise en oeuvre
571
des droits de l'enfant, entendu comme l'ensemble des
dispositifs juridiques règlementaires et administratifs de
prévention et de réponse à la violence et aux violations
de droits affectant les enfants. Pour ce faire, nous reprenons les propositions
formulées par l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfant en
Côte d'Ivoire et qui sont contenus dans un document1616. En
effet, la pertinence des mesures proposées par ces acteurs à
l'issue de nombreuses consultations menées durant la période
d'octobre 2010 à mai 2012, a permis d'imprimer à ces propositions
une meilleure qualité grâce à la contribution de nombreux
experts, des communautés, des Ongs, des représentants des
institutions étatiques , des institutions spécialisées de
l'Onu... Mieux, par cela seul que ce processus consultatif a permis
d'approfondir la pratique de la participation démocratique et de
progresser dans la modernisation de la gestion des affaires publiques au
service de la protection de l'enfant, les propositions en résultant
méritent notre pleine adhésion. Aussi, convaincu de l'importance
de ces mesures et de leur capacité à contribuer à une
meilleure effectivité des droits de l'enfant, nous pensons que les
pouvoirs publics gagneraient à se l'approprier et les implémenter
pour un mieux-être des enfants en Côte d'Ivoire.
Pour y arriver, trois actions importantes méritent
d'être mis en oeuvre : une réforme profonde de la stratégie
de prise en charge des enfants (Section 1), une plus grande
priorité à donner aux actions de prévention des atteintes
aux droits de l'enfant (Section 2) et un renforcement
bénéfique des mesures d'assistance aux enfants victimes
(Section 3).
1616 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, Politique nationale de
protection de l'enfant, version préliminaire, 17 octobre 2012,
inédit, 56p.
572
SECTION I. UNE REFORME PROFONDE DE LA STRATEGIE DE
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Cela passe d'une part, par une adaptation du cadre juridique
et fonctionnel (Paragraphe 1) ; d'autre part, par
l'utilité d'une nouvelle coordination et d'une meilleure mobilisation
des financements (Paragraphe 2).
§ 1. UNE ADAPTATION NECESSAIRE DU CADRE JURIDIQUE
ET FONCTIONNEL
Pour être nécessaire, le renforcement du cadre
juridique (A) devrait être accompagné d'un
fonctionnement institutionnel plus efficace (B).
A. UN CADRE JURIDIQUE PLUS RENFORCE
La Côte d'Ivoire se doit de redynamiser son arsenal
juridique de protection des enfants. Au regard du nombre des conventions
internationales protectrices des droits de l'enfant et des droits de l'homme
auxquelles la Côte d'Ivoire est partie, on peut affirmer que le
problème de la réalisation ne réside pas
véritablement aujourd'hui au niveau du défaut de ratifications.
Toutefois, à côté des instruments à caractère
contraignant, les Nations Unies ont, dans le cadre de la justice pour mineurs
élaboré un ensemble de règles qui, même si elles
n'ont pas de caractère contraignant, forment un tout solide et
cohérent, allant de la prévention de la délinquance des
mineurs, aux règles relatives à l'organisation de la justice
jusqu'aux conditions de l'exécution des sanctions privatives de
liberté. Il s'agit : des règles de Beijing1617, des
règles de Riyad1618 et celles de la Havane1619. La
prise en compte de ces règles par la Côte d'Ivoire pourrait
influencer positivement le traitement des enfants dans le cadre de la justice
pour mineurs.
1617 VAN BUEREN (G.) et TOOTELL (A-M), Règles
Minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour
mineurs-Règles de Beijing, in Défense des Enfants International,
normes internationales relatives aux droits de l'enfant, 1995, Tome 4
p.1.
1618 CAPPELAERE (G.), Principes directeurs des Nations
Unies pour la prévention de la délinquance
juvénile-Principes directeurs de Riyad, in Défense des Enfants
International, normes relatives aux droits de l'enfant, Tome 2, p.3.
1619 VAN BUEREN (G.), Règles des Nations Unies pour
la protection des mineurs privés de liberté, in Défense
des Enfants International, normes relatives aux droits de l'enfant, Tome3
, 1995, p.3
573
Bien qu'en soi, ces règles se présentent sous la
forme d'une recommandation n'ayant pas de caractère contraignant, nombre
d'entre elles le sont devenues en vertu de leur intégration dans le
droit des traités. Par ailleurs, elles reprennent plus en détail
les principes fondamentaux sur lesquels repose la Convention sur les droits de
l'enfant de 1989. Pour être des règles servant de cadre
internationalement accepté, leur prise en compte, au nom de
l'intérêt supérieur de l'enfant, par tout État
moderne contribuerait inéluctablement à contrer les effets nocifs
de la privation de liberté en garantissant le respect des droits de
l'enfant.
L'obligation de respecter et l'obligation de garantir,
certains traités de droits de l'homme imposent à l'Etat une
obligation de mise en conformité du droit interne avec les engagements
internationaux1620. Cela implique entre autres, l'adoption,
l'amendement ou l'abrogation de lois nécessaires à cette mise en
oeuvre effective des droits de l'homme dans l'ordre interne. Les environnements
légal et réglementaire doivent faire l'objet d'un
véritable toilettage, du moins, d'une révision approfondie et
progressive. Mieux, comme l'indique Jean Jacques ROUSSEAU, « un peuple
est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures
»1621 afin de mieux s'adapter aux réalités actuelles.
Au regard des atteintes et facteurs explicatifs de l'occurrence de certaines
atteintes aux droits de l'enfant, il importe d'opérer une totale mise en
conformité du cadre légal (1) et du cadre réglementaire
(2) avec les normes et standards internationaux.
1. La mise en conformité du cadre
législatif avec les normes et standards internationaux
L'adaptation du cadre légal national avec les normes et
standards internationaux1622 en matière de droits de l'enfant
apparait comme une priorité au regard des engagements internationaux
pris par l'Etat de Côte d'Ivoire.
1620 HENNEBEL (L.), TIGROUDJA (H.), Traité de droit
international des droits de l'Homme, Editions A. Pedone, 2016, p.663.
1621 Cité par GICQUEL (J.) et GICQUEL (J-E.), Droit
constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Montchrestien,
21e édition, 2007, p.180.
1622 Le standard peut être défini comme « un
type de disposition indéterminée, plutôt utilisé par
le juge, dont le caractère normatif est l'objet de contestations et qui
met en jeu certaines valeurs fondamentales de normalité, de
moralité ou de rationalité » RIALS (S.), Le juge
administratif français et la technique du standard. LGDJ,
574
Au regard de la persistance des atteintes aux droits de
l'enfant, il apparait urgent d'établir une législation nationale
globale. Cette législation devrait pouvoir établir et
préciser le statut de l'enfant dans la société, contenir
des dispositions pour la protection de l'enfant, ainsi que la mise en oeuvre de
tous les droits de l'enfant et intégrer les dispositions sectorielles
qui soutiennent la mise en oeuvre de ces mêmes droits. Cette nouvelle
législation devrait renforcer ou consolider les dispositions pertinentes
actuelles et prévoir des nouveaux mécanismes juridiques de
protection des droits en puisant par exemple dans la législation
française, qui apparait comme une banque de données à
laquelle puisent les Etats africains de tradition française. Les
dispositions afférentes au droit à la protection et aux
modalités de mise en oeuvre de ce droit seront contenues dans cette
législation globale. A cette fin, les mesures suivantes devraient
être prises :
- l'élimination par voie légale de toute forme
de discrimination statutaire et successorale1623 concernant les
enfants nés hors mariage1624, par la suppression du statut
d'enfant adultérin1625 ;
1980, p.3 ; RIALS (S.), « Les standards, notions
critiques du droit », In., PERELMAN (Ch.), R. VANDER ELST
(dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles,
Bruylant, 1984, p.40.
1623 En France, la loi du 3 décembre 2001, relative aux
droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant
diverses dispositions du droit successoral, a abrogé les dispositions
discriminatoires dont faisait l'objet « l'enfant naturel dont le
père ou la mère était, au temps de la conception,
engagé dans les liens du mariage » (l'enfant dit
adultérin) pour consacrer la pleine et entière
égalité successorale entre tous les enfants, légitimes,
naturels, simples ou adultérins et l'ordonnance du 4 juillet 2005,
portant réforme de la filiation, a consacré le principe
d'égalité des filiations (article 310 du code civil), faisant
disparaitre les notions même d'enfant légitime et d'enfant
naturel. Cependant, toute distinction n'a pas disparu car
l'inégalité continue à frapper les enfants incestueux ne
pouvant établir leur filiation maternelle et paternelle. L'article 310-2
du code civil prohibe l'établissement d'une relation incestueuse, en cas
d'inceste absolu et l'enfant dont la filiation est établie à
l'égard de l'un de ses parents, ne peut établir sa filiation
à l'égard de l'autre, « par quelque moyen que ce soit
». Par le biais de l'arrêt du 6 janvier 2004 (
1re Civ., 6 janvier 2004, Bull. 2004, Bull. 2004, I,
n°2, pourvoi n°01-01.600), la Cour de cassation a interdit aux
parents de recourir à l'adoption pour obtenir l'établissement de
ce lien de filiation. En conséquence, cet enfant est privé de
droits dans la succession de l'un de ses parents ; THIERRY (J.), Doit-on
accorder aux enfants adultérins les mêmes droits successoraux
qu'aux enfants ?, D. 2000. Chron. 157.
1624 Voir 1re Civ., 6 janvier 2004, Bull.2004, I,
n°10, pourvoi n°02-13-901 ; 1re Civ., 7 juin 2006,
Bull.2006, I, n°297, pourvoi n° 04-19.176 ; 1re Civ., 14
novembre 2007, Bull.2007, I, n°360, pourvoi n°06-13.806 ; 1re Civ.,
15 mai 2008, I, n°139, pourvoi n° 06-19.331). En France, la Cour de
Cassation a expressément jugé que, sous réserve d'accords
amiables déjà intervenus, les nouveaux droits successoraux des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps
de la conception, engagé dans les liens du mariage, sont applicables aux
successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu
à partage avant cette date. ; sur la question des enfants.
1625 Voir CEDH, 1er Février 2000,
Mazurek, requête n°34406/97 ; J.332, note J. Thierry et
chron. B. Vareille p.626 ; JCP 2000. Ed. G. n°14, p.643, note GOUTTENOIRE
(A.)-CORNUT et SUDRE (F.) ; JCP 2000. Ed.
575
- la détermination légale d'un âge minimum
ou d'un plancher pour le consentement sexuel qui soit en adéquation avec
la notion d'enfant ;
- La fixation légale de l'obligation de
signalement1626 à l'égard de toute personne
soupçonnant et /ou ayant des indices clairs de maltraitance,
négligence, abus et exploitation de l'enfant1627 ;
- la détermination légale de manière
claire des responsabilités institutionnelles en matière de
protection de l'enfant et ou de détention de l'autorité
administrative en matière de protection de l'enfant ;
- Une meilleure régulation de la protection de
remplacement pour les enfants privés de protection parentale ;
- la clarification ou explicitation des mesures de protection
administrative1628 et judiciaire1629 et les contours des
situations de danger ;
- Une meilleure et efficace redéfinition des
procédures de protection dans les cas de violences domestiques1630 ;
- Une reconnaissance légale de la gratuité du
certificat médico-légal1631 pour les enfants victimes
;
N. n° 9, p.396 ; DEFRENOIS, 2000.654, obs. MASSIP (J.) ;
Tirant les conséquences de la condamnation de la France par la Cour EDH,
la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a abrogé toutes les
dispositions discriminatoires touchant les enfants adultérins.
1626 Article 40 code pénal français.
1627 Loi du 5 mars 2007 relative à la protection de
l'enfance entend par « information préoccupante tout
élément d'information, y compris médical, susceptible de
laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de
danger, puisse avoir besoin d'aide. Cette information doit faire l'objet d'une
transmission à la cellule départementale pour évaluation
et suite à donner » ; Voir HANAOUI-ATIF (H.E), Le signalement
des maltraitances à enfants par les médecins
généralistes, Thèse de doctorat, Université
Joseph Fourier Faculté de médecine de Grenoble, 2012, pp1-112.
1628 ROSENCZVEIG (J-P), Le dispositif français de
protection de l'enfance, Editions Jeunesse et droit, Nouvelle
édition, 2005, pp-627-747. ; Voir également, GAUDIN (P.), «
Gérer différemment la protection des familles et des enfants
», Libres propos T.S.A, n°23 juin 1989, pp.15-16.
1629 ROSENCZVEIG (J-P), Le dispositif français de
protection de l'enfance, Editions Jeunesse et droit, Nouvelle
édition, 2005, pp.749-1158.
1630 VASSELIER-NOVELLI (C.) et HEIM (C.), « Les enfants
victimes de violences conjugales », In. Cahiers critiques de
thérapie familiale et de pratiques de réseaux 1/2006
(n°36), pp.185-207 ;
1631 MINISTERE DE LA JUSTICE, DIRECTION DES AFFAIRES
CRIMINELLES ET DES GRACES, Guide relatif à la prise en charge des
mineurs victimes, Septembre 2015.
576
- L'institution de la possibilité pour les associations
de défense des droits humains de se porter partie civile dans les
poursuites des auteurs de violence contre les enfants1632.
Il convient aussi d'opérer une profonde révision
de la loi pénale ivoirienne pour une meilleure protection de l'enfant
contre toute forme de violence. Pour y parvenir, le champ d'application
matérielle et les dispositions de droit pénal devraient
être révisés de la manière suivante :
- le nécessaire renforcement de l'interdiction de toute
forme de violences et d'abus sexuels, de corruption d'enfants et de
sollicitation d'enfants à des fins sexuelles ;
- Une claire définition et criminalisation du viol et
agressions sexuelles ; - L'introduction du crime d'inceste ;
- Un renforcement de l'interdiction de toutes formes
d'exploitation des enfants, y compris par la prostitution1633, la
pornographie, l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme, la
traite et la vente d'enfants, l'adoption illégale, le travail ou les
services forcés, l'esclavage moderne et les pratiques analogues,
à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;
- Une ferme interdiction de toutes les formes d'exploitation
d'enfants résultant du recours aux nouvelles technologies1634 ;
- Une claire interdiction de toutes les pratiques
traditionnelles ou coutumières néfastes telles que le mariage
précoce1635 ou forcé et les mutilations
génitales féminines ;
1632 THOMAS (F.), GERAGHTY et al, « L'accès
à la justice : problèmes, modèles et participation des
non-avocats à la prestation de services juridiques »
in, L'accès à la justice en Afrique et au-delà.
Pour que l'Etat de droit devienne une réalité, PENAL REFORM
INTERNATIONAL, 2007, pp.70-71.
1633 KOUTOUAN (N.C.), Etude sur la prostitution enfantine
et les réseaux de traite dans les communes de Yopougon et
d'Adjamé, Projet LTTE, inédit, 79p.
1634 ECPAT INTERNATIONAL, La violence contre les enfants
dans le cyberspace. Une contribution à l'Etude mondiale des Nations
Unies sur la violence à l'égard des enfants, 2005, pp.70-105
; ROISNE (P-L.), La construction de l'Espace de liberté,
sécurité et justice au sein de l'Union européenne face
à la cybercriminalité : le défi de la lutte contre la
pédopornographie sur l'Internet ; M-JONES (L.), « Regulating
child pornography on the internet-the implications of Article 34 of the United
Nations Convention on the Rights of the child », in International
Journal of Children's Rights, 1998, vol.6, p.70.
1635 Cf Majorité sexuelle « La majorité
sexuelle désigne l'âge à partir duquel un mineur peut avoir
une relation sexuelle consentie avec un majeur n'ayant pas autorité sur
lui, sans que ce dernier ne risque des poursuites pénales »
(article 227-25 du Code pénal français). Un adulte peut donc
avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur sans encourir de sanctions
pénales lorsque ce mineur a atteint l'âge minimum de 15 ans. Le
577
- Une ferme interdiction de l'exposition des enfants à
des contenus violents ou dommageables, quelle que soit leur origine ou le moyen
de diffusion ;
- Une ferme et totale interdiction de toute forme de violences
ayant lieu en institution1636 et aggravation des peines d'abus
d'autorité ;
- L'interdiction de toute forme de violences à
l'école ;
- L'interdiction de tous les châtiments corporels et
autres punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
infligés aux enfants, aussi bien physiquement que psychologiquement ;
- L'interdiction de l'exposition des enfants aux violences au
foyer/au sein de la famille ;
- La fixation des délais de prescription1637
pour les infractions pénales commises à l'égard de
l'enfant suffisamment longs pour permettre les poursuites une fois que l'enfant
a dépassé l'âge de la majorité ;
Ces mesures d'ordre légal adoptées, il importe
de conformer les dispositions réglementaires aux normes internationales
pour une protection juridique complète des enfants victimes.
2. La mise en conformité du cadre
réglementaire national avec les normes et standards
internationaux
Il convient d'élaborer des règlements de
protection sectoriels par l'adoption des normes et standards pour le
fonctionnement des services de protection de l'enfance et ce, en vue du
législateur estime que le mineur a, à cet
âge, un "consentement éclairé". En pratique, il est
déduit de ce texte que l'âge de la majorité sexuelle est
fixé à 15 ans en France.
Toutefois, même si le mineur a 15 ans ou plus, l'adulte
risque des poursuites pénales dès lors qu'il est un ascendant ou
a une autorité de droit ou de fait sur le mineur ou dès lors
qu'il abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions (article
227-27 du Code pénal). Dans cette situation, la peine encourue est de 3
ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Selon le conseil constitutionnel français, l'article
227-25 du code pénal a pour effet de fixer à quinze ans
l'âge de la « majorité sexuelle » définie comme
l'âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir
à des relations sexuelles (avec ou sans pénétration) avec
une personne majeure à condition que cette dernière ne soit pas
en position d'autorité à l'égard du mineur.
Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015.
1636 JEANNE (Y.), Penser la violence des jeunes
placés en institution, Thèse de doctorat, Université
Lumière Lyon 2, 2006, 357p.
1637 ROUVIERE (F.), « La distinction des délais de
prescription, butoir et de forclusion ». Les Petites Affiches,
Edition Lextenso, 2009, p.7-11.
578
renforcement de leurs actions de protection à
l'égard des enfants. Ces règlements devraient dicter et
préciser les normes auxquelles les personnels sont tenus de se conformer
vis-à-vis des enfants dans la routine de la prestation de services.
L'ensemble des professionnels travaillant au contact des enfants devraient
avoir l'obligation de se conformer strictement à ces règlements
et appliquer à la lettre, les consignes concrètes de protection
dictées par les règlements de protection.
Dans le même ordre d'idées, une politique de
recrutement et déploiement des cadres administratifs de la protection de
l'enfant devrait être adoptée : Des critères de
sélection relatifs à la protection de l'enfant contre toute forme
de violences, abus et exploitation devront être intégrés
dans les systèmes de recrutement des personnels1638
travaillant dans les services administratifs de protection de l'enfant et dans
les institutions qui accueillent des enfants en prise en charge avec
hébergement et accueil de jour. Seront également clairement
définies dans une politique de recrutement et d'affectation des
personnels, les connaissances, aptitudes et compétences exigées
des cadres administratifs de la protection de l'enfant.
Le cadre légal et réglementaire renforcé,
le cadre institutionnel devrait à son tour connaître une
véritable refonte pour un mieux-être des enfants.
B. UN FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL PLUS EFFICACE
Cette redynamisation du cadre institutionnel passe par le
renforcement des compétences par les formations initiales et continues
(1), la nécessaire amélioration du système de prestation
de services (2) et une nécessaire mise en place d'un système
d'information, de suivi et évaluation en matière de protection de
l'enfant (3).
1. Le renforcement des compétences par les
formations initiale et continue
Les ressources humaines chargées de la protection de
l'enfant devraient disposer des capacités nécessaires pour
exécuter leurs rôles. Pour ce faire, il apparait nécessaire
de
1638 CONSEIL SECTORIEL DES RESSOURCES HUMAINES DES SERVICES DE
GARDE A L'ENFANCE, Normes professionnelles des gestionnaires de services de
garde à l'enfance, 2013, Ottawa, p.16.
579
renforcer les capacités et
compétences1639des ressources humaines chargées de la
protection de l'enfant.
De par leur formation, tous les personnels de l'administration
publique1640 ou du secteur privé qui exercent au service ou
en contact avec des enfants dans les domaines de la sécurité, de
la santé, de l'éducation, de l'action sociale, des sports et
loisirs, du travail et dans tout autre service public doivent être en
mesure d'assumer les responsabilités générales par rapport
au bien-être et à la sécurité des enfants qui
dérivent de leur fonction publique1641.
Ainsi, la formation initiale et continue des professionnels
des services orientés vers les enfants devrait être axée
autour de :
- La nécessité d'un traitement des enfants avec
respect et dignité1642 en toutes circonstances et
l'instauration progressive d'une culture de conduites et pratiques
dénuées de toute forme de maltraitance et abus ;
- L'instauration d'actions préventives de lutte contre
la violence touchant les enfants. Deux axes majeurs pourraient être
considérés : d'une part, donner des conseils aux parents et aux
responsables sur le bien-être général de l'enfant et sur
les potentiels risques à éviter. Pour des situations
délicates, les acteurs de la protection de l'enfant devraient être
assez outillés afin de fournir des informations et orientations aux
parents et responsables sur les services disponibles pour un conseil
adapté et/ou une éventuelle prise en charge ; d'autre part,
l'information et la sensibilisation des enfants relativement à des
questions de protection.
- La détection : Ici, la formation des acteurs de la
protection devrait accorder une importance particulière sur
l'état de bien-être général des enfants et la
capacité de détecter
1639 CONSEIL SECTORIEL DES RESSOURCES HUMAINES DES SERVICES DE
GARDE A L'ENFANCE, Normes professionnelles des gestionnaires de services de
garde à l'enfance, 2013, Ottawa, p.38. ; UNESCO- SECTEUR DE
L'EDUCATION, Principes du renforcement des capacités en
planification des politiques éducatives et en gestion des
ressources, Paris, 2013, p-33-68.
1640 GARAS (F.), La sélection des cadres
administratifs, contribution à l'étude de la réforme de
l'Etat, Thèse de doctorat, Université de Poitiers, 1936,
p.5.
1641 N'DAH (P-A.), Modernisation de l'Etat africain,
Abidjan, Les éditions du CERAP, 2003, p.60.
1642 NEIRINCK (C.), « La dignité humaine ou le
mauvais usage juridique d'une notion philosophique. » In. P. PEDROT
(dir.) Ethique, Droit et dignité de la personne, Mélanges en
l'honneur de Christian BOLZE, Economica, Paris, 1999, pp.39-50. ;
HENNETTE-VAUCHEZ (S.), GIRARD (C.), JEANNIN (L.), LOISELLE (M.), ROMAN (D.),
La dignité de la personne humaine : recherche sur un processus de
juridicisation , PUF, 2005, 318p.
580
les cas des enfants victimes1643 ou courant le
risque d'être victimes de violation de leur intégrité
physique et émotionnelle ;
- L'obligation et la procédure de signalement à
leur responsable, à l'autorité1644 administrative1645,
à la police, ou au procureur, ou au tribunal, des cas d'enfant en
situation de risque sérieux ou de violence avérée.
Cette mise à niveau devrait être progressivement
réalisée par le biais de programmes de formation continue et de
formation initiale. Ces formations devraient être dispensées aux
travailleurs sociaux, policiers, magistrats, enseignants, directeurs
d'école, éducateurs, personnes travaillant dans des institutions
pour enfants, travailleurs humanitaires, responsables d'activités de
jeunesse et sports.
De même, un programme de formation continue devrait
être élaboré à l'intention des responsables et des
travailleurs sociaux chargés de l'autorité administrative en
matière de protection de l'enfant. Ce programme portera sur le
développement de connaissances approfondies sur les droits de l'enfant,
sur le cadre juridique et réglementaire, sur l'acquisition des
compétences et aptitudes nécessaires à l'exécution
des interventions de prévention, de détection et de prise en
charge, sur les capacités d'impulser une dynamique nouvelle à la
collaboration intersectorielle en matière de prévention et prise
en charge, y compris la protection de remplacement, en particulier avec le
secteur de la justice. Le programme inclura la gestion des difficultés
personnelles, éthiques et juridiques de l'intervenant. Ce programme fera
l'objet d'intégration progressive dans les programmes de formation
initiale de ces professionnels1646.
De plus, un programme de formation continue conjointe des
intervenants dans la protection de l'enfant au niveau local s'avère
aussi important.
1643 BROWN (W.K), « Les évolutions positives de
l'enfant vulnérable : présentation d'un cas de comportement
délinquant », in L'enfant vulnérable/sous la dir.
de E.J. ANTHONY et al. Paris : PUF, 1982, p.439-450. ; OIF-DIRECTION DE LA
PAIX, DE LA DEMOCRATIE ET DES DROITS DE L'HOMME, Guide pratique, Entendre
et accompagner l'enfant victime de violences, STIPA, Paris, 2015, 98p.
1644 KERNEIS (S.), Dictionnaire de la culture
juridique, ALLAND (D.)& RIALS (S.) dir., PUF, 2003, p.111 et s.
1645 FORTAT (N.), Autorité et responsabilité
administrative, thèse de doctorat-Université
François-Rabellais, 2011, 497p.
1646 Ibid.
581
Un programme de formation continue devrait être
élaboré et mis en place. Il sera basé sur
l'expérience directe qui favorise la formation interdisciplinaire et
associe des domaines de l'action sociale1647, de la justice, de la
santé, de la sécurité et de l'éducation et concourt
à la définition d'un modèle d'intervention et au
renforcement du réseau local. Chaque acteur doit être en mesure de
comprendre et maitriser son propre rôle et les rôles des autres
intervenants et des formes de coopération nécessaires dans la
poursuite du but commun, la protection de l'enfant et de son
intérêt supérieur.
Mises en application, ces propositions permettraient de doter
la Côte d'Ivoire d'un nouveau type d'acteurs de protection de l'enfant
qui serait véritablement qualifiés et disposeraient d'une
importante culture en matière de protection de l'enfance. Il faudrait
accompagner cette importante culture acquise à l'issue de ces
formations, d'une nécessaire amélioration du système de
prestation de services afin d'aboutir à une protection efficace des
enfants.
2. La nécessaire amélioration du
système de prestation de services
Il s'agira ici de mieux organiser et renforcer le
système de prestation de services1648. Cela devrait permettre
aux structures de prestation de services de disposer d'orientations et de
moyens efficients et efficaces pour une prestation de services de
qualité.
On le sait : en cas de violences commises à
l'égard d'un enfant, l'une des obligations à la charge de l'Etat
est l'obligation de facere1649ou encore obligation de
faire. Pour y arriver, il devrait disposer de services dotés de
l'autorité administrative de la protection de l'enfant.
1647 LAFORE (R.) et BORGETTO (M.), Droit de l'aide et de
l'action sociale, Montchrestien, 5ème édition,
2004, p.54 ; BUISSON (C.), Justice et solidarité : pour une
refondation philosophique de l'action sociale, thèse de doctorat de
philosophie, 2009, p385 ; BARREYRE (J-Y), BOUQUET (B.), CHANTREAU (A.), LASSUS
(P.) Sous la dir. de), Dictionnaire critique de l'action sociale ,
Paris, Bayard éditions,1995, p.26 ; HARDY (J-P), Guide de l'action
sociale contre les exclusions, Paris, Dunod, 1999, p.9 ; ces
différents ouvrages présentent l'action sociale comme
étant un terme indéterminée et paradoxale : « Il
n'y a pas de définition juridique et administrative de l'action sociale.
Alors que l'aide sociale est constituée par un ensemble de «
prestations », l'action sociale est un ensemble d'actions et de services
visant au développement social et à la mise en oeuvre de
solidarités ».
1648 DELPAL (B.) et LE COZ (G.), Contribution à la
cartographie de l'action sociale, Rapport n° RM2006-125P Novembre
2006, pp.4-12
1649 PIGNARRE (G.), A la découverte de l'obligation
de praestare-Pour une relecture de quelques articles du code civil, RTD
Civ. 2001, p.41. ; ROLAND (H.), Lexique juridique des expressions
latines, 6e édition, LexisNexis, 2014, p.111
582
Au niveau opérationnel, l'autorité
administrative de protection de l'enfant sera confiée aux structures
d'action sociale existantes. Ces structures disposeront d'un mandat clair, de
procédures de prise en charge et de personnels formés pour les
mettre en oeuvre. L'autorité administrative de la protection de l'enfant
incombera à la commune dans les localités où les
structures d'action sociales déconcentrées ne sont pas
représentées.
Les centres de protection spécialisée, les
services de protection spécialisée au sein du centre social et la
commune devront assurer la prestation des services de la protection
spécialisée.
S'agissant des centres de protection
spécialisée, ils se substitueront aux centres d'éducation
actuellement existants. Ces nouveaux centres spécialisés auront
la mission d'organiser les services et actions de détection et d'assurer
la gestion des cas d'abus, violations, violences et exploitation touchant les
enfants, en collaboration avec les autres secteurs impliqués. Les
actions de prévention seront confiées aux services chargés
de l'action sociale de base au sein du centre social.
Quant aux services de protection spécialisée au
sein du centre social1650, ils seront organisés au sein des
centres sociaux isolés pour assurer l'assistance aux enfants victimes
dans les localités où il n'existera pas de centre de protection
spécialisée à l'intérieur du complexe
socio-éducatif. Le service de protection spécialisée sera
chargé de la détection et de l'assistance aux enfants victimes de
violations, les fonctions de prévention demeurant la
responsabilité des services de l'action sociale de base.
Enfin, dans les localités privées d'un centre
social ou d'un complexe socio-éducatif chaque commune désignera
un fonctionnaire de la Mairie ayant la responsabilité de
représenter l'autorité administrative de protection de l'enfant.
A ce titre, ces chargés communaux de la protection
spécialisée seront chargés d'assurer l'assistance aux
enfants victimes de toute forme de violence, en collaboration avec les services
de la justice et les autres intervenants publics ou privés dans la
protection de l'enfant.
Le maillage de la protection spécialisée sur le
territoire devrait être aussi serré que possible. De plus, cette
couverture territoriale devrait être équitable, prendre en compte
des
1650 MILLERAND (P.), Garantir les missions d'un centre
social tout en développant son offre de services, Mémoire de
l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2012, 110p ;
583
critères de densité populationnelle et ne pas
pénaliser les régions les plus éloignées. Des
infrastructures adaptées, des moyens de fonctionnement, de communication
et de déplacement devront enfin être mis à la disposition
des services de protection spécialisée. Par ailleurs, ils devront
être dotés des budgets nécessaires à la mise en
oeuvre des actions qui leur sont confiées. Ces mesures devraient
s'étendre à toutes les autres structures de prestation de
services tels que les brigades de mineurs , le parquet et les tribunaux, les
structures de santé et les services sociaux des hôpitaux, les
structures scolaires et de formation professionnelle, les associations
agréées, les familles d'accueil et les centres d'accueil
privés et publics.
Une autre mesure très souvent négligée en
Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains nécessaire au
bien-être des enfants consiste en la mise en place d'un système
d'information, suivi et évaluation en matière de droits et de
protection de l'enfant.
3. Une nécessaire mise en place d'un
système d'information, suivi et évaluation en matière de
droits et de protection de l'enfant
Ce système viserait à doter la Côte
d'Ivoire de données fiables en matière de protection de l'enfant.
A terme, on aboutirait à un système d'information,
suivi1651 et évaluation1652 totalement opérationnel
qui produira inéluctablement des données très utiles.
1651 Le suivi est l'examen continu, assuré par
l'équipe multisectorielle, des actions de prévention et
d'intervention afin de déterminer si elles se déroulent
conformément au plan et aux exigences budgétaires et si des
ajustements peuvent être nécessaires pour qu'elles atteignent les
objectifs prévus. Un suivi efficace implique un système
d'établissement des rapports coordonné.
1652 L'évaluation est une analyse de la pertinence, de
l'efficacité et de l'efficience des stratégies de
prévention et d'intervention de l'équipe multisectorielle. Elle
s'applique systématiquement à l'impact, en matière de
protection, des politiques, programmes, pratiques, partenariats et
procédures sur les femmes, hommes, garçons et filles
réfugiés. Ses critères peuvent inclure la
durabilité des activités de prévention et d'intervention,
leur coordination et leur cohérence, et l'efficacité des
systèmes de suivi et d'établissement des rapports ; CONSEIL DE
L'EUROPE, « Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants », Série
Construire une Europe pour et avec les enfants, monographie n°5,
Editions Conseil de l'Europe, octobre 2001, p.36 ; Cf. RANGEON (F.), « La
notion d'évaluation », In. L'évaluation dans
l'Administration, Paris, PUF, coll. « Travaux du CURAPP »,
Paris, 1993 ; THOENIG (J-C), L'évaluation source de connaissances
applicables aux réformes de la gestion publique, RFAP,
n°92/1999, p.685 : « dans certains pays, ce n'est pas un hasard si
l'usage de pratiques d'évaluation par de hauts fonctionnaires et
conseillers est en corrélation avec le fait que leur formation
universitaire et professionnelle les a sensibilisés aux acquis des
sciences sociales et du management moderne, en rupture avec une formation
strictement juridique ou administrative » ; Voir aussi VIVERET (P.),
Evaluation et démocratie, Esprit, octobre 1989, p.43. Il
énonce de façon catégorique que : «
L'évaluation des politiques publiques entraîne l'absolue
nécessité de distinguer les formes de l'évaluation de
celles du contrôle ».
584
La nécessité de suivre les progrès
réalisés dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant, de
soutenir la planification des besoins du système de protection de
l'enfant et d'asseoir des stratégies d'intervention sur les
données précises, commande que soit défini prioritairement
un système d'information, de suivi et d'évaluation de la
protection de l'enfant. Ce système d'information sur la protection de
l'enfant devrait être intégré au système sectoriel
de l'action sociale. A cette fin, un cadre réglementaire adapté
sera élaboré et des ressources humaines et matérielles
suffisantes pour la gestion du système y seront affectées.
L'établissement d'un recueil systématique des
données administratives encore inexistant, s'avère aussi
nécessaire pour soutenir la collecte multisectorielle des données
administratives en matière de protection et de respect de la mise en
oeuvre des droits de l'enfant. Cela passe par l'établissement de
plusieurs actions : un cadre méthodologique unifié,
cohérent basé sur des définitions claires et
précises, utilisables par les différents secteurs
impliqués, assorti des outils pour la collecte des données
administratives de chaque secteur ; des circuits et des délais de
remontée des données sectorielles clairement défini ; un
cadre institutionnel et réglementaire précis établissant
le dispositif de centralisation des données ; des méthodes
d'analyse, utilisation et divulgation des données administratives
sectorielles.
En vue de soutenir la recherche scientifique dans ce domaine,
il serait indispensable d'envisager des concepts et des
indicateurs1653 qui soient, entre autres, utilisables par les
chercheurs lors de l'élaboration de ce cadre.
Outre cela, un renforcement des données relatives
à la protection de l'enfant dans les enquêtes d'envergure
nationale s'impose. A cet égard, des efforts devraient être
déployés pour intégrer davantage, des indicateurs relatifs
à toute forme de violence touchant les enfants dans les enquêtes
d'envergure nationale périodiques1654 ; Cela permettrait de mesurer
utilement et efficacement l'impact direct et indirect des actions sur les
enfants et la société dans son ensemble.
1653 OCDE, « Mesurer les droits de l'homme et la
gouvernance démocratique, Expériences et enseignements de
Métagora », In. Revue de l'OCDE sur le
développement, 2009/2 (n°10) volume 10-2, p.400 ; EITAN (F.),
« Mesurer les droits économiques et sociaux pour en demander compte
aux gouvernements », In. Revue de l'OCDE sur le développement
2009/2 (n°10), p.207-228.
1654 Enquête démographique et de santé
(EDS), autres enquêtes auprès des ménages, Multiple
Indicator Cluster Survey ou enquête à indicateurs multiples
(MICS).
585
Dans la même veine, une intégration des
données relatives à la protection de l'enfant dans les
systèmes d'information sectoriels apparait importante. En fait, pour
permettre de suivre l'impact des actions entreprises et les réorienter
au besoin, les systèmes de suivi et évaluation des secteurs de la
santé et de l'éducation devraient intégrer des indicateurs
relatifs à la protection de l'enfant.
Outre la nécessaire adaptation du cadre juridique et
fonctionnel de la protection de l'enfance, le renforcement des
stratégies organisationnelles pour une effectivité des droits de
l'enfant passera aussi par l'utilité d'une nouvelle et d'une meilleure
mobilisation des financements.
§ 2. L'UTILITE D'UNE NOUVELLE COORDINATION ET
D'UNE MEILLEURE MOBILISATION DES FINANCEMENTS
L'établissement d'un nouveau système efficace de
coordination des actions (A), la mise en place de partenariats efficaces (B) et
une meilleure mobilisation des financements (B) apparaissent comme trois fortes
mesures nécessaires à la réalisation des droits de
l'enfant. Ces trois aspects sont particulièrement importants et peuvent
contribuer à donner une dimension plus effective à l'exercice des
compétences de protection.
A. L'ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME EFFICACE DE
COORDINATION DES ACTIONS
Pour être efficace, l'établissement d'un
système de coordination des actions s'avère nécessaire.
Ici, l'objectif vise à assurer la coordination des actions afin que ce
système de coordination soit effectivement opérationnel.
En un mot, les mesures suggérées se
résumeraient en une suite d'actions transversales basées sur la
collaboration entre plusieurs acteurs et secteurs. Par cela seul, elle
défie les cloisonnements entre administrations centrales et
locales1655, entre institutions, entre acteurs de terrain
travaillant dans l'isolement sans grande concertation. Il est indispensable que
tous les acteurs agissent ensemble sur des communautés qui leur sont
communes, en mettant en commun idées et moyens, par le biais de
procédures simples de concertation et de
1655 RUIVO FERNANDO, FRANCISCO DANIEL, « Entre centres et
périphéries. Pour une esquisse des pouvoirs locaux au Portugal
», Pôle Sud 1/2005 (n°22), p.115-125.
586
coopération. Pour cela, il est indispensable de
créer d'une part, une dynamique interministérielle par le biais
de relations continues entre le ministère chef de file et les autres
ministères et d'autre part, des partenariats avec les
collectivités territoriales1656 et avec le secteur
associatif1657. La coordination est un processus visant à
l'élaboration d'une nouvelle cohérence de l'action. La poursuite
de cet objectif fondamental orientera tous les efforts dans ce sens.
Primo, au niveau national, il faut une coordination
multisectorielle : Le comité national de coordination et suivi de la
mise en oeuvre du programme national de protection de l'enfant devrait
être rapidement mis en place sur la base de la révision du cadre
juridique de la coordination nationale de la protection de l'enfance
(CNPE)1658. Ce comité assurera le leadership gouvernemental
et la mobilisation des parties prenantes dans la mise en oeuvre des
orientations contenues dans tout programme national d'actions en faveur de
l'enfant et ses droits. Un projet de décret fixant la
composition1659 et les attributions du comité national de
protection de l'enfant devrait être prévu et adopté.
Ce comité se réunirait fréquemment et
pourrait être présidé par le ministère en charge de
la protection de l'enfance. Cette structure aura pour mission d'harmoniser les
approches relatives à la protection de l'enfant, mettre en
cohérence les initiatives des différents intervenants, favoriser
l'élaboration de calendriers en phase les uns avec les autres,
1656 RAPHAEL DECHAUX, Alexandra LETURCQ et Alexis Le QUINIO,
Compte rendu des discussions et débats à propos d'une table ronde
portant sur « L'autonomie régionale et locale et constitutions
», In. Annuaire international de justice Constitutionnelle,
XXII-2006, pp.459-468. « (...) l'idée de collectivité
locale ne me paraît pas en effet un critère suffisamment
discriminant. Mieux vaut adopter une dénomination
générique susceptible de s'appliquer à différents
niveaux » p.462.
1657 TCHERNONOG (V.), VERCAMER (J.P.), Les associations
entre mutations et crise économique. Etat des difficultés,
Octobre 2012, Deloitte Conseil, 30p. ; STASI (B.), Vie associative et
démocratie nouvelle, PUF, Paris, 1980, 157p.
1658 La CNPE est une plateforme d'échanges et de
concertation qui a pour objet de renforcer la protection des enfants en
Côte d'Ivoire en initiant un ensemble de mesures ou d'actions, sociales
ou juridiques, de nature à garantir à l'enfant, le respect de ses
droits, de sa dignité humaine et à lui assurer son complet
épanouissement. 1659 Sa composition pourrait être prévu
comme suit : ministre, cabinet, direction de la protection de l'enfance (DPE),
direction de la protection sociale (DPS), direction de la lutte contre le
travail des enfants (DLTE), sous-direction de la lutte contre le trafic
d'enfant et la délinquance juvénile (S/DLTEDJ) du
ministère de l'intérieur, la direction de la protection
judiciaire de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ) du Ministère de la
justice ;la direction des écoles, collèges et lycées
(DELC) du ministère de l'éducation nationale (MEN) ; la direction
générale de la santé (DGS) du ministère de la
santé, les représentants des coalitions/réseaux des
structures associatives qui oeuvrent dans le domaine de l'enfance en
difficultés, les représentants des structures professionnelles
(ordre des médecins, ordre des avocats, associations de journalistes,
etc.) ; les représentants de structures de pouvoir local et les
représentants des structures des autorités traditionnelles .
587
mutualiser les bonnes pratiques1660, réduire
les cloisonnements entre sous-secteurs, éviter les duplications
d'actions et promouvoir le bilan participatif des activités
réalisées et des résultats obtenus par les
différents secteurs.
Un secrétariat exécutif permanent sera
spécialement créé et chargé exclusivement du suivi
des décisions prises par le comité national en matière de
coordination. A cet égard, le secrétariat exécutif
permanent de la protection de l'enfant veillera à établir des
relations étroites entre les structures de coordination existantes : le
Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants(
CIM), le comité national de surveillance des actions de lutte contre la
traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants (CNS) et le
comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux
enfants (CNLVFFE).
Il sera nécessaire d'élaborer des
procédures claires de coordination entre les acteurs publics du niveau
national avec le niveau régional et du niveau régional avec les
niveaux départemental et communal. Des démembrements
régionaux, départementaux et communaux du comité national
de protection de l'enfance devraient voir le jour. Au niveau organisationnel,
ces démembrements devraient avoir la même ossature que le
comité national tant au niveau de la composition que de ses attributions
compte tenu des acteurs présents à ces différents
niveaux.
Secundo, les autres niveaux de coordination devront aussi
être renforcés : Le ministère en charge de la coordination
de la mise en oeuvre du plan national de protection et des droits de l'enfant
veillera à mettre en place des structures légères de
coordination avec tous les intervenants dans la protection de l'enfant,
notamment avec : chaque ministère sectoriel ayant un rôle dans la
protection de l'enfant 1661 ; les collectivités territoriales1662 ;
les
1660 UNESCO, Secteur de l'Education, « Education pour le
développement durable-Bonnes pratiques dans l'éducation de la
petite enfance », Bonnes pratiques n°4-2012, 60p. ;
Voir aussi BICE, Guide des bonnes pratiques pour la protection des mineurs
en conflit avec la loi au Togo, 80p.
1661 Il s'agit des : Ministère en charge des affaires
sociales, ministère en charge de la justice, ministère en charge
de l'intérieur, ministère en charge de la santé,
ministère en charge de l'éducation nationale, ministère en
charge de la communication.
1662 V. notamment DOUENCE (J-C.), « Réflexions sur
la vocation générale des collectivités locales à
agir dans l'intérêt local », In. Quel avenir pour
l'autonomie des collectivités locales ?, Les 2èmes entretiens de
la Caisse des dépôts, éd. de l'Aube, Paris, 1999,
p.746-752 ; V. aussi, CAILLOSSE (J.), « Repenser les
responsabilités locales », In. Les cahiers de l'Institut de la
Décentralisation, n°8/2006. ; VERPEAUX (M.), « Le rapport
Balladur sur la réforme des collectivités locales, des raisons et
des solutions » In., R.F.D.A., 2009, p.407-418.
588
associations agréées de prestations de services
et celles qui mettent en place des actions de prévention ; les
partenaires techniques et financiers1663 (PTF) qui appuient la mise
en oeuvre des politiques de protection de l'enfant ; les pays
frontaliers1664 en particulier en ce qui concerne la traite
transfrontalière des enfants.
Plus spécifiquement, un mécanisme de
coordination interne aux différents ministères ayant un
rôle dans la protection de l'enfant devrait être mis en place. Cela
revient à dire que chaque ministère ayant un rôle dans la
protection de l'enfant veillera à mettre en place une structure
légère (groupe de travail) pour coordonner les actions de
protection de l'enfant entre les différentes directions et services
impliqués dans la protection de l'enfant, y compris avec les partenaires
techniques financiers (PTF) sectoriels.
Tertio, les actions de protection de l'enfant au niveau
régional doivent être bien coordonnées. Cela permettra de
faciliter la collaboration entre les secteurs, d'échanger les
informations entre les secteurs et de faire le bilan des activités des
différents secteurs. La présidence de la coordination
régionale pourrait être confiée au préfet de
région1665 ; celui-ci aura les responsabilités suivantes :
convoquer et diriger les réunions, rendre compte aux ministres
chargés de la protection de l'enfant, représenter la coordination
au niveau national, assurer que les interventions des différents
secteurs contribuent au renforcement du système de protection de
l'enfant.
Ce groupe de travail au niveau régional serait
composé de personnes ayant un rôle important dans le domaine des
droits et de la protection des enfants. Ainsi, sa composition pourrait
être la suivante: un président (préfet de région),
un vice-président (sous-préfet1666 ), un
secrétaire exécutif (directeur en charge de la protection de
l'enfant), un Directeur régional en charge des affaires sociales, juges
des tutelles, préfets de police, directeurs régionaux en charge
de l'éducation nationale (y compris enseignement technique et formation
professionnelle ),
1663 Nous pensons particulièrement à l'Union
Européenne, à l'Unicef et au PNUD, l'ambassade des USA... 1664 Le
disant, nous pensons particulièrement au Burkina Faso, le Mali le Ghana,
la Guinée et le Libéria. 1665 Voir Article 4 loi n° 2002643
du 25 /01 /2002 portant statut du corps préfectoral en Côte
d'Ivoire ; Pour une meilleure connaissance des attributions du préfet de
région et du préfet de département, voir Articles 6
à 22 de la loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant orientation
de l'organisation générale de l'administration territoriale.
1666 Article 6 Loi n° 2002643 DU 25 :01 :2002 portant
statut du corps préfectoral en Côte d'Ivoire ; Pour une meilleure
connaissance des attributions du sous-préfet, voir aussi 25 à 30
de la la loi n°2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de
l'organisation générale de l'administration territoriale.
589
directeur régional de la santé, le commandant de
légion, autorités traditionnelles et représentants des
ONG.
Une fois installé, ce groupe de travail devrait se
doter rapidement d'un cahier de charges. Le cahier de charges de ce groupe de
travail régional pourrait consister entre autres à : la
planification des activités, le partage des données sectorielles,
l'appréciation des rapports d'activités, la réorientation
des activités si nécessaire, le suivi de la mise en oeuvre et
l'évaluation.
S'agissant de son mode de fonctionnement, le groupe de travail
pourrait se réunir suivant les niveaux : réunion semestrielle au
niveau de district, réunion semestrielle au niveau régional et
réunion bimestrielle au niveau départemental.
Une fois établi, ce système efficace de
coordination des actions devrait être soutenu par l'instauration de
partenariats marqués au coin de l'efficacité.
B. LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS EFFICACES
Pourquoi s'arrêter sur la notion de partenariat alors
qu'elle est l'une des manifestations emblématiques de la
contractualisation de l'action publique ? C'est qu'elle est une forme bien
particulière de l' « agir contractuel1667 » dans
laquelle se loge la gouvernance1668 : les
1667 GAUDIN (J-P), « L'action publique contractuelle :
beaucoup de bruit pour rien ? », In. Droit et
société, 47/2001, p.285-293.
1668 Pour une meilleure compréhension du terme
gouvernance, voir KAMTO (M.), Droit international de la gouvernance,
ed. A. Pedone, pp.15-35. ; BARON (C.) « La gouvernance : débats
autour d'un concept polysémique » en Droit et
Société, Revue internationale de théorie du droit et
de sociologie juridique (RITDSJ), n, 2003, pp.320-352 ; « La bonne
gouvernance et les droits de l'homme sont complémentaires. Les principes
relatifs aux droits de l'homme posent un ensemble de valeurs qui visent
à 2 3 guider l'action des gouvernements et des autres intervenants sur
la scène politiques et sociale. Ils posent également un ensemble
de normes au regard desquelles la responsabilité de ces intervenants
peut être mise en cause. Ces principes inspirent en outre la nature des
efforts faits en matière de bonne gouvernance : ils peuvent être
à la base de l'élaboration de cadres législatifs, de
politiques, de programmes, de dotations budgétaires et d'autres mesures.
Cependant, en l'absence de bonne gouvernance, les droits de l'homme ne peuvent
être respectés et protégés durablement. La mise en
oeuvre des droits de l'homme exige un cadre incitatif et favorable, entre
autres des cadres juridiques et des institutions appropriés, ainsi que
les processus politiques et administratifs nécessaires pour satisfaire
aux droits et aux besoins de la population. Lorsqu'elles sont inspirées
par les valeurs des droits de l'homme, les réformes qui se rapportent
à la bonne gouvernance des institutions démocratiques mettent
à la portée du public les moyens de participer à
l'élaboration des politiques, que ce soit par le biais d'institutions
formelles ou de consultations informelles. Elles créent également
des mécanismes qui permettent d'intégrer des groupes sociaux
multiples aux processus décisionnels, en particulier au niveau local.
Enfin, elles peuvent encourager la société civile et les
communautés locales à formuler et à faire connaître
leur position sur des
590
interactions public/privé qui en sont l'une des
expressions privilégiées trouvent là un cadre juridique
favorable à leur institutionnalisation. Certes, on admettra sans mal
avec P. SADRAN que ce n'est pas le partenariat qui fait la bonne
gouvernance1669, mais tel n'est pas le problème qui nous
retient : il nous suffit de constater que l'usage, en cours de banalisation du
partenariat fait partie de ces pratiques qui marquent le passage du
gouvernement à la gouvernance1670. La mise en place de
partenariats efficaces aura pour objectif d'assurer le concours des partenaires
associatifs et partenaires techniques financiers à la mise en oeuvre
effective du plan d'actions. Le travail en partenariat s'est
développé à partir des lois de décentralisation,
étant donné la complexité des situations
rencontrées par les travailleurs sociaux, mais également des
dispositifs d'action sociale qui recourent à de nombreux acteurs. C'est
aujourd'hui un principe d'action nécessaire qui favorise la mise en
oeuvre des politiques publiques. Il se définit de manière
officielle comme la « coopération entre des personnes ou des
institutions généralement différentes (financement,
personnel...) permettant de réaliser un projet commun
»1671.
La mise en place de partenariats efficaces et de
réseaux1672 s'avère indispensable, compte tenu du fait
que l'action publique dans le domaine de l'enfance est constituée de
trois acteurs : l'Etat et ses institutions, la société
civile1673 et ses formes organisationnelles et les partenaires
techniques financiers.
sujets qu'elles jugent importants. Dans le domaine des
services de l'État au public, les réformes qui se rapportent
à la bonne gouvernance représentent une avancée pour les
droits de l'homme quand elles rendent l'État plus à même
d'assumer la responsabilité qui lui incombe de fournir des biens
collectifs essentiels à la protection d'un certain nombre de droits de
l'homme, tels que le droit à l'éducation, à la
santé et à l'alimentation. Au nombre des initiatives prises en
matière de réforme peuvent figurer des dispositifs
régissant l'obligation de rendre des comptes et la transparence, des
moyens politiques respectueux des cultures, afin de faire en sorte que les
services soient accessibles à tous et acceptables par tous, ainsi que
des moyens d'amener
le public à participer aux prises de décisions
», disponible
sur :
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance_fr.pdf
(consulté le 08/10/2017). 1669 SADRAN (P.), « Le partenariat
public-privé en France, catégorie polymorphe et inavouée
de l'action publique », RISA, vol.70, juin 2004, p.253-270.
1670 Lire GAUDIN (J-P), Pourquoi la gouvernance ?,
Presses de Sciences Po., coll. La bibliothèque du citoyen, 2002 ;
STOCKER (G.), « Cinq propositions pour une théorie de la
gouvernance », Revue internationale des sciences sociales
n°155, mars 1998, p.19.
1671 LYET (P.), L'institution incertaine du partenariat,
L'Harmattan, logiques sociales, 2012, p.19.
1672 DUMOULIN (P.), DUMONT (R.), BROSS (N.) MASCLET (G.),
Travailler en réseau, méthodes et pratiques en intervention
sociale, Dunod, Paris, 2006, p.30.
1673 KMF-CNOE et FES, Qu'est-ce que la
société civile ? , Antananarivo, Octobre 2009, , pp.1-22 ;
THIRIOT (C.), « Rôle de la société civile dans la
transition et la consolidation démocratique en Afrique :
éléments de réflexion à partir du cas du Mali
», Revue internationale de politique comparée 2/2002
(Vol.9), p.277-295 ;
591
Outre des partenariats de principe établis au niveau
national1674, les administrations de terrain responsables de
l'exécution des programmes nationaux de protection de l'enfance se
doivent d'établir localement des partenariats avec les corps
intermédiaires (associations, médias, syndicats, associations
professionnelles) et avec les intervenants extérieurs (Ongs, partenaires
techniques et financiers) sur la base d'une distribution concertée des
tâches.
Le partenariat avec les associations1675 ayant des
compétences en matière de prestation de services de la protection
spécialisée fera l'objet d'une politique de
contractualisation1676 avec les associations.
Par ailleurs, il faut compter avec les effets pervers du
morcellement juridique des territoires administratifs dans un contexte de
décentralisation1677. Du fait de leur propre montée en
puissance, les collectivités et autres institutions locales sont
vouées à s'organiser entre elles pour rendre plus performante
l'offre de services publics. Il en résulte une situation favorable
à la constitution contractuelle de réseaux1678.
L'établissement d'un système efficace de
coordination des actions soutenu par l'instauration de partenariats serait vain
si tous ces efforts ne sont pas suivis ou précédés d'un
budget conséquent alloué au financement des actions de
réalisation des droits et du bien-être de l'enfant ; ceci commande
donc un renforcement quantitatif du montant alloué à la cause de
l'enfant et ses droits.
1674 Nous entendons par là, par exemple, la conclusion
de conventions entre l'Etat et les organisations onusiennes en vue du
déploiement des activités de celles-ci sur le territoire
national.
1675 FIALAIRE (J.), « La délégation du
service public local aux associations », Les petites affiches, 22
Aout 1997, n°101-3, pp.3-9.
1676 RICHER (L.), « La contractualisation comme technique
de gestion des affaires publiques », AJDA 19 mai 2003,
pp.973-975. ; MATHIOT(P.), La politique de prévention de la
délinquance de la ville : un exemple de contractualisation d'une
politique publique, mémoire de maîtrise, 2001, pp74.
1677 BLEOU (M.), « Parti unique et
décentralisation. L'exemple ivoirien », in La
décentralisation. Etudes comparées des législations
ivoiriennes et françaises. Actes du Colloque international
organisé par la Faculté de droit de l'Université nationale
de Côte d'Ivoire et l'Université des Sciences sociales de Toulouse
I , Abidjan 9-12 mai 1988, pp.81-92.
1678 Dans une littérature spécialement
abondante, v. La contribution d'O. GOHIN, « Loi et contrat dans les
rapports entre collectivités publiques », Les Cahiers du
Conseil constitutionnel, 17/2004, Dalloz, p.95-102.
592
C. L'AUGMENTATION DES FINANCEMENTS
NECESSAIRES
L'augmentation des financements imposerait qu'il y ait une
véritable politique permettant la mobilisation et la
disponibilité de financements nécessaires à la mise en
oeuvre d'un programme d'actions utiles pour une effectivité optimale des
droits de l'enfant. Le secteur de la protection doit disposer de financement
public alloué de manière conséquente au regard des
objectifs fixés par ce plan ou programme d'actions en faveur des droits
de l'enfant. La charge financière de la protection de l'enfance incombe
essentiellement à l'Etat1679. L'Etat est chargé
d'assurer les budgets de fonctionnement des services de protection
administrative qui sont des services déconcentrés du
Ministère en charge de l'action sociale et des services relevant du
système judiciaire.
Pour y arriver, quelques actions données comme
importantes doivent être menées : A l'initiative de l'Etat, des
partenariats financiers devraient être mises en place entre l'Etat et les
collectivités territoriales (les Mairies) des localités ne
disposant pas des services de la protection spécialisée
(complexes socio-éducatifs ou Centre social) pour le soutien aux
chargés communaux de la protection spécialisée. Des
rubriques spécialement affectées aux interventions et actions, y
compris de formation, relatives à la protection de l'enfant devraient
être prévues dans les lignes budgétaires des autres
ministères en charge de la protection de l'enfance et ses droits.
Aussi, un cadre de concertation sera établi au niveau
national pour obtenir l'adhésion et le soutien financier des partenaires
techniques et financiers aux orientations de tout programme contenu dans le
plan d'actions pour la mise en oeuvre effective des droits de l'enfant et de
leur protection.
Par ailleurs, d'autres sources de financement seront à
rechercher pour assurer ou renforcer les moyens nécessaires à la
mise en oeuvre du programme national de mise en oeuvre des droits et de
protection de l'enfant. Plus spécialement, des stratégies de
partenariats financiers avec le secteur privé national et international
devront être explorées. A titre d'illustration, au niveau
national, un partenariat financier avec les coopératives de produits
vivriers serait une
1679 Selon la Comité des droits de l'enfant, tout
gouvernement qui prend au sérieux ses obligations à
l'égard des enfants, devrait effectuer une analyse budgétaire
adaptée pour déterminer la proportion des dépenses
publiques consacrée aux enfants et garantir l'utilisation effective de
toutes ces ressources, Voir HAMMARBERG (T.), Droits de l'Homme en Europe :
la complaisance n'a pas sa place, Editions du Conseil de l'Europe, Octobre
2011, p.180.
593
opportunité devant permettre de faire face aux
questions liées à l'alimentation des enfants détenus ou
enfants en institutions privées.
Des évènements ponctuels pourront aussi
être organisés pour la levée de fonds1680 destinés
à la lutte contre la violence qui touche les enfants. Ces
évènements se baseront sur le renforcement de la
solidarité nationale1681 et auront le double objectif de
sensibiliser la population et de fonctionner en tant que dispositifs de
collecte de fonds1682. Les fonds supplémentaires
collectés au titre de la protection de l'enfant pourront alimenter un
fonds exceptionnel destiné, par exemple, à financer les campagnes
nationales et locales de sensibilisation.
Pour être utiles à l'atteinte d'une
effectivité optimale des droits de l'enfant, toutes ces mesures de
réforme profonde de la stratégie de prise en charge des enfants
doivent être concomitamment accompagnées d'une plus grande
priorité accordée aux actions de prévention des atteintes
aux droits de l'enfant.
SECTION II. UNE PLUS GRANDE PRIORITE A DONNER AUX
ACTIONS DE PREVENTION DES ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT
La prévention par des actions de plaidoyer et de
sensibilisation des communautés (Paragraphe1) et la
prévention de la violence institutionnelle et des comportements à
risque sont à nos yeux, deux actions préventives
déterminantes pour une meilleure effectivité des droits de
l'enfant (Paragraphe 2).
§ 1. LA PREVENTION PAR DES ACTIONS DE PLAIDOYER
ET DE SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES
Seront mis en lumière à ce niveau de notre
analyse, l'instauration d'une culture de débat sur les atteintes aux
droits de l'enfant (A) et un appui renforcé aux structures
communautaires de protection de l'enfant (B).
1680 GALLOUIN (J-F), Guide pratique de la levée de
fonds, Groupe Eyrolles, 2007, p.5-6.
1681 KNESTSCH (J.), « La solidarité nationale,
genèse et signification d'une notion juridique », Revue
française des affaires sociales, 2014/1(n°1-2), pp.32-43. ;
THOMAZEAU (A-M.), Aider les autres ? Paris, De La Martinière Jeunesse,
2008. 254p.
1682 LEFEVRE (S.), Collecte de fonds, militantisme et
marketing : le programme Direct Dialogue à Greenpeace France,
mémoire de DEA de Science Politique, Université Lille2, 2003.
594
A. L'INSTAURATION D'UNE CULTURE DE DEBAT SUR LES
ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT
Les problèmes de violence1683 et
exploitation qui touchent les enfants sont méconnus de l'opinion
publique ivoirienne. On observe la coexistence de différents niveaux
d'appréhension et de conscience du problème de la violence
affectant les enfants. En Côte d'Ivoire, certaines formes de
violence1684 ne sont pas reconnues en tant que telles, notamment la
maltraitance1685 et l'exploitation1686. Pour d'autres,
notamment les punitions corporelles1687 et la violence sexuelle, la
propension sera à en faire porter la responsabilité à
l'enfant, pourtant victime : c'est par son comportement qu'il est
considéré méritant ce qui lui arrive. On explique encore
la violence contre les enfants par des considérations relatives aux
« défaillances parentales1688 », aux
« familles dysfonctionnelles ou recomposées1689
». Bref, dans la majorité des cas, on n'est pas prêt à
reconnaitre qu'il s'agit d'un problème véritablement collectif,
enraciné dans des pratiques tolérées et
répandues.
1683 FORTIN (A.) et CHAMBERLAND (C.) et LACHANGE (L.), «
La justification de la violence envers l'enfant, un facteur de risque de
violence », Revue Internationale d'éducation familiale,
IV, (2), 2000, pp.5-34.
1684 MILLER (A.), C'est pour ton bien. Racines de la
violence dans l'éducation de l'enfant. Réédition.
Paris : Aubier, 2008, 320p ; LAPIERRE (S.) et DAMANT (D.), « Les mauvais
traitements envers les enfants et les adolescents : le point de vue d'enfants
et d'adolescents victimes. ». Service social, 51(1), 2004,
pp.98-109. 1685 DURNING (P.), « L'évaluation des situations
d'enfants maltraités : définitions, enjeux et méthodes
», In. Evaluation (s) des maltraitances : rigueur et prudence,
Editions Fleurus psycho-pédagogie, Paris, 2002, pp.15-47. ; DURNING
(P.), L'enfance maltraitée : piège ou défi pour la
recherche en éducation familiale », Revue française de
pédagogie, 96, 1991, pp.33-42. ; DURNING (P.), La maltraitance :
une notion floue, des réalités incontournables » in
Revue du Haut Comité de Santé Publique, juin 2000,
pp.57-59.
1686 JACQUEMIN (M.), « Travail domestique et travail des
enfants, le cas d'Abidjan (Côte d'Ivoire) » in Tiers
Monde.2002, tome 43, n°170.
1687 COMITE DES DROITS DE L'ENFANT DES NATIONS UNIES, «
Observations générales n°8 du Comité des droits de
l'enfant des Nations Unies sur le droit de l'enfant à une protection
contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou
dégradantes de châtiments ». CRC/C/GC/8, 2 juin 2006 ;
CONSEIL DE L'EUROPE 2007, « L'abolition des châtiments corporels
à l'encontre des enfants : Questions et réponses » In.
Construire une Europe pour et avec les Enfants. Editions du Conseil de
l'Europe. Bruxelles, 57p. ; CLEMENT (M-E), KARINE (C.) et ISA IASENZA, «
Que retenir de l'implantation et de l'efficacité du programme Eduquons
nos enfants sans corrections physiques ». Défi jeunesse :
Revue professionnelle du Conseil multidisciplinaire du Centre Jeunesse de
Montréal, vol. 11, n°1, novembre 2004, p.8-27.
1688 LESAGE (F), « Défaillance parentale. Et choc
des cultures », Les Cahiers Dynamiques 3/2014 (n°61),
pp.135-142.
1689 MARIE-CHISTINE (S.J.), « Familles recomposées
: qu'avons-nous appris au fil des ans ? », Service social,
vol.39, n°3, 1990, pp.7-37.
595
Par conséquent, la violence à l'égard des
enfants, bien que observable par tout un chacun, fait l'objet d'une
visibilité limitée et apparait à un faible niveau des
préoccupations relayées dans le débat public. Le refus de
percevoir la violence contre les enfants comme une menace pour les valeurs et
à terme, pour le développement harmonieux de la
société génère l'apathie de l'opinion publique et
la rend peu encline à se mobiliser.
Pour contrer cette situation et faire évoluer les
mentalités, il est donc nécessaire de changer les perceptions du
public sur les phénomènes de violence et partant augmenter la
capacité d'indignation1690 face aux abus qui touchent les
enfants. Sur cette base, il sera possible de promouvoir des actions de lutte
contre la violence qui soient à la portée de tout citoyen.
En l'espèce, la communication sociale1691
apparait à nos yeux comme un véhicule puissant pour impulser ces
changements. Ici, la communication sociale réfère à toute
initiative de diffusion par les médias, de messages relatifs à la
protection de l'enfant et de ses droits auprès de la population toute
entière (campagnes nationales) ou de publics sélectionnés.
La communication sociale en matière de protection de l'enfant viserait
à faire évoluer les comportements par l'émergence et la
généralisation de nouvelles idées et normes
partagées qui soient résolument favorables à la protection
de l'enfant.
L'introduction des questions de violence touchant les enfants
dans l'agenda médiatique de masse et de proximité est une
stratégie incontournable pour arriver à une appréhension
de la violence envers les enfants en tant que problème sociétal
qui appelle à la responsabilisation de tout un chacun et pour soutenir
un dialogue social1692 ample et continu à ce sujet.
Le défi pour le secteur des médias est celui de
la pertinence et de l'adéquation des messages à l'intention de
l'opinion publique, pour éviter qu'elle ne bascule dans l'alarmisme qui
appelle démesurément à la répression ou à
l'opposé dans l'indifférence et l'immobilisme. Les médias
devront aussi assurer qu'il y ait une certaine continuité entre les
messages
1690 PIERRON (J.-P.), « L'indignation »,
Études, vol. Tome 416, no. 1, 2012, pp. 57-66.
1691 COLLET (H.), Communiquer : Pourquoi ? Comment ? Le
guide de la communication sociale, Paris, CRIDEC Editions, 2004, 608 p. ;
PACINI (M-C), Le rôle du digital dans la communication sociale,
mémoire de fin d'études (MBA 2ème
année), Ecole de Commerce de Lyon, 2015, pp.9-14.
1692 BIT, Dialogue social-Discussion récurrente en
vertu de la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable, Conférence internationale du
Travail, 102e session, 2013, ILC.102/VI.
596
véhiculés et d'autres initiatives plus
concrètes en appui au changement de comportement par rapport au
problème abordé.
Les initiatives de communication sociale en tant que moyen de
contribution à l'effectivité des droits de l'enfant, se donneront
comme objectifs de :
- Dénoncer publiquement les diverses formes de violence
qui affecte les enfants ;
- Faire la promotion de tous les droits de l'enfant et du
droit à la protection contre la violence en particulier ;
- Faire la publicité des conséquences
néfastes de la violence sur l'enfant, la famille et la communauté
;
- Soutenir le concept de la responsabilité individuelle
et collective de s'abstenir de tout
comportement violent vis-à-vis des enfants ;
- Diffuser l'information sur les textes protégeant les
enfants et sur les conséquences légales de tout acte de violence
;
- Divulguer l'obligation de signaler tout acte de violence
pour que les enfants victimes puissent être assistés ;
- Faire la publicité sur les dispositifs existants en
matière de signalement et assistance aux enfants victimes et donner des
orientations claires quant à la procédure à suivre ;
- diffuser des informations visant à renforcer les
capacités d'autoprotection des enfants, leur connaissance des droits et
les informer sur les voies de secours et de recours, de
préférence avec leur participation dans la production des
messages.
Les initiatives de communication sociale rechercheront
l'équilibre entre la notion de gravité de la situation et la
communication positive valorisant la «
bientraitance1693 », les valeurs et les pratiques
positives dans les processus d'éducation et de protection des
enfants.
Elles s'appuieront dans la mesure du possible sur la
participation des leaders d'opinion, soient-ils des responsables politiques,
des communicateurs, des artistes, des leaders traditionnels, etc., et sur la
participation de groupes d'enfants et de jeunes.
1693 SELLENET (C.), « De la bientraitance des enfants
à la bientraitance des familles ? », Spirale
1/2004(n°29), p.69-80 ; RAPOPORT (D.), « De la prévention
de la maltraitance à la « bien-traitance » envers l'enfant
», Informations sociales 4/2010 (n°160), pp.114-122.
597
Pour assurer la réussite des efforts de communication,
il serait nécessaire d'élaborer une stratégie de
communication1694 en matière de protection de l'enfant et de
ses droits, avec l'implication et la collaboration entre les responsables
politiques, le parlement1695, les réseaux professionnels, les
ONGs et les médias. Il sera nécessaire aussi d'assurer que les
efforts de communication aillent de pair avec les efforts d'amélioration
de l'efficacité des services d'assistance, de sécurité et
services judiciaires dans la suite donnée aux
signalements1696 de manière à améliorer la
confiance de la population et leur propension au signalement.
Outre l'instauration d'une culture de débat sur les
atteintes aux droits de l'enfant, notamment contre toute forme de violence, les
structures communautaires de protection de l'enfant doivent aussi faire l'objet
d'un appui renforcé.
B. UN APPUI RENFORCE AUX STRUCTURES
COMMUNAUTAIRES
L'objectif visé ici est de renforcer les pratiques
communautaires positives1697 en matière de protection et de
défense des droits de l'enfant. Ce faisant, à terme, les
pratiques communautaires en matière de violence affectant les enfants
devraient être axées sur la considération de
l'intérêt supérieur de l'enfant. En matière de
protection de l'enfant, le rôle principal étant dévolu aux
communautés, il importe que la priorité soit accordée aux
actions tendant à renforcer les capacités des communautés
afin que les enfants soient élevés ou éduqués
à l'abri de toute forme de violence et que leur protection face aux
risques soit assurée1698 . Les modes de vie
qui se basent sur une cohésion sociale forte sont vivaces en
1694 PALMIERI (J.), E-change-Stratégies de
communication des associations, ritimo, pp.1-14 ; LIBAERT (T.), Le
plan de communication. Définir et organiser votre stratégie de
communication, Paris, Dunod, 5è ed. 2017, 320p.
1695 UNICEF, La protection de l'enfant. Guide à
l'usage des parlementaires n°7, Presses de SRO Kundig, Genève,
2004, pp.23-44.
1696 CIRCULAIRE N° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février
2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au
développement de la bientraitance des personnes âgées et
des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux relevant de la compétence des ARS, p.5-6
disponible sur
www.circulaire.legifrance.gouv.fr
(consulté le 21/08/2016).
1697 TERRE DES HOMMES, Les pratiques communautaires dans
la protection des enfants-Les cas du Brésil, de la Colombie, du
Pérou, de l'Equateur et du Nicaragua, 2011, pp.9-24.
1698 CARBONNIER J., « Vis famille, Législation et
quelques autres », in J. CARBONNIER, Flexible droit, Pour une
sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 2001, p.275. ; Voir aussi, C.
RIEUBERNET, « Les limites de la solidarité familiale », in
C. NEIRINCK, Droits de l'enfant et pauvreté, Dalloz, 2010,
p.55. ; FULCHIRON
598
Côte d'Ivoire, notamment, dans le milieu rural. Il
existe dans ces communautés des normes, à tout le moins, des
règles intériorisées établissant des règles
de la vie communautaire et les diverses formes de solidarité. Les
parents sont les premiers responsables du bien-être de leurs enfants.
Dans l'exercice de cette responsabilité et face à des
difficultés majeures (décès et maladie, perte d'emploi et
de revenus, difficultés relationnelles, etc.), les diverses formes de
solidarité veulent que les membres de la communauté (famille
élargie, voisinage, quartiers, cercles d'amis et personnes proches,
autorités locales, etc.) viennent au secours des parents en
difficulté. Les règles communautaires établissent les
comportements admissibles ou souhaitables et ceux qui sont proscrits à
l'égard des enfants. Ceci est vrai par exemple quant aux
châtiments corporels, qui peuvent s'imposer aux parents par la force de
ces mêmes normes. Les comportements déviants de ces normes font
généralement l'objet d'une condamnation morale et en
conséquence, fonctionnent comme des éléments de dissuasion
de certains comportements de la part des parents. Les normes désignent
les personnes qui peuvent éventuellement intervenir dans le milieu
familial dans l'appréciation de la manière dont les parents
s'acquittent de leurs responsabilités et à partir de quel seuil.
Les mécanismes de règlement des conflits ethniques ou
communautaires1699 en général sont confiés
à la responsabilité des griots1700 ou chefferies
traditionnelles1701 grâce au pouvoir1702 à
eux confiés. Seulement et malheureusement, certains abus commis sur les
enfants font l'objet de règlement traditionnel, à la demande des
parents (par exemple, en cas d'abus sexuel commis par une personne
extérieure à la famille). Toutefois, force est de reconnaitre que
ces
H. (dir.), Les solidarités entre
générations, Paris, Bruylant 2013, 1149p ; Lire aussi :
MAISONNASSE (F.), L'articulation entre la solidarité familiale et la
solidarité collective, LGDJ, 2016, 485p.
1699 HOBSBAWM (E.), « Qu'est-ce qu'un conflit ethnique ?
», in Actes de la Recherche en Sciences sociales, n°100,
Paris, Seuil, 1993, p.52. ; LABAKI T. GEORGES, Les conflits communautaires et
ethniques dans le monde contemporain », in Encyclopaedia
Universalis, Paris, Universalia, 1991, pp.111-116.
1700 SORY CAMARA, Gens de la parole. Essai sur la
condition et le rôle des griots dans la société
malinké, Paris, Karthala, 1992, 375p.
1701 HASSANE (B.), « Autorités coutumières
et régulation des conflits en Afrique de l'Ouest francophone : entre
l'informel et le formel » in La réforme des systèmes de
sécurité et de justice en Afrique francophone, Organisation
Internationale de la Francophonie, 2011, p.178. ; ADRIANN (B.) van ROUVEROY van
NIEUWAAL, L'Etat en Afrique face à la chefferie : le cas du
Togo, ASC-Karthala, Paris/Leyde, 2000, p.25. ; PERROT (C.-H.) et
FAUVELLE-AYMAR (F.-X.) (dir.), Le retour des Rois : les autorités
traditionnelles et l'Etat en Afrique contemporaine, Paris, Karthala,
Paris, 2003, pp.249-266.
1702 BADIE (B.) et al., Dictionnaire de la science
politique et des institutions politiques, Paris, Armand Colin, 2005,
pp.265-266. ; LHOMME (J.), « La notion de pouvoir social », Revue
économique, Volume 10, n°4, 1959, p.487.
599
règlements privilégient le rétablissement
de la cohésion communautaire1703, par l'application à
l'auteur de l'abus, d'une forme de réparation informelle à la
famille. L'enfant victime ne fait en général l'objet d'aucune
attention particulière. Qui plus est, dans les communautés,
souvent des actes et des situations sont tolérées,
acceptés et même envisagés par les adultes, parce qu'elles
ne sont pas perçues en tant que telles. La violence à l'encontre
de l'enfant peut devenir tolérable ou banale aux yeux de ceux qui
l'infligent ou qui en sont spectateurs. En conclusion, l'intérêt
supérieur de l'enfant demeure soumis à l'intérêt des
adultes et de la communauté1704.
Pour pouvoir prévenir les abus, la violence et
l'exploitation à l'encontre de l'enfant en milieu communautaire, il est
donc nécessaire que les membres de la communauté
perçoivent clairement la maltraitance et l'exploitation en tant que
telles, soient conscients de leurs conséquences sur le
développement de l'enfant et sur la vie de la communauté, et
finalement acceptent de changer d'attitudes et de comportements. La
communication pour le changement de comportement1705 en
matière de protection de l'enfant au niveau communautaire pourrait
être un outil central pour assurer l'atteinte de ces objectifs. Cette
forme de communication fait référence à des initiatives de
communication sociale interpersonnelle. L'action consisterait à
établir un dialogue de proximité entre les membres d'une
communauté donnée et des professionnels de l'action sociale
autour de questions
1703 On ne le dira jamais assez, en Afrique, le primat du
groupe sur l'intérêt individuel reste prégnant au niveau
traditionnel malgré la consécration des droits individuels. KAMTO
(M.), « Charte africaine, instruments internationaux de protection des
droits de l'homme, constitutions nationales : articulations respectives »,
in E. LAMBERT ABDELGAWAD, J-F FLAUSS (s-dir.), L'application nationale de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Bruylant,
Nemesis, Bruxelles 2004, p.11. ; A contrario FULCHIRON H., « Existe-t-il
un modèle familial européen ? », Défrenois
2005, 38239, pour qui « s'il n'existe pas de modèle familial
européen, c'est donc bien parce que l'unité de mesure de toute
chose n'est pas le groupe, mais l'individu ». 1704 Selon RICHARD MOLLARD
(J.), « Le Nègre ne se conçoit pas seul. La cellule
fondamentale des sociétés négro-africaines n'est nullement
l'individu, mais un groupe. L'individu n'est à l'aise que s'il se saisit
lui-même par rapport à une communauté. Il est une dent de
rouage dans un complexe engrenage », RICHARD MOLLARD (J.), « Groupes
ethniques et collectivités d'Afrique Noire », In. Cahiers
d'Outre-Mer, 1952, cité par KOUASSIGNAN (G.), Quelle est ma loi
? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique
noire francophone, Paris, Pédone, 1974, p.14. ; Voir aussi ASSO
(B.) selon lequel, « Dans les sociétés
négro-africaines, la cellule essentielle de l'organisation sociale n'est
pas l'individu considéré isolement. Tout homme constitue un
chaînon vivant, actif et passif, rattaché par le haut à
l'enchainement de sa lignée ascendante et soutenant sous lui sa
lignée descendante », « De la sacralisation du pouvoir : essai
sur l'Afrique noire animiste », Revue Méditerranéenne
d'Histoire, 1976, p.97.
1705 FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE, La communication pour le changement de comportement
à l'usage des volontaires de la communauté-Manuel du
formateur, 2010, pp.19-66.
600
relatives aux droits et à la protection de l'enfant.
Pour être un complément des actions de communication sociale par
les médias, la communication pour le changement de comportement
permettrait d'en renforcer l'impact en instaurant un dialogue direct avec la
population, en particulier celles pour qui l'accès aux média est
plus difficile.
La communication pour le changement de comportement en milieu
communautaire partirait d'un double postulat : d'une part, la violence à
l'encontre des enfants provient souvent de la méconnaissance ou de
l'incompréhension de la part d'adultes (qui ont pour la plupart subi les
mêmes traitements)1706, des effets dommageables de la violence
et de l'exploitation sur le développement de l'enfant tout comme sur les
relations communautaires et le développement ; d'autre part, le
changement de comportement des uns et des autres dans le sens d'une meilleure
protection de l'enfant ne peut être que le fruit d'une prise de
conscience, de décision éclairée et d'un engagement
collectif de ceux qui sont concernés directement.
La communication pour le changement de comportement viserait
aussi à soutenir l'acquisition de connaissances, aptitudes et
comportements de protection et à renforcer les pratiques communautaires
favorables au développement holistique de l'enfant. Le dialogue entre
les intervenants extérieurs et la communauté portera sur la
valorisation des pratiques positives (renforcement des compétences
familiales, prise en charge communautaire) et sur la reconnaissance de ce qui
constitue une violation du droit à la protection de l'enfant. Le but est
de convenir avec les communautés de la nécessité d'une
moindre tolérance envers des comportements violents à
l'égard des enfants (corrections démesurées,
maltraitance), un moindre recours aux stratégies économiques
familiales qui pénalisent fortement les enfants (pires formes de travail
des enfants, mariage forcé), un abandon des pratiques socioculturelles
néfastes pour les enfants, telles que les mutilations génitales
féminines, le mariage précoce.
Les processus de communication pour le changement de
comportement en milieu communautaire se doivent d'être non seulement des
processus collectifs (engageant un grand nombre d'acteurs des
communautés), mais aussi progressifs (allant du développement
de
1706Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, La
communication pour le changement de comportement à l'usage des
volontaires de la communauté- Manuel du formateur, 2010,
pp.19-23.
601
l'enfant aux problèmes des violences touchant les
enfants) et inscrits dans une durée suffisante pour l'atteinte de
résultats réels. Ils se donneront les objectifs qui suivent :
informer et éduquer sur le développement physique et
émotionnel de l'enfant1707, y compris la phase de
l'adolescence1708; revisiter de manière critique ensemble
avec les chefferies traditionnelles et les membres des communautés, les
pratiques de résolution des conflits relatifs à la protection de
l'enfant et apprécier leur adéquation à
l'intérêt supérieur de l'enfant ; identifier les
problèmes de protection de l'enfant et évaluer l'étendue
de leur impact sur le développement de l'enfant ; reconnaitre et
renforcer les pratiques positives ; reconnaitre et abandonner les pratiques
nuisibles ; mener à la prise de conscience collective du devoir de
protection vis-à-vis des enfants ; inciter les communautés
à s'engager sur des initiatives mettant à profit les formes
organisationnelles et les potentialités existantes dans la
communauté au service d'une meilleure protection de l'enfant. Ces
initiatives pourront se formaliser en tant que mécanismes de veille,
détection, médiation1709 et référence ;
assurer que les communautés disposent des informations
nécessaires pour recourir aux services de protection de l'enfant dans
les cas où la prise en charge psychosociale de l'enfant1710
et l'accompagnement de la famille soient nécessaires et/ou envisageables
; poser la question de la résolution communautaire des litiges relatifs
aux infractions commises sur l'enfant en lieu et place du recours à la
justice sous le prétexte du maintien de la cohésion sociale
à l'appréciation des uns et des autres , et établir le
consensus quant à la nécessité de recourir à la
justice dans les cas prévus par la loi ; soutenir l'accès des
communautés aux services d'aide juridique1711 et le recours
à la justice1712 pour la poursuite de cas d'infractions
pénales commises contre les enfants.
1707 DELFOS -MARTINE (F.) , « Le développement des
enfants de 4 à 12 ans », In. De l'écoute au respect,
communiquer avec les enfants, Toulouse, ERES, « Enfance et
parentalité », 2007, pp.35-59.
1708 UNICEF, La situation des enfants dans le monde
2011- L'adolescence. L'âge de tous les possibles,
pp.8-12.
1709 DE LARA (A.), DE LARA (P.), « L'enfant, objet
transitionnel de la médiation familiale », Dialogue 2003/2
(n°160), p.69-87.
1710 PERRUSSON (O.), « Accompagnement psychologique des
enfants maltraités », Laennec 1/2008 (Tome 56), pp.34-44.
Disponible sur www.cairn.info/revue-laennec-2008-1-page-34.htm.
(Consulté le 15/05 /2016). 1711 Pour plus d'informations sur les
composantes fondamentales de l'assistance juridique adaptée aux enfants,
voir, UNICEF, L'assistance juridique adaptée aux enfants en
Afrique, Juin 2011, pp.10-21 ; Commission Internationale de Juristes-
Fédération des juristes africains, Les services juridiques en
milieu rural, rapport d'un séminaire tenu à Libreville du
1er au 5 février 1998, 152p.
1712 DIAGNE (P.), « Accès à la justice dans
les quartiers urbains pauvres : Dakar, Abidjan, Niamey, Ouagadougou », in
Pauvreté et accès à la justice en Afrique Impasses et
Alternatives, L'Harmattan, 1995, p.27-
602
Il apparait indispensable que toute institution ou association
qui se propose de travailler le thème de la protection avec une
communauté donnée utilise une approche adaptée. Il ne
s'agit pas en fait que les communautés perçoivent l'approche
comme une menace ou une sanction des modes de vie locales. Il est
nécessaire au départ de bien connaitre et de respecter les
traditions socio-culturelles locales. Cette condition est indispensable pour
engager avec les membres de la communauté, un réexamen des
pratiques locales au regard des droits de l'enfant. Il est clair que ce travail
demande une durée suffisante pour établir une relation de
confiance entre les personnes de la communauté et les intervenants
extérieurs. Au fur et à mesure de la stabilisation de la
relation, le travail de sensibilisation pourrait s'appuyer de manière
croissante sur les membres de la communauté acquis au changement : en un
mot, les propres membres de la communauté deviendraient à terme,
des vecteurs de transmission des connaissances et comportements visant à
renforcer l'effectivité des droits de l'enfant, son statut et sa
protection au niveau local. Aussi, les interventions ayant comme objectif le
changement des comportements seront couplées dans la mesure du possible
avec des actions plus amples de développement local1713, des
activités d'intérêt de la communauté (sports,
loisirs, activités culturelles), des échanges sur les droits de
l'enfant, etc.
Ces actions préventives doivent aussi s'étendre
au niveau de la protection institutionnelle et des comportements à
risque des enfants.
§ 2. LA PREVENTION DE LA VIOLENCE
INSTITUTIONNELLE ET DES COMPORTEMENTS A RISQUE
Une protection particulièrement stricte des enfants
dans les institutions d'accueil (A) et une attention accrue aux comportements
à risque de la part des adolescents (B) pourraient contribuer à
réduire le degré d'ineffectivité des droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire.
116 ; SAWADOGO (F.M), « L'accès à la
justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives. Le cas du
Burkina Faso », in L'effectivité des droits fondamentaux dans
la communauté francophone, éd. Aupel-Uref, 1994, p.295-313 ;
NKOU MVONDO (P.), « La crise de la justice de l'Etat en Afrique noire
francophone. Eudes des causes du divorce entre la justice et les justiciables
», Penant, 1997, p.208-228. ; FRICERO (N.), « L'accès
au juge » in Revue Annuelle des avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation « justice et cassation », édition
Dalloz, 2010, p.15.
1713 JAMBES (J-P), Territoires apprenants : esquisses pour
le développement local du XXIème siècle, Paris,
L'Harmattan, 2001, pp.16-17. ; BESSON (G.), Le développement social
local : significations, complexité et exigences, Paris,
L'Harmattan, 2008, p.191. ; PECQUEUR (B.), Le développement local.
Pour une économie des territoires. Ed. : La découverte.
Syros. 2000, 132p.
603
A. UNE PROTECTION PARTICULIEREMENT STRICTE DES ENFANTS
DANS LES INSTITUTIONS D'ACCUEIL
La protection des enfants dans les services et
institutions1714 aura pour objectif la prévention et le
contrôle de la violence institutionnelle1715.
Il faudrait à travers une politique claire,
préciser davantage les mesures mises en place par l'institution pour
assurer que les enfants qui y transitent ne soient l'objet d'une quelconque
forme de violence. Elle devrait non seulement, mettre en exergue la politique
de recrutement des personnels, mais aussi édicter des règlements
auxquels les institutions et leur personnel sont soumis ; Aussi, devrait-elle
établir des mécanismes indépendants de contrôle
interne et de contrôle externe ; Pour effectuer le signalement ou l'avis
à l'autorité judiciaire en vue de la transmission des
allégations ou plaintes aux autorités compétentes en cas
d'abus, des modalités claires devraient être
précisées.
Les établissements scolaires1716 de tous les
niveaux, les établissements sanitaires1717 et les structures
de formation et de professionnalisation seront les institutions prioritairement
visées par cette mesure. En concertation avec des ordres et associations
professionnelles concernées, les ministères de tutelles de ces
établissements privés ou publics, se doivent d'édicter des
règlements de protection de l'enfant conformément aux termes ci
devant précisés. Par la suite, il serait opportun de divulguer
ces documents, d'engager des actions de formation, de développer des
outils méthodologiques et, dans la mesure du possible, d'identifier des
personnes relais de la protection de l'enfant au niveau des
établissements.
Les institutions telles que les pouponnières,
orphelinats, centres d'accueils, centres spécialisés pour les
enfants porteurs de handicap, internats qui accueillent ou hébergent des
enfants, sont soumises à des règles dictées par les
autorités administratives de protection de
1714 ROSENCZVEIG (J.P.), Lettre ouverte aux directeurs
d'établissements et autres intervenants en institution sur les
réponses à apporter aux maltraitances à enfants et
à personnes vulnérables, Publication de l'ANCE, 2000. ;
CREOFF (M.), « Lutte contre les violences institutionnelles : un
engagement de la puissance publique ».In. Journal du Droit des
jeunes, Novembre 2001, n°209, pp.32-34.
1715 CORBET (E.), « Les concepts de violence et de
maltraitance », adsp, n°31, juin 2000, p.20. ;
TOMKIEWICZ (S.), VIVET (P.), Aimer mal, Châtier bien. Enquêtes
sur les violences dans les institutions pour enfants et adolescents, Paris
: Seuil, 1991.230 p.
1716 TOMKIEWICZ (S.), FABRE (M.), L'école et la
violence, in Journal des jeunes, mai 1998, pp.13-25. 1717 AUFORT (C.),
HOUDIN (J.), La peur dans les structures sanitaires et sociales,
Management, Avril 2001, n°3, pp.3-15.
604
l'enfant. Ces règles devraient de façon claire,
définir les critères relatifs à l'ouverture et au
fonctionnement de ces institutions, les standards de prise en charge et les
mécanismes de surveillance externe et interne. Les dispositions devant
être prises en cas de signalement d'une moindre indication de
maltraitance infantile, notamment des attitudes à caractère
sexuel devraient être prévues et précisées.
Par ailleurs, des codes de bonne conduite claires devant
orienter les professionnels relativement aux modalités d'exercice de
leurs prestations par rapport aux enfants, devraient être
élaborés par les associations professionnelles. In fine,
toutes ces mesures auraient pour résultat l'identification des cas de
violences institutionnelles et l'application des dispositions prévues
à cet effet. Il importe aussi que tous les services qui travaillent avec
des enfants disposent d'un programme interne clair de protection de
l'enfant.
De même, une attention doit être accordée aux
comportements à risque des adolescents.
B. UNE ATTENTION ACCRUE AUX COMPORTEMENTS A RISQUE DE
LA PART DES ADOLESCENTS
La période de l'adolescence peine à être
reconnue comme une phase du développement qui a ses
caractéristiques propres. Accédant à la puberté,
l'enfant est à tort considéré parfois comme un adulte
investi d'un certain nombre d'obligations ; ce faisant, son statut de personne
en développement avec ses besoins spécifiques est nié. Or,
selon les scientifiques, entre 12 et 15 ans, la personne humaine n'a pas encore
fini son développement physique, cognitif, psychologique1718.
Selon l'étude du processus de maturation
cérébrale1719, le cortex
préfrontal1720, partie du cerveau assurant le contrôle
de conduites, et partant la capacité d'anticiper et de prévoir le
raisonnement, l'auto contrôle, ne se développe pleinement qu'au
début de l'âge adulte. Ainsi, tout adolescent se trouve dans une
phase d'évolution
1718 FERNANDEZ (L.), Psychologie du
développement, Editions. Scientifiques et Médicales Elsevier
SAS, Paris, 2002, 5p. ; MYERS (DG), « Développement de l'enfant
» In. Myers DG éd. Psychologie, Paris : Medecine-Sciences
Flammarion, 1997, pp.77-115 ; RICAUD-DROISY (H.), SAFONT-MOTTAY (C.) et
OUBRAYIE-ROUSSEL (N.), « Psychologie du développement ». In
Enfance et adolescence, Dunod, 45-70. 1719 JAY N. GIEDD, «
Maturation du cerveau adolescent », In. Encyclopédie sur le
développement des jeunes enfants,Janvier 2011, p.28-31.
1720 LANDMANN (C.), Le cortex préfrontal et la
dopamine striatale dans l'apprentissage guidé par la récompense :
conception et étude d'une tâche cognitive d'exploration par essais
et erreurs en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et
en tomographie par émission de positions avec le 11C-raclopride.
Neurosciences. Université Pierre et Marie Curie-Paris VI,
2007.pp-15-20.
605
instinctuelle, émotionnelle et morale ne lui permettant
pas d'appréhender de façon sérieuse, les risques des
pratiques préjudiciables à sa santé et son
développement tels que la consommation de tabac, de l'alcool, la drogue,
les comportements sexuels à risque (précoce, non
protégé et ou en échange de rémunération),
agressivité entre pairs.
Les facteurs explicatifs des comportements à risque des
adolescents sont mal connus. Cependant, il va de soi que les adolescents
bénéficiaires d'un faible encadrement (vie familiale, exclusion
scolaire) seraient davantage exposés que les adolescents jouissant d'un
suivi parental attentif et adapté, fréquentant l'école,
etc.
Une des missions fondamentales de tout processus d'action
sociale est incontestablement l'encadrement et l'orientation des jeunes. Les
actions ou interventions à l'endroit des adolescents à
comportements à risque doivent permettre la création des
opportunités pédagogiques ; lesquelles opportunités
pédagogiques seraient un tremplin d'acquisition de savoir, de
connaissances, compétences et valeurs par les adolescents. Ainsi, fort
de ces acquis pluriels et divers, ils pourraient faire des choix responsables
quant à leurs relations sociales, y compris sexuelles. Ils doivent
être mis en mesure de mieux comprendre les risques auxquels ils sont
confrontés, de s'auto-protéger, de savoir où trouver de
l'aide et d'adhérer aux propositions de la part des éducateurs.
Ces objectifs pourront être atteints par la mise en place d'actions
éducatives de proximité dans les lieux fréquentés
par les adolescents, par la création de centres d'information et conseil
pluridisciplinaires, par l'organisation d'activités de quartier et
communautaires récréatives, artistiques, culturelles et
sportives, par le soutien aux associations de jeunes et la création de
plates-formes d'échange pour leur permettre de s'exprimer
véritablement.
Ces mesures viseraient à prévenir les
comportements à risque de la part des adolescents. Le résultat
escompté est la diminution sensible des comportements à risque
des adolescents. Pour être fondamentales, ces stratégies
contribueraient, notamment, à la prévention de la commission
d'infractions et l'entrée des adolescents dans le système de
l'administration de la justice des mineurs1721.
1721 GACUKO (L.), La mise en oeuvre de l'article 40 de la
convention internationale relative aux droits de l'enfant au Burundi,
thèse de doctorat, Université de Namur, 2012, 797p. ; TREMBLAY
(A.), « Justice des mineurs : Quand la victime a voix au chapitre »
In. Les cahiers de recherches criminologiques, cahier n°18,
Université de Montréal-Centre international de criminologie
comparée, 1994, 113p.
606
Cependant, il peut arriver des situations où les
mesures de prévention ne puissent empêcher la commission
d'infractions à l'égard des enfants ainsi que des atteintes
à leurs droits. Face à une telle hypothèse, le
renforcement des mesures d'assistance aux enfants victimes s'avère
nécessaire.
SECTION III. UN RENFORCEMENT BENEFIQUE DES MESURES
D'ASSISTANCE AUX ENFANTS VICTIMES
Le renforcement des mesures d'assistance aux enfants victimes
pourrait se décliner à trois niveaux : dans le cadre de la
détection et la prise en charge des cas de violence (
Paragraphe1), la mise en place d'un système d'un système
de substitution pour les enfants privés de protection parentale
(Paragraphe 2) et le renforcement des conditions de lutte
contre l'impunité (Paragraphe 3).
§ 1. DANS LE CADRE DE LA DETECTION ET LA PRISE EN
CHARGE DES CAS DE VIOLENCE
Des méthodes de détection et de signalement plus
perfectionnés des cas de violence(A) et une meilleure adaptation de la
prise en charge par la création de systèmes locaux (B)
contribueraient inéluctablement à une meilleure assistance des
enfants victimes.
A. DES METHODES DE DETECTION ET DE SIGNALEMENT PLUS
PERFECTIONNEES
La détection1722 et le
signalement1723 des cas de violence affectant les enfants
apparaissent indispensables pour des éventuels secours et assistance
à l'enfant victime. L'efficacité du système de protection
de l'enfant dépendrait en partie du renforcement de ces
stratégies de détection et de signalement. Comment y arriver
concrètement ?
1722 La détection est le fait de mettre en
lumière un cas de violence touchant un enfant, de l'identifier en tant
que cas quand existe des soupçons et/ou des preuves qu'un enfant est
victime de maltraitance, négligence sévère, violence et/ou
exploitation par un tiers et que par conséquent demande une
intervention.
1723 Le signalement, comme entendu ici, est le fait de porter
à la connaissance des autorités chargées de la protection
de l'enfant des informations relatives à une détection , en vue
d'une action de leur part. Il peut s'agir de faits observés directement,
dont on est témoin, ou bien des propos entendus de personnes fiables et
qui soulèvent des préoccupations quant aux dangers encourus par
l'enfant.
607
D'une part, il s'agira assurément d'opérer
l'identification de tous les cas nécessitant une prise en charge et de
réduire progressivement les risques de non détection. Pour ce
faire, des stratégies multiples de détection et de signalement
doivent être élaborées de façon à permettre
l'intervention rapide des autorités ; cette intervention rapide des
autorités aurait pour but l'évaluation de la situation et
l'adoption de mesures appropriées. D'autre part, il apparait aussi
nécessaire d'empêcher l'afflux de signalements non pertinents ou
de signalements relatifs à des demandes ne pouvant être
traitées ou satisfaites par les services de protection de l'enfant en
termes de réponses appropriées ; car le contraire entrainerait un
véritable engorgement des services administratifs ou judiciaires. A ce
sujet, il apparait indispensable d'élaborer des guides clairs et
précis orientant les différents acteurs chargés de la
détection et du signalement1724.
La mise en place des différentes modalités de
signalement commande de s'assurer que les services en charge du signalement
soient véritablement opérationnels. Les personnes qui
effectueront un signalement simple ou formel1725 ne transmettraient
que des informations et ne devraient en aucun cas être tenue de rapporter
la preuve des faits allégués.
Dans les localités situées à une distance
acceptable des services administratifs en charge de la protection de l'enfant,
les informations doivent être donnée de sorte que toute personne
ayant détecté un cas de violence commis à l'égard
d'un enfant puisse systématiquement avertir les autorités.
Devrait être porté à la connaissance des autorités
policières ou judiciaires, tout fait ou acte commis à
l'égard d'un enfant et juridiquement qualifié d'infraction ou de
violation.
Dans les localités n'abritant pas les autorités
administratives et/ou judiciaires de protection de l'enfant, tout individu
ayant identifié un cas de violation de droit ou de violence grave
relatif à un enfant, se doit de transmettre immédiatement ces
faits à la connaissance de l'autorité traditionnelle et s'assurer
que celle-ci prenne rapidement une action corrective ; au cas où, les
mesures prises par l'autorité traditionnelle s'avèrent
insuffisantes, les autorités compétentes au niveau local et
étatiques devraient être alertées afin de régler
cette question.
1724 Réseau Wassila-Sos Villages d'Enfants
Algérie, Le droit de l'enfant à la Protection : Plaidoyer
pour le signalement des violences sexuelles sur enfant, 2010, 53p.
1725 Le signalement formel est un document écrit selon
une formule convenue par lequel les services sociaux portent à la
connaissance des autorités judiciaires (Procureur, Tribunal) un cas de
violence touchant un enfant. Il décrit le cas et justifie le recours
à la justice.
608
Les Organisations nationales non gouvernementales (ONG) de
protection de l'enfant pourraient, au besoin, servir de véritables
relais entre la communauté et les autorités.
Dans l'hypothèse des cas jugés graves ou
à défaut de présence de tout service social ou judiciaire,
les représentants du préfet devraient rapidement être
informés en vue de mettre en place une action rapide et efficace.
Par ailleurs, des dispositifs anonymes de
signalement1726 se doivent d'être développés.
Les dispositifs anonymes de signalement apparaissent plus que
nécessaires dans les cas où l'anonymat pourrait encourager le
signalement émanant de personnes souhaitant ne pas rendre publique leur
identité en qualité d'auteurs du signalement et qui disposeraient
des informations à transmettre aux services sociaux ou à la
justice. Pour être utilisés par toute personne, ces dispositifs
n'en sont pas moins des services de recours et de secours à la
disposition des enfants eux-mêmes. Le signalement anonyme devrait
être davantage possible grâce à la multiplication de
services téléphoniques gratuits pour information, écoute,
orientation, et dénonciation dénommée « Ligne
verte ». La mise en place de ces services de signalement devrait
être constamment portée à la connaissance de la population.
Peuvent être aussi transmises directement aux autorités
policières et judiciaires, quelques informations anonymes à
toutes fins utiles.
Pour ce qui est de la détection et du signalement dans
les services ou institutions au contact avec les enfants, les personnels de
l'éducation, de la santé, de structures de sports, loisirs,
culture doivent d'une part, avoir la maitrise d'une série d'indicateurs
qui renseignent et alertent sur l'occurrence d'abus et qui
réfèrent au comportement de l'enfant, et d'autre part, disposer
de l'information afférente à la nécessité
d'informer les autorités administratives de protection de l'enfant dans
le cas d'un éventuel soupçon de violences commis à
l'égard d'un enfant.
D'ailleurs, les fonctionnaires publics ont l'obligation de
donner avis au Procureur dans tous les cas de connaissance d'un crime ou d'un
délit1727. L'avis au Procureur est prôné pour
tous les cas d'abus sexuel sans exception.
1726 Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008
organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires
départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire
national de l'enfance en danger (J.O.27 décembre 2008) »,
Journal du droit des jeunes 2/2009 (N°282), pp.46-47.
1727 Article 40 Code de procédure pénale «
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire
qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou
d'un délit, est tenu d'en donner
609
De même, le renforcement d'un système de
détection active au niveau des services chargés de la protection
de l'enfant s'avère nécessaire.
La mise en place des stratégies et procédures de
détection active de cas de violence affectant les enfants ressortit
à la compétence de la police, de la gendarmerie et de
l'inspection du travail. On le sait : dans l'exécution de leur mandat de
prévention de la commission d'infractions à l'encontre de
l'enfant, les services spécialisés de la police et de la
gendarmerie ont la charge de contrôler les sites à risque pour les
enfants ; cela passe généralement par le quadrillage et des
rondes opérées sur ces sites que sont : maquis1728,
boites de nuit, vidéoclub, jeux vidéo, marchés, gares
routières, plages, bars climatisés, hôtels, sites de
prostitution, cinémas. Après identification des cas à
risque, ils devront immédiatement solliciter l'intervention des services
sociaux ou passer à l'action en mettant l'enfant à l'abri car ce
n'est toujours pas le cas en pratique.
En collaboration avec les forces de l'ordre, l'inspection du
travail1729 et les services sociaux1730 chargés de
la protection de l'enfant se chargeront de réaliser la détection
active ; celle -ci devrait se réaliser par le biais de méthodes
de surveillance des sites à risque pour les enfants (mines, plantations,
carrières, transport, scieries, décharges, ports, abattoirs,
chantiers de construction) où les enfants travaillent, souvent à
la recherche de moyens de subsistance.
Les enfants vivant dans la rue et des adolescents ayant des
comportements à risque doivent faire l'objet d'une approche
singulière ; Comme déjà indiqué, les enfants en
rupture familiale vivant dans la rue fuient souvent des foyers maltraitants et
très démunis. De même, les adolescents qui de façon
ostensible, s'adonnent à des comportements à risque sont des
enfants en souffrance et leur comportement devrait être reçu et
perçu comme un cri à l'aide. Partant, ces enfants méritent
d'être approchés de manière appropriée par des
travailleurs
avis sans délais au Procureur de la République
et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
1728 Terme populaire usité en Côte d'Ivoire pour
désigner les bars où se réunissent des personnes en vue de
consommer l'alcool.
1729 L'inspection du travail est chargée de la
surveillance de tout type d'entreprise formelle et/ou informelle, en
particulier les lieux à risque pour les enfants (mines, plantations,
carrières, transport, scieries, décharges, ports, abattoirs,
chantiers de construction).
1730 Les services sociaux chargés de la protection de
l'enfant (services de la protection spécialisée) sont
responsables pour mettre en place des procédures de détection
active des cas de violence, abus et exploitation concernant des enfants.
610
sociaux dotés d'une expertise pédagogique
adaptée à leur situation. En effet, le contact initial est
extrêmement important en ce qu'il vise à instaurer les bases d'une
relation de confiance et surtout mettre ces enfants en confiance. Cette
relation de confiance désormais instituée entre le travailleur
social et les enfants aura pour effet d'inciter ces enfants à recourir
aux services de la protection spécialisée ou d'une association
ayant des compétences dans le travail avec ces enfants. Cela serait un
point de départ important pour engager un véritable processus de
sortie de rue et de changement. Ce processus d'accompagnement des enfants
vivant dans la rue, ne devrait se clôturer qu'avec la mise en place d'une
solution définitive stable consistant, entre autres, à : un
retour à la famille d'origine ou une intégration
socio-économique autonome, ou encore, une intégration dans une
structure éducative en vue d'un apprentissage ou d'une formation
professionnelle.
Une forte contribution des organisations expertes en
matière d'approche des enfants de la rue et développant des
comportements à risque tels la prostitution ou la consommation de
substances dangereuses, s'avèrent plus qu'utiles à la mise en
place de ces approches spécifiques. En cela, ces organisations devraient
être sollicitées par les pouvoirs publics à cette fin.
En vue d'améliorer la détection et le
signalement des cas de violence, il apparait aussi pertinent que l'enfant et
tout intéressé puisse directement solliciter une aide aux
services sociaux. Pour ce faire, l'information nécessaire à la
sollicitation directe d'une aide adaptée à chaque situation de
violation de droits de l'enfant, auprès des services sociaux, devrait
être mise à la disposition de l'enfant lui-même, des parents
et autres adultes concernés. Pour une meilleure connaissance de ce type
d'aide et en vue de son bénéfice par les enfants, les
systèmes locaux de protection de l'enfant doivent procéder
à la divulgation des informations précises et claires sur les
différents services concernés, les conditions de recours à
ces services et les services offerts aux enfants vivant dans leur
localité.
Le processus de plainte1731 actionné par
l'enfant victime ou ses parents, devrait aussi faire l'objet
d'améliorations significatives. L'amélioration de l'accueil des
victimes dans les services de police et de justice s'avère indispensable
en vue de soutenir la plainte et limiter
1731 La plainte est l'acte par lequel la partie
lésée par une infraction porte celle-ci à la connaissance
du procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire
d'une autre autorité. Cf. GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des
termes juridiques, 23e édition, Dalloz, 2015, p.779. ;
Voir aussi art.40. C.pr. pén. français.
611
la double victimisation. Cet accueil comprendrait entre
autres, un accueil physique adapté et l'assistance dans le
dépôt de plainte et dans les démarches administratives.
Dans la mesure du possible, les cas de protection de l'enfant directement
portés à la connaissance de l'autorité policière
par le biais d' une plainte devront être communiqués et
référés par cette dernière aux services
administratifs de protection de l'enfant ; Une fois saisis, ces services
administratifs devront mettre en place un processus d'accompagnement de
l'enfant et de la famille, et ce, parallèlement, avec l'éventuel
processus de poursuite de l'auteur. Les actes de
dénonciation1732 par les tiers devraient obéir au
même régime que celui de la plainte.
Par ailleurs, une rationalisation du signalement
formel1733 s'avère nécessaire dans les cas où,
il existe la nécessité d'une intervention de l'autorité
judiciaire, notamment dans les hypothèses suivantes :
- non adhésion de la famille au processus
d'accompagnement et de changement proposé par le service administratif
;
- nécessité de soustraire l'enfant de la situation
d'abus ou de son milieu de vie ;
- l'enfant est trouvé sur la voie publique, a
été placé d'urgence et il est nécessaire de
régulariser le placement d'urgence1734 par une ordonnance de
placement1735.
Il est important que les services de protection
spécialisée de l'enfant demeurent les destinataires
préférentiels, voire exclusifs du signalement. Cette mesure
viserait à assurer l'efficacité du système dans son
ensemble. Les services administratifs de protection de
1732 En matière de procédure pénale, la
dénonciation est l'acte par lequel un citoyen signale aux
autorités policières, judiciaires ou administratives une
infraction commise par autrui. La dénonciation est, dans certains cas,
ordonnée par la loi. En France voir, C.pr. pén., art.91, 337 et
451. Cf. GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques,
23e édition, Dalloz, 2015, p.351.
1733 Le signalement formel est une communication selon une
formule convenue et par écrit de la part des services administratifs de
la protection de l'enfant à l'autorité judiciaire (Procureur
et/ou Juge) dans les cas où il existe la nécessité d'une
intervention de sa part, notamment : non adhésion de la famille au
processus d'accompagnement et de changement proposé par le service
administratif ; nécessité de soustraire l'enfant de la situation
d'abus et/ou de son milieu de vie (situation de danger décrite dans la
législation ) ; l'enfant est trouvé sur la voie publique, a
été placé d'urgence et il est nécessaire de
régulariser le placement d'urgence par une ordonnance de placement.
1734 MIGNAVAL (A.), Comprendre les
spécificités de l'accueil en urgence dans un foyer de l'enfance
à travers l'étude de la temporalité, Mémoire
de l'Ecole Nationale de la Santé Publique, 2005, 82p.
1735 GEBLER (L.), « L'enfant et ses juges », AJ
Famille, 2007, p.390 et s. LAURENT (C.), « Le placement de l'enfant
et le droit au respect de la vie familiale », JDJ n°233,
mars 2004, p.19-25. ; RAYNAL F.), « Le juge des enfants sous tension
», ASH n°2695 du 04/02/2001, pp.36-39.
612
l'enfant se doivent d'avoir l'obligation désormais de
donner une suite aux signalements. Ils doivent également s'efforcer de
prendre des mesures adaptées afin de vérifier et évaluer
attentivement in situ, tout cas signalé ; Cela pourrait
ressortir à la compétence de ces services administratifs, ou une
autorité locale, voire, une personne digne de confiance, le cas
échéant. La suite de la prise en charge par les services
eux-mêmes et/ou d'un signalement formel à l'autorité
judiciaire sera décidée après un minutieux examen au cas
par cas.
A côté de cela, l'instauration d'un
système local efficace de prise en charge des enfants victimes de
violence apparaît également comme une mesure importante à
mettre en oeuvre.
B. UNE MEILLEURE ADAPTATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR
LA CREATION DE SYSTEMES LOCAUX
Pour être une mesure nécessaire, ce
système s'il est mis en place devrait pouvoir assurer une assistance
adéquate aux enfants victimes et à leurs familles. La prise en
charge des enfants victimes de toute forme de violence, abus et exploitation
vise à assurer la mise en oeuvre du droit de l'enfant au
rétablissement1736.
L'assistance aux enfants exposés ou sujets à une
violation est une responsabilité que l'Etat doit assumer sur toute
l'étendue de son territoire1737, sous peine de commettre une
omission grave en référence à sa mission de protection des
citoyens et renoncer à l'Etat de droit1738.
Les services de protection de l'enfant devraient intervenir en
soutien aux parents et à la communauté lorsqu'ils se
déparent avec des difficultés majeures difficilement
gérables au niveau local ou que la gravité de la situation impose
une intervention à l'autorité de l'Etat.
Devrait faire l'objet d'évaluation rapide en vue d'une
prise en charge réalisée par ou sous la supervision des services
chargés de la protection de l'enfant, chaque cas identifié ou
porté à la connaissance des autorités compétentes
par le signalement, la plainte, la dénonciation.
1736 Droit à la réhabilitation psycho physique et
sociale- CDE, art. 39.
1737 Sur la question du territoire de l'Etat, voir
CANAL-FORGUES (E.), et RAMBAUD (P.), Droit international public,
2e édition, Champs Université, Paris, 2011,
pp.156-159.
1738 MILLARD (E.), « L'Etat de droit : Idéologie
contemporaine de la démocratie. » J.M. Février & P.
Cabanel. Question de démocratie, Presses universitaires du Mirail,
2001, pp.415-443.
613
Une pluralité d'objectifs devrait s'attacher à
tout processus de prise en charge : la sécurisation et la
récupération physique et émotionnelle de l'enfant, le
rétablissement d'une dynamique familiale saine et la stabilisation de la
situation sociale de l'enfant et de la famille.
La prise en charge de l'enfant tiendra constamment compte du
contexte environnemental, surtout familial de l'enfant afin d'y apporter la
réponse la plus adéquate. Cette prise en charge loin de sacrifier
l'intérêt supérieur de l'enfant, se doit de sauvegarder et
renforcer les liens familiaux et communautaires. En un mot, toute action
relative à la protection de l'enfant ne devrait jamais aboutir au
relâchement des liens familiaux ou à la démission
parentale1739.
Pour être un système efficient et local de prise
en charge, il est primordial que l'entrée dans le système de
prise en charge, le processus de prise en charge, les prestations minimum, le
recours à l'autorité judiciaire pour l'application de mesures de
protection ainsi que le système de prise en charge fassent l'objet de
définitions ou de clarifications précises.
L'entrée dans le système de prise en charge
devrait être ouverte, aux cas de violence affectant les enfants
identifiés par les institutions suivantes: les services de santé
qui accueillent l'enfant aux fins de dispense de soins médicaux; les
services de sécurité et justice qui accueillent la plainte ou la
dénonciation émanant des parents, tuteurs ou des tiers ; les
services administratifs de protection de l'enfant qui accueillent directement
la/les personne(s) concernée(s), qui reçoivent le signalement ou
qui constatent des cas par les modalités de détection ; les
établissements scolaires qui constatent les signes de maltraitance, abus
et exploitation et alertent les autorités administratives,
sécuritaires et judiciaires compétentes de protection de l'enfant
; puis tout autre service et modalité efficaces de détection et
signalement.
Dans tous les cas de figure et autant que faire se peut, les
cas détectés par les différentes modalités
d'entrée dans le système de prise en charge, devraient dans les
brefs délais, être portés à la connaissance des
autorités administratives de protection de l'enfant. Les services de la
protection spécialisée auront en charge la mise en place et la
supervision de l'ensemble du processus de prise en charge de l'enfant et
d'accompagnement de la famille.
1739 MUCCHIELLI, « La démission parentale en
question : un bilan des recherches », Questions pénales,
septembre 2000, XIII-4, p.3. ; GIOVANNONI L., « La démission
parentale facteur majeur de délinquance : mythe ou réalité
? », In. Sociétés et jeunesses en difficulté,
n°5, Printemps 2008, disponible sur
http://sejed.revues.org/3133
(consulté le 21/08/2016).
614
615
La responsabilité de l'autorité administrative
de protection de l'enfant demeure entière y compris quand elle s'appuie
sur des services non publics pour l'exécution des diverses tâches
de gestion du cas. Les cas particuliers non assujettis au recours à
l'autorité judiciaire en raison de leurs spécificités
devront être totalement placés sous la supervision de
l'autorité administrative.
Quant aux cas transférés à
l'autorité judiciaire, les services administratifs demeurent
responsables du suivi de la mise en oeuvre effective des décisions du
juge des enfants.
Dans les localités marquées par l'absence
d'autorité administrative de protection de l'enfant, les
autorités coutumières, en collaboration avec les membres de la
communauté, devront assurer des règlements pris dans
l'intérêt supérieur de l'enfant ; Mieux, ces
autorités coutumières devraient accompagner l'enfant et sa
famille, jusqu'à une transformation favorable à l'enfant. Elles
devront en référer aux autorités les plus proches dans les
cas qui exigent une intervention extérieure de par leur gravité
ou complexité.
Pour ce qui est du processus, les services administratifs en
charge des enfants très exposés et/ou ayant subi une violation
sont les services de la protection spécialisée. Les services de
protection spécialisée cibleront en même temps les enfants
exposés et/ou victimes de violences physiques ou psychologiques,
violences sexuelles, abandon, en situation d'isolement et
précarité extrêmes suite à la rupture des liens
familiaux et communautaires. Au sein des services de protection
spécialisée, la priorité sera accordée à ces
enfants.
Le processus de prise en charge visera à mettre
à l'abri des victimes et leur permettre de retrouver un état
suffisant de bien-être physique et psychologique par la mise en place
d'une assistance adéquate.
Tout cas de violation détecté de quelque forme
que ce soit induit la responsabilité de l'autorité de protection
de l'enfant par rapport à la prise en charge du cas jusqu'à sa
résolution. A la suite de la détection ou du signalement simple,
les services chargés de la protection de l'enfant, auront l'obligation
de s'occuper du cas jusqu'à l'obtention d'un résultat positif
pour l'enfant et sa famille. Le responsable du service répondra aux
autorités supérieures quant à l'attente de ce
résultat.
Le processus de prise en charge, d'accompagnement peut
être long et laborieux, dépendant de la profondeur du traumatisme
et des dynamiques familiales en place. La prise
en charge ne parviendra à son terme qu'avec la mise
hors danger, la stabilisation émotionnelle et la normalisation des
conditions de vie de l'enfant au sein de son milieu familial.
Le processus de prise en charge doit être
individualisé et personnalisé. En effet, tout cas
nécessitant une mesure de protection met en évidence une
situation particulière de l'enfant affecté au regard de plusieurs
critères : son âge, la relation avec l'auteur, le type et la
durée de la situation de violence, abus et/ou exploitation, l'entourage
familial et communautaire et sa résilience. Le cas devrait être
d'abord reconnu en tant que cas singulier et traité de manière
individualisée et personnalisée. L'appui
psycho-social1740 à la victime et la reconstitution de
dynamiques familiales et communautaires positives seront au centre du processus
de prise en charge. L'outil central de la gestion des cas de protection
spécialisée pourrait être la médiation
familiale1741, qui se propose de reconstituer les liens et de
rétablir une dynamique familiale saine.
En sus, l'autorité administrative se doit d'organiser
les services de manière à assurer que les prestations minimum de
prise en charge soient disponibles et fonctionnelles. Elles seront
dispensées directement par les services sociaux avec, au besoin, le
concours de leurs partenaires agréés. Les prestations minimum
devraient être bien définies et précisées ; elles
devraient comporter à titre indicatif les éléments
suivants : l'accueil, l'écoute1742, l'ouverture de dossier,
la référence et le suivi de l'hébergement d'urgence en cas
de nécessité, la référence et le suivi de la
référence des soins d'urgence, si nécessaire ; la
recherche de la famille, au besoin, en collaboration avec la Police ou la
Gendarmerie et toute autre institution appropriée ; l'étude
personnelle et sociale de l'enfant ; la détermination d'un plan de prise
en charge ou de gestion du cas en concertation avec l'enfant et ses
responsables, comprenant
1740 CENTRE DE REFERENCE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE POUR
LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL, « Les interventions psychosociales ». In.
Manuel, Paramedia , Danemark 2010, pp.23-52. ; A titre d'exemple, voir
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE- REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE-
UNICEF, Guide de formation de base sur l'appui psychosocial en milieu
scolaire, 2011, 48p. 1741 La médiation est un mode pacifique de
règlement des conflits qui a pour but de faire intervenir une tierce
personne dans un différend opposant des individus ou des groupes. Il
s'agit pour la médiatrice d'aider les protagonistes à
régler par eux-mêmes leur litige, en rétablissant au
préalable entre eux la communication
1742 Commission Fédérale pour l'enfance et la
jeunesse (CFEJ)-Confédération Suisse, A l'écoute de
l'enfant. Le droit de l'enfant d'exprimer son opinion et d'être entendu.
Rapport de la Commission Fédérale pour l'enfance et la jeunesse
(CFEJ), CFEJ, Berne, novembre 2011 pp.33-57, DELFOS Martine F., De
l'écoute au respect, communiquer avec les enfants, Toulouse, ERES,
« Enfance et parentalité Su», 2007, pp.61-153.
616
des actions précises (accompagnement médical et
pour la réalisation d'expertises, prise en charge psycho-sociale,
médiation familiale, placement provisoire de l'enfant, conseil juridique
; prise en charge psychothérapeutique, psychiatrique, de santé
mentale, services d'assistance juridique) ; la mise en oeuvre des mesures ou
actions prévues dans le plan de prise en charge ou de gestion du cas ;
le suivi et l'évaluation puis la clôture du dossier.
Le recours à l'autorité judiciaire pour
l'application de mesures de protection s'avère aussi indispensable pour
assurer l'effectivité. En matière de protection de l'enfant, la
priorité devrait toujours être accordée à la
responsabilité des parents et au maintien de l'enfant dans son
environnement familial. Cette tâche, comme il a déjà
été dit, incombe aux services administratifs de protection de
l'enfant ayant l'expertise appropriée à la réalisation de
l'accompagnement des enfants et des familles vers une normalisation des
relations et une mise à l'abri de l'enfant des dangers.
La protection judiciaire joue un rôle subsidiaire par
rapport à l'autorité administrative1743. Ce rôle
se définit par la prise des décisions judiciaires qui s'imposent
aux parents et qui sont non négociables. La justice fonctionne pourtant
comme un recours pour les services de protection spécialisée. En
effet, le processus de résolution de certains cas de protection de
l'enfant se solde parfois par un échec ponctué par
l'épuisement de toute possibilité de médiation familiale ;
ce faisant, les autorités administratives se trouvent dans
l'incapacité de régler ces cas. Il en va ainsi dans les
hypothèses où les parents n'adhèreraient pas au processus
d'accompagnement et de changement suggéré par le service
administratif. L'enfant se retrouve dans une situation mettant en danger son
intégrité physique et psychologique et en conséquence, il
serait nécessaire de le soustraire de la situation d'abus par tout
moyen.
Il sera nécessaire de changer la garde de
l'enfant1744 lorsque le travail d'accompagnement de la famille
n'aboutit pas à un résultat. Dans ces circonstances, les
travailleurs sociaux doivent transmettre le cas directement aux
autorités judiciaires1745 par le truchement d'un
1743 CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF), «
Entre la prise en charge judiciaire et administrative. Deux points de vue
différenciés », Informations sociales 4/2007
(n°140), pp.96-103. 1744 GUIAVARCH (J.), La place des parents
dans le cadre de la protection de l'enfance, Mémoire professionnel
2012, p.32-44 ; MALAURIE (P.). et FULCHIRON (H.), Droit civil. Droit de la
famille, 5e édition, L.D.D.J., 2016, pp. 694-699.
1745 Par autorités judiciaires, nous entendons ici, le
Juge des enfants, le parquet ou le Commissariat
617
signalement formel pour la prise de mesures adéquates.
Dans les cas où le juge prononcerait une décision relative au
retrait de l'enfant et à son placement provisoire1746, il
serait indiqué que la mise en oeuvre de la décision de placement
soit confiée aux services de protection spécialisée qui se
chargeraient de trouver le placement le plus adapté.
Dans les cas où l'enfant est trouvé sur la voie
publique et nécessite un placement d'urgence, le recours dans les plus
brefs délais à l'autorité judiciaire devrait aussi
s'imposer comme une règle en la matière. Le recours à
l'autorité judiciaire s'imposerait aussi dans le cas où l'enfant
a perdu de facto la protection parentale et nécessite un
placement.
Au cours du processus de prise en charge de l'enfant, on
observe l'intervention d'une pluralité d'acteurs dans la prestation de
services : le système de santé, le système de la
protection spécialisée et le système judiciaire. En effet,
la protection de l'enfant relève concomitamment des professionnels de
santé pour les examens et les soins médicaux, des services
sociaux en charge de l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, de la
police pour une éventuelle enquête criminelle, du parquet
chargé de décider d'une éventuelle inculpation, du
système judiciaire enfin appelé, dans certains cas, à
appliquer des mesures protectrices à l'égard de l'enfant d'une
part, et à statuer sur la culpabilité ou l'innocence de l'auteur
présumé, d'autre part.
Le système de prise en charge mériterait
d'être modélisé et formalisé de manière
à assurer que les rôles et responsabilités de chaque
structure soient bien définies, que les relations de
référence et de contre-référence entre elles soient
claires et que chaque structure fonctionne de manière
complémentaire avec les autres. Ce système devrait
également se baser sur un partenariat institutionnel efficace, capable
de favoriser la coordination et la complémentarité des
différents intervenants et de garantir la continuité dans
l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, jusqu'à la
résolution du cas. Chaque institution n'est pas seulement chargée
de collaborer avec les autres structures, mais fait partie intégrante
d'un système. La finalité du système de prise en charge
est de répondre à l'impératif de protection et de
récupération de l'enfant victime et d'éviter la double
victimisation des enfants qui serait engendrée par l'absence de
coordination entre les institutions concernées : ce n'est pas l'enfant
qui doit
1746 GUIAVARCH (J.), La place des parents dans le cadre de
la protection de l'enfance, Mémoire professionnel 2012, p.14, (Pour
elle, le placement provisoire constitue une atteinte aux droits parentaux dans
le but de protéger l'enfant.).
618
s'adapter aux exigences des diverses institutions mais il
appartient à celles-ci de mettre au coeur de leurs actions,
l'intérêt supérieur de l'enfant par une véritable
prise en compte de ses besoins. Basé sur une coordination efficace, le
travail en réseau1747 apparait ainsi fondamental dans tout
processus de prise en charge et d'accompagnement au titre de la protection
spécialisée.
En sus, les enfants privés de protection parentale
devraient bénéficier d'un système de protection de
remplacement mis en place pour leur bien-être.
§ 2. LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE
SUBSTITUTION POUR LES ENFANTS PRIVES DE PROTECTION PARENTALE
La protection de remplacement est une mesure visant à
assurer la protection temporaire des enfants et à faciliter le retour
des enfants au sein de leur famille quand cela est possible1748.
Dans l'idéal, il s'agit donc d'une mesure temporaire. Il peut s'agir
d'une mesure de protection dans l'attente d'un regroupement
familial1749, par exemple pour des enfants migrants non
accompagnés ou séparés de leur famille1750.
Ici, l'objectif spécifique serait
1747 MERINI (C.), « Le partenariat en formation. »
In. BRODEUR (C.) et ROUSSEAU (R.), L'intervention de réseaux, une
pratique nouvelle, Montréal, Edition France-Amérique, 1984. (Il y
définit le réseau comme une connexion non stabilisée
d'opérations unies dans un système d'action ayant trait à
la question éducative et au problème commun que les partenaires
cherchent à résoudre) ; MERINI (C.), Le partenariat en
formation : de la modélisation à une application,
L'Harmattan, 1999. (Quant à M.C. GUEDON, il distingue le réseau
primaire et le réseau secondaire. Les réseaux primaires sont
« une entité collective, et non un enchainement de relations
focalisées sur un individu donné, tous les membres d'un
même réseau se connaissent les uns et les autres ; il s'agit d'un
groupement « naturel » d'individus, les liens unissant ces derniers
étant de nature affective, positive ou pas, plutôt que
fonctionnels » ; Il ajoute que les institutions sociales peuvent
être définies comme des réseaux secondaires basés
sur des liens entre les individus mais des liens uniquement fonctionnels. Ce
type de réseau est construit par les institutions en vue de
répondre à des exigences de nature fonctionnelle. Elle
précise que ces réseaux sont de type formel. Voir COMPAN (C.),
Le partenariat dans la protection de l'enfance : des enjeux identitaires et
organisationnels, Mémoire DEIS, Université Toulouse-Le
Mirail, 2012 p.27.
1748 ONU, Assemblée Générale (2010),
Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour
les enfants, A/RES/64/142, 24 février 2010, points 48 à 51.
; ONU, Comité des droits de l'enfant (2013), Observation
générale n°14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce
que son intérêt supérieur soit une considération
primordiale (art.3, para.1), CRC/C/GC/14, points 58 à 70.
1749 Sur le regroupement familial, voir BAUDET (V.), «
Regroupement familial : l'acharnement », Plein droit 1/2008
(n°76) p.366. ; DOLLAT (P.), Le droit de vivre en famille et le
regroupement familial en droit international et européen, RFDA
2009, p.698 s. SAROLEA (S.), Quelles vies privée et familiale pour
les étrangers ? R.Q.D.I., 2000, pp.247-285.
1750 ONU, Assemblée Générale, Convention
relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, art.22 ; ONU, Comité
des droits de l'enfant, Observation générale n°6 (2005),
Traitement des enfants non accompagnés et des enfants
séparés en dehors de leur pays d'origine, CRC/GC/2005/6,
1er septembre 2005, points 81 à 83.
619
d'assurer que les enfants privés de protection
parentale vivent dans un environnement familial et communautaire devant leur
permettre d'oublier l'absence de protection de remplacement. Mieux, cela
permettrait d'aboutir à une diminution sensible du nombre d'enfants ne
vivant pas dans un cadre familial.
On ne le dira jamais assez : tous les enfants ont le droit
fondamental de grandir dans leur famille d'origine, d'être
élevés par leurs parents et de n'être séparés
de leur famille qu'exceptionnellement dans les cas où cela soit
absolument nécessaire1751. Pour assurer ce droit fondamental,
il serait indiqué d'envisager tout d'abord, la mise en place de
stratégies de prévention de la séparation des enfants de
leur famille. Les interventions cibleront les mères et les familles
à risque de séparation ; elles porteront sur des actions de
soutien, y compris financier1752, aux parents pour qu'ils soient en
mesure d'assumer pleinement la responsabilité d'élever leur
enfants.
Des mesures devraient être prises afin de permettre aux
enfants privés de protection parentale1753 de pouvoir jouir
du droit de vivre dans un environnement familial.
Il importe de recourir à différentes formes de
protection de remplacement qui se substitueraient à celles qui
n'existent plus (A) ; mais cette protection de substitution devrait être
conditionnée par une meilleure implication des autorités
administratives et judiciaires (B).
1751 Art. 5 et 9 de la CIDE, « Les Etats parties
respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents
(...) de donner à l'enfant ; ONU, Conseil des droits de l'homme (2009),
Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour
les enfants, A/HRC/11/L.13, 15 juin 2009.
1752 CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE, Rapport « Aider
les parents à être parents »- Septembre 2002,
pp.156-160, disponible sur :
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000489.pdf
(Consulté le 05/06/2017); Une première série de
dispositifs de soutien à la parentalité fondé sur le
principe des incitations financières peut être identifiée
au sein des programmes de « transferts monétaires conditionnels
» ou (Conditional cash Transfers). Selon la banque mondiale, ces derniers
peuvent se définir comme « des subventions aux ménages
à condition qu'ils effectuent certains types d'investissements
prédéterminés dans le capital humain de leurs enfants
» (Cf. BANQUE MONDIALE, Conditional Cash Transfers : Reducing Present
and Future Poverty, Policy Research Report. 2009.
1753 Les enfants privés de protection parentale sont :
Les enfants ayant perdu de facto la prise en charge familiale, les enfants
victimes d'abandon anonyme, les enfants dont l'intégrité physique
et psychologique est en danger et ceux retirés de la famille par
l'Autorité judiciaire, les enfants séparés non
accompagnés de la famille du fait des conflits et autres
calamités naturelles.
620
A. LES DIFFERENTES FORMES DE SUBSTITUTION
SUSCEPETIBLES D'ETRE ENVISAGEES
Tenant compte de l'intérêt supérieur des
enfants privés de protection parentale, la priorité sera
accordée aux solutions temporaires dans un premier temps avant de
rechercher les solutions de nature définitive, et ce, suivant chaque cas
; en d'autres termes, non sans négliger les solutions
définitives, la priorité devrait être donnée aux
solutions de type familial.
Le placement temporaire1754 de l'enfant est une
mesure prise par l'autorité judicaire et mise en oeuvre avec le concours
de l'autorité administrative de protection de l'enfant. Elle vise
à organiser temporairement l'existence de l'enfant en prenant soin de
tous ses besoins et en préparant progressivement son retour dans sa
famille d'origine, nucléaire ou élargie.
Conscient que toute séparation de l'enfant d'avec ses
parents pose un problème de dynamique familiale, distension, sinon,
rupture des liens, démission parentale, le placement temporaire sera le
plus bref possible et se fera de préférence par des solutions de
proximité, soutenues par les règles coutumières de
solidarité communautaire1755 ponctuées par le
placement informel1756.
Dans l'attente de la réunion des conditions pour un
retour de l'enfant dans sa famille d'origine, des familles d'accueil formelles
seront organisées pour recevoir l'enfant. Le droit international
confirme que la prise en charge dans le cadre familial comme un placement dans
une famille d'accueil apparait être la forme la plus adaptée de
protection de remplacement garantissant la protection et le
développement de l'enfant. Ceci est confirmé par les Lignes
directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants
de l'ONU et la Convention de l'Onu relative aux droits des personnes
handicapées dont la Côte
1754 MESSAN (A.), « Le placement des enfants dans un
contexte de crise au Togo » In. Enfants
d'aujourd'hui-diversité-pluralité des parcours, colloque
international de Dakar (10-13 décembre 2002), n°11, Tome1, PUF,
2006, pp.195-203.
1755 A NTOINE (P.) et GUILLAUME (A.), « Une expression de
la solidarité familiale à Abidjan : enfants du couple et enfants
confiés », in : Familles d'aujourd'hui : démographie et
évolution récente des comportements familiaux, Paris, 1986,
pp.289-297. ; DELPECH (B.), « La solidarité populaire abidjanaise
en chiffres et en dires », Cahiers de l'ORSTOM, Série
Sciences Humaines, vol XIX, N°4, pp.551-566. ; JONCKERS D., « Les
enfants confiés » in Mélanges et Familles en Afrique :
Approches des dynamiques contemporaines, Les Etudes de CEPED n°15,
CEPED, ENSEA, ORSTOM, URD, 408p.
1756 Les lignes directrices des Nations Unies relatives
à la protection de remplacement pour les enfants traitent du placement
informel aux § 75 à 79 :
https://www.sosve.org/wp-media/uploads/2015/10/101012-UN-Guidelines-fr-WEB.pdf(consulté
le 22/08/2016).
621
d'Ivoire est signataire1757. D'ailleurs, s'agissant
de la situation de l'enfant handicapé, la CPRD déclare
expressément que « Les Etats parties s'engagent, lorsque la
famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant
handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la
prise en charge de l'enfant par la famille élargie, et si cela n'est pas
possible, dans un cadre familial au sein de la communauté
»1758
Le placement temporaire de l'enfant dans un centre d'accueil
privé ou public ne devrait être envisagé que comme solution
de dernier recours, si et seulement si, cette mesure correspond à
l'intérêt supérieur de l'enfant et/ou que d'autres
solutions alternatives de nature familiale ne sont pas disponibles et/ou
adaptées. En effet, le placement en dehors du foyer parental, comme un
éventuel placement en institution « devrait être
limité aux cas où cette solution est particulièrement
appropriée, nécessaire et constructive pour l'enfant
concerné et répond à son intérêt
supérieur »1759. Mieux, des efforts devraient
être consentis en vue d'éviter le placement des enfants en bas
âge en centre d'accueil.
Toutefois, dans toutes les hypothèses de
séparation et si cela s'avère nécessaire, il serait
opportun de garantir la continuité du contact entre les enfants et leurs
parents et de soutenir la réunification familiale dès que
possible.
Dans les cas où le retour de l'enfant dans la famille
d'origine s'avèrerait impossible, ce dernier serait placé
définitivement dans un cadre familial stable de substitution à
travers l'adoption qui constitue un moyen de protection important mais
subsidiaire de l'enfant privé de famille1760. Mieux, selon le
droit international, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être la considération primordiale dans les affaires
d'adoption1761. L'observation générale n°14 du
1757 ONU, Assemblée Générale (2010),
Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les
enfants, A/RES/64/142, 24 février2010, points 20 à 22 ; ONU,
Comité des droits de l'enfant (2006), Observation générale
n°7 (2005), Mise en oeuvre des droits de l'enfant dans la petite enfance,
CRC/C/GC/7/Rev.136 (b), 20 septembre 2006, point 18. ONU, Convention relative
aux droits des personnes handicapées (CPRD), 13 décembre 2006,
art.23 (5) (voir également art.7).
1758 ONU, Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CPRD), 13 décembre 2006, art.23 (5). 1759 ONU,
Assemblée Générale (2010), Lignes directrices relatives
à la protection de remplacement pour les enfants, A/RES/64/142, 24
février 2010, point 21.
1760 LAMMERANT (I.), « L'évolution et les enjeux
de l'adoption nationale et internationale » , journées de formation
pluridisciplinaire-Fondation Charles-Coderre 5,6 et 7 mai 2004,
R.D.U.S.n°35, 2005, pp.327-353. ; voir aussi LAMMERANT (I.),
L'adoption et les droits de l'homme en droit comparé, L.G.D.J.,
Paris et Bruylant, Bruxelles, 2001, n°s 75-76.
1761 Conférence de la Haye de droit international
privé, Convention de la Haye sur la Protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale, 29 mai 1993,
art. 1(a).
622
Comité des droits de l'enfant est à cet
égard pertinente car elle évoque le « droit de l'enfant
à ce que son intérêt supérieur soit une
considération primordiale »1762. L'adoption
plénière d'un enfant est une solution subsidiaire à
laquelle on ne saurait avoir recours que lorsque celui-ci est
définitivement privé de son milieu familial1763. Le
recours exceptionnel à l'adoption explique le fait que cette mesure doit
avoir comme finalité d'offrir une famille à l'enfant et non pas
l'inverse. En effet, la CIDE comme la Convention de la Haye du 29 mai 1993
relative à la coopération en matière d'adoption
internationale pose très clairement le principe de subsidiarité
de l'adoption par rapport au maintien de l'enfant dans sa famille
d'origine1764.
Ce faisant, l'adoption nationale1765 sera
priorisée, l'adoption internationale1766 devant rester une
solution de dernier recours, une fois épuisées toutes les
possibilités de faire adopter l'enfant par une famille ivoirienne.
Pour les enfants qui ne peuvent pas retourner dans la famille
d'origine et ne sont pas adoptables et/ou adoptés, l'Etat disposera d'un
réseau de centres d'accueil de petite taille, s'approchant dans leur
composition et leur fonctionnement le plus possible d'une famille, pour des
placements de longue durée.
Toutefois, pour atteindre les objectifs escomptés, le
rôle des autorités administratives et judiciaires se doit
d'être renforcé dans la mise en oeuvre de ces différentes
formes de protection de remplacement.
1762 ONU, Comité des droits de l'enfant (2013),
Observation générale n°14 (2013) sur le droit de
l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une
considération primordiale (art.3, para.1), CRC/C/GC/14, art.3,
para.1. 1763 MURRAT (P.), « L'évolution du droit de l'adoption en
Europe », in Le statut juridique de l'enfant dans l'espace
européen, 2004, Bruylant, p.119 et s. spéc. p. 125 et s.
1764 Article 4b de la Convention de la Haye. Pour la CIDE,
voir le préambule, les articles 7, 20-2 et 20-3 et 21-b.
1765 SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL, Evaluation du
système d'adoption nationale et internationale en Côte
d'Ivoire, mai 2010, 33p.
1766 CANTWELL (N.), « Adoption internationale-Commentaire
du nombre d'enfants adoptables et du nombre de personnes qui cherchent à
adopter au niveau international », Protection internationale de
l'enfant. La lettre des juges publiée par la Conférence de la
Haye de droit international privé, t. V., printemps 2003 aux
pp.69-73. ; PARA-ARANGUREN (G.), Rapport explicatif à la Convention
du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale. Bureau permanent de la
Conférence, La Haye, 1994, n°s 6-7. Pour les travaux
préparatoires, voyez aussi H. Van LOON, « Rapport sur l'adoption
d'enfants originaires de l'étranger » dans Conférence de
la Haye en droit international privé. Actes et documents de la
Dix-septième session 10 au 29 mai 1993, tome II, Bureau permanent
de la Conférence, La Haye, 1994 aux pp.10-119.
623
B. UNE PROTECTION DE SUBSTITUTION CONDITIONNEE PAR UNE
MEILLEURE IMPLICATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Dans le domaine de la protection de remplacement, les
autorités administratives chargées de la protection de l'enfant
exercent plusieurs missions de façon exclusive. Pour l'essentiel, ces
missions sont : le suivi permanent des services et institutions
hébergeant des enfants ; la mise en place des procédures
rigoureuses pour l'abri d'urgence, l'identification, la localisation et le
retour en famille des enfants trouvés sur la voie publique ;
l'organisation et la fourniture des ressources suffisantes pour la mise en
place des différentes options pour l'abri d'urgence, le placement
temporaire et le placement de longue durée, en donnant la
préférence à la mise en place de réseaux de
familles d'accueil et en utilisant le placement institutionnel comme dernier
recours ; la sélection, la formation et la supervision des familles
d'accueil ; la vérification de l'existence d'une ordonnance formelle de
placement pour tout enfant placé en dehors de sa famille ;
l'élaboration des normes et standards pour les différentes
modalités de protection de remplacement (familles d'accueil , centres
d'accueil ) ; l'organisation des processus d'adoption1767 par la
mise en place d'une autorité centrale1768 comme le fait le
Mali1769, pour les adoptions nationales et internationales et
relatifs aux mécanismes de surveillance ; la définition d'un
système de sanctions administratives pour les institutions publiques ou
privées qui fonctionneraient sans disposer
d'agrément1770 et/ou sans respect des normes et standards de
prise en charge ; la supervision de la sécurité, le
1767 LAVALLEE (C.), « L'adoption coutumière et
l'adoption québécoise : vers l'émergence d'une interface
entre les deux cultures ? », Revue générale de droit,
vol.41. n°2, pp.655-702. ;
1768 Actuellement, deux procédures d'adoption
coexistent en Côte d'Ivoire : les adoptions réalisées sous
le contrôle de la DPS et les adoptions « indépendantes »
qui sont un véritable système parallèle d'adoption. La DPS
a été créée en 2006 et l'adoption est entrée
dans la compétence de la DPS car elle est en charge des structures
sociales qui accueillent et protègent les enfants vulnérables,
parmi lesquels les enfants abandonnés. Or dans la mesure où ces
derniers ne devraient pas passer toute leur vie en institution, le
Ministère a décidé dans leur intérêt
supérieur, de leur trouver des familles adoptives. Cette décision
s'est traduite par un arrêté portant création d'un
Comité de placement familial logé à la DPS.
1769 Au Mali, la Protection et la promotion de l'adoption
internationale est assurée par la Direction nationale pour la Promotion
de l'Enfant et de la Famille (DNPEF) prise en sa qualité
d'Autorité Centrale. Il existe également une série
d'institutions publiques et privées d'accueil et de placement des
enfants qui peuvent faire l'objet d'une adoption filiation. Peuvent être
citées entre autres, la Commission nationale de l'adoption
internationale, le Centre d'accueil et de placement familial de Bamako
(Institution publique) et l'Association pour la Survie de la Mère et de
l'enfant (ASSUREME).
1770 On note malheureusement nombre de centre d'accueil pour
enfants qui fonctionnent sans un agrément dûment
délivré par les autorités compétentes
624
bien-être et le développement de tout enfant
privé de protection parentale et bénéficiant à ce
titre d'une protection de remplacement par la mise en place , d'une part, de
mécanismes de suivi et d'évaluation périodique du cas pour
les enfants placés dans les familles d'accueil et dans les centres
d'accueil , et d'autre part, de mécanismes de contrôle
périodiques des institutions accueillant des enfants.
Au plan local, les services en charge de la protection de
l'enfant disposeront de l'expertise nécessaire à la gestion de la
protection de remplacement. Ils travailleront en étroite collaboration
avec les services de placement, publics et/ou privés, avec
l'autorité policière (recueil de l'enfant, recherche des parents)
et l'autorité judiciaire. Ils veilleront à établir des
liens de collaboration avec tous les autres services devant apporter leur
contribution à la prise en charge temporaire et de longue durée
des enfants (services de santé et nutrition, services de
réhabilitation pour les enfants porteurs de handicap et autres).
Le concours des associations serait sollicité dans la
prévention de toutes formes de séparation familiale et dans
l'élaboration de perspectives de solutions, et ce, en parfaite
collaboration avec les autorités chargées de la protection de
l'enfant. Ces associations contribueraient ainsi à l'instauration
d'interventions en vue de :
- la sensibilisation des communautés et des parents sur
le droit de l'enfant à la vie familiale et communautaire, sur les
risques inhérents à la pratique du placement des enfants, sur les
conséquences néfastes de la vie en institution pour l'enfant et
la famille et sur la possibilité de fonctionner comme famille d'accueil
;
- l'identification et le soutien des familles à risque de
séparation et ;
- la facilitation de l'accueil temporaire de tout enfant, y
compris l'abri d'urgence, sous l'ordre et la supervision des autorités
de protection de l'enfant.
Les associations s'abstiendront de proposer toute forme
d'accueil avec hébergement des enfants en dehors des plans issus des
systèmes locaux de prise en charge des enfants élaborés
par les autorités compétentes.
Outre l'autorité administrative, le rôle de
l'autorité judiciaire dans la protection de remplacement devrait
être renforcé.
625
L'autorité judiciaire en charge de la protection de
l'enfant est la seule habilitée à décider et formaliser le
placement provisoire et le placement de longue durée et à rendre
définitive l'adoption d'un enfant à travers une décision
de justice1771. Pour ce faire, il convient de veiller à ce
que les services de protection spécialisée mettent à la
disposition de l'autorité judiciaire, toutes les informations pouvant
contribuer à la prise de décision du Juge. Le rôle de
l'autorité judiciaire devrait aussi s'étendre aussi au niveau du
contrôle des institutions qui hébergent des enfants à la
suite d'un placement.
Une autre mesure non moins importante passerait par l'adoption
de conditions plus efficaces de lutte contre l'impunité dans le cadre
des infractions commises à l'égard des enfants.
§ 3. DES CONDITIONS EFFICACES DE LUTTE CONTRE
L'IMPUNITE
Le renforcement de la lutte contre
l'impunité1772 se fera via une incitation au recours
systématique à la justice pour les infractions commises à
l'égard des mineurs (A) et la soumission des enfants
à des mesures de protection lors des poursuites des auteurs
d'infractions à leur égard (B).
A. UNE INCITATION AU RECOURS SYSTEMATIQUE A LA JUSTICE
Pour remédier à cette justice en panne, cette
mesure aurait pour objectif de soutenir le recours à la
justice1773 en matière d'infractions commises à
l'égard de l'enfant afin que les infractions pénales commises
à l'encontre de ceux-ci fassent l'objet de poursuite.
La répression pénale des infractions commises
à l'égard des enfants apparait inéluctablement comme un
aspect important de la lutte contre la violence ou les atteintes aux droits de
l'enfant. En l'absence de toute sanction appropriée, les comportements
abusifs aux
1771 CAPELETTI (D.), Accès à la justice et
Etat providence, Economica, 1984, p.48 et s.
1772 FIDH-LIDHO-MIDH, Côte d'Ivoire : La lutte
contre l'impunité à la croisée des chemins, 2013,
32p. ; KAPIAMBA (G.), « Le rôle des organisations non
gouvernementales dans la lutte contre l'impunité », In.
FONDATION KONRAD ADENAUER, La justice nationale et internationale dans la
lutte contre l'impunité en République démocratique du
Congo, Kinshasa, Fondation konrad Adenauer, décembre 2007,
pp.101-104. ; Résolution sur la lutte contre
l'impunité-CADHP/Rés.344 (LVIII).
1773 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association
Henri Capitant, 2011, p.590 ; FRICERO (N.), Les institutions
judiciaires, les principes fondamentaux de la justice : les organes de la
justice-les acteurs de la justice, Mémentos LMD, 2e
édition Lextenso, 2012, p.15.
626
antipodes des règles morales ou juridiques, en arrivent
à pervertir durablement les relations familiales et sociales et risquent
de perdurer et de se répandre.
Aujourd'hui, force est de reconnaitre que la plupart des
infractions commises contre les enfants aussi bien en période de guerre
qu'en période de paix ne font pas l'objet de poursuites. Cette absence
de sanctions judiciaires se doit à une multitude de facteurs. D'une
part, le droit coutumier1774 et les mécanismes informels de
résolution des conflits (justice des anciens)1775
prédominent souvent en milieu communautaire, car jugés plus
adaptés au maintien de la cohésion sociale. D'autre part, la loi
pénale reste ambiguë sur certains comportements abusifs
vis-à-vis de l'enfant, les justiciables ne font pas
régulièrement recours aux autorités judiciaires par manque
d'information, de moyens, de confiance et finalement le système de
justice ne traite pas systématiquement les cas de violence touchant les
enfants, sur la base de considérations d'opportunité et/ou de
pression communautaire.
Pour être un phénomène complexe et
très grave, l'impunité1776 mine l'objectivité
du droit. Elle ne peut être ni moralement ni juridiquement acceptable.
L'enjeu de la lutte contre l'impunité est la propre existence de l'Etat
de droit qui implique une application réelle des règles de droit
sans aucune exception, et le sentiment de sécurité des
populations. Que vaudraient les droits de l'enfant sans l'Etat de droit,
entendu dans son aspect concret, ou opérationnel ? Au-delà de la
proclamation des droits fondamentaux dans les ordres juridiques nationaux,
« le véritable test de l'Etat de droit se trouve dans
l'existence d'une panoplie de procédures et de recours, appuyée
sur des institutions, permettant à la victime d'une violation d'obtenir
qu'il y soit mis fin et qu'il obtienne une indemnisation le cas
1774 LE ROY (E), « La coutume et la réception des
droits romanistes en Afrique noire », In. Bulletin de la
société Jean Bodin pour l'histoire comparative des
institutions, Bruxelles, De Boeck université, tome 51 : « La
coutume », 1990, p.117-150. Droit et Société 51/52, 2002 ;
LE ROY (E.), « La formation du droit coutumier », in LE ROY (E.) et
WANE (M.) « La formation des droits non étatiques »,
Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome 1 L'Etat et le Droit,
chap. XV, 1982, p.371.
1775 BINET (J.), Afrique en question. Paris. Mame,
1965, p.156 et GONIDEC (P.F), « La place des traditions dans l'appareil
d'Etat » in Encyclopédie Juridique, Tome 1, L'Etat et le
Droit, 1982, p.233.
1776 JOINET (L.) (dir.), Lutter contre l'impunité.
Dix questions pour comprendre et pour agir. Ed. La découverte sur
le vif, mars 2002, 144p. ; MARIA DOS REMEDIOS FONTES SILVA, « La
question de l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme
», Principios V.6 (1998) : 139-145. ; ANDREU-GUZMAN FEDERICO, «
Impunité et droit international. Quelques réflexions
historico-juridiques sur la lutte contre l'impunité »,
Mouvements 1/2008 (n°53), p.54-60.
627
échéant »1777. Sous la
diversité des expressions, l'idée maitresse est que le droit pour
un citoyen d'obtenir d'un juge la défense de ses droits, constitue le
noyau de l'Etat de droit, la condition de son effectivité. Il est
l'outil qui permet à l'Etat de droit, à la fois, d'exister et de
fonctionner car « la dimension procédurale de l'Etat de droit a
permis d'optimiser la protection des droits et libertés et elle a
logiquement eu pour conséquence de revaloriser l'office du juge
»1778. Pour l'enfant victime, l'impunité traduit
une absence de points de repère et induit l'impossibilité de se
structurer par rapport aux évènements. De plus, il est
prouvé qu'en dépit de son caractère éprouvant, une
procédure judiciaire répondant aux attentes de la victime,
achève d'avoir une influence positive dans son processus de
reconstruction et notamment en ce qui concerne l'estime de soi.
Ainsi, en vue d'une lutte efficace contre l'impunité
aux fins de faire régner un véritable Etat de droit, plusieurs
conditions cumulatives et indispensables doivent être réunies : la
définition claire et précise des infractions commises contre
l'enfant, l'accès des justiciables à la justice1779 et
un meilleur fonctionnement de l'Institution judiciaire. L'atteinte de ces
objectifs fondamentaux doit être constamment au coeur des politiques
sectorielles de sécurité et de la justice en Côte
d'Ivoire.
Les acteurs de la protection de l'enfant doivent jouer leur
partition dans l'atteinte de ces objectifs ; Concrètement, ils doivent
faciliter la compréhension par les populations, de la
nécessité de recourir aux institutions judiciaires et d'exiger
des procédures efficaces en matière de justice. Pour ce faire,
les acteurs doivent renforcer leur contribution à la vulgarisation et
à la diffusion1780 des textes de loi en vigueur, à la
sensibilisation des autorités
1777 MORIN (J-Y), « l'Etat de droit : émergence
d'un principe du droit international », In. Recueil des Cours de
l'Académie de Droit international (RCADI), 1995, p.28.
1778 CAPPELLETI (M.), Le pouvoir des juges,
Economica, collection Droit public positif, 1990, p.397. Voir aussi GARAPON
(A.), La question du juge, Pouvoirs, 1995, n°74, p.13-26.
1779 Pour le Professeur J. MORAND-DEVILLERS, Le droit
d'accès au juge indique « la place de l'Etat de droit au sein d'une
société », voir, son ouvrage, MORAND-DEVILLERS (J.),
Cours de droit administratif, Motehres Tien, Paris, 2005, pp.706-709.
; GUIMDO DOGMO (B-R), « Le droit d'accès à la justice
administrative au Cameroun. Contribution à l'étude d'un droit
fondamental », In. Revue africaine des sciences juridiques (RASJ), vol
4, n°1, 2007, p.171. ; SAWADOGO (F.M.), « L'accès
à la justice en Afrique francophone : Problèmes et perspectives.
Le cas du Burkina Faso ». RJPIC, n°2, 1995, p.168.
1780 TAGODOE (A.), « Diffusion du droit et Internet en
Afrique de l'Ouest », Lex Electronica, vol.11,
n°1(Printemps/Spring 2006, disponible
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/tagodoe.htm
( Consulté le 21/06/2017).
628
traditionnelles et des communautés aux objectifs
poursuivis par le droit positif1781, à soutenir et appuyer
les familles dans leurs démarches auprès des organes de justice,
par le biais du conseil juridique et de l'assistance psychosociale.
Bien que la répression apparaisse comme un aspect
fondamental de la question, tout cas de protection de l'enfant
consécutif à une violation ou une violence à son
égard ne saurait se limiter à l'application d'une sanction
à l'auteur de l'acte incriminé. Qui plus est, peuvent être
aussi dévastateurs pour l'enfant que la commission de l'infraction
elle-même, des actes préparatoires ou des comportements
antérieurs à la commission. Cette mise en garde apparait plus
qu'opportune afin de faire primer l'intérêt en toute circonstance
et que la priorité soit pareillement accordée à la prise
en charge du traumatisme de l'enfant.
Déclinée dans les conditions
sus-évoquées, la sensibilisation au recours à la justice
pour les infractions commises à l'égard des mineurs contribuerait
à la lutte contre l'impunité. Cette lutte devrait aussi prendre
en compte la protection des enfants au cours des procédures de poursuite
des auteurs.
B. LA SOUMISSION DES ENFANTS A DES MESURES DE
PROTECTION LORS DES POURSUITES
Il s'agira ici de protéger les enfants participant
à des procédures judiciaires en qualité de victimes contre
l'effet dévastateur de la double victimisation.
Le recours à la justice et le droit à une
procédure judiciaire respectueuse des besoins de l'enfant doivent
être véritablement des voies de droit ouvertes et
disponibles1782 pour tout
1781 HENRI CAPITANT définit le droit positif comme
étant « le droit qui est en vigueur » (CAPITANT (H.),
Introduction à l'étude du droit civil, 4e
édit., Paris, 1925, p.32. ; JULLIOT DE LA MORANDIERE le définit
comme « le droit appliqué en fait », « l'ensemble des
faits qui gouvernent en fait à une époque donnée une
société humaine déterminée » (Introduction
à l'étude du droit civil français, Paris, 1951,
p.173). ; Carbonnier le définit comme « le droit effectivement
appliqué dans l'Etat et dans le moment où l'on se trouve »(
Droit civil, 1935, p.24.) ; Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD le
définissent aussi comme l' « Ensemble des règles juridiques
en vigueur dans un Etat ou dans la communauté internationale, à
un moment donné, quelle que soit leur source. C'est le droit «
posé », le droit tel qu'il existe réellement ». Cf.
GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques,
23e édition, Dalloz, 2015, p.402-403.
1782 Selon la jurisprudence Anuak Justice Council c.
Ethiopie ( Com./299/2005), la Commission considère qu'un recours
est disponible « si le requérant peut le poursuivre sans
empêchement ou s'il peut l'utiliser dans les circonstances entourant son
cas » En un mot, il s'agit de s'assurer que le recours est sans entrave,
qu'il est actuel et comporte en son sein les éléments de son
opérationnalité.
629
enfant victime. En un mot, la justice pénale doit aussi
protéger et respecter les enfants en leur qualité de victimes.
Pour assurer la protection judiciaire des enfants victimes,
l'institution d'un système juridique global et cohérent
s'avère fondamentale. En effet, les procédures judiciaires
doivent être engagées dans des conditions propices au respect de
la dignité de l'enfant. Elles doivent être déployées
de sorte à éviter d'infliger une expérience grave et
traumatisante à l'enfant victime. Dans ces procédures, devront
être prises sérieusement en compte, le traumatisme1783
résultant de l'abus1784, l'état de stress de la
victime et de ses parents ainsi que la nécessité de
protéger la sécurité et la vie
privée1785 des victimes et de leurs familles. En effet,
l'absence ou la non application de procédures policières et
judiciaires spécialisées et appropriées entrainerait une
double victimisation de l'enfant et l'intensification de son traumatisme. Dans
cette perspective, il apparait impérieux que le système juridique
national inclut ou incorpore des dispositions procédurales visant
à protéger la dignité, la vie privée et la
sécurité de l'enfant victime. En particulier, les
procédures d'audition1786 de l'enfant devront non seulement
être réduites au maximum, mais aussi préserver les
conditions de confidentialité et être pilotées par des
professionnels spécialement formés à cette fin et assurer
qu'il n'y ait pas de contact de l'enfant avec l'auteur
présumé.
1783 OQUENDO, Maria A., MILLER, Jeffrey, M., SUBLETTE,
Elizabeth, « Neuroanatomical Correlates of Childhood sexual abuse:
identifying biological substrates for Environmental effects on clinical
phenotypes » in The American Journal of Psychiatry, 2013, Vol.
170, Issue 6, p.574-577.
1784 PUTNAM (F.), « Ten-Year research update review :
child sexual abuse », in Journal of the American Academy of child and
adolescent psychiatry, Mars 2003, vol.42, Issue 3, p.269-278. ; TERR,
LENORE (C.), « Childhood traumas: an outline and overview » in
America Journal of Psychiatry, Janvier 1991, Vol. 148, Issue 1,
p.10-20.
1785 Article 10 : « Aucun enfant ne peut être
soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie
privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des
atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant
entendu que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle
raisonnable sur la réputation, étant entendu que les parents
gardent le droit à la protection de la loi contre de telles
ingérences ou atteintes ». Sur la notion de vie privée, lire
IVANA ROAGNA, « La protection du droit au respect de la vie privée
et familiale par la Convention européenne des droits de l'homme »,
Série des précis sur les droits de l'homme, n°1
Direction générale des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 2012, 116p.
1786 BERTHET (G.), MONNOT (C.), « L'audition du mineur
victime. Recueil de la parole de l'enfant par la police », Enfances
& Psy 3/2007 (n°36), p.80-92 disponible sur
www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2007-3-page-80.htm. (Consulté
le 21/03/2017); CREMIERE (M.), L'audition de l'enfant victime, in Journal
du droit des jeunes, 2013/7 (n°327), pp.40-51.
630
CONCLUSION DU TITRE 2
A l'état actuel, deux éléments majeurs
font obstacle à une appréciation objective des
phénomènes de violations et de violences touchant les enfants.
D'une part, les pesanteurs socioculturelles qui s'imposent aux
acteurs font que des nombreuses formes de violations à l'égard de
l'enfant ne sont pas perçues en tant que telles et font l'objet de
déni. La plupart des formes de violences contre l'enfant, en particulier
les châtiments corporels et l'exploitation dans le travail, continuent
d'être considérées comme légitimes, les mutilations
génitales féminines, comme nécessaires, la violence
sexuelle comme inexistante. Il s'agit ici d'amener les acteurs à une
considération exacte de la nocivité des actes et comportements
abusifs, des mobiles et intentions de ces actes et de leur impact sur le
développement de l'enfant, sur les relations familiales et sociales et,
en dernière instance, sur le capital humain, l'état de droit et
le développement.
D'autre part, l'absence d'analyses quantitatives et
qualitatives approfondies de l'ampleur et de la nature des violations à
l'encontre des enfants ne nous permet pas de connaître l'incidence et la
prévalence réelles de la violence qui touche les enfants ni
d'appréhender en profondeur ses diverses manifestations. Les
études nationales dans ce domaine sont extrêmement limitées
et fragmentaires, soit pour ce qui est de la description de la nature
diversifiée des phénomènes qui s'y rattachent que de leur
ampleur. Un système complet de suivi des phénomènes de
violations touchant les enfants et leurs droits n'est pas encore en place. Les
taux de signalement aux organes chargés de l'application de la loi et
/ou aux services sociaux est de toute évidence extrêmement faible.
Par conséquent, les cas recensés par les services de police, de
justice et les services sociaux sont très limités et non
systématisés. Qui plus est, parmi les comportements constitutifs
de maltraitance de l'enfant, ce sont seulement les plus extrêmes qui sont
portés à la connaissance des autorités, en particulier les
abus sexuels perpétrés par des adultes extérieurs à
la famille et à la communauté.
Malgré cette situation, les quelques études
disponibles et l'observation des praticiens de l'action sociale, de la
sécurité et de la justice, tout comme des associations qui
travaillent dans la protection de l'enfant démontrent que les
phénomènes de maltraitance, abus sexuel et exploitation des
enfants sont alarmants et répandus.
631
Partant des multiples facteurs juridiques, institutionnels,
socio-économiques et culturels qui déterminent l'occurrence des
atteintes aux droits de l'enfant, expression d'une importante
ineffectivité de ces droits, les propositions qui ont été
exposées s'efforcent d'apporter une réponse aux facteurs directs
et immédiats qui expliquent l'occurrence des atteintes aux divers droits
de l'enfant. Ces propositions de réponse s'articulent autour des actions
de prévention, de détection, d'assistance et de protection
judiciaire à tout enfant victime de ces violations et abus.
Ces propositions indiquent clairement les orientations
fondamentales pour continuer à construire un système de
protection adapté aux réalités juridiques,
économiques, sociales et culturelles de la Côte d'Ivoire, tout en
respectant les engagements internationaux. Elles proposent des solutions pour
dépasser les défis et les difficultés actuels. Partant des
défis posés par la question de l'effectivité des droits de
l'enfant en Côte d'Ivoire, Elles indiquent des solutions innovantes,
réalistes et potentiellement efficaces. Ces propositions s'inscrivent
dans la logique de complémentarité des politiques et
stratégies sectorielles devant intervenir dans le cadre d'une
stratégie globale de protection sociale. Mais la formulation de
propositions n'est pas une solution miracle. Elle est un instrument de travail
et nécessite désormais de procéder résolument
à son appropriation, voir son adoption par les pouvoirs publics, les
acteurs non étatiques oeuvrant pour la cause des droits de l'enfant,
ainsi que la population ivoirienne dans son ensemble. Toutes les parties
intéressées au mieux-être de l'enfant devront assumer
effectivement les tâches qui leur reviennent, tout en renonçant
à certaines actions irresponsables qui minent parfois la
réalisation des objectifs communs. En mettant en oeuvre de façon
efficace les diverses mesures législatives et administratives contenues
dans cette analyse, la Côte d'Ivoire avancera vers un pays où la
famille, la communauté et l'Etat assument leur devoir de protection
vis-à-vis de l'enfant sans ambiguïtés.
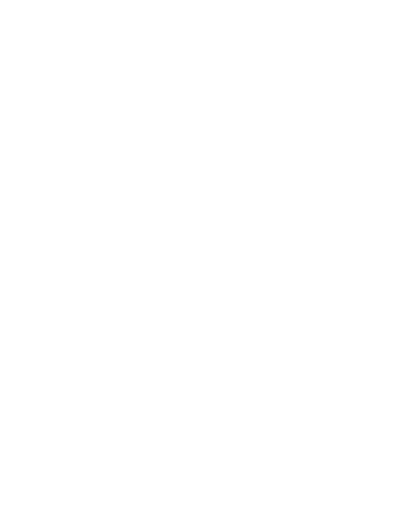
633
CONCLUSION GENERALE
Cette étude a permis de renouveler le débat
autour de la trop controversée notion de droits de l'enfant à
cette époque où les droits de l'homme connaissent un regain
d'intérêt. Elle a abouti à l'appréhension de son
sens et de son contenu aussi bien théorique qu'empirique.
Tels que définis et encadrés par les instruments
internationaux les concernant et précisés par les textes
nationaux, les droits de l'enfant ont fait l'objet d'une adaptation nationale
à la suite de leur ratification ou de l'adhésion de la Côte
d'Ivoire à ces instruments.
L'architecture actuelle de la protection de ces droits telle
qu'elle est élaborée par les autorités nationales permet
d'en donner une vision formelle susceptible de rendre crédible
l'exercice d'une telle protection. Des mécanismes de garantie prescrits
par les normes internationales mises en oeuvre à travers un dispositif
institutionnel complexe et souvent fort éloignée de la dimension
concrète de ces droits , renforce le formalisme de cette protection. La
recherche tente de montrer que, par le simple effet de la participation de la
Côte d'ivoire à ces normes et de leur réception nationale
selon les procédures requises et au moyen de garanties
appropriées, l'effectivité des droits de l'enfant pourrait
être considéré comme réalisée.
Il n'en est rien. Certes, l'un des grands enjeux de la
question de l'effectivité des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire
réside d'abord dans la reconnaissance nationale de l'ensemble des normes
proclamant ces droits et assurant leur protection. Les analyses qui viennent
d'être développées se sont dès lors attachées
à suivre le « fil d'Ariane » que représente la question
fondamentale de l'intégration dans le droit national ivoirien de ces
normes internationales de protection.
Les deux moments essentiels de cette intégration qui
constituent autant de « cailloux blancs » pour le petit poucet
observateur ressortent clairement de ce qui vient d'être dit, à
savoir : une phase de participation internationale de la Côte d'Ivoire
aux divers instruments internationaux, universels et régionaux, et une
seconde dite de détermination nationale, au cours de laquelle les
634
droits internationaux font l'objet d'une transcription
nationale, placée sous le respect des exigences constitutionnelles du
pays. De même, des mesures nationales d'accompagnement, notamment d'un
point de vue juridique et institutionnel sont prises pour traduire la
réalité juridique de l'existence de ces droits dans le droit
ivoirien.
Il n'est pas contestable pour autant que cette « image
juridique » qui peut attirer le respect devant l'importance des
engagements et la volonté de leur concrétisation n'est pas des
plus nette. Ne permettant qu'une présentation théorique, elle est
marquée par d'importantes limites quant à l'impact de ce
système juridique des droits de l'enfant sur la réalité de
leur respect.
L'analyse par l'étude du jeu des divers acteurs de la
protection, étatiques et non étatiques, le contexte de crise qui
a profondément et probablement, durablement marqué le pays au
cours des dernières années, conduisent dès lors à
soumettre cette approche formelle aux constatations du terrain. A cet
égard, les manifestations diverses des atteintes multiformes aux droits
de l'enfant, que celles-ci soient d'ordre général comme la
banalité du quotidien le montre souvent, ou qu'il s'agisse plus
gravement des violations envers des droits particulièrement
protégés, c'est le constat d'ineffectivité qui tente
à s'imposer. Il est vrai que pour une catégorie vulnérable
du droit telle que l'est celle des enfants, tous les droits qui leurs sont
reconnus, soit directement, soit par la voie d'obligations à la charge
des Etats, tous les droits doivent être considérés comme
protégés. Néanmoins, le Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants
dans les conflits armés, envisage une protection spéciale soumise
au contrôle international et qui devrait à ce titre être
respecté. L'on est cependant en cette matière, au vu de
l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et des soubresauts
sociopolitiques d'une grande partie de l'Afrique de l'ouest, très loin
de la réalité concrète. Il en est de même de la
situation évoquée au plan régional par la charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant qui prévoit
également une protection spéciale élargie aux cas
très divers d'enfants en conflit avec la loi, enfants des rues ou
enfants dans les rues selon les conceptions, enfants subjugués par des
situations décrites dans l'étude, à l'extérieur ou
à l'intérieur des institutions d'encadrement et en tant que tels
susceptibles d'être en danger, devraient conduire à une protection
renforcée.
635
Or, cette réalité d'ineffectivité traduit
le fait que des lacunes importantes existent toujours dans la prise en charge
des enfants en Côte d'Ivoire, dans le cadre de leur famille relativement
instable ou démunies, dans le cadre des établissements d'accueil,
dans la rue, et même lorsque l'Unicef intervient dans certaines
circonstances, dans le centre de transit et de réinsertion qui sont
mises en place. Les scandales d'agression sexuelle d'enfants ou
d'enlèvement et assassinats d'enfants continuent de défrayer la
chronique et l'on ne peut faire que le constat de l'impuissance de l'ensemble
de la société à agir.
Le second enjeu de la question étudiée apparait
donc ici clairement dans la mesure où elle conduit à
apprécier l'effectivité des droits de l'enfant à
l'épreuve des réalités locales. Les manifestations que
décrit la recherche montrent les limites de cette effectivité
mais, elles conduisent également au crible du concret de
préconiser un certain nombre de mesures qui pourraient renforcer
l'application efficace des règles de protection et renverser ainsi le
prisme négatif de l'ineffectivité.
Le « fil d'Ariane » qui aura servi de fil conducteur
de l'analyse débouche ainsi, à la manière du
théâtre d'ombre que constitue le « mythe de la caverne »
de Platon à une nouvelle étape qui marquerait, dans le cadre de
nouvelles institutions politiques et sociales de la Côte d'Ivoire, un
nouveau départ pour les droits de l'enfant. Du moins, peut-on
l'espérer !
636
ANNEXES :
(Extraits de : BUREAU INTERNATIONAL DES DROITS
DE L'ENFANT, L'état des lieux de la formation des Forces de
sécurité aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire,
Rapport final décembre 2012, p.90 ( Annexe1) et p.34 ( annexe2).).
Annexe 1 : Processus de résolution de conflit ou
de problème au niveau communautaire
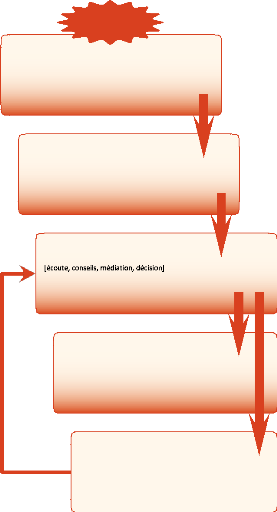
FAMILLE
[soins médicaux, médiation et
négociation]
FAMILLE ÉLARGIE/VOISINS
CHEF COMMUNAUTAIRE
CHEF DE CANTON
[délibération]
Abus sur l'enfant
POLICE
[enquête, conseils, arrangement6 à
l'amiable, ouverture d'un dossier ?]
si la crise continue/grave
si la crise continue/grave
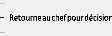
Promesse de changer
Procédure pénale (rare)
Résultats possibles: Enfant guéri
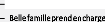

Promesse de changer Séparation temporaire
[soins médicaux, médiation et
négociation]
mère et enfants
Engagement publique
Sanction officielle
(Seulement des cas très sérieux
arrivent
aux chefs, y compris,
mais pas toujours, les viols)

Plainte de la victime
partie
Constat par les FS
Plainte la victime
et Police Nationale SDLTEDJ
auditions et PV)
Gendarmerie
OPJ
par les FS
638
Annexe 2 : Protection des enfants victimes au contact
des forces de sécurité
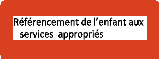
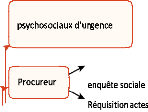
Réquisition
Soins médicaux et
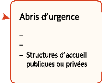
Communauté ONG
médico-légal

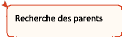
639
Annexe 3 : Questionnaire adressé aux populations
et acteurs de la
protection des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire
Questions introductives/ questions
générales
1. Une étude sur l'effectivité des droits de
l'enfant en Côte d'Ivoire vous parait-elle opportune ? Dans
l'affirmative, quel est selon vous l'intérêt d'une telle
étude ?
2. Quelles sont selon vous les progrès accomplis par
l'Etat de Côte d'Ivoire pour se conformer à la Convention relative
aux droits de l'enfant et aux textes pertinents relatifs aux droits de
l'enfant?
3. Connaissez-vous le cadre juridique et institutionnel de
reconnaissance et de protection des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire ?
Si oui, citez nous les instruments internationaux ou nationaux ainsi que les
institutions de protection de l'enfance que vous connaissez ?
4. Existe-t-il des juridictions spécialisées en
charge des questions de l'enfance en Côte d'Ivoire ? Si oui,
décrivez nous leur composition et fonctionnement ?
5. Quel est l'état des droits de l'enfant en
Côte d'Ivoire ?
6. Quelles sont les lacunes principales constatées au
niveau du système ivoirien de de protection des droits de l'enfant ?
7. Quel est l'état des droits civils et politiques de
l'enfant en Côte d'Ivoire ?
8. Quel est l'état des droits économiques,
sociaux et culturels de l'enfant en Côte d'Ivoire ?
9. Quelles sont les causes de l'ineffectivité des
droits civils et politiques de l'enfant en Côte d'Ivoire ?
Considérer individuellement chaque droit.
10. Quelles sont les causes de l'ineffectivité des
droits économiques et sociaux et culturels de l'enfant en Côte
d'Ivoire ? Considérer individuellement chaque droit.
11. Quels sont les défis en matière de
protection effective des mineurs en Côte d'Ivoire ?
12. Quelles sont selon vous, les recommandations utiles pour
une effectivité réelle des droits de l'enfant en Côte
d'Ivoire ?
13. Depuis 1991, année de ratification par l'Etat de
Côte d'Ivoire de la CIDE, le juge interne ivoirien a-t-il prononcé
une décision faisant expressément mention de violation des droits
de l'enfant en Côte d'Ivoire ?
14. Quelles sont les différentes formes de violations
de droits de l'enfant observées en Côte d'Ivoire tant en
période normale qu'en période de conflit armé ?
15. Selon vous, la protection des civils englobe-t-elle la
protection de l'enfant ou la protection de l'enfance devrait-elle être un
mandat autonome?
16. Les forces de sécurité ont-elles une
stratégie de protection de l'enfance pour l'intégration de la
protection des enfants dans l'accomplissement de leur mandat ? Si tel est le
cas, quelles sont les fonctions opérationnelles et les actions que l'on
attend d'elles à l'appui de la protection de l'enfance?
17. Quels sont, selon vous, les principaux défis
politiques dans la hiérarchisation de la protection des enfants, compte
tenu des contraintes de ressources et de l'élargissement des mandats des
forces déployées?
18. Quelles sont les normes minimales en matière de
protection de l'enfance auxquelles les Etats doivent se conformer?
19. Quel type de formation centrée sur la protection
de l'enfant est proposée aux acteurs étatiques en charge de la
protection de l'enfance et les forces armées (militaires, police,
gendarme) dans le cadre de leur formation préalable à leur
entrée en fonction et dans le cadre de leur formation continue?
20. Comment les autorités compétentes
vérifient-t-elles si une telle formation a été
effectuée, répond aux normes et, plus important encore, si le
personnel est capable d'appliquer les concepts de manière
substantielle?
21. Quelle est la feuille de route pour
opérationnaliser et consolider l'architecture de protection de l'enfance
au niveau du Gouvernement ?
640
Mandat d'influence
22.
641
Qui conçoit le mandat d'une mission de protection de
l'enfant au niveau de la Côte d'Ivoire ?
23. Le ministère en charge des droits de l'enfant
dispose-t-il d'une équipe de planification multidisciplinaire et
intégrée? A t-il des politiques et des directives
opérationnelles et des directives pour l'aider dans la phase de
planification?
24. Quel est le processus actuel de planification de la mission
et quels sont les acteurs clés?
25. Existe-t-il un système d'alerte rapide en
matière de violations des droits de l'enfant ? Comment fonctionne le
système d'alerte rapide ? Quel type d'information sur les
problèmes de protection de l'enfant inclut-il?
26. Quel est le processus de collecte de données sur les
atteintes aux droits de l'enfant?
27. Y a-t-il des préoccupations en matière de
protection de l'enfance?
Diligence raisonnable et
vérification
28. La direction de la protection de l'enfance a-t-elle ses
propres politiques de diligence raisonnable et de vérification? Sinon,
s'appuie-t-elle sur la politique de diligence raisonnable du Gouvernement
ivoirien ?
29. Existe-t-il des politiques / directives normalisées
à suivre par l'Etat pour vérifier les acteurs de la protection de
l'enfance dans chaque région ?
30. Quel rôle joue la Direction de la protection de
l'enfance pour s'assurer que les processus de diligence raisonnable et de
vérification au niveau des acteurs de la protection de l'enfance sont
menés et comment vérifie-t-il s'ils ont été
entrepris?
Reddition des comptes et responsabilité des
acteurs déployés
31. Quels sont les facteurs pris en compte par l'Etat dans
l'élaboration du contenu des accords sur le statut des acteurs de
protection de l'enfance et le statut de leurs missions?
32. Quel type d'accord / de documentation existe-t-il pour
lier les acteurs de la protection de l'enfance à l'Etat ? Quelles sont
les dispositions disciplinaires et de conduite, le cas échéant,
dans les protocoles d'accord? Que couvrent-ils et qu'est-ce qu'ils excluent?
33. Quels mécanismes existent au niveau de l'Etat
ivoirien pour surveiller de manière proactive la discipline et la
conduite des acteurs de la protection de l'enfance sur le terrain ?
34. Existe-t-il un mécanisme au niveau de la
Côte d'Ivoire pour suivre les rapports des Ongs et agir en
conséquence?
35. Dans une situation où un acteur de la protection
de l'enfance est auteur d'une violation grave aux droits d'un enfant sous sa
responsabilité ou en raison d'une mauvaise conduite condamnable à
l'égard de l'enfant, quel rôle joue les autorités
compétentes pour s'assurer que ces personnes sont tenues responsables de
leur conduite? Existe-t-il un mécanisme au niveau de l'Etat pour assurer
le suivi de ces cas jusqu'à leur finalisation?
36. Existe-t-il des politiques qui interdisent aux acteurs
fournisseurs de services de fournir des services si ces acteurs ne sont pas
disposés à poursuivre les membres de leur personnel
impliqués dans des abus pendant leur mission? Si oui, quels sont-ils?
37. Le Ministère de l'enfance tient-il une base de
données du personnel étatique ou non étatique
déployé par les différents acteurs et qui serait
impliqué dans des atteintes aux droits humains de l'enfant alors qu'il
était en service?
38. Comment l'Etat interagit-il avec les Ongs disposant de
cellule de suivi, d'analyse et de réponse des enfants victimes de
diverses atteintes ?
642
Ministère de la justice ; Ministère de
la défense
39.
643
Quelle est la politique de votre ministère en
matière d'assistance aux enfants victimes en période normale ou
en période de conflits armés?
40. Quelles sont les politiques et procédures à
suivre en cas de violation des droits de l'enfant dans le pays d'origine?
41. Quels sont les mécanismes en place pour aider les
plaignants? Les plaignants peuvent-ils déposer de telles plaintes de
manière anonyme par peur de représailles? Existe-t-il des
mécanismes spéciaux mis à la disposition du public pour
aider les enfants qui pourraient être des plaignants (assistance
juridique, protection des témoins, accès à un soutien
psychosocial, etc.)? Si oui, pouvez-vous les décrire?
42. Quelles sont les politiques et procédures à
suivre si la violation a eu lieu dans un autre pays mais que le pays a
compétence sur l'auteur de l'infraction?
43. Le personnel du ministère de la Justice a-t-il
déjà fait partie d'équipes d'enquêtes nationales
envoyées en mission pour enquêter sur des allégations de
pratiques ou de conduites attentatoires aux droits de l'enfant ? Si oui,
veuillez décrire qui a été déployé et les
activités entreprises ?
44. Les mécanismes existant ont-ils déjà
été utilisés pour poursuivre un membre des forces
armées pour une violation contre un enfant (ou même une violation
de l'exploitation et des abus sexuels)?
45. Existe-t-il un système d'aide juridique fournie
par l'État ivoirien aux enfants étrangers qui n'ont pas les
moyens ou l'accès à une telle assistance juridique?
46. Le ministère de la Justice tient-il un registre
des membres des forces armées, de la police et des civils reconnus
coupables de crimes liés aux enfants ou susceptibles d'infliger des
dommages aux enfants afin de contrôler les futurs
déplacés?
État-major des armées
47. L'armée dispose-t-elle d'un code de conduite qui
traite explicitement des questions de protection de l'enfance?
48. Si un tel devoir existe, pensez-vous que cela est
effectué avec diligence par les commandants de la force ou les chefs de
contingents militaires nationaux déployés? Quels facteurs peuvent
interférer avec cette obligation?
49.
644
À quelle fréquence les chefs de contingents
militaires doivent-ils informer les autorités nationales de
l'évolution d'une mission donnée? Que contiennent ces
rapports?
50. Quelles sont les violations communément
signalées qui ont été perpétrées contre des
enfants (hommes et femmes) par des membres des forces armées nationales,
tant dans le pays d'origine que dans les opérations de soutien de la
paix?
51. En cas d'allégations de violations commises par
des membres des forces armées à l'encontre d'enfants dans le
cadre d'opérations de soutien de la paix, quelle est la procédure
suivie par le Ministère pour traiter cette affaire?
52. Comment le processus de signalement et d'enquête
est-il axé sur le respect des besoins des enfants en tant que plaignants
et victimes? Cette approche garantit que les besoins de l'enfant et les
règles de preuve et le processus équitable requis dans toute
enquête et poursuite sont satisfaits.
53. Des violations des droits de l'enfant commises par des
militaires lors de conflits armés relèvent-elles du Code
militaire? Dans la négative, quelles sont les violations dont les
membres pourraient être poursuivis en vertu du Code militaire en ce qui
concerne les enfants?
54. Selon vous, l'armée est-elle politiquement
disposée à s'acquitter de ses rôles et
responsabilités en ce qui concerne les auteurs de violations à
l'égard des enfants? Veuillez donner des exemples concrets de cas
où des membres des forces armées ont été tenus
responsables de violations contre des enfants dans les conflits armés
(que ce soit dans le pays ou en tant que membres d'une force
déployée).
55. L'armée tient-elle un registre des membres qui ont
été reconnus coupables de crimes liés à l'enfance
ou qui ont le potentiel d'infliger des dommages aux enfants en vue d'examiner
les futurs déplacés?
56. Quel type de formation centrée sur la protection
de l'enfant est proposée aux militaires dans le cadre de leur formation
continue (c'est-à-dire non pré-déploiement)? Est-il
intégré à la formation des cadets? (à la fois
théorique et en termes d'exercices de simulation)
57.
645
Quel type de formation centrée sur la protection de
l'enfant est offerte aux militaires dans le cadre de leur formation
préalable au déploiement? Qu'est-ce que l'entraînement
implique? (à la fois théorique et en termes d'exercices de
simulation)
58. Quels types de formation sur la protection de l'enfance
les membres des contingents en mission reçoivent-ils? Qui effectue cette
formation et qu'est-ce que cela implique?
Au niveau national - Enquête
59. Quelle est la procédure suivie par l'Etat ivoirien
lorsqu'il est informé d'une violation présumée à
l'égard d'un enfant par un membre des institutions étatiques en
charge de la protection de l'enfant ou d'un contingent militaire national
déployé?
60. Qui décide des actions provisoires contre ce
membre?
61. Si une enquête doit être menée, qui
sont les enquêteurs nationaux ayant compétence pour le faire?
62. Quelle formation ces enquêteurs nationaux
reçoivent-ils pour leur permettre de mener les enquêtes?
63. Quelle procédure suivent-ils dans leurs
enquêtes?
64. À qui et à quelle fréquence
doivent-ils informer les autorités nationales des progrès de
l'enquête une fois qu'ils ont été
déployés?
65. À qui le résultat de l'enquête est-il
présenté?
66. Qui décide s'il existe des preuves suffisantes
pour poursuivre un membre?
67. Quelles sont les normes de preuve à respecter pour
qu'une transgression soit fondée et poursuivie?
68. Si les témoins du lieu de commission de la
violation alléguée sont tenus d'étayer leurs
allégations, leur présence dans le lieu abritant le tribunal
compétent est-elle facilitée?
69. Normes de preuve - Faut-il d'autres preuves corroborantes
indépendantes dans le cas où un enfant fait une
allégation?
70. Si un État membre refuse d'enquêter et que
l'ONU ou une ONG mène sa propre enquête et trouve des preuves
suffisantes établissant la culpabilité du suspect, l'État
de Côte d'Ivoire reconnaît-il cette conclusion?
71.
646
En cas d'inconduite de la part de certains membres du
personnel étatique en charge de la protection de l'enfance, le
supérieur hiérarchique peut-il être tenu pour responsable,
de même que le membre accusé?
Media - publication
72. Existe-t-il au sein de votre ministère/direction/
institution, une base de données des auteurs d'infractions à
l'égard des enfants ?
Cas actuels
73. Travaillez-vous actuellement des cas de violations des
droits de l'enfant dont vous avez été saisis ou tenu
informé ? À quel niveau l'enquête est-elle
74. Existe-t-il un protocole d'accord pour s'engager à
enquêter sur des allégations?
75. Quelles sont les difficultés rencontrées dans
les enquêtes actuelles relatives aux cas de violations des droits de
l'enfant ? Par exemple, des facteurs tels que la langue, la distance, la
capacité d'enquête, l'enquêteur, peu familier avec le
contexte.
76. Existe-t-il un protocole particulier pour s'engager à
enquêter sur des allégations?
Ministère de l'intérieur
(police)
77. La police a-t-elle un code de conduite qui traite
explicitement des questions de protection de l'enfance?
78. Les chefs de contingents de la police nationale sont-ils
déployés dans des missions habilitées, en termes de
législation, de politiques ou de directives nationales, à agir
sur les violations commises contre des enfants par des membres de leurs
unités en mission?
79. Si un tel devoir existe, pensez-vous que cela est
effectué avec diligence par les chefs de contingents de la police
nationale déployés? Quels facteurs peuvent interférer avec
cette obligation?
80. Quelles sont les violations communément
signalées qui ont été perpétrées contre des
enfants (hommes et femmes) par des membres de la police nationale?
81.
647
Dans le cas où des membres de la police auraient commis
des violations des droits de l'enfant, quelle est la procédure suivie
par le Ministère pour traiter cette affaire?
82. Comment le processus de signalement et d'enquête
est-il axé sur le respect des besoins des enfants en tant que plaignants
et victimes?
83. Comment les procédures préventives et
disciplinaires protègent-elles l'identité de la personne
(victimes et autres témoins) en rapportant des allégations ou des
préoccupations à l'encontre d'un membre?
84. Les infractions commises par des membres de la police
à l'encontre d'enfants victimes de conflits armés
relèvent-elles de la loi sur la police ou du code pénal? Dans la
négative, quelles sont les violations pour lesquelles les membres
pourraient être poursuivis, en vertu de ces codes en ce qui concerne les
enfants?
85. Selon vous, la police est-elle disposée à
assumer ses rôles et responsabilités lorsqu'il s'agit de demander
des comptes aux auteurs de violations à l'encontre d'enfants? Veuillez
donner des exemples concrets de cas où des membres de la police ont
été tenus pour responsables d'infractions commises contre des
enfants dans les conflits armés.
86. La police tient-elle un registre des membres qui ont
été reconnus coupables de crimes liés aux enfants ou qui
ont le potentiel d'infliger des dommages aux enfants afin de contrôler
les futurs déplacements?
87. Quel type de formation centrée sur la protection
de l'enfant est proposée aux membres de la police dans le cadre de leur
formation continue (c'est-à-dire non pré-déploiement)?
Est-il incorporé dans le cadre de leur formation académique?
(à la fois théorique et en termes d'exercices de simulation)
88. Quel type de formation axée sur la protection de
l'enfant est proposé aux membres de la police dans le cadre de leur
formation préalable au déploiement? Qu'est-ce que
l'entraînement implique? (à la fois théorique et en termes
d'exercices de simulation)
89. Quels types de formation sur la protection de l'enfance
les membres des contingents de police en mission reçoivent-ils? Qui
effectue cette formation et qu'est-ce que cela implique?
90. La police dispose-t-elle d'un mécanisme
adapté aux enfants pour permettre aux enfants victimes de violations
dans le pays de les signaler facilement ?
OSC, institutions nationales des droits de l'homme
et organes internationaux des droits de l'enfant
91. Travaillez-vous dans le domaine des enfants et des
adolescents dans les conflits armés ?
92. Pouvez-vous s'il vous plaît décrire le
travail que vous faites dans ce domaine?
93. Quels sont vos partenaires clés?
94. Quelles sont les violations des droits de l'homme
auxquelles sont soumis les enfants dans le pays?
95. Quels sont les développements positifs et les
défis rencontrés en matière de protection de l'enfance
dans le pays?
96. Quels mécanismes nationaux existent pour
coordonner le travail du secteur des droits de l'enfant?
97. Comment décririez-vous la culture de la
responsabilité des forces armées et de sécurité
dans le pays? (c'est-à-dire la corruption, l'impunité)
98. Selon votre expérience, les forces armées
et de sécurité nationales respectent-elles les lois et normes
pertinentes (y compris le droit international humanitaire, le droit relatif aux
droits de l'homme, les normes de protection de l'enfant et les dispositions
pertinentes du droit national)?
99. Pouvez-vous identifier des cas où des forces
armées et de sécurité ont été tenues
responsables de violations contre des enfants?
100. Pouvez-vous identifier des cas où des forces
rebelles ou des milices ont été
tenues responsables de
violations contre des enfants?
101. Des membres des forces armées ou de
sécurité nationales déployés en mission
ont-ils
déjà été accusés d'avoir commis des
violations contre des enfants? Y a-t-il une couverture de tels cas dans les
médias?
648
Accès des enfants aux mécanismes de
plainte / signalement des violations
102.
649
Quels mécanismes existent pour que les enfants victimes de
violations de
leurs droits les signalent? Y a-t-il des variations par
région dans le pays?
103. Existe-t-il une culture du signalement des violations ou
abus contre les
enfants perpétrées sur le territoire ivoirien
?
104. Les enfants se sentent-ils en sécurité pour
signaler des violations commises
par l'armée et les forces de
sécurité ou des abus commis par des particuliers ou entreprises
?
105. Votre organisation fournit-elle un soutien pour aider les
enfants qui pourraient
avoir été victimes ou témoins de
violations dans le signalement de telles violations?
106. La police dispose-t-elle d'un mécanisme
adapté aux enfants pour permettre
aux enfants victimes de violations
de les signaler?
107. À votre avis, les gens ont-ils une estime et une
confiance élevées dans les
processus judiciaires du pays?
108. Comment les données sont-elles été
collectées pour déterminer les violations
contre les enfants?
A quel point le processus a-t-il été participatif? Existe-t-il un
mécanisme de plainte défini pour que les victimes de violations
se manifestent?
Accès à la justice / Soutien aux
victimes
109. Le pays a-t-il un système de justice pour mineurs
accessible? De quoi s'agit-
il? Qui sont les acteurs clés?
110. Existe-t-il des tribunaux pour enfants ou des tribunaux
pour mineurs pour
traiter les violations contre les enfants?
111. Les acteurs clés (police, procureurs, juges)
sont-ils formés pour traiter avec
les enfants? (c.-à-d.
techniques d'entretien, soutien aux enfants, etc.)
112. Existe-t-il des mesures pour protéger
l'identité des enfants (victimes et autres
témoins)?
113. L'enquête et les procédures judiciaires
sont-elles menées de manière centrée
sur l'enfant?
Cette approche garantit que les besoins de l'enfant et les règles de
preuve et le processus équitable requis dans toute enquête et
poursuite sont satisfaits.
114. Quel type d'assistance juridique est fournie aux enfants
qui sont des plaignants et qui n'en ont pas les moyens? L'Etat fournit-il une
assistance juridique et une représentation juridique?
115. D'autres acteurs (forces armées nationales,
organisations de défense des droits de l'homme, institutions nationales
de défense des droits de l'homme, organismes internationaux,
communautés locales, par exemple) remplissent-ils leurs rôles et
responsabilités respectifs en matière de responsabilité
des auteurs de violations à l'égard des enfants?
116. Le processus de justice pour mineurs est-il
centré sur l'enfant? Quel est l'accès à l'assistance
juridique, à la traduction, au soutien psychosocial, au soutien
économique des victimes de violations?
650
BIBLIOGRAPHIE
I- DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
v ALLAND (D) et RIALS (S) (sous la direction
de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F, 2003, 1680
p.
v
651
ANDRIANTSIMBAZOVINA (J), GAUDIN (H), MARGUENAUD (J-P),
RIALS (S), SUDRE (F) (sous la direction de), Dictionnaire des
droits de l'homme, Paris, Quadrige/PUF, 2008, 1120 p.
v ARNAUD (A.-J.), (dir.), Dictionnaire
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit,
2ème éd., LGDJ, Paris, 1993. 757p.
v BEMBA (J), Dictionnaire de la justice
internationale, de la paix et du développement durable. Principaux
termes et expressions, 2eed., Paris, l'Harmattan, 2011, 452
p.
v BISSARDON (S.), Guide du langage
juridique, Paris, LexisNexis, 2013, 612p.
v BOUCHET-SAULNIER, (F.), Dictionnaire
pratique du droit humanitaire, Paris, Edition La Découverte, 2013,
760p.
v CABRILLAC (R) (sous la direction de),
Dictionnaire du vocabulaire juridique 2016, 7e éd.,
Paris, Éditions du Juris-Classeur, 2015, 543 p.
v CAYLA (O.) Jean-Louis HALPERIN (dir.),
Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques, Dalloz, Paris, 2008.
634p.
v CHAGNOLLAUD (D), DRAGO (G) (sous la
direction de), Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris, Dalloz,
Collection « Dictionnaires Dalloz », 2010, 750 p.
v CHAGNOLLAUD (D) (dir.), Dictionnaire
élémentaire du droit, Paris, Editions Dalloz, 2014, 738
p.
v CORNU (G), Vocabulaire juridique,
11e éd. mise à jour Paris, PUF, Quadrige, janvier
2016, 1101 p.
v CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, 8ème éd., PUF, Paris, 2018. 1152p.
v DEBARD (T.), GUINCHARD (S.), Lexique
des termes juridiques, 25ème éd 2017, Paris,
Lexiques-Dalloz, 1180 p.
v DESTRAIS (J), Dictionnaire
international des traités. Des origines à nos jours, Roanne,
Editions Horvarth H, 1981, 487 p.
v DUBOIS (J.), Le lexis-dictionnaire
érudit de la langue française, Larousse, 2009, 2128p.
652
+ PICOCHE (J.), Dictionnaire
étymologique du français, Les usuels du français,
1999, 740p.
+ SALMON (J) (sous la direction de),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001,
1198 p.
II- OUVRAGES GENERAUX
+ ADJOLOHOUN (H.), Droits de l'Homme et
Justice constitutionnelle en Afrique : Le modèle béninois,
Paris, L'Harmattan, 2011, 193 p.
+ AIVO(F. J.), Le juge constitutionnel
et l'Etat de droit en Afrique. L'exemple du modèle béninois,
Paris, L'Harmattan, 2006, 222 p.
+ AKANDJI-KOMBE (J-F) (sous la coordination
générale de), L'homme dans la société
internationale. Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier,
Bruxelles, Bruylant, 2013, 1624 p.
+ ALLAND (D), Manuel de droit
international public, Paris, P.U.F, 2ème édition, 2015, 281
p.
+ ANGELINO (I.), L'enfant, la famille, la
maltraitance, Paris, Dunod, 2002, 239 p.
+ ARDANT (P.), Institutions politiques
et droit constitutionnel, L.G.D.J., Paris, 16e édition,
2004, 112p.
+ ASSI - ESSO (A.-M.), Précis de
droit civil. Les personnes-la famille, L.G.D.J., Abidjan, 2e
édition, 2002, 463p.
+ AUBERT (J- L.), Introduction au droit,
1re éd., P.U.F, Paris, 1979, 127p.
+ AURENCHE (G.), La dynamique des droits
de l'homme, Desclée de Brouwer, Paris, 1998, 241p.
+ BADIE (B), La diplomatie des droits de
l'homme. Entre éthique et volonté de puissance, Paris,
Fayard, 2002, 380 p.
+ BASILIEN-GAINCHE (M-L), État de
droit et états d'exception. Une conception de l'État, Paris,
PUF, 2013, 303 p.
653
+ BATIFOL (H.), La philosophie du droit,
3e éd., Que sais-je ?, P.U.F, Paris, 1970, 128p.
+ BEAUD (M.), L'art de la thèse :
comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un
mémoire de DEA ou de maitrise ou tout autre travail universitaire,
La Découverte, Paris, Janvier 2003, 196p.
+ BEDIE (K. H.), Les Chemins de ma
Vie, Plon, 1999, 248p.
+ BEN ACHOUR (R) et LAGHMANI (S) (dir.),
Les droits de l'homme : une nouvelle cohérence pour le droit
international ? , Paris, Editions A. Pedone, 2008, 330 p.
+ BERGEL (J.-L.), Théorie
générale du Droit, 4ème éd., Paris, Dalloz,
2003, 374 p.
+ BERTRAND (M), DONINI (A), L'ONU,
7ème éd. Paris, La Découverte,2015, 128
p.
+ BOUZIRI (N), La protection des droits
civils et politiques par l'O.N.U. L'oeuvre du Comité des droits de
l'homme, Paris, l'Harmattan, 2003, 604 p.
+ BRIBOSIA (E), HENNEBEL (L), Classer
les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, 400 p.
+ BRISSET (C.), Un monde qui
dévore ses enfants, Paris, Éd. Liana Levi, 1997, 180
p.
+ BRISSET (C.), Les enfants et la loi de la
jungle, Paris, Éd. Odile Jacob, 2009, 217
p.
+ BUERGENTHAL (T.) et KISS (A.), La
protection internationale des droits de l'Homme, Editions N.P. Engel,
Strasbourg, 1991, 261p.
+ BURDEAU (G.), HAMON (F.) et TROPPER
(M.),Droit Constitutionnel,23e éd. LGDJ, Paris, ,
1993, 736p.
+ BUHRER (J-C), LEVENSON (C), L'ONU contre
les droits de l'homme ?, Paris, Éditions Mille et une nuits, 2003,
275 p.
654
+ BURGORGUE-LARSEN (L), Libertés
fondamentales, Paris, Montchrestien, 2003, 347 p.
+ CABANIS (A.) et LOUIS MARTIN (M.), Les
constitutions d'Afrique francophone. Evolutions récentes, Editions
KARTHALA, Paris, 193p.
+ CABRILLAC (R.), FRISON-ROCHE (M-A.), REVET (T.),
Libertés et droits fondamentaux, 12ème
éd. Dalloz, 2006, 863p.
+ CAPITANT (R.), Ecrits
constitutionnels, CNRS, Paris, 1982, 485p.
+ CARRE DE MALBERG (R.), Contribution
à la théorie générale de l'Etat, Tome II,
CNRS, Paris, 1992, 638p.
+ CARREAU (D.), Droit
International, Paris, éd. A Pedone, 1986, 612 p.
+ CAVARE (L.), Le droit international
public positif, Editions A. Pedone, Paris, 1973, 806p.
+ CHAMPEIL (V.) (dir.), A la recherche
de l'effectivité des droits de l'homme, Paris, Presse Universitaire
de Paris, 2008, 265 p.
+ COHEN-JONATHAN (G.), La protection
internationale des droits de l'homme : Europe, Paris, la Documentation
française, 2007, 80 p.
+ COT (J-P), PELLET (A) et FORTEAU (M),
La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article,
Tome I, Paris, Economica, 3ème édition mise à jour, 2005,
1366 p.
+ COT (J-P), PELLET (A) et FORTEAU (M),
La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article,
Tome II, Paris, Economica, 3ème édition mise à jour, 2005,
2363 p.
+ DE SCHUTTER (O), TULKENS (F), VAN DROOGHENBROECK
(S),Code de droit international des droits de l'homme, 4e
ed., 2014, Bruxelles, Bruylant, , 2013, 868 p.
+ DEBBASCH (C.) et autres, Droit
constitutionnel et Institutions politiques, 3e éd.,
Economica, Paris, 1990, 977p.
655
+ DECAUX (E), FROUVILLE (Olivier de),
Droit international public, Paris, Dalloz, 9ème ed.,
2014, 619 p.
+ DECAUX (E), BIENVENU (N), Les grands
textes internationaux des droits de l'homme, Paris, La Documentation
française, 2016, 826 p.
+ DEKEUWER-D, Françoise., Les
droits de l'enfant, Que sais-je?, 9e éd., Paris, PUF,
2010, 126 p.
+ DENIZEAU (C), Droit des
libertés fondamentales, Paris, Editions Magnard-Vuibert, 4
ème édition, août 2015, 394 p.
+ DEVIN (G) et SMOUTS (M-C), Les
organisations internationales, Paris, Éditions Armand Colin, 2011,
253 p.
+ DIPLA (H.),La responsabilité de
l'Etat pour violation des droits de l'homme, Paris, A.PEDONE, 1994, 116
p.
+ DREYFUS (S.), La thèse et le
mémoire de Doctorat en droit, Armand Colin, Paris, 1971, 512p.
+ ERGEC (R.), Protection
européenne et internationale des droits de l'homme, Bruylant,
Bruxelles, 2004, 237 p.
+ FAVOREU (L), GAÏA (P), GHEVOTIAN (R),
MELIN-SOUCRAMANIEN, PENASOLER (A), PFERSMANN (O), PINI (J), ROUX (A), SCOFFONI
(G), TREMEAU (J), Droit des libertés fondamentales, Paris,
Editions Dalloz, 2009, 685 p.
+ FLAUSS (J.-F.) et LAMBERT-Abdelgawad (E.),
(dir.), Droit et Justice, Bruxelles, 2004, 266 p.
+ GONIDEC (P.-F.), Les droits africains
: Evolution et sources, 2e éd., L.G.D.J, Paris, 1976,
190p.
+ GRAWITZ (M.), Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1972, 1013p.
+ HENNEBEL (L), TIGROUDJA (H),
Traité de droit international des Droits de l'homme,
Paris, Editions A. Pedone, 2016, 1705 p.
656
+ HENNETE-VAUCHEZ (S), ROMAN (D), Droits
de l'homme et libertés fondamentales, Paris, Editions Dalloz, 2
ème édition, 2015, 792 p.
+ JESSICA LAWRENCE (C.), Les droits de
l'Homme, institut de formation aux opérations de paix, 2014,
405p.
+ KELSEN (H.), Théorie pure du
droit, Traduction française de la 2e édition de
la « Reine Rechtsehre » par Charles EISENMAN, Dalloz, Paris,
1962, 496p.
+ KELSEN (H.), Théorie pure du
droit, traduit par Charles Eisenmann, Bruxelles, Bruylant, 1999, 367 p.
+ KOUASSIGNAN (G. A.), Quelle est ma loi
? Tradition et modernisme dans le droit privé de la famille en Afrique
noire francophone, Ed. A. Pedone, Paris, 1974, 311p.
+ LABRUSSE-RIOU (C.) et TRUCHET (D.),
(dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne des
Droits de L'Homme , 4e éd., Paris, PUF, 2007, 816 p.
+ LEBRETON (G.), Libertés
publiques et droits de l'Homme, Armand Colin, Paris, 7e édition,
2005, 551p.
+ LETTERON (R), Libertés
publiques, Paris, Éditions Dalloz, 2012, 613 p.
+ LUCHAIRE (F.) et GONAC (G.), La
Constitution de la République Française. Analyses et
commentaires, Ed. Economica, 2 volumes, Paris, 1979, 1031p.
+ M'BAYE (K.), Les Droits de l'homme en
Afrique, Paris, A. Pedone, 2002, 385 p.
+ MADIOT (Y.), Les droits de l'homme
à l'aube du XXIe siècle, Paris, Masson, 1991, 230 p.
+ MADIOT (Y.), Droits de l'Homme et
libertés publiques, Masson, Paris, 1976, 304p + MACHIAVEL
Nicolas, Le Prince, Flammarion, Paris, 1980, 261p.
+ MARIE, (J.-B.), La Commission des
droits de l'homme de l'ONU , Paris, éd. A. Pedone, 1975, 352 p.
+ MASSERON (J-P.), Le pouvoir et la
justice en Afrique Noire et à Madagascar, Ed. A. Pedone, Paris,
1966, 160p.
+ MAUGENEST (D.), et POUGOUE (P.-G.),
(dir.), Droits de l'Homme en Afrique Centrale,
Yaoundé, Karthala, 1995, 283 p.
657
+ Ministère des Droits de l'Homme et des
Libertés Publiques et la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme (LIDHO),
Recueil des textes internationaux relatifs aux Droits de l'Homme
ratifiés par la Côte d'Ivoire », 2011, 507p.
+ MORANGE (J.),
- Droits de l'Homme et libertés publiques,
PUF, Paris, 5e édition, 2000, 463p.
- La Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, Paris, PUF, 2002, 128 p.
- Manuel des droits de l'homme et libertés
publiques, Paris, PUF, 2007, 278 p.
+ MOURGEON (J.), Les droits de
l'Homme, Que sais-je ? PUF, Paris, 1978, 127p.
+ MUBIALA (M.), Le système
africain de protection des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 2005,
299 p.
+ MURRAY (R.), The African Commission on
Human and Peoples Rights and International Law, Oxford, Hart Publishing,
2000, 316 p.
+ NCHAMA EYA (C. M.),
Développement et droits de l'Homme en Afrique, Paris, Publisud,
1991, 438 p.
+ NGUYEN QUOCK (D.), DAILLER (P.) et PELLET
(A.), Droit international public, 5e éd.,
L.G.D.J, Paris, 2009, 1722p.
+ OBERDOFF (H), Droits de l'homme et
libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 5ème édition,
2015, 608 p.
+ OBERDOFF (H), ROBERT (J),
Libertés fondamentales et droits de l'homme : textes
français et internationaux, Paris, 13 édition, L.G.D.J,
2015, 1116 p.
+ OST (F.) et VAN DE KERCHOVE (M.), De
la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du
droit, Bruxelles : Publications des Facultés universitaires
Saint-Louis, 2002, 598p.
+ RIVERO (J), MOUTOUH (H),
Libertés publiques. Tome 1, Paris, P.U.F,
9e éd., mise à jour, 2003, 271 p.
+ ROBERT (J), DUFAR (J), Droits de
l'homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, Lextenso
éditions, 2009, 907 p.
658
+ ROBERT (J.), Droits de l'homme et
libertés fondamentales, Montchrestien, Paris 1993, 808p.
+ ROBERT (J.) et OBERDORFF (H.),
Libertés fondamentales et droits de l'Homme. Textes
français et internationaux, Montchrestien, Paris, 5e
édition, 2002, 719p.
+ PECES-BARBA (G.), Théorie
générale des droits fondamentaux. LGDJ, Paris, 2004,
497p.
+ RANDALL (M H), HOTTELIER (M),
Introduction aux droits de l'homme, Paris, L.G.D.J-Lextenso,
2014, 861 p.
+ RAYMOND (J-F), Les enjeux des droits
de l'homme, Paris, Librairie Larousse, 1988, 257 p.
+ RAWLS (J.), Théorie de la
justice, Le Seuil, Paris, 1987, 667p.
+ SALMON (J), Droit international et
argumentation, Bruxelles, Editions Bruylant, Groupe Larcier, «
Collection de droit international », 2014, 497 p.
+ SCIOTTI-LAM (C.),
L'applicabilité des traités internationaux relatifs
aux droits de l'homme en droit interne , Bruxelles, Bruylant, 2004, 704
p.
+ SERIAUX (A.) et autres, Droits et
Libertés fondamentaux, Ellipses, Paris, 1998, 224p.
+ SUDRE (F), Droit européen et
international des droits de l'homme, Paris, Presses universitaires de
France, 12e éd. refondue, 2015, 967 p.
+ TAVERNIER (P.), (dir.), Recueil
juridique des droits de l'Homme en Afrique 19962000, Bruxelles, Bruylant,
2002, 1312 p.
+ TAVERNIER (P.), (dir.), Recueil
juridique des droits de l'homme en Afrique 20002004, tome I et II,
Bruxelles, Bruylant, 2005, 2081 p.
+ TAVERNIER (P.), Regard sur les droits
de l'homme en Afrique, Paris, L'Harmattan, 2008, 307 p.
+ TAVERNIER (P) (sous la direction de),
Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique. Volume 2,
2000-2004, Tome 1 et 2, Bruxelles, Bruylant, 2006, 2117 p.
659
+ TAVERNIER (P) (sous la direction de),
Regards sur les droits de l'Homme en Afrique, Paris, l'Harmattan,
« Collection Presses Universitaires de Sceaux », 2008, 307 p.
+ TORRELLI, (M.), La protection
internationale des droits de l'enfant, Paris, PUF, 1983, 218 p.
+ TRIEPEL (H.), Droit international et
droit interne, Paris, éd. Panthéon-Assas, coll. Les
Introuvables, 2010, 448 p.
+ TURGIS (S), Les interactions entre les
normes internationales relatives aux droits de la personne, Paris,
Editions A. Pedone, 2012, 640 p.
+ VILLEY (M), Le droit et les droits de
l'homme, Paris, Quadrige, PUF, 2014, 169 p. + WACHSMANN (P),
Les droits de l'homme, Paris, Editions Dalloz, 2002, 180
p.
+ WALINE (M.), L'individualisme et le
droit, 2e éd., Domat Montchrestien, Paris, 1949,
430p.
+ WALLANT (R. C.), Jeunesse
marginalisée. Espoir de l'Afrique, ed. L'harmattan, Paris, 1992,
187p.
+ WEBER (A.), Les mécanismes de
contrôle non contentieux du respect des droits de l'Homme, Paris, A.
Pedone, 2008, 411 p.
+ WEIL (P.), Le droit administratif,
Que sais-je ?, PUF, Paris, 1973, 128p. + WODIE (F.) :
- Institutions politiques et droit
constitutionnel en Côte d'Ivoire, Presses universitaires de Côte
d'Ivoire (P.U.C.I), Abidjan, 1996, 625p.
- Les Institutions internationales
régionales en Afrique occidentale et centrale, L.G.D.J, Paris,
1970, 274p.
+ ZIEGLER (J.), Le pouvoir africain,
Editions du Seuil, Paris, 1971, 227p.
+ ZUBER (V), Le culte des droits de
l'homme, Paris, Editions Gallimard, 2014, 405
p.
660
III- OUVRAGES SPECIALISES
+ ABRAMSON (B.), « Article 2 The Right of
Non-Discrimination » in A. Alen et al. (dir.), A commentary on the United
Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff
Publishers, 2008, 154p.
+ ANKUMAH (E.A.), The African Commission on
Human and Peoples'Rights, Practice and Procedures, London, Martinus
Nijhoff Publishers, 1996, 246 p.
+ ANG (F.), « Article 38 : Children in
Armed Conflicts », in A. ALEN et al. (dir.), A commentary on the
United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden-Boston, Martinus
Nijhoff Publishers, 2005, 64p.
+ ANGLADE (J.-M.), Les droits de l'homme
à l'épreuve de la grande pauvreté, Editions Sciences
de service Quard Monde, Paris, 1987, 166p.
+ ARCHARD (D.), Children: Rights and
childhood, 2eéd., London-New-York, Routledge, 2004,
246p.
+ ARIES (P.), L'enfant et la vie
familiale sous l'ancien régime, Réed., Paris, éd. Du
Seuil, 1973, 504p.
+ AUBERT (J.-M.), Droits de l'homme et
libération évangélique, Editions du Centurion, Paris,
1987, 286p.
+ AUPELF, L'effectivité des
droits fondamentaux dans les pays de la Communauté francophone,
Colloque international, Port-Louis, 29-30
sept. et 1er oct. 1993,
AUPELF-UREF, 1994, 687p.
+ BELLO (S.), La traite des enfants en
Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux droits de
l'enfant en République du Bénin, L'Harmattan 2015, 465p.
+ BICE, Recueil sur la minorité
Analyse et commentaires de la législation pénale applicable
aux mineurs, BICE, 2003, 300p.
661
+ BARBE (V.), Le rôle du parlement
dans la protection des droits fondamentaux. Etude comparative : Allemagne,
France, Royaume-Uni, Paris, LGDJ, 2009, 527 p.
+ BAUDOUIN (J.-P.), Le juge des enfants,
punir ou protéger ? , Coll. « La vie de l'enfant », Ed.
E.S.F., Paris, 1990, 244p
+ BAUER (M.), et SCHERER-DARSCH (C.), De
l'enfance à la majorité : droits de l'enfant, de sa famille, de
ses éducateurs, Paris, Éd : ESF, 1990, 194 p.
+ BECET (J.-M.) et COLARD (D.), Les
droits de l'Homme. Dimensions nationales et internationales, Economica,
Paris, 1982, 301p.
+ BIGOT (A.), L'autorité
parentale dans la famille désunie en droit international
privé, Aix en Provence, PUAM, 2003, 544p.
+ BIRUKA (I.), La protection de la femme
et de l'enfant dans les conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan, 2006, 500
p.
+ BONFILS (P.), et GOUTTENOIRE (A.),
Droits des mineurs, Paris, Dalloz, 2008, 1121 p.
+ BONGRAIN (M.), Le placement de l'enfant
victime : une mesure irrespectueuse, Paris, Budapest, Torin, l'Harmattan,
2005, 138 p.
+ BROU (K. M.), Droit des personnes et
de la famille, Nouvelle édition 2013, les éditions ABC,
2013, 296p.
+ BROWN-WEISS (E.), Justice pour les
générations futures, Paris, éd. Sang de la terre,
2008, 356p.
+ BURDORGUE LARSEN (L.) et UBEDA DE TORRES (A.),
Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des
droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2008, 1092p.
+ BUREAU INTERNATIONAL DES DROITS DE
L'ENFANT, L'état des lieux de la formation des Forces de
sécurité aux droits de l'enfant en Côte d'Ivoire,
Rapport final décembre 2012, 124p.
+ CHAPLEAU (P.), Enfants soldats.
Victimes ou criminels de guerre ?, Coll. « L'art de la guerre »,
Paris, éd. du Rocher, 2007, 306p.
662
+ CHILD FRONTIERS, Cartographie et
analyse du système de protection de l'enfant en Côte
d'Ivoire, Rapport final, Avril, 2010, 121p.
+ CIFENDE KACIKO (M), SMIS (S),Code de
droit international africain, Bruxelles, Larcier, 2011, 608 p.
+ CNDHCI, L'Etat des droits de l'homme
en Côte d'Ivoire. Rapport annuel 2015, 92p.
+ CELHTO, La Charte de Kurukan Fuga. Aux
sources d'une pensée politique en Afrique, Paris, l'Harmattan,
2008, 162 p.
+ CONAC (G) (sous la direction de),
L'Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris,
Economica, 1993, 517 p.
+ CLIGMAN (O.), GRATIOT (L.) et HANOTEAU
(J-C.), Le droit en prison, Ed. Dalloz, Paris, 2001, 119p.
+ COHEN-JONATHAN (G) et FLAUSS (J-F) (dir.),
Droit international, droits de l'homme et juridictions
internationales, Bruxelles, Bruylant, Nemesis, « Collection Droit et
justice », 2004, 152 p.
+ CREOFF (M.), Guide de la protection de
l'enfance maltraitée, Paris, Dunod, 2006, 310 p.
+ DECAUX (E) (dir.), Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Commentaire article par
article, Paris, Economica, 2011, 996 p.
+ DECAUX (E) (dir.), Les Nations Unies
et les droits de l'homme : enjeux et défis d'une réforme,
Paris, Pedone, 2006, 348 p.
+ DEGNI-SEGUI (R.), Les droits de
l'Homme en Afrique noire francophone. Théories et
réalités, CEDA, 2e éd. Abidjan, 2001,
343p.
+ DOUMBE-BILLE (S) (sous la direction de),
Nouveaux droits de l'homme et internationalisation du droit,
Bruxelles, Bruylant, 2012, 277 p.
+ ERNY (P.), L'enfant et son milieu en
Afrique Noire, essai sur l'éducation traditionnelle, Paris,
Éd. Payot, 1972, 310 p.
+ ESCHYLLE, (J. F.) et MARRAUD (C.),
Droit de l'enfant et de la famille , Nancy, Éd. PUN,
1998, 356 p.
663
+ EZEMBE (F.), L'enfant africain et ses
univers, Paris, Karthala, 2009, 381 p.
+ FURET (M.-F.), MARTINEZ (J.-C.) et DORANDEU
(H.), La guerre et le droit, Editions A. PEDONE, Paris, 1979,
335p.
+ GABA (L), L'État de droit, la
démocratie et le développement économique en Afrique
subsaharienne, Paris, l'Harmattan, Collection « Logique juridique
», 2003, 399 p.
+ GARAPON (A.), Les crimes qu'on ne peut
ni punir, ni pardonner. Pour une justice internationale, Editions ODILE
JACOB, Paris, novembre 2002, 348p.
+ GAREIL (L.), L'exercice de
l'autorité parentale, Paris, LGDJ, 2004, 604 p.
+ GLÉLÉ AHANHANZO (M),
Introduction à l'Organisation de l'Unité africaine
et aux organisations régionales africaines, Paris, LGDJ, 1986, 574
pages.
+ GOY (R.), La Cour internationale de
justice et les droits de l'homme, Emile Bruylant, Bruxelles, 2002,
222p.
+ GRATALOUP (S.), L'enfant et sa famille
dans les normes européennes, Paris, LGDJ, 1998, 600 p.
+ HERMANGE (M.-T.), L'enfant soi-disant
roi : Pour une nouvelle culture de la parentalité, Paris, Albin
Michel, 1999, 329 p.
+ HOFNUNG, (T.), La crise ivoirienne de
Félix Houphouét-Boigny à la chute de Laurent Gbagbo,
Paris, Edition La Découverte, 2011, 140p.
+ HUNT (L), L'invention des droits de
l'homme. Histoire, psychologie et politique, Paris, Editions Markus
Haller, 2013, 310 p.
+ HUYETTE (M.), et DESLOGES (P.), Guide
de la protection judiciaire de l'enfant, Paris, DUNOD, 2009, 536 p.
+ KADOGO (H. C.), « Enfants des guerres
d'Afrique Centrale », L'Harmattan, Paris, 2003, 312p.
+ KAMTO (M), Pouvoir et droit en Afrique
noire : essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États
d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, 545 p.
664
+ KAMTO (M) (sous la direction de), La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole
facultatif y relatif portant création de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples. Commentaire article par article, Bruxelles,
Bruylant, 2011, 1628 p.
+ KEDE-ONANA (M.), Le droit à
l'éducation en Afrique : enjeux et perspectives à l'ère de
la mondialisation, Paris, l'Harmattan, 2007, 176 p.
+ KEMBO TAKAM GATSING (H), Le
système africain de protection des droits de l'homme. Un système
en quête de cohérence, Paris, l'Harmattan, 2014, 202 p.
+ KERBRAT (Y),La référence
au chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions
à caractère humanitaire, Paris, LGDJ, 1995, 120 p.
+ KI-ZERBO (J), Histoire de l'Afrique
noire. D'hier à demain, Paris, Éditions Hatier, 1972, 702
p.
+ KONE (K.S.), Du travail des enfants au
travail décent des jeunes en Côte d'Ivoire. Eléments de
politique pour l'action publique, 81p.
+ KORCZAK (J.), Les droits de l'enfant
au respect, traduit et adapté du polonais par Lydia Waleryszak,
Paris, éd. Fabert, 2009, 134 p.
+ KOUTOU (N. C.), Etude sur la
prostitution enfantine et les réseaux de traite dans les communes de
Yopougon et de Adjamé, GTZ, 20106, 49p.
+ LACROIX (E.), Les droits de
l'enfant, coll. « Philo », Paris, Ellipses, 2001, 128p.
+ LAGRANGE (E), SOREL (J-M) (sous la
direction de), Droit des organisations internationales, Paris,
L.G.D.J, 2013, 1248 p.
+ LAMBERT-ABDELGAWAD (E), MARTIN-CHENUT (K)
(sous la direction de), Réparer les violations graves et
massives des droits de l'homme : la Cour interaméricaine,
pionnière et modèle ?, Paris, Société
Législation Comparée, « Collection Unité mixte de
recherche de droit comparé de Paris (Université de Paris I/CNRS
UMR 8103 », mai 2010, 334 p.
+ LAROCHE-GISSEROT (F.), Les droits de
l'enfant, Paris, Dalloz, 2003, 119 p.
665
+ LAVOUE (J.), La demande de justice en
protection de l'enfance, Paris, l'Harmattan, 2004, 219 p.
+ LAZERGES (C) (sous la direction de),
Les grands avis de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme, Paris, Editions Dalloz, « Grands Textes », 2016, 466
p.
+ LEBRETON (M.-C.), L'enfant et la
responsabilité civile, Mont-Saint-Aignan, Publications des
Universités de Rouen et du Havre, 1999, 464 p.
+ LIEBEL (M.) avec la collab. de
ROBIN (P.) et SAADI (I.), Enfants, droits
et citoyenneté. Faire émerger la perspective des enfants sur
leurs droits, coll. « Logiques juridiques », Paris, l'Harmattan,
2010, 262p
+ LOCKE (J.), Quelques pensées
sur l'éducation, Paris, éd. Librairie philosophique J. Vrin,
2007, 399p
+ MAIKASSOUA (R.I), La Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples. Un organe de contrôle au
service de la Charte africaine, Paris, Karthala, 2013, 516 p.
+ MARIE (J-B), La Commission des droits
de l'homme de l'ONU, Paris, Pedone, 1975, 352 p.
+ MATRINGE (J),Tradition et
modernité dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
: étude du contenu normatif de la Charte et de son apport à la
théorie du droit international des droits de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1996, 137 p.
+ MALEMBA (M. N.G.), Enfants dans la
rue. Le sans et le hors famille, Lubumbashi, Presses Universitaires de
Lubumbashi, 2003, 127 p.
+ MARQUET (J.), BONMARIAGE (J.), Le bien
de l'enfant : entre normes relatives et exigence vitale, Louvain-la-Neuve,
Bruylant, 1998, 240 p.
+ MARIE (J.-B.), La Commission des droits
de l'Homme de l'ONU, Editions A. Pedone, Paris, 1975, 351p.
666
+ MATRINGE (J.), Tradition et
modernité dans la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, Bruylant, Bruxelles, 1996, 137 p.
+ MAYSTRE (M.), Les enfants soldats en
droit international. Problématiques contemporaines au regard du droit
international humanitaire et droit international pénal, coll.
« Perspective internationale », n°30, Paris, éd. A.
Pedone, 2010, 202p.
+ MEUNIER (G.), L'application de la
Convention des Nations-Unies relatives aux droits de l'enfant dans le droit
interne des États parties , coll. « Logiques Juridiques
», L'Harmattan, Paris, 2002, 253 p.
+ MINISTERE DE LA JUSTICE-FRANCE,
Adapter la justice pénale des mineurs : entre modifications
raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions : rapport au
Ministre de la justice, Garde des Sceaux / rapport de la commission
présidée par le recteur André Varinard, Paris, La
documentation Française, 2009, 271p.
+ MOUHAMADOU (S.), La protection
constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique. L'exemple du
Sénégal, Paris, l'Harmattan, 2007, 562 p.
+ MUBIALA (M.), Le système
régional africain de protection des droits de l'homme, coll. «
Organisation internationales et relations internationales », Bruxelles,
Bruylant, 2005, 299 p.
+ NDEMBI (D. L.), Le travail des enfants
en Afrique subsaharienne : le cas du Bénin, du Gabon et du Togo,
Paris, l'Harmattan, 2006, 274 p.
+ NEIRINCK (C.), Le droit de l'enfance
après la Convention des Nations Unies, Paris, Editions Belfond,
1993, 179 p.
+ NGONDANKOY (N.-E.-L.), Droit congolais
des droits de l'homme, 2004, Bruylant-Academia, 2004, 489p.
+ PILON (M.), et VIGNIKIN (K.),
Ménages et famille en Afrique subsaharienne,
éd. des archives contemporaines, Paris, 2006, 77p.
+ RAYMOND (G.), Droit de l'enfance et de
l'adolescence. Le droit français est-il conforme à la convention
internationale des droits de l'enfant ? , Paris, Litec, 1995, 383 p.
667
+ RAYMOND (G.), Droit de l'enfance et de
l'adolescence, 5e éd., Paris, LexisNexis LITEC, 452
p.
+ RICHER (L.), Les droits de l'homme et
du citoyen, Economica, Paris, 1982, 406p.
+ RIVERO (J.), Le conseil
constitutionnel et les libertés, Economica, Paris, 2e
éd., 1987, 192p.
+ ROYAL (S.) et AVENA-ROBARDET (V.), Les
droits des enfants, Paris, Dalloz, 2007, 182 p.
+ RUBELLIN-DEVICHI (J.), et RAINER (F.),
(dir.), L'enfant et les Conventions Internationales, Lyon,
PUL, 1996, 492 p.
+ SANTOS (M.), et SALAH (R.), La traite
des enfants en Afrique de l'Ouest : Réponses politiques, Centre de
recherche INNOCENTI-UNICEF, 2002, 30 p.
+ SCHLEMMER (B.), L'enfant
exploité : oppression, mise au travail, prolétarisation,
Paris, Karthala, 1996, 522 p.
+ STROOGO (J.), Les Droits de l'enfant
en questions, Paris, la Documentation française, 1990, 183 p.
+ TOUSCOZ (J.), Le principe
d'effectivité dans l'ordre international, Paris, L.G.D.J., 1964,
280p.
+ WALTER (B.), Le droit de l'enfant
à être éduqué, Paris, l'Harmattan, 2001, 127 p.
+ WODIE (F.) :
- Le droit en question (Questions de droit/ Réponses
du droit) Du droit et des
faits !, Educi, 2017, 37p.
- L'esprit et la lettre de l'Accord de Linas-Marcoussis, 26
Août 2003, inédit,
13p.
+ YOUF (D.), Penser les droits de
l'enfant, coll. « Questions d'éthique », Paris, PUF,
2002, 184 p.
+ ZANI (M.), La Convention
internationale des droits de l'enfant : Portées et limites, coll.
« Manuels 2000 » Paris, Publisud, 1996, 223 p.
668
669
IV- THESES ET MEMOIRES
A/ LES THESES
+ AFFA'A MINDZIE (M), La protection
internationale des droits de l'enfant, Thèse de droit,
Université de Strasbourg, 2001, sous la direction de
Jean-François Flauss.
+ AIVO (G.), Le statut de combattant
dans les conflits armés non internationaux. Etude critique de droit
international humanitaire, Thèse de doctorat droit international et
relations internationales, Université Jean Moulin 3, 2011, 585p.
+ AKONO (F.T.), Le discours de la baule
et les processus démocratiques en Afrique. Contribution à une
problématique de la démocratie et du développement dans
les pays d'Afrique noire francophone, Thèse de doctorat en science
politique, Université de Clermont-Ferrand 1, 1995, 644p.
+ ATSU-DETE (T.), La protection du
mineur et du majeur atteint de troubles mentaux en droit Togolais,
Thèse de doctorat Université Jean Moulin Lyon 3, 2004, 431p.
+ BELLO (S.), La traite des enfants en
Afrique, L'application des conventions internationales relatives aux droits de
l'enfant en République du Bénin, Dissertation, zur Erlangung
des Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayr, 2013,
425p.
+ BERTOL (D.), Famille et
responsabilité, Thèse de doctorat, Droit, Bordeaux 4 : 2006,
449 p.
+ BETAILLE (J.), Les conditions
juridiques de l'effectivité de la norme en droit public interne,
Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2012, 767p.
+ CHERIF (A.), L'effectivité des
droits fondamentaux dans l'ordre juridique ivoirien: étude à la
lumière du droit international et comparé. Thèse de
doctorat, Université de Genève. Thèse, 2014. 577p.
+ CISSE (L),La problématique de
l'État de droit en Afrique de l'ouest : analyse comparée de la
situation de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Sierra
Léone, Thèse
670
de droit, Université de Paris XII Val de Marne, 2009,
sous la direction de Pierre-Henri Chalvidan, 552 p.
+ COULIBALY (K.), La protection
sanitaire internationale de l'enfant .
· contribution à
l'étude du droit de l'enfant à la santé, Thèse
de doctorat, Droit, Bordeaux, 1990, 543 p.
+ DASSE (F. O.), Les instruments de
protection des droits de l'homme en Afrique subsaharienne, Thèse
unique de doctorat de droit, Faculté de droit et de sciences politiques
de l'Université de Nantes, Octobre 2001, 480p.
+ DE DINECHIN (P.), La
réinterprétation en droit interne des conventions internationales
sur les droits de l'homme. Le cas de l'intégration de la Convention des
droits de l'enfant dans les droits nationaux en Amérique latine.
Droit. Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III, 2006, 516p.
+ DEGNI-SEGUI (A.), L'Administration
locale ivoirienne, Thèse pour le doctorat d'Etat en droit,
Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix Marseille, 1982, 520p.
+ DIALLO (Y.), Les enfants et leur
participation au marché du travail en Côte d'Ivoire,
Thèse de Doctorat ès Sciences économiques,
Université Montesquieu Bordeaux IV, 355p.
+ DRAN (M.), Le contrôle
juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Thèse
pour le doctorat d'Etat en Droit, Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de l'Université de Montpellier, L.G.D.J., Paris, 1960,
655p.
+ DUMERCQ (M.M), Mise en perspective des
ambiguïtés de la communication des organisations
intergouvernementales humanitaires .
· le cas de l'UNICEF dans les
stratégies de recherche de fonds, Université Bordeaux 3-
Michel Montaigne, Thèse de doctorat, 2009, 322 p.
+ ETEKA (G.V.), Etude comparative de la
Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et des autres instruments
universels et régionaux des droits de l'Homme, Thèse de
doctorat, université de Rennes 1, Droit public, 1994, 480p.
671
+ GACUKO, (L).La mise en oeuvre de
l'article 40 de la Convention Internationale relative aux droits de L'Enfant au
Burundi, Thèse de doctorat, Université de Namur, 2012, 797
p.
+ GAMBARAZA (M), Le statut juridique de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, Thèse de
droit, Université Panthéon Assas, sous la direction d'Emmanuel
Decaux, 612 p
+ GUÉRET-GBAGBA (H-R), Les droits
de l'homme dans la prévention et la résolution des conflits en
Afrique subsaharienne, Thèse de droit, Université Pierre
Mendès France (Grenoble), 2006, sous la direction de Jean-Luc Chabot,
499 p.
+ HEUSCHLING (L), État de droit,
Rechtstaat, Rule of law, Étude comparative, Thèse de droit
public, Université Paris I, 2000, sous la direction de Françoise
Dreyfus, 739 p.
+ KANE (A.F.), La protection des droits
de l'enfant pendant les conflits armés en droit international,
doctorat en droit international, Université de Lorraine, 2014, 498p.
+ KOBO (P. C.), Droit et ville en
Afrique. Essai sur le droit de l'urbanisme en Côte d'Ivoire,
Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit, Faculté de Droit et des
Sciences économiques de Nice, Octobre 1984, 446p.
+ KOFFI (K.E.), Les droits de l'homme
dans l'Etat de Côte d'Ivoire, Thèse unique de droit public,
Université de Cocody-Abidjan, UFR-SJAP, 2008, 903p.
+ KONDE MBOM (J-B), Le contrôle
international de l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, Thèse de doctorat de droit, Université Grenoble
2, 1996. 413p.
+ KOUDE (R.K.), La pertinence
opératoire des droits de l'homme : de l'affirmation universaliste
à l'universalité récusée, Thèse de
doctorat en Philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3, 2009, 343p.
+ MARRION (B.), Le mineur, son corps et
le droit criminel, Thèse, Nancy 2, 2010, 459p.
672
+ MBALA MBALA (F.), La notion
philosophique de dignité à l'épreuve de sa
consécration juridique, Université du Droit et de la
Santé - Lille II, 2007, 466p
+ MBANDJI MBENA (E.), Les droits
fondamentaux de l'enfant en droit camerounais, Thèse de doctorat en
Droit et Science Politique -Toulouse, 2013, 667p
+ MELEDJE (D.-F.), La contribution des
organisations non gouvernementales à la sauvegarde des droits de
l'homme, Thèse pour le doctorat en droit public, Université
d'Amiens, 1987, 553p.
+ MEYER-BISCH (P.), Le corps des droits
de l'homme : L'indivisibilité comme principe d'interprétation et
de mise en oeuvre des droits de l'homme, Editions universitaires de
Fribourg, 1992, 401p.
+ KONDE (M. J-B), Le contrôle
international de l'application de la Charte africaine des droits de l'Homme et
des peuples, Thèse de doctorat, université Pierre Mendes
Grenoble II, Droit public, Lille, ANRT, 2003, 413 p.
+ NEIRINCK (C.), La protection de la
personne de l'enfant contre ses parents, Thèse de doctorat,
Montpellier, 1984, 453p.
+ NGOUMBANGO KOHETTO (J.),
L'accès au droit et à la justice des citoyens en
République centrafricaine, Thèse de doctorat,
Université de Bourgogne, 2013, 589p.
+ OURAGA (O. B.), L'Etat et les
libertés publiques en Côte d'Ivoire, essai de théorie
générale, Thèse de doctorat d'Etat en Droit,
Faculté de Droit et des Sciences économiques de Nice,
Décembre 1986, 694p.
+ SADEK (S.), Contribution à
l'étude des facteurs de la délinquance des jeunes issus de
l'immigration maghrébine, Le cas du Grand Mirail à Toulouse,
Thèse, Toulouse, 2004, 656p.
+ SANGHARE (E.H.M.), La réception
du droit international des droits de l'homme au Sénégal.
Droit. Université de Grenoble, 2014. Français. 366p.
+ SOMA (A.), Droit de l'homme à
l'alimentation et sécurité alimentaire en Afrique.
Genève, Zurich, Bâle : Schulthess, 2010, 561p.
+ SORO ( P.S-G.), L'exigence de
conciliation de la liberté d'opinion avec l'ordre public
sécuritaire en Afrique subsaharienne francophone
(Bénin-Côte d'Ivoire-
673
Sénégal) à la lumière des
grandes démocraties contemporaines (Allemagne-France), Thèse
de doctorat en droit public, Université de Bordeaux, 2016, 535p.
B/ LES MEMOIRES
+ ASSI Brou (R. D.), Le juge ivoirien et
les traités internationaux, UFR des Sciences juridique,
administrative et politique, Université de Cocody-Abidjan, Novembre
2003, 192p.
+ BOULESTIN (A.), La protection des
femmes et des enfants dans les conflits armés, Mémoire II
Recherche, Bordeaux IV, 2007, 112p.
+ BOUTROS ABDEL-NOUR (M.), La Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, élaboration et
inspiration, Mémoire de Master 2 de droit international public,
Université Jean Moulin Lyon 3, 2009, 111p.
+ BOSSER (M.), La convention
internationale des droits de L'enfant : les droits de l'enfant, utopie d'une
liberté ? , Bordeaux, IEP, 1998, 92 p.
+ COULIBALY (H.), Le contrôle de
constitutionnalité des lois en Côte d'Ivoire, Mémoire
de DEA de droit public général, UFR des Sciences juridique,
administrative et politique, Université de Cocody-Abidjan, 2003,
195p.
+ DJIBO (J.), La responsabilité
civile du mineur non émancipé, Mémoire de DEA de
Droit privé fondamental, UFR des Sciences juridique, administrative et
politique, Université de Cocody-Abidjan, 2001, 85p.
+ DIOP (R.), Secteur informel et
exploitation du travail des enfants : une étude de deux réseaux
pourvoyeurs d'enfants loués à Abidjan, Abidjan,
Université d'Abidjan, Département de sociologie, mémoire
de maitrise, 1987, 99p.
+ GARCIA (L.), La traite des femmes pour
les fins de prostitution : les conventions internationales et la
législation canadienne sur le sujet, mémoire
présenté comme exigence partielle de la maîtrise en droit
international, Université de Québec à Montréal,
Octobre 2009, pp.44-48.
674
+ GOABIN CHANCOCO (G.), La
problématique de l'effectivité du droit de l'enfant à la
santé et à l'éducation dans les situations de conflit
armé interne en Afrique : réflexions à la lumière
de la crise en Côte d'Ivoire, Mémoire présenté
à la Faculté des études supérieures et
postdoctorales en vue de l'obtention du grade de Maître en droit,
Août, 2014, 200p.
+ IBO (L. N.), La loi dans le
système constitutionnel ivoirien, Mémoire de DEA de droit
public général, UFR des Sciences juridique, administrative et
politique, Université de Cocody-Abidjan, 1996, 81p.
+ IRITIE (N.D.), Echec scolaire et
devenir comportemental des adolescentes vivant dans les quartiers
précaires à Abidjan : Le cas de YAHOSEI dans la commune de
Yopougon, Mémoire de maitrise criminologie 2005, Université
de Cocody-UFR de criminologie, 2005, 90p.
+ KRA (K. J. A.), L'internationalisation
des conflits armés internes en Afrique, Mémoire, de DEA de
droit public général, UFR des Sciences juridique, administrative
et politique, Université de Cocody-Abidjan, 2003, 110p.
+ LA ROSA (A.), La protection de
l'enfant en Droit International Pénal, Mémoire de Master
Recherche, Université de Lille 2, 2004, 171p.
+ MOUHAMADOU (N.), La protection des
droits de l'homme par la Cour de justice de la CEDEAO, Université
de Bordeaux, Mémoire de Master 2, 2014, 122p.
+ MESMES (E.), OMS et la protection de
l'enfant et de la femme dans le système de santé africain,
Bordeaux, Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2001, 161 p.
+ NCHO (M. A.), La deuxième
République : son apport à la démocratie et aux droits de
l'homme, Mémoire de DEA de Droit public général, UFR
des Sciences juridique, administrative et politique, Université de
Cocody-Abidjan, 2002, 94p.
+ NIZIGIYIMANA (P.C.),
L'amélioration des conditions sanitaires dans les prisons
du Burundi, Mémoire Master of Advanced Studies en Action
Humanitaire, Juin 2012, 79p.
675
+ ROBERT (L), Les clauses relatives aux
droits de l'homme dans les accords internationaux conclus par la
Communauté européenne. Ambitions et réalités,
Mémoire de Master 2, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2008,
109p.
+ SAKAMOTO (N.), L'enregistrement des
enfants à la naissance, Bordeaux, Mémoire Sciences
Politiques, 2006, 89 p.
+ SOSSOUKPE (S.L.), La protection de
l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la
Côte d'Ivoire, mémoire de recherche Master 2,
Université de Nantes, 2009,115p.
+ TAPSOBA (J.S.), L'accès des
enfants victimes à la justice en Côte d'Ivoire, Mémoire de
Master 2 en éthique et gouvernance, Centre de recherche et d'action
pour la paix (CERAP) 2010, 97p.
V - ARTICLES, Chroniques, observations, Notes
+ ABI-SAAB (G), « Droits de l'homme et
juridictions pénales internationales. Convergences et tensions » in
Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos. « Droit et
justice », sous la direction de DUPUY (J-R), Paris, Editions A. Pedone,
1999, pp. 245-253.
+ ACKA (S. F.), « Une survivance de la
tradition dans la République : l'exemple des Chefs et des Rois »,
in Actualités juridiques, AIDD, Abidjan, 2004, pp.24-39
+ AGGREY (A.), « L'enfant victime
d'infraction dans le projet du code pénal ivoirien », Rev. Jur.
Pol. Ind. Et coop., n°2, 1977, p. 296.
+ AHANHANZO (M. G.), « Introduction
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Organisation
de l'Unité africaine) », in Etudes offertes à
Claude-Albert COLLIARD, Editions PEDONE, Paris, 1984, pp.511-537.
+ AHONTO (L.), « Mineurs en prisons.
Des conditions de vie déplorables », L'autre Afrique, 14
au 21 juillet 1998, p. 33.
676
+ AIVO (G), « Convergences entre droit
international humanitaire et droit international des droits de l'homme : vers
une assimilation des deux corps de règles ? », RTDH, 2010,
n°82, pp. 341-370.
+ AJAVON, Ata, « La protection des
droits de l'Homme dans les constitutions des Etats de l'Afrique noire
francophone », RJPIC, n°1, mars 1992, pp.79-87.
+ ALSTON (P.), « The Best interests
principle: Toward a reconciliation of culture and human rights »,
Int'l J.L. & Fam., vol.8, n° 1, 1994, pp. 1-25.
+ ALVAREZ (J.), « La réinsertion
ou les réinsertions ? », A.P.C., Ed. A. Pedone, n°22,
Paris, 2000, p. 697.
+ ANCEL (M.), « Pour une étude
systématique des problèmes de politique criminelle »,
A.P.C, Ed. A. Pedone, n°1, 1975, pp. 15-42.
+ ANCEL (M.), « Responsabilité et
défense sociale », R.S.C., 1959, pp. 179-184.
+
APATI-BASSAH, « Justice et authenticité »,
Penant, n°784, 1984, pp. 193-198.
+ ATANGANA AMOUGOU (J-L.), «
Avancées et limites du système africain de protection des droits
de l'homme : la naissance de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples », Dr. Fond., vol.3,
janvier-décembre 2003, pp.175-178.
+ ATANGANA-MALONGUE (T), « Mutilations
sexuelles et droit à l'intégrité physique de l'enfant en
Afrique : l'exemple du Cameroun », C.R.D.F., 2005, n°4, pp.
183-197.
+ ARNE (S.), « Existe-t-il des normes
supra-constitutionnelles ? Contribution à l'étude des droits
fondamentaux et de la constitutionnalité », in Revue de Droit
public et de la science politique en France et à l'étranger,
Tome 109, LGDJ, Paris, 1993, pp.459-512.
+ ARTS (K.C.J.M.), « The international
protection of children's rights in Africa : The 1990 OAU Charter on the rights
and welfare of the child », R.A.D.I.C., vol. 5, 1993,
pp.139-162.
677
+ AUBY (J. M.), « Droits de l'homme et
droit de la santé. En particulier dans le régime juridique des
services publics sanitaires », in Mélanges offerts au
Professeur Robert-Edouard CHARLIER, Editions Emile- Paul, 1981,
pp.673-685.
+ AYISSI (J), « De la Commission au
Conseil des droits de l'homme : une réforme du système onusien
des droits de l'homme », Cahier spécial de l'Institut des
droits de l'Homme de Lyon, 2007, pp. 177-197.
+ BALMOND (L.), « Le droit
international face à l'enrôlement des enfants soldats » in
Le droit et les droits de l'enfant, l'Harmattan, Champs Libres, 2007,
19 p.
+ BALMOND (L.), « Chronique de faits
internationaux », R.G.D.I.P., vol. 112, n° 2, 2008,
pp.379-414.
+ BARRIERE-BROUSSE (I.) « L'enfant et
les conventions internationales », J.D.I., n°4,
Octobre-décembre 1996, p.843-888.
+ BASSON (J.-C.), « Faut-il
réprimer la violence scolaire ? A propos du centenaire de la loi du 19
avril 1898 », Les cahiers de la sécurité
intérieure, n°32, 1998, pp. 175178.
+ BASSIOUNI (C.), « Protéger
l'enfant sans protéger ses droits », R.I.D.P., 1991, pp.
723-729.
+ BEAU (C.), « La Convention
internationale des droits de l'enfant et le traitement de la délinquance
juvénile en France », R.I.D.P., 1991, pp. 903-913.
+ BEN SALEM (H.), « Le système
africain de protection des droits de l'homme et des peuples », in La
Voix de l'Intégration Juridique et Judiciaire Africaine, n°001
2001, pp. 205-211.
+ BESSON (J.-C.), « Délinquance
juvénile : approche sociologique et juridique. Le droit adapté
aux mineurs », Revue de Gendarmerie nationale, n°186, 1997,
pp. 6-9.
+ BESSON (S.), « The principle of
Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child »,
Int'l J. Child. Rts. Vol. 13, n°4, 2005, pp. 433-461.
+ BESSON (S.), « L'effectivité
des droits de l'homme : du devoir être, du pouvoir être et de
l'être en matière de droits de l'homme », in J-B.
ZUFFEREY et alii (éd.), L'Homme et son droit, Mélanges en
l'honneur de Marco Borghi à l'occasion de 65e
678
anniversaire, Faculté de l'Université de
Fribourg/Schulthess, Zurich/Bâle/Genève, 2011,pp..53-83.
v BETTATI (M), « Du devoir
d'ingérence à la responsabilité de protéger »,
Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de
culture juridiques, 2012, pp. 3-8.
v BHUKUTH (A.), « Le travail des enfants :
limites de la définition », Mondes en
développement, t.37, vol.2, n°146, juin 2009, pp.27-32.
v BIANCHI (A), « L'immunité des
Etats et les violations graves des droits de l'homme : la fonction de
l'interprète dans la détermination du droit international »,
RGDIP, 2004/1, tome 108, pp. 63-101.
v BLEOU (M.),
- Les instruments relatifs à une protection
particulière des droits de l'homme, Cours à l'Institut de
Formation Judiciaire du Sénégal, Dakar, 2003, 19p.
- L'accord de Linas-Marcoussis et la
délégation de pouvoir du Président de la République
au Premier Ministre, Abidjan, le 26 Aout 2003, inédit, 9p.
v BONGERT (Y.), « Délinquance
juvénile et responsabilité pénale du mineur au
18e siècle », Cahiers des annales, n° 133,
Paris, 1971, pp. 48-90.
v BONI (A.), Synthèse des analyses de
treize arrêts rendus par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire en
matière de droit foncier, in Les Cours suprêmes en
Afrique, IV, Ed. Economica, Paris, 1990, pp.74-100.
v BONNET (M.), « La déclaration
de Kundapur : et si on écoutait les enfants travailleurs ? in M. BONNET
et al.,Enfants travailleurs. Repenser l'enfance, coll. « cahiers
libres », Lausanne, éd. Page deux, 2006, pp.59-101.
v BORRICAND (J.), « La notion de
prévention de la délinquance en milieu urbain »,
R.I.C.P.T., Vol. XLVI, n°4, 1993, pp. 409-418.
v BOSSUYT (M), DECAUX (E), « De la
Commission au Conseil des droits de l'homme, un nom pour un autre ? »,
Droits fondamentaux, janvier-décembre 2005, n°5, pp.
3-4.
679
+ BOUDREAU (L.), et autres, « La
Convention relative aux droits de l'enfant et son application en droit canadien
», in L'enfant et les conventions internationales, Jacqueline
Rubellin-Devichi et Rainer Franck, (dir.), Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 1996, pp. 259-285.
+ BOUKONGO (J-D), « L'application de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par les autorités
nationales en Afrique centrale » in L'application nationale de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, sous la direction de
FLAUSS (J-F), LAMBERT-ABDELGAWAD (E), Bruxelles, Bruylant-Nemesis, «
Droit et justice », 2004, pp. 123-160.
+ BOUKRIF (H.), « La Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples : Un organe judiciaire au service des droits
de l'Homme et des peuples en Afrique », in Revue africaine de droit
international et comparé/ African Journal of international and
comparative law, t.10, n°1, mars 1998, pp.60-87.
+ BOUKONGOU (J-D.), « Le système
africain de protection des droits de l'enfant : exigences universelles et
prétentions africaines », in M.-J.RERDOR-FICHOT et
J.-M. LARRALDE (dir.), L'enfant. Cahiers de la recherche sur
les droits fondamentaux, Presses universitaires de Caen Basse-Normandie et
CRDFED, n°5, 2006, pp. 21-45.
+ BRILLON (Y.), « La délinquance
juvénile en Afrique noire et vision du monde », R.I.C.P.T.,
vol. XXXVL, n°4, 1983, pp. 12-34.
+ BUIRETTE (P.), « Réflexions
sur la Convention internationale des droits de l'enfant », R.B.D.I.,
vol.23, 1990, pp.54-73.
+ BUISSON (J.), « La garde à vue
dans la loi du 15 juin 2000 », R.S.C., n°1, 2001, p. 26 et
s.
+ CANNAT (P.), « La prison »,
Rev.pénit. et dr.
Pén., 1982, p. 163.
+ CAPPELAERE (G.) et VERHELLEN (E.), «
Les enfants et les lois dans une perspective internationale »,
Enfance, vol. 46, n°3, 1992, pp. 265-277.
+ CARIO (R.), « Le renforcement de la
spécificité éducative de la protection judiciaire de la
jeunesse », R.I.C.P.T., Vol. L., n°3, 1977, pp. 276-299.
680
+ CARTIER (E.M.), « La judiciarisation
de l'exécution des peines », R.S.C., n°1, 2001, p. 87
rt s.
+ CASSAGNABERE (B.), « Le mineur et la
prison : le service éducatif auprès du tribunal »,
Rev.pénit. et dr.
Pén., n°2, 1996, pp. 158-182.
+ CASSESE (A.), La valeur des droits de
l'homme, in Mélanges René-Jean DUPUY, Editions A.
PEDONE, Paris 1991, pp.65-75.
+ CASSESSE (A), « Les droits de l'homme
sont-ils véritablement universels ? », RUDH, 1989,
n°1-12, volume 1, pp. 13-18.
+ CERDA (J.S.), « The draft Convention on
the Rights of the Child : New Rights », Hum. Rts. Q., vol. 12,
n°1, 1990, pp.115-119.
+ CHAZAL (J.) et DELACROIX (V.), « La
loi du 14 mai 1951 relative à l'enfance délinquante »,
Gal. Pal., 1951-2-21.
+ CHAZAL (J.), « Le petit enfant devant
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante », Gal, Pal., 1954-1-Doc., p. 26 et s.
+ COLLINS (T.M.), « Monitoring : more
than a report », in T. COLLINS et al. (dir.), Droits de l'enfant,
Actes de la Conférence internationale, Ottawa 2007, coll. «
Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, pp.3-15.
+ CONAC (G.), Le juge Constitutionnel en
Afrique : censeur ou pédagogue, in Les Cours suprêmes en
Afrique, II, Ed. Economica, 1989, pp. 7-16.
+ COSLIN (P.G.), « Déviance et
culture à l'adolescence », Bull. psy., T. XLVIII,
n°419, 1994-1995, p.365 et s.
+ COSTA (J.-L.), « La politique de la
prise en charge de la jeunesse inadaptée et évolution de la
criminalité juvénile », R.S.C., 1979, pp.
753-785.
+ COSTA-LASCOUX (J.), « Les mutations
de la justice des mineurs » in problèmes politiques et
sociaux, n° 669, 13 déc., 1991, p. 16.
+ COUTURIER-BOURDINIERE (L.), « La
Convention européenne des droits de l'homme et la protection des droits
de l'enfant », in Liberté, Justice, Tolérance.
681
Mélanges en hommage au Doyen Gérard
Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant, 2004, vol. I, pp.523-549.
+ COUVRAT (P.), « Prisons des villes ou
prisons es champs », Justices, n° 2, 1995, p. 105.
+ CROUZATIER (J-M), TZITZIS (S), YACOUB (J), BOUCAUD
(P), KOUDE (R), LEVINET (M), TOMUSCHAT (C), BEN ACHOUR (Y), « La
Déclaration universelle des droits de l'homme a-t-elle encore un sens ?
», Revue d'études francophones sur l'Etat de droit et la
démocratie, Dossier, Hors-Série, 2009, pp. 1128.
+ D'OLIVEIRA (B.), « Aperçu
socio-anthropologique de la maltraitance en Afrique », in
Thérèse AGOSSOU (éd), Regards d'Afrique sur la
maltraitance, Paris, Karthala, 2000, 277 p. pp.59-63.
+ DEBENNE (C.), et HOFMANN (E.), «
Trafic des enfants au nord du Bénin : causes et approche de solutions
», IATU, Bordeaux, 2004, 43 p.
+ DECAUX (E), « La réforme du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
» in Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos. « Droit et
justice », sous la direction de DUPUY (J-R), Paris, Editions A.
Pedone, 1999, pp. 405-415.
+ DECAUX (E), « Les Nations Unies et
les Droits de l'homme : 60 ans après... », CRDF, 2009,
n°7, pp. 33-47.
+ DECAUX (E), « Éducation et
droits de l'homme » in L'homme et le droit. Mélanges en hommage
au Professeur Jean-François Flauss, Paris, Editions A. Pedone,
2014, pp. 255-269.
+ DEJO (O.), « Protecting children's
rights in Africa: A critique of the African charter on the rights and welfare
of the child », Int'l J. Child. Rts., vol. 10. 2002,
pp.127-136.
+ DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), « La
Convention internationale des droits de l'enfant : quelles répercussions
en droit français ? », C.R.D.F., 2006, n°5, pp.
39-43.
+ DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), «
L'effectivité de la CIDE : rapport de synthèse », Les
Petites affiches, octobre 2010, n° 200, pp. 35-42.
682
+ DEMERS (V.), « Le contrôle
des fumeurs-Une étude d'effectivité du droit »,
Thémis, Montréal, 1996, pp.15-24.
+ DHOMMEAUX (J.), « De
l'universalité du droit international des droits de l'homme : du pactum
ferendum au pactum latum ». In : AFDI, volume 35, 1989. pp.
399-423.
+ DHOMMEAUX (J), « La contribution du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations
Unies à la protection des droits économiques, sociaux et
culturels », AFDI, 1994, n°40, volume 40, pp.
633-657.
+ DHOMMEAUX (J.), « La typologie des
droits de l'homme dans le système universel », dans E.
BRIBOSIA et L. HENNEBEL (dir.), Classer les
droits de l'Homme, Collection Penser le Droit, Bruxelles, Bruylant, 2004,
pp.265-297.
+ DHOMMEAUX (J), « Les nouveaux droits
de l'homme et l'ONU : le 3ème pilier » in Nouveaux droits de
l'homme et internationalisation du droit, sous la direction de
DOUMBEBILLE (S), Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 213-238.
+ DHOMMEAUX (J), « Les droits
économiques, sociaux et culturels dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et leur devenir » in L'homme dans la
société internationale. Mélanges en hommage au Professeur
Paul Tavernier, sous la coordination générale de
AKANDJI-KOMBE (J-F), Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 645-664.
+ DHOMMEAUX (J), « Les recours
individuels devant les neuf organes conventionnels des Nations Unies :
étude comparative » in L'homme et le droit. Mélanges en
hommage au Professeur Jean-François Flauss, Paris, Editions A.
Pedone, 2014, pp. 271-292.
+ DIENG (M.M.), « Les
difficultés d'application des Conventions en matière de droits de
l'homme en Afrique : Cas de la Convention sur les droits de l'enfant au
Bénin » in Revue de Droit Africain, n°17 janvier
2001, Bruxelles, RDJA, pp. 32-48.
+ DOI (T.) et SUGIMOTO (I.), « Deux
catégories de mineurs récidivistes : ceux qui s'attaquent
à la propriété et ceux qui se livrent à la violence
», Rev. Internat. Pol. crim. 1967, p. 24 et s.
v
683
DORAIS (M.), « L'exploitation sexuelle
des enfants : des situations et des réflexions », in L.
LAMARCHE et P. BOSSET (dir.), Des enfants et des
droits, Sainte-Foy, PUL, 1997, pp.57-64.
v DOSSO (B.), « Centre de
rééducation de Dabou, Voir autrement la réinsertion
», Frat.Mat. du mardi 7 mai 1991, p.2.
v DOUMBE-BILLE (S), « La
juridictionnalisation des droits de l'homme en Afrique : « much ado about
nothing » ? » in L'homme dans la société
internationale. Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier,
sous la coordination générale de AKANDJI-KOMBE (J-F), Bruxelles,
Bruylant, 2013, pp. 693-706.
v DOUMBE-BILLE (S.), « Un quart de
siècle de protection des droits de l'homme en Afrique », in
Mélanges en l'honneur du Professeur Petro Pararas, Bruxelles, Bruylant,
2009, pp.133-141.
v DUBLINEAU (J.), « La surveillance
éducative des jeunes délinquants en milieu libre »,
R.S.C., 1952, p. 53 et s.
v DUBOIS DE GAUDUSSON (J), « La justice
en Afrique : nouveaux défis, nouveaux acteurs », Afrique
contemporaine, 2014/2, pp. 13-28.
v DUPUY (P.M), « L'unité de
l'ordre juridique international. Cours général de droit
international public », RCADI, vol.297, 2002, p.200.
v ERRE (C.), « La gendarmerie nationale
face à la délinquance juvénile. Réagir »,
Revue de la gendarmerie Nationale, Ministère de la justice,
n°186, 1997, pp. 10-12.
v FALL (B. A.), « L'universalité
des droits de l'homme et pluralisme des normes juridiques en Afrique. Analyse
d'un paradoxe » in Jérôme Ferrand, Hugues Petit et al.,
L'odyssée des droits de l'homme, Enjeux et perspectives des droits de
l'homme, Tome III, Collectif, Paris, l'Harmattan, 2004, 125 et s.
v FALL (B. A.), « Universalité
des droits de l'Homme et pluralité juridique en Afrique » in La
constitution et les valeurs, Mélange en l'honneur de Dmitri Georges
Lavrof, Paris, Dalloz, 2005, pp. 359-380.
v FALLON (M.), « Questions actuelles de
conflit de lois relatives à l'enfant », in J-L.Renchon (dir.),
L'enfant et les relations familiales internationales, Actes du VII
684
Colloque de l'Association « Famille et droit »
Louvain-La-Neuve organisé les 19 et 20 octobre 2001, Bruylant,
Bruxelles, 2003, pp.40-82.
+ FASSASSI (I), « De la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies au Conseil des droits de l'homme »,
RDP, 2009, n°1, pp. 171-196.
+ FASSASSI (I), « L'Examen
périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme »,
RTDH, 2009/9, pp. 739-761.
+ FAU-NOUGARET (M), « Le contrôle
du respect des droits de l'homme par la Banque mondiale : le Panel d'Inspection
» in MELIN-SOUCRAMANIEN (F) (Contributions réunies par),
Espaces du service public. Mélanges en l'honneur de Jean du Bois de
Gaudusson, Tome I, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2013, pp.
255-270.
+ FAUGERON (C.), « Le sentiment
d'insécurité chez les adolescents. Approche psychanalytique
», Les cahiers de la sécurité intérieure,
n°5, 1991, pp.50-66.
+ FIERENS (J.), « La Charte Africaine
des droits de l'homme et des peuples au regard de la théorie des droits
fondamentaux », in Revue Burkinabè de droit, n°18,
juillet 1990, pp.251-283.
+ FOUDA (G.), « L'accès au droit en
Afrique », Afrilex, Bordeaux, 2000-2001, 11 p.
+ FULCHIRON (H.), « Les Conventions
internationales. Présentation sommaires », in L'enfant et les
Conventions internationales, Dir. J. Rubellin-Devichi et R. Frank, Lyon,
Presse Universitaire de Lyon, 1996, pp.19-33.
+ GASSIN (R.), « Les fondements
juridiques de la réinsertion des délinquants dans le droit
français », R.S.C., 1996, p.155 et s.
+ GEORGEL (J.), « Aspects du
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 », in
R.D.P, 1960, pp.85-101.
+ GHERARI (H.), « La Charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant », Etudes
internationales, vol. 22, n° 4, 1991, pp.735-751.
685
+ GHERARI (H), « La Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples » in LEBRETON (G), Valeur
républicaine et droits fondamentaux de la personne humaine en 2003 et
2004, Paris, l'Harmattan, 2006, pp. 169-183.
+ GIRAULT-MONTENAY (H.), « La
délinquance juvénile des moins de 13 ans », Dr. Enf.
Fam., 1981/2, p.79 et s.
+ GLASER (S.), Les droits de l'homme
à la lumière du droit international positif, in
Mélanges offerts à Henri ROLIN, Editions A. PEDONE,
Paris, 1964, pp.104-123.
+ GLEEN (P.), « Le droit international
privé du divorce et de la filiation adoptive : un renversement de la
méthodologie conflictuelle », R.G.D., vol. 19. 1988,
pp.359-372.
+ GLELE-AHONZON (M.), « Pour un Etat de
droit en Afrique », in Mélanges Pierre-François Gonidec,
L'Etat moderne : Horizon 2000, Aspects internes et externes, Paris, LGDJ,
1985, pp.181-193.
+ GLELE-AHONZON (M.), « Introduction
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples » in
Organisation de l'Unité Africaine, Etudes offertes à
Claude-Albert, Colliard, Paris, Pedone, 1984, pp.511-537.
+ GONIDEC (P.-F.) « Réflexions
sur l'Etat de droit en Afrique », Penant, n°783, 1984,
pp.16-40.
+ GONIDEC (P.-F.), « Droit
international et droit interne en Afrique », in Recueil Penant
n°820, janvier-avril 1996, LeVésinet, Paris, pp.241-257.
+ GORCE (I.), « Les nouvelles
politiques de réinsertion », A.P.C., Ed. A. Pedone,
n°22, Paris, 2000, Pp. 105-111.
+ GOUTTENOIRE (A.), « La convention
internationale des droits de l'enfant dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme », in P. COURBE et al. (dir.),
Le monde du droit. Ecrits rédigés en l'honneur de Jacques
Foyer, Paris, Economica, 2008, pp.495-506.
+ GRANET (F.), « La Convention de
New-York sur les droits de l'enfant et sa mise en oeuvre en France », in
Jacqueline Rubellin-Devichi et Rainier Frank, (dir.) L'enfant et les
Conventions internationales, Presse Universitaire de Lyon, 1996, 492 p.,
pp.95-114.
686
+ GUEMATCHA (E), « La
justiciabilité des droits sociaux en Afrique : l'exemple de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples », Revue des
droits de l'homme, juin 2002, pp. 140-157.
+ HANSON (K.), « Repenser les droits de
l'enfant », in M. BONNET et al., Enfants travailleurs. Repenser
l'enfance, coll. « Cahiers Libres », Lausanne, éd. Page
deux, 2006, pp.101-129.
+ HARDY (A.), BOURSERIE (J.), « La
Convention internationale des droits de l'enfant et le principe fondamental de
protection de l'enfant en droit français », P. U.A.M.,
Aix-en-Provence, 2001, pp. 907-940.
+ HARREMOES (E.), « Les
réactions sociales à la délinquance juvénile vue
par le Conseil de l'Europe : aperçu des activités du
Comité européen pour la prévention du crime »,
Rev. Internat. De politique criminelle, n°39-40, 1990, Pp. 53 et
s.
+ HELLE (D.), « Optional Protocol on
the involvement of children in armed conflict to the Convention on the Rights
of the Child », RICR, vol.82, n°839, sept.2000,
pp.797-823.
+ HERZOG-EVANS (M.), « Les
particularités du droit pénitentiaire », Les cahiers de
la sécurité intérieure, n°31, 1998, Pp.19-34.
+ INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'ENFANT,
« L'intérêt supérieur de l'enfant. De
l'analyse littérale à la portée philosophique »,
Working Report 2-2003, 30 p. et « The best Interest of the Child
Principle: Literal Analysis and Function», International Journal of
Children's Rights, 2010, vol. 18, p. 483-499.
+ JAFFE (P.D.) (dir.), Défier les
mentalités. La mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant, Université de Genève, 1998,
pp.251-270.
+ JEAN-MARIE (B.), « Les fondements
historiques et philosophiques de la Convention relative aux droits de l'enfant
», Notes, Cours d'été international relatif aux droits
de l'enfant, du 8 au 15 août 2012, Université de Moncton,
Nouveau Brunswick, Canada.
687
+ JULLIEN (K.), « The Recent International
Efforts to End Commercial Sexual Exploitation of Children », Denv. J.
Int'L.& Pol'y, vol. 21, n°4, 2003, pp.579-605.
+ KAMTO (M.), « Une justice entre
tradition et modernité », in La justice en Afrique, Dir. Jean
du Bois de Gaudusson et Gérard Conac, Afrique Contemporaine
n°156 ; 1990, Paris, La Documentation Française, pp.57-64.
+ KELSEN (H.), « Les rapports de
système entre le droit interne et le droit international public »,
R.C.A.D.I., 1926, tome 14, Paris, Hachette, 1927, pp.231-331.
+ KELSEN (H.), « Transformation du
droit international en droit interne », R.G.D. I.P., Tome 9,
Paris, Dalloz, 1936, 768 p., pp. 5-49.
+ KHERAD (R), « La protection
internationale des droits de l'homme. Regard d'un juriste » in
AMSELLE (J-L), GUIRLINGER (L), HERITIER (F), JULLIEN (F), KHERAD
(R), LE BLANC (G),Diversité culturelle et
universalité des droits de l'homme, Nantes, Editions Cécile
Defaut, 2010, pp. 55-78.
+ KIGANAHE (D.), « Les droits de
l'homme et le nouveau code pénal burundais », Penant,
n°798, 1988, Pp.453-474.
+ KOUDE (R-K), « Les droits de l'homme
: de l'intuition universaliste à l'universalité
récusée », R.T.D.H., 2006, n°68, pp.
909-938.
+ KOUDOU (O.), « Environnement et
enracinement du comportement délinquant chez les adolescents en
Côte d'Ivoire », Institut Goethe d'Abidjan, 1994,
pp.221-235.
+ KOUDOU (O.), « Changement des
rapports d'autorité au sein des familles ivoiriennes contemporaines et
inadaptations sociales juvéniles », GIDIS-CI/ORSTOM,
Abidjan, 1994, Pp.34-49 .
+ KOUDOU (O.), « Discours sur la
démocratie et la place de l'enfant de la rue en Afrique : d'une
minorité en danger à une minorité dangereuse »,
Rev. Inter. De recherche et d'études pluridisciplinaires, GUREP,
n°4, 1997, Pp. 59-67.
+ KOUDOU (O.), « Familles
dissociées secondaires en Côte d'Ivoire et comportement
délinquant des adolescents », R.I.C.P.T., Vol. XLVII,
n°2, 1994, Pp.179-186 .
688
+ KOWOUVIH (S), « La Cour africaine des
droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du
concept de spécificité africaine en matière de droits de
l'homme », R.T.D.H., n°59, 2004, pp. 757-790.
+ KUSI (J A), « La compétence de
l'UNESCO en matière de droits de l'homme : réflexions critiques
sur quelques problèmes spécifiques » in Les droits de
l'homme à l'aube du XXIème siècle. Karel Vasak. Amicorum
Liber, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 599-631.
+ LAFONTAINE (F), « La
compétence universelle et l'Afrique : ingérence ou
complémentarité ? », Études internationales,
mars 2014, numéro 1, volume 45, pp. 129-151.
+ LAGARDE (P.), « La nouvelle
Convention de la Haye sur la protection des mineurs », Rev. Crit.
D.I.P., vol.86, n°2, 1997, pp.217-237.
+ LAINGUI (A.), « Histoire de la
protection pénale de l'enfant », Rev.Internat. De droit
pénal, 1979, Pp.521-533.
+ LAMPUE (P.), « Droit écrit et
droit coutumier en Afrique francophone », Penant, n°765,
1979, Pp.245-285.
+ LAPOYADE-DESCHAMPS, « Les petits
responsables, responsabilité civile et pénale de l'enfant »,
D.1988, p.299 et s.
+ LARRALDE (J-M.), « Les
réponses du droit international à la question des enfants soldats
», Cahiers de la recherche sur les Droits fondamentaux (CRDF),
vol. 5, 2006, Presses universitaires de Caen, pp. 65-78.
+ LARRALDE (J-M), « Concurrence des
procédures en droit international des droits de l'homme » in
KERBRAT (Y) (dir.), Forum shopping et concurrence des procédures
contentieuses internationales, Bruxelles, Bruylant, Collection «
Travaux de droit international et européen », juin 2011, pp.
104-125.
+ LASCOUMES (P.) et SERVERIN (E.), «
Théories et pratiques de l'effectivité du droit », Droit
et. Société, n° 2, 1986, pp.126-149.
+ LAVALLEE (C.) :
689
- « La Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale et
sa mise en oeuvre en droit québécois », R.U.D.S.,
vol.35, 2005, pp.356-374.
- « L'actualisation des droits de
l'enfant dans une perspective globale : entre l'universalité de la
Convention relative aux droits de l'enfant et les particularismes de la Charte
africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant », in J. Otis
(dir.), Démocratie, droits fondamentaux et
vulnérabilité, Presa Universitara, Clujeana, 2006,
pp.267-290.
- La parole de l'enfant devant les instances
civiles : une manifestation de son droit de participation selon la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant », in V. FORTIER et S.
LEBREL-GRENIER (dir.), La parole et le droit, Rencontres juridiques,
Montpellier-Sherbrooke, Editions R.D.U.S., 2009, pp.121-137.
- « Respect des droits de l'enfant
», in JurisClasseur Québec, Droit des personnes et de la
famille, coll. « Droit civil », fasc.3, Montréal, Lexis Nexis
Canada, f.mob. , pp.1-28.
v LAVALLEE (C.) et GIROUX (M.), « Le
droit de l'enfant québécois à la connaissance de ses
origines évalué à l'aune de la Convention internationale
relative aux droits de l'enfant », R. du B., vol. 72, 2013, pp.
147-175.
v LAZERGES (C.) :
- « Le renforcement de la
présomption d'innocence et des droits des victimes. Histoire d'une
navette parlementaire presque achevée », A.P.C., Ed. A.
Pedone, n°22, 2000, Paris, p.60 et s.
- « De l'irresponsabilité
à la responsabilité des mineurs délinquants ou relecture
des articles 1et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 »,
R.S.C., 1995, p.149. et s.
- « La réinsertion, une
réalité à facette multiple », A.P.C., Ed. A.
Pedone, n°22, Paris, 2000, Pp. 99-104.
690
- « Evolution de la délinquance
urbaine contemporaine », Justices, n°2, 1995, Pp.79-91.
- « Quel droit pénal des mineurs
pour l'Europe de demain ? », Mélanges offerts à Georges
LEVASSEUR, Ed. Litec, 1992, pp.435-448.
+ LAZERGES (C.), BALDUYCK (J. P.), «
Réponses à la délinquance des mineurs. Mission
interministérielle sur la prévention et le traitement de la
délinquance des mineurs. Synthèse du rapport au premier ministre
», Justices, n°10, 1998, p.122 et s.
+ LEBLANC (M.), « Stabilité de
la conduite délinquante des adolescents et constance du mécanisme
de régulation personnelle et sociale », R.I.C.P.T., Vol.
XLVI, n°2, 1993, Pp.135-151.
+ LE GRAND (V.), « La naissance de
l'enfant dans l'Histoire des idées politiques », in M.-J.
REDOR-FICHOT et J.-M. LARRALDE (dir.), L'enfant. Cahiers de
recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit,
Presse universitaire de Caen Basse-Normandie et CRDFED, n°5, 2006, pp.
11-22.
+ LEROY (E.), « Les droits de l'homme
entre l'universalisme hâtif et le ghetto des particularismes culturels
», Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la
communauté francophone (1993 : University of Mauritius), coll.
« Prospectives francophones. Universités francophones »,
Montréal, AUPELF-UREF, 1994, pp.59-70.
+ LEROY (Y.), « La notion
d'effectivité du droit », Droit et société,
vol. 79, no. 3, 2011, pp. 715-732.
+ LEGRE OKOU (H.), « Autorité
traditionnelle et développement en Afrique. Le cas de la Côte
d'Ivoire de 1960 à nos jours », Ann. de l'Université de
Toulouse, T.XL, 1992, Pp.167-180.
+ LOPATKA (A.), « La convention
relative aux droits de l'enfant », in International revue of
pénal Law, Vol 62, p.765-777.
+ LORHO (G.), « Les alternatives
à l'emprisonnement ou l'art baroque en droit pénal »,
R.S.C., n°1, 1991, Pp.53-57.
691
+ LORVELLEC (S.), « Procédure
pénale et mineurs : A propos de quelques lis françaises
récentes », R.I.C.P.T., n°2, 1996, Pp.147-158.
+ LUCHAIRE (F.),
- Le Conseil constitutionnel et la
protection des droits et libertés du citoyen, In Mélanges
WALINE, 1974, Tome II, pp. 563-575.
- Procédures et techniques de
protection des droits fondamentaux. Conseil Constitutionnel
français, Actes du IIè Colloque d'Aix-en-Provence, 19-20 et
21 février 1981, Economica et Les Presses universitaires
d'Aix-Marseille, pp.517-529.
- Les droits et libertés garantis par
la déclaration de 1789, in La Constitution de la République
française. Analyses et commentaires, Economica, Paris, 1979, p.41
et s.
+ M'BAYE (K.) :
- Droits de l'Homme et pays en
développement, in Mélanges René-Jean DUPUY,
Editions A. PEDONE, Paris 1991, pp.211-222.
- L'Afrique et les droits de l'Homme, in
Penant 1994, 16p.
- « Les réalités du monde
noir et les droits de l'homme », in Revue des droits de l'homme
(RDH), n°3, 1969, pp.382- 393.
+ MANDE-DJAPOU (J.), « La
législation centrafricaine en matière de protection de l'enfance
», Penant, n°807, 1991, Pp.309-318.
+ MANGIN (G.), « La délinquance en
Afrique noire francophone », A.P.C., Ed. A. Pedone, 1975, p.8.
+ MAGNOL (J.) :
- « L'ordonnance du 2 février
1945 sur l'enfance délinquance », R.S.C., 1946, p.7 et
s.
692
- « La loi n°51-687 du 24 mai
modifiant l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante », R.S.C., 1951, p.445 et s.
+ MARTAGUET (P.), « Le nouveau droit
pénal des mineurs », R.I.C.P.T., Vol. XXXVII, n°4,
1984, Pp.418-436.
+ MARTAGUET (P.), « La convention
internationale des droits de l'enfant », in Enfance, n° 1 et
2, 1990, p.132.
+ MARTIN-CHENUT (K.), « La protection
des enfants en temps de conflit armé et le phénomène des
enfants soldats », in J.-M. SOREL et C. -L. POPESCU (dir.), La
protection des personnes vulnérables en temps de conflit
armé, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp.159-256.
+ MELEDJE Djédjro (F.) :
- La problématique de la protection des
droits de l'homme en période de crise, inédit, 4p.
- Les rapports entre le droit international et
le droit interne : Application à l'ordre juridique ivoirien,
inédit.
+ MEULDERS-KLEIN, (M.-T.), « Les Droits
de l'enfant. A la recherche d'un équilibre entre parents et enfants
», in L'enfant et les conventions internationales, Jacqueline
Rubellin-Devichi et Rainer Franck, (dir.), Lyon, Presses universitaires de
Lyon, 1996, pp.133-149.
+ MEYER-FABRE (N.), « La convention de
la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale », Rev. Crit. D.I.P.,
vol.83, n°2, avril-juin 1994. pp.259-295.
+ MUBIALA (M.), « Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples et cultures africaines », R.Q.D.I.,
vol.12.2. 1999, pp. 197-206.
+ MUBIALA (M.), « La Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples : Mimétisme institutionnel ou
avancée judiciaire ? », R.G.D.I.P., n°3, 1998,
pp.765-780.
693
+ MUBIALA (M), « L'accès de
l'individu à la CADH » in La promotion de la justice des droits
de l'homme et du règlement des conflits en droit international,
sous la
direction de KOHEN (M-G), Leiden, Amicorum Conflisch, 2007, pp.
369-378.
+ MIGNOT Alain, « La justice
traditionnelle, une justice parallèle. L'exemple du Sud-Togo »,
Penant, n°775, Pp.5-30.
+ MUCCHIELLI (L.), « L'expertise
policière de la violence urbaine. Sa contribution intellectuelle et ses
visages dans le débat public français », Déviance
et société, vol.24, n°4 , 2000, Pp.351-375.
+ MUNGAL (A.), « Jeunesse africaine et
monde moderne », R.I.C.P.T., Vol. XL, n°4, 1987,
Pp.423-435.
+ N'GOUAN (K. P.), Quelle prise en compte de
la pauvreté dans la gestion du budget de l'Etat ?, in
Pauvreté et droits de l'Homme en Côte d'Ivoire, Colloque
international organisé par la LIDHO à l'occasion de la
20e anniversaire, du 18 au 20 octobre au CERAP, Editions
l'Harmattan, Octobre 2008, pp.201-222.
+ NGOMO (A-F), « Des droits de la femme
et de l'enfant en Afrique : Réflexions sur l'article 18 alinéa 3
de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples », Revue
juridique et politique des Etats francophones, juillet-septembre 2007,
n°3, pp. 331-355.
+ NGUEMA (I), « La promotion et la
protection des droits de l'homme à l'heure des ajustements structurels
», Actes du Colloque de Ouagadougou sur la « la promotion et la
protection des droits de l'homme à l'heure des ajustements
structurels, Genève, OMCT/SOS Torture, 1994, pp. 189-203.
+ NWOBIKE (J.C.), « The African
Commission on Human and Peoples'Rights and the demystification of second and
third generation rights under the African Charter : Social and Economic Rights
Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR) v.
Nigeria », Afr. J. Legal Stud., vol. 1, n°2, 2005,
pp.129-146.
694
+ O'FLAHERTY (M), « Le respect des
droits de l'homme et les situations de conflit armé : les
difficultés des Nations Unies» in Les droits de l'homme, la
sécurité humaine et le désarmement, Forum du
désarmement, 2004, n°3, pp. 53-65.
+ OLINGA (A-D), « Regards sur le
premier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Michelot Yogogombaye c.
Sénégal, 15 décembre 2009 », R.T.D.H., 2010,
n°83, pp. 749-768.
+ OLINGA (A-D), « Pratique de la Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples au cours de l'année 2011
», R.T.D.H., n°93, 2013, pp. 123-143.
+ ONDOUA (A), « L'internationalisation
des Constitutions en Afrique subsaharienne francophone et la protection des
droits fondamentaux », R.T.D.H., n°98,2014, pp. 437-457.
+ OUGERGOUZ (F.), « La Charte africaine
des droits de l'Homme et des peuples, Une approche juridique des droits de
l'Homme entre tradition et modernité », P.U.F.,
Publications de l'IUHEI, 1993, XXIX, 479 p.
+ OUGUERGOUZ (F.), La Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples : Présentation et bilan
d'activités (1988-1989). In : Annuaire français de droit
international, volume 35, 1989. pp. 557-571.
+ OLINGA (A.D.) :
- « La Charte africaine sur les droits et
le bien-être de l'enfant. Essai de présentation »,
Penant, vol. 106. n° 820, Janvier-avril 1996, pp.53-68.
- « Regards sur le premier arrêt de
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples », R.T.D.H.,
vol.83, 2010, pp. 749-768.
+ OLOKA-ONYANGO (J.), « Quelques
réflexions à propos du cadre africain des droits
économiques, sociaux et culturels », R. Comm. I. Jur.,
vol. 55, 1995, pp.185-213.
+ OTTENHOFF (R.), « Jeunes auteurs et
jeunes victimes : Unité ou dualité », R.I.C.P.T.,
Vol. XLII, n°4, 1989, Pp. 455-463.
695
+ OUIZAN-BI (H.), « Les enfants de la
rue à Abidjan. De la recherche action à l'action de terrain
», Actes du Symposium internat. d'Abidjan, 5-7 mai, 1997,
Pp.181-284.
+ PARTSH (K.J), « La mise en oeuvre des
droits de l'homme par l'UNESCO. Remarques sur un système particulier
», AFDI, 1990, numéro 36, pp. 482-506.
+ PELLET (A), « Droits-de-l'hommisme et
Droit international », Droits fondamentaux,
juillet-décembre 2001, n°1, pp. 167-179.
+ PERCHERON (A.), ROY (B.), « Les
jeunes entre sécurité et liberté », Les cahiers
de la sécurité intérieure, n°5, 1991,
pp.29-44.
+ PINATEL (J.), « Doctrine et pratique
en matière de délinquance juvénile », R.I.C.P.T.,
Vol. XXXVI, n°1, 1983, Pp.50-61.
+ POILLOT PERUZZETO (S.), « Les droits
de l'enfant dans l'espace communautaire » in D. GADBIN et
F. KEMALEGUEN (dir.), Le Statut juridique de l'enfant dans
l'espace européen, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 31-64.
+ POULIN (R.), « La prostitution des
enfants, la notion de consentement et la Convention relative aux droits de
l'enfant », in T. COLLINS et al. (dir.), Droits de l'enfant : actes de
la Conférence international Ottawa 2007, Montréal, Wilson
& Lafleur, 2008, pp.187-203.
+ POITOU (D.), « Pratiques
traditionnelles et processus de marginalisation de la jeunesse africaine
», R.I.C.P.T., Vol. XL, n°4, 1987, Pp.395-407.
+ PRISO-ESSAWE (S.-J.), « Pratiques
traditionnelles et intégrité physique en Afrique subsaharienne.
Droit international. Législations nationales et protection des femmes et
des enfants. », in Cahiers de l'IDEDH (Montpellier), n°7,
1999, pp.78-93.
+ QUILLERÈ-MAJZOUB (F.), «
L'option juridictionnelle de la protection des droits de l'Homme en Afrique.
Etude comparée autour de la création de la Cour africaine des
droits de l'Homme et des peuples », in R.T.D.H., n°44,
octobre 2000, pp. 729785.
+ RANGEON (F.), « Réflexions sur
l'effectivité du droit », in CURAPP, Les usages sociaux du
droit,. PUF, 1989, pp. 126 et svts.
696
+ REDOR-FICHOT (M-J), «
L'indivisibilité des Droits de l'homme », CRDF, 2009,
n°7, pp. 75-85.
+ REDOR-FICHOT (M.-J.), «
Synthèse », in M.-J. REDOR-FICHOT et J.-M. LARRALDE
(dir.), L'enfant. Cahiers de recherche sur les droits fondamentaux
et les évolutions du droit (CRDFED), Presse universitaire de Caen
Basse-Normandie et, n°5, 2006, pp.109-112.
+ RENUCCI (J. F.) :
- « La justice pénale des mineurs
», Justices, n° 10, 1998, Pp.111-132.
- « Les juridictions pour mineurs »,
J-Cl., Pén., 1995, art.122-8, Fasc. 30, p.8.
- « Mineur délinquant. Mesures
applicables aux mineurs », J.-Cl., Dr. Pén., 1995, Fasc.
n°20, art. 122-8.
- « Droit pénal des mineurs.
L'actualité du droit pénal français des mineurs »,
R.I.D.P., 1992, vol.63, p.435 et s.
+ RIVERO (J.), Les garanties
constitutionnelles des droits de l'homme en droit français, in Revue
internationale de droit comparé, 1977, p.9 et s.
+ RUPERT, « Choses vues à
Abidjan », Jeune Afrique, n° 1879, 8-14 janv. 1997, p.22.
+ SALAS (D.) « Quel avenir pour la
justice des mineurs ? », in Le droit dans la société,
Cahiers français, n° 288, p.72 et s.
+ SECCAUD (C.), « La conception de
l'enfance en droit international. Illustration par les enfants travailleurs
», R.Q.D.I., vol. 24.1, 2011, pp. 131-170.
+ SECK (M), « Plaidoyer pour
l'éducation en matière de droits de l'homme en Afrique »,
R.U.D.H., 1989, n°1-12, volume 1, pp. 34-41.
+ SERMET (L), « De la carence dans la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de la clause de
dérogation aux droits de l'homme », RGDIP, 2005-2, pp.
389-406.
+ SERIAUX (A.), Entre Justice et droits de
l'homme : la condition juridique de l'embryon, in Actualités
juridiques, n°30-31, Août-Sept 2002, pp. 3-6.
697
+ SCHULER-SPRINGORUM (H.) :
- « Les instruments des Nations Unies
à la délinquance juvénile », R.I.C.P.T.,
Vol. XLII, n°2, 1994, Pp. 153-164.
- « Sociétés modernes et
délinquance juvénile. Politique nationale en matière de
délinquance juvénile », R.I.C.P.T., Vol. XXXVI,
n°2, 1993, Pp31-41.
+ SINKONDO (M. H.,) « La Charte
africaine des droits de l'Homme et des peuples ou les apories juridiques d'une
convention encombrante », Penant, n°816, Pp. 288309.
+ SOREL (J-M), « Sur quelques aspects
juridiques de la conditionnalité au FMI et leurs conséquences
», Journal européen de droit international, 1996/1, pp.
42-66.
+ SOW (A-I), « Les juges de la cour
africaine des droits de l'homme et des peuples », in Revue Juridique
et Politique. Indépendance et Coopération, n°1,
janvier-avril 2001, pp.38-54.
+ SZABO (D.), « Pour une science
criminelle de la politique criminelle », R.I.C.P.T., Vol. XLVI,
n°2, 1992, Pp. 117-182.
+ TALL (A.), « Un
phénomène aux antipodes de la Convention Internationale des
Droits de l'enfant : Les enfants Talibés des rues de Dakar », in
Revue de Droit Africain (RDJA), n°39, Bruxelles juillet 2006, pp.
261-273.
+ TALPIS (J.-A.), « Quel est l'impact
de la Convention de la Haye sur l'adoption internationale ? », in
Québec (prov.), Secrétariat à l'adoption
internationale, Dessine-moi une famille, Ministère de la
Santé et des Services sociaux, 1995, pp.133-146.
+ TARDU (M), « Le nouveau Conseil des
droits de l'homme aux Nations Unies : décadence ou résurrection
», RTDH, n°72, 2007, pp. 967-991.
+ THIOYE (M.), « Part respective de la
tradition et de la modernité dans les droits de la famille des pays
d'Afrique noire francophone », R.D.I.C., vol.57, n°2, 2005,
pp.345-397.
698
+ TIGROUDJA (H.), « Propos conclusifs :
La légitimité du particularisme interaméricain des droits
de l'homme en question » in L. Hennebel et H. Tigroudja (dir.), Le
particularisme interaméricain des droits de l'homme. En l'Honneur du
40e anniversaire de la Convention américaine des droits de
l'homme, Paris, éd. A. Pedone, 2009, pp. 383-413.
+ TRAORE (B.), « Droits de l'homme en
Afrique : évolution de leur conception et de leur pratique »,
Annales africaines, 1986-1988, pp.149-176.
+ TREBILCOCK (A.), « Le droit à
un niveau de vie suffisant, la protection de, et l'assistance à, la
famille », in J-M. THOUVENIN et A. TREBILCOCK (dir.), Droit
international social. Droits économiques, sociaux et culturels,
t.2, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 1663-1742.
+ TOGBA (Z.), Le droit des conventions
internationales dans la Constitution ivoirienne de 1960, in Annales de
l'Université d'Abidjan, 1985, série A, Tome VII, Droit,
1985, pp. 159-219.
+ TOURNIER (P.), « Jeunes en prison
», Rev. Pénit. Et dr. Pén., n°2, 1994,
Pp.135-161.
+ TRIEPEL (H.), « Rapports entre le
droit interne et le droit international », RCADI, 1923, tome 1,
Paris Hachette, 1925, pp.77-119.
+ TROISIER (S.), « Les enfants
délinquants », Rev. Internat. pol. Tech., 1976, p.61
et s.
+ VAN BUEREN (G.), « Child sexual abuse
and exploitation : A suggested human rights approach », Int'l J.
Child. Rts., vol.2, 1994, pp.45-59.
+ VAN LOON (J.H.A.), « Les Conventions
de la Conférence de la Haye », in J. RUBELLIN-DEVICHI et
FRANK (dir.), L'enfant et les conventions internationales,
Lyon, PUL, 1996, pp.49-69.
+ VASAK (K.), « Le droit international
des droits de l'homme », in RCADI, 1974, tome 140, 429 p., pp.
335-415.
+ VEDEL (G.), Les droits de l'Homme : quels
droits ? quel homme ?, in Mélanges René-Jean
DUPUY, Editions A. PEDONE, Paris, 1991, pp.349-362.
v
699
VERDIER (R.), « Problématique des
droits de l'homme dans les droits traditionnels d'Afrique Noire », in
Droit et cultures, n° 5, 1983, pp. 97-103.
v VIRALLY (M.), « La valeur juridique
des recommandations des organisations internationales », in AFDI,
volume 2, 1956, pp.66-96.
v WODIE F.
- Le droit en question (Questions de droit/ Réponses
du droit) Du droit et des faits !, Educi, 2017, 37p.
- L'esprit et la lettre de l'Accord de Linas-Marcoussis, 26
Août 2003, inédit, 13p.
- La loi, Conférence inaugurale à la
Faculté de Droit d'Abidjan (1996), in Actualités
Juridiques, Aout-Septembre 2001, pp.5-8.
- La législation en matière de droits de
l'Homme en Côte d'Ivoire, in Les droits de l'homme en Afrique,
Institut des droits de l'homme et de la paix, Dakar, juillet 1991, p.137 et
s.
- La législation, Encyclopédie juridique de
l'Afrique, Tome 1, L'Etat et le Droit, NEA, Abidjan, Dakar, 1982,
pp.307-330.
- 100 questions-100 réponses pour la Côte
d'Ivoire, Programme de gouvernement du PIT, inédit 35p.
v WILSON (B.), « Quelques
réflexions sur l'adoption du protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des
Nations Unies », in RTDH, Bruxelles, Bruylant, n°77 janvier
2009, pp.295-317.
v YAO-N'DRE (P.),
- Relecture du droit international Public à la
lumière de la situation de l'Afrique depuis le XVIIIe siècle
jusqu'à nos jours, Annales de l'Université d'Abidjan,
Droit, Tome VIII, 1988, pp. 141-170.
- L'Universalité des droits de l'homme et le nouvel
ordre international, Revue ivoirienne de sciences juridiques n°4,
Abidjan, 1994-1995, pp.6-10.
700
6. YOUSSOUFI (A), « Réflexions sur
l'apport de la troisième génération des droits de l'homme
» in Les droits de l'homme à l'aube du XXIème
siècle. Karel Vasak. Amicorum Liber, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.
427-432.
6. ZAKPA (K. R.), Code nationalité et
code électoral, in Réformes institutionnelles en Côte
d'Ivoire. La question de l'éligibilité, Actes du Séminaire
international de l'A.D.I.R., P.U.C.I., Janvier 1999, pp.111-133.
6. ZANI (M), « Le Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies : un mécanisme d'affaiblissement ou de
renforcement des procédures de contrôle ? »,
Études internationales, 2008, n°3, volume 39, pp.
433-452.
6. ZERMATTEN (J.), « Face à
l'évolution des droits de l'enfant, quel système de protection ou
système de justice ? » R.I.C.P.T., Vol. XLII, n°2,
1994, Pp.165-178.
VI - ACTES DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
6. Centre de Recherche Innocenti, « La
traite des êtres humains en Afrique, en particulier des femmes et des
enfants », Florence, 2004, 72 p.
6. Centre de recherche Innocenti, « La
traite des êtres humains en Afrique, en particulier des femmes et des
enfants », Florence Italie, 2004. Document disponible sur le site :
www.unicef-irc.org,
(consulté le 10 mai 2012).
6. Communiqué de presse.
Présentation de l'Insight Innocenti : « La traite des êtres
humains en Afrique, en particulier des femmes et des enfants » Embargo le
23 avril 2004.
6. Conseil d'Etat (France), « Statut et
protection de l'enfant : rapport adopté en mai 1990 », la
Documentation française, Paris, 1991, 232 p.
6. JACOB (A.), « Les droits de l'enfant :
quelle protection demain ? » Actes du colloque organisé par la
société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence, Paris,
Lierre et Coudrier, 1991, 336 p.
701
+ Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées au
Droit Privé, « L'enfant, la famille et l'argent », Actes
des journées d'études des 13 et 14 décembre 1990,
Paris, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1991, 217
p.
+ LAND (J.), « Rapport d'information
sur la protection des droits de l'enfant dans le monde », Paris,
Assemblée nationale, 1997, 344 p.
+ La décentralisation. Etudes comparées des
législations ivoirienne et française, Actes du colloque
international organisé par la faculté de droit de
l'Université nationale de Côte d'Ivoire et l'Université des
Sciences sociales de Toulouse I, Abidjan 9-12 mai 1988, 228p.
+ L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays
de la communauté francophone, Colloque international, 29 et 30
septembre, 1er octobre 1993, Port-Louis (République de
Maurice), Editions AUPELF-UREF, Montréal, 1994, 687p.
+ Les droits de l'homme en Afrique Centrale, Colloque de
Yaoundé, 9-11 novembre 1994, UCAC, Karthala, Paris, 283p.
VII - DOCUMENTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
+ Bureau International du Travail, Travail des enfants.
Réponses politiques et législatives modernes au travail des
enfants, 2007, 165 p. (
www.ilo.org/ipec).
+ Bureau du Représentant spécial du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé, Les six violations graves commises envers les enfants
en temps de conflit armé : Fondements juridiques, Octobre 2009 (mis
à jour en novembre 2013), 32p.
+ Comité des droits de l'enfant, l'Observation
générale n°12(2009) Le droit de l'enfant d'être
entendu, .CRC/C/GC/12 du 20 juillet 2009.
+ Comité des droits de l'enfant des Nations Unies,
Document : CRC/GC/2003/5 du 27 novembre 2003.
+ Comité des droits de l'enfant, 33ème session,
Observations finales n°3, Le VIH/SIDA et les droits de l'enfant ,
2003, 15 p.
+ CRC/GC/2003/5 du 27 novembre 2003 du Comité des
droits de l'enfant des Nations
Unies.
702
+ CRC/GC/2003/5 du 27 novembre 2003 du Comité des
droits de l'enfant des Nations Unies.
+ Comité des Droits de l'enfant intitulée,
L'observation générale n°1 « Les buts de
l'éducation ». Doc.CRC/GC/2001/1 du 17 avril 2001.
+ CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), Comité des droits de
l'homme, commentaire général 29, states of Emergency (art.4).
+ E/C.12/1/Add.69, Observations finales du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels : Israel, 2001.
+ HCDH, Manuel des procédures spéciales des
droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, Nations Unies, 1999
révisé.
+ HCDH, Fiche d'information n°3. Services
consultatifs et de la coopération technique dans le domaine des droits
de l'homme, Office des Nations Unies à Genève, 15.
+ HCDH, Fiche d'information n°7. Procédures
d'examen des requêtes soumises par des particuliers en vertu des
instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, Office des
Nations Unies à Genève, 48 p.
+ HCDH, Fiche d'information n°10. Les droits de
l'enfant, Genève, Office des Nations Unies, 15 p.
+ HCDH, Fiche d'information n°11. Exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Genève, Office des
Nations Unies, 15 p.
+ HCDH, Fiche d'information n°15. Droits civils et
politiques : le Comité des droits de l'homme, Office des Nations
Unies à Genève, 73 p.
+ HCDH, Fiche d'information n°19. Institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme,
Office des Nations Unies à Genève, 12 p.
+ HCDH et OMS, Fiche d'information n°31. Le droit
à la santé, Nations Unies, Droits de l'homme, Office des
Nations Unies à Genève, 57 p.
703
+ HCDH et UNESCO, Éducation aux droits de l'homme
dans les systèmes d'enseignement primaire et secondaire : Guide
d'auto-évaluation à l'intention des gouvernements, New-York
et Genève, 2012, Nations Unies, UNESCO, 38 p.
+ HCDH et UNESCO, Plan d'action. Programme mondial en
faveur de l'éducation aux droits de l'homme. Première phase,
New-York et Genève, 2006, 62 p.
+ HCDH, Les droits de l'homme et le système des
Nations Unies : Des clés pour agir, Genève et New-York,
Nations Unies, 24 p.
+ HCDH, Guide pratique pour la société civile,
Fonds, subventions et Bourses en faveur des droits de l'homme,
Genève, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, 37 p.
+ HCDH, Guide pratique pour la société
civile. Examen Périodique Universel, Genève, Bureau du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme, 17 p.
+ HCDH, Guide pratique pour la société
civile. Le Forum social du Conseil des droits de l'homme, Nations Unies,
Droits de l'homme, 13 p.
+ HCDH, Travailler avec le programme des Nations Unies
pour les droits de l'homme : un manuel pour la société
civile, New-York et Genève, Droits de l'homme, 2008, 192 p.
+ HCDH, Droits de l'homme et application des lois. Guide
de formation aux droits de l'homme à l'intention des services de
police, Série sur la formation professionnelle n°5,
Genève et New-York, Nations Unies, 2003, 223 p.
+ HCDH, Protocole d'Istanbul. Manuel pour enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, Série sur la formation professionnelle
n°8, New-York et Genève, Nations Unies, 2005, 25 p.
+ HCDH, Les droits de l'homme et les prisons.
Répertoire de poche sur les normes internationales relatives aux droits
de l'homme à l'usage des agents pénitentiaires, Série
sur la formation professionnelle n°11, New-York et Genève, Nations
Unies, Droits de l'homme, 2004, 20 p.
704
+ HCDH, Droits économiques, sociaux et culturels.
Manuel destiné aux institutions nationales des droits de l'homme,
Série sur la formation professionnelle n°12, New-York et
Genève, Nations Unies, Droits de l'homme, 2004, 144 p.
+ HCDH, Évaluer les activités de formation
aux droits de l'homme. Manuel destiné aux éducateurs dans le
domaine des droits de l'homme, Série sur la formation
professionnelle n°18, Genève et Montréal, 2011, 139 p.
+ HCDH, La protection juridique internationale des droits
de l'homme dans les conflits armés, New-York et Genève,
Nations Unies, Droits de l'homme, 2011, 128p.
+ Nations unies A/CONF.157/24 (Part I) 13 octobre 1993,
portant « Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de
l'homme ».
+ Nations Unies et UIP, Droits de l'Homme. Guide pour
parlementaires, n°8 2005, 202 p.
+ Nations Unies, Fiche d'information n°7,
Procédures d'examen des requêtes ,54 p.
+ Nations Unies, Déclaration et programme d'action
de Vienne, 1993.
+ Nations Unies, A/RES/66/138, Assemblée
générale du 27 janvier 2012.
+ Nations Unies, Assemblée Générale,
A/6/583 du 20 novembre 2006.
+ Nations Unies, CRC/C/15/Add.106 du 24 août 1999.
+ Nations Unies, CRC/C/3/Add.25 du 4 juillet 1997.
+ Nations Unies, CRC/C/5 du 30 octobre 1991.
+ Nations Unies, CRC/C/58 du 20 novembre 1996.
+ Nations Unies, CRC/GC/2003/5 du 27 novembre 2003.
+ Nations Unies, CRC/GC/2003/5 du 27 novembre 2003.
+ Nations Unies, CRC/GC/2003/5 du 27 novembre 2003, portant
Observations générale N°5 (2003), Mesures d'application
générales de la Convention relative aux droits de l'enfant.
+ Nations Unies, Procédure d'examen des
requêtes, Fiche d'information n°7 (Rev.1), Genève, 2003,
54.
705
+ Nations Unies, Résolution A/RES/63/117.
+ Nations Unies, Résolution A/RES/66/138
l'Assemblé Générale des Nations Unies. + OIT, Intensifier
la lutte contre le travail des enfants, 2010, 112 p.
+ UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2008 :
La survie de l'enfant, Décembre 2007, 155 p.
+ UNICEF, Une approche de l'éducation pour tous,
fondée sur les droits de l'homme. Cadre pour la réalisation du
droit des enfants à l'éducation et de leurs droits au sein de
l'éducation, Paris, UNESCO, février 2008, 164 p.
+ UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2009 :
La santé maternelle et néonatale, Décembre 2008,
160p.
+ UNICEF, Fiche d'information sur la protection de
l'enfant : La traite d'enfants, Mai 2006, 2p ;
+ UNESCO, Déclaration et cadre d'action
intégré concernant l'Éducation pour la Paix, les Droits de
l'homme et la Démocratie, Paris, novembre 1995, 14 p.
+ Rapport du Secrétaire général de
l'ONU, Rétablissement de l'État de droit et administration de
la justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit
, S/2004/616, 23 août 2004, 30 p.
+ Rapport du Secrétaire général, Les
causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement
durables en Afrique, A/52/871-S/1998/318, 13/04/1998.
+ Résolution de l'Assemblée
générale de l'ONU relative au Programme mondial
d'éducation dans le domaine des droits de l'homme, adoptée le 10
décembre 2004, A/RES/59/113, 2 p.
+ Rapport de l'Assemblée générale des
Nations Unies, Renforcement et coordination de l'action des Nations Unies
dans le domaine de l'État de droit, A/68/213, 29 juillet 2013,
68ème session, 23 p.
+ Résolution de l'Assemblée
générale, L'Etat de droit aux niveaux national et
international, 10 décembre 2014, 69/123, 1p.
706
+ Nations Unies, Traités multilatéraux
déposés auprès du Secrétaire général.
Etat au 31 décembre 1997, New-York, Publication des Nations Unies,
1998, 1060 p.
VIII - DOCUMENTS DE L'UNION AFRICAINE
+ Union Africaine, Critères d'octroi du statut
d'observateur auprès du Comité africain d'experts sur les droits
et le bien-être de l'enfant aux Organisations Non Gouvernementales(ONG)
et Associations.
+ Union Africaine, Directives pour l'établissement
des premiers rapports des Etats parties.
+ Union Africaine, Directives relatives à la
conduite des enquêtes du Comité Africain d'Experts sur les droits
et le bien-être de l'enfant en vertu de l'article 45 de la Charte
africaine et de l'article 74 de son règlement intérieur.
+ Union Africaine, Procédure d'examen des rapports
des Etats parties, 8 p.
+ Union Africaine, Doc.0003 « Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant. Liste des pays qui ont signé,
ratifié/adhéré », en ligne sur le site de
l'organisation :
www.africa-union.org.
+ Union Africaine, Règlement Intérieur du CAE.
+ Doc. UA/Conférence de l'Union, Décision
sur l'élection des membres de la Cour africaine des droits de l'homme et
des peuples, Assembly/AU/Dec.100 (VI) , 6e session ordinaire de la
Conférence de l'Union, 23-24 janvier 2006, Khartoum (Soudan).
+ Doc. UA/Conf. De l'Union, « Activity report of the
court for 2006, Assembly/AU/8 (VIII) », 8e session de la
conférence de l'Union, 29-30 janvier 2007, Addis-Abeba, Ethiopie, 9
p.
+ Doc.UA/CE, « Rapport provisoire de la Cour
Africaine des droits de l'homme et des
peuples. EX.CL/363
(XI) » 11e sesion ordinaire du Conseil exécutif, 25-29 juin
2007 Accra, Ghana, 6p., voy. Spéc.§§ 14-28, pp.2-5.
707
+ Doc.UA/CE, « Rapport d'activités de la cour
africaine des droits de l'homme et des peuples pour l'année 2008,
Ex.CL/489 (XIV) », 14e session ordinaire du conseil exécutif,
26-30 janvier 2009, Addis-Abeba, Ethiopie, spéc. §§ 42-44.
IX - TEXTES OFFICIELS
A/ Les textes nationaux
1 - Les textes constitutionnels
+ Loi n°59-1 du 26 mars 1959 portant Constitution de la
République de Côte d'Ivoire (JORCI n°21 (NS), du
28/03/1959).
+ Loi n°60-356 du 03 novembre 1960 portant Constitution
de la République de Côte d'Ivoire (JORCI n°50 (NS), du
4/11/1960), modifiée par les lois : n°63-01, du 11/01/1963 ;
n°75-365, du 31/05/1975 ; n°75-747 du 22/10/1975 ; n°80-1038 du
1er /09/1980 ; n°80-1232 du 26/11/1980 ; n°85-1072 du 12/10/1985 ;
n°86-90 du 31/01/1986 ; n°90-1529 du 06/11/1990 ; n° 94-438 du
16/08/1994 ; n°95-492 du 26/06 /1995 ; n°98-387 du 2 juillet 1998.
+ Loi n° 2000-513, du 1er août 2000
portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire (JORCI
n°30, du 3 août 2000).
+ Loi n° 2012-1134 du 13 décembre 2012
insérant au titre VI de la Constitution un article 85 bis et relative
à la Cour pénale internationale, publiée par décret
n° 20121135 du 13 décembre 2012.
+ Loi n° 2016-886, du 08 novembre 2016 portant
Constitution de la République de Côte d'Ivoire (JORCI, n°16,
du 9 novembre 2016).
2 - Les textes législatifs a) Les lois
708
+ Loi n°. 64-374, 1964 portant enregistrement des
naissances modifiées par la Loi n° 83-799, 1983.
+ Loi n° 70-483 du 3 aout 1970, sur la minorité.
+ Loi n°88-651 du 7 juillet 1988 portant protection de
la santé publique et de l'environnement contre les effets des
déchets industriels, toxiques, et nucléaires et des substances
nocives (JORCI n°27, du jeudi 7 juillet 1988).
+ Loi n°95-15, du 12 Janvier 1995 portant Code du
Travail (JORCI n°8, du Jeudi 23 février 1995, p.153 et s.).
+ Loi n° 95-685 Education, 1995.
+ Loi n° 97-613 contre l'enlèvement de mineurs
1996.
+ Loi n° 97-613 portant création et organisation
d'une commission nationale pluridisciplinaire de lutte contre le
phénomène des enfants de la rue, 1997.
+ Loi No 98-756 modifiant et complètent la loi 81-640
(juillet1981) instituant un code pénal, 1998.
+ Loi n°98-387, du 2 juillet 1998 portant
révision de la Constitution (JORCI n°29, du jeudi 16 Juillet 1998,
pp.694-699).
+ Loi n°98-757 du 23 décembre 1998 portant
répression de certaines violences à l'égard des femmes
(JORCI n°2, du Jeudi 14 janvier 1999, p.25.).
+ Loi n° 2004-302 portant création de la
Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (JORCI
n°33, du jeudi 12 août 2004, p.502 et s.).
b) Les ordonnances
+ Ordonnance n° 2000-308, du 26 avril 2000 abrogeant la
loi n°92-464 du 30 juillet 1992 portant répression de certaines
formes de violences (JORCI n°4 (NS), du jeudi 4 mai 2000, p.219).
+ Ordonnance n°2000-551, du 1er Aout 2000
portant Statut du Corps Préfectoral (JORCI n°46, du jeudi 23
novembre 2000, p.907.).
709
+ Ordonnance n° 2007-06 du 17 janvier 2007 portant
dispositions spéciales en vue de la reconstitution des Registres de
l'Etat Civil disparus ou détruits entièrement ou
partiellement.
+ Ordonnance n° 2011-258 du 28 septembre 2011 relative
à l'enregistrement des
naissances et des décès survenus durant la crise
c) Les textes réglementaires
+ Décret n°61-425, du 29 décembre 1961
portant application du Code de la nationalité ivoirienne (JORCI 1962,
53).
+ Décret n°69-356, du 31 juillet 1969,
déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leur
sont applicables (JORCI n°35, du 7 août 1969).
+ Décret n°90-1162, du 28 septembre 1990 portant
ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
(JORCI n°41, du 25 octobre 1990).
+ Décret n° 91-884, du 27 décembre 1991
portant adhésion de la République de Côte d'Ivoire aux
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme (JORCI, n°19, du 07
mai 1992).
+ Décret n°91-887, du 27 décembre 1991 portant
adhésion de la République de Côte d'Ivoire à la
Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, adoptée à
Nairobi (Kenya) en juin 1981 (JORCI n°20, du jeudi 14 mai 1992).
+ Décret n°96-853 du 25 octobre 1996 portant
création de la Commission interministérielle nationale pour la
mise en oeuvre du Droit international humanitaire (JORCI n°46, du jeudi 14
novembre 1996).
+ Décret n°2000-830, du 22 novembre portant
création de la direction des droits de l'homme et des libertés
publiques au sein du ministère de la justice et des libertés
publiques (JORCI n°1, du jeudi 4 janvier 2001).
+ Décret n°2000-848, du 4 décembre 2000
portant déclaration de l'état d'urgence et instauration du
couvre-feu (JORCI n°48, du jeudi 7 décembre 2000).
710
+ Décret n°2001-365, du 27 juin 201 portant
création d'un comité de suivi de l'application des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme (JORCI n°35, du jeudi 30
août 2001).
+ Décret No 2001-467, du 25 juillet 2001, portant la
création du comite National de Lutte contre le Trafic et L'exploitation
des enfants.
+ Décret 2004-206 du 11 mars 2004, portant
création du comité Directeur du Programme IPEC/Cote d'ivoire
(MFPE).
+ Décret 2006-70 du 26 avril 2006 portant
l'organisation du Ministère de la Justice et Droit de l'Homme.
+ Décret N° 2007-569, du 10 Aout 2007, portant
organisation du ministère de la famille, de la femme et des affaires
sociales.
+ Décret n° 2007-650 du 20 décembre 2007
portant modalités d'application de l'ordonnance n° 2007-06 du 17
janvier 2007 portant dispositions spéciales en vue de la reconstitution
des Registres de l'Etat Civil disparus ou détruits entièrement ou
partiellement.
+ Décret n°2011-364, portant création du
Comité Interministériel de Lutte contre la
traite, l'exploitation et le travail des enfants (CIM), le 3
novembre 2011.
d) Les arrêtés
+ Arrêté n°01 MJLP. DDHLP portant
nomination des membres du Comité de Suivi de l'application des
instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme (JORCI n°30, du
jeudi 25 juillet 2002).
+ Arrêté 191/MFFAS/DPS, 2008 rendant obligatoire
l'agrément des pouponnières, orphelinats, centres d'accueil et
d'hébergement prives pour enfants.
+ Arrêté 189/MFFAS/CNLTEE, 2008 portant
attributions, organisation et fonctionnement du Comité National de Lutte
contre la Traite et L'Exploitation des enfants.
+ Arrêté 188/MFFAS/DPS, 2008 portant la
création du Comité de placement Familial d'enfants
abandonnés en vue d'adoption.
711
712
B) Les textes internationaux et étrangers
1 - Les Constitutions étrangères
+ La Constitution française du 27 Octobre 1946.
+ La Constitution française du 4 Octobre 1958.
+ La Constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991.
+ La Constitution béninoise du 11 décembre
1990.
+ La Constitution du Mali du 25 février 1992.
+ La Constitution du Niger du 28 juin 1999.
+ La Constitution du Sénégal du 7 Janvier 2001.
2 - Textes internationaux
+ Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, Rés. A.G. 39/46, 1465
R.T.N.U.85.
+ Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre, 12 Aout 1949, 75 R.T.N.U. 288.
+ Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, 15 novembre 2000, 2225 R.T.N.U. 209.
+ Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai
1969, 1155 R.T.N.U. 331.
+ Convention internationale pour la répression de la
circulation et du trafic des publications obscènes, 12 septembre 1923,
27 R.T.S.N. 213.
+ Convention internationale relative à la
répression de la traite des blanches, 4 mai 1910 à Paris, et
amendée par le Protocole signé et Lake Success (New York), 4 mai
1949, 98 R.T.N.U. 101.
+ Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 R.T.N.U. 195.
713
+ Convention (n° 138) concernant l'âge minimum
d'admission à l'emploi, 26 juin 1973, 1015 R.T.N.U. 297.
+ Convention (n° 182) concernant l'interdiction des
pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur
élimination, 17 juin 1999, R.T.N.U. 271.
+ Convention relative à l'esclavage, 25 septembre
1926, amendée par le Protocole du 7 décembre 1953, 212 R.T.U.N.
17.
+ Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre
1989 Rés. A.G. 44/25, 1577 R.T.N.U. 3.
+ Convention relative aux droits des personnes
handicapées, 13 décembre 2006, 2515 R.T.N.U. 3, R.T.Can.
n°8.
+ Convention sur l'élimination de toute forme de
discrimination à l'égard des femmes 18 décembre 1979,
Rés A.G. 34/180, 1249 R.T.U.N. 13.
+ Déclaration de l'Organisation mondiale du tourisme
sur la prévention du tourisme sexuel organisé, A.G., 11°
sess., Doc. N.U. A/RES/338 (1995).
+ Déclaration et Programme d'action de Vienne, Doc. off.
A.G.N.U., 48° sess., Doc. N.U.A/Conf.157/23 (12 juillet 1993).
+ Déclaration sur le droit au développement,
Rés A 41/128, Doc. off. A.G.N.U., 41° sess , supp. n° 53, p.
196, Doc. N.U. A/41/53 (4 décembre 1986).
+ Déclaration sur les principes sociaux et juridiques
applicable à la protection et au bien-être de l'enfant,
envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international,
Doc. off. A.G.N.U., 41° sess., Doc. N.U. A/RES/41/85 (3 décembre
1986).
+ Déclaration universelle des droits de l'enfant,
Rés. 1386 (XIV), Doc. off.A.G.N.U., 14° sess., Doc. N.U. A/4354 (20
novembre 1959).
+ Déclaration universelle des droits de l'homme,
Rés. 217 A (III), Doc. off. A.G.N.U., 3° sess. suppl. n°13, p.
17, Doc. N.U. A/810 (10 décembre 1948).
714
+ Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la
peine de mort, 15 décembre 1989, 1642 R.T.U.N. 414.
+ Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171.
+ Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3.
+ Protocole additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée visant
à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants, 15 novembre 2000,
2237 R.T.N.U. 319.
+ Protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 Aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977, 1125 R.T.N.U. 271.
+ Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
Aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, 1125 R.T.N.U. 649.
+ Protocole amendant la Convention pour la répression
de la circulation et du trafic des publications obscènes, 12 septembre
1923, 46 R.T.N.U. 201.
+ Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000, 2171
R.T.U.N. 227.
+ Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant l'implication des enfants dans les conflits
armés, 25 mai 2000, 2173 R.T.U.N. 222.
+ Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant établissant une procédure de
présentation de communication, Doc. off. A.G.N.U., 66° sess., Doc
N.U.A/RES/66/138 (2011).
+ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U.
171.
715
+ Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques sociaux et culturels, Doc. off.
63°sess., Doc. N.U. A/RES/63/117, A/RES/63/435 (10 décembre
2008).
+ Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17
juillet 1998, 2187 R.T.N.U. 3.
3 - Textes européens
+ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7
décembre 2000 (entrée en
vigueur le 1° décembre 2009), in JOCE,
2000/C 364/01, 18 décembre 2000.
+ Charte sociale européenne, 18 octobre 1961, S.T.E.
n° 35, adoptée lors de la Conférence à haut-niveau
sur la Charte sociale européenne tenue à Turin.
+ Charte sociale européenne (révisée), 3
mai 1996, S.T.E. n°163.
+ Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 4 novembre 1950, S.T.E. n°5.
+ Convention européenne en matière d'adoption des
enfants, 24 avril 1967, S.T.C.E.
n° 58.
+ Convention européenne en matière d'adoption
des enfants (révisée), 27 novembre 2008, S.T.C.E. n°202.
+ Convention européenne sur l'exercice des droits des
enfants, 25 janvier 1996, S.T.E. n° 160.
+ Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tel qu'amendé
par le Protocole n° 11, 20 mars 1952, S.T.E. n° 9, art. 2.
4 - Textes américains
+ Charte de l'Organisation des Etats américains, 30
avril 1948, O.A.S. (A-41), adoptée lors de la neuvième
Conférence Internationale Américaine à Bogota,
Colombie.
716
+ Charte internationale américaine relative au trafic
international de mineurs, 15 juillet 1989, O.A.S -(B-57), adoptée lors
de la cinquième Conférence spécialisée
interaméricaine sur le droit privée, Mexico.
+ Déclaration américaine des droits et des
devoirs de l'homme, 30 avril 1948, adoptée lors de la neuvième
Conférence Internationale Américaine à Bogota, Colombie,
O.A.S.Rés. XXX, Doc. OEA/Ser.L V/II.82 doc.6 rev. 1 (1992).
+ Protocole additionnel à la Convention
américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits
économiques, sociaux et culturels « Protocole de San Salvador
», 7 novembre 1988, O.A.S. (B-52), adopté lors de la
dix-huitième session ordinaire de l'Assemblée de la Commission
interaméricaine des Droits de l'homme à San Salvador, El
Salvador.
5 - Textes africains
+ Acte constitutif de l'Union africaine, Doc. OUA CAB/LEG/23.15
(11 juillet 2000).
+ Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Doc.
OUA CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) (27 juin 1981).
+ Charte africaine sur les droits et le bien-être de
l'enfant, adoptée lors de la conférence constitutive de l'OUA du
22 au 25 mai 1963 à Addis-Abeba, Ethiopie.
+ Déclaration africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, adoptée lors de la seizième session
ordinaire du 17 au 20 juillet 1979 par l'Assemblée des Chefs d'Etats et
de Gouvernement de l'OUA à Monrovia, Libéria, Doc.AHG/ST.4 (XVI)
Rv.1 (1979).
+ Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, 11 juillet 2003,
adoptée lors de la deuxième session ordinaire la
Conférence de l'UA à Maputo.
+ Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et
des droits de l'homme, 1er juillet 2008, adopté lors du onzième
Sommet de l'UA à Charm el-Cheikh, Egypte.
X - JURISPRUDENCE
A - Jurisprudence Ivoirienne
v TPI Bouaflé jugt n°140 du 24/11/2005,
inédit.
v TPI DALOA, jugt n°86 du 11/11/2005, inédit.
v TPI Gagnoa, jugt n°139 du 10/08/2005, inédit.
v TPI Bouaflé ,jugt n°84 du 16/06/2005,
inédit.
v CS ch jud form civ arrêt n°344 du 16
/06/2005.
v TPI Bouaflé, jugt n°78 du 09/06/2005,
inédit.
v TPI Gagnoa, jugt n°12 du 20/04/2005, inédit.
v TPI Gagnoa jugt n°83 du 08/12/2004, inédit.
v TPI Gagnoa, jugt n°3 du 02/06/2004, inédit.
v Sect Trib Sassandra, jugt n°183 du 03 /09/2003,
inédit.
v Section de trib Dabou, jugt n°100 du 25/07/2000,
inédit.
v Section de Trib de Dabou, jugt n°05 du 18/01/2000,
inédit.
v TPI Daloa,jugt n°109 du 13/08/1997.
v Section Trib Dimbokro, jugt n° 15 du
05/02/1997.
v TPI Gagnoa, jugt n°44 du 25/10/ 1996 : cndj/REC JP CATBX
1996 n° 1 p 5.
v Section de trib Bouaflé, jugt n°46 du 24
/04/1996.
v Section de Trib de Sassandra, jugt n°08 du
17/01/1996.
v TPI Bouaké jugt n° 1248 du 22/10/1996, CNDJ /Rec
CATBX 1998 n°2 p225.
v Section de tribunal de Bongouanou, jugement n°825 du
27/07/1996 : CNDJ/ Rec
CATBX 1996 n°2 p.134.
v TPI Abengourou, jugt n°226 du 26/07/1995
v 717
CA Daloa arrêt n°111 du 27/06/1995.
718
+ TPI Daloa, jugt n°191 du 16/12/1994.
+ TPI Man jugt n°160 du 28 /10 /1994.
+ TPI GAGNOA, jugt n°46 du 06/05/1994 : CNDJ/rec CATBX
1999 n°4 p 194).
+ TPI Man, jugt n°64 du 22/04/1994 : CNDJ/rec CATBX 1997
n°1p101.
+ Section Trib Gagnoa, jugt n°12 du 29/01/1993 : Rec
CATBX/cndj 1999 n°i p227.
+ Section de trib de Katiola, jugt n°29 du 11/02/1993 ;
cndj/Rec CATBX 1997 n°2,
P.57.
+ TPI Bouaké jugt n°165 du 27/07/1992 : CNDJ/Rec
CATBX 1998 n3 p87.
+ TPI Bouaké jugt n°190 du 10/04 /1992 : cndj/Rec
CATBX 1998, n°4 p 67.
+ Section Trib Katiola, jugt n°6 du 5/03/1987, in
cndj/Rec CATBX 1996 n°2 p4.
+ C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt, n° 698 du 6
avril 1982, Ministère Public c/E.D.
+ C.A. d'Abidjan, 2 mars 1982, Ministère public
c/M.D.
+ C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt n°1524 du 11
novembre 1981, Ministère public
c/L.A.
+ C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt, n° 722 du 20 mars
1980, Ministère public c/ Y.E.G., R.I.D., n°3-4/1986, Jurisp.3.2,
Pp. 170-171.
+ C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt, n°875 du 24 avril
1979, Ministère public c/K.O. + CAA arrêt n°108 du 18
février 1977 : RID 1978 n° 3-4, p 5.
+ C.A. d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt n°542 du 15 avril
1975, Ministère public c/K.Y.J. + C.A d'Abidjan, Ch. Corr., Arrêt
n°244 du 3 mars 1975, Ministère public c/Y.D.E.
B - Jurisprudence Française
(Conseil Constitutionnel, CE, Cour de Cassation, CA)
+ Décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971
sur la liberté d'association + Tribunal civ Seine 18 janvier 1965
J.C.P, 1965, II , 14 421.
+ civ.10 mai 1989.D.1989, IR.171.
v
719
civ.21 mai1990. J.C.P 1990, II, 21.588.
v Civ. 27 mai 1952.
v Civ, 21 mai 1990.
v Civ. 04 nov 1970.D.1971.186.
v civ. 18 juin 1844.
v Cass civ 24/04/1989 bull civ n°89.
v Cass. Civ. 2ème ,18 juin 1975, Yamani,
arrêt n°462.
v Cass. Civ. 1re, 10 mai 1977, Ballesteros arrêt
n°386.
v Cass.Fr.1ere Civ., 15 juillet 1993 XC. A.S.E du val de
Marne.
v Cass. Crim.2 juin 1977.
v Cass. Crim., 3 septembre 1985 : Bull. crim. 1985,
n°283.
v Cass. Crim., 13 octobre 1986 : Bull. crim. 1986,
n° 282.
v Cass. Crim. 13 octobre 1986.
v Cass. Crim. 9 mars 1973 .
v Cass. Crim. 15 novembre 1951: Bull. crim. 1951,
n°289.
v Cass. Crim.5 Avril 1954 : Bull. crim.1954, n°
142,n°246.
v Cass. Crim. 8 décembre 1971 : Bull. crim. 1971,
n°344.
v Cass. Crim. 7 août 1851.
v Cass. Crim.23 janvier 1989 : Bull. crim., n°26
v Cass. Crim. 9 février 1956.
v Cass.crim.21 mars 1957 :Bull. crim. 1957, n°281.
v Cass.crim.29 novembre 1963 : Bull. crim.1963,
n°268.
v Cass.crim. 5 juillet 1832 : Bull.crim.1832, n°24,
p.541.
v Cour cass. Chambre civ. N° 02-16336 du 18 mai
2005.
v Cour cass.,Chambre soc. N°05-40876 du 16
décembre 2008.
v C.E. fr. 23 novembre 1984, Roujansky.
720
+ CE Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud, Rec.265, S
1952.3.13.
+ CE 18 avr. 1951, Elections commune de Nolay. + CE du
12 février 1960, Arrêt société Eky.
+ TC, 7 juin 1951, Dame Noualek, Rec.636. + TC, 5
décembre 1977, Demoiselle Motsch.
C - Jurisprudence américaine
+ Cour d'appel, 10th circuit, Etats-Unis, 9 juillet 1981,
Rodriguez-Fernandez v. Wilkinson, 654 F.2d 1382 (1981).
+ Cour d'appel, 2nd circuit, Etats-Unis, 30 juin 1980,
Filartiya v. Pena-Irala, 630 F.2d 876.
D - Jurisprudence Internationale (Universelle et
régionale)
+ CPJI, Affaire relative à la compétence des
tribunaux de Dantzig (Pays-Bas c. Etats-Unis d'Amérique), avis
consultatif du 3 mars 1928, CPJI Série B n°15 p.4.
+ CPJI, Affaire relative aux décrets de
nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, Avis
consultatif sur les décrets de nationalité promulgués en
Tunisie et au Maroc, 1923, CPJI Série B n°4 p.7.
+ CIJ, Affaire de l'Interhandel, (Suisse c. Etats-Unis
d'Amérique), exceptions préliminaires, arrêt du 21
mars 1959, Recueil, CIJ 1959 p.6.
+ C.I.J, « Réserves à la convention sur la
présentation et la répression du crime de génocide»
Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil 1951, pp.15 et ss.
+ CIJ, Affaire relative à la réparation des
dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif du 11 avril
1949, Recueil CIJ 1949 p.174.
+ CIJ, « Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé» , avis consultatif du 09 juillet 2004, Recueil CIJ
2004 p.136.
721
+ CIJ, « Affaire des Activités armées
sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo v.
Ouganda) », arrêt du 19 décembre 2005, Recueil CIJ 2005
p.168.
+ CIJ, Affaire relative à la licéité
de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit
armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil CIJ 1996 p.66
(Requête de l'OMS) et Affaire relative à la licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif du 08
juillet 1996, Recueil CIJ 1996 p. 226 (requête de l'AG de l'ONU).
+ CIJ, Affaire Nottebohm, (Lichtenstein C. Guatemala),
Arrêt du 06 avril, 1955, Recueil CIJ 1955 p.20.
+ TPIY, Affaire le Procureur C.TIHOMIR Blaskic (Affaire n°
IT-95-14-T3, mars 2000). + TPIY, Affaire le Procureur C. Kupreskic et consorts
(Affaire IT-95-16, 14 janvier 2000).
+ Comité dr. h., T.K. c. France, décision
d'irrecevabilité du 8 novembre 1989, communication n°220/1987,
§8.3.
+ CCPR/C/50/D/488/1992 (31 Mars 1994) Toonen c. Australia,
Communication N°. 488/1992.
+ CADBE, Décision du 22 Mars 2011 relative à la
Communication n°.com/002/2009. + CADBE, Décision No
003/Com/001/2012.
+ Cour CEDEAO, arrêt Afolabi c/ République du
Nigéria, 2004. + Cour CEDEAO, Arrêt
n°ECW/CCJ/JUD/06/08.
+ Cour CEDEAO, décision ECWCCJ/JUD/06/08 Dame
Hadijatou Mani Koraou c/ République du Niger du 27 octobre 2008.
+ CEDH, Dudgeon v. UK (1983) App n° 7525/76, ECHR,
séries A, n° 45.
+ C.E.D.H., (GC), Demopoulos et autres c. Turquie,
décision d'irrecevabilité du 1er
mars 2010, req. n°46113/99 et al., §69.
+ CEDH, 1er Février 2000, Mazurek, requête
n°34406/97.
+ C.E.D.H., Salguero da Silva Mouta (1999) App n°
33290/96.
+ Cour interaméricaine des droits de l'homme dans
l'affaire Villagran Morales c/ Guatemala, 19 novembre 1999.
722
+ Cour interam. Dr. h., avis consultatif OC- 10/89,
interprétation de la déclaration américaine des droits et
devoirs de l'homme en vertu de l'article 64 de la convention américaine
relative aux droits de l'homme, 14 juillet 1989.
+ Cour interam. Dr. h., Velasquez Rodriguez c. Honduras,
arrêt du 29 juillet 1988, fond, Série C n°4,
§61.
+ Commission interaméricaine des droits de l'homme,
James Terry Roach et Jay Pinkerton c. Etats-Unis, affaire 9647,
résolution 3/87,22 septembre 1987, §§ 46-49,
Rafael-Mazorra et consorts c. Etats-Unis, affaire 9903.
+ Commission Européenne des Droits de l'Homme, «
décision du 11 janvier 1961, Autriche c. Italie », Annuaire
CEDH, vol, 4 p. 139 s.
XI - JOURNAUX ET PERIODIQUES
A -
JOURNAUX
+ Fraternité-Matin n° 11388, du jeudi 21 octobre
2002.
+ Fraternité-Matin n°11532, du 16 avril 2003.
+ Fraternité-Matin n° 11547, du mardi 6 mai 2003.
+ Fraternité-Matin n° 11493, des samedi
1er et dimanche 02 mars 2003.
+ Fraternité-Matin n°11651, du mercredi 10 septembre
2003.
+ Fraternité-Matin n°12549, du mardi 05 septembre
2006.
+ Fraternité-Matin n°12556, du mercredi 13 septembre
2006.
+ La Bombe n°705, des samedi 10 et dimanche 11 mai 2003.
+ Le Front n°003, Hors-série, du 29 novembre
2004.
+ Le Jour n°2244, des samedi 5 et dimanche 6 octobre
2002.
+ Le Nouveau Réveil n°369, du Samedi 8
février 2003.
+ Le Patriote n°986, du Lundi 9 décembre 2002.
+ Le Patriote n°974, du mercredi 30 novembre 2002.
v
723
L'Inter n°1375, des samedi 7 et dimanche 8
décembre 2002.
v L'Inter n°1442, du Jeudi 27 février 2003.
v L'Inter n°1563, du Jeudi 24 juillet 2003.
v L'oeil du peuple n°337, du lundi 16 juin 2003.
v Soir Info n°2449, du mercredi 22 octobre 2002.
v Soir Info n°2626, des mercredi 28 et jeudi 29 mai
2003.
v Soir Info n°2531, des Samedi 1er et
dimanche 2 Février 2003.
v Soir Info n°2749, du Jeudi 23 Octobre 2003.
v 24 heures n° 188, du mercredi 16 Octobre 2002.
v 24 heures n° 253, du jeudi 9 janvier 2003.
v 24 heures n°260, du vendredi 17 Janvier 2003.
B - PERIODIQUES
v Actualités juridiques n°18-19,
Août-Septembre 2001.
v Cahiers africains-Africa Studies n°23-24, 1996.
v Débats-Courriers d'Afrique de l'Ouest n°22,
Février 2005.
v Débats-Courrier d'Afrique de l'Ouest n°36-37,
Juillet-Août 2006.
v Jeune Afrique n°2384, du 17 au 23 septembre 2006.
v Jeune Afrique n°2385, du 24 au 30 septembre 2006.
v J.A. L'Intelligent n°2293, du 19 au 25 décembre
2004.
v J.A. L'Intelligent n°2351, du 19 Janvier au 4
Février 2006.
v Reflets Nations Unies n°4, Juin 2006.
v Revue Juridique et politique des Etats francophones
n°3, Juillet-Septembre 2003.
724
XII - SITES INSTITUTIONNELS
Académie de droit international de la Haye :
https://www.hagueacademy.nl/?lang=fr
Académie de droit international humanitaire et de droits humains
:
https://www.geneva-
academy.ch/
Cour internationale de Justice :
http://www.icj-cij.org/fr
Child rights international network : http://crin.org/
Comité international de la Croix-Rouge :
https://www.icrc.org/fr
Conseil de l'Europe : www.coe.int
Comité africain des experts et du bien-être de
l'enfant :www.acerwc.org
Cour Africaine :
www.african-court.org
Cour de Justice de la CEDEAO :
http://www.ecowas.int/institutions-2/court-de-justice-
communautaire/?lang=fr
Cour pénale internationale :
https://www.icc-cpi.int/about?ln=fr
Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
HURIDOCS :
www.huridocs.org
Organisation des Nations Unies :www.un.org
Société Française pour le Droit
international : http://www.sfdi.org/
Unicef: https://www.unicef.org/
Union Africaine :
www.africa-union.org
Union Européenne :
https://europa.eu/european-union/index
fr
INDEX
725
726
Actes de naissance, 172, 174, 175, 176, 177
|
Adoption, 32, 39,
|
95,
|
96, 97, 99,
|
100,
|
105,
|
|
113,
|
115,
|
116,
|
119,
|
122,
|
123,
|
124,
|
126,
|
|
145,
|
169,
|
183,
|
194,
|
201,
|
204,
|
214,
|
238,
|
|
280,
|
301,
|
315,
|
334,
|
335,
|
338,
|
373,
|
395,
|
|
415,
|
433,
|
520,
|
521,
|
543,
|
597,
|
598,
|
600,
|
|
601,
|
632,
|
647,
|
648,
|
649,
|
650,
|
657,
|
703,
|
|
707,
|
712,
|
714,
|
727,
|
729
|
|
|
|
Adoption plénière, 647
Apatridie, 324, 370, 372, 376, 377
|
Application, 18, 19, 24, 36, 42, 43, 44, 48,
49, 50, 62, 63, 66, 67, 88, 89, 96, 105, 106,
|
|
112,
|
118,
|
126,
|
129,
|
133,
|
135,
|
141,
|
149,
|
|
151,
|
164,
|
165,
|
168,
|
171,
|
175,
|
185,
|
201,
|
|
205,
|
208,
|
209,
|
210,
|
211,
|
218,
|
220,
|
222,
|
|
223,
|
224,
|
226,
|
248,
|
249,
|
259,
|
261,
|
262,
|
|
274,
|
283,
|
284,
|
290,
|
299,
|
301,
|
311,
|
312,
|
|
320,
|
325,
|
326,
|
329,
|
330,
|
332,
|
337,
|
338,
|
|
348,
|
358,
|
364,
|
389,
|
399,
|
400,
|
403,
|
458,
|
|
467,
|
471,
|
518,
|
584,
|
600,
|
605,
|
623,
|
624,
|
|
629,
|
638,
|
641,
|
643,
|
652,
|
654,
|
655,
|
656,
|
|
680,
|
686,
|
693,
|
697,
|
718,
|
719,
|
723,
|
724,
|
|
725
|
|
|
|
|
|
|
|
assistance judiciaire, 230
bien-être, 7, 322, 378, 387, 399
capacité juridique, 368
Comité des droits de l'enfant, 42, 584
cour africaine des droits de l'homme et des peuples,
105, 334, 335, 678, 690, 699, 702, 708, 709
Cour de Justice de la CEDEAO, 340, 341, 738
Cour pénale internationale, 344
crimes de guerre, 121, 344, 345, 355, 356,
487, 490, 499, 505
déchets toxiques, 383, 385, 386, 542
déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 160, 161,
215, 441, 566, 671
727
délinquance juvénile, 232, 240, 241, 251,
|
|
252,
|
260,
|
589,
|
590,
|
611,
|
691, 693, 698,
|
|
699,
|
700,
|
709,
|
711
|
|
|
|
détention, 92, 94,
|
98,
|
112,
|
137, 208, 209,
|
|
210,
|
235,
|
346,
|
370,
|
411,
|
441, 442, 450,
|
|
451,
|
454,
|
458,
|
460,
|
461,
|
465, 467, 469,
|
|
470,
|
471,
|
514,
|
590,
|
599
|
|
détention provisoire, 235, 454 devoirs de l'enfant, 36,
40
|
devoirs de l'Etat, 107
|
|
|
|
|
|
dignité, 304
|
|
|
|
|
|
droit à l'éducation, 17,
|
40,
|
59, 91, 98, 99,
|
|
112, 130, 156, 195,
|
196,
|
214,
|
293,
|
295,
|
|
296, 308, 325, 367,
|
386,
|
387,
|
389,
|
391,
|
|
392, 396, 507, 508,
|
509,
|
523,
|
551,
|
558,
|
|
563, 566, 614, 678
|
|
|
|
|
droit à la nationalité, 112, 323, 324, 370, 371
droit à la santé, 17, 39, 90, 130, 377, 378,
379, 381, 382, 386, 462, 465, 523, 566, 717
droit à la vie, 37, 98, 116, 179, 212, 213, 377,
378, 386, 399, 486, 497, 500, 505, 530, 531, 534, 544
droit à un environnement sain, 103, 379, 386
droit international humanitaire, 117, 118,
343, 442, 473, 474, 483, 486, 503, 505,
507, 680, 683, 690, 738
droits civils et politiques, 33, 64, 90, 95, 96,
98, 99, 107, 111, 147, 152, 407, 442, 473,
474, 519, 520, 521, 522, 667, 677, 728
728
droits de l'enfant, 13, 14, 15, 26, 28, 29, 30,
|
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75,
79, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 94, 98, 99, 107, 111, 112, 114, 115, 116,
117,
|
|
118,
|
119,
|
120,
|
122,
|
123,
|
124,
|
129,
|
134,
|
|
143,
|
144,
|
145,
|
146,
|
147,
|
152,
|
154,
|
156,
|
|
157,
|
158,
|
165,
|
166,
|
167,
|
169,
|
171,
|
172,
|
|
174,
|
181,
|
195,
|
200,
|
204,
|
205,
|
207,
|
210,
|
|
211,
|
212,
|
213,
|
214,
|
218,
|
219,
|
220,
|
222,
|
|
223,
|
224,
|
225,
|
230,
|
234,
|
236,
|
240,
|
244,
|
|
255,
|
266,
|
278,
|
279,
|
280,
|
281,
|
283,
|
284,
|
|
285,
|
296,
|
299,
|
300,
|
301,
|
302,
|
303,
|
304,
|
|
305,
|
307,
|
308,
|
309,
|
310,
|
311,
|
312,
|
313,
|
|
314,
|
315,
|
316,
|
317,
|
318,
|
319,
|
322,
|
323,
|
|
324,
|
325,
|
326,
|
327,
|
328,
|
329,
|
330,
|
331,
|
|
332,
|
333,
|
343,
|
346,
|
348,
|
349,
|
350,
|
351,
|
|
353,
|
354,
|
355,
|
357,
|
358,
|
359,
|
362,
|
364,
|
|
366,
|
367,
|
368,
|
378,
|
387,
|
388,
|
392,
|
394,
|
|
395,
|
396,
|
402,
|
403,
|
406,
|
413,
|
415,
|
422,
|
|
425,
|
428,
|
430,
|
432,
|
441,
|
442,
|
448,
|
450,
|
|
454,
|
455,
|
457,
|
459,
|
467,
|
476,
|
477,
|
486,
|
|
498,
|
499,
|
500,
|
501,
|
509,
|
511,
|
512,
|
513,
|
|
514,
|
516,
|
518,
|
519,
|
520,
|
522,
|
523,
|
524,
|
|
525,
|
527,
|
530,
|
531,
|
566,
|
575,
|
583,
|
584,
|
|
585,
|
591,
|
593,
|
594,
|
597,
|
598,
|
604,
|
608,
|
|
609,
|
612,
|
616,
|
617,
|
618,
|
620,
|
622,
|
627,
|
|
630,
|
635,
|
644,
|
646,
|
647,
|
651,
|
652,
|
656,
|
|
657,
|
659,
|
660,
|
669,
|
673,
|
675,
|
679,
|
680,
|
|
681,
|
682,
|
683,
|
684,
|
687,
|
691,
|
693,
|
694,
|
|
695,
|
696,
|
697,
|
700,
|
701,
|
703,
|
704,
|
705,
|
|
706,
|
709,
|
710,
|
714,
|
715,
|
716,
|
717,
|
719,
|
|
724,
|
727,
|
728
|
|
|
|
|
|
729
droits de l'homme, 7, 13,
|
14,
|
16,
|
19,
|
20,
|
21,
|
|
22,
|
23,
|
24,
|
25,
|
30,
|
31,
|
32,
|
33,
|
36,
|
37,
|
38,
|
|
40,
|
41,
|
43,
|
44,
|
46,
|
49,
|
54,
|
55,
|
56,
|
57,
|
58,
|
|
59,
|
60,
|
62,
|
64,
|
65,
|
70,
|
82,
|
85,
|
86,
|
87,
|
88,
|
|
89,
|
92,
|
94,
|
95,
|
96,
|
98,
|
99,
|
100, 101, 102,
|
|
103,
|
104,
|
105,
|
106,
|
107,
|
108,
|
109,
|
111,
|
|
113,
|
116,
|
130,
|
131,
|
144,
|
146,
|
147,
|
148,
|
|
149,
|
150,
|
152,
|
153,
|
154,
|
158,
|
160,
|
161,
|
|
163,
|
165,
|
166,
|
167,
|
168,
|
171,
|
179,
|
214,
|
|
215,
|
216,
|
218,
|
230,
|
236,
|
238,
|
239,
|
240,
|
|
248,
|
284,
|
294,
|
295,
|
299,
|
300,
|
301,
|
305,
|
|
306,
|
307,
|
311,
|
328,
|
329,
|
334,
|
335,
|
336,
|
|
338,
|
339,
|
340,
|
343,
|
348,
|
349,
|
350,
|
352,
|
|
364,
|
365,
|
367,
|
371,
|
378,
|
382,
|
387,
|
391,
|
|
399,
|
400,
|
425,
|
430,
|
437,
|
441,
|
451,
|
454,
|
|
456,
|
461,
|
462,
|
463,
|
464,
|
465,
|
468,
|
471,
|
|
473,
|
474,
|
477,
|
482,
|
488,
|
490,
|
494,
|
495,
|
|
496,
|
507,
|
511,
|
514,
|
520,
|
521,
|
566,
|
583,
|
|
592,
|
593,
|
597,
|
608,
|
614,
|
615,
|
623,
|
644,
|
|
647,
|
652,
|
655,
|
659,
|
665,
|
667,
|
668,
|
669,
|
|
670,
|
671,
|
672,
|
673,
|
674,
|
676,
|
677,
|
678,
|
|
679,
|
680,
|
681,
|
684,
|
685,
|
686,
|
689,
|
690,
|
|
691,
|
692,
|
693,
|
694,
|
695,
|
696,
|
697,
|
698,
|
|
699,
|
700,
|
701,
|
702,
|
703,
|
705,
|
706,
|
707,
|
708,
|
709,
|
711,
|
712,
|
713,
|
714,
|
716,
|
717,
|
718,
|
719,
|
720,
|
724,
|
727,
|
730,
|
735,
|
736
|
|
droits économiques et sociaux, 37, 90, 364, 521, 523,
527, 608
droits fondamentaux, 7, 19, 21,
37, 43, 63, 69, 71, 75, 83, 86,
|
23, 33, 34,
90, 94, 98,
|
149,
|
150,
|
152,
|
158,
|
160,
|
161,
|
164,
|
165,
|
166,
|
168,
|
241,
|
288,
|
386,
|
422,
|
423,
|
428,
|
455,
|
456,
|
486,
|
500,
|
501,
|
511,
|
522,
|
523,
|
585,
|
626,
|
652,
|
665,
|
668,
|
672,
|
675,
|
680,
|
686,
|
690,
|
693,
|
698,
|
699,
|
703,
|
705,
|
708,
|
|
|
710,
|
715,
|
729
|
|
|
|
|
|
Effectivité, 46, 392, 705
730
enfant, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
|
33, 34, 35, 36, 44, 45, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72,
89, 90, 94, 98,
|
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 75, 79, 82, 83, 85, 86, 88, 99, 101, 104, 107, 108, 109,
|
|
111,
|
112,
|
113,
|
114,
|
115,
|
116,
|
117,
|
118,
|
|
119,
|
122,
|
123,
|
124,
|
127,
|
128,
|
129,
|
130,
|
|
131,
|
132,
|
133,
|
134,
|
135,
|
136,
|
138,
|
140,
|
|
143,
|
144,
|
145,
|
146,
|
147,
|
149,
|
151,
|
152,
|
|
154,
|
155,
|
157,
|
158,
|
161,
|
165,
|
166,
|
167,
|
|
169,
|
171,
|
172,
|
173,
|
174,
|
177,
|
180,
|
181,
|
|
182,
|
183,
|
184,
|
185,
|
186,
|
187,
|
188,
|
189,
|
|
192,
|
193,
|
194,
|
195,
|
196,
|
197,
|
198,
|
200,
|
|
202,
|
203,
|
204,
|
205,
|
206,
|
207,
|
210,
|
211,
|
|
212,
|
213,
|
214,
|
215,
|
216,
|
218,
|
219,
|
220,
|
|
221,
|
222,
|
223,
|
224,
|
225,
|
226,
|
227,
|
228,
|
|
229,
|
230,
|
232,
|
234,
|
235,
|
236,
|
240,
|
241,
|
|
242,
|
243,
|
244,
|
245,
|
246,
|
247,
|
252,
|
255,
|
|
256,
|
260,
|
264,
|
266,
|
276,
|
278,
|
279,
|
280,
|
|
281,
|
282,
|
283,
|
284,
|
285,
|
296,
|
299,
|
300,
|
|
301,
|
302,
|
303,
|
304,
|
305,
|
307,
|
308,
|
309,
|
|
310,
|
311,
|
312,
|
313,
|
314,
|
315,
|
316,
|
317,
|
|
318,
|
319,
|
321,
|
322,
|
323,
|
324,
|
325,
|
326,
|
|
327,
|
328,
|
329,
|
330,
|
331,
|
332,
|
333,
|
335,
|
|
342,
|
343,
|
346,
|
348,
|
349,
|
350,
|
351,
|
353,
|
|
354,
|
355,
|
357,
|
358,
|
359,
|
362,
|
364,
|
366,
|
|
367,
|
368,
|
369,
|
370,
|
373,
|
374,
|
377,
|
378,
|
|
381,
|
387,
|
388,
|
391,
|
392,
|
393,
|
394,
|
395,
|
|
396,
|
399,
|
400,
|
402,
|
403,
|
404,
|
405,
|
406,
|
|
407,
|
411,
|
412,
|
413,
|
414,
|
415,
|
416,
|
417,
|
|
418,
|
419,
|
421,
|
422,
|
423,
|
425,
|
428,
|
429,
|
|
430,
|
431,
|
432,
|
434,
|
437,
|
440,
|
441,
|
442,
|
|
443,
|
448,
|
450,
|
452,
|
454,
|
455,
|
456,
|
457,
|
|
459,
|
467,
|
468,
|
469,
|
470,
|
475,
|
476,
|
477,
|
|
480,
|
481,
|
483,
|
484,
|
485,
|
486,
|
498,
|
499,
|
|
500,
|
501,
|
505,
|
508,
|
509,
|
511,
|
512,
|
513,
|
|
514,
|
516,
|
517,
|
518,
|
519,
|
520,
|
521,
|
522,
|
|
523,
|
524,
|
525,
|
527,
|
530,
|
531,
|
532,
|
533,
|
|
534,
|
535,
|
536,
|
537,
|
540,
|
541,
|
542,
|
544,
|
|
546,
|
547,
|
548,
|
549,
|
551,
|
552,
|
554,
|
558,
|
|
560,
|
566,
|
570,
|
572,
|
575,
|
578,
|
579,
|
581,
|
|
582,
|
583,
|
584,
|
585,
|
587,
|
589,
|
590,
|
591,
|
|
593,
|
594,
|
597,
|
598,
|
599,
|
600,
|
601,
|
602,
|
|
603,
|
604,
|
605,
|
606,
|
607,
|
608,
|
609,
|
610,
|
|
611,
|
612,
|
613,
|
616,
|
617,
|
618,
|
619,
|
620,
|
731
621,
|
622,
|
624,
|
625,
|
626,
|
627,
|
628,
|
629,
|
|
630,
|
631,
|
632,
|
633,
|
634,
|
635,
|
636,
|
637,
|
|
638,
|
639,
|
640,
|
641,
|
642,
|
643,
|
644,
|
645,
|
|
646,
|
647,
|
648,
|
649,
|
650,
|
651,
|
652,
|
653,
|
|
654,
|
655,
|
656,
|
657,
|
659,
|
660,
|
666,
|
669,
|
|
673,
|
674,
|
675,
|
677,
|
678,
|
679,
|
680,
|
681,
|
|
682,
|
683,
|
684,
|
686,
|
687,
|
688,
|
690,
|
691,
|
|
693,
|
694,
|
695,
|
696,
|
697,
|
698,
|
699,
|
700,
|
|
701,
|
702,
|
703,
|
704,
|
705,
|
706,
|
707,
|
708,
|
|
709,
|
710,
|
712,
|
713,
|
714,
|
715,
|
716,
|
717,
|
|
719,
|
720,
|
721,
|
724,
|
727,
|
728,
|
730,
|
738
|
enfant délinquant, 204
enfant en conflit avec la loi, 205, 234, 264
enfants soldats, 119, 346, 362, 443, 476, 478,
479, 480, 481, 485, 486, 493, 503, 680, 691, 703, 706
enregistrement des naissances, 172, 174, 176, 177, 325, 367,
369
Etat civil, 545
Famille, 223, 225, 232, 234, 245, 284, 552,
561, 637, 649, 683, 698
filiation adoptive, 699
garde à vue, 210, 237, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 694
garde d'enfant, 415
infanticide, 213
instruments internationaux, 41, 43, 44, 54,
|
61, 85, 101, 102, 109, 200, 214, 255, 329,
381, 396, 407, 442, 455, 483, 623, 724, 725
instruments nationaux, 214, 425
intérêt supérieur de l'enfant, 35, 114,
119, 130, 135, 138, 181, 187, 189, 194, 198, 207, 403, 404, 413, 415, 428, 429,
622, 626, 638, 639, 643, 647
|
|
Juge des enfants, 642
juge des tutelles, 192, 193, 194,
|
233
|
|
732
juridiction, 17, 18, 19,
|
99,
|
163,
|
207,
|
219,
|
|
231,
|
252,
|
253,
|
256,
|
258,
|
259,
|
260,
|
265,
|
|
267,
|
270,
|
272,
|
273,
|
274,
|
275,
|
316,
|
340,
|
|
343,
|
344,
|
348,
|
349,
|
350,
|
353,
|
355,
|
357,
|
|
446,
|
457,
|
499
|
|
|
|
|
|
justice des mineurs, 255, 256, 266, 448, 455,
|
630, 695, 711 liberté, 695
mineur, 27, 30, 44, 99,
|
113, 116, 181, 182,
|
|
183,
|
184,
|
185,
|
186,
|
187,
|
192,
|
193,
|
197,
|
|
205,
|
206,
|
207,
|
208,
|
209,
|
210,
|
213,
|
233,
|
|
253,
|
254,
|
255,
|
256,
|
258,
|
259,
|
260,
|
261,
|
|
262,
|
263,
|
264,
|
265,
|
266,
|
267,
|
268,
|
269,
|
|
270,
|
271,
|
272,
|
273,
|
274,
|
275,
|
373,
|
387,
|
|
396,
|
400,
|
442,
|
445,
|
448,
|
450,
|
451,
|
452,
|
|
454,
|
455,
|
456,
|
457,
|
462,
|
464,
|
466,
|
469,
|
|
514,
|
563,
|
600,
|
601,
|
655,
|
683,
|
686,
|
687,
|
|
692,
|
694
|
|
|
|
|
|
|
|
minorité, 27, 30,
|
181,
|
182,
|
185,
|
186,
|
187,
|
|
192,
|
193,
|
205,
|
206,
|
207,
|
209,
|
232,
|
233,
|
|
253,
|
255,
|
258,
|
260,
|
263,
|
270,
|
274,
|
420,
|
442,
|
702
|
|
|
|
|
|
|
|
naissance, 26, 37,
|
38,
|
48, 99, 126, 129, 132,
|
172,
|
173,
|
174,
|
175,
|
176,
|
177,
|
178,
|
179,
|
180,
|
259,
|
260,
|
261,
|
262,
|
324,
|
325,
|
365,
|
|
|
367,
|
368,
|
369,
|
370,
|
373,
|
375,
|
376,
|
377,
|
439,
|
531,
|
535,
|
545,
|
689,
|
690,
|
704
|
|
|
nationalité, 21, 38, 62, 90, 99, 112, 130, 173,
200, 236, 304, 323,
|
324, 340,
|
367,
|
368,
|
370, 371, 372, 373,
|
374, 375,
|
376,
|
377,
|
|
|
398, 419, 427, 438,
|
584, 714,
|
723
|
|
|
norme, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 92,
|
128,
|
|
129, 130, 151, 155,
|
364, 522,
|
525,
|
552
|
officier d'état civil, 177, 260
paix, 44, 81, 86, 88, 97, 103, 109, 121, 161,
|
202,
|
293,
|
295,
|
357,
|
386,
|
442,
|
471,
|
473,
|
|
475,
|
478,
|
503,
|
508,
|
509,
|
511,
|
514,
|
592,
|
|
593,
|
651,
|
665,
|
714,
|
720
|
|
|
|
733
pauvreté, 42, 58, 125, 204, 220, 235, 286, 305, 306,
389, 397, 438, 477, 501, 526, 538, 550, 573, 580, 583, 585, 586, 591, 674,
707
|
placement familial, 649, 727
|
226,
428,
560,
594,
|
228, 434, 563, 622,
|
|
préambule, 14, 36, 38, 57, 86, 97, 98,
|
103,
|
|
104, 129,
|
130,
|
138,
|
151,
|
152,
|
158,
|
159,
|
160, 161,
|
162,
|
163,
|
165,
|
172,
|
377,
|
525,
|
648
|
|
|
|
|
|
|
prison, 213,
|
303,
|
437,
|
441,
|
459,
|
460,
|
462,
|
463, 464,
|
466,
|
467,
|
468,
|
469,
|
470,
|
471,
|
550, 676,
|
694,
|
713
|
|
|
|
|
|
protection spéciale, 39, 118, 171, 229, 370, 473
rebelles, 277, 381, 478, 480, 481, 486, 487,
488, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 499, 502, 508
rebellion, 381, 474, 480, 489, 496, 498, 555
sujet de droit, 368
témoin, 346
torture, 708
trafic d'enfant, 138, 241, 430, 611
traite d'enfant, 138, 367, 432, 437, 577, 582, 583, 584, 720
travail des enfants, 34, 41, 43, 124, 125, 126,
127,
|
128,
|
131,
|
197,
|
198,
|
199,
|
221,
|
223,
|
|
240,
|
247,
|
248,
|
249,
|
250,
|
251,
|
286,
|
288,
|
|
289,
|
290,
|
291,
|
292,
|
293,
|
295,
|
296,
|
302,
|
|
370,
|
414,
|
416,
|
417,
|
418,
|
428,
|
429,
|
545,
|
|
547,
|
578,
|
579,
|
580,
|
582,
|
583,
|
584,
|
611,
|
|
619,
|
625,
|
681,
|
688,
|
692,
|
716,
|
719,
|
727
|
|
tueries, 493, 498,
|
499,
|
501
|
|
|
|
Union Africaine, 9, 237, 318, 322, 375, 720, 721, 738
Union européenne, 227, 523, 600, 729
734
victime, 136, 140,
|
200,
|
202,
|
204,
|
212,
|
213,
|
|
234,
|
236,
|
243,
|
244,
|
245,
|
246,
|
247,
|
319,
|
|
333,
|
335,
|
342,
|
349,
|
356,
|
424,
|
426,
|
431,
|
432,
|
433,
|
454,
|
457,
|
488,
|
604,
|
619,
|
624,
|
630,
|
631,
|
636,
|
640,
|
643,
|
652,
|
654,
|
655,
|
656,
|
675,
|
690
|
|
|
|
|
|
|
violations, 24, 48, 71, 94, 111, 122, 204, 211,
212,
|
214,
|
236,
|
237,
|
283,
|
301,
|
304,
|
315,
|
316,
|
318,
|
322,
|
324,
|
326,
|
327,
|
331,
|
335,
|
336,
|
340,
|
343,
|
344,
|
345,
|
346,
|
348,
|
349,
|
|
|
354,
|
357,
|
364,
|
365,
|
366,
|
367,
|
443,
|
459,
|
|
473,
|
474,
|
486,
|
487,
|
490,
|
496,
|
497,
|
498,
|
|
499,
|
500,
|
506,
|
512,
|
513,
|
514,
|
534,
|
571,
|
|
593,
|
594,
|
606,
|
652,
|
655,
|
656,
|
679,
|
692
|
viols, 426, 427, 443, 486, 487, 488, 489, 490
735
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 13
PREMIÈRE PARTIE : L'INTEGRATION EN DROIT IVOIRIEN
DES NORMES
INTERNATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT
55
Titre I : UN DISPOSITIF JURIDIQUE AU CONTENU REEL
59
Chapitre I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES
INSTRUMENTS
PROTEGEANT LES DROITS DE L'ENFANT 62
Section I : UNE RECONNAISSANCE INDIRECTE A TRAVERS
LES
INSTRUMENTS GENERAUX DES DROITS DE L'HOMME 67
§ 1. AU NIVEAU UNIVERSEL 67
A. L'ADHESION DE LA COTE D'IVOIRE A LA CHARTE DES
NATIONS
UNIES ET LA DUDH 68
1. La Charte des Nations Unies 68
2. La déclaration universelle des droits de
l'homme 71
B. L'ADHESION DE LA COTE D'IVOIRE AUX PACTES
INTERNATIONAUX
DE 1966 77
1. Présentation des pactes de 1966 77
2. Les enjeux des pactes pour les droits de l'enfant
80
§ 2. AU NIVEAU AFRICAIN : LE CAS DE LA CHARTE
AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES 82
A. LES ELEMENTS DE RESSEMBLANCE ENTRE LA CHARTE ET
LES
AUTRES INSTRUMENTS DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
83
B. DES SPECIFICITES DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
DE
L'HOMME ET DES PEUPLES 85
C. LES ENJEUX DE LA CADHP POUR LES ENFANTS
89
Section II. UNE RECONNAISSANCE DIRECTE A TRAVERS DES
INSTRUMENTS
SPECIFIQUES AUX DROITS DE L'ENFANT 93
§ 1. AU NIVEAU UNIVERSEL 93
A. LA RATIFICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES
DROITS DE L'ENFANT (CIDE) 93
1. Des droits au profit des enfants 93
2. Des obligations à la charge des Etats
96
B. LA RATIFICATION DES DEUX PROTOCOLES FACULTATIFS A LA
CIDE ET DU PROTOCOLE DE PALERME 99
C. LA RATIFICATION DES CONVENTIONS N°138 et 182 de
l'OIT 106
§ 2. AU NIVEAU AFRICAIN 111
A. LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ETRE DE
L'ENFANT
112
1.
736
Le contenu de la Charte 112
2. Portée juridique de la CADBE 116
B. A TRAVERS LA SIGNATURE D'ACCORDS REGIONAUX ET
BILATERAUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES
ENFANTS 117
1. Les accords régionaux de protection des
enfants contre la traite 117
2. Les accords bilatéraux contre le trafic
transfrontalier d'enfants 120
Chapitre II : LA RECEPTION NATIONALE DES DROITS
INTERNATIONAUX DE
L'ENFANT 125
Section I : UNE PROGRESSIVE CONSTITUTIONNALISATION DES
DROITS DE
L'ENFANT 127
§ 1. UNE EVOLUTION DES FORMES DE RECONNAISSANCE
DES DROITS DE
L'ENFANT 127
A. LE STATUT DE LA CONSTITUTION DANS LE DROIT DES DROITS
DE
L'ENFANT 127
B. UNE RECONNAISSANCE IMPLICITE DES DROITS DE L'ENFANT
SOUS LE PRISME DE LA PROTECTION GENERALE DES DROITS DE L'HOMME DANS LA
CONSTITUTION DE 1960 : UN RENVOI AUX GRANDES
DECLARATIONS DE DROITS 130
C. UNE RECONNAISSANCE EXPRESSE DE LA PROTECTION
SPECIFIQUE
DE L'ENFANT EN TANT QUE PERSONNE VULNERABLE
137
§ 2. UNE EVOLUTION DES TECHNIQUES DE CONSECRATION
DES DROITS
DE L'ENFANT 140
A. AU NIVEAU DU PREAMBULE 141
B. UNE CONSECRATION PLUS CIRCONSTANCIEE DES DROITS AU
NIVEAU DU CORPUS DE LA CONSTITUTION SOUS LES CONSTITUTIONS
DE 2000 ET DE 2016 148
Section II : LES MESURES D'APPLICATION LEGISLATIVE
ET
REGLEMENTAIRE DES DROITS DE L'ENFANT 153
§ 1. UNE IMPORTANTE RECONNAISSANCE DES DROITS DE
L'ENFANT AU
NIVEAU CIVIL 154
A. UN ENCADREMENT JURIDIQUE DES REGLES DE DECLARATION
DES
NAISSANCES FONDEES SUR L'INTERET DES ENFANTS
154
1. L'obligation légale de déclaration et
d'établissement d'actes de naissances,
moyens d'individualisation et de protection des enfants
154
2. Les règles de suppléance en cas de
perte de registre ou de défaut d'actes de
naissance 156
3. Les sanctions de l'inobservation des règles
d'établissement des actes de
naissances 158
B. UN ENCADREMENT JURIDIQUE RIGOUREUX DE L'INCAPACITE
DU
MINEUR DANS L'INTERET DE L'ENFANT 163
1. L'étendue de l'incapacité du mineur
163
2. Les sanctions de l'incapacité du mineur, un
régime juridique favorable à
l'enfant 168
737
C. LE REGIME DE PROTECTION DU MINEUR NON EMANCIPE, UN
MOYEN DE CONTROLE DES DROITS PARENTAUX A L'EGARD DE LEURS
ENFANTS 169
1. La substitution de l'autorité parentale
à la puissance paternelle 170
2. Du contrôle à la déchéance
de l'autorité parentale, une mesure de protection
de l'enfant 174
§ 2. UNE DIVERSITE DE LOIS SOCIALES PROTECTRICES DE
L'INTERET DE
L'ENFANT 176
A. UNE RECONNAISSANCE LEGISLATIVE DU DROIT A L'EDUCATION
177
B. UN ENCADREMENT JURIDIQUE CONSTANT DU TRAVAIL
DES
ENFANTS 179
C. LA LOI DEFINISSANT LE STATUT DE PUPILLE DE LA NATION
183
D. AUTRES LOIS PERTINENTES EN MATIERE DE PROTECTION
SOCIALE
DES ENFANTS 185
§ 3. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES ENFANTS
PAR
L'ADOPTION D'UNE DIVERSITE DE LOIS PENALES
186
A. UN CADRE PENAL HYBRIDE APPLICABLE AUX MINEURS
DELINQUANTS 186
1. Une responsabilité pénale des mineurs
peu ou prou conforme aux normes
internationales 187
2. Une application de règles de droit commun aux
mineurs dans le cadre de
l'enquête préliminaire 189
B. UNE REPRESSION PENALE DES AUTEURS DE VIOLATIONS DES
DROITS DE L'ENFANT 193
CONCLUSION DU TITRE 1 195
Titre II : DES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE GARANTIE A
EFFECTIVITE
LIMITEE 199
Chapitre I : LE ROLE LIMITE DES MECANISMES
GOUVERNEMENTAUX 201
SECTION I. LES ORGANES ADMINISTRATIFS A CARACTERE
POLITIQUE ET
TECHNIQUE 202
§ 1. LES ORGANES DE PROTECTION A CARACTERE GENERAL
202
A. AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA FAMILLE ET DE LA
SOLIDARITE
NATIONALE 204
1. La direction de la protection de l'enfance (DPE)
205
2. Direction régionale de la Famille et de
l'enfant et ses démembrements 207
B. AU NIVEAU DU MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE LA JUSTICE
ET
DES DROITS DE L'HOMME 212
1. La Direction de la Protection Judiciaire de l'Enfance
et de la Jeunesse
(DPJEJ) 213
2. De l'apport de la Commission nationale des droits de
l'homme dans la
protection des enfants 218
§ 2. LES ORGANES SPECIFIQUES DE PROTECTION
222
738
A. LA SOUS-DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES
ENFANTS ET LA DELINQUANCE JUVENILE (S/D-LTEDJ)
223
1. Composition et attributions de la sous-direction de
la lutte contre la traite des
enfants et la délinquance juvénile
223
2. Le centre d'accueil et de transit des enfants de la
SD/LTEDJ 227
B. LA CREATION RECENTE DE DEUX COMITES DE LUTTE CONTRE
LA
TRAITE, L'EXPLOITATION ET LE TRAVAIL DES ENFANTS
229
SECTION II. LES JURIDICTIONS SPECIALISEES POUR ENFANTS
234
§ 1. LES JURIDICTIONS COMPETENTES EN
MATIERE
CONTRAVENTIONNELLE ET DELICTUELLE 234
A. LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE 234
B. LE TRIBUNAL POUR ENFANTS 236
C. LE JUGE DES ENFANTS 246
§ 2. LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, UNE
JURIDICTION SPECIALE
COMPETENTE EN MATIERE CRIMINELLE 248
A. LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS
249
B. LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS
252
1. La Compétence ratione loci
253
2. La compétence ratione personae
253
3. La compétence ratione materiae
255
Chapitre II : L'IMPORTANCE VARIABLE DES INSTITUTIONS
D'APPUI ET DE
CONTROLE 259
SECTION I. LE ROLE D'APPUI DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES ET
PRIVEES 260
§ 1. LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES COMPETENTES
EN MATIERE
DE DROITS DE L'ENFANT 260
A. LE ROLE ESSENTIEL DE L'UNICEF 261
1. Présentation du rôle de l'UNICEF dans la
protection des droits de l'enfant 261
2. Les actions de l'Unicef en Côte d'Ivoire
265
B. L'ACTION COMPLEMENTAIRE DES AUTRES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES : CAS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL ET DE L'UNESCO 267
1. L'OIT, une structure de coopération efficace
dans le domaine du travail des
enfants 267
2. L'Unesco, une structure de coopération
efficace au niveau du droit à
l'éducation 275
§ 2. LES INSTITUTIONS DE LA SOCIETE CIVILE
280
A. UN ROLE INDISPENSABLE DES ONG 282
1. La sensibilisation 283
2. L'assistance juridique 284
3. L'assistance psychologique et matérielle
285
B. LES LIMITES DE CES ACTIONS 286
1.
739
Des organisations pauvres et dépendantes
286
2. Des associations à organisation administrative
et financière aléatoire 287
3. Des structures non spécialisées et
cacophoniques manquant de coordination
288
4. De l'insuffisance du personnel qualifié
à une forte concentration des activités
des ONGs à Abidjan 289
SECTION II. LE ROLE MITIGE DES ORGANES DE CONTROLE
291
§ 1. DES GARANTIES QUASI-JURIDICTIONNELLES PEU
SOLLICITEES 291
A. L'IRREGULARITE DES RECOURS 292
1. La quasi inexistence du recours universel
293
2. L'inertie du recours régional 300
B. L'INEFFICACITE DES RECOURS 309
1. Une inefficacité tenant à la nature des
organes de contrôle 309
2. Une inefficacité tenant à la
portée de ses décisions 313
§ 2. DES GARANTIES JUDICIAIRES PEU EXPLOITEES
315
A. LA SEULE OPTION DES ORGANES JUDICIAIRES A COMPETENCE
GENERALE : UNE VOIE PEU SOLLICITEE 315
1. Une opportunité au regard de leurs
compétences 315
2. Une opportunité au regard de leurs
décisions à caractère contraignant 328
B. DES RECOURS DIFFICILEMENT ACCESSIBLES 329
1. Les obstacles aux communications individuelles devant
la Cour africaine 329
2. Les obstacles liés à la
recevabilité : l'épuisement des voies de recours
internes
331
3. Les handicaps propres à la CPI inhibant son
efficacité 335
CONCLUSION DU TITRE 2 339
SECONDE PARTIE : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DES
DROITS DE
L'ENFANT A L'EPREUVE DES REALITES LOCALES 341
Titre I : DES MANIFESTATIONS PREOCCUPANTES DE
L'INEFFECTIVITE 343
Chapitre I : LES ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT EN
PERIODE DE PAIX
346
SECTION I. DES ATTEINTES LIEES A LA VIE ET AU
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL DE L'ENFANT 347
§ 1. DES MANIFESTATIONS DES VIOLATIONS AFFECTANT
L'EXISTENCE
ET LA SURVIE DE L'ENFANT 347
A. LES ATTEINTES AU DROIT A L'IDENTITE ET A LA NATIONALITE
DES
ENFANTS, UNE NEGATION DU DROIT A L'EXISTENCE JURIDIQUE
347
1. Des enfants non déclarés
347
2. Des enfants apatrides 350
B. LES ATTEINTES AU DROIT A LA SANTE ET A UN
ENVIRONNEMENT
SAIN DE L'ENFANT 357
§ 2. LES ATTEINTES AU DROIT A L'EDUCATION ET AU
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL DE L'ENFANT 366
A.
740
LES ATTEINTES AU DROIT A L'EDUCATION 366
B. UN FAIBLE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES D'EVEIL
372
C. LE MARIAGE FORCE ET/OU PRECOCE : UNE
PRATIQUE
TRADITIONNELLE NEFASTE 373
§ 3. DES ATTEINTES AUX FORMES DE PARTICIPATION DE
L'ENFANT 381
A. LA QUASI INEXISTENCE DU DROIT A LA PARTICIPATION AU
NIVEAU
FAMILIAL ET SCOLAIRE 382
1. Un faible niveau de participation à la vie
familiale 382
2. Un faible niveau de participation à la vie
scolaire 383
B. L'EXCLUSION DE TOUTE PARTIPATION A LA VIE PUBLIQUE
ET
SOCIO-ECONOMIQUE 385
1. Une faible participation à la vie publique
politique et associative 385
2. Une participation à la vie économique
comme obligation familiale 387
3. Une faible participation aux services sociaux de base
387
SECTION
II. LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE TOUTES
FORMES
D'ABUS 391
§ 1. LES ABUS TOUCHANT LES ENFANTS DES RUES
391
A. DEFINITION DE LA NOTION D'ENFANTS DES RUES
392
B. LES DIVERS ABUS PORTES AUX ENFANTS DANS LES RUES
393
§ 2. LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS : UN
TRAITEMENT
INHUMAIN DE L'ENFANT 396
1. Les formes classiques de travail des enfants
396
2. Le cas particulier de l'exploitation sexuelle des
enfants 400
§ 3. LA TRAITE DES ENFANTS, UN DENI DE LA NATURE
D'ETRE HUMAIN
DE L'ENFANT 409
A. DEFINITION DE LA NOTION DE TRAITE DES ENFANTS
409
B. LES DIFFERENTES FORMES DE TRAITE DES ENFANTS
412
1. Existence d'une traite interne d'enfants
413
2. La traite transfrontalière d'enfants vers la
Côte d'Ivoire 415
Chapitre II : DES ATTEINTES D'UNE GRAVITE PARTICULIERE
EN SITUATION
DE GUERRE OU D'URGENCE 420
SECTION I. LA VIOLATION DES DROITS DU MINEUR EN
CONFLIT AVEC LA
LOI 423
§ 1. UNE PROTECTION INSUFFISANTE DU MINEUR LORS DE
L'EXERCICE
DES MISSIONS DE POLICE NATIONALE DE L'ETAT
423
A. DANS LE CADRE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
423
B. DANS LE CADRE DES RETENTIONS JUDICIAIRES
430
§ 2. LA SITUATION DU MINEUR INCARCERE
435
A. DES CONDITIONS CARCERALES GENERALEMENT PRECAIRES ET
DIFFICILES 436
1. La surpopulation 437
2. La question de l'insalubrité des locaux
d'emprisonnement 438
741
3. De la malnutrition à la permanence des maladies
441
B. LE CAS PARTICULIER DES JEUNES FILLES INCARCEREES
445
SECTION II. LES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS DE
L'ENFANT EN
PERIODE DE CONFLIT ARME 451
§ 1. L'EXPLOITATION MILITAIRE DE L'ENFANT DURANT LE
CONFLIT
ARME IVOIRIEN 453
A. L'ENROLEMENT DES ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMES
453
1. L'embrigadement ou endoctrinement idéologique
et le recrutement volontaire
des enfants 454
2. Le recrutement forcé ou obligatoire des
enfants 458
B. LA NATURE ET LES CONSEQUENCES DES ACTIVITES DE
L'ENFANT
RECRUTE 461
1. Les différentes formes de participation
461
2. L'impact sur l'intégrité physique et
morale de l'enfant 462
§ 2. LES ATTEINTES GRAVES AUX DROITS FONDAMENTAUX
DE
L'ENFANT DURANT LE CONFLIT IVOIRIEN 464
A. EN ZONE SOUS CONTROLE DES FORCES REBELLES
464
1. Des viols massifs 464
2. Des enfants victimes de traitements inhumains et
d'exécutions sommaires 468
3. La découverte de charniers d'enfants
475
B. EN ZONE SOUS CONTROLE GOUVERNEMENTALE 477
1. Des atteintes aux droits de l'enfant imputables aux
milices privées 479
CONCLUSION DU TITRE 1 491
Titre II : LES CONDITIONS D'UNE EFFECTIVITE AMELIOREE
492
Chapitre I : L'IDENTIFICATION DES CAUSES
D'INEFFECTIVITE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'ENFANT 494
SECTION I. LES CAUSES TENANT A LA COMPLEXITE DES REGLES
INTERNATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT ET A LA
CONCLUSION TARDIVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
495
§ 1. ANALYSE DE L'ARTICLE 4 DE LA CIDE COMME
FACTEUR EXPLICATIF
DE L'INEFFECTIVITE DES DROITS DE L'ENFANT
496
§ 2. DES CAUSES D'INEFFECTIVITE TENANT AUX
RETICENCES DE LA COTE D'IVOIRE A L'EGARD DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
DE
PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT 504
SECTION II. LES CAUSES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT A
LA SURVIE, AU
DEVELOPPEMENT ET A LA PARTICIPATION DES ENFANTS
507
§ 1. LES CAUSES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT A LA VIE
ET A LA
SURVIE DE L'ENFANT 507
A. LES RESISTANCES TENANT AUX PANDEMIES ACCABLANTES : LE
DEVELOPPEMENT DES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 507
1. Les maladies courantes 508
742
2. Les autres maladies attentatoires à la survie
de l'enfant (l'anémie, la
malnutrition, les maladies évitables, les maladies
diarrhéiques) 509
B. LES OBSTACLES SOUS-JACENTS A LA REALISATION DU DROIT A
LA
VIE ET A LA SURVIE DE L'ENFANT 511
1. Les résistances liées aux comportements
de la mère 511
2. Les difficultés d'accès aux services
sociaux de base 515
C. LES RESISTANCES STRUCTURELLES 519
1. Les facteurs liés à la gestion et
à l'inadaptation des politiques sanitaires et à
des contraintes économiques 519
2. Les pesanteurs socio-culturelles 520
§ 2. LES CAUSES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT AU
DEVELOPPEMENT DE
L'ENFANT 521
A. LES CAUSES INTRAFAMILIALES DE L'INEFFECTIVITE DU DROIT
AU
DEVELOPPEMENT 521
1. Les causes liées à l'environnement
familial et scolaire 521
2. Les autres causes imputables à la famille
522
3. Les causes imputables aux enfants 525
B. LES CAUSES EXTRA FAMILIALES 526
1. Les causes directes imputables à la
communauté 526
2. Les causes tenant à l'insuffisance des
services sociaux de base 531
3. Les causes tenant à l'inadéquation des
services sociaux de base 535
4. Les contraintes socio-économiques et
culturelles affectant le développement
optimal de l'enfant 536
§ 3. LES CAUSES LIEES A LA FAIBLE PARTICIPATION DES
ENFANTS 541
A. LES CAUSES IMMEDIATES 541
1. Une faible implication communautaire 541
2. L'ignorance des enfants de leurs droits
542
3. De l'absence de prise de conscience des enfants de
leur rôle à la crise de
confiance et la recherche du gain immédiat
543
B. LES CAUSES SOUS-JACENTES 543
1. Le faible niveau d'éducation des parents et
une faible collaboration entre
parents et enseignants 544
2. Un accès limité et une faible
implication à la diffusion de l'information 545
3. La faiblesse des réseaux d'association
d'enfants 545
C. LES CAUSES STRUCTURELLES 546
1. L'influence des structures traditionnelles
d'éducation 546
2. La faiblesse du cadre institutionnel 547
SECTION III. LES CAUSES DES ABUS CONTRE TOUTES FORMES
DE
PROTECTION DES ENFANTS 547
§ 1. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA DESHERENCE DES
ENFANTS 547
A. LA RUPTURE AVEC LA FAMILLE ET LES MAUVAIS
TRAITEMENTS
DES ENFANTS 548
B. 743
LES MAUVAISES CONDITIONS DE VIE ET LA
SOUS-SCOLARISATION
DES ENFANTS 549
C. LES MULTIPLES RESISTANCES DE NATURE STRUCTURELLE
549
§ 2. LES CAUSES DE L'EXPLOITATION ECONOMIQUE ET
SEXUELLE DES
ENFANTS 553
A. LES CAUSES DU TRAVAIL ET DE LA TRAITE DES ENFANTS
553
1. Les résistances d'ordre immédiat
553
2. Les causes sous-jacentes de la persistance du travail
des enfants 556
3. Les résistances structurelles à la
lutte contre le travail des enfants 559
B. LES RESISTANCES TENANT A LA PERSISTANCE DES SEVICES
ET
EXPLOITATIONS SEXUELS 561
1. Les mauvaises conditions de vie et une
sexualité précoce et non maitrisée 561
2. Les dysfonctionnements familiaux et le travail
domestique des enfants 562
3. Les résistances d'ordre structurel
562
§ 3. LES CAUSES DE LA PERSISTANCE DU PHENOMENE DES
ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI OU DES ATTEINTES AUX DROITS DES ENFANTS
EN
PERIODE DE CONFLIT ARME 564
A. LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA PERSISTANCE DU
PHENOMENE
DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI 564
1. Les facteurs immédiats 564
2. Les causes lointaines de la pérennisation des
enfants en conflit avec la loi 566
B. LES CAUSES DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'ENFANT EN
PERIODE DE CONFLIT ARME 567
Chapitre II : LES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR D'UNE
EFFECTIVITE
AMELIOREE 570
SECTION I. UNE REFORME PROFONDE DE LA STRATEGIE DE
PRISE EN
CHARGE DES ENFANTS 572
§ 1. UNE ADAPTATION NECESSAIRE DU CADRE JURIDIQUE
ET
FONCTIONNEL 572
A. UN CADRE JURIDIQUE PLUS RENFORCE 572
1. La mise en conformité du cadre
législatif avec les normes et standards
internationaux 573
2. La mise en conformité du cadre
réglementaire national avec les normes et
standards internationaux 577
B. UN FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL PLUS EFFICACE
578
1. Le renforcement des compétences par les
formations initiale et continue 578
2. La nécessaire amélioration du
système de prestation de services 581
3. Une nécessaire mise en place d'un
système d'information, suivi et évaluation
en matière de droits et de protection de l'enfant
583
§ 2. L'UTILITE D'UNE NOUVELLE COORDINATION ET
D'UNE MEILLEURE
MOBILISATION DES FINANCEMENTS 585
A. L'ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME EFFICACE DE
COORDINATION
DES ACTIONS 585
B.
744
LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS EFFICACES
589
C. L'AUGMENTATION DES FINANCEMENTS NECESSAIRES
592
SECTION II. UNE PLUS GRANDE PRIORITE A DONNER AUX
ACTIONS DE
PREVENTION DES ATTEINTES AUX DROITS DE L'ENFANT
593
§ 1. LA PREVENTION PAR DES ACTIONS DE PLAIDOYER ET
DE
SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES 593
A. L'INSTAURATION D'UNE CULTURE DE DEBAT SUR LES
ATTEINTES
AUX DROITS DE L'ENFANT 594
B. UN APPUI RENFORCE AUX STRUCTURES COMMUNAUTAIRES
597
§ 2. LA PREVENTION DE LA VIOLENCE INSTITUTIONNELLE
ET DES
COMPORTEMENTS A RISQUE 602
A. UNE PROTECTION PARTICULIEREMENT STRICTE DES
ENFANTS
DANS LES INSTITUTIONS D'ACCUEIL 603
B. UNE ATTENTION ACCRUE AUX COMPORTEMENTS A RISQUE DE
LA
PART DES ADOLESCENTS 604
SECTION III. UN RENFORCEMENT BENEFIQUE DES MESURES
D'ASSISTANCE
AUX ENFANTS VICTIMES 606
§ 1. DANS LE CADRE DE LA DETECTION ET LA PRISE EN
CHARGE DES
CAS DE VIOLENCE 606
A. DES METHODES DE DETECTION ET DE SIGNALEMENT
PLUS
PERFECTIONNEES 606
B. UNE MEILLEURE ADAPTATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR
LA
CREATION DE SYSTEMES LOCAUX 612
§ 2. LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE SUBSTITUTION
POUR LES
ENFANTS PRIVES DE PROTECTION PARENTALE 618
A. LES DIFFERENTES FORMES DE SUBSTITUTION
SUSCEPETIBLES
D'ETRE ENVISAGEES 620
B. UNE PROTECTION DE SUBSTITUTION CONDITIONNEE PAR UNE
MEILLEURE IMPLICATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET
JUDICIAIRES 623
§ 3. DES CONDITIONS EFFICACES DE LUTTE CONTRE
L'IMPUNITE 625
A. UNE INCITATION AU RECOURS SYSTEMATIQUE A LA JUSTICE
625
B. LA SOUMISSION DES ENFANTS A DES MESURES DE
PROTECTION
LORS DES POURSUITES 628
CONCLUSION DU TITRE 2 630
CONCLUSION GENERALE 633
ANNEXES : 637
Annexe 1 : Processus de résolution de conflit
ou de problème au niveau
communautaire 637
Annexe 2 :
Protection des enfants victimes au contact des forces de
sécurité 638
ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX
POPULATIONS ET ACTEURS
DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT EN CÔTE
D'IVOIRE 639
BIBLIOGRAPHIE 650
I-
745
DICTIONNAIRES ET LEXIQUES 650
II- OUVRAGES GENERAUX 652
III- OUVRAGES SPECIALISES 660
IV- THESES ET MEMOIRES 669
V - ARTICLES, Chroniques, observations, Notes
675
VI - ACTES DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 700
VII - DOCUMENTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
701
VIII - DOCUMENTS DE L'UNION AFRICAINE 706
IX - TEXTES OFFICIELS 707
X - JURISPRUDENCE 717
XI - JOURNAUX ET PERIODIQUES 722
XII - SITES INSTITUTIONNELS 724
INDEX 725
LES DROITS DE L'ENFANT EN COTE D'IVOIRE : ENTRE
NORMES
INTERNATIONALES ET REALITES LOCALES
Les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire sont soumises
à une tension constante et fragile entre les normes internationales qui
proclament ces droits et assurent leur garantie et les réalités
locales qui sont celles d'un pays en développement. De surcroît,
la Côte d'Ivoire a rencontré depuis plus de dix ans de graves
problèmes d'instabilité politique et sociale à cause d'une
crise armée qui a déstabilisé les régimes de
protection dans tous les domaines où ceux-ci existaient auparavant. La
situation de la protection des droits de l'enfant, essentiellement d'origine
internationale et placée à ce titre, sous un contrôle
international pouvait-elle échapper à ce contexte ?
La thèse montre que l'intégration dans le droit
national ivoirien des normes internationales de protection à travers une
large participation de la Côte d'Ivoire à la plupart des
instruments protégeant tant les droits de l'Homme en
général que les droits de l'enfant en particulier, de même
que la traduction nationale de ces droits selon les exigences
constitutionnelles dans une importante législation pourraient donner une
image d'effectivité. Cette image est cependant fausse.
L'effectivité de ces droits, lorsqu'elle est mise à
l'épreuve des réalités du pays, tombe sous le poids des
manifestations des violations aussi diverses qu'inacceptables. C'est pourquoi
des mesures pour une effectivité améliorée sont
préconisées. Leur mise en oeuvre pourrait garantir un meilleur
avenir à tous les enfants de la Côte d'Ivoire.
Mots clés : droits de l'enfant,
santé, effectivité, éducation, conflit armé,
violations, responsabilité, dignité, droits fondamentaux,
égalité, enfant, existence, instruments juridiques,
intérêt supérieur de l'enfant, justice des mineurs,
protection, Adoption, comité international des droits de l'enfant,
parole de l'enfant, normes internationales, réalités locales,
détention, dignité, garde à vue, privation de
liberté.
CHILDREN RIGHTS IN IVORY COAST : BETWEEN
INTERNATIONAL
STANDARDS AND LOCAL REALITIES
Children's rights in Ivory Coast is subject to a constant and
fragile tension between the international standards that proclaim these rights
and guarantee them and the local realities that are those of a developing
country. In addition, for more than ten years, Ivory Coast has faced serious
problems of political and social instability because of an armed crisis that
has destabilized protection regimes in all areas where they previously existed.
Could the situation of the protection of the rights of the child, mainly from
international origin and placed under international control, escape this
context?
The thesis shows that the integration into Ivorian national
law of international standards of protection through a wide participation of
Ivory Coast in most instruments protecting both human rights in general and the
rights of the child in particular, just as the national translation of these
rights according to constitutional requirements into important legislation
could give a sense of effectiveness. However, this feeling is fake. The
effectiveness of these rights, when challenged by the realities of the country,
falls under the weight of manifestations of violations as diverse as
unacceptable. This is why measures for improved effectiveness are recommended.
Their implementation could guarantee a better future for all children in Ivory
Coast.
Key words : Children's rights, health,
Effectiveness, education, armed conflict, violations, accountability, dignity,
fundamental rights, equality, child, existence, legal instruments, best
interest of the child, juvenile justice, protection, privacy, adoption,
committee on the rights of the children, views of the child, international
standards, local realities, arrest, dignity, police custody, deprivation of
liberty.
|
|



