1. De la région au territoire
L'utilisation du terme territoire dans le vocabulaire
géographique est récente. Selon certains auteurs comme (Di
méo,1998, Chivalon,1999) cités par (Ripoll & Veschambre,
2015), l'apparition importante du terme en géographie peut toutefois
être attribuée à Claude Raffestin avec la parution de
« pour une géographie du pouvoir » en 1980. Cependant pour
Bernard Elissalde (2002) : « c'est plutôt du côté du
groupe Dupont, avec l'édition 1982 de Géopoint « Les
territoires de la vie quotidienne » qu'il faut rechercher l'entrée
officielle du territoire en géographie. Parmi ces pionniers du
territoire, il faut également mettre en avant Joël Bonnemaison qui
dès 1981 a publié « Voyage autour du territoire dans
l'Espace géographique » (Ripoll & Veschambre, 2015). De ce
fait, la décennie 1980 est caractérisée par des usages
pionniers du territoire dans les différents travaux. Cependant, à
cette période sur la totalité des travaux en géographie
l'« espace » et la « région » l'emportent nettement
sur le « territoire » comme l'affirme les auteurs :
« Dans le catalogue de l'UFR de géographie de
l'Université de Caen, les trois premiers ouvrages dont le titre comporte
territoire (en dehors de l'expression aménagement du territoire) sont
parus en 1980, 1981 et 1982, mais pour un total de 10 ouvrages seulement
classés en géographie sur l'ensemble de la décennie. De
même, dans les intitulés de DEA, espace l'emporte encore
très largement sur territoire en 1989 » (Ripoll & Veschambre,
2015).
Seuls les intitulés de colloque, logiquement le premier
canal de diffusion large des modes et paradigmes, enregistrent plus nettement
ce succès naissant et le favorisent : alors que le territoire est
totalement absent des intitulés de la période 1980-1981, 10 ans
plus tard, il est aussi prisé que l'espace et devance déjà
la région, comme indiqué dans le tableau suivant :
8
Années
|
1980/1981
|
1989/1990
|
2000/2001
|
|
Région et dérivés
|
2
|
6
|
0
|
|
Espace et dérivés
|
4
|
10
|
14
|
|
Territoire et dérivés
|
0
|
9
|
23
|
|
Nombre de colloques répertoriés
|
49
|
163
|
123
|
Tableau 1 : Les notions de régions, espaces et
territoires dans les intitulés de colloque ( Bulletin d'intergéo
cité par Ripoll & Veschambre, 2015, p. 271? 291)
Dans le tableau au début de la décennie 1980, la
notion de région et dérivés est en régression 2
contre 4 pour espace et dérivés et 0 pour territoire et
dérivés. C'est au début de la décennie 1990, qu'on
aura l'usage du territoire et dérivés dans les colloques. Il faut
attendre la décennie 2000 pour voir l'ancrage de la notion de territoire
et dérivés dans les colloques et l'usage confirmé de la
notion de l'espace et la disparition de la notion de région et ses
dérivés dans les colloques. L'usage de la notion du territoire ne
se fera pas sans conséquence.
Ainsi, en 2001 lors des concours, les épreuves de la
géographie régionale seront remplacées par la
géographie des Territoires comme cela a été indiqué
par (Ripoll & Veschambre, 2015).
En géographie, le territoire est tout espace
approprié. De ce fait, tout est territoire. Selon, l'usage premier du
mot territoire à l'époque moderne, Maryvonne Le Berre donne trois
éléments qui peuvent définir un territoire. La
domination (le pouvoir) qui s'exerce sur une aire
géographique qui a des limites. Dans ce cas, une portion
de l'espace devient un territoire (Le Berre, 1995, p. 603). Cette
définition du territoire peut être recevable dans une certaine
approche du territoire. Dans leur dictionnaire, Jacques Lévy et Michel
Lussault (2003) donnent d'abord, huit premiers sens au mot territoire. Ensuite,
ils font des critiques de chacune d'elle. De ce fait, une définition
unique du territoire se placerait probablement en porte-à-faux par
rapport aux autres définitions. Néanmoins, les auteurs vont
proposer une neuvième définition. À partir de quatre
approches se sont le « territoire » comme la forme matérielle
et symbolique, le « territoire » comme forme d'appropriation et le
« territoire » comme configuration spatiale puis le « territoire
» comme l'auto-référence. Pour les auteurs, le territoire
est un espace approprié qui permet la construction identitaire et existe
à des scalaires différentes. Quant à (Brédif,
2021), il développe aussi quatre approches du territoire. Selon lui, le
territoire est d'abord les limites du territoire de répartition des
éléments biophysiques (plantes ou les animaux) ; c'est aussi
l'espace juridico-politique de (l'État-nation), où l'État
exerce son autorité politique ; ensuite c'est un lieu d'appropriation et
de la construction identitaire individuelle ou collective et enfin c'est aussi
un ensemble de lieux interconnectés dans le système de la
mondialisation économique. Par ailleurs, l'entrée du
9
territoire par « l'espace » est un territoire
cartographiable (Pesqueux, 2009) c'est le territoire administratif. Le
territoire fait objet de découpage administratif. La souveraineté
et l'autorité d'un État s'exerce sur ce territoire. De là,
il a des frontières plus ou moins formelles. Il est
désigné comme un espace délimité où vivent
les gens sous une autorité politique. Ainsi, l'État se
légitime d'une part, de l'intérieur en soumettant sa population
sous son autorité et d'autre part, de l'extérieur en se faisant
reconnaitre par les autres États. Nous avons l'approche du territoire
comme un système. Ainsi, les auteurs comme Elsa Filâtre, (2021) et
Alexandre Moine (2006) considèrent le territoire comme un système
complexe. Ce système est évolutif et composé d'acteurs,
d'espace géographique et de systèmes de représentations.
La géographie est une science du territoire, différencié
de lieux reliées par un réseau (Brunet, 1995). La
différenciation des lieux suppose une production spatiale. Le territoire
est aménagé en des lieux différents pour des objectifs
différents et tous ceux-ci bien agencés et organisés pour
former des réseaux. Ce territoire s'appuie sur la théorie de
l'allemand Christaller. C'est le lieu de la réalisation des projets, des
rapports de force sur l'objet. La chose « territoire » devient un
enjeu et source de conflit.
Le territoire est fait d'espace culturel et de symbole
identitaire. Autrement dit, c'est un espace de représentation sociale.
Il se construit à partir d'un attachement et de sentiment d'appartenance
autour d'un paysage très souvent sacralisé. Le territoire
vécu est un territoire où vivent la population. La population est
enracinée à ce territoire qui est au coeur de son
identité. Chaque communauté se singularise par son
identité sur un territoire donné. Ainsi sur ce territoire,
l'identité résulte d'un sentiment d'appartenance de la
collectivité à des formes spatiales particulières. Ce
sentiment d'appartenance partagé par le collectif permet l'unité
sur ce territoire. Ainsi, le territoire est d'abord un lien avant d'être
une frontière. Le territoire est avant tout un lieu d'identification ou
d'appartenance ; l'appropriation se positionne au second plan (Bonnemaison et
al., 1995). Ces auteurs ont donné une définition plus ou moins
complète du territoire. Le territoire est un géo-système,
un espace approprié et constitué de différents lieux (Da
cunha, 2021, p. 14 cité par Hertig, 2012). C'est dans la même
logique mais avec une définition plus élaborée que Guy Di
Méo (1996, p. 40) affirme que : « Le territoire est une
appropriation à la fois économique, idéologique et
politique de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation
particulière d'eux-mêmes, de leur histoire et de leur
particularité. » Dans cette approche de Guy Di Méo, nous
retrouvons les trois approches épistémologiques du territoire
dans le cadre éducatif comme développé par (Girault &
Barthes, 2016).
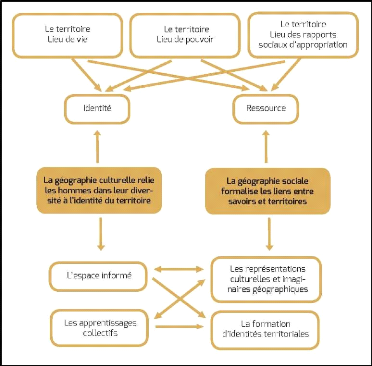
10
Figure 1 : Les différentes acceptations du territoire
(Girault & Barthes, 2016)
Ainsi, comme le présente la figure, le territoire est
soit un lieu de vie, soit un lieu de pouvoir ou encore un lieu des rapports
sociaux. Le territoire est un concept englobant en géographie. Dans
cette étude, je vais m'intéresser au territoire dans une approche
identitaire.
| 


