2. Objectifs et hypothèses de recherche
2.1. Objectifs de recherche
Objectif général
-Montrer que le lien entre identité et territoire est
faible dans la géographie scolaire ivoirienne.
Objectifs spécifiques
-Montrer que le concept d'identité prend de multiples
facettes dans les manuels scolaires ivoiriens.
-Montrer que les élèves ont une meilleure
perception du paysage des régions forestières que celle des
régions savanicoles ivoiriennes.
2.2. Hypothèses de recherche
Hypothèse générale
-Le lien faible entre identité et territoire dans la
géographie scolaire ivoirienne est lié à la volonté
politique éducative ivoirienne.
Les autorités éducatives décident
d'occulter l'étude de l'identité. Elle est une question
socialement vive en Côte d'Ivoire. Pour cela, le territoire n'est pas
pris dans toute sa dimension dans la géographie scolaire.
43
Hypothèses spécifiques
-Le concept d'identité dans les manuels scolaires a de
multiples facettes parce que dans les manuels scolaires l'identité n'est
pas que territoriale. Elle est aussi polarisée.
Dans la géographie scolaire bien que le concept
d'identité ne soit pas traité officiellement. Les auteurs vont
privilégier une idéologie religieuse catholique dans les contenus
du manuel d'un côté et d'un autre côté,
l'étude de l'économie de la Côte d'Ivoire sera
polarisée sur les paysages identitaires et les produits agricoles
identitaires de la région du Sud.
- Les élèves ont une meilleure perception des
paysages de la région forestière contrairement à la
région savanicole de la Côte d'Ivoire à cause de la
manière dont le concept d'identité est enseigné dans les
manuels scolaires de géographie et des facteurs sociaux.
L'enseignement du concept d'identité fait que les
élèves connaissent mieux la région du Sud. Dans les
manuels scolaires, l'identité est enseignée à travers le
développement des activités économiques du pays. Pourtant
dans les manuels, ces activités sont focalisées sur la
région forestière. Les paysages identitaires et les produits
identitaires agricoles de la région forestière sont plus promus
dans les manuels et dans la société ivoirienne.
3. Ma posture de recherche : praticien-chercheur ou
prof-chercheur
La posture de praticien-chercheur est un analyseur « qui
met en relief beaucoup de questions et de situations qui se posent à
tout chercheur » (De Lavergne, 2007). Dans le cas d'un enseignant, «
la recherche peut avoir une foison de finalités dont le changement de
paradigme, l'adaptation de stratégies de façon contextuelle, des
propositions curricula » (Kouadio, 2022, p. 35) et des analyses de manuels
scolaires. La posture de « praticien-chercheur » est un professionnel
et un chercheur qui mène des recherches dans son domaine professionnel
ou dans un domaine professionnel similaire. Ainsi, l'expression de «
praticien-chercheur » signifie qu'une double identité est
revendiquée, sans que l'une des deux prennent le pas sur l'autre (De
Lavergne, 2007, p. 29). En effet, pour l'auteure il y a une
égalité entre deux postures et aussi une
simultanéité entre les deux mondes comme si c'était le cas
d'un doctorant-praticien-chercheur définit par (De Saint-Martin et al.,
2014). Par ailleurs, pour ces auteures « le praticien-chercheur est un
praticien devenu chercheur » (De Saint-Martin et al., 2014, p. 4),
c'est-à-dire un professionnel qui devient un chercheur. Un
praticien-chercheur va entamer des recherches sur sa pratique professionnelle
au quotidien. « L'entrée en recherche du professionnel s'origine
dans sa
44
pratique et la nécessité ressentie d'approfondir
sa réflexion pour améliorer son travail. Sa recherche est donc
déterminée à la fois par ses intérêts
professionnels et sa curiosité intellectuelle » (De Saint-Martin et
al., 2014, p. 5). Dans le cadre de l'enseignement, la recherche va permettre
à l'enseignant de comprendre les objectifs implicites des notions et
concepts qu'il enseigne. Car, le chercheur analyse ce que le praticien ne voit
pas (De Saint-Martin et al., 2014, p. 6), il voit ce que le praticien ou le
professionnel ne voit pas. Le praticien et le chercheur n'ont pas
forcément les mêmes objectifs. Le professionnel a une
expérience sur le terrain que le chercheur n'a pas. Cela permet au
chercheur de recadrer et de se poser les bonnes questions. «
L'expérience du praticien alimente les questionnements du chercheur
» (De Saint-Martin et al., 2014, p. 8). Les résultats du chercheur
permettent au praticien de s'améliorer dans sa pratique professionnelle.
L'analyse du chercheur bouleverse les certitudes du praticien dans ses routines
quotidiennes (De Saint-Martin et al., 2014, p. 8). Dans ce cas, il n'y a pas de
rapport d'égalité entre les deux postures. Ma posture de
praticien ou de professeur m'a permis de travailler dans un milieu dont j'ai la
connaissance. Cela a facilité ma position de chercheur et en justifiant
mon objet de recherche (De Saint-Martin et al., 2014) et permis de faire une
enquête rapide. Quant à ma posture de chercheur qui est celui d'un
chercheur dont le champ de recherche porte sur le concept d'«
identité » qui sera analyser dans les manuels scolaires de
géographie et un questionnement a été adressé aux
élèves du secondaire. Par ailleurs, quand un professeur
(enseignant de Collège) entreprend une recherche sur son milieu
professionnel, il est un « professeur-chercheur » (Gaujal, 2016
cité par Kouadio, 2022). Ses implications et surimplications
opèrent un double mouvement, sur sa recherche et sur sa pratique (De
Saint-Martin, 2013, p. 461). Mes implications et surimplications se sont faites
à plusieurs niveaux. Dans chaque classe choisie pour mon enquête,
j'ai choisi de manière aléatoire 30 élèves dans
chaque classe. Ma posture de praticien (professeur) a profité à
ma posture de chercheur. Car lors de l'enquête, chaque jour, j'ai
regroupé 30 élèves dans une classe en leur remettant le
questionnaire. J'ai pris le temps de leur expliquer les enjeux de
l'enquête et à répondre aux préoccupations de
certains élèves. Et là, j'ai vu ma posture de praticien et
de chercheur s'entremêler. Les élèves étaient
surpris de ma posture de chercheur qui interdisait à ma posture de
praticien de ne pas citer d'exemples concernant certains points sur le
questionnaire comme le voulaient certains élèves.
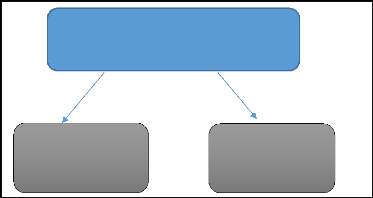
Dans les manuels scolaires
Praticien-chercheur ou prof-chercheur
Un questionnaire et
un entretien avec
les
élèves
45
Figure 10 : Les lieux d'exercice de ma posture de
praticien-chercheur
| 


